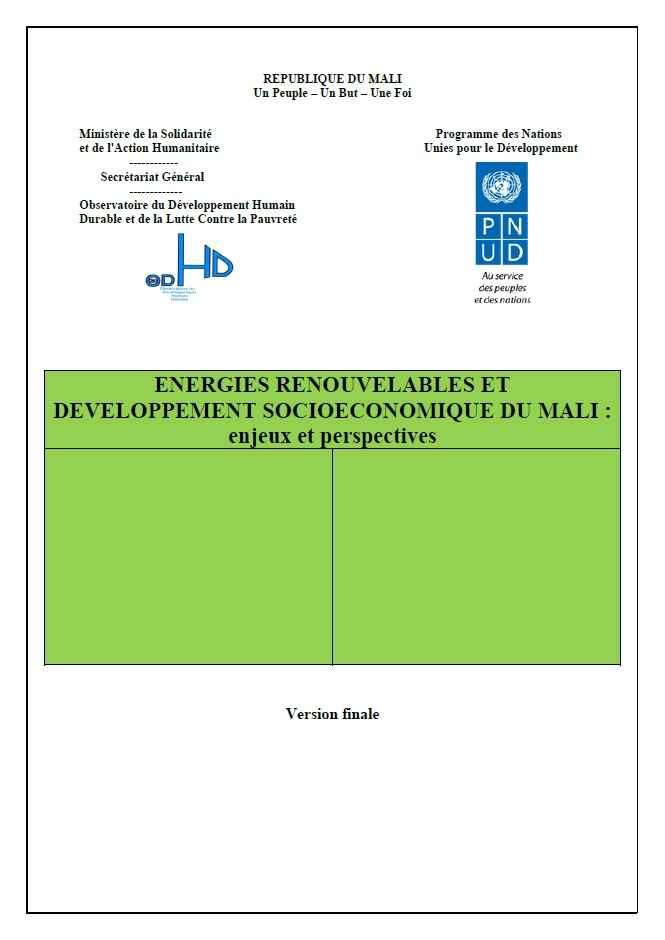REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Solidarité...
 |
REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Solidarité... |
 |
1 1 |
▲back to top |
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de la Solidarité Programme des Nations
et de l'Action Humanitaire Unies pour le Développement
------------
Secrétariat Général
-------------
Observatoire du Développement Humain
Durable et de la Lutte Contre la Pauvreté
ENERGIES RENOUVELABLES ET
DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DU MALI :
enjeux et perspectives
Version finale
 |
2 2 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 1
Dédicace
A notre défunt et regretté, Zoumana Bassirou FOFANA
qui, avec nous, a commencé l’élaboration de ce
rapport, mais n’a pas pu assister à son dénouement.
 |
3 3 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 2
EQUIPE D’ELABORATION
Supervision Générale
Hamadou KONATE Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire
Boubou Dramane CAMARA Directeur Pays du PNUD Mali
Coordination Technique
Samba Alhamdou BABY Secrétaire Général MSAH
Mohamed Oualy DIAGOURAGA Conseiller Technique MSAH
Zoumana B. FOFANA Directeur Général ODHD/LCP
Bécaye DIARRA Economiste Principal du PNUD
Alassane BA Economiste National du PNUD
Equipe ODHD/LCP
Personnel technique
Zoumana B. FOFANA Directeur Général
Diakaridja KAMATE Expert Économiste
Bouréma F. BALLO Expert Statisticien
Mody SIMPARA Statisticien
Ely DIARRA Économiste- Informaticien
Moussa HAIDARA Statisticien
Seydou MAGASSA Sociologue
Sogona Binta Fadd DIABY Socio-anthropologue
Aminata Ali TRAORE Economiste
Abdoulaye dit Noël CISSOKO Chargé de Communication
Ismaila COULIBALY Documentaliste
Administration et Gestion
Youssouf DIARRA Agent Comptable
Sabane Mahamane MAIGA Comptable Matière Adjoint
Adama M. DIAKITE Appui à la Comptabilité Matière
Madame NIARE Hawa KAREMBÉ Assistante d’équipe
Madame DIALLO Aminata TRAORE Secrétaire
Equipe PNUD
Bécaye DIARRA Economiste Principal du PNUD, Unité économique
Alassane BA Economiste National du PNUD, Unité économique
Comité Scientifique élargi
Président
Mohamed Oualy DIAGOURAGA MSAHRN
Membres
M. Zoumana B. FOFANA ODHD/LCP
M. Aboubacar S. SACKO DNPD
M. Amadou B. COULIBALY DNDS
Pr Cheick Hamallah BARADJI CNRST
Mme Zéinabou DRAME IER
M. Ishaga COULIBALY DNP
M. Bandiougou DIARISSO INSTAT
M. Sogo COULIBALY DNPSES
M. Lassana SACKO DGB
M. Yaouaga Félix KONE ISH
M. Adama BARRY CT-CSLP
M. Sadou YATTARA CERCAP
M. EL HADJ Oumarou Malam SOULE AFRISTAT
M. Abdoulaye BAYOKO PNUD
M. Alassane BA PNUD
M. Arsène R. KAHO Banque Mondiale
M. Naffet KEITA ULSHB
M. Bréhima S. DIALLO UNICEF
Dr Mamadou Fadiala SISSOKO INRSP
M. Adama KONATE BSTP-Mali (CNPM)
M. Mohamed OUEDRAOGO CPS/SME
M. Assékou AHMADOU CPS/SICAEPIP
M. Sanidié TOURE IERGG- Maison des Aînés
M. Minemba TRAORE BAD
M. Modibo SYLLA USTTB
M. Djibril SOW USJPB
M. Abdrahamane COULIBALY AEDD
M. Ibrahim Chicode YATTARA EDM SA
M. Mahia AKLININE DNI
M. Mahamadou KANTA AMADER
 |
4 4 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 3
M. Gaoussou KONE ONAP
Mme. Haby SOW TRAORE ONUDI
M. Baba dit Yahya SIDIBE AMARAP
M. Madani M. DIALLO ANADEB
M. Béïdari TRAORE AER-Mali
M. Yahaya KANE APCAM
M. Ahmadou Mahamane ASCOFARE CPS/SDR
M. Sidy KEITA DNA
M. Cheick Oumar TOURE USSGB/SREC
Dr Karounga KEITA Wetlands International Mali
Mme SANOGO Farima KEÏTA CPS/SEEUDE
M. Souleymane CAMARA CPS/SCI
M. Abou SIDIBE CPS/SATSIFP
M. Lassine SIDIBE CPS/SE
M. Antonin Sambaly KEÏTA CPS/SCJ
Mme TRAORE Fatoumata BERTHE CPS/SSDSPF
M. Abdourahamane SISSOKO CNDIFE
M. Salif DIALLO Personne ressource
M. Mohamed DIALLO Personne ressource
Comité de lecture
Mme Maïmouna K. TRAORE CT-CSLP
M. Mohamed OUEDRAOGO CPS/SME
Consultants
Dr Mansa KANTE Spécialiste Energie
M. Mamadou MAGASSA Macro économiste
 |
5 5 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 4
PREFACE
 |
6 6 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 5
Table des matières
EQUIPE D’ELABORATION .............................................................................................................. 2
PREFACE .............................................................................................................................................. 4
LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................. 8
RESUME .............................................................................................................................................. 12
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 15
I. HISTORIQUE ............................................................................................................................. 18
II. CONTEXTE ................................................................................................................................. 19
2.1 Contexte international ........................................................................................................... 19
2.2 Contexte sous régional .......................................................................................................... 19
2.3 Contexte national ................................................................................................................... 21
III. PREMIERE PARTIE : DIFFÉRENTS TYPES D’EnR ET LEURS UTILISATIONS ........ 22
3.1 Energie solaire ....................................................................................................................... 23
3.2 Energie éolienne .................................................................................................................... 25
3.3 Energie hydraulique .............................................................................................................. 27
3.4 Biomasse ............................................................................................................................... 28
3.5 Énergie géothermique ............................................................................................................ 29
3.6 Utilisation des EnR dans le monde ........................................................................................ 31
3.7 Utilisation des EnR en Afrique.............................................................................................. 37
3.8 Problématiques liées à l’utilisation des EnR ......................................................................... 40
IV. DEUXIEME PARTIE : POLITIQUES ET STRATÉGIES .................................................... 43
4.1 Cadre législatif et règlementaire ............................................................................................ 43
4.2 Politique Energétique Nationale (PEN) ................................................................................. 44
4.3 Stratégies ............................................................................................................................... 46
4.4 Résultats de quelques projets EnR ........................................................................................ 52
4.5 Acquis des projets programmes ............................................................................................ 59
4.6 Impacts des EnR sur le développement socioéconomique des zones rurales ........................ 61
4.7 Difficultés pour la Promotion des EnR ................................................................................. 63
V. TROISIEME PARTIE : ENJEUX, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES ........................ 65
5.1 Enjeux .................................................................................................................................... 65
5.2 Contraintes ............................................................................................................................ 70
5.3 Perspectives ........................................................................................................................... 71
5.4 Recherche et Développement ................................................................................................ 84
VI. Energies Renouvelables, Développement Humain Durable et Réduction de la Pauvreté..... 86
6.1 Accès à l’éducation ............................................................................................................... 86
6.2 Accès à la santé ..................................................................................................................... 86
6.3 Accès des foyers à l’éclairage et aux modes de cuisson propres ........................................... 86
6.4 Accès à l’emploi .................................................................................................................... 87
6.5 Accès aux TIC ....................................................................................................................... 87
6.6 Energie pour gagner sa vie .................................................................................................... 87
6.7 Exploitation des terres ........................................................................................................... 88
 |
7 7 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 6
6.8 Transformation et commercialisation améliorées des produits agroalimentaires .................. 89
CONCLUSION .................................................................................................................................... 90
RECOMMANDATIONS .................................................................................................................... 90
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .......................................................................................... 92
ANNEXES ............................................................................................................................................ 93
ANNEXE 1 : Les objectifs nationaux pour une pénétration accrue et durable des énergies
renouvelables sont résumés dans les tableaux N°1 à N°5 ci-dessous : ............................................. 94
ANNEXE 2 : Liste des structures rencontrées .................................................................................. 96
ANNEXE 3 : Cadre législatif et règlementaire du secteur de l’énergie ............................................ 97
ANNEXE 4 : Dispositif institutionnel du secteur de l’énergie ....................................................... 101
ANNEXE 5 : Termes De Référence ................................................................................................ 102
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Cinq premiers pays producteurs de chaque type d’énergie renouvelable électrique
en 2013 ..................................................................................................................................... 33
Tableau 2: Puissance installée des énergies renouvelables (GW) en 2012 et 2013................ 34
Tableau 3 : Production énergétique mondiale commercialisée selon la source d'énergie ...... 35
Tableau 4 : Evolution de la puissance éolienne installée dans le Monde (MW) .................... 35
Tableau 5 : Evolution de la production éolienne d’électricité dans le Monde (TWh) ............ 35
Tableau 6 : Evolution de la production d’électricité solaire dans le monde (TWh) ............... 36
Tableau 7 : Principaux pays producteurs d’électricité géothermique en 2012 ....................... 36
Tableau 8 : Objectifs en production d’huile ........................................................................... 51
Tableau 9 : Objectifs en production de graines et superficie emblavée ................................. 51
Tableau 10 : Pourcentage des communes urbaines et rurales faisant usage des panneaux
solaires ...................................................................................................................................... 52
Tableau 11 : Réalisations du projet FENR ............................................................................. 54
Tableau 12 : Réalisations du projet FENR au titre des formations ......................................... 54
Tableau 13 : Résultat de l’électrification rurale de l’AMADER ............................................ 56
Tableau 14 : Impacts de quelques projets Energie Renouvelable ........................................... 61
Tableau 15 : Exécution budgétaire du secteur énergie (millions de FCFA) ........................... 64
Tableau 16 : Caractéristiques du projet PAPERM ................................................................. 75
Tableau 17 : Objectifs pour les énergies renouvelables raccordées au réseau ....................... 94
 |
8 8 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 7
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1 : Soleil, principale source des différentes formes d’énergies renouvelables disponibles sur
terre........................................................................................................................................................ 23
FIGURE 2 : Four solaire Global .......................................................................................................... 23
FIGURE 3 : Chauffe-eau solaire .......................................................................................................... 23
FIGURE 4 : Moulins à vent ................................................................................................................. 25
FIGURE 5 : Eolienne ........................................................................................................................... 25
FIGURE 6 : Champ éolien ................................................................................................................... 26
FIGURE 7 : Evolution de puissance installée éolien ........................................................................... 27
FIGURE 8 : Moulin à eau .................................................................................................................... 27
FIGURE 11 : Centrale géothermique de Nesjavellir en Islande. ......................................................... 29
FIGURE 10 : Les 10 pays les plus consommateurs d'électricité ......................................................... 34
FIGURE 11 : Evolution des parts de marché des principaux pays producteurs de cellules
photovoltaïques ..................................................................................................................................... 42
FIGURE 12 : Productions mensuelles d'une installation photovoltaïque de 1 kWcau Nord de
l’Allemagne ........................................................................................................................................... 70
FIGURE 13 : Projection de l’utilisation des EnR à l’horizon 2040 ..................................................... 83
 |
9 9 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 8
LISTE DES ACRONYMES
 |
10 10 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 9
Sigles Dénominations
ADEME Agence de Maîtrise d’Energie
AER-Mali Agence des Energies Renouvelables du Mali
AFD Agence Française de Développement
AFPPE Association Française des Professionnels du Petit Eolien
AIE Agence Internationale de l’Energie
AMADER Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de
l'Electrification Rurale
AMARAP Agence Malienne de Radioprotection
ANADEB Agence Nationale pour le Développement des Biocarburants
AUREP Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière au Mali
BNEF Bloomberg New Energy Finance (Institution de Financement)
BOOT Build Own Operate and Transfer
BRICS Brésil Russie Inde Chine et Sud Afrique
CEAO Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEREEC Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la
CEDEAO
CI Centre Isolé
CILSS Comité Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel
CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
CMDT Compagnie Malienne de Développement du Textile
CNESOLER Centre National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables
CPS/SME Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Mines et Energie
CREDD Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
CRE Commission de Régulation de l'Electricité (France)
CREE Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau
CRES Centre Régional d’Energie Solaire
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
DNE Direction Nationale de l’Energie
DNEF Direction Nationale des Eaux et Forêts
DNGM Direction Nationale de la Géologie et des Mines
ECOW-GEN Programme de la CEDEAO pour l’intégration du Genre dans l’Accès à l’Energie
EDM – SA Energie du Mali – SA
EE Efficacité Energétique
EnR Energies Renouvelables
EPIA European Photovoltaic Industry Association (Association Européenne de
l’Industrie Photovoltaïque)
EPR European Pressurized Reactor (Réacteur Pressurisé européen)
EUEI-PDF European Union Energy Initiative – Partnership Dialogue Facility
FEM - SPWA Programme Stratégique du Fonds Mondial pour l’Environnement pour l’Afrique de
l’Ouest
 |
11 11 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 10
GdM Gouvernement du Mali
GES Gaz à Effet de Serre
GIZ Coopération Technique Allemande
GMN Groupe Multisectoriel National de l'énergie
GWh Giga Watt heure
GWth Giga Watt thermique
GPOBA Global Partnership Output Based Aid (Partenariat Global Basé sur l’Aide
Extérieure)
INSTAT Institut National de la Statistique
IPP Independent Power Producer (Producteur Indépendant d’Electricité)
KFW Fonds Allemand pour les Financements extérieurs
IRENA Agence Internationale de l'Energie Renouvelable
kt Kilotonne
ktep Kilotonne Equivalent Pétrole
kWh Kilo Watt Heure
LESO Laboratoire d’Energie Solaire
LOA Loi d'Orientation Agricole
MASEN Agence Marocaine de l'Energie Solaire
MEE Ministère de l’Energie et de l'Eau
MEPRED Mainstreaming Energy for Poverty Reduction and Economic Development (Accès
à l’énergie et son intégration dans les stratégies de réduction de la pauvreté ainsi
que les programmes nationaux de développement économique et social)
MFC Mali Folk Center (ONG Malienne)
MW Méga-Watt
Mtep Million de tonne-équivalent pétrole
ODHD Observatoire du Développement Humain Durable
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
PANER Plans d’Action Nationaux des Energies Renouvelables
PANEE Plans d’Action Nationaux de l'Efficacité Energétique
PASE Projet d’Appui au Secteur Energie
PCV Période Couverture Végétale
PDER Plan Directeur d'Electrification Rurale
PEDASB Projet Energie Domestique et Accès aux Services de Base en milieu rural
PERC Politique des Energies Renouvelables de la CEDEAO
PDIO Plan Directeur des Investissements Optimaux
PDRM Programme pour le Développement des Ressources Minérales
PEN Politique Energétique Nationale
PERC Politique en matière d'Energies Renouvelables de la CEDEAO
PEEC Politique en matière d'Efficacité Energétique de la CEDEAO
PIB Produit Intérieur Brut
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PPP Partenariat Public Privé
RI Réseau Interconnecté
 |
12 12 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 11
RGPH 2009 Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2009
SAFE Solar Alliance for Europe
SDB Stratégie de Développement des Biocarburants
SEAF Sustainable Energy Asset evaluation and optimisation Framework
SED Stratégie Energie Domestique
SE4ALL Sustainable Energy for All (Initiative Energie Durable pour tous)
SHER Système Hybride d’Electrification Rurale
SREP Scaling up Renewable Energy Program in low income countries (Programme de
Valorisation à Grande Echelle des Energies Renouvelables)
TVA Taxes sur la Valeur Ajoutée
 |
13 13 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 12
RESUME
Le présent rapport d’étude sur « Energies Renouvelables et Développement
Socioéconomique du Mali : enjeux et perspectives » se situe dans un contexte particulier de
sortie d’une crise institutionnelle, politico-économique, sociale et sécuritaire.
Avec entre autres l’un des taux d’électrification le plus bas au monde (36,11 % au niveau
national, CPS du Secteur Mines et Energie, 2015), une exploitation abusive des ressources
ligneuses (bois et charbon de bois) dans un contexte de croissance démographique élevée, les
défis du secteur des énergies renouvelables au Mali sont nombreux.
Les orientations nationales en matière d'énergie sont globalement déclinées dans la Politique
Energétique Nationale (PEN) adoptée en mars 2006 par le Gouvernement du Mali, afin de
renforcer et de soutenir la contribution de l'énergie pour une meilleure croissance économique
et un développement socioéconomique durable du pays.
Les initiatives et perspectives de développement du secteur de l'énergie reposent sur le
renforcement et la diversification de l'offre énergétique pour satisfaire la demande d'énergie et
améliorer l'accès aux services de base des populations.
En matière d'énergies renouvelables, il s’agit de promouvoir une large utilisation des
technologies et équipements d’Energies Renouvelables (EnR) pour accroître la part des EnR
dans la production nationale d’électricité de (-1%) en 2004 à 6% en 2010 et 10 % en 2015.
Pour atteindre ces objectifs en matière de promotion d'énergies renouvelables, le Gouvernement
du Mali a aussi adopté en 2006, la Stratégie nationale de développement des énergies
renouvelables afin d'accroître durablement la part des EnR (hors grande hydroélectricité) dans
le bilan énergétique global du pays de (-1 %) en 2002 à 15 % en 2020.
En effet, cette étude se veut une meilleure contribution des Energies Renouvelables dans la
production d’énergie, une accessibilité facile et durable à ces énergies et une amélioration des
conditions de vie des populations.
La problématique des énergies renouvelables est de plus en plus positionnée dans un nouveau
paradigme du fait des nouveaux enjeux à l’échelle mondiale, continentale, nationale, voire
locale.
L’analyse qualitative, quantitative et géographique des enjeux pour les différentes filières
devrait amener à nuancer l’approche répandue selon laquelle les EnR sont avant tout un enjeu
pour le développement des pays du Sud. En effet, si l’on tient compte des besoins à satisfaire
dans les décennies à venir, les potentiels globaux raisonnablement mobilisables au Nord et au
Sud sont voisins, même s’ils sont très différentiés, filière par filière.
Par ailleurs, l’accès à ces potentiels renouvelables est beaucoup plus facile dans les pays du
Nord que dans les pays en développement. Si pour les premiers, le problème de l’introduction
des énergies renouvelables n’est principalement qu’une affaire de substitution sur un marché
existant, très développé et solvable ; pour les seconds il s’agit bien souvent de développer
 |
14 14 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 13
l’accession à des services énergétiques inexistants ou très insuffisants, en faveur de
consommateurs pauvres, dans des zones dispersées et dans des conditions techniques et de
risque défavorables, donc « qui pourra payer quoi, comment et quand ? », le coût de
développement des technologies EnR restant encore de nos jours assez élevé.
Les contraintes au développement des énergies renouvelables sont d’ordre institutionnel,
économique, financier, technique et social. On peut retenir entre autres :
la faible coordination entre l’ensemble des agences impliquées dans le développement
des EnR, la faiblesse des processus de planification, le manque d’un cadre pour le
partenariat public/privé spécifique pour les projets connectés au réseau, le déficit de
règlementation prenant en compte la vente du surplus d’un auto producteur EnR au
réseau ;
la faiblesse des institutions financières nationales, les coûts d’investissements élevés des
technologies EnR, les mesures incitatives financières peu attractives pour les
investissements du secteur privé et les difficultés à canaliser les sources de financement
internationales pour le développement à grande échelle des EnR ainsi qu’à taille réduite
pour le marché national ;
les capacités limitées des ressources humaines du secteur énergétique, le nombre limité
des études et évaluations d’impacts des EnR pour la production d’électricité,
saisonnalité de la production EnR, l’insuffisance d’unités locales de production
(Exemple : une seule unité de montage de composants des technologies d’énergie
renouvelable (HORONYA), l’absence de service après-vente ;
la sous information de la population sur les EnR et la faible prise de conscience par ces
derniers des opportunités et des défis des EnR.
En termes de perspectives : le développement des EnR, présente une chance pour l’humanité
en général et pour les peuples des régions bien ensoleillées et bénéficiant d’un bon potentiel
éolien, en particulier. Une coopération Nord-Sud volontariste et bien programmée dans le
domaine des énergies renouvelables, sera certainement fructueuse, mettra en exergue les
synergies et les complémentarités possibles et réduirait sensiblement le fossé qui sépare les pays
industrialisés de ceux en développement pour un avenir meilleur.
Une valorisation rationnelle et bénéfique des énergies renouvelables, nécessite une volonté
politique précise, bien développée et clairement exprimée.
En matière de Recherche Développement, il y a beaucoup d’avancées dans le domaine du
solaire photovoltaïque d’où une diminution constante des prix et une progression des
rendements. Il existe aussi des innovations au niveau d'autres éléments qui peuvent réduire le
coût global ou améliorer les fonctionnalités.
Au Mali, le Centre Régional de l’Energie Solaire (CRES), disposait d’un laboratoire de
recherche qui a fait ses preuves. Avec la fermeture du CRES, le Centre National de l’Energie
Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER) a élargi le domaine de ses recherches au
 |
15 15 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 14
solaire thermique notamment les cuisinières solaires, les séchoirs solaires et les chauffes eau
solaire.
Créée en 2014, l’Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER-Mali) s’attache à
inventorier et évaluer le potentiel du pays en la matière, à contribuer à la définition des stratégies
nationales, à mener des activités de recherche développement dans le domaine des énergies
renouvelables. Elle conduit des études et suit la mise en œuvre des projets d’énergies
renouvelables au profit des acteurs. Elle informe et sensibilise les promoteurs et les utilisateurs
d’équipements d’énergies renouvelables. Elle réalise des tests, contrôle la qualité et labélise
les équipements d’énergies renouvelables.
Des programmes de recherches devront être aussi menés dans les établissements
d’enseignement supérieur tant publics que privés. Dans le domaine de la recherche
développement, des partenariats doivent être noués avec les institutions de recherches et des
universités des pays qui sont leaders dans le domaine à l’échelle mondiale.
On peut affirmer sans risque de se tromper que les EnR ont pris un nouvel élan ces dix dernières
années et leur utilisation devient de plus en plus populaire à l’échelle individuelle et collective.
Le Mali et l’Afrique ne sont pas en reste de cette évolution comme en témoignent les différentes
initiatives en cours.
Enfin, des propositions de recommandations ont été formulées pour les différents acteurs en
vue d’une meilleure utilisation dans le cadre d’un développement socioéconomique durable.
 |
16 16 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 15
INTRODUCTION
L’Energie est un secteur à vocation économique et sociale, pourvoyeur de produits, de services
et de commodités. Elle a un caractère éminemment transversal et nécessaire à la plupart des
secteurs du développement socio-économique. L’énergie contribue de manière significative à
toutes les activités humaines pour l’atteinte de meilleures conditions de vie (Education, Santé,
Accès à l’eau potable, Activités génératrices de revenus, etc.). Elle peut prendre diverses
formes, provenir de différentes sources et faire l’objet de diverses transformations et
utilisations. Ainsi, l’eau, le rayonnement solaire, le mouvement du vent, la chaleur, le pétrole
et ses produits dérivés, le gaz, la biomasse, la géothermie et l’électricité, sont entre autres des
formes sous lesquelles l’énergie se présente habituellement.
Le Secteur de l’Energie couvre les produits et matières énergétiques (sources,
productions/traitements, cycles de transformation, transport, distribution, commercialisation,
utilisation et récupération), les mesures d’économie d’énergie, les acteurs institutionnels
impliqués, les commodités et économies engendrées et les mesures de sécurité requises.
Enfin, le rôle moteur mondialement reconnu au secteur de l’énergie pour le développement
équilibré et durable requiert, pour tout pays, l’établissement et la mise en œuvre d’une Politique
Energétique Nationale (PEN) cohérente et efficiente.
Avec la démographie galopante au Mali et le développement de l’activité économique, la
fourniture de l’énergie en quantité et en qualité est confrontée à d’énormes difficultés.
L'approche développée par le Gouvernement du Mali appuyée par les Partenaires au
développement dans le domaine énergétique, à travers des projets et programmes d’Energie
Renouvelable (EnR), tend à mettre un accent particulier sur l'utilisation des systèmes EnR pour
l'équipement des points d'eau, la réfrigération, la cuisine et le transport ainsi que l'électrification
du monde rural pour la satisfaction de ses besoins essentiels.
Le sous-secteur des Energies Renouvelables (EnR), dont il est question dans la présente étude
utilise des sources inépuisables d’énergies d’origine naturelle (soleil, vent, eau, biomasse, etc.)
qui sont très peu polluantes et bénéficient d'avancées technologiques et de processus de
développement.
Le recours croissant aux énergies traditionnelles dégrade l’environnement, fragilise
l’écosystème, accélère le réchauffement et le changement climatique, entraine des catastrophes
naturelles, des maladies, des crises alimentaires, etc. Ces effets néfastes se font sentir surtout
au niveau des couches les plus vulnérables (femmes, enfants, démunis, etc.). Compte tenu des
contraintes comme l’insuffisance des énergies modernes, les coûts élevés des réseaux de
distribution en milieu rural, la faible densité de peuplement font qu’un grand nombre de maliens
n’a pas accès aux services énergétiques modernes.
La méthode de vulgarisation massive du potentiel d’Energies Renouvelables disponible en
milieu rural est certainement la solution appropriée. Ainsi le modèle de Village Solaire dans les
 |
17 17 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 16
chefs-lieux de Communes peut jouer un rôle de premier plan dans la reproduction du modèle
au niveau des autres Communes et villages du pays.
L’objectif général de l’étude est de montrer le rôle et l’importance des Energies Renouvelables
(EnR) dans le développement socioéconomique et culturel du pays et assurer la promotion de
leur utilisation.
Les objectifs spécifiques visent à :
faire l’état des lieux de l’évolution des Energies Renouvelables ;
analyser brièvement les différentes politiques de l’énergie et les stratégies pour le
développement des EnR ;
identifier les contraintes, enjeux et opportunités des EnR ;
proposer les mesures nécessaires pour développer la recherche sur les technologies de
production d’EnR au Mali ;
proposer les perspectives et les mesures incitatives pour une plus grande utilisation des
EnR au Mali.
Les résultats attendus pour l’atteinte des objectifs spécifiques de l’étude sont :
les différents types d’EnR utilisés au Mali sont identifiés ;
les stratégies de mise en œuvre pour développer, les EnR et leurs bilans respectifs sont
analysés ;
les contraintes, enjeux, opportunités pour le développement des EnR sont identifiés ;
les mesures incitatives pour la recherche et le développement des EnR sont proposées ;
les perspectives d’avenir pour le sous-secteur des EnR et les mesures incitatives pour leurs
utilisations à grande échelle au Mali sont proposées.
La méthodologie proposée pour mener à bien cette étude comprend essentiellement :
la collecte de la documentation auprès des services techniques en charge de l’énergie et
des énergies renouvelables notamment la Direction Nationale de l’Energie (DNE),
l’Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER-MALI), l’Agence Malienne de
Développement de l’Energie et de l’Electrification Rurale (AMADER), l’Agence
Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB), l’Energie du Mali (EDM-
SA) et la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Mines et Energie
(CPS/SME) ;
la recherche documentaire sur internet ou toutes autres sources d’information relatives
aux EnR ;
les entretiens qualitatifs avec les principaux acteurs tant publics, privés qu’associatifs ;
l’exploitation et l’analyse de la documentation recueillie.
A l’issue de la revue documentaire, il a été procédé à :
 |
18 18 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 17
l’identification des contraintes, des enjeux et des opportunités pour le développement et
l’utilisation des EnR ;
la proposition de perspectives pour la recherche, le développement et l’utilisation des
EnR ;
l’identification du rôle et de la place des EnR dans le développement socioéconomique
du pays.
L’étude comprend une introduction, un contexte, un historique, quatre (04) grandes parties : la
première traite des différents types d’Energies Renouvelables, la deuxième porte sur l’état des
lieux des politiques et stratégies en matière d’EnR, la troisième renseigne sur les enjeux ainsi
que les perspectives et la quatrième sur les liens entre les EnR, le développement humain
durable et la réduction de la pauvreté. Enfin, une conclusion et des recommandations bouclent
le travail.
 |
19 19 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 18
I. HISTORIQUE
Les énergies renouvelables (EnR) proviennent des sources d'énergies dont le renouvellement
naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle
de temps humaine. L'expression « énergie renouvelable » est la forme courte et usuelle des
expressions « sources d'énergie renouvelables » ou « énergies d'origine renouvelable ».
Selon la Politique Nationale d’Energie (PEN) du Mali, les énergies renouvelables sont des
énergies produites à partir du soleil, du vent, de la biomasse et des petits cours d’eau.
L'humanité n'a disposé, pendant la plus grande partie de son histoire, que d'énergies
renouvelables pour satisfaire ses besoins énergétiques.
Au Paléolithique, les seules énergies disponibles étaient la force musculaire humaine et
l'énergie de la biomasse utilisable grâce au feu ; mais de nombreux progrès ont permis d'utiliser
ces énergies avec une efficacité grandissante (inventions d'outils de plus en plus performants).
Le progrès le plus significatif a été l'invention de la traction animale, qui est survenue plus tard
que la domestication des animaux. On estime que l'homme a commencé à atteler des bovins à
des araires ou des véhicules à roues durant le IVe millénaire avant Jésus Christ. L'invention de
la marine à voile a été un progrès très important. Celle des moulins à eau et moulins à vent du
XIe siècle au XIIIe siècle a également apporté une énergie supplémentaire considérable.
À la fin du XVIIIe siècle et à la veille de la révolution industrielle, la quasi-totalité des besoins
d'énergie de l'humanité était encore assurée par des énergies renouvelables.
L'apparition de la machine à vapeur, puis celle du moteur Diesel ont entrainé le déclin des
moulins à eau et de l'énergie éolienne au XIXe siècle. Ces derniers ont fini par disparaître pour
être remplacés par les minoteries industrielles.
Au XIXe siècle également, François de Larderel met au point en Italie les techniques
d'utilisation de la géothermie. En 1911, la première centrale géothermique était construite à
Larderello.
Au milieu du XXe siècle, l'énergie éolienne n'était plus utilisée que pour la navigation de
plaisance et pour le pompage (agriculture, polders). Par contre, l'énergie hydraulique a connu
un nouvel âge d'or avec l'hydroélectricité, apparue en Suisse, en Italie, en France et aux États-
Unis à la fin du XIXe siècle.
Dans les années 1910, les premiers chauffe-eau solaires individuels apparaissent en Californie.
Puis, les éoliennes sont réapparues, bénéficiant de techniques plus performantes issues de
l'aviation ; leur développement a pris de l'ampleur à partir des années 1990. Le solaire thermique
et le solaire photovoltaïque connaissent un début d’essor dans les années 2000.
 |
20 20 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 19
II. CONTEXTE
2.1 Contexte international
L'humanité n'a disposé, pendant la plus grande partie de son histoire, que d'énergies
renouvelables pour satisfaire ses besoins énergétiques.
Afin de rattraper le retard pris par rapport aux objectifs de Rio de Janeiro et Kyoto,
l’Organisation des Nations Unies (ONU) a proposé en 2011 comme objectif de produire 30%
de l'énergie utilisée en 2030 à partir des énergies renouvelables, contre 13% en 2010.
Selon les prévisions 2013 de l'Agence Internationale de l’Energie (AIE), au rythme actuel de
son développement, en 2030, la production d’électricité d’origine EnR atteindra 24% de la
production électrique contre 20% en 2011, dépassera en 2018 la part du gaz naturel et produira
deux fois plus d’électricité que le nucléaire. Dans la production totale d'énergie, les énergies
renouvelables passeront de 13% en 2011 à 14% en 2020.
Dans le monde, de manière générale, le charbon restera dominant ; mais l'AIE présente deux
autres scénarii qui sont :
1. le scénario "New Policies" (nouvelles politiques) évalue l'effet que pourraient avoir des
politiques plus déterminées de lutte contre le réchauffement climatique (cf. détail des
"quatre mesures" ci-dessous) : la part des renouvelables atteindrait 15% en 2020 et 18% en
2035 dans l'énergie primaire, 26% en 2020 et 31% en 2035 dans la production d'électricité ;
2. le scénario "450" décrit les mesures coordonnées au niveau mondial qui devraient être
appliquées afin de limiter la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère : la
part des renouvelables atteindrait 16% en 2020 et 26% en 2035 dans l'énergie primaire,
28% en 2020 et 48% en 2035 dans la production d'électricité.
En 2013, Maria Van der Hoeven, directrice exécutive de l'AIE, déplore la décision de certains
pays européens de réduire leur soutien aux énergies renouvelables dans le contexte de crise
économique et climatique, qui au contraire devrait leur être favorable. Le 5 juillet 2013, l’AIE
a recommandé quatre mesures urgentes et "sans regret", qui ne devraient pas menacer la
croissance économique :
1. investir dans l’efficacité énergétique dans le bâtiment, l’industrie et les transports ;
2. mettre fin à la construction et à l’utilisation des centrales à charbon les moins efficaces ;
3. réduire les émissions de méthane dans la production d’hydrocarbures ;
4. éliminer les subventions aux énergies fossiles.
2.2 Contexte sous régional
 |
21 21 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 20
L’Afrique de l’Ouest traverse une crise croissante de l’énergie qui entrave le développement
économique et social et affecte surtout les groupes de population à faible revenu. Cette crise se
caractérise par :
1. une forte augmentation de la demande énergétique soutenue par la croissance
économique alors que l’accès à l’énergie aujourd’hui est encore limité (un taux d’accès
à l’électricité d’environ 30% avec de larges disparités entre zones urbaines et rurales)
et les coûts de production sont élevés ;
2. un déficit de production se traduisant par des délestages très préjudiciables à l’activité
économique, notamment certains processus industriels ;
3. une forte dépendance des importations de combustibles fossiles.
Face à ces défis, le secteur privé souffre de :
- l’insuffisance de réglementation pour le développement des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique ;
- l’insuffisance de moyens humains, matériels et de compétences techniques ;
- les difficultés d’accès aux financements bancaires en raison (du coût élevé du crédit,
de la timidité des banques à jouer leur rôle de transformation, de l’étroitesse de leurs
ressources et de leur manque d’expérience dans ce type de projets).
C’est pourquoi, l’Agence Française de Développement (AFD) a décidé de mettre en place une
ligne de crédit dédiée en la matière, en zone UEMOA principalement. La ligne consentie à
plusieurs banques commerciales leur permettra de prêter à des entreprises, qui elles-mêmes
mettront en œuvre ce type de projet, pour leur compte, ou pour des tiers ou pour le réseau.
La Politique des Energies Renouvelables de la CEDEAO (PERC) et la Politique en matière
d’Efficacité Energétique de la CEDEAO (PEEC) ont été adoptées par les Etats membres de
cette organisation en octobre 2012 et par les Chefs d'Etats, le 18 juillet 2013. Les documents
d'orientation ont été préparés avec l'appui technique du Centre Régional de la CEDEAO pour
les Energies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (CEREEC) et un large éventail de
partenaires internationaux (ONUDI, EUEI-PDF, FEM-SPWA, l’Autriche et Espagne). Les
politiques incluent un minimum de cibles/objectifs et de scénarios pour les Energies
Renouvelables (EnR) et l'Efficacité Energétique (EE), ainsi que les mesures, les normes et les
incitations à mettre en œuvre aux niveaux régional et national.
La PERC prévoit le développement des Plans d'Actions Nationaux en matière d’Energies
Renouvelables (PANER) par les quinze Etats membres de la CEDEAO à la fin de 2014. Les
PANER, dont la mise en œuvre sera quinquennale, contribueront à l’atteinte des cibles établies
par la PERC régionale pour 2020 et 2030. Le PANER est élaboré par chaque Etat membre de
la CEDEAO, en conformité avec le modèle qui a été élaboré par le CEREEC. Les PANER
contiennent des données de base sur le statu quo des politiques nationales en matière de
développement d’énergies renouvelables et proposent des objectifs et cibles atteignables, dont
certains indicateurs sont désagrégés selon le genre et basés sur les potentiels nationaux et des
évaluations socio-économiques. La mise en œuvre des PANER sera suivie au Mali par le
 |
22 22 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 21
Ministère de l'Energie et de l'Eau et le CEREEC au nom de la commission de CEDEAO selon
une procédure de consultation continue. Le modèle des PANER a été préparé avec l'assistance
technique du CEREEC et de l'ONUDI. Le processus de la mise en œuvre sera supporté par une
multitude de partenaires, dont le Programme Stratégique du Fonds Mondial pour
l’Environnement (FEM) pour l'Afrique de l'Ouest, la GIZ, l’IRENA, les gouvernements de
l'Autriche et de l'Espagne.
2.3 Contexte national
Le Mali, 1 241 238 Km2 de superficie territoriale pour environ 14,5 millions d'habitants en
2009, est encore essentiellement constitué de population rurale (66,7% de ruraux), avec
cependant un taux d’urbanisation de plus en plus élevé d’Afrique, de l’ordre de 30% durant ces
dix dernières années. L'enclavement géographique (pays continental), les fluctuations des
termes de l'échange, les aléas climatiques ainsi que les récents problèmes sécuritaires et
conflictuels armés constituent les principaux obstacles au développement économique du pays.
La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB), en nette amélioration, est passée de 1% l’an en
moyenne entre 1991 et 1993 à respectivement 4,5% par an sur la période 1994/1996 ; 5,7%
entre 1997 et 2002 ; 6,1% en 2003 et entre 4 et 5% en moyenne depuis 2004. La pauvreté des
conditions de vie (ou pauvreté de masse) qui se traduit par une situation de manque dans divers
domaines (alimentation, éducation, santé, etc., entre zones urbaines et rurales) et les coûts de
production sont élevés.
Le déficit de production d’énergie se traduit par des délestages très préjudiciables à l’activité
économique et une forte dépendance aux importations de combustibles fossiles.
Cette situation contraste beaucoup avec la disponibilité au Mali d’un important potentiel en
sources d’énergies renouvelables (EnR) : i) l’existence d’un énorme potentiel (solaire, éolien,
mini/micro hydroélectricité, etc.) ; ii) la position pionnière du Mali pour le développement des
technologies EnR ; iii) le rapprochement de l’évolution technologique des équipements EnR
des préoccupations des utilisateurs ; iv) l’Installation de plusieurs milliers d’équipements EnR
sur le territoire national et ; v) l’existence d’un régime fiscal et douanier favorable au
développement des EnR (exonération des équipements EnR à l’importation).
Depuis les années 60, le Mali a créé le Laboratoire d’Energie Solaire (LESO) pour la mise en
valeur de l’énergie du rayonnement solaire. Le LESO est devenu ensuite le Centre National de
l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER) qui a mis en œuvres plusieurs
projets et programmes. En 2014, le CNESOLER a été érigé en Agence des Energies
Renouvelable du Mali (AER-MALI). Il faut aussi signaler la création dans les années 80 du
Centre Régional de l’Energie Solaire (CRES) par la Communauté Economique de l’Afrique de
l’Ouest (CEAO) qui regroupait la Haute Volta (actuel Burkina Faso), la Côte d’Ivoire, le Mali,
la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Ce centre était un important lieu de la recherche sur
l’énergie solaire, avec la dissolution de la CEAO, les bâtiments ont été rétrocédés au Mali et les
lieux abritent actuellement l’essentiel des services en charge de l’énergie.
De 1996 à nos jours, le Gouvernement a posé beaucoup d’actes parmi lesquels :
 |
23 23 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 22
l'ordonnance N°019 du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité et le
Décret N°00-183/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application ;
le cadre d'électrification rurale élaboré en 2003 ;
l’adoption du document de la Politique Energétique Nationale en mars 2006 ;
la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables en décembre
2006 ;
la Stratégie de Développement des Biocarburants 2009 ;
le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2007-2011 ;
le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017
devenu depuis 2016 le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement
Durable (CREDD 2016-2018). Ce cadre retient dans son Axe Stratégique 1 « Croissance
Economique Inclusive et durable » et Domaine Prioritaire « Développement des
Infrastructures » un Objectif spécifique "Développer les Energies Renouvelables et accroître
l’accès à l’électricité à moindre coût pour les populations rurales et urbaines".
Les énergies renouvelables sont une priorité pour l’Etat malien, ce qui est confirmé par la
promulgation du Décret N°02-026/P-RM du 30 janvier 2002, qui suspend pour cinq ans, la
perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ainsi que des droits et taxes à l’importation
sur tous les équipements d’énergies renouvelables. Ce décret a été régulièrement renouvelé tous
les cinq (5) ans, le dernier est celui de 2014 (Décret N°2014-816/P-RM du 27 octobre 2014).
Cette exonération a été citée par plusieurs acteurs dans le sous-secteur des énergies
renouvelables comme un avantage pour leurs activités au Mali.
Le sous-secteur comporte l’Etat, les opérateurs privés et les ONG qui font des activités de
recherches et développement, d’installations et de démonstration ainsi que la vulgarisation des
différentes technologies d’énergie renouvelable. Le sous-secteur est encore sous développé vu
son potentiel sur l’étendue du territoire national et sa contribution dans le bilan énergétique
national. Toutefois, il reste très dynamique et plusieurs opérateurs privés maliens y sont actifs
et ont des relations avec des grandes sociétés internationales qui fournissent la plus grande
partie des équipements. L’énergie solaire photovoltaïque constitue la filière la plus développée
de ce sous-secteur.
Cependant, il y a aussi quelques activités pilotes et innovatrices qui se développent dans les
domaines de l’éolien, de la biomasse moderne et des biocarburants (surtout à base de l’huile de
pourghère et d’éthanol).
Les acteurs du sous-secteur des énergies renouvelables ont salué l’exonération des droits et
taxes à l’importation ainsi que la TVA sur les différents équipements et la considère comme un
catalyseur pour leurs activités. Ils ont également souligné des problèmes logistiques pour
l’acquisition d’équipements de qualité, ainsi que ceux liés à l’accès au financement auprès des
institutions financières pour le développement de nouveaux produits et services.
III. PREMIERE PARTIE : DIFFÉRENTS TYPES D’EnR ET LEURS UTILISATIONS
Les énergies renouvelables sont par définition inépuisables. Leur évaluation se fait, non en
termes de réserves, mais en considérant le flux énergétique potentiel que peut fournir chacune
 |
24 24 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 23
de ces sources d'énergies. Comme pour toutes les sources d'énergie, on obtient la quantité
d'énergie produite en multipliant le temps de production par la puissance moyenne disponible
(puissance maximale pondérée par le facteur de charge). Il est assez difficile de connaître le
potentiel de chaque énergie, car celui-ci varie selon les sources. Cependant, le potentiel
théorique de l'énergie solaire peut être évalué assez facilement puisque l'on considère que la
puissance maximale reçue par la terre - après passage dans l'atmosphère - est d'environ 1 kW/
m2. On arrive alors à un potentiel énergétique solaire sur un an de 1 070 000 PWh.
3.1 Energie solaire
FIGURE 1 : Soleil, principale source des différentes formes d’énergies renouvelables
disponibles sur terre
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
Le soleil émet un rayonnement électromagnétique dans lequel se trouvent notamment les rayons
cosmiques, gamma, X, la lumière visible, l’infrarouge, les micro-ondes et les ondes radios en
fonction de la fréquence d’émission. Tous ces types de rayonnement électromagnétique
véhiculent de l’énergie. Le niveau d’irradiation (le flux énergétique) mesuré à la surface de la
terre dépend de la longueur d’onde du rayonnement solaire.
Deux grandes familles d'utilisation de l'énergie solaire à cycle court se distinguent :
l'énergie solaire thermique, l’utilisation de la chaleur transmise par le rayonnement, l'énergie
photovoltaïque, l’utilisation du rayonnement lui-même pour produire de l'électricité.
3.1.1 Energie solaire thermique
FIGURE 2 : Four solaire Global FIGURE 3 : Chauffe-eau solaire
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
Dans les conditions terrestres, le rayonnement thermique se situe entre 0,1 et 100 micromètres.
Il se caractérise par l’émission de rayonnement au détriment de l’énergie calorifique du corps
émetteur. Ainsi, un corps émettant un rayonnement thermique diminue son énergie calorifique
et un corps recevant un rayonnement thermique augmente son énergie calorifique. Le soleil
 |
25 25 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 24
émet principalement dans le rayonnement visible entre 0,4 et 0,8 micromètre. Ainsi, en entrant
en contact avec un corps, le rayonnement solaire augmente la température de ce corps. On parle
ici d’énergie solaire thermique. Cette source d’énergie est connue depuis très longtemps et
utilisée par exemple pour réchauffer ou sécher des objets (y compris le corps humain) en les
exposants au soleil.
L'énergie thermique peut être utilisée directement ou indirectement :
directement pour chauffer des locaux ou de l'eau sanitaire (serres, architecture
bioclimatique, capteurs solaires chauffants et chauffe-eau solaire) ou des aliments (fours
solaires) ;
indirectement pour la production de vapeur d'un fluide caloporteur pour entraîner des
turbines et ainsi obtenir une énergie électrique (énergie solaire thermodynamique ou
hélio thermodynamique).
L'énergie solaire thermique peut également être utilisée pour la cuisine. Apparue dans les
années 1970, la cuisine solaire consiste à préparer des plats à l'aide d'un cuiseur ou d'un four
solaire. Les petits fours solaires permettent des températures de cuisson de l'ordre des 150 °C,
les paraboles solaires permettent de faire les mêmes plats qu'une cuisinière classique à gaz ou
électrique. À grande échelle, la Fondation Desertec construit dans le Sahara des centrales
solaires thermiques à concentration. D'après ses ingénieurs, « les déserts de la planète reçoivent
toutes les 6 heures du soleil l’équivalent de ce que consomme l’humanité chaque année » et
quelques centaines de km² d'étendue désertique pourrait satisfaire l'ensemble des besoins
énergétiques de la planète.
La majorité des systèmes solaires thermiques sont utilisés sur le toit des maisons et des
immeubles pour produire l'eau chaude (40 à 80 % des besoins selon les régions). La Chine a
produit 71 millions de m² de collecteurs en 2013. Mais les technologies de récupération de la
chaleur du soleil sont de plus en plus utilisées dans les applications industrielles, pour la
production de vapeur, ou de froid. La puissance thermique solaire est de l’ordre de 326 GW en
2013 dans le monde.
3.1.2 Energie solaire photovoltaïque
L’énergie photovoltaïque se base sur l’effet photoélectrique pour créer un courant électrique
continu à partir d’un rayonnement électromagnétique. Cette source de lumière peut être
naturelle (soleil) ou artificielle (une ampoule). L'énergie photovoltaïque est captée par des
cellules photovoltaïques, un composant électronique qui produit de l'électricité lorsqu'il est
exposé à la lumière. Plusieurs cellules peuvent être reliées pour former un module solaire
photovoltaïque ou un panneau photovoltaïque. Une installation photovoltaïque connectée à un
réseau d'électricité se compose généralement de plusieurs panneaux photovoltaïques, leur
nombre pouvant varier d'une dizaine à plusieurs milliers.
Il existe plusieurs technologies de modules solaires photovoltaïques :
 |
26 26 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 25
les modules solaires monocristallins possèdent le meilleur rendement au m² et sont
essentiellement utilisés lorsque les espaces sont restreints et pour optimiser la
production d'une centrale photovoltaïque ;
les modules solaires poly cristallins représentent une technologie proposant des
rendements plus faibles que la technologie monocristalline ;
les modules solaires amorphes sont des panneaux solaires proposant un rendement
largement inférieur aux modules solaires cristallins. Cette solution nécessite donc une
plus grande surface pour la même puissance installée.
En France, l'énergie photovoltaïque est produite par de nombreux opérateurs (particuliers,
propriétaires de bâtiments industriels ou agricoles…) qui vendent l'électricité produite par leur
installation aux fournisseurs d'électricité qui sont soumis à une obligation d'achat, à des
conditions tarifaires régies par la loi. Les tarifs d'achat sont fixés par le ministre chargé de
l'énergie après consultation de la CRE, de façon à stimuler l’investissement par ces opérateurs
tout en limitant les "effets d’aubaines" ; le surcoût découlant de ces tarifs d'achat est mis à la
charge des consommateurs d'électricité.
FIGURE 4 : Evolution de puissance installée solaire
Source : REN21 / RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT - page 49
Malgré un recul des investissements internationaux dans l’énergie solaire photovoltaïque de
près de 22% par rapport à 2012, les installations de nouvelles capacités ont progressé de plus
de 32%. Le marché de l’énergie solaire photovoltaïque a connu une année record, la puissance
ajoutée atteignant près de 39 GW en 2013, pour un total d’environ 139 GW. La Chine a
enregistré une croissance spectaculaire en assurant près d’un tiers des capacités mondiales
ajoutées, devant le Japon et les États-Unis.
La nouvelle puissance installée photovoltaïque supplante, pour la première fois, celle de l’éolien
à l’échelle mondiale.
3.2 Energie éolienne
FIGURE 4 : Moulins à vent FIGURE 5 : Eolienne
 |
27 27 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 26
FIGURE 6 : Champ éolien
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
L’activité solaire est la principale cause des phénomènes météorologiques. Ces derniers sont
notamment caractérisés par des déplacements de masses d’air à l’intérieur de l’atmosphère.
C’est l’énergie mécanique de ces déplacements de masses d’air qui est à la base de l’énergie
éolienne. L’énergie éolienne consiste ainsi à utiliser cette énergie mécanique.
Des voiliers ont été utilisés dès l’Antiquité, comme en témoigne la Barque solaire de Khéops.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’essentiel des déplacements nautiques à moyenne et longue
distance se sont faits grâce à la force du vent. Un dérivé terrestre n’ayant d’usage que sportif a
été rendu possible par les techniques modernes : le char à voile.
L’énergie éolienne a aussi été vite exploitée à l’aide de moulins à vent équipés de pales en
forme de voile, comme ceux que l’on peut voir aux Pays-Bas ou encore ceux mentionnés dans
Don Quichotte. Ces moulins utilisent l’énergie mécanique pour actionner différents
équipements. Les moulins des Pays-Bas actionnent directement des pompes dont le but est
 |
28 28 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 27
d’assécher ou de maintenir secs les polders du pays. Les meuniers utilisent des moulins pour
faire tourner une meule à grains.
Aujourd’hui, ce sont les éoliennes qui prennent la place des moulins à vent. Les éoliennes
transforment l’énergie mécanique en énergie électrique, soit pour l’injecter dans un réseau de
distribution, soit pour être utilisée sur place (site isolé de réseau de distribution). Pour résoudre
le problème d'espace, elles sont de plus en plus souvent placées en mer.
L'éolien se développe également à l'échelle individuelle. Le petit éolien est généralement utilisé
pour produire de l'électricité qui sera consommée directement sur place. De nombreux
problèmes sont apparus pour des éoliennes installées en zones bâties sans étude préalable
sérieuse sur les vitesses de vent et les turbulences. L'Association Française des Professionnels
du Petit Éolien (AFPPE) déconseille les installations sur les sites improductifs trop turbulents,
en pignon ou en toiture.
Des concepts d'éolienne aéroportée sont à l'étude pour aller chercher les vents d'altitude, plus
puissants, plus réguliers : Magenn, KiteGen, et Skywindpower conçus pour s'élever à 300 m,
1 200 m ou 5 000 m avec l'espoir de produire jusqu'à 100 fois plus d'électricité qu'une éolienne
actuelle.
FIGURE 7 : Evolution de puissance installée éolien
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT - page 59
Plus de 35 GW de capacités éoliennes ont été ajoutés en 2013 pour un total légèrement supérieur
à 318 GW. Après plusieurs années de fortes progressions, ce marché a toutefois reculé de près
de 10 GW par rapport à 2012, en raison principalement de la forte baisse du marché américain.
L’énergie éolienne en mer a connu une année record, avec 1,6 GW ajoutés, la quasi-totalité
installée dans l'Union européenne.
3.3 Energie hydraulique
FIGURE 8 : Moulin à eau
 |
29 29 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 28
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
A l’instar de l’énergie éolienne, les énergies hydrauliques (à l'exception de l'énergie
marémotrice) ont leur origine principale dans les phénomènes météorologiques et donc l'énergie
solaire. Le soleil provoque l'évaporation de l’eau, principalement dans les océans et en libère
une partie sur les continents à des altitudes variables. On parle du cycle de l'eau pour décrire
ces mouvements. L’eau (en fait, la vapeur d'eau) possède, en altitude, une énergie potentielle
de pesanteur ; cette énergie peut être captée et transformée dans des barrages hydroélectriques,
lors du retour de l’eau vers les océans. Avant l’avènement de l’électricité, les moulins à eau
permettaient de capter cette énergie mécanique pour entrainer des machines ou des outils
(machines à tisser, moulins à moudre le blé…).
Depuis l’invention de l’électricité, cette énergie mécanique est transformée en énergie
électrique ; l'hydroélectricité est après la biomasse la deuxième énergie renouvelable. Selon
l'Agence internationale de l'énergie, elle fournit 2,3% de l'énergie primaire produite dans le
monde en 2011, sur un total de 13,3% d'énergies renouvelables.
L’hydroélectricité a progressé de 4%, à environ 1000 GW en 2013, ce qui représente près d’un
tiers de la capacité en électricité renouvelable ajoutée cette année-là. La part la plus importante
revient à la Chine avec une augmentation de 29 GW de la puissance installée.
D'autres énergies hydrauliques existent et proviennent généralement de sources marines :
énergie des vagues, produite par le mouvement des vagues ;
énergie marémotrice, produite par le mouvement de l’eau créé par les marées ;
énergie hydrolienne : elle est issue de l'utilisation des courants sous-marins ;
énergie thermique des mers, produite en exploitant la différence de température entre
les eaux superficielles et les eaux profondes des océans ;
énergie osmotique, elle a pour origine la diffusion ionique qui a lieu lors de l’arrivée
et du mélange d’eau douce dans l’eau salée de la mer. L’idée remonte aux années 1970
et d'après Stat kraft, le potentiel technique mondial de l'énergie osmotique serait de
1 600 TWh par an, soit 50% de la production électrique de l’Union Européenne.
3.4 Biomasse
 |
30 30 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 29
Indirectement, il s’agit d’énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse.
Elle est exploitée par combustion ou métabolisation. Cette énergie est renouvelable à condition
que les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites ; cette condition n'est pas
toujours remplie. On peut citer notamment le bois et les biocarburants.
Jusqu'au XVIIIe siècle, la biomasse était la principale ressource énergétique utilisée par
l'humanité, en particulier sous forme de bois ; c'est encore aujourd'hui, et de loin, la principale
énergie renouvelable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la biomasse et les déchets
fournissent 10% de l'énergie primaire produite dans le monde, sur 13,3% d'énergies
renouvelables. Mais cette ressource produit de nombreux polluants et a l'inconvénient majeur
d'exiger des surfaces considérables pour sa production, du fait de la faible efficacité énergétique
de la photosynthèse. Aussi, sa production sous forme d'agro carburant entre en conflit avec la
production vivrière ; l'utilisation énergétique de la biomasse restera donc toujours limitée par
ces multiples contraintes.
Une équipe de recherche de l'université Stanford a montré que la production d'électricité à partir
de la biomasse serait plus rentable économiquement et écologiquement que leur transformation
et leur utilisation dans les transports en tant que bio-carburant. Pour Elliott Campbell et ses
collègues, l’option électrique émet deux fois moins de CO2 que l’option bio carburant et 1
hectare de culture permet de parcourir 52 000 km à partir de l’électricité contre 31 000 km à
partir de l’éthanol.
Le chauffage et le refroidissement utilisant la biomasse moderne, l’énergie solaire et les sources
géothermiques assurent une part, certes modeste mais en progression constante, de la demande
mondiale finale en matière de chauffage, avec 10% selon les estimations.
3.5 Énergie géothermique
FIGURE 9 : Centrale géothermique de Nesjavellir en Islande.
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
Un des témoignages les plus anciens date de 2 000 ans av. J.-C., avec l'exploitation d'eau
naturellement chaude pour les thermes.
Le principe consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous
forme de chauffage ou pour la transformer en électricité. Par rapport à d’autres énergies
renouvelables, la géothermie profonde ne dépend pas des conditions atmosphériques (soleil,
pluie, vent).
 |
31 31 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 30
En 2012, les trois premiers producteurs étaient, les États-Unis (27,9%), les Philippines (14,6%)
et l'Indonésie (11,2%) et quatre autres pays ont une production importante : la Nouvelle-
Zélande, le Mexique, l'Italie et l'Islande28. L'Indonésie possède le plus grand potentiel
(27 gigawatts, soit 40% des réserves mondiales).
Pour autant le géothermique comporte lui aussi des risques au niveau humain. Les techniques
évoluent et permettent de chercher la chaleur à de plus grandes profondeurs. Il a été montré que
la modification des pressions dans les sous-sols avait un impact sur l'activité sismique. La
fréquence des tremblements de terre mais aussi leur puissance peut être augmentée à cause de
l'exploitation de cette énergie.
La géothermie très basse énergie exploite la chaleur de la couche superficielle du sol, qui
provient non pas des profondeurs de la croûte terrestre, mais du soleil et du ruissellement de
l'eau de pluie ; elle est utilisée pour :
la climatisation passive ;
le chauffage et la climatisation avec la pompe à chaleur géothermique, qui se développe
en particulier en Allemagne, en Suède et en France ; ces pompes à chaleur sont
considérées comme exploitant une énergie partiellement renouvelable ; car une grande
partie de l’énergie qu’elles fournissent provient de l'énergie solaire.
En France, des objectifs très ambitieux ont été fixés pour la géothermie comme : la
multiplication par 6 de la production de chaleur à partir de la géothermie entre 2006 et 2020.
 |
32 32 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 31
3.6 Utilisation des EnR dans le monde
Le nombre de pays s’étant fixé des objectifs en termes d’énergie renouvelable a quadruplé en
10 ans, passant de 43 en 2005 à 164 en 2015, selon un rapport publié par l’Agence internationale
de l'énergie renouvelable. Les pays émergents comblent leur retard : 131 d'entre eux se sont
donnés des objectifs ; la trentaine de nations sans objectifs sont surtout en Afrique et en Asie
centrale. Cent cinquante un (151) pays ont fixé des objectifs pour les énergies renouvelables
électriques, mais seulement 47 dans le domaine du chauffage et du froid et 59 pour les
transports.
La Chine, les Etats-Unis, le Brésil, le Canada et l'Allemagne sont en-tête en matière de capacité
électrique renouvelable totale installée. Si on enlève l'hydroélectricité, les leaders sont la Chine,
les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Inde. Mais c'est le Danemark qui est le leader
en terme de capacité installée par habitant (non-hydraulique).
Les nouvelles capacités de production électrique renouvelable de la Chine ont, pour la première
fois, dépassé les nouvelles capacités électriques fossiles et nucléaires.
Dans l'Union européenne, 72% des nouvelles capacités de production électrique sont
renouvelables (essentiellement éolien et solaire). Ce qui est un chiffre extraordinaire si on
remonte 10 années en arrière quand 80% des nouvelles capacités électriques dans Europe +
Norvège + Suisse, venaient des combustibles fossiles.
Selon le bilan annuel publié le 9 janvier 2015 par Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les
investissements mondiaux dans les énergies renouvelables (hors hydraulique) ont progressé de
16% en 2014, à 310 milliards de dollars, tout près de leur niveau record de 317,5 Mds $ atteint
en 2011. Le solaire a représenté à lui seul près de la moitié des investissements, grâce à des
projets géants comme la centrale de Setouchi au Japon (1,1 Mds $ pour 250 MW), ou celle de
XinaSolar One en Afrique du Sud (1 Md $, 100 MW), et à la croissance de 34% des petites
installations. L’éolien a absorbé près de 100 Mds $ ; l’éolien en mer a boosté la croissance, avec
sept grands projets ayant passé le cap d’une décision finale d’investissement en Europe. Celui
de Gemini, aux Pays-Bas (3,8 Mds $ et 600 MW) est le plus grand projet jamais lancé dans les
renouvelables (hors hydraulique). BNEF évoque aussi les projets de Dudgeon (402 MW) au
Royaume-Uni et de Wikinger (350 MW) au large de l’Allemagne. La Chine reste le plus grand
investisseur au monde avec 89,5 Mds $, devant les États-Unis (51,8 Mds $) et le Japon (41,3
Mds $).
En 2015, environ 50 GW de systèmes photovoltaïques ont été installés dans le monde, contre
40 GW en 2014. La puissance installée cumulée atteignait 227 GW en fin 2015, correspondant
à une production moyenne en année pleine de l'ordre de 270 TWh/an, soit près de la moitié de
la production annuelle d'électricité de la France ; à titre de comparaison : 1 GW est la puissance
électrique moyenne d'un réacteur nucléaire des années 1970, l'EPR a une puissance de
1,65 GW ; mais 1 GW nucléaire produit en moyenne 7 à 8 TWh/an, contre 1,2 TWh/an pour
1 GW photovoltaïque.
 |
33 33 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 32
L'Italie est, en 2015, le pays où le solaire photovoltaïque assure la part la plus élevée de la
production nationale d'électricité : 8%, suivie par la Grèce : 7,4% et l'Allemagne : 7,1% ; la
Belgique et le Japon sont proches de 4%. Au total, 22 pays dépassent 1%, dont la Chine qui
vient d'atteindre le seuil de 1% les États-Unis et l'Inde devraient l'atteindre en fin 2016.
Le nombre d'emplois directs et indirects créés dans le secteur des énergies renouvelables, hors
gros hydraulique est de l’ordre de 6,5 millions en 2013. Par rapport à sa population, c'est
l'Allemagne qui a créé le plus d'emplois avec une estimation de 371 000. En valeur absolue, la
Chine est le leader, créditée de 2,6 millions d'emplois dans les énergies renouvelables suivie de
l'Europe (1,2 million), du Brésil (894 000), des Etats-Unis (625 000) et de l'Inde (391 000).
La Chine est clairement première en ce qui concerne le photovoltaïque avec 1,6 million
d'emplois. Pour le biogaz, c'est l'Europe avec 306 000 emplois. Pour les biocarburants, le Brésil
occupe la première place avec 820 000 emplois. En ce qui concerne l'éolien, si la Chine est
encore leader avec 356 000 emplois, l'industrie du vent procure 328 000 emplois à l'Europe
(Source : Renewables 2014 Global Status Report).
L'industrie photovoltaïque employait directement environ 435 000 personnes dans le monde en
2012, dont 265 000 personnes en Europe, selon l'EPIA; près d'un million d'emplois dépendent
indirectement de cette filière, dont 700 000 dans l'installation, la maintenance et le recyclage
des systèmes PV ; les scénarii de l'EPIA prévoient jusqu'à 1 million de créations d'emplois en
Europe d'ici 2020. La production d'un MWc induit la création de 3 à 7 emplois équivalent temps
pleins directs et 12 à 20 indirects. La filière photovoltaïque représenterait entre 20 000 et 35
000 emplois en France.
En 2012, les énergies renouvelables représentaient 19% de la consommation finale mondiale
d’énergie, dont 9% pour la biomasse et 10% pour les énergies renouvelables « modernes » :
4,2% de chaleur produite par les énergies renouvelables thermiques, 3,8% d'hydroélectricité,
1,2% pour les autres renouvelables électriques (éolien, solaire, géothermie, biomasse, biogaz)
et 0,8% pour les biocarburants. Les taux de croissance moyens annuels les plus élevés sur cinq
ans (2008-2013) ont été ceux du solaire photovoltaïque (+55% l'an), du solaire
thermodynamique (+48%), de l'éolien (+21%), du solaire thermique (+14%) et du biodiesel
(+11%).
La part des énergies renouvelables dans la consommation mondiale d’énergie primaire était de
13,3% en 2011, dont 10% issus de la biomasse et des déchets, 2,3% de l'hydroélectricité puis
1% des autres EnR (éolien, solaire, etc.) et 20,8% de la production mondiale d'électricité en
2012 (hydro : 16,2%, éolien : 2,4%, biomasse : 1,4%, solaire : 0,5%, etc.).
Au Mali, les données ne sont pas disponibles pour déterminer le nombre d’emplois créé par le
sous-secteur des Energies renouvelables. Mais vu le nombre d’opérateurs et d’utilisateurs des
EnR, on peut en déduire que les emplois créés ne sont pas négligeables.
 |
34 34 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 33
La différence entre ces statistiques provient des conventions adoptées pour les bilans
énergétiques, qui minorent la part des énergies renouvelables électriques dans l'énergie
primaire.
3.6.1 Energie renouvelable thermique
Les cinq premiers pays producteurs d’énergie renouvelable thermique en 2013 sont par ordre
la Chine, les Etats Unis, l’Allemagne, la Turquie et le Brésil.
La puissance des systèmes de chauffage à biomasse « modernes » a progressé en 2013 de 1% à
296 GWth. Les biocarburants ont représenté 2,3% de la consommation de carburants du
transport mondial ; leur production a progressé de 7,7 milliards de litres pour atteindre 116,6
milliards de litres ; la production d'éthanol s'est redressée de 6% après deux ans de déclin, le
biodiesel a progressé de 11% et celle de l'huile végétale carburant de 16%, à 3 millions de litres ;
de nouvelles usines de biocarburants avancés produits à partir de biomasse non-alimentaire ont
été mises en service en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, le total des investissements
en nouvelles usines de biocarburant a continué à décliner depuis le pic de 2007.
L'usage direct de la chaleur géothermique (bains thermaux, chauffage de piscines, chauffage de
locaux, procédés agricoles et industriels) est estimé à plus de 300 pétajoules par an, mais
progresse peu.
La puissance thermique des capteurs de chaleur solaire, à eau ou à air, est passée de 283 GWth
en fin 2012 à 330 GWth en fin 2013 ; la Chine reste le principal marché, avec plus de 80% du
marché mondial ; la demande continue à ralentir en Europe. Mais de nouveaux marchés se
développent dans des pays comme le Brésil, où le prix du chauffage solaire de l'eau est
compétitif ; la tendance au développement de systèmes collectifs se confirme, ainsi que
l'utilisation du solaire thermique pour le chauffage urbain, la production de froid et les
applications industrielles.
3.6.2 Production d’électricité renouvelable
Tableau 1 : Cinq premiers pays producteurs de chaque type d’énergie renouvelable électrique
en 2013
Rang Hydroélectrique Géothermie Éolien Biomasse Solaire PV Solaire CSP
1. Chine États-Unis Chine États-Unis Allemagne Espagne
2. Brésil Philippines États-Unis Allemagne Chine États-Unis
3. Canada Indonésie Allemagne Chine Italie
Émirats
arabes unis
4. États-Unis Mexique Espagne Brésil Japon Inde
5. Russie Italie Inde Inde États-Unis Algérie
SOURCE : SITE DE L'IEA WORLD TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY REGION AND FUEL
 |
35 35 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 34
FIGURE 10 : Les 10 pays les plus consommateurs d'électricité
La puissance installée des EnR électriques atteignait 1 560 GW fin 2013, en progression de 8%
par rapport à 2012 ; l'hydroélectricité a progressé de 4% à 1 000 MW et les autres EnR de 17%
à 560 GW.
La part des renouvelables dans la production d'électricité atteignait 22,1% à la fin 2013, dont
16,4% d'hydroélectricité, 2,9% d'éolien, 1,8% de biomasse, 0,7% de photovoltaïque et 0,4% de
divers (géothermie, solaire thermodynamique, énergies marines) ; la part de l'éolien atteint
33,2% au Danemark et 20,9% en Espagne, celle du photovoltaïque 7,8% en Italie et celle de la
géothermie 29% en Islande et plus de 20% au Salvador et au Kenya.
Les 560 GW de puissance installée renouvelable hors hydro se répartissent en 235 GW pour
l'Union européenne (dont 78 GW en Allemagne, 32 GW en Espagne et 31 GW en Italie),
162 GW pour les BRICS (dont 118 GW en Chine et 27 GW en Inde), 93 GW pour les États-
Unis et 70 GW pour le reste du monde.
Tableau 2: Puissance installée des énergies renouvelables (GW) en 2012 et 2013
Énergie fin 2003 fin 2012 fin 2013 % 2013
Hydroélectricité 715 960 1000 64
Éolien 48 283 318 20
Solaire photovoltaïque 2,6 100 139 9
Solaire thermodynamique 0,4 2,5 3,4 0,2
Biomasse <36 83 88 6
Géothermie 8,9 11,5 12 0,8
Total EnR 800 1 440 1 560 100
SOURCE: SITE DE L'IEA WORLD TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY REGION AND FUEL
 |
36 36 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 35
Tableau 3 : Production énergétique mondiale commercialisée selon la source d'énergie
Énergie
Production
en 1998
Production
en 2014
Variation
2014/1998
(en %)
Part dans
la production
(en %)
Pétrole 73 538 kbbl/j 88 673 kbbl/j 21 32,4
Gaz naturel 2 273 Gm3 3 461 Gm3 52 24,0
Charbon 2 227 Mtep 3 933 Mtep 77 30,1
Nucléaire 2 431 TWh 2 537 TWh 4 4,4
Hydraulique 2 607 TWh 3 885 TWh 49 6,7
Éolien 16 TWh 706 TWh 4312 1,2
Solaire photovoltaïque 0,8 TWh 186 TWh 23150 0,3
Géothermie, Biomasse, etc. 179 TWh 509 TWh 184 0,8
Total 8 958 Mtep 13 045 Mtep 46 100
SOURCE: SITE DE L'IEA WORLD TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY REGION AND FUEL
Cette statistique comprend les énergies renouvelables utilisées pour la production d'électricité,
mais pas celles utilisées directement pour des usages thermiques (bois, biocarburants, pompe à
chaleur géothermique, chauffe-eau solaire, ...) ni celles qui sont autoconsommées.
Pour l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire, la conversion en Mtep se fait en « équivalent à la
production » en considérant un rendement de 38%.
Les combustibles fossiles totalisent 86,5% du total et les énergies renouvelables 9,0% ; si les
énergies renouvelables thermiques étaient prises en compte, la part des énergies renouvelables
serait beaucoup plus importante : ainsi, dans les statistiques mondiales de l'AIE, la catégorie
"biomasse et déchets" représente 10,2% de l'énergie primaire consommée en 2013 ; on peut en
déduire qu'au total, les énergies renouvelables couvrent environ 19% des besoins mondiaux en
énergie.
Tableau 4 : Evolution de la puissance éolienne installée dans le Monde (MW)
Année 1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 7 482 18 040 59 135 194 680 237 502 282 398 318 596 369 695 432 419
SOURCE : EUROBSERV'ER, 2013
Tableau 5 : Evolution de la production éolienne d’électricité dans le Monde (TWh)
Année 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 3,9 31,4 341,3 435,3 522,7 636,8 ND ND
SOURCE : EUROBSERV'ER, 2013
 |
37 37 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 36
Tableau 6 : Evolution de la production d’électricité solaire dans le monde (TWh)
Année 2011 2012 2013 2014 2015
Total 63,2 98,7 139,1 ND ND
SOURCE : EUROBSERV'ER, 2013
Tableau 7 : Principaux pays producteurs d’électricité géothermique en 2012
Pays Production (TWh) Part production mondiale (%)
États-Unis 19,6 27,9
Philippines 10,2 14,6
Indonésie 7,9 11,2
Nouvelle-Zélande 6,2 8,8
Mexique 5,8 8,3
Italie 5,6 7,9
Islande 5,2 7,4
Japon 2,5 3,6
Salvador 1,5 2,2
Kenya 1,5 2,1
Reste du monde 4,2 6,0
Total 70,4 100
SOURCE : EUROBSERV'ER, 2013
La puissance des centrales électriques à biomasse a augmenté de 5 GW pour atteindre 88 GW,
produisant plus de 400 TWh, y compris la production électrique des centrales de cogénération.
La puissance installée des centrales géothermiques a progressé de 455 MW en 2013, portant le
parc à 12 GW ; cette progression de 4% est supérieure à celle des deux années précédentes :
3% en moyenne.
La production hydroélectrique mondiale est estimée à 3 750 TWh en 2013 ; 40 GW ont été mis
en service en 2013, portant la puissance installée mondiale à 1 000 GW (+4%) ; 29 GW ont été
mis en service en Chine ; les autres pays ayant inauguré des centrales importantes sont la
Turquie, le Brésil, le Vietnam, l'Inde et la Russie.
La puissance équipée des énergies marines (centrales marémotrices pour l'essentiel) était
d'environ 530 MW en fin 2013 ; plusieurs installations pilotes de diverses technologies ont été
mises en test, en particulier au Royaume-Uni et en France.
Le marché du solaire photovoltaïque a connu une croissance explosive en 2013 : 39 GW sont
venus s'ajouter au parc, le portant à 139 GW ; la Chine a compté pour le tiers de cet
accroissement, suivie par le Japon et les États-Unis. Le solaire thermodynamique a progressé
de 0,9 GW, soit 36%, pour atteindre 3,4 GW ; les États-Unis et l'Espagne restent en tête, mais
le marché continue à basculer vers le pays émergents et ceux dotés de niveaux élevés
 |
38 38 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 37
d'insolation : Émirats arabes unis, Inde et Chine ; des formules hybrides se développent et les
capacités de stockage gagnent en importance.
La puissance installée éolienne a progressé de 35 GW en 2013, atteignant 318 GW. Mais après
plusieurs années records, le marché a reculé de 10 GW, surtout du fait des États-Unis ; l'Asie
gagne du terrain et a pris la tête en 2014 ; le marché latino-américain émerge ; l'éolien offshore
a connu une année record à 1,6 GW, presque uniquement en Europe.
La production mondiale d'énergie commercialisée était en 2014, selon British Petrolum (BP),
de 13 045 Mtep, en progression de 46% depuis 1998 ; elle se répartissait en 32,4% de pétrole,
30,1% de charbon, 24% de gaz naturel, 4,4% de nucléaire et 9% d'énergies renouvelables
(hydroélectricité 6,7%, éolien 1,2%, biomasse et géothermie 0,8%, solaire 0,3%). Cette
statistique ne prend pas en compte les énergies autoconsommées (bois, pompes à chaleur,
solaire thermique, etc.).
3.7 Utilisation des EnR en Afrique
Bloomberg New Energy Finance prévoit un “boom” des énergies renouvelables en Afrique
subsaharienne : les nouvelles capacités installées en 2014 (1,8 GW hors grande hydraulique)
devraient dépasser le total de celles installées de 2000 à 2013. L'investissement atteindra 4,4
milliards d'euros, contre un milliard par an entre 2006 et 2011 ; en 2016, les investissements
atteindraient 5,8 Mds €. Le Kenya devrait accueillir 1,4 GW de renouvelables ; l'Éthiopie
installera 570 MW de géothermie et d'éolien entre 2014 et 2016 ; l'Afrique du Sud devrait
installer 3,9 GW en 2015-2016, surtout en éolien et solaire et prévoit 17,8 GW d'ici 2030.
3.7.1 Algérie
L’Algérie a lancé, le 3 février 2011, son Programme national de développement des énergies
nouvelles et renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ce programme, qui s'étale sur la
période allant de 2011 à 2013, ambitionnait de produire 22 000 MW d'électricité à partir du
solaire et de l'éolien dont 10 000 MW destinés à l'exportation.
Le gouvernement algérien a adopté en fin février 2015 son programme de développement des
énergies renouvelables 2015-2030. Une première phase du programme, démarrée en 2011, avait
permis la réalisation de projets pilotes et d'études sur le potentiel national. Le nouveau
programme précise les objectifs d'installations d'ici à 2030 :
13 575 MWc de solaire photovoltaïque ;
5 010 MW d'éolien ;
2 000 MW de solaire thermodynamique (CSP) ;
1 000 MW de biomasse (valorisation des déchets) ;
400 MW de cogénération ;
15 MW de géothermie.
Le total s'élève ainsi à 22 GW, dont plus de 4,5 GW doivent être réalisés d'ici à 2020.
 |
39 39 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 38
3.7.2 Maroc
Le Maroc souffre d’un manque de ressources fossiles (gaz naturel et pétrole). Ce manque
entraîne une dépendance énergétique des importations (d'Espagne pour l'électricité, entre
autres) : 96% de l’énergie marocaine est importée. Les besoins en énergie du Maroc
augmentent, tandis que les ressources se raréfient. La demande en énergie primaire a augmenté
en moyenne de près de 5% pendant ces dernières années.
Afin de remédier à cette dépendance, en 2009 le gouvernement marocain a lancé le projet
marocain pour l'énergie solaire, avec une première réalisation : le projet NOOR dont le coût
d’investissement est estimé à 9 milliards de dollars. Ce projet vise une puissance installée de
2 000 mégawatts, cela évitera l’émission de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an et permettra
de fournir l'équivalent de la consommation d’électricité de 800 000 habitants.
Les six objectifs majeurs de la feuille de route de MASEN (Agence marocaine de l'énergie
solaire) sont :
assurer la sécurité d'approvisionnement ;
généraliser l'accès à l'énergie à des prix optimisés ;
mobiliser les ressources énergétiques nationales, principalement les potentialités
importantes en énergies renouvelables ;
promouvoir l'efficacité énergétique ;
intégrer le Maroc dans le système énergétique régional ;
appliquer en amont des dispositifs de préservation de l'environnement dans toutes les
activités énergétiques.
Le complexe solaire NOOR s'inscrit dans l'objectif d'indépendance nationale. Les premiers
kilowattheures de NOOR Ouarzazate 1, la plus grande centrale de technologie à miroirs
cylindro-paraboliques au monde, seront injectés dans le réseau électrique national à partir d'août
2015. MASEN prévoit de construire ensuite les trois centrales NOOR Ouarzazate 2, 3 et 4,
finalisant ainsi le complexe solaire d’Ouarzazate, d'une capacité cible de 500 MW. Les sites
retenus pour abriter les prochains projets du plan solaire marocain NOOR sont Midelt et Tata.
L'objectif fixé par le plan solaire marocain est de 2 000 MW à l'horizon 2020, soit 14% des
besoins en énergie électrique du Royaume ; et la part des énergies renouvelables dans la
consommation électrique globale atteindra 42%.
3.7.3 Mali
En termes d’atouts, le Mali dispose : i) d’énormes potentialités en EnR, ii) des expériences
acquises dans la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes, iii) d’une approche
communautaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets, iv) d’une maîtrise des
technologies EnR et v) de beaucoup d’avancées constatées au niveau du solaire.
 |
40 40 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 39
Une vingtaine de sites hydroélectriques de moyenne et grande capacité ont été identifiés à
travers le territoire national pour une puissance totale d’équipement de 1150 MW pour un
productible d’environ 5 600 GWh, dont seulement 4 sites sont à présent aménagés et
représentent selon les estimations 30% du potentiel national (Félou 60 MW pour le Mali, soit
120 GWh/an ; Sotuba 5,2 MW, soit 40 GWh/an ; Selingué 44 MW, soit 200 GWh/an et
Manantali 104 MW, soit 800 GWh/an).
L’irradiation solaire est de l’ordre de 5 à 7 kWh/m2/jour et se trouve bien répartie sur le territoire
national. Depuis les années soixante, le Mali a créé le Laboratoire d’énergie Solaire (LESO),
qui est ensuite devenu le Centre National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables
(CNESOLER) avant de se voir ériger en Agence des Energies Renouvelables (AER-MALI).
La vitesse du vent dans les zones sahéliennes et sahariennes du pays varie de 3 à 7 m/s en
moyenne annuelle.
Les surfaces totales des formations ligneuses sur les cinq (05) régions les mieux couvertes
(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) sont estimées à près de 33 millions d’hectares
avec un volume sur pied d’environ 520 millions de m3 et une productivité pondérée sur
l’ensemble du pays d’environ 0,86 m3/ha/an.
Pays à vocation agro-pastorale, le Mali dispose chaque année d’importantes quantités de résidus
agricoles et agro-industriels dont environ un million de tonnes de tiges de cotonnier après la
récolte et une appréciable quantité annuelle de balle de riz et de résidus d’autres céréales (mil,
maïs, etc.). Aussi, le pays dispose d’un potentiel énorme de production d’huile végétale de
substitution et d’alcool carburant (bioénergie).
Le Mali regorge d’un grand potentiel en bioéthanol à travers la production annuelle de N-sukala
estimée à 10 millions de litres par an extensible à 20 millions de litres. L’utilisation du
biocarburant à base de Jatropha a atteint 740 000 litres d’huile de Jatropha en 2016, pour le
fonctionnement de plus d’une centaine de meuniers en milieu rural. L’ANADEB, l’AMADER,
la N-Sukala et la société Ecopower-sahel mènent la réflexion pour utiliser le bioéthanol dans
les réchauds afin d’amenuiser la pression sur le massif forestier. La centrale électrique à
Bagasse de N-Sukala d’une puissance installée de 40 MW contribue à la fourniture de
l’électricité dans la zone.
Pour la promotion des énergies renouvelables : dix (10) Banques commerciales (Banque
Atlantique, Banque de Développement du Mali (BDM), Banque de l’Habitat du Mali (BHM),
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM), Banque Internationale
pour le Mali (BIM), Banque Malienne de Solidarité (BMS), Bank of Africa, Banque Sahélo-
saharienne pour l’Industrie et le Commerce (BSIC), Banque Nationale de Développement
Agricole (BNDA) et Ecobank s’engagent résolument à travers un protocole d’accord avec le
Ministère de l’Energie et de l’Eau, pour financer une initiative ambitieuse qui permettra
d’accroître le taux d’acquisition individuelle de kits solaires photovoltaïques de puissances
prédéfinies ou sur mesure.
Le projet « Prêt énergie renouvelable » est une initiative de financement innovant visant à
permettre à davantage de maliens d’accéder aux énergies renouvelables. Le Gouvernement a
 |
41 41 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 40
opté pour l’introduction de ressources alternatives et facilement mobilisables pour accroître le
taux d’acquisition individuelle de kits solaires photovoltaïques de puissances prédéfinies ou sur
mesure, conçus pour satisfaire tout ou partie des besoins domestiques ou résidentiels
d’électricité, une démarche qui s’ajoute aux efforts importants déployés en faveur du secteur de
l’énergie. Ceci permettra d’augmenter le nombre d’auto-producteurs d’électricité solaire, de
contribuer à la diminution de la puissance de pointe de la demande électrique sur le réseau
public, de réduire la facture pétrolière et les charges en électricité.
3.8 Problématiques liées à l’utilisation des EnR
3.8.1. Perceptions, appropriation par le public
Les EnR semblent de plus en plus faire consensus dans le monde. Une nette tendance à la
réorientation vers les énergies renouvelables est constatée depuis la fin du XXe siècle, en
réponse à un début de raréfaction du pétrole, aux impacts climatiques et sanitaires négatifs des
énergies carbonées, à la dangerosité du nucléaire et à la difficulté de traiter ses déchets ou à sa
moindre acceptabilité après les accidents de Tchernobyl et de Fukushima.
Le prospectiviste Jeremy Rifkin annonce pour le début du XXIe siècle une possible « troisième
révolution industrielle » issue de la convergence du secteur de l'énergie et de celui de
l'informatique. Le développement de systèmes de stockage des énergies irrégulières (via
l'hydrogène ou les véhicules électriques utilisés comme accumulateurs mobiles) et celui des
smart grids autorisent la mise en commun et le partage de millions de sources distribuées
d'énergie (solaire, éolienne, marine, géothermique, hydroélectrique, issue de la biomasse et des
déchets, etc.). Jeremy Rifkin estime que cette révolution est urgente ; elle doit être mise en
œuvre avant 2050 et largement entamée en 2020 si l'humanité veut répondre aux défis du
changement climatique, à la crise du pétrole, aux crises économiques et écologiques.
Selon l’étude réalisée en 2010 par le Cabinet BVA en France portant sur le thème « Etude sur
les Français et les Energies Renouvelables », au compte de l’Agence De Maitrise d’Energie
(ADEME), 97% des Français se déclaraient favorables au développement des EnR avec une
préférence pour le solaire (61% contre 68% en 2009), l’éolien (53% contre 43% en 2009),
devant l'hydraulique (20%) et la géothermie (20%). L'acceptabilité générale a augmenté, mais
des critères d'esthétique sont cités et des craintes de nuisances sonores comme frein à leur
développement, sauf si elles sont situées à plus de 1 km du domicile. Utiliser son domicile pour
produire de l'électricité à partir de sources renouvelables semble intéressant.
En 2010, grâce notamment aux aides publiques, le solaire a gagné +13% et les pompes à chaleur
(+5%). L'acceptabilité générale EnR est en hausse, 75% des Français sont favorables à leur
installation. Cependant, l’ADEME enregistre une baisse d’acceptabilité pour les projets
installés « sur son toit », l'installation des équipements étant jugé trop compliquée pour le
particulier, trop coûteuse ou avec un temps de retour sur investissement trop long. Le principe
du tiers-investisseur peine à se développer pour les petits projets en France, et la baisse des
 |
42 42 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 41
coûts de rachats de l'électrifié photovoltaïque a probablement contribué à freiner ce secteur, en
fort développement dans d'autres pays.
Au Mali, le développement actuel des EnR a connu une acceptation appréciable des utilisateurs
au cours de ces dernières années avec l’évolution technologique de ces équipements EnR,
l’installation de plus d’un demi-millier de pompes solaires Photo Voltaïque (PV), des dizaines
de fours solaires, une dizaine d’éoliennes de pompage, quelques centaines de séchoirs, une
vingtaine de milliers de systèmes d’éclairages individuels, une utilisation intensive des
équipements EnR pour l’alimentation électrique des sites isolés par les sociétés de
télécommunications et une baisse sensible du prix de ces équipements.
Bien que les projets et programmes exécutés sous l’égide des pouvoirs publics et le secteur
privé aient permis l’installation de beaucoup d’équipements EnR et la réalisation d’appréciables
formations, ils ont été fortement handicapés par les facteurs comme la trop forte intensité du
social, le manque d’approche participative efficiente, la faible approche pour la vente de service
au profit de la vente des équipements, l’absence de cadre cohérent, l’insuffisance du service
après-vente, l’absence de mécanismes de financement appropriés, etc.
3.8.2. Effets de la baisse des prix du Photovoltaïque
La baisse des prix sur le marché a atteint en un (01) An 33% pour les modules polycristallins,
26% pour les modules monocristallins, 25,4% pour les modules au tellurure de cadmium et
48,7 % pour les modules au silicium amorphe. Selon GTM Research, les coûts de production
des modules premium des marques chinoises renommées ont diminué de plus de 50% entre
2009 et 2012, passant de 1 €/W à 0,46 €/W. Cette baisse devrait se ralentir, mais continuer
jusqu'à 0,33 €/W en 2015, grâce à de nouvelles innovations techniques.
Selon les industriels occidentaux, la baisse drastique de ces prix n'est pas seulement due aux
innovations technologiques, à la diminution du prix du silicium et aux économies d'échelle,
mais résulte également d'une stratégie de dumping des fabricants chinois, qui visent avec l'appui
de leur gouvernement à contrôler la totalité du marché mondial ; on serait dans une situation où
tous les industriels perdraient de l'argent. Les États-Unis ont annoncé dès octobre 2012 la mise
en place de droits de douanes sur les importations de cellules et modules chinois, et l'Union
européenne a annoncé en septembre l'ouverture d'une enquête antidumping, à la suite d'une
plainte déposée par EU Pro Sun, une association de 25 fabricants européens de modules
solaires.
Mais la Chine importe de grandes quantités de silicium d'Europe et des États-Unis. Elle a
annoncé, en octobre 2012, l'ouverture d'une enquête antidumping sur les importations de
silicium polycristallin en provenance de l'Union européenne, après avoir fait de même en juillet
pour les États-Unis. Le gouvernement allemand, dont l'industrie exporte et investit massivement
en Chine, presse pour une solution amiable. Le 4 juin 2013, Bruxelles avait conclu au dumping
de la part de l'industrie chinoise, qui affiche avec l'Europe un excédent commercial de
21 milliards de dollars dans les équipements solaires, et annoncé le relèvement de ses droits de
douane de 11,8% dans un premier temps avant de les augmenter de 47,6% à partir du 6 août
 |
43 43 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 42
2013. Un accord a été négocié et conclu en juillet 2013 sur un prix minimum de vente de
0,56 €/W solaire fourni et sur un volume maximum d'exportation vers l'Europe de 7 GW, soit
60% du marché européen, alors que les Chinois ont pris 80% du marché en 2012, mettant en
faillite une trentaine d'entreprise européennes.
Le groupement européen d'entreprises de panneaux solaires EU ProSun a dénoncé le 5 juin
2014 auprès de la Commission européenne quelque 1 500 violations par les entreprises
chinoises des règles anti-dumping qu'elles s'étaient engagées à respecter : ces entreprises
chinoises proposent des prix inférieurs au prix plancher ayant fait l'objet d'un accord. Selon EU
ProSun, « aucun d'entre eux ne semble respecter les prix minimum ; les produits solaires chinois
à prix cassés continuent d'inonder le marché et détruisent l'industrie et les emplois européens ».
En 2015, les surcapacités ont disparu, y compris en Chine. La croissance du marché global du
photovoltaïque devrait atteindre 33% par rapport à 2014 ; le marché atteignant 58,8 GW, les
prix moyens des galettes de silicium ont commencé à augmenter depuis juin 2015.
Une étude commandée à IHS par Solar Alliance for Europe (SAFE), réseau d'entreprises
européennes (surtout allemandes) du secteur solaire, conclut que les coûts de production des
modules photovoltaïques en Chine sont inférieurs de 22% à ceux de l'Europe du fait des
économies d'échelle, d'une large chaîne locale d'approvisionnement et d'un degré élevé de
standardisation. Le prix minimum à l'importation imposé par l'Union européenne pénalise donc
gravement la croissance de l'énergie solaire.
FIGURE 11 : Evolution des parts de marché des principaux pays producteurs de cellules
photovoltaïques
SOURCE : REN21/RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
 |
44 44 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 43
IV. DEUXIEME PARTIE : POLITIQUES ET STRATÉGIES
4.1 Cadre législatif et règlementaire
Le cadre juridique et politique, qui favorise la mise en œuvre efficace de la PEN, des différentes
stratégies et des projets/programmes, est défini par les documents suivants :
i. l'Ordonnance N°019 du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité et
le Décret N°00-183/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application ;
ii. le Cadre d'électrification rurale élaboré en 2003 ;
iii. le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
Le cadre institutionnel afférent au développement spécifique des énergies renouvelables est
composé fondamentalement de :
i. la Direction Nationale de l'Energie (DNE) ;
ii. la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF);
iii. la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) ;
iv. l'Agence des Energies Renouvelables (AER-Mali) ;
v. l'Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification
Rurale (AMADER) ;
vi. l'Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB) ;
vii. l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD) ;
viii. la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau (CREE) ;
ix. la Société Energie du Mali (EDM-SA).
Compte tenu de l'importance des acteurs, un cadre national de coordination est indispensable
pour soutenir la synergie d'actions existante afin d'assurer un développement durable et rapide
du sous-secteur des énergies renouvelables.
La politique de décentralisation, engagée dans le pays depuis 1992, permet aux Collectivités
Territoriales de concevoir, programmer et mettre en œuvre des actions de développement
économique, social et culturel d’intérêt régional et local.
Le document du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP-
2012-2017), exprime la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre la pauvreté la
priorité de toutes les priorités de développement. Cette volonté répond à une double exigence :
d’une part, rendre les actions de développement plus efficaces au profit des pauvres, et d’autre
part, définir de nouvelles politiques, de nouveaux instruments et enfin prendre des mesures
appropriées à court et moyen termes permettant au Gouvernement d’utiliser rationnellement et
efficacement les ressources internes et externes.
Les orientations nationales en matière d'énergie au Mali sont globalement déclinées dans les
politiques et stratégies suivantes.
 |
45 45 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 44
4.2 Politique Energétique Nationale (PEN)
La Politique Energétique Nationale a été adoptée en mars 2006 par le Gouvernement du Mali,
afin de renforcer et de soutenir la contribution de l'énergie pour une meilleure croissance
économique et un développement socioéconomique durables du pays.
Ainsi, comme cadre national de référence en matière d'énergie, la PEN sous-tend toutes les
initiatives et autres perspectives de développement du secteur de l'énergie. A cet effet, elle est
structurée en six (6) sous-secteurs qui sont :
i. les énergies traditionnelles ;
ii. les hydrocarbures ;
iii. l'électricité ;
iv. les énergies renouvelables ;
v. l'énergie nucléaire ;
vi. la maîtrise et l'économie d'énergie.
Toutefois, il est important de noter que les sous-secteurs i) et iv) sont consacrés respectivement
à la promotion de la bioénergie et des énergies renouvelables. Les autres sous-secteurs sont
favorables au développement d'applications d'énergies renouvelables telles, le biodiesel, les
centrales d'énergies renouvelables connectées au réseau électrique national (ou autonomes), les
lampadaires solaires, les kits solaires, etc.
La PEN vise dans son ensemble la réduction accrue de la pauvreté pour contribuer au
développement durable du pays, à travers la fourniture de services énergétiques "modernes"
accessibles au plus grand nombre de la population, au moindre coût et favorisant la promotion
des activités socioéconomiques.
Cet objectif et les axes stratégiques correspondant sont motivés par la lettre de cadrage du 23
octobre 2003 du Président de la République à l'adresse du Premier ministre, indiquant que le
"secteur rural, doit être le moteur de l'économie nationale et que sa valorisation à cet effet passe
par le renforcement des infrastructures dont l'élargissement du parc énergétique, sa
diversification et son extension aux zones rurales". En 2013, près de 70% de la population totale
du pays résidaient en milieu rural.
C'est dire que la PEN repose sur le renforcement et la diversification de l'offre énergétique pour
satisfaire une demande d'énergie à prédominance résidentielle qui croît de 14% par an (et 10%
par an pour l'électricité) sur la dernière décennie. Il s'agit donc d'une politique particulièrement
sociale, orientée vers l'amélioration de l'accès aux services de base des populations (par
exemples, la préservation de l'équité sociale à travers l'application de la péréquation tarifaire
dans la fourniture de l’électricité d'EDM-SA, autres subventions, etc.).
Pour ce faire, l'approche développée dans la PEN consiste substantiellement à la valorisation à
grande échelle des ressources énergétiques nationales notamment d'origines renouvelables
suivant les applications centralisées et/ou décentralisées, à la promotion des interconnexions de
 |
46 46 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 45
réseaux électriques inter-Etats et à la recherche pétrolière au plan national pour soutenir
durablement l'assurance de la sécurité énergétique (et plus ambitieusement de la souveraineté
énergétique) du pays.
Le mécanisme d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre de la PEN prévoit sa relecture tous
les cinq (5) ans dont le premier exercice devrait être réalisé immédiatement. Cette approche
contribue à favoriser la disponibilité de données complètes, cohérentes et appropriées pour
l'amélioration du document de politique.
Spécifiquement, la PEN vise à promouvoir une large utilisation des technologies et équipements
d’Energies Renouvelables pour accroître la part de celles-ci dans la production nationale
d’électricité de moins de 1% en 2004 à 6% en 2010 et 10% en 2015.
D'autres objectifs sectoriels importants de la PEN favorables au développement des Energies
Renouvelables existent et sont, entre autres :
sécuriser et accroître la couverture électrique du pays de 14% en 2004 à 45% en 2010
et 55% en 2015 ;
porter le taux d’électrification rurale de 1% en 2005 à 12% en 2010 et 55% en 2015 ;
intensifier la recherche sur les hydrocarbures, les combustibles solides et gazeux sur
le territoire national (l'intérêt de cette orientation est qu'elle peut à long terme,
renforcer les capacités financières du pays pour développer des technologies EnR ou
contribuer à la réduction des importations à travers la réalisation d'une raffinerie, etc.).
 |
47 47 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 46
4.3 Stratégies
4.3.1 Stratégie Nationale de Développement des Energies Renouvelables
Afin d'assurer l'atteinte de tous ses objectifs en matière d'Energies Renouvelables
conformément à la PEN, le Gouvernement du Mali a aussi adopté en 2006, la Stratégie
Nationale de Développement des Energies Renouvelables dont l'objectif principal est
d'accroître durablement la part des Energies Renouvelables (hors grande
hydroélectricité) dans le bilan énergétique global du pays de moins de 1% en 2002 à 15% en
2020.
Pour que la Stratégie Nationale pour le Développement et la Promotion des Energies
Renouvelables soit complète, il sera nécessaire d’envisager et d’entreprendre au Mali la
réalisation d’une carte des ressources naturelles disponibles et susceptibles d’être utilisées pour
la satisfaction des différents besoins énergétiques. Cela permettra de faire une analyse
comparative des coûts et de la durabilité d’une technologie EnR par rapport à une autre pour la
délivrance du ou des services souhaités.
4.3.1.1 Objectifs
Trois (03) objectifs sont retenus pour le Sous-secteur des Energies Renouvelables :
1. promouvoir une large utilisation des technologies et équipements d’Energie
Renouvelable (EnR) pour accroître la part de cette source d’énergie dans la production
nationale d’électricité de moins de 1% en 2004 à 6% en 2010 et 10 % en 2015 ;
2. créer les meilleures conditions de pérennisation des services d’Energies Renouvelables ;
3. rechercher des mécanismes de financement durables et adaptés aux Energies
Renouvelables.
4.3.1.2 Principes directeurs
Pour atteindre les objectifs fixés, la mise en œuvre de la stratégie s’inspirera de six (06)
principes directeurs qui sont :
1. clarification du rôle des acteurs du sous-secteur ;
2. mise en place d’un mécanisme de financement approprié (Etat, Partenaires, Secteur
privé) ;
3. participation plus accrue du Secteur privé et des Associations spécialisées dans la
promotion et la diffusion des EnR ;
4. implication et participation des Banques locales et des Institutions financières
décentralisées ;
5. confection locale et/ou assemblage des éléments de technologies EnR pour la
maîtrise de la technologie et la réduction des coûts des équipements EnR ;
6. information, éducation et communication (IEC) à l’endroit des populations.
4.3.1.3 Mesures
 |
48 48 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 47
Les treize (13) mesures retenues dans la Politique Energétique Nationale pour le sous-secteur
des EnR doivent être mises en œuvre prioritairement ainsi que la Stratégie Nationale de
Développement en la matière et son Plan d'Actions (PANER) sur différents horizons en vue de
soutenir une pénétration accrue de cette forme d’énergie tant dans la production nationale
d'électricité que dans le bilan énergétique global. Il s’agit de :
1. l’inventaire et la valorisation des potentialités nationales en EnR (solaires, éoliens,
biomasse, mini/micro hydroélectricité) ;
2. la promotion de l’installation massive des équipements d’énergie solaire dans les centres
communautaires ruraux (centres de santé, écoles, etc.), d’éoliennes de pompage d’eau
et d’aérogénérateurs dans les zones sahéliennes et sahariennes du pays ;
3. la promotion de la valorisation énergétique de la biomasse (briquettes combustibles,
biogaz, huile végétale, alcool, etc.) en zones agricoles et agro-industrielles ;
4. l’initiation et du soutien aux projets de montage local et de fabrication locale des
composants d’EnR ;
5. la promotion de la recherche/développement sur les technologies d’EnR non éprouvées ;
6. la promotion de l’association systématique des activités génératrices de revenus aux
projets et programmes d’EnR ;
7. l’amélioration de l’accès des promoteurs des EnR aux systèmes bancaires et autres
institutions financières à l’échelle locale, nationale et internationale ;
8. l’appui conseil aux initiatives locales promotrices du sous-secteur des EnR ;
9. la formation massive des groupes d’artisans et des promoteurs de petites et moyennes
entreprises du sous-secteur des EnR ;
10. développement de systèmes efficaces pour l’exploitation et l’entretien des équipements
d’EnR en milieu rural et périurbain ;
11. la promotion de la décentralisation territoriale des structures assurant la vente et le
service après-vente des équipements d’EnR ;
12. l’établissement d’un régime fiscal et douanier suffisamment incitatif ;
13. développement des échanges d’expériences avec d’autres pays et organismes et la
participation aux programmes énergétiques des Communautés Economiques, dans le
domaine des énergies renouvelables.
Les facteurs actuels et futurs qui constituent des enjeux essentiels pour le développement
soutenu des EnR sont entre autres :
l’amélioration de l’accès du monde rural aux services énergétiques durables pour y
assurer de meilleures conditions de vie et de productivité en privilégiant les énergies
renouvelables ;
le renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile en vue
d’insuffler au sous-secteur des EnR, un développement équilibré soutenu et durable à
travers la formation et la dotation en outils de planification et de suivi/évaluation ;
l’intensification du partenariat public-privé pour la mobilisation des ressources et le
développement du secteur des EnR ;
 |
49 49 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 48
la mise en place d’une plateforme de concertation avec les banques locales et les
institutions financières décentralisées afin de les faire découvrir les opportunités
d’affaires dans le domaine des EnR et de les convaincre à investir dans ce sous-secteur ;
l’élaboration des plans et programmes intégrés de développement des énergies
renouvelables ;
la réalisation des unités nationales et sous régionales de fabrication et/ou de montage
des composants d’énergies renouvelables ;
la restauration et/ou le renforcement des capacités techniques des centres nationaux et
sous régionaux spécialisés en énergie renouvelable ; cas de l’ex Centre Régional
d’Energie Solaire (CRES) pour en faire un Centre Régional d’excellence des Energies
Renouvelables et d’Efficacité Energétique pour la formation et la recherche en rapport
avec les instituts de recherche, les Universités et les grandes écoles ;
le renforcement du Programme intégré de développement des biocarburants (pourghère
et autres) ;
la conception de Programmes d’Electrification Rurale Décentralisés basés sur les EnR
ainsi que de projets et programmes d’intérêts sous-régionaux ;
la création de mécanismes novateurs pour le financement du sous-secteur des EnR dans
le cadre du développement durable ;
l’adhésion de façon dynamique et durable à la Coalition de Johannesburg pour les
énergies et au Conseil Mondial pour les énergies renouvelables ;
la prise en compte dans le Document de Référence dénommé Cadre stratégique pour la
Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2016-2018) de la
dimension Energie renouvelable au titre des domaines prioritaires d’intervention ;
l’appui à un programme de production et de vulgarisation de l’éthanol au Mali comme
carburant pour le transport, la production d’électricité et le gel fuel ;
l’appui au programme de production de briquettes et de combustibles à partir des résidus
agricoles et du typha ;
l’appui à un programme de sécurisation des équipements d’EnR ;
la mise en place d’un mécanisme d’exonération des coûts des équipements EnR.
En 2013, soit sept (07) ans après l'adoption de la PEN et de la stratégie Energies Renouvelables,
les résultats obtenus dans l'ensemble étaient, certes encourageants mais loin de l’atteinte des
objectifs fixés. Cependant, conformément aux prévisions de la stratégie EnR, il restait du temps
pour développer des actions contributives à l'atteinte des objectifs fixés.
En conséquence, le Gouvernement du Mali, à travers le Centre National pour l'Energie Solaire
et les Energies Renouvelables (CNESOLER) dont le statut a changé, de Service rattaché de la
Direction Nationale de l'Energie (DNE) à l'Agence des Energies Renouvelables (AER-Mali) en
septembre 2014, a initié l'élaboration d'un Plan d’Actions National d’Energies Renouvelables.
4.3.2 Plan d’Actions National des Energies Renouvelables (PANER) 2013-2033
Le PANER est une approche fédératrice et globale des opportunités de développement des
énergies renouvelables pour l'accès durable, propre et à moindre coût à l'énergie moderne.
 |
50 50 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 49
Le PANER devra à terme être conforme aux objectifs de la PEN et de la stratégie EnR révisées
et, demeurer avec ses spécificités.
Les objectifs recherchés à travers ce Plan d'Actions National des EnR, consistent à renforcer la
pénétration de cette source d’énergie dans la satisfaction des besoins en énergie à travers
l’augmentation de la part :
des EnR dans le bilan énergétique de 1% à 10% en 2033 ;
des EnR dans la production d’électricité de 5% à 25% en 2033 ;
de la bioénergie dans les EnR de 1% à 10% en 2033.
Par ailleurs, d'autres stratégies nationales contribuant particulièrement au développement des
Energies Renouvelables ont été adoptées par le Gouvernement du Mali, à savoir ;
4.3.3 Stratégie de Développement des Biocarburants (SDB)
Elle fût adoptée en 2008 et a pour objet d'accroître la production locale d’énergie par le
développement des biocarburants, en vue de fournir au moindre coût l’énergie pour satisfaire
les besoins socio-économiques du pays.
Suivant la filière Pourghère, ces objectifs correspondraient annuellement à des :
- productions d’huile de 39,2 millions de litres à l’horizon 2012 ; 56 millions de litres en
2017 et 84 millions de litres en 2022 ;
- productions de graines de 224 000 tonnes, 336 000 tonnes et 448 000 tonnes
respectivement aux horizons 2012, 2017 et 2022 ;
- superficies d’emblavement de 71 680 hectares, 53 760 hectares et 47 787 hectares
respectivement en 2012, 2017 et 2022.
Sur le plan de la lutte contre la pauvreté, trois principaux indicateurs d’impact sont retenus pour
la stratégie : i) la création de revenu monétaire au profit des femmes et de leurs ménages et
localités d’attache ii) la création des opportunités d’emplois productifs et rémunérés pour les
femmes et les jeunes et ; iii) la protection de l’environnement.
Pour assurer un meilleur positionnement stratégique des biocarburants au Mali, les 5 mesures
suivantes sont recommandées : i) Etablissement d’une feuille de route ; ii) Renforcement des
capacités ;, iii) Amélioration de l’attrait du secteur des biocarburants ;, iv) Concertation des
acteurs sur le développement de la filière Pourghère et ; v) Recherche et développement.
Au plan des risques, deux (2) facteurs potentiellement gênants sont identifiés pour le
développement des biocarburants à base de Jatropha curcas, à savoir : son caractère invasif et
sa toxicité naturelle. Au demeurant, une attention constante devra être accordée à toute la filière
pour prévenir et gérer le risque d’accidents potentiels liés à l’ingestion humaine de graines ou
d’huile par négligence, par ignorance ou par malveillance. Il importe spécifiquement de
prévenir ce risque potentiel en : i) privilégiant l’exploitation de variétés à moindre teneur en
produits toxiques ; ii) informant largement les travailleurs, les vendeurs et le public et iii)
réglementant l’apposition de signalisations visuelles sur les emballages et équipements utilisés
dans la filière.
 |
51 51 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 50
La non-comestibilité de la graine et de l’huile de Pourghère peut être considérée comme un
avantage comparatif par rapport à d’autres plantes oléagineuses qui peuvent faire l’objet de
concurrence entre les usages alimentaires et énergétiques.
Des évènements importants, tels que la baisse significative des cours du pétrole au niveau
international ou la découverte de gisements importants de ce produit au Mali, sont possibles
pendant la durée de la mise en œuvre de la Stratégie. Dans de tels cas : i) la rentabilité et la
viabilité économiques et financières des activités de production et d’exploitation des
biocarburants risques d’être compromises ; ii) la priorité accordée au développement des
biocarburants risque d’être remise en cause ; et iii) les opportunités d’exportation de
biocarburant auront tendance à se réduire, voire à disparaître.
Il est proposé de gérer ces risques en considérant que : i) l’utilisation du biocarburant sera
maintenue en milieu rural isolé, ii) l’accent sera alors mis sur la substitution du biocarburant
aux coproduits et/ou les sous-produits notamment les engrais, les insecticides, les cosmétiques,
la pharmacie et iii) une base d’entente sera conclue à cet effet entre l’Etat et les opérateurs de
la filière.
Il vise spécifiquement à promouvoir l'accès à l’énergie et son intégration dans les stratégies de
réduction de la pauvreté, ainsi que dans les programmes nationaux de développement
économique et social. Pour ce faire, le MEPRED met en œuvre une approche multisectorielle
permettant l'intervention de tous les acteurs du secteur énergétique, plus particulièrement le
secteur privé. Quatre (4) pays de l’Afrique de l’Ouest participent au programme MEPRED à
savoir : le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal.
En outre, la zone rizicole de l’Office du Niger est envahie par le Typha australis qui représente
une sérieuse nuisance pour les aménagements d’irrigation. Le réseau d’irrigation de l’Office du
Niger est très important et se compose de 75 km de canaux principaux, 153 km de canaux
distributeurs, 50 km de grands collecteurs, 491 km de partiteurs et plus de 2 000 km d’arroseurs.
La superficie des falas (bras naturels de cours d’eau) colonisés par le typha est de 269 km de
long sur 2 km de large en moyenne. Le potentiel estimé en Typha australis est de l’ordre de 100
tonnes de matière sèche (MS)/ha. Cette source est utilisable comme combustible de substitution
au bois énergie, mais demeure à présent non valorisée.
Par ailleurs, de nombreuses plantes oléagineuses poussent à l’état naturel ou sont cultivées au
Mali : zèkènèn (Balanites aegyptiaca), mpeku, ricin, pourghère, coton, etc. Les huiles pouvant
être extraites des graines de telles plantes peuvent fournir des combustibles ou carburants. En
particulier, la plante pourghère (Jatropha curcas), qui existe dans plusieurs zones (3ème, 4ème et
5ème régions administratives du Mali) et présente un très bon potentiel de biocarburant.
Dans le pays, peu de ces plantes oléagineuses ont fait l’objet d’études et recherches poussées
en vue de déterminer leurs propriétés énergétiques et d’estimer leur valeur technico-
économique comme biocarburant (comparaison coûts/avantages liés à leur développement à
grande échelle ; atouts et contraintes caractérisant leur production/exploitation).
Des potentialités de biocarburants existent également sous forme d’éthanol, sous-produit de
l’industrie du sucre ou de l’amidon. L’éthanol constitue une alternative envisageable pour le
transport, la production d’électricité et la chaleur de cuisson (gel fuel). C’est le cas notamment
pour la canne à sucre (en zone de l’Office du Niger), le sorgho à tige sucrée (nyimi-kala) et de
 |
52 52 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 51
nombreuses autres variétés de graminées, ainsi que des tubercules (patate douce, igname) et
d’arbres fruitiers (anacardier, mpeku, ngunan, etc.).
Au cours des 20 dernières années, le Ministère en charge de l’Energie a mené de nombreuses
actions, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers notamment la GTZ/GIZ,
le PNUD, le SEAF, le CIRAD (FED), l’UEMOA, l’ONUDI, etc. Ces partenaires ont contribué
à l’établissement de la faisabilité technico-économique et des avantages environnementaux de
diverses formes de valorisation de la plante pourghère.
Dans le cadre de la recherche appliquée, on peut essentiellement citer : l’Institut Polytechnique
Rural (IPR/IFRA), l’Institut d’Economie Rurale (IER) et NOVARTIS.
Dans le cadre de la plantation et de la transformation des graines, notamment de pourghère,
certaines ONG, sociétés nationales et internationales ont commencé à s’implanter notamment :
Mali-Folkecenter Nyetaa (MFC), CMDT, FactFoundation, Foundries & Agricultural
Machineries, Tissina S.A.R.L., Biodiesel Mali S.A. ; Mali Bioénergie, etc.
Ces objectifs correspondraient à une production annuelle d’huile de pourghère estimée à 39,2
millions de litres à l’horizon 2012 ; 56 millions de litres à l’horizon 2017 et 84 millions de litres
en 2022 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : Objectifs en production d’huile
Horizons
temporels
Objectifs de substitution/réduction affichés Quantités (milliers de
litres)
Jatropha Autres Jatropha Autres
2007 à 2012
Remplacer 10% de gasoil et
DDO par l’huile de pourghère
A définir après
approfondissement des
enquêtes
39.200
-
2012 à 2017
Remplacer 15% de gasoil et
DDO par l’huile de pourghère
A définir après
approfondissement des
enquêtes
56.000
-
2017 à 2022
Remplacer 20% de gasoil et
DDO par l’huile de pourghère
A définir après
approfondissement des
enquêtes
84.000
-
SOURCE : CPS/SME, REVUE 2015 DES PROJETS ET PROGRAMMES
Tableau 9 : Objectifs en production de graines et superficie emblavée
Horizons
temporels
Besoins de
production de
graines (tonnes)
Estimation productivité en
graines
Superficies à
emblaver (ha)
kg/arbre t/ha
2012 224.000 5 3,125 71 680
2017 336.000 10 6,25 53 760
2022 448.000 15 9,375 47 787
SOURCE : CPS/SME, REVUE 2015 DES PROJETS ET PROGRAMMES
4.3.4 Stratégie Energie Domestique (SED)
Elle a été élaborée en 1990 et son plan d'actions couvrait la période 1993 à 1997. Elle a visé la
gestion rationnelle des ressources forestières par les communautés rurales afin que les modes
 |
53 53 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 52
d'approvisionnement de combustibles ligneux soient davantage économiques et préservent le
cadre environnemental d'une part, et l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des énergies
modernes d'autre part. Aussi, elle a permis la création et l'exécution du PEDASB à travers
l'AMADER depuis 2003.
4.4 Résultats de quelques projets EnR
Durant les dernières décennies, diverses actions d'envergure locale et nationale, participant de
la politique générale de lutte contre la pauvreté, ont été mises en œuvre en faveur des
populations villageoises et périurbaines, à travers des projets et programmes d’Energie
Renouvelable (EnR), appuyés par des partenaires au développement.
L'approche développée par le Gouvernement du Mali dans le domaine énergétique tend à mettre
un accent particulier sur l'utilisation des systèmes EnR pour l'équipement des points d'eau, la
réfrigération, la cuisine, le transport ainsi que l'électrification du monde rural pour la
satisfaction de ses besoins essentiels.
Le développement actuel des EnR au Mali peut être illustré comme suit : i) l’évolution
technologique des équipements EnR s’est beaucoup rapprochée des préoccupations des
utilisateurs sahéliens, ii) plus d’un demi-millier de pompes solaires Photo Voltaïque (PV) sont
installées pour la satisfaction des besoins d’approvisionnement en eau des populations en milieu
rural, iii) des dizaines de fours solaires, une dizaine d’éoliennes de pompage et quelques
centaines de séchoirs sont installés, iv) une vingtaine de milliers de systèmes d’éclairage
individuels sont fonctionnels, v) les télécommunications utilisent de façon intensive les
équipements EnR pour l’alimentation électrique des sites isolés, vi) et le prix des équipements
a connu une baisse sensible.
On note également, quoi que relativement timide, la dotation du pays en certaines capacités
techniques (collecte de données, inventaire des potentialités, montage et maintenance des
systèmes d’énergie solaire et éolienne) ainsi que la formation et l’encadrement d’artisans
nationaux pour la fabrication de quelques catégories d’équipements (séchoirs, fours solaires,
etc.).
Selon le rapport sur le profil de pauvreté des 703 communes du Mali (édition 2014) de l’ODHD,
il ressort que l’énergie solaire est utilisée globalement dans la majorité des communes (546 sur
703 communes). L’utilisation des panneaux solaires se généralise dans les communes. De façon
explicite, on dira que 77,7% des communes font usage de panneaux solaires.
Tableau 10 : Pourcentage des communes urbaines et rurales faisant usage des panneaux
solaires
Région Urbain Rural Ensemble
Kayes 91,7 90,6 90,7
Koulikoro 33,3 21,0 21,3
 |
54 54 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 53
Sikasso 100,0 99,3 99,3
Ségou 100,0 99,1 99,2
Mopti 80,0 94,2 93,5
Tombouctou 33,3 46,9 46,2
Gao 100,0 63,6 66,7
Kidal 10,0 9,1
Bamako 16,7 16,7
Ensemble 67,6 78,2 77,7
SOURCE : ODHD, RAPPORT PROFIL DE PAUVRETE DES 703 COMMUNES, EDITION 2014
Le niveau des indicateurs pour le Sous-secteur des Energies Renouvelables ressorti dans le
rapport de la revue 2015 des projets et programmes du Secteur Mines et Energie donne 3,9%,
loin des 10% prévus en termes d’objectifs. A l’absence d’une évaluation de la politique
énergétique nationale, on peut attribuer cette contreperformance à l’insuffisance de financement
du secteur.
4.4.1 Projet Femmes Energies Nouvelles et Renouvelables
Le projet Femmes Énergies Nouvelles et Renouvelables (FENR) est une réponse du
Gouvernement malien aux questions posées lors de la Conférence Internationale sur les
Energies Nouvelles et Renouvelables, qui s’est tenue à Nairobi en 1981. Cette conférence a
vivement recommandé l’implication des femmes dans les mesures prises pour rationaliser la
consommation de l’énergie, car elles sont les principales productrices, utilisatrices et
gestionnaires des sources d’énergie.
Le projet a été exécuté entre 1992 et 2001 en deux phases : la phase pilote de 1992 à 1995 et
celle de l’exécution de 1996 à 2001.
Le FENR visait la promotion et l’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables par
l’installation de systèmes d’éclairage solaire, des chauffe-eaux, des séchoirs solaires ainsi que
des plateformes multifonctionnelles fonctionnant à l’huile de Pourghère. Le projet visait
également la formation des groupements de femmes pour l’utilisation des équipements installés
et la gestion des revenus qu’ils génèrent. Les partenaires du projet étaient : le PNUD et les
Gouvernements des Pays-Bas et du Mali. Le projet a été exécuté par le CNESOLER.
 |
55 55 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 54
Tableau 11 : Réalisations du projet FENR
Région Nombre
de village
Nombre
d’Éclairage
Nombre de
chauffe-eau
Nombre de
Séchoir
Nombre
d’Éolienne
Nombre de
Plate-forme
Total
Koulikoro 40 33 19 09 - - 63
Ségou 44 40 27 12 02 01 82
Sikasso 46 40 28 06 - 15 89
Total 130 113 74 27 02 16 232
SOURCE : CPS/SME, REVUE 2015 DES PROJETS ET PROGRAMMES
Tableau 12 : Réalisations du projet FENR au titre des formations
Région Nombre Formé
Ségou 150 animatrices (eurs)
Sikasso 150 animatrices (eurs)
Koulikoro 175 animatrices (eurs)
Ségou, Sikasso, Koulikoro 60 réparateurs locaux
Ségou, Sikasso, Koulikoro 3 500 femmes alphabétisées
SOURCE : CPS/SME, REVUE 2015 DES PROJETS ET PROGRAMMES
4.4.2 Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l’Avancement des
Femmes (PENRAF)
Le projet est conjointement réalisé par le Gouvernement du Mali et le PNUD. L’agence
d’exécution du projet est le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) à travers l’Agence des
Energie Renouvelable (AER-MALI). Le projet a été conjointement géré avec le PNUD selon
les procédures nationales.
Les activités ont porté sur :
l’information et la sensibilisation des groupes cibles : cette activité vise à faire
connaître le projet, les technologies EnR et leurs contributions au développement du
milieu rural. Elle précède toutes les activités sur le terrain. Le but recherché est d’arriver
à une grande sensibilisation des décideurs aux niveaux national et régional ;
la formation des groupes cibles sur les EnR : ce volet, à travers les différentes
formations a créé les conditions nécessaires pour l’appropriation des technologies EnR
par les bénéficiaires et leur multiplication. Il s’agit des technologies suivantes :
Eclairage solaire, Chauffe-eau solaire, Séchoirs solaires, Cuiseurs solaires,
Réfrigérateur solaire, Eolienne de pompage, Aérogénérateur, Biogaz, etc. ;
le développement d’un système opérationnel de réparation et
d’approvisionnement en pièces de rechanges : ce volet a créé les conditions propices
en milieu rural pour l’auto développement des Energies Renouvelables par une forte
implication des partenaires que sont la chambre de commerce et la coordination des
artisans en vue d’assurer l’approvisionnement en pièces de rechange, la réparation de
proximité et la production locale de matériels solaires thermiques ;
 |
56 56 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 55
l’installation des équipements : le projet a mis à la disposition des bénéficiaires des
équipements EnR pour améliorer leurs conditions de vie des et à réduire la pression sur
le couvert végétal. L’implication du secteur privé, des ONGs et des artisans à cette
activité a été très bénéfique pour l’économie locale des régions bénéficiaires.
En plus de ces activités mentionnées, le projet fait de l’Appui Conseil pour la promotion des
Activités Génératrices de Revenus. Cet appui conseil permet de renforcer les compétences
des groupes cibles dans le domaine de l’organisation en gestion d’entreprise et de marketing
(exemple : production et commercialisation des produits séchés). Le PENRAF est à sa troisième
phase.
4.4.3 Etudes du Gisement Eolien (PEGET)
Des équipements de mesure de la vitesse et de la régularité du vent ont été installés dans
plusieurs localités. Il s’agit de :
trois (03) équipements de mesure dans la région de Tombouctou : Tombouctou aéroport,
Goundam météo et Niafunké météo ;
un (01) équipement de mesure installé à Gao : Gao aéroport ;
quatre (04) équipements de mesure dans la région de Mopti : Sévaré aéroport, Hombori
météo, Koro météo et Bandiagara ville ;
trois (03) équipements de mesure dans la région de Ségou : Ségou météo, San météo et
Macina météo ;
deux (02) équipements de mesure dans la région de Sikasso : Sikasso aéroport et
Kadiolo météo ;
un (01) équipement de mesure dans la région de Koulikoro : Kangaba météo ;
deux (02) équipements de mesure dans la région de Kayes : Kayes aéroport et Nioro
aéroport ;
un (01) équipement de mesure à Bamako : Bamako ex-CRES colline de Badalabougou.
Programme National de Valorisation Energétique de la Plante Pourghère
(PNVEP) :
L’exécution de ce programme a permis d’avoir les résultats suivants :
830 ménages dans les (6) villages électrifiés ont accès au service de l’électricité par ce
qu’ils sont raccordés au réseau et les autres ménages à travers l’éclairage public ;
33 000 ha de pourghère sont emblavés et rentrent en production (quantité de graine
environ 66 000 tonnes) ; ainsi le revenu et les conditions de vie des producteurs vont
être améliorés grâce à la transformation et à l’utilisation des produits pourghère ;
l’organisation d’une large concertation sur la filière Pourghère afin d’orienter les acteurs
susceptibles d’être impliqués ;
l’évaluation du potentiel productif en termes de superficies plantées et de nouvelles
emblavures à réaliser ;
 |
57 57 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 56
la création de 100 000 emplois directs et de 50 000 emplois indirects par la vulgarisation
de la culture et l’organisation de la filière de collecte de graines et ainsi que la
transformation des sous-produits ;
l’élaboration/exécution d’un plan de communication prenant en compte les sensibilités
et les préoccupations de tous les acteurs et bénéficiaires des usages de la plante
pourghère ;
la constitution d’organisations paysannes autour de la valorisation du pourghère ;
le transfert de compétences aux populations rurales bénéficiaires des technologies et
équipements (15 000 producteurs formés en conduite de pépinières, technique culturale,
collecte, stockage, transformation et utilisation des produits et coproduits).
4.4.4 Electrification rurale de l’AMADER
Tableau 13 : Résultat de l’électrification rurale de l’AMADER
N° Opérateur Localités
Puissance
Totale
(KWc)
Réseau
(km)
Coût
Projet
(millions
de FCFA)
Contrepartie
Opérateur
(millions de
FCFA)
Etat
d'avancement
du projet
1 KAMA
Région de
Kayes:
1-Doualé
2-Madina
3-Djedigui
Kassé
4-Guindinta
5-
Kourounidifing
6-Kandia
79 9,66 580,373 127,682
le génie civil
est réalisé à
80% dans les
différentes
localités ;
les matériels
des centrales
sont livrés sur
sites ;
les réseaux sont
en cours de
tirage.
Taux d’exécution
global estimé à
80%
2 CPSE
Région de
Koulikoro:
1-Bancoumana
32 10,5 264, 906 52, 981
Les installations
sont en phases
d’exploitation
3 BMB
Région de
Kayes:
1-Yéréré
2-Nomo
3-Korokodjo
61 14,42 569, 604 113, 920
Le recrutement
des entreprises
est en cours.
4 SEECO
Région de
Ségou:
1-Ténéni
32 10 311, 229 62, 245
Les installations
sont en phases
d’essai.
 |
58 58 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 57
N° Opérateur Localités
Puissance
Totale
(KWc)
Réseau
(km)
Coût
Projet
(millions
de FCFA)
Contrepartie
Opérateur
(millions de
FCFA)
Etat
d'avancement
du projet
5 MOHACOM
Région de
Kayes:
1-Tigana
2-Soroané
37 6 284, 847 62, 666
Les installations
sont en phases
d’essai.
6 SPE
Région de
Koulikoro:
1-Kourémalé
42 5 253, 912 55, 860
Les installations
sont en phases
d’essai
14 localités 283 56 2 264, 873 475, 357
SOURCE : AMADER
4.4.5 Valorisation Energétique des Résidus Agricoles « BIOMASSE MALI »
L’objectif principal de la valorisation énergétique des résidus agricoles est la production de
combustibles de substitution au bois et charbon de bois.
La société « Biomasse Mali SARL » produit des briquettes combustibles par la technique de
carbonisation et de l’agglomération. Les acquis de « Biomasse Mali » en matière de production
de briquettes sont :
l’installation d’une unité de production de briquettes combustibles à Bamako ayant une
capacité de 600 kg en 8 heures;
la mise en place d’une chaîne d’agglomération qui en compte 5 et 2 broyeurs
la fabrication et la commercialisation de plus de 40 carbonisateurs ;
la formation de plus de 60 personnes aux techniques de carbonisation (dont une
association de femmes) à Falan, Koula, Kalfabougou et Djinina ;
la production de plusieurs dizaines de tonnes de briquettes.
4.4.6 Objectifs des autres projets en cours
1. Le Projet Energie Domestique et Accès aux Services de Base en milieu rural
(PEDASB) est financé par le Mali, la Banque Mondiale, le FEM, la Coopération Suédoise et
la KFW, pour un coût global de 64 millions $ EU pour 5 ans. Il vise à : (i) augmenter le taux
d’électrification dans les zones rurales à hauteur de 12% dans les cinq (5) prochaines années
(2005-2009) et de 80% à l’horizon 2020; (ii) atteindre 60 000 abonnés aux services d’électricité
en zones rurales et périurbaines ; (iii) mettre en place environ 500 systèmes solaires
photovoltaïques communautaires ou institutionnels (pour les services collectifs, les Centres de
Santé, le pompage photovoltaïque, les Administrations) et (iv) mettre en place environ 10 000
systèmes solaires photovoltaïques domestiques individuels.
2. Le Projet Mini/Micro centrales hydroélectrique, financé par le Mali, le PNUD et la
BAD pour un montant de 6,1 millions de $ EU, pour la réalisation de six (06) centrales (447
kW) pour une population de 17 000 personnes.
 |
59 59 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 58
3. Le projet PRODERE, financé par l’UEMOA dans les 8 pays membres a installé 2425
kits solaires individuels, 92 kits communautaires, 378 lampadaires solaires pour l’éclairage
public et équipé 18 adductions d’eau potable en système de pompage solaire. La deuxième
phase est en préparation.
4. Le Projet Electrification Villageoise par systèmes d’Energie Solaire (PEVES) a été
lancé en 2003 pour 4 ans avec un coût total de 1 685 494 000 F CFA, financé par les Etats du
Mali et de l’Inde avec une participation prévue des futurs bénéficiaires.
5. Le volet Energies Renouvelables du PEDASB, en préparation pour une enveloppe de
3,2 millions de dollars US. Ce sera financé par le FEM, le Mali et d’autres partenaires financiers
en tant qu’un appui opérationnel à la Politique Energétique au Mali à travers la promotion du
sous-secteur des énergies renouvelables.
6. Le projet d’appui au CNESOLER a été financé sur 4 ans pour la réalisation de cartes
des données du rayonnement solaire et du gisement éolien sur le territoire national nécessaire
au choix optimal de ces technologies.
7. Le projet de réhabilitation des machines de fabrication des prototypes d’énergies
renouvelables du CNESOLER, est prévu pour 2 ans.
8. La création d’un Centre d’excellence national et/ou sous régional dans le domaine
des EnR sera prometteur ;
9. La réalisation d’Unités de montage et de fabrication de composants EnR pour le
marché national et sous régional contribuera fortement à la maîtrise de la technologie ainsi qu’à
la diminution des coûts de production.
 |
60 60 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 59
4.5 Acquis des projets programmes
Au Mali, au cours des dix à quinze dernières années, il y a eu de nombreux acquis, dont les plus
importants sont les suivants :
Acquis technologiques : de nombreuses technologies ont été expérimentées avec de beaucoup
de réussites (barrages hydroélectriques, systèmes de pompage photovoltaïques, éclairage
public, réfrigération, systèmes de télécommunication, chauffe-eaux solaires, etc.). D’autres
technologies prometteuses ont été identifiées et peuvent être davantage développées (systèmes
de biogaz pour les ménages, systèmes de biogaz pour les industries, systèmes de combustion
pour les déchets municipaux et/ou industriels, et production de biocarburants). Des systèmes
énergétiques solaires ont été introduits avec succès au cours de la dernière décennie, en
particulier grâce à l’appui de la Banque mondiale (BM), du Fonds environnemental mondial
(FEM) et du Fonds pour l’Electrification rurale (FER). Environ 10% de l’approvisionnement
d’électricité dans les zones rurales sont assurés aujourd’hui par les EnR.
Acquis au niveau des politiques : La vision et les objectifs du Gouvernement malien ont été
formulés dans des documents importants, à savoir : (i) la Politique Energétique Nationale
(PEN), adoptée en 2006 ; (ii) la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies
Renouvelables, adoptée en 2006 ; (iii) la Stratégie Nationale pour le Développement des
Biocarburants adoptée en juin 2008 ; la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie couvrant la
période 2009-2012 et le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement
Durable (CREDD) 2016-2018.
Acquis au niveau institutionnel : En tenant compte de la dimension transversale de l’énergie,
le Mali a créé et renforcé un certain nombre d’institutions, qui jouent un rôle clé dans le
développement du sous-secteur de l’EnR. Le Cabinet du Premier ministre est impliqué
directement par le biais de la supervision de la Commission de Régulation de l’Electricité et de
l’Eau (CREE) et d’autres directions et agences. La Direction Nationale de l’Energie formule
les politiques énergétiques nationales et assure la coordination et la supervision techniques des
services régionaux et subrégionaux. Les services d’électricité sont essentiellement fournis par
l’Agence Malienne de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER), comme
aussi par les opérateurs privés (AMADER supervise aussi le FER). D’autres importantes
institutions du secteur sont le Centre National de l’Energie Solaire et des Energies
Renouvelables (CNESOLER) et l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants
(ANADEB).
Acquis environnementaux et sociaux : L’impact environnemental et social des projets
énergétiques est évalué en fonction des procédures nationales, sous la responsabilité du
Ministère en charge de l’Environnement et des dispositifs de sauvegarde conformes aux
exigences des BMD. Une stratégie nationale pour la lutte contre le changement climatique a été
finalisée en septembre 2011. Des activités spécifiques, qui tiennent compte des différences liées
au genre, ont été identifiées (elles ont de fortes potentialités liées à l’utilisation productive de
 |
61 61 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 60
l’énergie), comme aussi des mesures visant au renforcement du partenariat public-privé entre
les prestataires de services locaux et les agences nationales (ces aspects sont le résultat d’une
étude genre de la Banque mondiale et seront approfondis ultérieurement dans le cadre du PI).
Acquis en matière d’accès à l’énergie rurale : Au cours des dix dernières années, le
Gouvernement malien a lancé un ambitieux programme d’accès à l’énergie rurale, pour
atteindre les objectifs d’électrification rurale définis par la Politique Energétique Nationale.
Dans les zones rurales, les compagnies privées locales d’énergie, avec l’appui de l’AMADER,
ont permis la mise en œuvre d’un programme réussi d’électrification rurale. Le taux d’accès à
l’énergie rurale a connu des augmentations, en passant de 1% en 2000 à 15% en 2010. On
estime que 10% des services énergétiques ruraux sont fournis à partir d’EnR, y compris des
applications à petite échelle, comme les kits solaires individuels.
 |
62 62 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 61
4.6 Impacts des EnR sur le développement socioéconomique des zones rurales
Tableau 14 : Impacts de quelques projets Energie Renouvelable
Intervention Impacts Socioéconomiques
Plateformes
Multifonctionnelles
pour la Lutte contre la
Pauvreté au Mali qui
utilisent l’EnR
L’un des impacts les plus importants de la plateforme est le gain de temps.
Il est estimé que pour la seule transformation mécanique des céréales
(mil/sorgho, maïs), le gain de temps cumulé par femme sur une semaine
est équivalent à une journée de travail de huit (08) heures ;
Une amélioration des conditions sanitaires à travers notamment la
distribution d’eau potable et l'éclairage des centres de santé ;
L’Utilisation de l’huile de Pourghère comme carburant en remplacement
du gasoil permet d’économiser en moyenne 928 800 franc CFA par an et
par plate-forme ;
La valeur monétaire des graines de Pourghère est de 55 franc CFA/kg. Pour
les sous-produits leur valeur monétaire est estimée à 40% de la valeur des
graines. Ces revenus générés par les plates-formes à travers la valorisation
de la plante Pourghère contribuent grandement à la diversification des
sources de revenus, à la lutte contre la pauvreté, à l’accroissement du
Produit Intérieur Brut.
Stratégie de l’Energie
Domestique
Le projet a permis l’économie de 65 FCFA/jour au niveau des dépenses en
combustibles.
Le projet a permis la création de travail pour plus de 565 artisans dans le
cadre de la production des fourneaux améliorés ;
Les foyers améliorés ont permis d’éviter la consommation de 404 631
tonnes de bois et l’émission de 2,8 millions de tonnes de CO2 pendant la
période 1997-2000 ;
Le projet a permis l’aménagement de plus de 320 414 ha de forêt.
Projet Femmes
Energies Nouvelles et
Renouvelables (FENR)
Un chauffe-eau solaire peut contribuer à économiser 20.880 FCFA par an.
Il est donc estimé que les 74 chauffe-eau installés par le projet permettront
d’économiser 23.176.800 FCFA pendant leur durée de vie de 15 ans ;
Il est estimé qu’un chauffe-eau installé dans une maternité permet d’éviter
pendant 15 ans la consommation de 171 tonnes de bois, ce qui correspond
à 1 350 000 kilomètres carrée de forêts ;
L’utilisation des plateformes multifonctionnelles libère du temps pour les
femmes qu’elles peuvent consacrer aux activités génératrices de revenus
comme le jardinage et le tissage ;
Le projet a aussi formé plus de 475 animatrices (eurs) et plus de 60
réparateurs.
Société de Services
Décentralisés (SSD)
Les habitants tirent les avantages inhérents à la disponibilité de
l’électricité. Beaucoup d’activités génératrices de revenus comme : le
tissage, la couture etc., peuvent être entreprises dans les villages tard dans
la nuit. Les artisans peuvent améliorer leurs travaux grâce à l’électricité
(possibilité de faire la soudure).
 |
63 63 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 62
Intervention Impacts Socioéconomiques
Valorisation
Énergétique des
Résidus Agricoles
BIOMASSE MALI
• La vente des tiges de cotonnier et de poussier de charbon constitue une
source de revenu supplémentaire pour les paysans et pour les revendeurs
de charbon ;
• La société contribue à la création d’emplois par l’emploi d’une dizaine de
personnes pour la production des briquettes combustibles ;
• La substitution des briquettes combustibles à base de tige de cotonnier au
charbon de bois permet d’éviter la coupe massive du bois.
PRODERE • La résolution des besoins d’éclairage des populations ;
• La réalisation des travaux domestiques pendant la nuit ;
• L’opportunité offerte aux enfants d’apprendre la nuit ;
• La conservation des vaccins ;
• La facilitation de l’accomplissement des cultes ;L’accès à l’eau potable des
populations.
Source : AbeekuBrew-Hammond et Anna Crole-Rees, Octobre 2001. Les plates-formes multifonctionnelles
en Afrique. Revue axée sur le développement d’une initiative régionale. PNUD/PRODERE 2015.
 |
64 64 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 63
4.7 Difficultés pour la Promotion des EnR
Bien que les projets et programmes exécutés sous l’égide des pouvoirs publics et le secteur
privé aient permis l’installation de beaucoup d’équipements EnR et d’assurer d’appréciables
formations, ils ont été fortement handicapés par les facteurs suivants :
les pesanteurs socioculturelles ;
le manque d’approche participative efficiente ;
le manque d’approche pour la vente de service au profit de la vente des équipements ;
l’absence de cadre de cohérence (stratégie et plan directeur) ;
l’insuffisance du service après-vente ;
l’absence de mécanismes de financement appropriés ;
le coût élevé des équipements EnR pour les populations pauvres ;
le manque d’informations du grand public sur les EnR ;
le manque de ressources humaines qualifiées ;
l’insuffisance des équipements technologiques ;
les difficultés de mobilisation des fonds de l’Etat pour financer la
Recherche/Développement ;
l’insuffisance du cadre règlementaire, institutionnel et tarifaire ;
l’inondation du marché par des produits de contrefaçon ;
le manque de synergies entre les différents intervenants dans le domaine des EnR.
D’importantes problématiques et contraintes restent cependant à lever à court et moyen termes
pour assurer un développement équilibré et durable du Sous-secteur, notamment : i)
l’inadéquation de la fiscalité et des prix du bois avec les coûts réels de la ressource ligneuse ;
ii) la faiblesse du contrôle forestier ; iii) le fait que le bois énergie demeure défavorisé par
rapport aux autres combustibles ; iv) la répartition inégale des ressources ligneuses sur le
territoire national ; v) l’atteinte du capital forestier de certaines régions du pays et vi) le rythme
de consommation de bois énergie supérieur à la capacité de régénération naturelle des massifs
forestiers.
L’utilisation à grande échelle des technologies d’énergie renouvelable rencontre également
d’importantes barrières d’ordre institutionnel, réglementaire, technique, économique,
financier et organisationnel qu’il importe de lever afin de faciliter leur pleine promotion. On
peut retenir entre autres : i) l’insuffisance de ressources humaines qualifiées, ii) la faible
implication de la population dans le montage des projets, iii) l’absence d’unités locales de
production et de montage de composants des technologies d’énergie renouvelable, iv)
l’insuffisance des ressources financières de la population et de l’Etat, v) les difficultés d’accès
aux crédits des promoteurs des technologies d’énergie renouvelable, vi) le sous équipement des
opérateurs du sous-secteur des énergies renouvelables et vii) la taille réduite du marché
national.
Le manque de financement à souhait de différentes stratégies est la principale difficulté dans la
mise en œuvre des projets énergétiques en général et des EnR en particulier. A titre
d’illustration, l’inscription au Budget Spécial d’Investissement (BSI) du sous-secteur énergie a
été de 37 435 millions en 2015 contre 46 834 millions en 2014 ; soit une diminution de 21%.
 |
65 65 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 64
Tableau 15 : Exécution budgétaire du secteur énergie (millions de FCFA)
Investissements dans les infrastructures énergétiques
2013 2014 2015
Programmation annuelle des investissements du BSI 18 854 46 834 37 435,4
Investissements annuels réalisés du BSI 9 713 22 375 20 992,6
Taux d’exécution (%) 51,51 47,77 56,1
SOURCE : RECUEIL DES INDICATEURS STATISTIQUES DE LA CPS/ME 2015
 |
66 66 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 65
V. TROISIEME PARTIE : ENJEUX, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES
5.1 Enjeux
La problématique des énergies renouvelables est de plus en plus positionnée dans un nouveau
paradigme du fait de nouveaux enjeux à l’échelle mondiale, continentale, nationale, voire
locale. Mondialement, 22,1% de l'électricité proviennent de sources renouvelables, dont 16,4%
pour l'hydraulique.
L’analyse qualitative, quantitative et géographique des enjeux pour les différentes filières
devrait amener à nuancer l’approche répandue selon laquelle les EnR sont avant tout un enjeu
pour le développement des pays du Sud. En effet, si l’on tient compte des besoins à satisfaire
dans les décennies à venir, les potentiels globaux raisonnablement mobilisables au Nord et au
Sud sont voisins, même s’ils sont très différentiés, filière par filière.
Par ailleurs, l’accès à ces potentiels renouvelables est beaucoup plus facile dans les pays du
Nord que dans ceux en développement. Si pour les premiers, le problème de l’introduction des
renouvelables n’est principalement qu’une affaire de substitution sur un marché existant, très
développé et solvable, pour les seconds, il s’agit bien souvent de développer l’accession à des
services énergétiques inexistants ou très insuffisants, en faveur de consommateurs pauvres,
dans des zones dispersées, et dans des conditions techniques et de risque défavorables, donc
« qui pourra payer quoi, comment et quand ? », le coût de développement des technologies
EnR restant encore de nos jours assez élevé.
5.1.1 Prise de conscience mondiale du rôle des EnR dans les stratégies
énergétiques futures pour un développement durable
En plus des facteurs précités qui justifient l'importance que la Convention sur la lutte contre la
désertification accorde aux technologies d’énergie renouvelable, s’ajoute l’intérêt manifeste
que la communauté internationale, à travers les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), porte sur la promotion des énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique.
En effet, ce consensus international demande plus d’effort pour renforcer l’accès aux services
énergétiques pour les populations rurales et pour contribuer à la sauvegarde de
l’environnement mondial. Cela, à travers la maîtrise de la croissance des consommations
d’énergie et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le potentiel énergétique
des pays en développement. L’initiative OMD s’inscrit dans le cadre du renforcement des
efforts de coopération technique et institutionnelle pour faciliter la structuration des
politiques énergétiques nationales et mettre en place les structures nécessaires à la
conception et à la bonne réalisation des projets. Elle vise notamment à :
développer les marchés des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, par la
meilleure utilisation des mécanismes financiers existants, les partenariats public-privé,
et la mobilisation de l’épargne locale ;
 |
67 67 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 66
coordonner de façon très structurée et simplifiée les principales étapes du financement
de projets/programmes par la création d'une plate-forme commune.
5.1.2 Gains d’opportunités à l’échelle continentale à travers le NEPAD
Au niveau continental, l’initiative africaine traduite par le NEPAD vise globalement dans le
secteur de l’énergie à réduire le fossé qui sépare les pays du continent des pays développés, par
la mise à disposition d’énergie de qualité, en quantité suffisante et à des prix abordables.
Ainsi, à travers son approche basée sur une politique volontariste de réalisation d’infrastructures
à caractère régional, le NEPAD vise à accroître la taille des marchés énergétiques en faisant
profiter l’abondance énergétique des pays excédentaires à ceux faiblement dotés en ces
ressources et cela à l’aide des interconnexions. Dans cette optique, des projets transfrontaliers
vont voir le jour pour traduire la volonté des Etats de renforcer leur coopération régionale tant
pour le développement des énergies renouvelables que pour améliorer l’efficacité et la fiabilité
de la fourniture d’énergie.
5.1.3 Intégration dans les nouveaux mécanismes de lutte contre la pauvreté
à l’échelle nationale et locale
A l’échelle nationale et locale, les Pays en Développement particulièrement les pays africains,
se trouvent dans une nouvelle dynamique d’élaboration et de mise en œuvre des plans
stratégiques de réduction de la pauvreté. L’attention a été récemment portée sur une approche
multisectorielle de mise en œuvre de ces plans avec un accent sur l’apport en service
énergétique. Ce faisant, compte tenu de la transversalité de l’énergie, il est aujourd’hui urgent
de la considérer dans toute sa dimension comme étant le socle de développement des autres
secteurs stratégiques de réduction de la pauvreté tels que l’éducation, la santé, l’agriculture,
l’eau et les PME/PMI. Aucun secteur ne peut émerger réellement dans une perspective de lutte
contre la pauvreté sans un apport conséquent de services énergétiques.
Cette vision est fortement partagée par certaines institutions internationales, y compris la
Banque Mondiale, qui vient de lancer un processus de concertation sous régionale pour un
développement optimal des synergies entre l’énergie et les autres secteurs afin d’assurer une
bonne création des richesses, promotion des services sociaux de base et l’amélioration des
conditions de vie des groupes vulnérables.
L’initiative Européenne de l’énergie (EUEI) ouvre également de grandes perspectives pour la
mise en œuvre de programmes énergétiques d’envergure destinés à la réduction de la pauvreté.
Elle doit procéder, dans un pays donné, à une analyse en profondeur des besoins en services
énergétiques requis par la politique de réduction de la pauvreté avec le souci, entre autres, de :
mieux articuler la politique énergétique et les politiques sectorielles ;
identifier des actions en faveur de l’accès à l’énergie.
Ainsi, la problématique de l’accès à l’énergie exprime tout l’intérêt pour le développement
harmonieux des énergies renouvelables en Afrique. Et cela, d’autant plus que toutes les
 |
68 68 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 67
stratégies énergétiques futures intègrent l’utilisation d’énergie propre principalement là où le
potentiel de valorisation existe.
5.1.4 Genre et Energies Renouvelables
L’Afrique de l’Ouest dispose de sources d’énergies renouvelables abondantes. Selon les
estimations, un potentiel total de 23 000 MW de petite hydroélectricité est concentré dans cinq
États membres de la CEDEAO et seuls 16% sont exploités. La biomasse traditionnelle reste la
principale source d’énergie exploitée par la majorité pauvre et constitue 80% de l’énergie totale
consommée pour des besoins domestiques. Par ailleurs, les ressources énergétiques éoliennes,
maritimes et thermiques sont également considérables. La région possède également un
potentiel énergétique solaire important. Ces sources pourraient être développées pour réduire
les charges des femmes les plus pauvres dans leurs efforts pour répondre à leurs besoins en
énergie. Néanmoins, les efforts réalisés sont insuffisants pour satisfaire les besoins des femmes
afin d’assurer leurs accès à des services énergétiques abordables. De nombreux facteurs sont en
cause, notamment le manque de reconnaissance des besoins, des savoirs puis des contributions
des femmes en matière d’énergie et les défaillances dans la redistribution, le contrôle des
ressources ainsi que des avantages tirés des services énergétiques. Il y a un besoin urgent de
reconnaître que le statut de la femme dans le foyer détermine son accès aux ressources et son
contrôle sur ces dernières, ainsi que la façon dont elle pourrait bénéficier des interventions et
des actions en matière de développement.
Dans le secteur spécifique des énergies renouvelables, il y a quatre domaines clés où les
questions de genre peuvent être identifiées :
le savoir des femmes est critique pour la gestion des ressources naturelles ;
les innovations technologiques visant à améliorer l’accès à l’énergie ;
les besoins énergétiques spécifiques liés aux activités productives des femmes ;
le rôle joué par les femmes comme agents clés de changement, leur autonomisation, la
valeur économique de leurs tâches de soins à la famille particulièrement au niveau du
foyer et de la communauté (collecte d’eau et de bois de chauffe, entretien et préparation
des repas, éducation des enfants, etc.).
Un certain nombre d’initiatives en matière d’énergies renouvelables ont été mises en œuvre en
Afrique de l’Ouest pour favoriser les femmes utilisatrices et consommatrices d’énergie et les
impliquer dans des programmes de fourneaux. Par exemple, au Ghana le Ministère de l’Énergie
a travaillé directement à la promotion de plusieurs fourneaux améliorés, surtout de 1990 à 2000.
Les leçons clés tirées de ces programmes ont montré que l’implication des femmes grâce à leurs
connaissances autochtones a été un facteur déterminant pour le succès des conceptions, de
l’utilisation, de la commercialisation et de la diffusion des appareils. En tant qu’entrepreneures
en énergie, les femmes sont surtout intéressées par les technologies d’énergies renouvelables
susceptibles d’accroître leurs revenus, ce qui leur permettrait d’améliorer leur cadre de vie et
ceux de leurs familles. Dans plusieurs pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal, les
femmes utilisant des plates-formes multifonctionnelles (PTMF) ont enregistré d’importants
bénéfices.
 |
69 69 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 68
Avec l’étude de cas du Burkina Faso, le programme de plates-formes multifonctionnelles a été
promu en tant qu’un élément du cadre stratégique pour la réduction de la pauvreté dans le pays.
Il avait pour objectif de réduire la pauvreté dans des zones rurales et périurbaines de ce pays
par la promotion de l’accès des femmes aux services énergétiques modernes, essentiels pour la
croissance économique et le bien-être des populations. Avec la mise en place de 23 PTMF, les
résultats positifs sont nombreux : économies de temps pour les femmes dégagées de leurs tâches
domestiques, augmentation de la production agricole, développement d’activités génératrices
de revenus, mobilisation des systèmes bancaires locaux, introduction du micro financement et
opportunités d’emploi.
L’utilisation du “fumoir Chorkor” dans les communautés de pêcheurs du Ghana, où la majorité
des femmes vendent du poisson, est un cas similaire. Les femmes de la région centrale du Ghana
fumaient le poisson avec le fumoir traditionnel en glaise, avec de grandes ouvertures à la base
et des ventilations dans les coins supérieurs. Ce fumoir traditionnel ne pouvait accueillir qu’une
seule couche de poisson. Le processus impliquait des difficultés de fonctionnement, notamment
le coût élevé de la production, car le fumoir consomme beaucoup de bois et donc réduit les
marges de profit. Cette méthode, comme le four suisse traditionnel utilisé pour griller le gari,
générait beaucoup trop de fumée et de chaleur, avec des conséquences nocives sur la santé des
poissonnières. La conception du fumoir Chorkor lui confère des caractéristiques améliorées et
lui permet de contenir jusqu’à cinq couches de poissons, ce qui permet de le retourner
facilement au cours du processus de fumage. Ainsi, le poisson fumé est très bon et vendu plus
rapidement. Le fumoir Chorkor est également associé à la réduction de la fumée et de la chaleur,
ce qui améliore la qualité du poisson et réduit les risques pour la santé, liée à la chaleur et à la
fumée excessives. De plus, sa consommation de bois de chauffe étant moindre, les coûts de
production sont réduits et les marges accrues.
Le fumoir Chorkor peut être construit avec des blocs de ciment pour supporter les pluies
abondantes, la plupart des sites de production n’étant pas couverts. Deux ans après
l’introduction du fumoir Chorkor dans ces communautés, la plupart des femmes qui avaient
bénéficié d’une formation ont adopté la technologie et ont accru leurs revenus et leur possession
d’actifs.
D’autres projets se sont concentrés sur le renversement des rôles entre les sexes, en étendant les
capacités techniques des femmes, grâce à une formation efficace. Le meilleur exemple en est
l’installation de panneaux solaires au Mali, dans le cadre du Projet Promotion des Energies
Nouvelles et Renouvelables pour l’Avancement des Femmes (PENRAF), mis en place depuis
2003. Les femmes et les hommes ont été formés pour réaliser des séchoirs solaires et des
chauffe-eaux et les jeunes femmes ont été formées pour installer et maintenir les panneaux
solaires. Jusqu’à présent, 30 000 femmes et hommes dans 55 communautés ont directement
bénéficié du projet. L'association des Femmes et des Jeunes gère les installations de séchage
solaires et la recharge des batteries solaires. Dans les centres de santé des localités ayant
bénéficié du projet, l’éclairage solaire a remplacé les lampes au kérosène et les torches
électriques utilisées la nuit à l’origine pour les visites de contrôle et les accouchements. Les
chauffe-eaux produisent également de l’eau en permanence pour les patients et les réfrigérateurs
 |
70 70 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 69
alimentés à l’énergie solaire permettent de conserver les vaccins et les médicaments à des
températures adéquates.
Une autre étape décisive a été la priorité donnée au rôle de la femme dans la gestion des services
énergétiques. Dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, de nombreuses plates-formes
multifonctionnelles sont gérées par des femmes. La formation reçue dans des pays comme le
Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée permet aux femmes de développer
leurs compétences entrepreneuriales, de produire et de distribuer l’énergie, mais également
d’élargir leurs capacités en tant que propriétaires d’activités.
 |
71 71 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 70
5.2 Contraintes
Les contraintes au développement des énergies renouvelables sont d’ordre institutionnel,
économique, financière, technique et social. On peut retenir entre autres :
la faible coordination entre l’ensemble des agences impliquées dans le développement
des EnR, faiblesse des processus de planification, manque d’un cadre pour le partenariat
public/privé spécifique pour les projets connectés au réseau, déficit de règlementation
prenant en compte la vente du surplus d’un auto producteur EnR au réseau ;
la faiblesse des institutions financières nationales, coûts d’investissement élevés des
technologies EnR, mesures incitatives financières peu attractives pour les
investissements du secteur privé, et difficultés à canaliser des sources de financement
internationales pour le développement à large échelle des EnR, taille réduite du marché
national ;
les capacités limitées des ressources humaines du secteur énergétique, nombre limité
d’études et d’évaluations d’impact des EnR pour la production d’électricité, saisonnalité
de la production EnR, insuffisance d’unités locales de production (Exemple : une seule
unité de montage de composants des technologies d’énergie renouvelable
(HORONYA), absence de service après-vente ;
la sous information de la population sur les EnR et faible prise de conscience par ces
derniers des opportunités et des défis des EnR.
Sur le plan international, la forte diminution des subventions au secteur des EnR et la chute des
prix associés à la forte concurrence des producteurs chinois ont entrainé la faillite de plusieurs
entreprises européennes et américaines.
Les nouveaux investissements en matière d’énergies renouvelables et de carburants
renouvelables à l’échelle mondiale ont baissé entre 2011 et 2013. Cette baisse est en partie en
rapport avec la baisse continue du coût des technologies EnR.
Par exemple, entre autres, la production photovoltaïque dépendant de l'ensoleillement est donc
très fluctuante, volatile du fait de trois facteurs : i) l’alternance jour-nuit, ii) la saisonnalité et
iii) les variations de la nébulosité.
FIGURE 12 : Productions mensuelles d'une installation photovoltaïque de 1 kWcau Nord de
l’Allemagne
 |
72 72 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 71
La recherche est en train de faire des tests pour mettre au point un système de détection avancée
de l'approche de nuages permettant au réseau électrique de mieux s'adapter à ce type de
variation.
La gestion de la variabilité passe par la combinaison de l'énergie photovoltaïque avec d'autres
sources d'électricité renouvelable (électricité éolienne, marémotrice, hydroélectricité) via un
« réseau intelligent » (super-smart grid ou « internet de l'énergie ») et à des systèmes de
stockage de l'énergie, l'ensemble permettant de limiter les problèmes posés par l'intermittence
de chaque source prise individuellement. Le solaire et l'éolien semblent assez complémentaires
(l'éolien produit plus en hiver, le solaire en été ; l'éolien la nuit, le solaire le jour). Les
gestionnaires de réseaux électriques ont par ailleurs depuis longtemps développé des
équipements permettant de faire face à d'importantes variabilités de la demande. Ces
possibilités techniques requièrent cependant des investissements considérables en réseaux et en
moyens de stockage mais se heurtent également à l'opposition des populations qui s'estiment
lésées par l'installation de tout nouvel équipement.
La prévisibilité de la production photovoltaïque peut être envisagée avec une assez bonne
précision grâce à des modèles informatiques croisant les prévisions météorologiques détaillées
par région avec la localisation des installations photovoltaïques, Cela permet d'anticiper les
mesures d'adaptation à prendre pour compenser les variations de la production photovoltaïque.
5.3 Perspectives
Le développement des énergies renouvelables, présente une chance pour l’humanité en général
et pour les peuples des régions bien ensoleillées et ventées, en particulier. Une coopération
 |
73 73 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 72
Nord-Sud volontariste et bien programmée dans le domaine des énergies renouvelables, sera
certainement fructueuse, mettra en exergue les synergies et les complémentarités possibles et
réduirait sensiblement le fossé qui sépare les pays industrialisées de ceux en développement et
permettra d’atteindre un avenir meilleur pour l’ensemble.
Une valorisation rationnelle et bénéfique des énergies renouvelables, nécessite une volonté
politique précise, bien développée et clairement exprimée.
5.3.1 Politique pour l'intégration du Genre dans l'Accès à l’Energie de la
CEDEAO (ECOW-GEN)
L'objet de cette politique est d'accélérer les réponses à la pauvreté sexospécifique dans le
domaine de l'énergie grâce à : 1) l'amélioration de l'égalité d'accès aux services énergétiques
modernes dans tous les États membres comme un droit, quel que soit le sexe, l'âge ou le statut
socio-économique; 2) l'accélération et l'exploitation de différentes formes d'énergie grâce à des
pratiques de développement socio-économique inclusives et durables qui favorisent l'égalité
d'accès à l'énergie, y compris des applications à usage domestique et communautaire
productives ; 3) l'harmonisation des législations et des pratiques entre les États membres
concernant l'égalité des sexes et l'énergie; et 4) le renforcement de l'égalité entre les hommes et
les femmes en matière de participation et d'implication dans les chaînes de valeur de l'énergie,
notamment les marchés, en promouvant l'égalité des chances et le soutien pour une participation
accrue à l'économie locale, nationale et régionale. La politique a été adoptée en 2014 et un plan
d’actions pour sa mise en œuvre existe.
Un programme national pour la mobilisation des ressources financières au profit du sous-
secteur des énergies renouvelables sera le plus ambitieux pour la création d’emploi jamais
réalisé.
Créée en 2015, Africa Solar Energy (ASE) est une société de droit malien spécialisée dans les
énergies renouvelables. Elle se veut un espoir pour l’Etat malien dans la politique des énergies
renouvelables. Dans la perspective de valorisation par l’Etat malien des ressources d’énergies
renouvelables pour la satisfaction des besoins des populations en matière de ressources
énergiques de proximité et pour la réduction des coûts de consommation, l’ASE s’est engagée
à proposer une multitude de solutions solaires à travers des produits de qualité qui répondent
aux normes internationales : centrales, congélateurs, chargeurs, climatiseurs, éclairages
muraux, fours, kits autonomes, lampadaires, lampes à torche, attrapes moustiques, etc.
5.3.2 Plan d’Actions National d’Energies Renouvelables (PANER)
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a déclaré 2012, Année internationale
de l'énergie durable pour tous. Elle a demandé à son Secrétaire général d'organiser et de
 |
74 74 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 73
coordonner les activités visant à accroître la sensibilisation sur l'importance d'aborder les
questions d'énergie. En réponse, le Secrétaire général a lancé une initiative mondiale sur
l'énergie durable pour tous.
L'initiative vise à mobiliser l'action des gouvernements, le secteur privé et la société civile
autour de trois objectifs à savoir : (i) assurer l'accès universel aux services énergétiques
modernes, (ii) doubler le taux global de l'amélioration de l'efficacité énergétique et (iii) doubler
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial, le tout pour être atteint d'ici
à 2030.
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) accompagne cette
initiative en fournissant, entre autres, un appui aux pays pour une évaluation rapide de l’état des
lieux et des besoins et l’analyse des écarts pour l’atteinte des objectifs de l’énergie durable pour
tous à l’horizon 2030.
Pour atteindre ses objectifs, avec l’appui de la CEDEAO, le Mali a élaboré et adopté le Plan
d'Actions National d'Energies Renouvelables (PANER) et le Plan d’Actions National
d'Efficacité Energétique (PANEE) ainsi que le gap financier nécessaire pour à l’atteinte des
objectifs du projet Energie pour tous à l’horizon 2030 (SE4ALL).
Les objectifs recherchés à travers le PANER pour renforcer la pénétration des EnR dans la
satisfaction des besoins en énergie sont :
accroître la part des EnR dans le bilan énergétique de 1% en 2013 à 10% en 2033 ;
accroître la part des EnR dans la production d’électricité de 5% en 2013 à 25% en 2033;
accroître la part de la bio énergie dans les EnR de 1% en 2013 à 10% en 2033.
En outre, les principales orientations stratégiques de la stratégie EnR sont les suivantes :
Au triple plan institutionnel, organisationnel et réglementaire :
o poursuivre les réformes et les restructurations engagées ;
o promouvoir la recherche et le développement ;
o renforcer les capacités des acteurs;
o soutenir la déconcentration des structures et des activités et l'implication des
collectivités territoriales ;
o créer un cadre efficient permanent de concertation et de coordination.
Au plan technique :
Pour le solaire photovoltaïque (PV) :
o définir pour le court terme un programme de réalisation des composants utilisables
(régulateur, ballast, convertisseur, onduleur, etc.) ;
o négocier pour le long terme et en rapport avec les pays voisins la possibilité de
construction d'une unité de production de modules solaires (montage, encapsulation,
etc.) ;
o exiger un transfert adéquat de technologies pour toute installation d'au moins 1 MWc ;
 |
75 75 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 74
o exiger une vérification du respect des normes nationales et internationales en vigueur
pour toute installation d'au moins 1 MWc.
Pour le solaire thermique :
o poursuivre les travaux entrepris pour l'amélioration des cuisinières solaires et réaliser
des prototypes de la cuisinière Schwatzer ;
o maîtriser la technique de fabrication des bacs en résine pour les distillateurs ;
o diversifier la gamme, en matière de capacité des Chauffe-eaux Solaires et définir sur un
site réel l'économie qu'engendrerait le couplage des Chauffe-eaux électriques et solaires
;
o poursuivre les travaux de perfectionnement des séchoirs solaires et élargir l'éventail
aussi bien de la technologie proposée que des variétés de produits à sécher ;
o démarrer effectivement la Recherche & Développement dans le domaine de la bio
climatisation et particulièrement de l'habitat bioclimatique ;
o poursuivre la collaboration avec les universités, instituts et entreprises extérieures pour
la réalisation d'équipements d’énergies renouvelables de coût supportable par les
utilisateurs potentiels : par exemple avec l'Université de Nancy 1 et la S.A COMESSE
SOUDURE, pour la réalisation des réfrigérateurs photo thermiques ;
o exiger un transfert adéquat de technologies pour toute installation d'au moins 100 kWc;
o exiger une vérification du respect des normes nationales et internationales en vigueur
pour toute installation d'au moins 100 kWc.
Pour la valorisation de la biomasse :
o tout en poursuivant l'effort de vulgarisation des foyers améliorés et du gaz butane dans
les centres urbains, l'accent doit être mis sur l'utilisation du biogaz dans les zones
agricoles en intégrant l'élevage à l'agriculture pour faciliter la collecte de déchets
pouvant servir de matière première ;
o les tests de transformation de déchets végétaux en briquettes doivent être complétés par
l'encouragement à une utilisation massive du produit fini ;
o la production de l'huile de Pourghère et son utilisation comme carburant sont des
opérations bien maîtrisées actuellement. Par conséquent, la valorisation de cette plante
à travers les programmes et projets de développement du monde rural doit faire l'objet
d'une concertation nationale et internationale.
Pour l'énergie éolienne :
o dresser une carte détaillée du potentiel éolien national ;
o recenser les besoins locaux pouvant être satisfaits par l'énergie éolienne ;
o étudier les équipements adaptés pour l'exploitation optimale de l'énergie éolienne ;
o négocier la fabrication industrielle locale des équipements de qualité et proposer des
méthodes permettant de faire leur promotion ou leur vulgarisation.
5.3.3 Projets et programmes
Pour atteindre les objectifs du PANER à l’horizon 2030, plusieurs projets et programmes seront
mis en œuvre dont les plus importants sont entre autres :
 |
76 76 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 75
5.3.3.1 Programme de Valorisation à Grande Echelle des Energies Renouvelables
(Scaling up Renewable Energy Program in Low Income Countries, SREP)
L’objectif principal du SREP-Mali est de valoriser à grande échelle les énergies renouvelables
afin qu’elles contribuent de manière déterminante à la réduction de la pauvreté et au
développement durable du Mali, au bénéfice des populations. En conformité avec les lignes
directrices du SREP, le programme proposé vise à entreprendre une évolution vers des solutions
à faible intensité de carbone dans le secteur énergétique et appuyer le développement d’EnR.
Le SREP a quatre (4) composantes qui sont :
a) Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables (PAPERM)
Le Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables (PAPERM) a pour objectif
général de favoriser l’essor des énergies renouvelables au Mali. Le Projet a les objectifs
spécifiques suivants : (i) améliorer le cadre politique, juridique, réglementaire et institutionnel
pour favoriser à la promotion des investissements en EnR; (ii) renforcer les capacités des
acteurs, procéder à la gestion des connaissances, à la communication et au plaidoyer en faveur
des EnR et (iii) améliorer le système de suivi et d’évaluation du sous-secteur et renforcer
l’approche programmatique dans le cadre du SREP-Mali.
Les composantes du PAPERM, si elles sont bien exécutées, constituent de bonnes perspectives
pour le développement et la promotion des EnR comme le montre le tableau suivant.
Tableau 16 : Caractéristiques du projet PAPERM
N° Nom de la
composante
Estimation
coût (USD)
Description de la composante
1 Amélioration du
cadre politique,
juridique,
553 000 (i) Appui à la révision et à la mise en cohérence des
textes du secteur ; (ii) mise à disposition d’un modèle
de Contrat d’Achat d’Electricité standard pour les
 |
77 77 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 76
N° Nom de la
composante
Estimation
coût (USD)
Description de la composante
réglementaire et
institutionnel
favorable à la
promotion des
investissements
en EnR
EnR ; (iii) mise à disposition de DAO standards
spécifiques pour les EnR ; (iv) préparation d’un guide
à l’intention des investisseurs en EnR ; (v) programme
de renforcement des capacités en lien avec le cadre
politique et réglementaire.
2 Renforcement des
capacités, gestion
des
connaissances,
communication et
plaidoyer
1 332 000 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de
communication et de gestion des connaissances pour
les EnR incluant : (i) un Portail web national sur les
EnR au Mali ; (ii) une campagne de sensibilisation sur
les enjeux des EnR avec la production d’outils
d’information et de communication ; (iii) un système
d’archivage numérique et physique du centre de
documentation et d’information de la DNE ; (iv)
l’organisation de la semaine des énergies
renouvelables chaque deux ans ; (v) des ateliers de
formation pour le renforcement des capacités des
principaux acteurs ; (vi) des ateliers de concertation
avec toutes les parties prenantes au niveau sous
régional et régional ; etc.
3 Suivi et
évaluation du
sous-secteur,
gestion du projet
et coordination
stratégique du
programme
SREP-Mali
717 000 A. Amélioration du système de suivi et d’évaluation
du sous-secteur, incluant : (i) le recensement des
équipements EnR installés ; (ii) la préparation d’un
manuel détaillé de suivi et d’évaluation ; (iii) le
renforcement des capacités en matière de suivi et
d’évaluation pour le sous-secteur ; (iv) le
développement d’un cadre de mesure des résultats
pour la nouvelle stratégie des EnR ; (v) le suivi des
indicateurs EnR et la diffusion des résultats.
B. Gestion du projet PAPERM et coordination
stratégique du programme SREP.
SOURCE : DNE/PAPERM
b) Système Hybride d’Electrification Rurale (SHER)
 |
78 78 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 77
L’objectif de ce projet est d’appuyer le Gouvernement du Mali à améliorer l'accès des
populations, notamment dans les zones rurales, aux services énergétiques de base, pour
contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.
Ce projet proposé dans le cadre du SREP vise une expansion de la capacité des Énergies
Renouvelables (EnR) dans les systèmes existants et dans de nouveaux projets de production et
de distribution de l’électrification en milieu rural. Cela permettrait d’augmenter la capacité
actuelle des EnR photovoltaïques d’environ 4,8 MWc au cours des six prochaines années (2014-
2020) dans 50 localités des opérateurs privés locaux pour fournir les services énergétiques
modernes. En plus, des combinaisons des systèmes hybrides avec les produits solaires PV à
petite échelle (systèmes solaires individuels, produits d’éclairage moderne), il portera
également sur la création de marchés d’éclairage hors réseau et l’efficacité énergétique. Le
financement est assuré par un Crédit IDA, un Don GPOBA, un Don SREP et la contrepartie
de l’Etat malien pour un montant global de 44,9 millions $US.
Les principaux résultats attendus du projet sont :
50 localités renforcées avec des champs solaires ;
9 770 nouveaux raccordements aux réseaux ;
250 km de réseau réalisés pour étendre les réseaux existants vers les clients ;
2 440 kits solaires individuels installés au niveau des ménages ;
4,8 MWc solaires installés pour améliorer le taux de pénétration des énergies
renouvelables ;
36 600 Lampes Basse Consommation (LBC) distribuées pour l’économie d’énergie ;
110 000 lanternes solaires distribuées en milieu rural ;
50 équipements économes d’énergie distribués dans les établissements sociaux ;
des Activités Génératrices de Revenus (AGR) créées dans les localités concernées pour la
réduction de la pauvreté dans le pays.
c) Projet de Développement de Mini/micro Hydroélectricité
Ce projet permettra d’accroître la part des énergies renouvelables dans les systèmes de
production et de distribution d’électricité du pays (en produisant 14,6 MW additionnels), avec
un accent sur l’électrification rurale. En appuyant la construction et la mise en fonctionnement
de quatre micro centrales et deux mini-centrales hydroélectriques, le projet bénéficiera à des
milliers de ménages ruraux, créera de nouvelles activités économiques, réduira les coûts de
l’électricité et réduira les émissions de GES. La contribution du SREP sera d’environ US$ 10
millions, pour un budget total d’environ US$ 136,5 million. Les fonds du SREP seront utilisés
pour réduire les coûts d’investissement initiaux des mini/micro centrales hydroélectriques. Au-
delà des investissements dans les infrastructures, le projet renforcera un environnement
favorable au développement des micro/mini-centrales hydroélectriques au Mali et entreprendra
des activités de renforcement des capacités particulièrement relatives à la mini/micro
hydroélectricité dans le contexte de l’électrification rurale.
 |
79 79 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 78
Les sites concernés sont Farako1 et Woroni dans la région de Sikasso, Billy et Keniéto dans la
région de Kayes, Talo dans la région de Ségou et Djenné dans la région de Mopti. Le
financement est assuré par la Banque Africaine de Développement (BAD). Les études de ces
sites sont en cours avec le bureau d’étude allemand FICHTNER.
d) Projet de Développement d’un Projet Solaire par un Producteur Indépendant
Ce projet vise à augmenter la contribution des sources d'énergie renouvelable à la production
énergétique nationale. Il ouvrira la voie au développement de futurs partenariats public/privé
dans le pays. D’une manière générale, ce projet vise à démontrer la faisabilité technique,
sociale, économique et environnementale d'un modèle énergétique intégré et auto-suffisant au
Mali. Son budget proposé sera d’environ US$ 60 millions (dont US$ 12 millions en tant que
contribution du SREP). Les allocations du SREP permettront surtout de réduire les coûts
d'investissement. Le projet devrait permettre d’ajouter une capacité de production d’environ 20
MW sur le réseau. Au-delà des investissements dans les infrastructures, le projet assurera la
fourniture d’une assistance technique relative spécifiquement aux projets IPP.
5.3.3.2 Autres Projets
Les centrales solaires photovoltaïques de 50 MWc à Kita et 33 MWc à Ségou
Pélengana : dont les Conventions de Concession et les Contrats d’Achat d’Energie ont
été signés, font l’objet d’études complémentaires et de recherche de financement par les
promoteurs;
Les centrales photovoltaïques de 50 MWc à Sikasso et celle de 25 MWc à Koutiala :
seront réalisées en type Buld Own Operate and Transfer (BOOT). Le). le Le promoteur
a été recruté par appel d’offres, les négociations sont en cours pour la signature de la
Convention de Concession et le du Contrat d’Achat d’Energie ;
L’hybridation des centres isolés d’EDM-SA, après la centrale solaire pilote de
Ouélessébougou (334 kWc), se poursuit notamment avec celui : de Tominian (265
kWc), de Koro (384 kWc), de Bankass (384 kWc), de Nara (646 kWc), de Diéma (646
kWc), d’Ansongo (384 kWc) et de Siby (45 kWc). Les appels d’offres sont en
préparation pour d’autres localités ;
Le Projet Prêt Energie vise à créer un type de financement innovant des EnR, en ce
sens que l’AER a recruté un prestataire par appel d’offres qui va s’occuper des
installations et de l’entretien des équipements aux domiciles des clients auxquels les
banques prêteront de l’argent à des taux d’intérêts meilleurs à ceux classiques. Le projet
est au démarrage, il y a plusieurs types d’offres selon les besoins du client ;
Le projet KFW consiste à électrifier 14 localités rurales par six opérateurs sélectionnés
à la suite d’un appel à concurrence. Il bénéficiera à 37 700 personnes pour une puissance
solaire de 299 kW ;
Le Fonds Abu Dhabi, à travers l’IRENA et la BADEA, va financer l’électrification de
30 localités en système hybride (solaire plus diesel) qui va bénéficier à 92 000
personnes ;
Le projet SREP, à travers sa composante Système Hybride d’Electrification Rurale
(SHER), va doter en centrale solaire 50 localités quant à l’Agence Française de
 |
80 80 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 79
Développement (AFD), elle en dotera 80 localités et la Banque Islamique de
Développement (BID) aussi intervient avec l’installation de centrales solaires dans 30
localités ;
Le Projet d’installation de 36 123 Lampadaires solaires : consiste à doter les localités
à travers le pays à partir de financement du budget national d’éclairage public, pour
réduire l’insécurité et développer les activités génératrices de revenu pendant la nuit ;
Le Programme d’Actions National d’Adaptation aux Changements climatiques
(PANA), soumis et disséminé en 2007, comporte des projets de développement des
énergies renouvelables dont certains ont été partiellement mis en œuvre. Par ailleurs, en
2011, le Gouvernement du Mali a élaboré une Politique Nationale de Lutte contre les
Changements Climatiques ainsi que la stratégie y afférente, les deux documents
intègrent les énergies renouvelables.
5.3.4 Stratégies pour l’action
5.3.4.1 Acquis stratégiques
La stratégie pour l’action repose sur un certain nombre d’acquis découlant des expériences de
diffusion des technologies d’énergie renouvelable parmi lesquels on peut citer :
la fiabilité des technologies d’énergie renouvelable ;
les impacts positifs sur le développement rural par la possibilité de création de richesse
et d’emplois ;
les impacts positifs sur les problèmes de lutte contre l’effet de serre et plus globalement
de protection de l’environnement ;
la propension croissante des personnes à pouvoir payer le coût des services d’énergie
renouvelable avec des modalités de financement approprié ou l’octroi de subvention
pour supporter les investissements initiaux requis pour leur promotion ;
les possibilités de développement d’affaires ou d’entreprises rurales dans le domaine
des énergies renouvelables ;
la mise en place des agences dédiées à l’énergie rurale et susceptibles d’améliorer le
cadre institutionnel ;
l’existence d’organisations promouvant la fluidité des marchés ;
la viabilité des approches par le service énergétique et non par la technologie.
Les voies sont donc déjà tracées pour passer de projets de démonstration à des programmes
d’énergie renouvelable de grande envergure.
 |
81 81 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 80
5.3.4.2 Actions stratégiques
Les actions suivantes doivent être renforcées. Il s’agit de/du :
la mise en place un environnement politique favorable au développement et à
l’utilisation des énergies renouvelables à l’échelle régionale ;
réexamen des stratégies de diffusion des énergies renouvelables dans une optique de
lutte contre la désertification et pour l’atténuation de la pauvreté ;
la mise en place et de l’opérationnalisation des mécanismes financiers et de crédit pour
la promotion des énergies renouvelables, notamment à travers des fonds issus des
accords multilatéraux relatifs à l’environnement ;
renforcement de l’information et la communication sur les énergies renouvelables ;
la valorisation des ressources locales en capitalisant les résultats de recherche ;
l’harmonisation des interventions au niveau du continent ;
développement des infrastructures de production d’équipements et d’offre de services
énergétiques ;
renforcement de la coopération Sud-Sud-Nord et public-privé.
5.3.5 Leçons Apprises et Chemin à parcourir
Certaines technologies ont été bien maîtrisées et peuvent être recommandées pour une
promotion à grande échelle dans le domaine de l’approvisionnement du milieu rural et
périurbain en services énergétiques modernes. Il s’agit : i) des systèmes de pompage solaire, ii)
des systèmes d’éclairage et de réfrigération, des chauffe-eau et des séchoirs solaires ainsi que
d’autres applications du solaire photovoltaïque (PV), iii) des systèmes de pompage éolien et
des petits aérogénérateurs dans les zones sahéliennes et sahariennes.
L’expérience a démontré que les interventions dans le domaine des énergies renouvelables qui
n’intègrent pas la division du travail par sexe peuvent grever les charges des femmes ou les
exclure des nouvelles opportunités. Les inégalités structurelles, comme l’absence d’accès aux
ressources et de contrôle sur ces dernières ou aux avantages comme la terre, le crédit, les
revenus et l’éducation, agissent comme des barrières destinées à empêcher les femmes de
profiter de droits que les technologies et les programmes d’énergies durables pourraient leur
octroyer. Cela signifie que les possibilités des femmes de profiter équitablement des
opportunités offertes sont souvent moindres.
Néanmoins, plusieurs études ont démontré que les femmes peuvent profiter d’un accès adéquat
et fiable aux services énergétiques modernes. Ces services peuvent avoir un impact positif
notamment sur : la santé des femmes (réduction des risques liés à la fumée), le soutien au
fonctionnement des cliniques sanitaires dans les zones rurales, la réalisation des économies de
temps et d’allègement des efforts grâce à la disponibilité de technologies améliorées pour la
cuisine, la corvée d’eau, l’agriculture et les activités génératrices de revenus. Ces leçons
montrent que les politiques et les programmes en matière d’énergies renouvelables doivent
absolument intégrer les préoccupations du genre (réduire le plus possible les inégalités entre
homme, femme, jeune, enfant, handicapés, etc.) afin de garantir une amélioration des conditions
de vies des femmes.
En ce qui concerne le chemin à parcourir, l’utilisation de processus et d’outils de planification
prenant en compte les préoccupations du genre peut permettre de programmer des interventions
 |
82 82 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 81
plus efficaces dans le secteur des énergies renouvelables. Les actions liées au genre peuvent
être explicitement formulées pour des interventions réussies dans ce domaine. Il est également
important de noter que plusieurs résultats peuvent être obtenus dans une seule intervention
énergétique.
Pour offrir un accès universel aux services énergétiques, des actions visant à intégrer les
questions de genre doivent être réalisées. Cela consiste à définir des actions concrètes à
entreprendre et des objectifs et cibles à atteindre, pour compenser l’écart en termes d’accès aux
services énergétiques et aux ressources entre les femmes et les hommes sur une base équitable.
Il s’agit également d’atténuer le plus possible, voire supprimer les inégalités structurelles
relatives au genre et de reconnaître la valeur des contributions des diverses catégories sociales
d’hommes, de femmes, de personnes handicapées, etc.
5.3.6 Encourager les initiatives locales dans le secteur des énergies renouvelables
Les acteurs du développement rural doivent être outillés d’un guide qui peut servir de manuel
de référence pratique pour : évaluer le potentiel local en matière d’énergie renouvelable et
étudier l’impact d’un projet dans ce domaine sur la situation économique, écologique et sociale
du territoire concerné afin d’en assurer la mise en œuvre.
Les sources d’énergie renouvelable sont multiples et ce guide doit se concentrer sur les
technologies (solaire, éolienne, de la biomasse et de la petite hydraulique) qui semblent offrir
plus de perspectives économiques dans certaines zones rurales. Les fiches qu’il contient
fournissent des informations de base sur ces différentes technologies et leur application dans
les zones rurales, mais en s’attachant principalement aux projets de petite à moyenne taille.
Les évaluations d’intérêt pour la mise en œuvre d’un projet de développement d’énergie
renouvelable dans une zone donnée consistent d’abord à identifier :
la ressource locale en énergie renouvelable ;
la demande et le marché potentiel de ce type d’énergie ;
les avantages pouvant être capitalisés de la mise en œuvre d’un projet d’énergie
renouvelable ;
le coût et l’impact du projet ;
les possibilités de financement et les mécanismes d’appui disponibles.
On peut ainsi établir un tableau des opportunités et des risques liés à la mise en œuvre d’un tel
projet, et décider si l’investissement qu’il implique se justifie. Certaines de ces informations
peuvent être obtenues à partir de sources proches, d’autres exigeront le concours de ressources
extérieures et probablement de spécialistes.
Dans certaines zones, l’exploitation des énergies renouvelables n’est pas forcément viable à
l’heure actuelle, même si partout les coûts d’équipement diminuent et les aides publiques sont
de plus en plus nombreuses. Ceci étant dit, si l’on décide que les conditions sont réunies pour
la mise en œuvre d’un tel projet, il faudra notamment :
mobiliser la population locale dès le départ ;
nouer des liens avec les groupes et organismes appropriés ;
s’assurer le concours d’experts afin de réaliser une étude technique détaillée ;
 |
83 83 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 82
élaborer un plan financier.
Pour l’essentiel, l’élaboration d’un projet de valorisation d’une énergie renouvelable ne diffère
guère de celle d’un autre projet, mais elle peut rencontrer des écueils particuliers. A cet égard,
ce guide essaie de donner des conseils pratiques et concrets, ainsi qu’un accompagnement “pas
à pas” pour la préparation du projet. Il s’appuie entre autres sur l’expérience des groupes leader
ayant participé à des actions de cette nature à travers l’Europe.
Il s’agit avant tout de faciliter l’émergence de projets d’énergie renouvelable, adaptés à leur
localisation géographique, dans le cadre d’une stratégie de diversification économique durable.
5.3.7 Exploiter les énergies renouvelables dans le cadre d’une stratégie de
développement durable
Les technologies d’exploitation de l’énergie renouvelable sont de plus en plus prises en
considération dans la promotion d’un développement rural durable en Afrique. Elles suscitent
un intérêt croissant en raison des avantages écologiques et sociaux qu’elles offrent, mais aussi
parce que leurs coûts diminuent.
Une source d’énergie renouvelable présentant un potentiel d’exploitation est un atout pour une
zone rurale. Selon le territoire, elle peut offrir les avantages suivants : exploitation des
ressources locales qui contribuent à améliorer la situation économique en exportant de l’énergie
ou en diminuant les approvisionnements extérieurs; création d’emplois qualifiés; allègement de
la charge sur l’environnement, notamment par la réduction des émissions de dioxyde de carbone
(CO2), principal responsable de l’effet de serre, et de dioxyde de soufre (SO2), principal
responsable des pluies acides; effet de levier pour d’autres initiatives de développement rural
étant donné notamment la mobilisation et l’animation locales que le projet d’énergie implique.
La qualité de l’air est, depuis plusieurs années, une priorité politique de l’Union européenne et
elle le restera. En 1992, au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, l’Union s’est engagée à
stabiliser en l’an 2000 ses rejets de CO2 au niveau de 1990. A Kyoto en 1998, elle a convenu
d’une réduction de 8% par rapport à ce niveau pour un ensemble de six gaz à effet de serre. Cet
objectif était à réaliser entre 2008 et 2012. Ce protocole de Kyoto devrait avoir de profondes
conséquences sur la politique énergétique des décennies à venir.
Tout indique que les énergies renouvelables joueront un rôle très important dans notre
approvisionnement énergétique, notamment pour apporter une contribution significative à la
réalisation des objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
 |
84 84 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 83
FIGURE 13 : Projection de l’utilisation des EnR à l’horizon 2040
L'indépendance énergétique est un objectif politique et économique fondamental pour tous les
pays. Pour un pays dépourvu de ressources locales, les énergies fossiles nécessitent
l'importation de combustibles en provenance d'autres contrées, rendant l'approvisionnement
énergétique dépendant de la situation géopolitique des pays extracteurs et des fluctuations des
marchés internationaux. Quant au nucléaire, le combustible ne représentant qu'une faible part
du prix de revient du kilowattheure, l'indépendance nationale dépend surtout de la détention de
la technologie du réacteur.
Dans le cas du solaire et de l'éolien, la production d'électricité est réalisée dans le pays, sans
importation de combustible. Le contenu en produits importés se limite pour l'essentiel à la phase
initiale, où, en dehors des quelques grands pays producteurs d'équipements, la plus grande
partie des équipements est acquise à l'étranger, en Chine dans la plupart des cas pour les
panneaux photovoltaïques. En 2015, sept des huit plus grands producteurs de modules
photovoltaïques sont chinois ou produisent surtout en Chine. Par contre, l'installation est
généralement effectuée par des entreprises locales.
Dans le monde, le marché du photovoltaïque a été créé pour les besoins d'électrification de
systèmes isolés du réseau tels les satellites, les bateaux, les caravanes et d'autres objets mobiles
(montres, calculatrices…) ou de sites et instrumentations isolés. Le progrès des techniques de
production de cellules photovoltaïques a entrainé, à partir des années 1990, une baisse des prix
qui a permis d'envisager, moyennant des soutiens étatiques divers, une production de masse
pour le réseau électrique. Cette production qui pourrait s'étendre à la production
autoconsommée intégrée dans les réseaux intelligents (smart grids), à partir de murs et des
toitures et dans la perspective d'une énergie propre et décentralisée, via des services
éventuellement partagés tels ceux prônés par Jeremy Rifkin dans son concept de troisième
révolution industrielle.
 |
85 85 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 84
5.4 Recherche et Développement
La recherche est très active dans le domaine du solaire photovoltaïque. Les prix diminuent
constamment et les rendements augmentent. L'essentiel des progrès se fait au niveau des
cellules. Il existe aussi des innovations au niveau d'autres éléments qui peuvent réduire le coût
global ou améliorer les fonctionnalités : amélioration des onduleurs, des héliostats, intégration
dans des éléments standards de toitures (sous forme de tuiles par exemple), de vitrage ou de
façade, mécanismes anti-poussières automatiques, vitres des panneaux solaires laissant mieux
passer l'énergie solaire, PV à concentration, trackers innovants, moules en carbone, etc.
Le système peut en synergie être associé à une pompe à chaleur, avec amélioration des
rendements respectifs. C'est ce qu'a montré une expérimentation récente (ex. : +20% de
rendement dans les conditions climatiques de Chambéry en Savoie). C'est un des moyens
(breveté en France sous le nom « Aedomia ») d'atteindre la "basse consommation", voire le
bâtiment à énergie positive ; la chaleur accumulée par les panneaux photovoltaïques peut être
récupérée pour améliorer le rendement d'une pompe à chaleur, elle-même alimentée par
l'électricité produite. De plus, le module photovoltaïque produit plus d'électricité quand il est
ainsi refroidi. Un stockage intermédiaire de calories (ballon d'eau chaude) est nécessaire, car
les pompes à chaleur classiques s'arrêtent (sécurité) au-dessus de 40 °C alors que l'air chauffé
par le soleil peut atteindre 50 °C.
Parmi les projets émergents figure un ballon/cerf-volant photovoltaïque autonome dénommé
"Zéphyr" revêtu de capteurs solaires à couche mince CIGS (cuivre-iridium-gallium-silicium)
(prix Art science en 2014 - thématique était les énergies du futur) facile à déployer dans des
lieux isolés pour répondre à des besoins humanitaires provisoires ou de crise via un câble
d'accrochage au sol, permettant aussi de transporter le courant vers des batteries. Il est gonflé
par de l'Hydrogène produit sur place par électrolyse de l'eau, au moyen des panneaux. Le
prototype de 3,80 mètres de diamètre devrait produire 3 kW, assez pour remplacer un groupe
électrogène classique.
Au Mali, le Centre Régional de l’Energie Solaire (CRES), disposait d’un laboratoire de
recherche qui a fait ses preuves. Avec la fermeture du CRES, le Centre National de l’Energie
Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER) a élargi ses recherches dans le domaine
du solaire thermique notamment les cuisinières solaires, les séchoirs et les chauffe-eaux
solaires.
Créée en 2014, l’Agence des énergies renouvelables du Mali s’attache à inventorier et évaluer
le potentiel du pays en matière d’énergies renouvelables, à contribuer à la définition des
stratégies nationales, à mener des activités de recherche et de développement dans le domaine
des énergies renouvelables.
L’Agence conduit des études et suit la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables au
profit des acteurs. Elle informe et sensibilise les promoteurs et les utilisateurs d’équipements
d’énergies renouvelables. Elle réalise des tests, contrôle la qualité et labélise les équipements
d’énergies renouvelables.
Des programmes de recherches devront être aussi menés dans les établissements
d’enseignement supérieur tant publics que privés. Dans le domaine de la recherche
 |
86 86 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 85
développement, des partenariats doivent être noués avec les institutions de recherches et des
universités des pays qui sont leaders dans le domaine à l’échelle mondiale.
On peut affirmer sans risque de se tromper que les EnR ont connu un développement
remarquable ces dix dernières années. Leur utilisation devient de plus en plus populaire à
l’échelle individuelle et collective.
 |
87 87 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 86
VI. Energies Renouvelables, Développement Humain Durable et Réduction de la
Pauvreté
L’Energie contribue inéluctablement au développement socioéconomique d’un pays. C’est la
recherche de débouchés énergétiques à travers le monde qui a motivé en partie la répartition
des terres. Les économies modernes les plus développées considèrent certaines sources
d’énergie comme stratégiques et d’intérêt vital.
Le secteur de l’énergie au Mali couvre des enjeux importants en termes de développement
socio-économique et durable. En effet, la demande énergétique augmente plus rapidement que
l’évolution du PIB d’environ 5% par an contre 14% pour la demande d’énergie primaire hors
biomasse.
Ces sources d’énergie traditionnelles sont limitées dans le temps et dans l’espace, d’où la
question de leur durabilité.
Les EnR, constituent de nos jours une panacée en ce sens qu’elles sont tirées de la nature donc
quasi inépuisables (soleil, vent, étangs, biomasse…).
Du point de vue de la pauvreté de conditions de vie (privations), les EnR peuvent
contribuer à augmenter les taux d’accès dans beaucoup de domaines : éducation, santé,
emploi, communication,…
6.1 Accès à l’éducation
Une éducation de qualité est essentielle pour augmenter les revenus et l’activité économique,
améliorer le développement et le bien-être des populations. Le revenu attendu et le niveau
d’activité économique d’un individu dépendent fortement de son niveau d’instruction.
L’accès à l’énergie contribue à améliorer ou facilite les éléments habilitants pour une éducation
de qualité. Pourtant, plus de 50% des enfants des pays en développement fréquentant les écoles
primaires n’ont pas accès à l’électricité. Il suffit d’un système d’équipement des salles de classe
en kits solaires pour palier à ce problème.
6.2 Accès à la santé
L’accès à l’énergie joue un rôle clé dans l’efficacité d’un établissement de soins de santé.
En effet, la population a peu de chances de bénéficier des soins adaptés lorsque les
établissements de santé ne disposent pas d’électricité pour satisfaire aux besoins d’éclairage
électrique, d’alimentation des réfrigérateurs, des équipements de stérilisation, etc.
Pourtant, environ 1 milliard de personnes dans le monde sont traitées dans des
établissements de santé qui ne disposent pas d’électricité.
L’énergie reste donc vitale pour l’amélioration des services de santé.
6.3 Accès des foyers à l’éclairage et aux modes de cuisson propres
L’éclairage reste aujourd’hui un besoin fondamental pour la grande majorité de la population
mondiale. L’accès à l’énergie offre un grand avantage pour les populations rurales.
 |
88 88 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 87
D’après les estimations, en 2010, 1,2 milliard de personnes (soit 17% de la population
mondiale) n’ont pas accès à l’électricité (Banerjee et coll., 2013) et perdent de nombreuses
heures de productivité. Les populations ont recours à des sources d’éclairage généralement plus
chères que l’éclairage électrique comme les lampes polluantes et dangereuses, qui fournissent
de la lumière de faible qualité.
D’autres impacts qualitatifs se sont également fait sentir : l’éclairage rassemblant les personnes
et les aidants à se sentir davantage en sécurité une fois la nuit tombée (SolarAid 2013).
En terme de développement humain, particulièrement dans le domaine de l’espérance de vie,
selon le rapport de l’étude sur la charge mondiale de morbidité 2010 (OMS), on estime
que l’exposition à la fumée issue du simple fait de cuisiner est le quatrième pire facteur de
risque de maladie dans les pays en développement ; et que cela provoque 4 millions de
décès prématurés par an (Lim et coll., 2012), dépassant le nombre de décès attribuables
au HIV/SIDA, à la malaria et à la tuberculose, combinés.
Aussi, selon l’OMS en 2014, plus de la moitié des décès des enfants de moins de cinq ans sont
dus à la pneumonie causée par l’inhalation de particules fines (suie) issues des feux de cuisson
dans les foyers.
6.4 Accès à l’emploi
De nombreuses personnes démunies occupent des emplois non qualifiés, peu qualifiés, voire
qualifiés, tant dans le secteur informel que dans le secteur formel. L’augmentation de
l’utilisation des EnR dans les entreprises peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur
leurs opportunités en termes d’emplois, en fonction du secteur, des entreprises en question et
des réglementations nationales en matière de droits et d’organisation des travailleurs.
6.5 Accès aux TIC
Avec les transferts d’argent en lien avec la téléphonie mobile, les TIC ont permis de rehausser
le taux d’accès aux services bancaires et financiers jusqu’en milieu rural permettant de sécuriser
ces mouvements de fonds et de réduire la pauvreté des ruraux.
Dans un contexte de pauvreté monétaire difficile, les EnR peuvent permettre d’accroître la
productivité et les revenus des couches défavorisées, les plus pauvres.
Dans une enquête menée auprès d’entreprises en Afrique subsaharienne (CGDEV, 2009),
l’électricité a été citée comme le premier obstacle à la croissance d’une entreprise dans 11 des
30 pays interrogés et deuxième dans 9 pays supplémentaires, parmi d’autres problèmes aussi
importants pour la réussite d’une entreprise que l’accès au financement et la stabilité macro-
économique. En outre, avec des sources d’énergie bon marché, les entreprises peuvent
privilégier les investissements en matière d’automatisation plutôt que les emplois, ce qui
appauvrit davantage les populations.
6.6 Energie pour gagner sa vie
 |
89 89 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 88
Pour des milliards de personnes parmi les plus pauvres du monde, la capacité à gagner sa vie
dépend de l’accès à l’énergie. Disposer d’éclairage la nuit pour pouvoir garder son magasin
ouvert plus longtemps, ou de combustible pour un moteur à moudre le grain ou pour une pompe
d’irrigation, peut faire la différence entre gagner sa vie de manière décente et rester au niveau
ou en dessous du niveau de subsistance et vivre dans la pauvreté. Cette connexion directe entre
énergie et réduction de la pauvreté est la plus citée lors des discussions relatives à la pauvreté
énergétique.
6.7 Exploitation des terres
L’agriculture contribue largement aux fondations économiques et sociales de la plupart des
pays en développement.
Environ 2,5 milliards de personnes soit 45% de la population des pays en développement, vivent
dans des foyers dont les moyens de subsistance dépendent principalement de l’agriculture et
d’une économie agricole. Dans de nombreux pays en développement, le secteur agricole génère
en moyenne 29% du PIB, tout en fournissant du travail à 65% de la main-d’œuvre composée
d’un nombre disproportionné de personnes pauvres en matière de revenus et d’énergie (GIZ,
2011). Par conséquent, l’augmentation de la productivité agricole est un moteur essentiel pour
la sécurité alimentaire, la génération de revenus, le développement des zones rurales et donc la
réduction de la pauvreté mondiale. Pour nourrir les 9 milliards de personnes qui devraient vivre
sur terre en 2050, on estime que la productivité agricole doit augmenter de 70% (FAO, 2009).
Au Mali, le taux de pauvreté est élevé dans les zones rurales (53,1% selon l’enquête modulaire
et permanente auprès des ménages (EMOP 2015)). De plus, les ménages maliens, notamment
dans le secteur rural restent très vulnérables. En effet, la productivité agricole actuelle n’offre
pas un revenu suffisant pour élever le niveau de vie d’une grande partie des ménages ruraux au-
dessus du seuil de pauvreté.
Malgré cet environnement globalement difficile, un certain nombre d’évolutions favorables ont
eu lieu dans l’agriculture malienne ces dernières décennies.
Augmenter la productivité agricole nécessite un meilleur accès à l’énergie et à de meilleurs
services énergétiques à chaque niveau de la chaîne de production agroalimentaire. L’énergie
est essentielle pour réaliser ce potentiel, et en tant que telle, les besoins différents des exploitants
et exploitantes agricoles doivent être intégrés dans la planification, la fourniture de services et
l’accès à l’énergie.
Augmenter la production agricole
Le type de système d’énergie agricole disponible pour les agriculteurs constitue un facteur
important pour déterminer la surface des terres que ces derniers peuvent cultiver. Les
exploitations agricoles basées sur le travail humain cultivent généralement 1 à 2 hectares par
an, les agriculteurs qui louent des animaux de trait cultivent 2 hectares, ceux qui possèdent des
animaux de trait 3 à 4 hectares, ceux qui louent un tracteur environ 8 hectares et ceux qui
possèdent leur propre tracteur plus de 20 hectares (FAO, 2006).
 |
90 90 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 89
Au Mali, le Gouvernement a mis en place certaines mesures en vue d’améliorer la productivité
par le vote de la loi agricole et l’aménagement des terres agricoles. La mécanisation de
l’agriculture quoique timide a commencé.
6.8 Transformation et commercialisation améliorées des produits agroalimentaires
Les services énergétiques modernes peuvent réduire considérablement le temps et la charge de
travail qu’implique la transformation traditionnelle des produits agroalimentaires, tout en
améliorant les revenus des petits exploitants agricoles en leur permettant de vendre des produits
finis à un meilleur prix. Par exemple, le projet de plate-forme multifonctionnelle au Mali, qui
est largement utilisé pour la transformation des produits agroalimentaires, a permis aux femmes
qui l’ont utilisé d’économiser en moyenne 2 à 6 heures par jour (PNUD, 2004).
Une spécialisation ainsi que des économies d’échelle peuvent souvent être obtenues grâce à une
transformation semi-centralisée, par exemple par le biais de moulins communautaires. Ces
activités ne peuvent pas se réaliser sans des échanges d’informations, qui sont grandement
facilités par les services énergétiques modernes et les TIC. Cette préoccupation est prise en
compte dans le cadre du nouveau document CREDD 2016-2018.
Si l’accès aux EnR est accéléré, nous devons créer des systèmes de marchés dynamiques,
inclusifs et durables, au sein desquels plusieurs organisations plus fortes pourront fournir une
gamme de sources d’approvisionnement et de services énergétiques durables propres à
davantage de personnes plus pauvres.
 |
91 91 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 90
CONCLUSION
De tout ce qui précède en termes de résultats des projets/programmes et des perspectives dans
le domaine des EnR, on peut affirmer sans risque de se tromper que ce type d’énergie a pris un
nouvel élan ces dix dernières années. L’utilisation des EnR devient de plus en plus populaire à
l’échelle individuelle et collective.
Le Mali et l’Afrique ne sont pas en reste de cette évolution comme en témoignent les différentes
initiatives en cours.
Cependant, des problèmes existent notamment : i) l’insuffisance d’une stratégie de
communication sur les EnR, ii) l’insuffisance de financement approprié, iii) le nombre limité
d’unités de production locale, iv) les difficultés institutionnelles, l’insuffisance de
règlementation prenant en compte la vente du surplus d’un auto producteur EnR au réseau
interconnecté, v) la faible prise en compte du genre dans les politiques et stratégies EnR et vi)
l’insuffisance de synergie entre les intervenants du secteur.
RECOMMANDATIONS
Pour booster le développement des EnR au Mali, il faut trouver des solutions aux difficultés sus
citées comme entre autres :
A l’endroit du Gouvernement :
élaborer une stratégie de communication qui couvre l’ensemble des EnR pour mieux
faire connaître au grand public, leurs modes et conditions d’utilisation, ainsi que leurs
limites ;
mettre en place un plan de financement innovant adapté aux EnR ;
mobiliser les fonds nationaux et ceux des PTF au profit des EnR (solaire, éolien, mini
hydroélectricité, et biomasse, etc.) ;
inciter les investisseurs nationaux et internationaux à investir dans la production des
équipements EnR au Mali en leur offrant un cadre attractif ;
procéder à la relecture du cadre institutionnel et règlementaire pour la promotion des
EnR ;
intégrer le genre dans les politiques et stratégies des énergies renouvelables ;
créer une synergie d’actions entre les différents acteurs du sous-secteur des EnR ;
impulser le Partenariat Public Privé (PPP) pour le développement des EnR ;
renforcer les capacités des acteurs du secteur ;
intégrer le solaire à grande échelle dans le réseau d’EDM-SA ;
procéder à la labellisation et à la certification des équipements solaires importés ou
produits localement ;
introduire des programmes de recherches sur les EnR dans les établissements
d’enseignement supérieur comme l’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba
TOURE (ENI-ABT), la Faculté des Sciences et Techniques (FST) et dans les universités
privées ;
créer des partenariats dans le domaine de la recherche développement avec les
Institutions de recherches et les Universités des pays qui sont leaders dans le domaine
des EnR à l’échelle mondiale ;
 |
92 92 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 91
A l’endroit de l’Assemblée Nationale :
légiférer pour l’injection de surplus de production des installations EnR individuelles
sur le réseau ;
A l’endroit du Secteur Privé :
saisir les opportunités qu’offre le Partenariat Public Privé (PPP) dans le secteur des EnR
pour son développement ;
A l’endroit de la société civile :
renforcer les capacités des acteurs du secteur ;
informer les populations sur les EnR et leurs modes et conditions d’utilisation ;
A l’endroit des partenaires techniques et financiers :
faciliter le Partenariat Public Privé (PPP) dans le secteur des EnR pour son
développement ;
renforcer les capacités des acteurs du secteur ;
accompagner les programmes de recherches sur les EnR des établissements
d’enseignement supérieur comme l’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba
TOURE (ENI-ABT), la Faculté des Sciences et Techniques (FST) et des universités
privées ;
aider à la création des partenariats dans le domaine de la recherche développement avec
les Institutions de recherches et les Universités des pays qui sont leaders dans le domaine
des EnR à l’échelle mondiale.
 |
93 93 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 92
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Document de Politique Energétique
Nationale (2006-2015) adopté en mars 2006 ;
Stratégie Nationale de Développement des Energies Renouvelables adopté en 2006 et
son plan d’actions ;
Stratégie de Développement des Biocarburants (SDB) ;
Rapport 2015 de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction
de la Pauvreté (CSCRP-2012-2017) ;
Document du Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement
Durable (CREDD) (2016-2018) ;
Rapports annuels d’activités 2011, 2012, 2013 et 2014 volume 1/2 d’EDM-SA ;
Document de la quinzième revue sectorielle des projets et programmes du secteur de
l’Energie du Ministère de l’Energie et de l’Eau ;
Plan d'Actions National des Energies renouvelables (PANER) de la République du Mali
(2015-2020/2030) dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière
d’énergies renouvelables de la CEDEAO (PERC), Rapport provisoire juin 2015 ;
Plan d’investissement SREP-MALI, pour la Valorisation à Grande Echelle des Energies
Renouvelables ;
Programme de la CEDEAO pour l’intégration du Genre dans l’Accès à l’Energie
(ECOW-GEN).
 |
94 94 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 93
ANNEXES
 |
95 95 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 94
ANNEXE 1 : Les objectifs nationaux pour une pénétration accrue et durable des énergies
renouvelables sont résumés dans les tableaux N°1 à N°5 ci-dessous :
Tableau 17 : Objectifs pour les énergies renouvelables raccordées au réseau
Capacité installée en MW 2010 2020 2030
Capacité installée de centrales fonctionnant à
base d’énergie renouvelables en MW (incluant
la moyenne et grande hydro)
156,54 674,5 979
Part des énergies renouvelables en % de la
capacité totale installée (incluant la moyenne et
grande hydro)
57,9 49,25 52,6
Production d’énergie raccordée au réseau
(GWh)
2010 2020 2030
Production électrique totale à base d’énergies
renouvelables en GWh (incluant la moyenne et
grande hydro)
692,3 1936 2550
Part des énergies renouvelables dans le mix
électrique1 en % (incluant la moyenne et grande
hydro)
65,09 32,83 33,38
SOURCE : PANER
Tableau 2 : Objectifs pour les énergies renouvelables hors réseau
2010 2020 2030
Part de la population rurale desservie par des
systèmes hors réseau (mini-réseaux et systèmes
autonomes) de services électriques à base
d’énergies renouvelables en %
1,7 36,9 66,64
SOURCE : PANER
1Le mix électrique définit la répartition des différentes sources d’énergie primaire (Charbon minéral, Produit Pétrolier, Nucléaire, Hydraulique, Eolienne, Solaire, et autres
énergies renouvelables utilisées pour la production d’électricité).
 |
96 96 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 95
Tableau 3 : Objectifs pour l’énergie domestique de cuisson
2010 2020 2030
Part de la population utilisant des Foyers améliorés en % 43,88 91,49 108,81
Proportion de charbon de bois produit par des technologies2 de
carbonisation efficace en %
ND ND ND
Consommation de gaz butane en % de la population 10,04 15,58 19,60
Consommation de réchaud à gaz et de réchaud à pétrole en % de
la population 8,70
16,74
19,22
Consommation de séchoirs semi-industriels en % de la population 0,24
0,53
1,02
Consommation de séchoirs de type familial en % de la population
ND*
2,09
40,31
Consommation de cuiseurs solaires dans les ménages, restaurants
et cantine en % de la population 0,00
0,18
4,83
Consommation de digesteurs pour la cuisine en % de la
population
ND
0,24
2,96
Consommation de briquettes / bûchettes combustibles en % de la
population 0,3
1,86
11
Consommation de réchauds à biocarburants en % de la population
ND
0,24
2,71
SOURCE : PANER
* Donnée non disponible
Tableau 4 : Objectifs pour les chauffe eaux solaires
Chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude
sanitaire et d’eau chaude pour les processus industriels
2010 2020 2030
Nombre de maisons résidentielles avec des chauffe-
eaux solaires installés
926 56 000,00 206 000,00
Part des centres de santé communautaires, des
maternités et établissements scolaires avec des
chauffe-eaux solaire (en %)
0,49 25,57 62,49
Part des Industries agro‐alimentaires (utilisant l’eau
chaude dans leur processus) avec des chauffe-eaux
solaires (en %)
ND
42,37 68,81
Part des Hôtels utilisant des chauffe-eau solaires (en
%)
0,83 9,43 21,42
SOURCE : PANER
Tableau 5 : Objectifs pour les biocarburants
Biocarburants (1ère génération) 2010 2020 2030
Part d’éthanol dans la consommation d’essence (en %) 0,19 10,83 11
Part du biodiesel dans la consommation de gasoil et de
DDO (en %)
0,02 4 5,4
SOURCE : PANER
2 Insuffisance de données statistiques disponibles pour les technologies efficaces de carbonisation (type et rendement, quantité en exploitation, production imputable, charbonniers
(ères), etc.)
 |
97 97 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 96
ANNEXE 2 : Liste des structures rencontrées
Direction Nationale de l’Energie (DNE) ;
Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Mines et Energie (CPS/SME) ;
Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER-Mali) ;
Agence Malienne de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER) ;
Agence Nationale des Biocarburants (ANADEB) ;
Entreprise ZED ;
Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) ;
Projet Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l’Avancement des
Femmes (PENRAF), AER-MALI ;
Projet d’Etude du Gisement Eolien (PEGET), AER-MALI ;
Projet Développement des Energies Renouvelables au Mali (PDER), AER-MALI ;
Projet Electrification Villageoise par Systèmes d’Energie Solaire (PEVES), AER-
MALI ;
Projet Système Hybride d’Electrification Rurale (SHER), AMADER ;
Boutique / usine Horonya ;
Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables (PAPERM) ;
ONG Mali-Folkecenter Nyetaa ;
Entreprise Air Com.
 |
98 98 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 97
ANNEXE 3 : Cadre législatif et règlementaire du secteur de l’énergie
Les principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent les activités du secteur de
l’Energie au Mali sont :
Décret n°128/PG-RM du 30 mars 1961 : définit l’organisation du Service de
l’Hydraulique et de l’Electricité qui comprenait deux sections à savoir, la Section
Hydraulique Urbaine et Electricité et la Section Hydraulique pastorale ;
Décret n°138/PG-RM du 11 novembre 1966, portant organisation et fonctionnement
de la Direction Nationale de l’Hydraulique et de l’Energie (DNHE) consacre
notamment le remplacement de l’Electricité par l’Energie au sein de la nouvelle
direction ;
Loi n°67-12/AN-RM du 13 avril 1967 crée la Direction de l’Hydraulique et de
l’Energie ;
Ordonnance n°90-45/P-RM du 04 septembre 1990 crée le Centre National de
l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER) et le Décret n°90-
434/P-RM du 31 octobre 1990, en fixe l’organisation et les modalités de
fonctionnement, consacrant ainsi l’option stratégique du Gouvernement pour la
valorisation des potentialités nationales en énergies renouvelables;
Loi n°90-105/AN-RM du 11 octobre 1990 crée la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines (DNGM), ayant notamment en charge toutes les recherches
et études ainsi que toutes les mesures relatives à la réorganisation du secteur
pétrolier et le Décret 02-583/P-RM du 20 décembre 2002 en fixe l’organisation et
les modalités de fonctionnement ;
Loi n°90-103/AN-RM du 11 octobre 1990 crée le Programme pour le
Développement des Ressources Minérales (PDRM), qui a notamment en charge les
travaux de prospection ainsi que la reconnaissance et le Décret 02-584/P-RM du 20
décembre 2002 en fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement ;
Ordonnance n°90-64/P-RM du 08 novembre 1990 crée la Direction Nationale de
l’Hydraulique et de l’Energie (DNHE), dont l’organisation et les modalités de
fonctionnement furent fixées par le Décret n°90-458/P-RM du 08 novembre 1998 ;
Loi n°92-009 du 27 août 1992 crée l’Office National des Produits Pétroliers (ONAP)
qui est chargé notamment de la gestion des importations de produits pétroliers et le
Décret n°93-098/P-RM portant modification de l’article 3 du Décret n°92-155/P-
RM du 14 octobre 1992 en fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement ;
Loi n°98-056 du 17 décembre 1998, ratifiant l’Ordonnance n°98-025/P-RM du 25
août 1998 crée la Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN) avec
entre autres pour mission, la gestion des massifs forestiers et le Décret n°98-292/P-
RM du 08 septembre 1998 en fixe l’organisation et les modalités de
fonctionnement ;
 |
99 99 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 98
Ordonnance n°99-013/P-RM du 1er avril 1999, ratifiée par la loi n°99-022 du 15 juin
1999, crée la Direction Nationale de l’Energie (DNE), chargée notamment de la
définition des éléments de la politique énergétique, la planification générale et la
coordination des activités des acteurs du secteur énergétique et le Décret n°99-
186/P-RM du 05 juillet 1999 en fixe l’organisation et les modalités de
fonctionnement ;
Ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000 crée la Commission de Régulation
de l’Electricité et de l’Eau (CREE), en tant qu’organe autonome et indépendant qui
a principalement en charge la tarification des services publics dont la gestion est
déléguée aux concessionnaires, la protection des consommateurs ainsi que le respect
du jeu de la concurrence et le Décret 185/P-RM du 14 avril 2000 en fixe les
modalités d’application ;
Ordonnance n°02-060/P-RM du 05 juin 2002, crée l’Agence Malienne de
Radioprotection (AMARAP), chargée notamment de l’établissement du cadre
réglementaire et normatif de la radioprotection et de veiller sur son respect par les
usagers des matières et sources radioactives et le Décret n°02-333/P-RM du 06 juin
2002 en fixe l’organisation et le fonctionnement ;
Loi n°03-006 du 21 mai 2003 crée l’Agence Malienne pour le Développement de
l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER) et le Décret n°03-
226/P-RM du 30 mai 2003 fixe son organisation et ses modalités de
fonctionnement ;
Ordonnance n°04-033 du 23 septembre 2004 crée l’Autorité pour la Promotion de
la Recherche Pétrolière au Mali (AUREP) et le Décret n°04-582/P-RM du 21
décembre 2004 déterminant le cadre organique de l’AUREP ;
Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau au Mali ;
Loi n°95-003 du 18 janvier 1995, portant organisation de l’exploitation, du transport
et du commerce du bois ;
Loi n°95-004 du 18 janvier 1995, fixant les conditions de gestion des ressources
forestières ;
Arrêté 91-1725/MEFB-CAB du 03 janvier 1991, portant exonération des droits et
taxes à l’importation sur le gaz butane, les emballages et accessoire des réchauds ;
Décret n°98-402/P-RM du 17 décembre 1998, fixant les taux, les modalités de
recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du
bois dans le domaine forestier de l’Etat ;
Loi n°04-004 du 14 janvier 2004, portant création du fonds d'aménagement et de
protection des forêts et du fonds d'aménagement et de protection de la faune dans
les domaines de l'Etat ;
Décret n°04-091/P-RM du 24 mars 2004, fixant l'organisation et les modalités de
gestion du fonds d'aménagement et de protection des forêts et du fonds
d'aménagement et de protection de la faune dans les domaines de l'Etat ;
 |
100 100 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 99
Décret n°04-137 (bis) P-RM du 27 avril 2004, fixant la répartition des recettes
perçues à l'occasion de l'exploitation des domaines forestier et faunique de l'Etat
entre les fonds d'aménagement et de protection des forêts et de la faune et les budgets
des collectivités territoriales ;
Arrêté Interministériel n°90-1560/MIHE-MTPUC-MFC-MTT du 19 mai 1990,
fixant les règles d’implantation, d’aménagement et d’exploitation des points de
vente de carburant ;
Arrêté Interministériel n°90-1561/MIHE/MFC du 19 mai 1990, fixant les normes
du Distillat Diesel Oil (DDO) ;
Arrêté Interministériel n°90-1562/MIHE-MFC du 19 mai 1990, fixant les
caractéristiques de l’essence ordinaire ;
Arrêté Interministériel n°90-1563/MIHE-MFC du 19 mai 1990, fixant les
caractéristiques de l’essence super ;
Arrêté Interministériel n°90-1564/MIHE-MFC du 19 mai 1990, fixant les normes
du pétrole lampant ;
Arrêté Interministériel n°90-1565/MIHE-MFC du 19 mai 1990, fixant les normes
du gazole ;
Arrêté 91-1745/MEF-CAB du 08 juin 1991, portant homologation du prix du gaz
butane ;
Décision n°93-010/MEF Plan-CAB du 22 janvier 1993 fixant la liste des dépôts
d’hydrocarbures et leur zone de desserte ;
Arrêté Interministériel n°95-2495/MFC-MMEH-MTPT du 17 novembre 1995,
fixant les conditions d’importation des produits du pétrole, de certains dérivés et
résidus ;
Instruction Interministérielle n°98-001/MICA-MF-MME-MTPT du 06 juillet 1998,
déterminant les modalités d’application de l’Arrêté Interministériel n°95-
2495/MFC-MMEH-MTPT ;
Directive n°06-2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant harmonisation de
la taxation des produits pétroliers au sein de l’UEMOA ;
Arrêté Interministériel 04-0135/MEF-MET-SG du 22 janvier 2004, fixant le taux de
la redevance d’usage routier sur les produits pétroliers ;
Loi n°04-037 du 02 août 2004, portant Organisation de la Recherche, de
l’Exploitation, du Transit et du Raffinage des Hydrocarbures ;
Décret n°04-357/P-RM du 08 septembre 2004, fixant les modalités de la Loi n°04-
037 du 02 août 2004 ;
Décret n°04-467/P-RM du 20 octobre 2004, fixant l’Organisation et les Modalités
de fonctionnement de l’AUREP ;
Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000, portant organisation du secteur de
l’Electricité et son Décret d’application n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 qui
consacrent entre autres, le désengagement de l’Etat des activités opérationnelles de
l’industrie électrique, la libéralisation du secteur et la clarification du rôle des
acteurs (Etat, collectivités territoriales, opérateurs, organe de régulation) ;
 |
101 101 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 100
Décret n°02-107/P-RM du 05 mars 2002, instituant le visa de conformité des
installations électriques intérieures aux normes et règlements de sécurité, qui vise à
sécuriser les usagers et leurs biens contre les risques inhérents à l’utilisation de
l’énergie électrique ;
Loi n°05-019 du 30 mai 2005, portant modification de l’Ordonnance n°00-19/P-RM
du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’Electricité ;
Décret n°02-026/P-RM du 30 janvier 2002, portant suspension de la perception de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits et taxes sur les équipements solaires
et d’énergies renouvelables à l’importation ;
Décision n°00277/MMEE-SG du 06 mai 2004, portant création de la Commission
des Energies Renouvelables auprès du Ministère des Mines, de l’Energie et de
l’Eau ;
Ordonnance n°02-059/P-RM du 05 juin 2002, portant sur la radioprotection et la
sûreté des sources de rayonnements ionisants.
Ces textes législatifs et réglementaires se caractérisent par leur grand nombre qui est
essentiellement lié à la diversité des sous - secteurs énergétiques (énergies traditionnelles,
hydrocarbures, électricité, énergies renouvelables, énergie nucléaire) et au nombre
important des départements ministériels et services techniques impliqués.
 |
102 102 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 101
ANNEXE 4 : Dispositif institutionnel du secteur de l’énergie
Le cadre institutionnel du secteur énergétique malien a profondément évolué depuis
l’indépendance nationale, consacrant l’option marquée du Gouvernement de faire jouer à
l’énergie, un rôle de plus en plus important dans le développement socioéconomique du pays.
Les principales étapes de la réforme institutionnelle opérée peuvent se résumer comme suit :
Les services techniques publics actuellement en charge de l’énergie sont :
- la Primature (CREE) ;
- le Ministère en charge de l’Energie (DNE, AER-Mali, AMARAP, AMADER,
ANADEB) ;
- le Ministère en charge des Mines (DNGM, AUREP) ;
- le Ministère en charge de la Promotion de la Femme (Plateformes multifonctionnelles) ;
- le Ministère en charge des Finances (ONAP) ;
- le Ministère en charge de l’Environnement (DNEF).
Il existe donc au Mali une dispersion institutionnelle de la gestion publique de l’énergie, dont
l’une des conséquences demeure l’existence de risques d’incohérence et d’éparpillement des
efforts dans la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique nationale, si des
dispositions adéquates ne sont pas prises en matière de mise en synergie des activités des
intervenants.
Pour assurer une gestion plus cohérente et partant, plus efficiente du secteur de l’énergie,
il est recommandé de tendre à terme vers un regroupement institutionnel autour d’un seul
département ministériel ou au maximum deux (2) en charge de l’énergie.
Par ailleurs, bon nombre des structures techniques étant de création très récente (AMARAP,
AMADER, AUREP créées en 2002, 2003, 2004), une revue des textes existants s’avère
nécessaire pour éviter des conflits de compétence et créer ainsi les conditions propices à
l’amélioration de l’efficacité de l’ensemble des structures intervenant dans le secteur de
l’énergie.
Quelques opérateurs du secteur privé assurent le service public de l’électricité, dont les plus
importantes sont la Société Energie du Mali (EDM.SA) en tant que concessionnaire et deux (2)
Sociétés de Services Décentralisés (SSD) comme permissionnaires.
Les Organisations Inter-Gouvernementales (OIG) africaines intervenant dans le secteur de
l’énergie dont le Mali est membre sont notamment l’Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal (OMVS), l’Autorité du Liptako Gourma (ALG), l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Comité Inter-Etat de Lutte Contre la Sécheresse dans
le Sahel (CILSS), la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union
Africaine (UA).
 |
103 103 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 102
ANNEXE 5 : Termes De Référence
Etude sur « Energies Renouvelables et Développement Socioéconomique du Mali : enjeux
et perspectives »
I. Contexte et justification de l’étude
L’Energie est un secteur à vocation économique et sociale, pourvoyeur de produits, de services
et de commodités. Elle a un caractère éminemment transversal, en ce sens qu’elle est nécessaire
à la plupart des secteurs du développement socio-économique. Aussi, ne peut-elle être
déconnectée des besoins de la population et de l’économie nationale, tant les services
énergétiques contribuent de manière significative à toutes les activités humaines pour l’atteinte
des meilleures conditions de vie qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau
potable et des activités génératrices de revenus. En un mot l’énergie est indispensable à la survie
et au développement de l’homme.
L’énergie peut en outre prendre diverses formes, provenir de différentes sources et faire l’objet
de diverses transformations et utilisations. L’eau, le rayonnement solaire, le vent, la chaleur, le
pétrole et ses dérivés, le gaz, la biomasse, la géothermie et l’électricité sont quelques formes
sous lesquelles l’énergie se présente habituellement.
Avec la forte croissance démographique et le développement de l’activité économique, le
problème de la fourniture d’énergie en quantité et en qualité se pose avec de plus en plus
d’acuité. Dans ce contexte, si des dispositions adéquates ne sont pas prises suffisamment à
temps, le développement socioéconomique déjà handicapé le sera plus et le malaise social
s’instaure.
Le sous-secteur Energies Renouvelables (EnR) dont il est question dans cette étude utilise
des flux inépuisables d'énergies d'origine naturelle (soleil, vent, eau, croissance végétale...). De
nos jours, ces énergies de l'avenir ne couvrent qu’environ 22% de la consommation mondiale
d'électricité avec une prédominance de l'hydroélectricité qui représente les trois quarts de
l'électricité issue des EnR.
Les "énergies renouvelables" (EnR) sont inépuisables à l’échelle humaine, très peu polluantes.
Les énergies renouvelables et tout particulièrement l’hydro-électricité, la biomasse et le PV
solaire fournissent de l'énergie électrique, de la chaleur, de la force motrice et de
l’approvisionnement en eau à des dizaines de millions de personnes dans les zones rurales
desservant ainsi l'agriculture, les petites industries, les foyers, les écoles et beaucoup d'autres
besoins des communautés.
Le Mali a l’un des taux d’électrification les plus bas au monde avec 34,89% en 2014 contre
32,43% en 2013. Ce taux était de 31,74% en 2012 (Cf. Recueil des indicateurs de statistiques
de la CPS du Secteur Mines-Energie 2014). Il y a une exploitation abusive des ressources
ligneuses pour la production de bois-énergie (bois de chauffe et charbon de bois) dans un
contexte d’explosion démographique et un faible taux d’accès à l’électricité par les populations.
 |
104 104 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 103
Au même moment, très peu d’efforts sont fournis en faveur de la production ou de la
vulgarisation des sources d’énergie renouvelable qui constituent des alternatives sûres et
durables. Les défis du sous-secteur des énergies renouvelables au Mali sont donc nombreux.
Le Gouvernement du Mali, avec l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers et en
rapport avec le Secteur Privé et les Collectivités, a mis en œuvre depuis les années 70 plusieurs
stratégies de développement des EnR.
Cette dynamique encore émergente nécessite, pour perdurer, des politiques ambitieuses avec
des mesures de soutien qui, d'une part encouragent la baisse de la consommation d'énergie
fossile et, d'autre part accroissent la production d'énergies renouvelables.
II. Objectif
L’objectif général de l’étude est de montrer le rôle et l’importance des Energies Renouvelables
(EnR) dans le développement socioéconomique et culturel du pays et assurer la promotion de
leur utilisation.
Comme objectifs spécifiques, il s’agit de :
retracer l’évolution des EnR ;
décrire brièvement les différentes politiques de l’énergie et les stratégies pour le
développement des EnR ;
identifier les contraintes, enjeux, et opportunités3 des EnR
proposer les mesures nécessaires pour développer la recherche et la production de
technologies de production d’EnR au Mali ;
indiquer les perspectives y compris les mesures incitatives pour plus d’utilisation des EnR
en vue d’un meilleur développement économique, social et culturel du pays.
III. Résultats et produits attendus
III.1 Résultats attendus
Les résultats attendus, permettant l’atteinte des objectifs spécifiques de l’étude, sont l’état actuel
de production et d’utilisation des EnR, les différentes stratégies de développement des EnR, les
contraintes, enjeux et opportunités pour le développement des EnR et, pour les autres secteurs
de développement ainsi que les perspectives d’avenir pour le secteur des EnR.
les différents types d’EnR disponibles et/ou utilisés au Mali sont connus ;
les stratégies mises en œuvre pour développer les EnR et leurs bilans respectifs sont
proposées ;
les mesures favorables à la recherche et aux technologies de production d’ENR au Mali sont
proposées ;
les contraintes, enjeux et opportunités pour le développement des EnR et pour les autres
secteurs de développement sont répertoriés ;
les perspectives d’avenir pour le sous-secteur des EnR et son impact sur les autres secteurs
de développement sont décrites.
3y compris la création de petites et moyennes entreprise, la création d’emplois, la préservation de l’environnement, les changements climatiques, etc.
 |
105 105 |
▲back to top |
ENERGIES RENOUVELABLES ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE: ENJEUX ET PERSPECTIVES
ODHD/LCP Page 104
III.2 Produit attendu
le rapport de l’étude ;
IV. Méthodologie
La consultation demandée ici s’appuiera d’abord sur l’exploitation des données disponibles sur
les différents types d’EnR, les acteurs impliqués tant publics que privés et associatifs. La
description des contraintes, enjeux et opportunités pour le développement et l’utilisation des
EnR et enfin les propositions de perspectives pour le développement futur des EnR.
V. Profil des consultants
Les Consultants, au nombre de deux (2), doivent avoir une qualification en économie, en
planification du développement et en énergie.
Le personnel clé nécessaire à la réalisation de la mission :
- un économiste de niveau BAC+4 ou plus ayant une expérience d’au moins 10 ans dans les
stratégies et programmes de développement ;
- un spécialiste en énergie de niveau BAC+4 ou plus ayant une expérience d’au moins 10 ans
dans la mise en œuvre des stratégies de développement des énergies renouvelables.
VI. Durée de l'étude
La durée de l’étude est de 3 mois.
Activités Mois1 Mois 2 Mois 3
Semaines Semaines Semaines
Validation des TDR
Choix des consultants
Elaboration et
validation de la note de
compréhension
Recherche
documentaire
Compilation et
rédaction du document
Dépôt du rapport
provisoire
Examen technique
validation, intégration
des observations
Dépôt du rapport final
VII. Financement
PNUD et Budget National.
Copyright @ 2024 | ONEF .