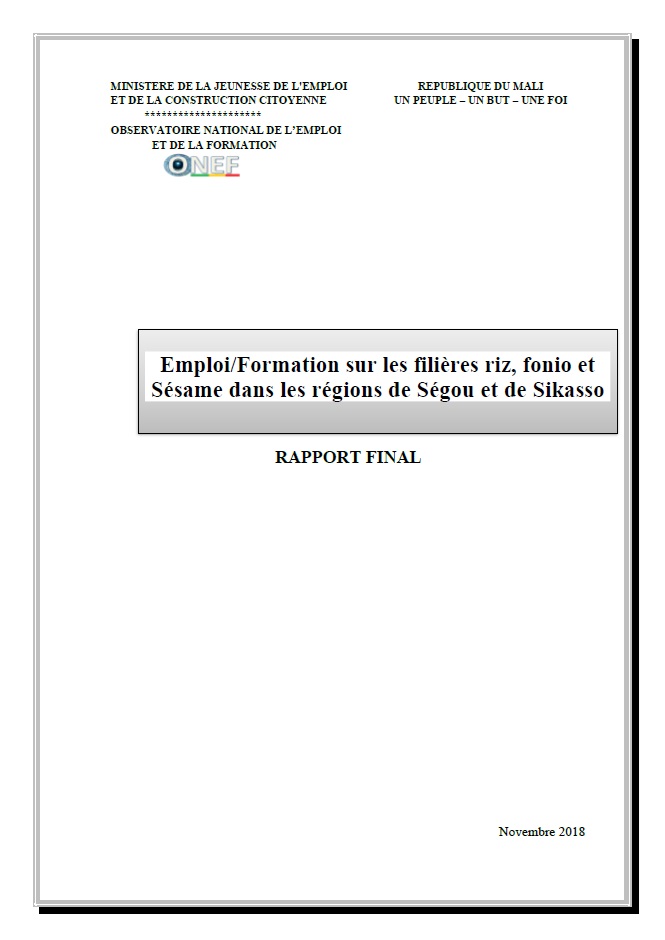MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'EMPLOI REPUBLIQUE DU MALI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE UN PEUPLE...
 |
MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'EMPLOI REPUBLIQUE DU MALI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE UN PEUPLE... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'EMPLOI REPUBLIQUE DU MALI
ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
RAPPORT FINAL
Novembre 2018
Emploi/Formation sur les filières riz, fonio et
Sésame dans les régions de Ségou et de Sikasso
 |
2 2 |
▲back to top |
i
TABLE DES MATIERES
SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................. v
I. INTRODUCTION ............................................................................................................ 1
II. CONTEXTE ................................................................................................................... 1
III. PRESENTATION DE L’ETUDE .................................................................................... 1
3.1. Objectif global de l’étude ........................................................................................... 1
3.2. Objectifs spécifiques .................................................................................................. 1
3.3. Résultats attendus ...................................................................................................... 2
3.4. Champ de l’étude ....................................................................................................... 2
IV. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE .................................................................................. 2
4.1. Analyse documentaire ................................................................................................ 3
4.2. Collecte et traitement des données .............................................................................. 3
4.3. Analyse des données .................................................................................................. 4
4.4. Capitalisation et renforcement des capacités des agents de l'ONEF et de l'INIFORP. ...... 4
V. ANALYSE ET DESCRIPTION DES CHAÎNES DE VALEUR RIZ, FONIO ET SESAME 4
VI REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES ENQUETEES DE LA FILIERE
RIZ ET NOMBRE DE TRAVAILLEURS EXISTANTS ...................................................... 11
6.1. Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière riz ............................. 11
6.2. Nombre d’entreprises de la filière riz enquêtées ......................................................... 11
6.3. Nombre de salariés existants de la filière riz .............................................................. 12
6.4. Typologie des entreprises de la filière riz des entreprises enquêtées ............................. 12
6.5. Typologie des emplois/métiers des entreprises enquêtées ............................................ 13
6.6. Description des emplois/métiers de la chaîne de valeurs filière RIZ ............................. 14
6.7. Qualification par type d'emploi (emplois types, emplois cibles, emplois sensibles,
emplois clés) .................................................................................................................. 34
VII. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES ENQUETEES DE LA
FILIERE SESAME ET NOMBRE DE TRAVAILLEURS EXISTANTS ............................... 39
7.1. Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière sésame ...................... 39
7.2. Nombre d’entreprises enquêtées filière sésame .......................................................... 39
7.3. Nombre de salariés de la filière sésame des entreprises enquêtées ............................... 40
7.4. Typologie des emplois des entreprises enquêtées ....................................................... 40
7.5. Typologie des emplois/métiers des entreprises enquêtées filière sésame ...................... 41
7.6. Description des emplois/métiers dans la chaîne de valeurs de la filière sésame ............. 42
VIII. LA FILIERE FONIO ET SA CHAINE DE VALEUR .................................................. 45
8.1. Poids économique de la filière fonio.......................................................................... 45
8.2. Analyse de la chaîne de valeur de la filière fonio ........................................................ 46
IX. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES ENQUETEES DE LA FILIERE
FONIO ET NOMBRE DE TRAVAILLEURS EXISTANTS ................................................ 49
9.1. Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière fonio ......................... 49
9.2. Nombre d’entreprises enquêtées filière fonio ............................................................. 50
9.3. Nombre de salariés existants filière fonio .................................................................. 50
9.4. Typologie des entreprises enquêtées de la filière fonio ............................................... 50
 |
3 3 |
▲back to top |
ii
9.5. Typologie des emplois/métiers des entreprises enquêtées ............................................ 52
9.6. Description des emplois/métiers de la chaîne de valeurs filière fonio ........................... 52
9.7. Qualification par type d'emploi (emplois types, emplois cibles, emplois sensibles,
emplois clés) filière fonio ................................................................................................ 56
X. DESCRIPTION DES DISPOSITIFS DE FORMATION EXISTANTS ............................. 60
XI. BESOINS PREVISIONNELS EN RESSOURCES HUMAINES POUR CHAQUE
METIER ........................................................................................................................... 72
XII. PROPOSITION DES ELEMENTS DE STRATEGIE.................................................... 74
12.1. Emploi et politique de formation professionnelle ...................................................... 74
12.2. Emploi et développement rural : la mise en œuvre de la LOA ................................... 76
12.3 Vision et point de vue des acteurs et plus particulièrement des organisations professionnelles et
interprofessions (riz, fonio et sésame) .............................................................................. 80
12.4. Options stratégiques pour le développement de l'offre de formation ........................... 80
XIII. RENFORCEMENT DE CAPACITE DES AGENTS DE L'ONEF ET DE L'INIFORP ... 81
XIV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ........................................................... 82
14.1. Conclusions ........................................................................................................... 82
14.2. Recommandations .................................................................................................. 82
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 84
ANNEXES ........................................................................................................................ 85
 |
4 4 |
▲back to top |
iii
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Entreprises riz enquêtées .................................................................................................... 11
Tableau 2 : Nombre d’entreprises de riz enquêtées .............................................................................. 11
Tableau 3 : Typologie des Entreprises filière riz ................................................................................... 12
Tableau 4 : Typologie des emplois filière riz ........................................................................................ 13
Tableau 5 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chargé du battage mécanique .. 14
Tableau 6 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Animateur ................................ 15
Tableau 7 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chargé d’étuvage .................... 15
Tableau 8 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Coordinateur ............................ 16
Tableau 9 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : ouvrier agricole ........................ 17
Tableau 10 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : comptable .............................. 17
Tableau 11 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chef d’exploitation agricole .. 18
Tableau 12 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Conducteur d’engins
agricoles ................................................................................................................................................ 18
Tableau 13 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Magasinier ............................. 19
Tableau 14 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Manœuvre .............................. 19
Tableau 15 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Gérant .................................... 20
Tableau 16 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Vendeur ................................. 20
Tableau 17 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Gardien .................................. 21
Tableau 18 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Riziculteur ............................. 21
Tableau 19 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : mécanicien ............................. 22
Tableau 20 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Forgeron ................................ 22
Tableau 21 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Ouvrier agricole ..................... 23
Tableau 22 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : laboureur ................................ 24
Tableau 23 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : transporteur ............................ 24
Tableau 24 : Fiche fonction de travail ouvrier agricole – cultures sèches............................................. 25
Tableau 25 : Fiche fonction de travail comptable ................................................................................ 25
Tableau 26 : Fiche fonction de travail coordinateur .............................................................................. 26
Tableau 27 : Fiche fonction de travail animateur .................................................................................. 26
Tableau 28 : Fiche de fonction de travail Ouvrier agricole cultures irriguées ...................................... 27
Tableau 29 : Fiche de fonction de travail Magasinier ........................................................................... 28
Tableau 30 : Fiche de fonction de travail Conducteurs d’engins agricoles ........................................... 28
Tableau 31 : Fiche de fonction de travail meunier ................................................................................ 29
Tableau 32 : Fiche de fonction de travail Manœuvre ............................................................................ 29
Tableau 33 : Fiche de fonction de travail Gérant .................................................................................. 30
Tableau 34 : Fiche de fonction de travail Vendeur ............................................................................... 30
Tableau 35 : Fiche de fonction de travail Gardien ................................................................................ 31
Tableau 36 : Fiche de fonction de travail Chargé de l’étuvage ............................................................. 31
Tableau 37 : Fiche de fonction de travail Chargé du battage mécanique .............................................. 32
Tableau 38 : Fiche fonction de travail Chef d’exploitation ................................................................... 32
Tableau 39 : Fiche fonction de travail laboureur ................................................................................... 33
Tableau 40 : Fiche fonction de travail transporteur ............................................................................... 33
Tableau 41 : Qualification emploi/métier.............................................................................................. 35
Tableau 42 : Qualification emploi/métier : Métiers spécifiques à la filière riz ..................................... 35
Tableau 43 : Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière sésame ........................ 39
Tableau 44 : Nombre d’entreprises enquêtées ....................................................................................... 39
Tableau 45 : Typologie des Entreprises sésames ................................................................................. 40
Tableau 46 : Typologie des emplois filière sésame ............................................................................... 41
 |
5 5 |
▲back to top |
iv
Tableau 47 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chargé d’extraction d’huile ... 42
Tableau 48 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Ouvrier-souffleur ................... 43
Tableau 49 : Fiche de fonction de travail chargé d’extraction d’huile .................................................. 44
Tableau 50 : Fiche de fonction de travail ouvrier souffleur .................................................................. 44
Tableau 51 : Qualification emploi/métier : Métiers spécifiques à la filière sésame .............................. 45
Tableau 52 : Entreprises enquêtées de la filière fonio ........................................................................... 49
Tableau 53 : Nombre d’entreprises enquêtées ....................................................................................... 50
Tableau 54 : Typologie des entreprises filière fonio enquêtées ............................................................ 51
Tableau 55 : Typologie des emplois ...................................................................................................... 52
Tableau 56 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Agent chargé de pré cuisson du
fonio ...................................................................................................................................................... 53
Tableau 57 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Forgeron ................................ 53
Tableau 58 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Soudeur .................................. 54
Tableau 59 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Electricien .............................. 54
Tableau 60 : Fiche de fonction de travail Forgeron .............................................................................. 55
Tableau 61 : Fiche de fonction de travail Soudeur ................................................................................ 55
Tableau 62 : Fiche de fonction de travail Electricien ............................................................................ 56
Tableau 63 : Qualification emploi/métier : Métiers spécifiques à la filière fonio ................................. 57
Tableau 64 : Formation à développer pour les acteurs des métiers emplois nouveaux ......................... 58
Tableau 65 : Nombre d’élèves formés : ................................................................................................ 61
Tableau 66 : Nombre formés en moyenne par an et par filière ............................................................. 62
Tableau 67 : Nombre de formés en moyenne par an et par filière ........................................................ 63
Tableau 68 : Nombre de formés en moyenne par an et par filière ........................................................ 63
Tableau 69 : Nombre de formés en moyenne par an et par filière ........................................................ 64
Tableau 70 : Nombre de formés : formez-vous en moyenne par an et par filière ................................. 65
Tableau 71 : Main d’œuvre utilisée pour réaliser les tâches au niveau des entreprises enquêtées ........ 70
Tableau 72 : Répartition de la population agricole selon le sexe et le niveau d’instruction ................. 71
Tableau 73 : Besoins prévisionnels en ressources humaines ................................................................ 72
Tableau 74 : Coût et financement des formations existantes ................................................................ 73
Tableau 75 : Source de financement ..................................................................................................... 73
LISTE DE FIGURES
Figure 1 : Evolution des superficies et des productions .......................................................................... 5
Figure 2 : Rendement par système de production (kg/ha) ....................................................................... 5
Figure 3 : Chaîne de valeur Riz ............................................................................................................. 12
Figure 4 : Chaîne de valeur Sésame....................................................................................................... 40
Figure 5 : Evolution des superficies et des productions de 2012-2013 à 2016-2017 ............................ 45
Figure 6 : Répartition Production par région, Campagne 2014 /2015 ................................................... 47
Figure 7 : Chaîne de valeur fonio .......................................................................................................... 50
 |
6 6 |
▲back to top |
v
SIGLES ET ABREVIATIONS
ACI/VOCA : Coopérative Agricole pour le Développement International Volontaires
pour l’Assistance Coopérative à l’Etranger
ADRS : Agence de Développement Rural de la Vallée du Sénégal les bas-fonds
dans les régions Sud du pays
AFD : Agence Française de Développement
AGRA : Alliance Agricole pour une Révolution Verte en Afrique
AMASSA : Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires
AOPP : Association des Organisations Professionnelles Paysannes
APC : Approche par Compétence
APCAM : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
ARPASO : Association des Riziculteurs de la Plaine Aménagée de San Ouest
ASCOMA : Association des Consommateurs du Mali
BAD : Banque Africaine de Développement
BID : Banque Islamique pour le Développement
BM : Banque Mondiale
BMS- SA : Banque Malienne de Solidarité
BNDA : Banque de Développement Agricole du Mali.
BT : Brevet de Technicien
CAE/USAID : Centre Agro entreprise de l’USAID
CAFON/SOCAFON : Coopérative des Artisans et Forgerons de l’Office du Niger
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CFUACT : Coopérative des Femmes de l’Union des Agriculteurs du Cercle de
Tominian
CNOP : Coordination Nationale des Organisation Paysannes du Mali
CPS-SDR : Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur du Développement
Rural
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
CRU : Commission Nationale des Utilisateurs (de la recherche)
CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire.
DLCA : Délégation Locale des Chambres d’Agriculture
DNGR : Direction Nationale du Génie Rural
DNSI : Direction Nationale de la Statistique et de l’informatique
DRA : Direction Régionale de l’Agriculture
EAF : Exploitation Agricole Familiale
F CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FENATRA : Fédération Nationale des Transformateurs
FUAPAD : Fédération des Unions des Agriculteurs et Producteurs pour une
Agriculture Durable
GCDC : Groupement des Commerçants Détaillants de Céréales
GDCM : Grand Distributeur Céréalier du Mali
 |
7 7 |
▲back to top |
vi
GIE : Groupement d’Intérêt Economique
GIZ/KFW : Coopération Allemande pour le Développement
ha : hectare
IER : Institut d’Economie Rurale
IICEM : Initiative Intégrée de la Croissance Economique au Mali 2
INFP : Institut National de la Formation Professionnelle
IMF : Institution de Microfinance
INIFORP : Institut National Ingénierie Formation Professionnelle
LOA : Loi d’Orientation Agricole les
ODRS : Office du Développement Rural de Sélingué
ON : Office du Niger
ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
OPIB : Office des Périmètres Irrigués de Baguineda
ORM : Office Riz Mopti
ORS : Office Riz Ségou
ROM : Référentiel Opérationnel des Métiers
SND : Stratégie Nationale de Développement
TdR : Termes de Référence
UACT : Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian
UPROBEK : Unité de Production du Beurre de karité
VAE : Valorisation Acquis Expérience
 |
8 8 |
▲back to top |
1
I. INTRODUCTION
Lux-Dev a reçu de la part du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE)
en 2015 trois mandats de formulation portant sur le 3e Programme Indicatif de
Coopération (PIC III) dont l'objectif est d'appuyer le Gouvernement malien dans ses
efforts visant à réduire la pauvreté, à travers un appui à la croissance inclusive et durable
et à la réduction de l'insécurité alimentaire. S'articulant sur la programmation conjointe
de l'Union européenne (2014 - 2018), le champ d'activités couvre les secteurs
suivants : i) le développement rural et la sécurité alimentaire ; ii) la formation et
l'insertion professionnelle ; et iii) la décentralisation et la bonne gouvernance.
L'un des programmes formulés, le programme MLI/021, concerne l'appui au secteur rural.
Le programme MLI/022, concerne la formation et l'insertion professionnelle au Mali,
dans la région de concentration Sud du PIC III.
II. CONTEXTE
En matière de Formation professionnelle (FP), la problématique relative à la qualité et à
l'efficacité des formations existantes est au cœur des préoccupations. Le manque
d'adéquation des compétences aux besoins du secteur productif, le faible niveau des
relations entre l'école et l'entreprise, les difficultés liées au développement de
l'entreprenariat rendent complexe le défi de l'insertion professionnelle.
III. PRESENTATION DE L’ETUDE
3.1. Objectif global de l’étude
L'objectif global de cette étude vise à identifier dans la zone d'intervention du programme
(cercles de Baraouéli, Bla, San, Ségou, Tominian en région de Ségou et le cercle de
Yorosso dans la région de Sikasso) l'offre de formation existante, les besoins non satisfaits
en matière de qualification professionnelle et les besoins prévisionnels en ressources
humaines.
3.2. Objectifs spécifiques
Ils sont les suivants :
- fournir une analyse et un descriptif détaillés de la chaîne des valeurs des filières riz,
fonio et sésame ;
- décrire les emplois/métiers dans la chaîne de valeurs des 3 filières ;
- décrire les dispositifs de formation existants (Etat des lieux) ;
 |
9 9 |
▲back to top |
2
- définir les besoins en formation non satisfaits, les formations à créer ou à adapter aux
emplois/métiers identifiés ;
- proposer des éléments de stratégie ;
- capitaliser et renforcer les capacités des agents de l'ONEF et de l'INIFORP.
3.3. Résultats attendus
- une analyse et un descriptif détaillés de la chaîne des valeurs des filières riz, fonio et
sésame sont fournis ;
- les emplois/métiers dans la chaîne de valeurs des 3 filières sont décrits ;
- les dispositifs de formation existants (Etat des lieux) sont décrits ;
- les besoins en formation non satisfaits, les formations à créer ou à adapter aux
emplois/métiers identifiés sont définis ;
- des éléments de stratégie sont proposés ;
- les capacités des agents de l'ONEF et de l'INIFORP sont renforcées.et capitalisées.
3.4. Champ de l’étude
L’étude portant formation emploi/métiers s’est déroulée dans la région de Ségou et a
couvert les cercles de Baraouéli, Bla, San, Ségou, Tominian. Dans la région de Sikasso
seul Yorosso, le chef-lieu du cercle a été couvert.
IV. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
La méthodologie est basée sur l’analyse des chaînes de valeur production, transformation
et commercialisation des trois filières dans la perspective de déterminer les
métiers/emplois et les ressources humaines y afférentes aux fins de leur adéquation. Elle
vise à donner une réponse aux besoins non satisfaits en matière de qualification
professionnelle et aux besoins prévisionnels en ressources humaines pour chaque
métier. De facto, la visite des dispositifs de formation à même de fournir les ressources
humaines de qualités à ces différentes chaînes de valeurs, devenait une impérieuse
nécessité.
La démarche mise en place pour réaliser l’étude a consisté en :
- analyse documentaire ;
- collecte et traitement des données ;
- analyse des données ;
- proposition des éléments de stratégie ;
- capitalisation et renforcement des capacités des agents de l'ONEF et de l'INIFORP.
 |
10 10 |
▲back to top |
3
4.1. Analyse documentaire
Cette première étape de l’étude a permis de faire, au terme de la réunion de cadrage, la
collecte des informations utiles auprès des responsables impliqués dans la gestion de la
formation professionnelle et surtout de ceux des organisations professionnelles des
filières concernées.
Elle a consisté en des rencontres de partage et à la mise à disposition de documents sur
les filières riz, sésame et fonio, les rapports d’études.
De l’analyse de ces différents documents, il est ressorti un plan constitué d’éléments dont
la présence, dans ces documents, donne des pistes conduisant à la détermination du poids
économique.
4.2. Collecte et traitement des données
4.2.1. Elaboration et validation du guide d’entretien
Deux types de guides appropriés ont été élaborés pour les différents groupes cibles :
- guide d’entretien pour les entreprises évoluant dans les chaînes de valeur des trois
filières (riz, sésame et fonio) ;
- Guide d’entretien pour les centres de formation.
Ces différents outils, après conception, ont été partagés et validés en réunion avec le
commanditaire.
4.2.2. Enquête de terrain
Un échantillon de (31) entreprises évoluant soit dans la production, la transformation soit
dans la commercialisation des trois filières, choisies dans le répertoire de 73 entreprises,
a été retenu. Il faut rappeler que ce répertoire est constitué de 42 entreprises contenues
dans « l’Etude Identification des Organisations professionnelles et des Centres pouvant
servir d’Incubateur pour le Financement de projets de jeunes et de femmes dans la région
de Ségou et le cercle de Yorosso- PAFIP-2010 ». Les sites couvrent les cinq cercles de
la région de Ségou et le cercle de Yorosso.
Pour couvrir cet espace géographique pendant sept (7) jours, trois (3) enquêteurs
spécialisés ont réalisé l’enquête. Un planning des rencontres sur le terrain a été fourni
dans ce sens.
Les enquêteurs ont rencontré les responsables des entreprises et des centres de formation
en focus groupe (voir annexe)
 |
11 11 |
▲back to top |
4
4.3. Analyse des données
Les guides d’entretien remplis ramenés du terrain ont été vérifiés par les consultants pour
contrôler l’exhaustivité des réponses fournies par les enquêtés.
Un masque de saisie a été réalisé avec le logiciel SPSS qui permet de faire la saisie des
réponses données aux questions posées. Des agents de saisie ont été recrutés à cet effet.
Après la saisie des données, des tableaux analytiques ont été extraits et analysés.
4.4. Capitalisation et renforcement des capacités des agents de l'ONEF
et de l'INIFORP.
Les termes de référence préconisent l’organisation d’un atelier à l’intention des agents
de l’ONEF et de l’INFORP. L’objectif de cet atelier est de pérenniser les acquis de cette
étude en termes de maîtrise de la démarche méthodologique adoptée pour la réalisation
de l'étude, et surtout de la mise en œuvre du rapport en ses parties portant sur les
emplois/métiers. Il sera mis à la disposition des structures participantes, une copie de la
documentation comportant le contenu des modules et de la méthode pédagogique adoptée
avant la tenue de l’atelier.
V. ANALYSE ET DESCRIPTION DES CHAÎNES DE VALEUR RIZ,
FONIO ET SESAME
L’agriculture occupe une place de choix dans l’économie du Mali. La production
céréalière de la campagne agricole 2015/2016 est estimée, selon les résultats provisoires
de l’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC), à 8 045 669 tonnes, toutes céréales
confondues. Les filières riz, sésame et fonio, principales cultures sèches entrent dans
l’alimentation d’un grand nombre de maliens.
5.1. La filière riz et sa chaîne de valeur
5.1.1. Poids économique de la filière riz
Le riz est un produit stratégique au Mali tant par son potentiel de production que par sa
consommation aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Il constitue le principal
produit de base agricole en termes de volume avec une production qui a atteint 2 780 905
tonnes de paddy en 2016/2017(plan de campagne 2016/2017). Cette céréale, à elle seule,
génère 5 % du PIB du pays. Selon les données de la Cellule de planification et de
statistique du secteur du développement rural (CPS-SDR), la moyenne de consommation
du riz des dernières années dans le pays est de 61,46 kg par habitant et par an, avec une
 |
12 12 |
▲back to top |
5
préférence portée sur le riz local. De nos jours, ce chiffre a crû pour atteindre 75,70 kg
par habitant et par an.
Le Mali dispose d’importantes potentialités rizicoles avec des superficies jugées aptes à
l’irrigation évaluées à près de 2.200.000 ha. Cependant, ce potentiel n’est valorisé qu’à
hauteur de 20 % (DNGR, 2013). Les systèmes de production existants sont :
- le système des grands et petits périmètres irrigués, en maîtrise totale de l’eau ;
- le système de riziculture de submersion contrôlée et de bas-fonds, en maîtrise
partielle ;
- le système de riziculture fluviale de submersion libre ;
- le système de riziculture pluviale.
Le riz est cultivé dans les bas-fonds et plaines du Sud, le long du fleuve Niger dans le
delta et sur les périmètres aménagés. Les systèmes de culture sont dépendants de la source
d’eau, d’où une grande variation de la productivité par hectare selon les systèmes de
production.
Source : MA 2016/2017
Figure 1 : Evolution des superficies et des productions
Il ressort de ce graphique que de 2012 à 2017, les superficies ont connu une évolution en
dents de scie, pour connaître son paroxysme en 2016/2017 avec 834,643 ha.
Source : MA 2016/2017
Figure 2 : Rendement par système de production (kg/ha)
679 369 543 501 803 136 762 140
834 643
1914867 1984504 2 166 830
2 331 053
2 780 905
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Evolution des superficies et des productions
superficie (ha) production (T)
6206
2627
1162
2733
Rendt Rendt Rendt Rendt
maîtrise totale submersion Contrôlée submersion libre Bas Fond
Rendement par système de production (kg/ha)
 |
13 13 |
▲back to top |
6
Le rendement élevé dans le système de maîtrise totale justifie les investissements
importants du gouvernement dans ce secteur pourvoyeur d’emplois pour les jeunes
urbains et ruraux comme c’est le cas de la zone Office du Niger.
5.1.2. Analyse de la chaîne des valeurs de la filière riz
Par chaîne des valeurs, il faut comprendre l’ensemble des étapes, déterminant la capacité
d’un acteur de dégager des avantages compétitifs sur une filière agricole. La chaîne de
Valeur du riz se définit dès lors comme la mise en relation des activités de production du
paddy avec les autres activités qui permettent de transformer ce paddy sous différentes
formes et de le distribuer tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur.
Les différents acteurs tout au long de la chaîne travaillent à assurer le développement de
leurs activités, chacun en ce qui le concerne, dans une logique de recherche de
rentabilité/compétitivité. Ces acteurs, qui opèrent dans la filière riz au Mali sont entre
autres les producteurs, les transformateurs, les collecteurs, les regroupeurs (dépendants et
indépendants), les demi-grossistes, les grossistes importateurs, les détaillants, les
transporteurs les appuis conseils. Ces acteurs interviennent sur les marchés soit pour
acheter soit pour vendre.
La chaîne de valeur production du riz fait recourt à plusieurs acteurs qui sont entre autre
les exploitants agricoles, les fournisseurs d’intrants agricoles, les producteurs semenciers,
les transporteurs, les banques et les IMF, les services d’appui conseil, les structures de
recherche et les ONG.
5.1.2.1. Production
La production de riz a connu une augmentation significative de 2012 à 2017 Elle a atteint
2 780 905 tonnes de paddy en 2016/2017. Pour ce qui est du rendement elle varie en
fonction des systèmes de production. Selon le plan de campagne 2016/2017, les
estimations de rendement sont de 6,206 tonnes à l’hectare, 2,733 tonnes à l’hectare, 2,627
tonnes à l’hectare et 1,162 tonnes à l’hectare, respectivement dans le système de maîtrise
totale, dans le bas-fond, dans le système de submersion contrôlée et dans le système de
submersion libre (voir figure I et figure 2).
Les coûts de production varient par système de production. Par exemple, la production
de 1 ha de riz en hivernage à l’Office du Niger en maîtrise totale de l’eau indique une
marge nette d’exploitation de 221 050 F CFA (voir tableau en annexe I) .
5.1.2.2. Riz et Pisciculture
L’activité de pisciculture est à son début dans les périmètres irrigués de Baguineda et de
Dioro. Elle a besoins d’être vulgarisée car les premiers résultats sont assez concluants.
Elle permet d’obtenir du riz et du poisson dont la vente est majoritairement une activité
féminine au Mali (DIARRA Salifou B, TRAORE P, KEITA F- OMA 201)
 |
14 14 |
▲back to top |
7
En fait, la rizipisciculture est une variante de pisciculture qui associe la riziculture
immergée avec l’introduction de poissons non rhizophage. La pratique de la
rizipisciculture consiste à aménager un étang piscicole de refuge des poissons de 6 mètres
de longueur et 80 centimètres de profondeur. Il est adossé à des tranchées périmètrales de
80 centimètres de largeur et 60 centimètres de profondeur.
La mise en eau est effectuée dans l'étang piscicole, qui à son tour, alimentera les tranchées
grâce à un système de vases communicants. Le dispositif permet le libre mouvement des
poissons dans toutes les directions de l'étang piscicole. Le paysan procédera ensuite à la
mise en eau des alevins qu'il nourrira deux fois par jour. Tous les deux mois, la ration est
doublée. Les alevins sont alimentés essentiellement avec la farine basse de riz, les restes
d’aliments, les bouses de vache, les termites et les boyaux d’animaux.
5.1.2.3. Transformation du riz
La transformation est l’ensemble des activités qui permettent d’avoir le riz local à partir
du paddy. Elle comprend essentiellement l’étuvage et le décorticage. Il existe plusieurs
technologies pour la transformation. La transformation du paddy concerne l’étuvage et le
décorticage.
L’étuvage : Dans les zones de production rizicoles l’étuvage est essentiellement pratiqué
par les femmes productrices de riz soit individuellement, soit en association.
Le décorticage: Il permet d’avoir soit le riz étuvé, soit le riz local. En décortiquant le
paddy étuvé, on obtient le riz étuvé blanc ou rouge. De la même manière, le paddy simple
donne le riz local.
Au Mali, pendant ces dernières décennies, le secteur de la transformation du riz a évolué
en plusieurs étapes qui ont permis de passer progressivement des rizeries industrielles
avant les années 90 aux décortiqueuses et mini rizeries aujourd’hui. En effet, dans les
grandes zones de production (ON, ORM, ORS), jusqu’au début des années 90, de grandes
rizeries assuraient la transformation du paddy commercialisé par les agriculteurs, tandis
que la production destinée à l’autoconsommation était transformée manuellement et par
des décortiqueuses. Ces rizeries proposaient à la vente plusieurs qualités de riz usiné pour
le marché malien : RM 40 (riz malien 40 % de riz entier), RM 25, ELB (Entier Long
Blanchi), BB (brisure blanchie), etc. (Havard, 2003).
Au début des années 90, le programme d’ajustement structurel agricole s’est traduit par
la libéralisation de la filière, le désengagement progressif de l’Etat et l’émergence de
nouveaux acteurs (Organisations de producteurs [OP] et privés) dans les activités de
service aux producteurs.
Dans le secteur de la transformation du riz, ces nouveaux acteurs ont investi surtout dans
des décortiqueuses qui n’effectuent que le décorticage, mais qui sont moins couteux que
 |
15 15 |
▲back to top |
8
les rizeries industrielles qui effectuent le stockage, le nettoyage et le décorticage du
paddy, puis le blanchiment, le triage et le conditionnement du riz.
Pour l’essentiel, la transformation du paddy est actuellement assurée par des organisations
paysannes et des privés à travers l'utilisation de petites décortiqueuses. Elles se
concentrent au niveau des grands bassins de production de riz comme l’Office du Niger,
qui en comptait environ 1460 unités en 2013 (Bilan campagne, ON, 2012/2013)
Environ 80 % du riz commercialisé est transformé par ces unités qui sont très peu
performantes avec un rendement usinage variant de 58 à 60 % et un taux de brisure jugé
élevé (qualité du riz médiocre) par des consommateurs de plus en plus exigeants.
(Yacouba M. COULIBALY et Abdoulaye Ouologuem 2014).
Malgré le nettoyage et le tamisage de ce riz, quelque part dans la chaîne de valeur, les
niveaux élevés de pertes induites par cette faiblesse technique engendrent des coûts qui
ne peuvent pas être couverts.
Dans certaines zones (par exemple à l’intérieur du delta du Niger et dans le Sud où le riz
est cultivé dans les bas-fonds et les plateaux), le riz est transformé selon une autre
méthode pour produire du riz étuvé qui est bien moins important que le riz blanc sur le
marché mais bien apprécié à la consommation.
Les contraintes de la transformation du paddy sont liées à :
- la qualité du paddy (le taux d’humidité du paddy qui doit être compris entre 12 et
14 %, le taux d’impureté, la maturité au moment de la récolte et la variété du riz) ;
- la qualité des équipements (décortiqueuses, trieuses).
5.1.2.4. Commercialisation
Dans la commercialisation du riz, interviennent plusieurs acteurs que sont les
producteurs, les collecteurs, les coopératives, les transformateurs, les grossistes, les
détaillants et les consommateurs. Il y a lieu de préciser que, dans le circuit de
commercialisation du riz, certains acteurs intègrent plusieurs fonctions. Cette intégration
des fonctions a essentiellement pour but d’améliorer leur part dans les marges
commerciales et partant de maximiser leur bénéfice.
Cette commercialisation permet d’approvisionner les différents segments de la demande.
Par segment de marché, on entend un sous-groupe de consommateurs qui ont des
caractéristiques similaires, expriment des besoins et des désirs semblables et réagissent à
la même stratégie de marketing. La compréhension de la segmentation des marchés
concernés est donc très importante dans la mesure où elle permettra d’identifier pour le
riz, les stratégies de marketing en fonction de ces segments.
A partir de cette définition on distingue pour le riz, quatre segments : a) Le segment des
riz entiers (ELB) haut de gamme d’origines diverses, correspondant à la petite frange de
 |
16 16 |
▲back to top |
9
la population à haut revenu, notamment les expatriés occidentaux et les hauts cadres de
l’administration et des affaires. Ce segment utilise moins de 3 % des tonnages de riz
importés (Zaslavsky, 2005) et local. Il est surtout alimenté à partir des importations. De
plus en plus des acteurs du marché se positionnent sur ce segment en reconditionnant le
riz « Gambiaka tout venant ». b) Le segment du riz à 15 %-25 %, qui représente une
qualité intermédiaire entre le lux et la qualité dominante qui est le riz 35 % ou RM 40
(selon les normes de l’Office du Niger). Ce segment représente environ 10 % de part du
marché. c) Le segment du riz RM40, assimilé au 35 % du marché mondial, représente
près de 80 à 85 % de part de marché. C’est le riz de grande consommation qui est le
« Gambiaka tout venant » lorsqu’il s’agit actuellement du riz d’origine locale et celui des
riz « brisure 100 % » qui est une catégorie de riz de qualité relativement médiocre
lorsqu’il est d’origine « tout venant local » ou importé non parfumé. (d) Le quatrième
segment est celui du riz brisure parfumé (provenant surtout de l’importation).Ce type de
riz est très prisé et s’assimile au semi lux ou au lux, très généralement utilisé lors des
cérémonies de baptême, de mariage ou des funérailles.
De nos jours, les consommateurs des centres urbains, surtout de Bamako, sont de plus en
plus exigeants sur la qualité des céréales notamment le riz. Ainsi pour satisfaire la
demande des clients sur ces marchés, les détaillants procèdent au nettoyage du riz tout
venant qu’ils achètent avec les forains pour obtenir du riz de meilleure qualité. Pour
présenter une qualité de riz visiblement appréciable par les clients, certains éléments
d’appréciation apparente peuvent être, notamment le taux de brisures, le degré de
blanchiment et l’homogénéité des grains. D’autres éléments d’appréciation que sont l’âge
qui détermine le taux de gonflement, le goût et diverses appréciations culinaires et les
conditions de traitement et de conservation rentrent également en jeu dans le choix des
consommateurs. Si les premiers éléments d’appréciation sont visibles à l’œil nu, il en est
autrement pour la deuxième catégorie d’éléments qui reposent essentiellement sur les
conseils reçus d’autres personnes ayant eu accès à ces informations.
Pour améliorer la qualité du riz au niveau des marchés, les techniques utilisées par les
commerçants sont le criblage, le tamisage et le vannage.
Le criblage permet de débarrasser le riz tout venant des graviers et autres impuretés afin
de le rendre plus propre. Selon les commerçants, le taux d’impuretés peut atteindre
souvent 2 à 3 % du stock total acheté. Après le criblage, le commerçant procède au
tamisage du riz tout venant pour séparer les grains brisés des grains Entier Long. Cette
opération permet d’obtenir selon la qualité de riz tout venant acheté, soit 90 % de riz
Entier Long Blanchi et 10 % de riz Brisé ou dans certain cas 80 % de riz Entier Long
Blanchi et 20 % de riz Brisé. Les riz Brisé et Entier Long Blanchi ainsi obtenus sont
soigneusement vannés pour enlever le son et la farine de brisure qui seront utilisés pour
d’autres fins.
 |
17 17 |
▲back to top |
10
D’une manière générale, une étude sur les chaînes de valeur riz en zone Office du Niger
réalisée en 2014 relative à une analyse comparative les marges bénéficiaires des acteurs
directs fait ressortir que les marges bénéficiaires :
- des producteurs varient de 15 F CFA/kg à 45 F CFA /kg,
- des transformateurs sont de 4,18 F CFA/kg pour les petites décortiqueuses et de 95
F CFA/kg pour les rizeries,
- des commerçants grossistes sont 10 F CFA/kg et celles des détaillants sont 12,5 F
CFA/kg.
Source : COULIBALY, 2014
Schéma 1 : Marge bénéficiaire des acteurs direct de la chaîne de valeur riz
5.1.2.5. Les sous-produits de riz, leur utilisation et les opportunités de marché.
Les sous-produits du riz au Mali sont :
- la paille de riz, qui reste après le battage dans les champs et qui est consommé par
les animaux. La paille peut servir aussi de litière et des matières premières dans la
fabrication des pâtes à papier. Cependant au Mali, cette paille ne fait pas toujours
l’objet de vente. La Société CAFON fabrique actuellement des botteleuses qui
permettent de mieux valoriser ces pailles;
- le son de riz, qui est produit lors du décorticage et qui est vendu à 1000 F le sac aux
éleveurs comme aliment bétail ;
- les balles de paddy, qui sont brûlées dans les champs car pense-t-on qu’elles jouent
le rôle de fertilisant organique. Elles sont aussi utilisées par les étuveuses pour
réduire leur consommation de fagots de bois;
- La farine de riz ou farine basse et les sons de riz servent pour l’alimentation de bétail
et des volailles.
 |
18 18 |
▲back to top |
11
VI REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES
ENQUETEES DE LA FILIERE RIZ ET NOMBRE DE
TRAVAILLEURS EXISTANTS
Dans le répertoire de 73 entreprises, 31 entreprises agropastorales (soit 42 %) ont été
enquêtées et se répartissent comme suit :
6.1. Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière riz
Les entreprises de la filière riz, dans la zone enquêtée se concentrent dans la localité de
San où le riz est produit par l’association des Riziculteurs de la Plaine Aménagée de San
Ouest (ARPASO) véritable PMI bien structurée et fonctionnant avec des moyens
suffisamment mécanisés.
Tableau 1 : Entreprises riz enquêtées
Filière Entreprises enquêtées Répartition géographique des
entreprises enquêtées
Région Cercle Commune
Riz
Association des Riziculteurs de la Plaine
Aménagée de San Ouest (ARPASO)
Ségou San San
ARPASO Mme Coulibaly Korotoumou Traoré San San
ARPASO (Muni rizerie- transformation primaire) San San
Malowoussou Sanké N°1 Lafiabougou
commercialisation
San San
ARPASO, commercialisation San San
Malowoussou Sanké N° Transformation
Source : Kara Consult enquête 2018
6.2. Nombre d’entreprises de la filière riz enquêtées
Il ressort de ce tableau que ce sont 6 entreprises qui ont été enquêtées. Elles se répartissent
comme suit :
Tableau 2 : Nombre d’entreprises de riz enquêtées
Filière Chaînes de Valeur Total
Production Transformation Commercialisation
Riz 1 3 2 6
Source : Kara Consult enquête 2018
 |
19 19 |
▲back to top |
12
6.3. Nombre de salariés existants de la filière riz
La filière riz emploi: 5 207 soit 4 787 hommes et 420 femmes répartis comme suit :
Filière riz : 5 207 soit 4 787 hommes et 420 femmes répartis comme suit :
- Entreprises de production : 5 090 travailleurs pour 4 763 hommes et 627 femmes ;
- Entreprises de transformation : 107 travailleurs pour 17 hommes et 90 femmes ;
- Entreprises de commercialisation : 10 travailleurs pour 7 hommes et 3 femmes.
Figure 3 : Chaîne de valeur Riz
6.4. Typologie des entreprises de la filière riz des entreprises enquêtées
La typologie des entreprises des chaînes de valeur de la filière riz sont de deux (2) types :
les petites et moyennes industries (PMI) au nombre de quatre (4) et les petites et moyennes
entreprises (PME) au nombre de deux (2).
Tableau 3 : Typologie des Entreprises filière riz
Filières/chaînes Entreprises
PMI Localisation Total
Riz/ production Association des Riziculteurs de la
Plaine Aménagée de San Ouest
ARPASO
San 1
Riz/ transformation
ARPASO (Muni rizerie- transformation
primaire)
San 1
PME
Malowoussou Sanké N°1 Lafiabougou
San
1
ARPASO Mme Coulibaly Korotoumou
Traoré
1
PME
Riz/Commercialisation Malowoussou Sanké N°1 Lafiabougou
San
1
ARPASO, commercialisation San 1
Source : Kara Consult enquête 2018
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
H F Total
Main d’œuvre
RIZ Production
RIZ Transformation
RIZ Commercialisation
 |
20 20 |
▲back to top |
13
6.5. Typologie des emplois/métiers des entreprises enquêtées
L'analyse des métiers et des emplois par filière et sous-filière repose sur un découpage
par activité. Il faut distinguer la tâche ou le poste de travail, l'activité, l'emploi et le métier
comme suit :
- une tâche est une opération précise qu'exécute un acteur d'une filière afin d'atteindre
son objectif économique ;
- un poste de travail est une situation individuelle de travail ; il est constitué de
l'ensemble ordonné des tâches réalisées par une personne. Il est un emplacement
ou une position qu'occupe effectivement un acteur qui effectue une tâche ou une
activité précise ;
- un emploi est un savoir-faire pratique permettant à un acteur de filière d'accomplir
une ou un ensemble de tâches cohérentes liées à une fonction économique ;
- un métier est un ensemble d'emplois connus et repérés, eux-mêmes décomposables
en activités.
Un métier indique tout ce qu'un « professionnel confirmé » fait dans le cadre de
ses activités professionnelles.
Les types d’emplois/métiers recensés dans les chaînes de valeurs filière riz de la zone
concernée par l’étude.
Ils se répartissent en emplois classiques et en emplois nouveaux
Il faut comprendre par métiers ceux soumis à un diplôme (CAP, DEF, ...) qui
sanctionnent un niveau d'instruction. Le métier, fait référence à un corps de savoirs
théoriques et pratiques. La formation aux métiers est organisée dans un cursus ou
programme. L'emploi n'est pas reconnu officiellement par un diplôme. Il est acquis par
un apprentissage direct et par l'expérience.
Tableau 4 : Typologie des emplois filière riz
Filière Chaîne de valeur/
Maillon
Métier Emploi
Classique Nouveau
Riz Production
Riziculteur
Conducteur d’engins, laboureur,
transporteur
Mécanicien
Gardien, Gestionnaire, Magasinier,
Manœuvre, Comptable, Ouvrier
agricole culture irriguées Ouvrier
agricole cultures sèches
Chef d’exploitation agricole
Chargé du battage
mécanique,
Animateur,
Coordinateur,
Transformation Transformateurs
Riz
Meunier, transporteur
Gardien, Gestionnaire, Magasinier,
Manœuvre, Comptable,
Chargé de l’étuvage
Commercialisation Agent commercial Transporteur
Magasinier, Manœuvre, Comptable,
Vendeur, Gardien
Source : Kara Consult enquête 2018
 |
21 21 |
▲back to top |
14
6.6. Description des emplois/métiers de la chaîne de valeurs filière RIZ
6.6.1. Description des emplois/métiers nouveaux- RIZ
Les tableaux ci-dessous présentent la description des emplois/métiers nouveaux de la
filière riz
Tableau 5 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chargé du battage
mécanique
Intitulé de l’emploi/métier
Chargé du battage mécanique
Code
Appellation principale
Chargé du battage mécanique
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Séparer la paille du grain Connaître les techniques de
conduite
Avoir des notions de
mécanique et d’entretien
Savoir conduire une machine
agricole, savoir entretenir une
machine. Savoir réparer une
machine
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Utiliser rationnellement la batteuse Connaissance des
techniques d’utilisation des
batteuses.
Effectuer de petites réparations
sur la batteuse
Contrôle régulier de l’état de la
batteuse
Conditions générales d’exercice
Avoir une connaissance des règles de sécurité, être vigilent et avoir des réflexes rapides.
Lieux d’exercice
S’exerce en milieu rural, dans les exploitations
agricoles
Conditions de travail
Travail en milieu bruyant et poussiéreux
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Physiquement solide, sérieux, courageux, dynamique, consciencieux, endurant
 |
22 22 |
▲back to top |
15
Tableau 6 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Animateur
Intitulé de l’emploi/métier
Animateur
Code
Appellation principale
Animateur
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
la vulgarisation des techniques de
production auprès des agriculteurs
Connaître les techniques de
vulgarisation
Connaître toutes les
techniques agricoles, les
techniques d’animation
Savoir préparer les techniques
d’animation, savoir préparer les outils
d’animation, savoir mener une
animation.
Savoir appliquer les techniques de
vulgarisation
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Réaliser des animations de
vulgarisation (Tests de
démonstration, réunion
participative…)
Connaître les différentes
techniques de l’animation
Connaître toutes les
techniques agricoles
Préparer une animation, animer une
séance de vulgarisation
Savoir transmettre les messages de
vulgarisation
Conditions générales d’exercice
Travaille en milieu rural sur le terrain en groupe ou en individuel
Lieux d’exercice
Bureau et hors du bureau
Conditions de travail
Travail effectué sur le terrain
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Bonne condition physique et bonne aptitude à l’oralité et au leadership
Tableau 7 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chargé d’étuvage
Intitulé de l’emploi/métier
Chargé de l’étuvage
Code
Appellation principale
Agent chargé de l’étuvage
Appellation spécifique
Agent chargé de l’étuvage
Activités de base Connaissance Savoir faire
Etuver, préparer le riz semi- fini
Connaître les techniques
d’étuvage du riz
Connaître les bonnes
pratiques d’hygiène et de
fabrication (BPH/BPF) du
produit
identifier la qualité du riz, poser le
dispositif de l’étuvage, exécuter les
travaux de l’étuvage, conditionner le
produit étuvé
Appliquer les bonnes pratiques
d’hygiène et de fabrication du produit
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Conditions générales d’exercice
S’exerce en groupe ou seul dans un atelier
Lieux d’exercice
Atelier de production
Conditions de travail
Endurance, persévérance, travail dans la chaleur et
parfois dans la fumée
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Capacité physique requise
 |
23 23 |
▲back to top |
16
Tableau 8 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Coordinateur
Intitulé de l’emploi/métier
Coordinateur
Code
Appellation principale
Coordinateur
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Il est chargé de la mise en cohérence
des activités de production, de
transformation et de
commercialisation des produits
agricoles (sésame et fonio)
Connaître les notions de
planification et toutes les
techniques de production, de
transformation et de
commercialisation des produits
agricoles
Savoir ordonner, suivre et
évaluer(le temps de
préparation du matériel et les
équipements, la quantité et la
qualité du produit,
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Collecter et compiler les programmes
d’activités des services de l’entreprise,
planifier les activités
Connaître les différentes
activités des services, les
techniques de la planification des
activités.
Avoir des notions techniques sur
le matériel/équipements
Réaliser des plannings,
distinguer et appliquer les
activités des programmes
Conditions d’accès : Niveau CAP ou DEF
Conditions générales d’exercice
Emploi rural/urbain
Lieux d’exercice
Bureau ou hors du bureau
Conditions de travail
Travail minutieux, Rigoureux et demande un esprit
critique, flexibilité et d’adaptation
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Grande capacité d’écoute et de synthèse
 |
24 24 |
▲back to top |
17
6.6.2. Description des emplois/métiers classiques-riz-sésame et fonio
Tableau 9 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : ouvrier agricole
Intitulé de l’emploi/métier
Ouvrier agricole- Cultures sèches
Code
Appellation principale
Ouvrier agricole
Appellation spécifique
Saisonnier
Activités de base Connaissance Savoir faire
Chargé de la mise en pratique du système
semis à la volée et du semis en ligne
Préparer le terrain, labourer, semer à la
volée, enfouir les grains, désherber,
apporter, récolter, mettre en gerbe, battre,
vanner, sécher, conditionner
Connaître les techniques et
les systèmes culturaux,
connaître l’emploi des
fertilisants, les techniques
de récolte, utilisation du
matériel agricole
Savoir réaliser des travaux de
préparation du champ, effectuer les
travaux de labour, de semis à la volée
et du semis en ligne, de démariage, de
buttage, de désherbage, du traitement,
de la récolte, du battage (secouage
pour le sésame), du vannage et du
conditionnement
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Conditions générales d’exercice
travail dans les champs, plaines, aux abords des cours d’eau, dans les jardins ; mode de rémunération journalier,
hebdomadaire, par décade, par quinzaine, mensuel, à la production
Lieux d’exercice
Champ
Conditions de travail
Travaille sous le soleil, dans la chaleur et dans la poussière,
travail saisonnier
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Physiquement solide, sérieux, courageux, dynamique, consciencieux, endurant
Tableau 10 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : comptable
Intitulé de l’emploi/métier
Comptable
Code
Appellation principale
Comptable
Appellation spécifique
Comptable
Activités de base Connaissance Savoir faire
Recherche et gérer les fonds
de l’entreprise
Connaître les concepts
comptables et financiers
Préparer le budget, tenir le journal, établir la balance,
réaliser les rapprochements, élaborer le bilan, assurer
le paiement des salaires, effectuer les achats
Conditions d’accès : Avoir le DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Chercher et gérer les
documents comptables (plan
comptable, OHADA, textes
…)
Avoir des connaissances
sur les documents
comptables et financiers
Maîtriser l’application des documents comptables et
financiers
Conditions générales d’exercice
Rigueur et esprit de synthèse, courtoisie, ponctualité et assiduité.
Lieux d’exercice
Bureau
Conditions de travail
Travaille parfois tardivement
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Courage et honnêteté
 |
25 25 |
▲back to top |
18
Tableau 11 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chef
d’exploitation agricole
Intitulé de l’emploi/métier
Chef d’exploitation agricole
Code
Appellation principale
Chef d’exploitation agricole
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Travailler la terre; préparer les
productions à développer ou à
abandonner ;
choisir le matériel à acheter,
conduire les travaux au champ
Connaître les techniques
d’exploitation agricole
Connaître le matériel agricole
Connaître le management des
travaux
Appliquer les techniques d’exploitation
agricole
Savoir opérer le choix du matériel
agricole
Savoir manager une équipe
Conditions d’accès : Niveau d’étude CAP machinisme agricole, CAP ouvrier agricole
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Réparer ou entretenir un tracteur
Gérer l’exploitation
Connaître les techniques de
maintenance
Connaître les techniques de
gestion d’une exploitation
agricole
Connaître la comptabilité
Réparer ou entretenir un tracteur
Gérer l’exploitation
Appliquer les techniques comptables
Conditions générales d’exercice
S’exerce dans une ferme
Lieux d’exercice
Champ
Conditions de travail
Endurance, persévérance, travail dans la chaleur et parfois
dans la fumée
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Capacité physique et habileté manuelle requise
Tableau 12 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Conducteur
d’engins agricoles
Intitulé de l’emploi/métier
Conducteur d’engins agricoles
Code15409
Appellation principale
Conducteur d’engins agricoles
Appellation spécifique
Machiniste agricole
Activités de base Connaissance Savoir faire
Conduire et entretenir un engin
agricole
Connaître les techniques de
conduite
Avoir des notions de
mécanique et d’entretien
Savoir conduire une machine agricole,
savoir entretenir une machine. Savoir
réparer une machine
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Utiliser rationnellement les engins
agricoles
Connaissance des techniques
d’utilisation des engins.
Effectuer de petites réparations sur les
engins
Contrôle régulier de l’état de la machine
Conditions générales d’exercice
Avoir une connaissance des règles de sécurité, être vigilent et avoir des réflexes rapides.
Lieux d’exercice
S’exerce en milieu rural, dans les exploitations
agricoles
Conditions de travail
Travail en milieu bruyant, poussiéreux et boueux
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Physiquement solide, sérieux, courageux, dynamique, consciencieux, endurant
 |
26 26 |
▲back to top |
19
Tableau 13 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Magasinier
Intitulé de l’emploi/métier
Magasinier
Code
Appellation principale
Magasinier
Appellation spécifique
Chef magasinier, chef de dépôt, gestionnaire des stocks
Activités de base Connaissance Savoir faire
Gérer les stocks : réceptionner les
produits, contrôler la qualité et la
quantité des produits, les conserver
dans les meilleures conditions.
Préparer pour la sortie des produits
Connaître des notions en
gestion et de la comptabilité
Avoir des notions sur les
produits, leur conservation et
l’utilisation des matériels
adaptés.
Réceptionner les produits, effectuer les
stockages, reconnaître et vérifier le
produit ou le matériel, recevoir les
commandes, préparer les livraisons
Effectuer les inventaires
Conditions d’accès : Niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Etiqueter et classer les produits,
Emballer le produit, organiser le
rangement des produits, vendre
Connaissances en techniques
de conditionnement et de
vente des produits
Tenir les stocks, conditionner et vendre
Conditions générales d’exercice
Respect des délais, respect des processus de contrôle
Lieux d’exercice
Le métier s’exerce en magasin, entrepôt, seul ou en
équipe
Conditions de travail
Manipulation de charge ou de matières dangereuses et
d’utilisation de matériel de manutention, horaires décalés,
peut nécessiter un travail de nuit
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Physiquement solide, sérieux, courageux, dynamique, consciencieux, endurant
Tableau 14 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Manœuvre
Intitulé de l’emploi/métier
Manœuvre
Code
Appellation principale
Manœuvre
Appellation spécifique
Manutentionnaire
Activités de base Connaissance Savoir faire
Aider à la manutention entreposer
les produits
Connaître les notions de la
manutention
Connaître les règles d’hygiène
(port des charges) et de sécurité
Charger, décharger, peser un produit,
transporter des produits, entreposer les
produits en toute sécurité
Conditions d’accès : Niveau DEF
Activités spécifiques Connaissance Savoir-faire
Effectuer des travaux de
conditionnement
Différencier les types
d’emballages
Préparer les sacs, remplir les sacs
Conditions générales d’exercice
Travail exercé à l’intérieur et à l’extérieur d’un magasin
Lieux d’exercice
Magasin
Conditions de travail
Travail dur, salissant, journalier
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Bonne capacité physique
 |
27 27 |
▲back to top |
20
Tableau 15 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Gérant
Intitulé de l’emploi/métier
Gérant
Code
Appellation principale
Gérant
Appellation spécifique
Gérant
Tableau 16 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Vendeur
Intitulé de l’emploi/métier
Vendeur :
Code
Appellation principale
Vendeur
Appellation spécifique
Vendeur
Activités de base Connaissance Savoir faire
commercialiser le produit Connaître les caractéristiques du
produit
Avoir des notions en techniques
de vente et comptabilité
Attirer le client, communiquer sur l’entreprise
et le produit, vendre, tenir la caisse et le
journal de caisse
Conditions d’accès : Niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Faire la promotion des
produits
Avoir des notions de marketing Faire connaître le produit
(radio, télé, téléphone)
Conditions générales d’exercice
Travail seul ou en équipe
Lieux d’exercice
En boutique, au marché ou en déplacement
constant
Conditions de travail
Travail fatiguant
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Condition physique nécessaire, rigueur, honnêteté
Activités de base Connaissance Savoir faire
S’assurer de la collecte, de
l’entreposage du produit, de la
valorisation du produit et la mise à
disposition du produit
Connaître les notions de
planification, de la gestion
et de la comptabilité
réceptionner, identifier la qualité du
produit, caractériser le produit, peser,
stocker, vendre et encaisser
Conditions d’accès : Niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Vendre Notion de techniques de
vente
Servir le client, encaisser l’argent
Conditions générales d’exercice
Travail en bureau
Lieux d’exercice
Entreprise
Conditions de travail
Travail comportant des risques de perte
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Bonne capacité d’anticipation et de gestion
 |
28 28 |
▲back to top |
21
Tableau 17 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Gardien
Intitulé de l’emploi/métier
Gardien
Code
Appellation principale
Gardien
Appellation spécifique
Gardien
Activités de base Connaissance Savoir faire
sécuriser l’entreprise, les produits et les
personnes
Connaître les notions sur
la sécurité et de l’accueil
Accueillir, contrôler les lieux, surveiller
les biens et les personnes
Conditions d’accès : Niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Nettoyer les lieux Techniques de nettoyage
Avoir des notions sur
l’hygiène
Balayer les lieux, ranger le matériel
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène
Conditions générales d’exercice
Travail de nuit et parfois de jour seul ou en équipe
Lieux d’exercice
Devanture de l’entreprise
Conditions de travail
Travail fatiguant et dangereux
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Condition physique nécessaire, vigilance
Tableau 18 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Riziculteur
Intitulé de l’emploi/métier
Riziculteur
Code
Appellation principale
Riziculteur
Appellation spécifique
Producteur de riz
Activités de base Connaissance Savoir faire
Produire le riz; préparer les
surfaces à labourer, conduire les
travaux de labour au champ
Connaître les techniques de
culture du riz
Connaître les techniques de
conduite des travaux de labour
Appliquer les techniques de culture du riz
Appliquer les techniques de conduite des
travaux de labour
Conditions d’accès : Niveau d’étude DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Réparer ou entretenir un tracteur
Gérer la production
Connaître les techniques de
maintenance
Connaître les techniques de
gestion d’une production de riz
Connaître les techniques de
gestion
Réparer ou entretenir un tracteur
Appliquer les techniques de production
de riz
Appliquer les techniques de gestion
Conditions générales d’exercice
S’exerce dans une rizière ou au champ
Lieux d’exercice
Champ
Conditions de travail
Endurance, persévérance, travail dans la chaleur
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Capacité physique et habileté manuelle requise
 |
29 29 |
▲back to top |
22
Tableau 19 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : mécanicien
Intitulé de l’emploi/métier
Mécanicien
Code
Appellation principal
Mécanicien
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Répare et effectue l’entretien des
machines et des moteurs. Peut
diriger un atelier
Connaître les techniques
d’entretien d’un moteur et d’une
machine
Prévenir et détecter les pannes, réparer,
entretenir les machines et les moteurs
Conditions d’accès : niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Description du fonctionnement du
moteur
Connaissances et lecture des
fiches techniques
Connaissances sur l’évolution
technologique
Décrire le fonctionnement d’un moteur,
démonter un moteur, remonter un moteur,
diagnostiquer les pannes rapidement et en
toute sécurité
Conditions générales d’exercice
Emploi nécessitant une observation des règles de sécurité
Lieux d’exercice
Travail dans un atelier en relation avec les autres
intervenants de la structure
Conditions de travail
Travail à risque, sens d’observation
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Nécessite une bonne condition physique
Tableau 20 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Forgeron
Intitulé de l’emploi/métier
Forgeron
Code 60107
Appellation principale
Forgeron
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Fabriquer et concevoir des pièces de
rechange
Connaissance du processus de
fusion et de transformation du
fer ainsi que les alliages
Savoir tenir la pince, utiliser le soufflet,
savoir tenir un burin
Conditions d’accès : niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Gérer un atelier Techniques de gestion d’un
atelier
Savoir réparer des pièces de machines,
savoir appliquer les techniques de
fabrication d’une pièce de machine
Conditions générales d’exercice
Travail nécessitant promptitude dans l’application des règles sécurité
Lieux d’exercice
L’emploi s’exerce au sein d’une forge
Conditions de travail
Le travail s’effectue avec la manipulation de charges dans un
environnement bruyant et une chaleur parfois élevée.
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
L’activité nécessite une bonne condition physique
 |
30 30 |
▲back to top |
23
Tableau 21 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Ouvrier agricole
Intitulé de l’emploi/métier
Ouvrier agricole Cultures irriguées
Code : 01010108
Appellation principale
Ouvrier agricole- Cultures irriguées
Appellation spécifique
Saisonnier
Activités de base Connaissance Savoir faire
Exécuter des travaux champêtres
Submersion contrôlée : labourer, herser, niveler,
semer (semis direct), entretenir (désherber,
fertiliser, traiter phytosanitaire), récolter, mettre
en gerbe, battre, conditionner, transporter,
stocker.
Maîtrise totale : installer la pépinière, labourer,
mettre en boue ou pudlage, niveler, repiquer
manuellement (arracher, les plants, repiquer en
ligne ou en quinconce), entretenir, drainer 15 jours
avant la récolte, récolter, mettre en gerbe, battre,
conditionner, transporter, stocker
Connaissance des
techniques culturales et
des systèmes
d’irrigation du riz
Installer la pépinière, réaliser les
travaux de labour, arracher et
repiquer les plants, entretenir les
cultures, récolter.
mettre en gerbe
battre sécher et conditionner
Conditions d’accès : niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Réaliser des travaux de maraîchage Connaître les
techniques
d’installation et
d’entretien des cultures
maraichères
Appliquer les bonnes pratiques du
maraîchage
Conditions générales d’exercice
Travail dans les champs, plaines, aux abords des cours d’eau, dans les jardins ; mode de rémunération journalier,
hebdomadaire, par décade, par quinzaine, mensuel, à la production.
Lieux d’exercice
Champs, plaine, abord des cours d’eau, dans les
jardins
Conditions de travail
Travail le jour, Travail sous la chaleur, le soleil, la pluie, dans le
froid, pieds dans l’eau
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Physiquement solide, sérieux, courageux, dynamique, consciencieux, endurant
 |
31 31 |
▲back to top |
24
Tableau 22 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : laboureur
Intitulé de l’emploi/métier
laboureur :
Code
Appellation principale
Laboureur
Appellation spécifique
Agriculteur
Activités de base Connaissance Savoir faire
Mettre en valeur une
exploitation agricole.
Labourer le champ
Connaître les techniques
d’exploitation agricoles
Connaître les caractéristiques des sols,
Connaître les techniques de labour
Préparer le champ, labourer, semer,
désherber, mettre l’engrais,
Conditions d’accès : niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Les techniques de production
de la fumure,
Avoir des notions de fabrique des
fumures
Appliquer les techniques de production
des fumures
Conditions générales d’exercice
Travail seul ou en équipe
Lieux d’exercice
Dans un champ,
Conditions de travail
Travail fatiguant
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Condition physique nécessaire, rigueur, honnêteté
Tableau 23 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : transporteur
Intitulé de l’emploi/métier
Transporteur
Code
Appellation principale
Transporteur
Appellation spécifique
Conducteur, chauffeur
Activités de base Connaissance Savoir faire
Transporter les produits
agricoles
Réaliser les opérations liées
au transport
Connaître la conduite d’un
véhicule
Connaître les techniques de
manutention
Connaître les techniques des
opérations liées au transport
Savoir conduire un véhicule
Savoir appliquer les techniques de
manutention
Savoir distinguer les opérations liées au
transport
Conditions d’accès : niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Entretenir un véhicule
Avoir des notions d’entretien
d’un véhicule
Appliquer les notions d’entretien d’un
véhicule
Conditions générales d’exercice
Travail seul ou accompagné
Lieux d’exercice
A bord d’un véhicule
Conditions de travail
Travail fatiguant
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Condition physique nécessaire, rigueur, honnêteté
6.6.3. Fonctions de travail
L’analyse d’une fonction de travail repose sur la définition de la mission du poste ainsi
que les compétences requises. Elle permet de définir les attentes de l’employeur, en
délimitant clairement les compétences requises et les responsabilités du collaborateur et
contribue à donner une vision d’ensemble de la structure. Elle facilite la mise en place de
 |
32 32 |
▲back to top |
25
l’organigramme. Celles des Emplois/métiers issus de l’enquête de la filière riz se
présentent comme suit :
Tableau 24 : Fiche fonction de travail ouvrier agricole – cultures sèches
Intitulé de la fonction
Ouvrier agricole- Cultures sèches
Ouvrier agricole- Cultures sèches
Description Producteur de céréales sèches
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions L’ouvrier agricole, dans la chaîne de production de la filière sésame
et fonio, a pour mission principale la mise en pratique du système
semis à la volée et du semis en ligne
Activités Savoir réaliser des travaux de préparation du champ, effectuer les
travaux de labour, de semis à la volée et du semis en ligne, de
démariage, de buttage, de désherbage, du traitement, de la récolte, du
battage (secouage), du vannage et du conditionnement Savoir réaliser
des travaux de préparation du champ, effectuer les travaux de labour,
de semis à la volée et du semis en ligne, de démariage, de buttage,
de désherbage, du .traitement, de la récolte, du battage (secouage), du
vannage et du conditionnement.
Compétences requises
Savoirs Connaître les techniques et les systèmes culturaux, connaître
l’emploi des fertilisants, les techniques de récolte
Savoir-faire Connaître les techniques et les systèmes culturaux
connaître l’emploi des fertilisants, les techniques de récolte.
Savoir-être (comportement) Rigueur et dextérité dans l’utilisation des techniques et systèmes
culturales
Qualifications (diplôme) BT agricole
Critères de performance Décrit et applique les techniques et systèmes culturales
Relations de travail Travaille avec toutes les structures de l’entreprise
Tableau 25 : Fiche fonction de travail comptable
Intitulé de la fonction Comptable
Description Le comptable aide à la recherche et à la gestion des fonds de
l’entreprise
Positionnement dans la hiérarchie Rend compte au responsable de l’entreprise
Missions Gestion du patrimoine de l’entreprise
Activités Tenir le journal, établir la balance, réaliser les rapprochements,
élaborer le bilan, assurer le paiement des salaires, effectuer les
achats
Compétences requises
Savoir Connaître les concepts comptables et financiers
Savoir-faire Savoir tenir un journal, établir une balance, réaliser les
rapprochements, élaborer un bilan, assurer le paiement des salaires,
effectuer les achats.
Savoir-être (comportement) Rigueur et esprit de synthèse, courtoisie, ponctualité et assiduité.
Qualifications (diplôme) BT
Critères de performance Maîtrise des fondamentaux de la comptabilité
Relations de travail Travaille avec les responsables à l’interne et les clients à l’extérieur
 |
33 33 |
▲back to top |
26
Tableau 26 : Fiche fonction de travail coordinateur
Intitulé de la fonction Coordinateur
Description Chargé de la mise en cohérence des activités de l’entreprise
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de service
Missions Il a pour mission principale la mise en cohérence des activités de
l’entreprise
Activités Collecter et compiler les programmes d’activités des services de
l’entreprise, planifier les activités
Compétences requises
Savoir Connaître les différentes activités des services, les techniques de la
planification des activités
Savoir-faire Distinguer et appliquer les activités des programmes
Savoir-être (comportement) Rigueur et esprit critique, courtoisie, ponctualité et assiduité.
Qualifications (diplôme) Certificat de Qualification Professionnelle CQP
Critères de performance Bonne maîtrise de l’application des activités des programmes
Relations de travail Travaille avec toutes les structures de l’entreprise
Tableau 27 : Fiche fonction de travail animateur
Intitulé de la fonction Animateur
Description Il contribue à la promotion du produit
Positionnement dans la hiérarchie Relève du coordinateur
Missions Il a pour mission principale la vulgarisation des techniques de
production auprès des agriculteurs
Activités la vulgarisation des techniques de production auprès des
agriculteurs Réaliser des animations de vulgarisation (Tests de
démonstration, réunion participative…)
Compétences requises
Savoir Connaître les techniques de vulgarisation
Connaître toutes les techniques agricoles, les techniques
d’animation Connaître les différentes techniques de l’animation
Connaître toutes les techniques agricoles
Savoir-faire Savoir préparer les techniques d’animation, savoir préparer les
outils d’animation, savoir mener une animation.
Savoir appliquer les techniques de vulgarisation
Préparer une animation, animer une séance de vulgarisation
Savoir transmettre les messages de vulgarisation
Savoir-être (comportement) Courtoisie, cordialité, jovial
Qualifications (diplôme) Certificat Qualification Professionnelle CQP
Critères de performance Maîtrise des techniques de vulgarisation et d’animation
Relations de travail Travaille avec l’ouvrier agricole et le chargé de battage mécanique
 |
34 34 |
▲back to top |
27
Tableau 28 : Fiche de fonction de travail Ouvrier agricole cultures irriguées
Intitulé de la fonction Ouvrier agricole- Cultures irriguées
Description L’ouvrier agricole des cultures irriguées produit du riz
Positionnement dans la hiérarchie Rattaché au responsable de l’entreprise
Missions L’ouvrier agricole des cultures irriguées a pour missions,
l’application des techniques culturales des systèmes de submersion
contrôlée et de maîtrise totale.
Activités Exécuter des travaux champêtres
Submersion contrôlée : labourer, herser, niveler, semer (semis
direct), entretenir (désherber, fertiliser, traiter phytosanitaire),
récolter, mettre en gerbe, battre, conditionner, transporter, stocker.
Maîtrise totale : installer la pépinière, labourer, mettre en boue ou
pudlage, niveler, repiquer manuellement (arracher, les plants,
repiquer en ligne ou en quinconce), entretenir, drainer 15 jours
avant la récolte, récolter, mettre en gerbe, battre, conditionner,
transporter, stocker
Réaliser des travaux de maraîchage
Compétences requises
Savoir Connaissance des techniques culturales et des systèmes
d’irrigation du riz
Connaître les techniques d’installation et d’entretien des cultures
maraichères
Savoir-faire Installer la pépinière,
Réaliser les travaux de labour
Arracher et repiquer les plants
Entretenir les cultures
Récolter,
Mettre en gerbe
Battre sécher et conditionner
Appliquer les bonnes pratiques du maraîchage
Savoir-être (comportement) Rigueur et dextérité dans l’utilisation des techniques et systèmes
culturales
Qualifications (diplôme) BT agricole
Critères de performance Décrit et applique les techniques et systèmes culturales
Relations de travail Travaille avec le magasinier, les ouvriers
 |
35 35 |
▲back to top |
28
Tableau 29 : Fiche de fonction de travail Magasinier
Intitulé de la fonction Magasinier
Description Le magasinier travaille à la sécurisation des produits
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission principale la gestion des stocks (réceptionner les
produits, contrôler la qualité et la quantité des produits, les
conserver dans les meilleures conditions) et la préparation la sortie
des produits
Activités Enregistrer les entrées, enregistrer les sorties, évaluer la qualité du
fonio à l’entrée et à la sortie, établir en fin d’année le bilan du
magasin
Compétences requises
Savoir Connaître des notions en gestion et de la comptabilité
Avoir des notions sur les produits, leur conservation et l’utilisation
des matériels adaptés
Savoir-faire Réceptionner les produits, effectuer les stockages, reconnaître et
vérifier le produit ou le matériel, recevoir les commandes, préparer
les livraisons, effectuer les inventaires, tenir les stocks,
conditionner et vendre
Savoir-être (comportement) Rigueur et esprit de contrôle, courtoisie, ponctualité et assiduité.
Qualifications (diplôme) BT
Critères de performance Maîtrise les savoir-faire de ses missions
Relations de travail Travaille avec le responsable de l’entreprise
Tableau 30 : Fiche de fonction de travail Conducteurs d’engins agricoles
Intitulé de la fonction Conducteur d’engins agricoles
Description Assure la conduite et l’entretien un engin agricole
Positionnement dans la hiérarchie Relève de l’ouvrier agricole
Missions Il a pour mission la conduite et l’entretien d’un engin agricole
Activités Conduire et entretenir un engin agricole
Utiliser rationnellement les engins agricoles
Compétences requises
Savoir Connaître les techniques de conduite
Avoir des notions de mécanique et d’entretien
Connaissance des techniques d’utilisation des engins
Savoir-faire Savoir conduire une machine agricole, savoir entretenir une
machine, savoir réparer une machine
Effectuer de petites réparations sur les engins
Contrôle régulier de l’état de la machine
Savoir-être (comportement) Endurance, courtoisie et respect de la hiérarchie
Qualifications (diplôme) CAP
Critères de performance Conduit avec dextérité la machine, entretient et répare
rapidement une machine
Relations de travail Travaille avec l’ouvrier agricole
 |
36 36 |
▲back to top |
29
Tableau 31 : Fiche de fonction de travail meunier
Intitulé de la fonction Meunier
Description Dans la chaîne de valeur transformation, le meunier conduit le
moulin
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission l’entretien et la conduite d’un moulin
Activités Epurer le produit, entretenir le moulin
Compétences requises
Savoir Connaître les techniques de conduite d’un moulin
Connaître la qualité du produit
Connaître les règles de sécurité, Connaître en techniques
d’entretien d’un moulin
Avoir des notions en mécanique
Savoir-faire Vanner; décortiquer, conditionner le produit, entretenir,
démonter, remonter un moulin
Savoir-être (comportement) Endurance, persévérance
Qualifications (diplôme) Certificat de Qualification Professionnelle CQP
Critères de performance Maîtrise de l’application des techniques de l’épuration du riz
Relations de travail Travaille avec le responsable de l’entreprise
Tableau 32 : Fiche de fonction de travail Manœuvre
Intitulé de la fonction Manœuvre
Description Le manœuvre est un travailleur journalier qui aide à la
manutention
Positionnement dans la hiérarchie Relève du magasinier
Missions Il a pour mission principale l’entreposage des produits.
Activités Aider à la manutention entreposer les produits, Effectuer des
travaux de conditionnement
Compétences requises
Savoir Connaître les notions de la manutention
Savoir-faire Charger, décharger, peser un produit, transporter des produits,
entreposer les produits en toute sécurité, Préparer les sacs,
remplir les sacs
Savoir-être (comportement) Endurance, courtoisie et minutie
Qualifications (diplôme) CQP
Critères de performance Appliquer avec maîtrise les techniques de manutention
Relations de travail Travaille avec le magasinier
 |
37 37 |
▲back to top |
30
Tableau 33 : Fiche de fonction de travail Gérant
Intitulé de la fonction Gérant
Description Il s’assurer de la collecte, de l’entreposage, de la valorisation
du produit et à sa mise à disposition
Positionnement dans la hiérarchie Rattaché au comptable
Missions Il a pour mission la gestion des stocks du produit
Activités S’assurer de la collecte, de l’entreposage du produit, de la
valorisation du produit et la mise à disposition du produit
Vendre
Compétences requises
Savoir Connaître les notions de planification, de la gestion et de la
comptabilité, notion de technique de vente
Savoir-faire réceptionner, identifier la qualité du produit, caractériser le
produit, peser, stocker, vendre et encaisser, servir le client,
encaisser l’argent
Savoir-être (comportement) Rigueur et esprit de contrôle, courtoisie, ponctualité et
assiduité.
Qualifications (diplôme) CAP
Critères de performance Maîtrise les techniques d’identification de la qualité du riz, de
la caractérisation du riz
Relations de travail Travaille avec le comptable
Tableau 34 : Fiche de fonction de travail Vendeur
Intitulé de la fonction Vendeur
Description Il vend le produit mis à sa disposition
Positionnement dans la hiérarchie Rattache au comptable
Missions Il a pour mission principale la liquidation du produit
Activités Commercialiser le produit, faire la promotion des produits
Compétences requises
Savoirs Connaître les caractéristiques du produit
Avoir des notions en techniques de vente et comptabilité, avoir
des notions de marketing
Savoir-faire Attirer le client, communiquer sur l’entreprise et le produit,
vendre, tenir la caisse et le journal de caisse
Faire connaître le produit (radio, télé, téléphone)
Savoir-être (comportement) Rigueur et esprit de contrôle, courtoisie, ponctualité et
dynamique
Qualifications (diplôme) BT
Critères de performance Maîtrise des techniques de vente
Relations de travail Travaille avec le comptable et le gérant
 |
38 38 |
▲back to top |
31
Tableau 35 : Fiche de fonction de travail Gardien
Intitulé de la fonction Gardien
Description Aide à la sécurisation de l’entreprise, des produits et des
personnes
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission principale la garde de l’entreprise
Activités sécuriser l’entreprise, les produits et les personnes
Nettoyer les lieux
Compétences requises
Savoir Connaître les notions sur la sécurité et de l’accueil, techniques
de nettoyage
Avoir des notions sur l’hygiène
Savoir-faire Accueillir, contrôler les lieux, surveiller les biens et les
personnes Balayer les lieux, ranger le matériel
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène
Savoir-être (comportement) Vigilance, courtoisie, persévérance
Qualifications (diplôme) Certificat
Critères de performance Maîtrise les techniques de contrôle de la surveillance des biens
et des personnes
Relations de travail Travaille avec toutes les structures de l’entreprise
Tableau 36 : Fiche de fonction de travail Chargé de l’étuvage
Intitulé de la fonction Agent chargé de l’étuvage :
Description Dans la chaîne de valeur transformation, le chargé de l’étuvage
contribue à la qualité du riz
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Dans la chaîne de valeur transformation, le chargé de l’étuvage
Activités Etuver, préparer le riz semi-fini
Compétences requises
Savoirs Connaître les techniques d’étuvage du riz
Connaître les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication
(BPH/BPF) du produit
Savoir-faire Identifier la qualité du riz, poser le dispositif de l’étuvage,
exécuter les travaux de l’étuvage, conditionner le produit étuvé
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication du
produit
Savoir-être (comportement) Endurance, persévérance et courtoisie
Qualifications (diplôme) Certificat de Qualification Professionnelle CQP
Critères de performance Maîtrise les techniques d’identification de la qualité de riz, de
l’exécution des travaux de l’étuvage et de conditionnement
Relations de travail Travaille avec le responsable de l’entreprise
 |
39 39 |
▲back to top |
32
Tableau 37 : Fiche de fonction de travail Chargé du battage mécanique
Intitulé de la fonction Chargé du battage mécanique
Description Dans la chaîne de production fonio, il contribue à la mise à
disposition du produit semis fini
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission principale l’épuration du fonio semis fini
Activités Séparer la paille du grain Utiliser rationnellement la batteuse
Compétences requises
Savoir Connaître les techniques de conduite
Avoir des notions de mécanique et d’entretien
Connaissance des techniques d’utilisation des batteuses
Savoir-faire Savoir conduire une machine agricole, savoir entretenir une
machine, savoir réparer une machine
Effectuer de petites réparations sur la batteuse
Contrôle régulier de l’état de la batteuse
Savoir-être (comportement) Rigueur et esprit de courtoisie, ponctualité et assiduité.
Qualifications (diplôme) CAP
Critères de performance Maîtrise des techniques de battage mécanique, de vannage, de
conditionnement et de stockage du fonio
Relations de travail Travaille avec le responsable de l’entreprise et le magasinier
Tableau 38 : Fiche fonction de travail Chef d’exploitation
Intitulé de la fonction
Chef d’exploitation
Chef d’exploitation
Description Travailler la terre; préparer les productions à développer ou à
abandonner ; choisir le matériel à acheter, conduire les travaux
au champ
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Le chef d’exploitation, dans la chaîne de production de la filière
sésame et fonio, a pour mission principale l’exploitation du
champ
Activités Travailler la terre; préparer les productions à développer ou à
abandonner ;
choisir le matériel à acheter, conduire les travaux au champ
Compétences requises
Savoirs Connaître les techniques d’exploitation agricole
Connaître le matériel agricole
Connaître le management des travaux
Savoir-faire Appliquer les techniques d’exploitation agricole
Savoir opérer le choix du matériel agricole
Savoir manager une équipe..
Savoir-être (comportement) Rigueur et dextérité Capacité physique et habileté manuelle
requise
Qualifications (diplôme) BT agricole
Critères de performance Décrit et applique les techniques d’exploitation agricole
distinguer le matériel agricole les techniques de
management des travaux
Relations de travail Travaille avec toutes les structures de l’entreprise
 |
40 40 |
▲back to top |
33
Tableau 39 : Fiche fonction de travail laboureur
Intitulé de la fonction
Laboureur
Laboureur
Description Le laboureur est une personne dont l’activité principale a pour
objet de mettre en valeur une exploitation agricole
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Le laboureur a pour mission principale l’exploitation du champ
Activités Préparer le champ, labourer, semer, désherber, mettre l’engrais
Compétences requises
Savoirs Connaître les caractéristiques des sols,,
Connaître les techniques de labour
Savoir-faire Appliquer les techniques de préparation du champ, de labour,
du désherbage et d’utilisation de l’engrais
Savoir-être (comportement) Rigueur, capacité physique et habileté manuelle requise
Qualifications (diplôme) CAP agricole
Critères de performance Décrit et applique les techniques de préparation du champ, de
labour, du désherbage et d’utilisation de l’engrais
Relations de travail Travaille avec le chef d’exploitation
Tableau 40 : Fiche fonction de travail transporteur
Intitulé de la fonction
Transporteur
Transporteur
Description Le transporteur est chargé de la conduite des véhicules de
Transport les produits agricoles
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Le Transporteur a pour mission l’acheminement, le stockage
et la sécurisation des produits agricoles produits agricoles
Activités Transporter les produits agricoles vers le lieu de stockage
Réaliser les opérations liées au transport
Compétences requises
Savoirs Connaître la conduite d’un véhicule de transport
Connaître les techniques de manutention
Connaître les techniques des opérations liées au transport
Savoir-faire Savoir conduire une machine à manutention
Savoir appliquer les techniques de manutention
Savoir distinguer les opérations liées au transport
Savoir-être (comportement) Rigueur , capacité physique et habileté requise
Qualifications (diplôme) CAP agricole
Critères de performance Décrit et applique les techniques de conduite d’une machine,
de manutention, les techniques liées aux opérations de transport
Relations de travail Travaille avec le chef d’exploitation
 |
41 41 |
▲back to top |
34
6.7. Qualification par type d'emploi (emplois types, emplois cibles,
emplois sensibles, emplois clés)
La notion de qualification renvoie à deux approches selon que l’on se trouve du côté de
l’emploi à occuper ou du côté du salarié qui occupe cet emploi.
6.7.1. La qualification d’un emploi
La distinction des emplois/métiers sur lesquels mettre l’accent en fonction des évolutions
technologiques (emploi cible), ceux qui seront profondément modifiés par les évolutions
technologiques (emploi sensible) et ceux qui requiert une importance cruciale au sein de
l’entreprise (emploi clé) aideront les chefs d’entreprise à mieux cerner les qualifications
nécessaires pour leur secteur d’activités à venir.
6.7.1.1. Emplois sensibles
Les emplois sensibles sont ceux qui peuvent être profondément modifiés avec l’évolution
technologique. Parmi ces emplois, il faut retenir :
Filière riz : le métier de coordinateur, de mécanicien dans la chaîne de production, le
chargé de l’étuvage dans la chaîne de valeur transformation
6.7.1.2. Emplois-cibles
Certains métiers peuvent gagner en importance au sein de l’entreprise. L’accent y sera
mis sur ces métiers. Les nouveaux emplois dits emploi cibles susceptibles d’être
considérés de ce point de vue sont :
Filière riz : le métier de coordinateur dans la chaîne de valeur production ; le Chargé de
l’étuvage dans la chaîne de valeur transformation
Ces emplois sensibles doivent faire l’objet d’une attention particulière au moment de
l’élaboration des programmes qui doivent prendre en compte ces évolutions.
 |
42 42 |
▲back to top |
35
Tableau 41 : Qualification emploi/métier
Emploi/métier Qualification
Emploi
type
Emploi
cible
Emploi
sensible
Emploi clé
Comptable X
Magasinier X
Ouvrier agricole X
Manœuvre X
Conducteur d’engins agricoles X
Gérant X
Gardien X
Meunier X
Vendeur X
Mécanicien X X
Chef d’exploitation agricole X
Coordinateur X X X
Tableau 42 : Qualification emploi/métier : Métiers spécifiques à la filière riz
Emploi/métier Qualification
Emploi type Emploi
cible
Emploi
sensible
Emploi clé
Chargé de l’étuvage X X X
6.7.2. La filière sésame et sa chaîne de valeur
6.7.2.1. Poids économique de la filière sésame
La filière sésame est un produit qui a de beaux jours devant elle. Elle suscite un réel
intérêt dans les pays limitrophes tel que le Burkina Faso et à l’étranger. Il parait utile de
souligner que le secteur du sésame (Bènè en langue nationale bambara) représente au
Mali une source de revenu les populations situées dans sa zone naturelle de
développement.
Au niveau national, les bassins de production identifiés sont les régions de Kayes (cercle
de Kita et Diéma), de Koulikoro (cercles de Koulikoro, de Banamba, de Dioîla), région
de Ségou (cercle de Tominian), région de Mopti (cercles de Bankass, de Koro), région de
Sikasso (cercles de Koutiala, Bougouni et Yanfolila) (CNOP 2012.)
En fait, les superficies exploitées au Mali sont de cinquante mille hectares (50 000 Ha),
soit une production annuelle estimée à cent mille tonnes (100 000). Ce secteur est un
véritable pourvoyeur d’emploi dont 200 000 personnes travaillent essentiellement dans
l’informel.
 |
43 43 |
▲back to top |
36
Il dispose cependant d’un potentiel important au regard des disponibilités en terres et
main-d’œuvre agricole pour son expansion et suscite un réel intérêt dans les pays
limitrophes et à l’étranger.
La culture est annuelle et pluviale, il résiste relativement bien à un climat sec et peut supporter un
plus haut niveau de stress hydrique que la plupart des plantes. Par contre, il supporte mal la
rétention d’eau.
Le système dominant est le conventionnel, bien que le sésame Bio continu à gagner du
terrain par le fait qu’il soit bien prisé sur les marchés internationaux.
La promotion de la culture du sésame Bio est prônée surtout par l’OHVN et le MOBIOM.
Le sésame Bio correspond à un besoin des transformateurs sur les marchés
internationaux.
En vue d’assister les acteurs de la filière à développer une stratégie sectorielle dans le but
d’améliorer la compétitivité du secteur et organiser sa mise en œuvre, le Centre du
Commerce International (CCI) a réalisé en 2006 en collaboration avec le Gouvernement
du Mali à travers le Ministère chargé du commerce "une stratégie nationale de
développement sectoriel pour le karité" avec l’implication des acteurs.
Dans cette stratégie, l’objectif de développement est d’accroître la part de la filière sésame
de 1 à 2 % dans le PNB d’ici dix (10) ans.
Contraintes
Les contraintes liées à la filière sésame sont entre autres :
- faible qualité du sésame malien ;
- insuffisance de l’appui conseil dans certaines zones de production ;
- faiblesse des fonds de roulement ;
- instabilité des prix aux producteurs ;
- méconnaissance du fonctionnement des marchés ;
- Insuffisance des infrastructures de stockage et de conditionnement ;
- Insuffisance de marketing ;
- Insuffisance d’information sur les normes internationales, d’harmonisation des
procédures et des documents par rapport aux accords internationaux.
6.7.2.2 Analyse de la chaîne de valeur de la filière sésame
- Production
La production moyenne était d’environ 5 000 tonnes au début des années 2000, depuis
trois (03) saisons, elle évolue vers des volumes de 30 à 40 000 tonnes annuelles.
Le sésame produit au Mali est exporté à 90 % ; le reste est essentiellement transformé en
biscuits d’agglomérés de graines.
 |
44 44 |
▲back to top |
37
Les acteurs, qui opèrent dans la filière sésame au Mali sont entre autres les producteurs,
les transformateurs, les collecteurs, les regroupeurs (dépendants et indépendants), les
demi-grossistes, les grossistes importateurs, les détaillants, les transporteurs, les IMF et
les appuis conseils.
Concernant les acteurs de la filière, il existe au Mali entre 200 et 300 Organisations de
Producteurs (OP) de base spécialisée sur le sésame. Elles sont regroupées en unions dans
les différentes zones de production ou en interprofession appelée ISMA.
L’union des agriculteurs du cercle de Tominian est une branche dynamique de cette
organisation faîtière en raison de l’importance de la production dans cette zone.
Elle regroupe 2 052 producteurs (dont 652 femmes) regroupés en assemblées
communales. Ces membres proviennent de 102 villages de 9 communes rurales du cercle
(Tominian, Yasso, Sanékuy, Bénéna, Diora, Koula, Fangasso, Ouan et Mandiakuy).
L’exploitation d’un hectare de sésame indique une marge nette d’exploitation de 41 100
FCFA (voir tableau en annexe II).
- Transformation
Au Mali, les transformations du sésame en huile sont minimes et non rentables au regard
des traitements réalisés à l’extérieur du pays. A Tominian, pour la transformation du
sésame, l’UACT dispose de quatre (4) vanneuses mécaniques et d’un cribleur manuel
pour le nettoyage du produit. Le sésame est collecté, débarrassé des impuretés et ne subit
aucun autre traitement préalable, puis mis en sac (50kg) pour la commercialisation. Cela
suppose que le tri est rigoureusement fait au moment de la collecte.
Pour les produits secondaires du sésame, hors huile raffiné, il existe des transformatrices
à l’UACT et également dans les centres urbains. Ce sont des individus ou groupements
souvent organisés qui payent le sésame suivant la taille de leur clientèle. Ils
s’approvisionnement, soit directement dans les zones de production les plus proches, soit
en détail dans les marchés urbains. Ils en font des croquettes, du tourteau, du savon, des
biscuits, etc.
- Commercialisation
Au Mali, la commercialisation est en grande partie assurée par la Société PROSEMA qui
vise à promouvoir la filière sésame. La production est essentiellement exportée ; elle a
atteint 10 000 tonnes entre 2006 et 2012 pour une valeur de 6,5 milliards de francs CFA.
Au début de la campagne de commercialisation du sésame (novembre et début décembre)
les quantités mises sur le marché sont faibles car les prix ne sont pas suffisamment
incitatifs. Le commerce de sésame est en grande partie dominé par les commerçants
étrangers qui proposent des prix plus intéressants.
 |
45 45 |
▲back to top |
38
Au cours des six dernières années, le prix au producteur de sésame est passé d’une
moyenne de 125 F CFA à 600 F CFA le kg, avec des percées de 800 F CFA en 2012 et
950 F CFA en 2013.
Pour le Mali, ce marché émergeant représente une importante source de devise et pour
ses entreprises, une opportunité d’affaires sans précédent, difficilement quantifiable, en
raison de l’absence de statistiques consolidées.
Malgré ce potentiel et des avantages comparatifs conséquents, les sociétés maliennes
d’exportation de sésame (au premier rang desquelles PROSEMA), peinent encore à
couvrir 10 % de leur commande, sur un marché qui s’élargit autant qu’il se diversifie, tiré
par l’Inde, Israël, le Japon, les pays de l’Union Européenne et surtout la Chine.
Les différents acteurs du circuit de commercialisation sont :
Les producteurs : localisés sur toute l’étendue des zones de production, leur
fonction première est la mise en circulation du sésame.
Les collecteurs ou acheteurs intermédiaires : sont chargés de l’acheminement
du sésame des zones de production vers les marchés régionaux ou vers les centres
urbains. Ils se situent généralement en zones centre urbains.
Les exportateurs/importateurs : ce sont généralement des opérateurs travaillant
avec des structures techniques de l’Etat et/ou des ONG.
- Consommateurs
Le sésame est essentiellement consommé au Mali sous forme de biscuits. Pour ce qui est
de l’huile de sésame, elle n’est pas suffisamment connue par le consommateur malien.
Cependant, des consommateurs urbains ont connaissance de l’importance de cette huile.
Son utilisation à plus grande échelle nécessite des changements d’habitudes alimentaires.
 |
46 46 |
▲back to top |
39
VII. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES
ENQUETEES DE LA FILIERE SESAME ET NOMBRE DE
TRAVAILLEURS EXISTANTS
7.1. Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière
sésame
Les entreprises de la filière sésame, dans la zone couverte par l’enquête se répartissent
comme suit :
Tableau 43 : Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière sésame
Filières Entreprises filière sésame Répartition géographique des
entreprises
Région Cercle Commune
Sésame
Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian
(UATC)
Tominian Tominian
Coopérative Djigiyaton Baraouéli Kalaké
Unité de transformation des céréales FASO
YIRIWA
San San
UPROBEK Ségou Ségou Ségou
Unité de Production, Beurre de Karité –
UPROBEK
Ségou Ségou Ségou
Unité de transformation des céréales FASO
YIRIWA
San San
UACT Tominian Tominian
Source : Kara Consult enquête 2018
Il ressort de cette répartition géographique que les entreprises de la filière sésame se
concentrent, à Ségou, à San et à Tominian.
7.2. Nombre d’entreprises enquêtées filière sésame
La phase terrain a décelé 7 entreprises dans la filière sésame
Tableau 44 : Nombre d’entreprises enquêtées
Filière Chaînes de Valeur Total
Production Transformation Commercialisation
Sésame 1 3 3 7
Source : Kara-Consult, Enquête de terrain 2018
 |
47 47 |
▲back to top |
40
7.3. Nombre de salariés de la filière sésame des entreprises enquêtées
Filière Sésame : 2 211 soit 1379 hommes et 832 femmes
- Entreprises de production : 2052 travailleurs dont 1 332 hommes et 720 femmes ;
- Entreprises de transformation : 130 travailleurs dont 23 hommes et 107 femmes ;
- Entreprises de commercialisation : 29 travailleurs dont 24 hommes et 5 femmes.
Source : Kara Consult enquête 2018
Figure 4 : Chaîne de valeur Sésame
7.4. Typologie des emplois des entreprises enquêtées
Dans cette typologie, les Petites et Moyennes Industries sont plus importantes au niveau
de la chaîne de valeur production, tandis que les Petites et Moyennes Entreprises se
concentrent dans celles de la transformation et de la commercialisation.
Tableau 45 : Typologie des Entreprises sésames
Filières/chaînes Entreprises
PMI Localisation Total
Sésame Production Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian
(UATC)
Losi Tominian 1
PME
Sésame
transformation
Unité de transformation des céréales FASO
YIRIWA
Médine San 1
UPROBEK huile de sésame et Beurre de Karité Pélingana Sud
Ségou
1
Sésame
commercialisation
Unité de Production, 1
Unité de transformation des céréales FASO
YIRIWA
Médine San 1
UACT Losi Tominian 1
Source : Kara Consult enquête 2018
0
100
200
300
400
500
600
700
800
H F Total
Sésame Production
Sésame
Transformation
Sésame
Commercialisation
 |
48 48 |
▲back to top |
41
7.5. Typologie des emplois/métiers des entreprises enquêtées filière
sésame
Les types d’emplois/métiers recensés dans les chaînes de valeurs sésame se répartissent
en emplois classiques et en emplois nouveaux
Tableau 46 : Typologie des emplois filière sésame
Filière Chaîne de valeur/
Maillon
Métier Emploi
Classique Nouveau
Sésame Production
Producteur/Chef
d’exploitation
agricole
Conducteur d’engins, laboureur,
transporteur
Mécanicien
Gardien, Gestionnaire, Magasinier,
Manœuvre, Comptable Ouvrier
agricole cultures sèches,
Chargé du battage
mécanique, Animateur,
Coordinateur,
Transformation Transformateurs
de sésame
Meunier, transporteur
Gardien, Gestionnaire, Magasinier,
Manœuvre, Comptable,
Chargé de l’extraction
d’huile
Ouvrier-souffleur
Commercialisation Agent commercial Transporteur
Magasinier, Manœuvre, Comptable,
Vendeur, Gardien
 |
49 49 |
▲back to top |
42
7.6. Description des emplois/métiers dans la chaîne de valeurs de la
filière sésame
7.6.1. Description des emplois/métiers nouveaux
Outre le métier d’ouvrier-souffleur et du chargé d’extraction d’huile, tous les autres
métiers ont été décrits dans la filière riz
Tableau 47 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Chargé
d’extraction d’huile
Intitulé de l’emploi/métier
Chargé de l’extraction d’huile
Code
Appellation principale
Chargé de l’extraction d’huile
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
production de l’huile de
qualité
Connaître les techniques
d’extraction de l’huile (à froid ou à
chaud).
réaliser les travaux de pesage, tamisage,
lavage, de séchage, mouture et de
pressage, les travaux de concassage et de
l’étuvage.
Savoir utiliser une machine à presse.
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Application des techniques
de d’extraction, les bonnes
pratiques d’hygiène et de
sécurité.
Connaissance théorique du
fonctionnement des machines
d’extraction
Connaitre les bonnes pratiques
d’hygiène et de sécurité.
Connaitre la qualité du produit
Techniques de conduite et d’entretien
des machines d’extraction en respectant
les règles d’hygiène et la qualité du
produit
Conditions générales d’exercice
Travail en entreprise
Lieux d’exercice
Atelier
Conditions de travail
Travail dans la chaleur et sur des machines
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Bonne aptitude physique
 |
50 50 |
▲back to top |
43
Tableau 48 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Ouvrier-souffleur
Intitulé de l’emploi/métier
Ouvrier-souffleur
Code
Appellation principale
Ouvrier-souffleur
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Assurer les travaux de
réception, soufflage, pesage, de
conditionnent et de Stockage
Connaître les techniques de
soufflage
Connaitre les bonnes pratiques
d’hygiène et de sécurité.
Réaliser des travaux de réception, de
soufflage, de pesage, de conditionnent et
de Stockage
Appliquer les règles d’hygiène
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Traitement et épuration du
sésame
Connaître le fonctionnement et
la manipulation de la machine
d’épuration
Application de la conduite de la machine
Conditions générales d’exercice
Travail en entreprise sur une machine
Lieux d’exercice
Atelier
Conditions de travail
Travail dans la chaleur et la poussière
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Capacité physique, résistance propreté
7.6.2. Description des emplois/métiers classiques
Tous les emplois/métiers classiques ont déjà fait l’objet d’une description dans les filières
riz-fonio et sésame
Fonctions de travail
Les autres emplois/métiers étant décrits dans la filière riz, l’accent est mis sur ceux
spécifiques à la filière sésame.
 |
51 51 |
▲back to top |
44
Tableau 49 : Fiche de fonction de travail chargé d’extraction d’huile
Intitulé de la fonction Chargé de l’extraction d’huile
Description Il contribue à la valorisation de a filière sésame
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il assure la production de l’huile de qualité à froid ou à chaud.
Activités produire l’huile de qualité, appliquer les techniques de d’extraction,
les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité.
Compétences requises
Savoirs Connaître les techniques d’extraction de l’huile (à froid ou à chaud).
Connaissance théorique du fonctionnement des machines
d’extraction
Connaitre les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité.
Connaitre la qualité du produit
Savoir-faire Réaliser les travaux de pesage, tamisage, lavage, de séchage, mouture
et de pressage, les travaux de concassage et de l’étuvage.
Savoir utiliser une machine à presse. Techniques de conduite et
d’entretien des machines d’extraction en respectant les règles
d’hygiène et la qualité du produit
Savoir-être (comportement) Propreté, observation des règles d’hygiène
Qualifications (diplôme) Certificat de Qualification Professionnelle CQP
Critères de performance Bonne maîtrise des techniques de pré-cuisson, bonne application des
règles d’hygiène
Relations de travail Travaille avec le magasiner
Tableau 50 : Fiche de fonction de travail ouvrier souffleur
Intitulé de la fonction Ouvrier- Souffleur
Description Aide à l’épuration du sésame
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission le traitement et l’épuration du sésame
Activités Il assure les travaux de réception, soufflage, pesage, de conditionnent
et de stockage
Compétences requises
Savoir Connaître les techniques de soufflage et les règles d’hygiène
Savoir-faire Savoir réaliser des travaux de réception, de soufflage, de pesage, de
conditionnent et de Stockage
Savoir-être (comportement) Propreté, observation des règles d’hygiène et de sécurité
Qualifications (diplôme) CQP
Critères de performance Bonne application des techniques de soufflage et des règles
d’hygiène
Relations de travail Travaille avec le magasinier
7.6.3. Qualification par type d'emploi (emplois types, emplois cibles,
Pour les métiers de la filière sésame, peuvent devenir à la fois emploi cible et emploi
sensible les métiers suivants : le métier de coordinateur, de chargé d’extraction d’huile et
d’ouvrier souffleur.
 |
52 52 |
▲back to top |
45
Tableau 51 : Qualification emploi/métier : Métiers spécifiques à la filière sésame
Emploi/métier Qualification
Emploi type Emploi cible Emploi sensible Emploi clé
Coordinateur X X X
Animateur X
Chargé de l’extraction
d’huile
X X X
Ouvrier Souffleur X X X
VIII. LA FILIERE FONIO ET SA CHAINE DE VALEUR
8.1. Poids économique de la filière fonio
Le fonio est cultivé sur des sols considérés comme pauvres, peu profonds et dans des
zones à faible pluviométrie. C’est une plante qui présente une bonne résistance aux
conditions de sécheresse par rapport aux autres céréales. Le fonio concourt à la sécurité
alimentaire pendant les périodes de soudure en milieu paysan, car sa récolte est plus
précoce (entre août et septembre) que celle des autres céréales de base que sont le mil, le
sorgho, le maïs et le riz. Les femmes pratiquent souvent la culture du fonio pour couvrir
les besoins financiers de la famille.
Source : Ministère Agriculture, 2017
Figure 5 : Evolution des superficies et des productions de 2012-2013 à 2016-2017
Il ressort de ce tableau que les superficies ont évolué en dents de scie de 2012 à 2016.
Elle a été de 55 704 ha en 2014-2015 et 33 983 ha en 2016/2017. Quant à la production,
elle a augmenté et baissé d’une année à l’autre. La production la plus importante a été de
37 284 tonnes enregistrées en 2014/2015, la plus faible production a été de 16 500 tonnes
en 2013/2014 et 2016/2017. Le rendement moyen varie de 400 kg à 800 kg à l’hectare.
Contraintes
Les contraintes de la filière fonio sont entre autres
- culture secondaire par rapport aux autres céréales
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
superficie (ha) 43 809 35 612 55 704 41 080 33 983
production (T) 21 038 16 488 37 284 20 294 16 740
superficie (ha) production (T)
 |
53 53 |
▲back to top |
46
- faible niveau d’investissement pour le développement de la filière en matière de
recherche,
- faible organisation des acteurs de la filière,
- Faible vulgarisation d’équipements appropriés pour la récolte et la transformation,
- Difficulté d’accès des acteurs au financement
- Faible qualité souvent du produit transformé
8.2. Analyse de la chaîne de valeur de la filière fonio
- Production
La production de fonio, dans la zone concernée par l’étude, est surtout concentrée à Ségou
et à Tominian dans la région de Ségou.
Le fonio qui jadis était cultivé pour assurer la nourriture pendant les périodes de soudures
est devenu aujourd’hui une véritable culture de rente à cause de la maîtrise d’un certain
nombre de technologie (battage, décorticage).
Les technologies apportées dans le cadre de la production (utilisation de variétés
améliorées, d’engrais minéral, application correcte des techniques culturales) sont d’un
apport très appréciable dans l’amélioration de la productivité et de la production
On a pu encore apprécier une fois de plus l’importance du fonio dans la sécurité
alimentaire des populations et la lutte contre la vulnérabilité des ménages pendant les
périodes les plus difficiles.
L’implication des femmes dans la production contribue à améliorer les volumes de
commercialisation. Effectivement, au départ les femmes étaient seulement au niveau de
la transformation et les volumes collectés étaient faibles. L’avènement des champs
collectifs des femmes a permis d’améliorer considérablement ces volumes. En plus des
champs collectifs il existe des champs individuels des femmes qui augmentent le volume
de production.
Mais sur le plan national les grands bassins de production sont :
Ganga, Fangasso, Bénéna, Tominian, Bla (région de Ségou) ;
Fakola, Dembasso, Neguepié, Farako, Kolondiéba (région de Sikasso) ;
Manankoro, Garalo Kokélé, Bougouni, Yanfolila (région de Sikasso) ;
Diallasagou, Ouenkoro, Kouyentomo, Barapiréli, Sokoura, Bankass (région de
Mopti)
Bafoulabé, Kéniéba, Kita, (région de Kayes)
Les acteurs, qui opèrent dans la filière fonio au Mali sont entre autres les producteurs, les
transformateurs, les collecteurs, les regroupeurs (dépendants et indépendants), les demi-
grossistes, les grossistes importateurs, les détaillants, les transporteurs, les IMF et les
appuis conseils.
 |
54 54 |
▲back to top |
47
Figure 6 : Répartition Production par région, Campagne 2014 /2015
Sur la base de la production de la campagne 2014/2015, il apparait clairement que la
région de Ségou est la principale zone de production du fonio avec 61,07 %. Ensuite vient
la région de Mopti avec 21,84 %.
Les coûts de production établis par le projet d’amélioration des technologies post-récolte
du fonio, à travers des enquêtes réalisées par Ecofil/IER sont les suivants :
- moyenne par opération sur l’ensemble des zones de Bankass, Tomian, Kolondiéba
et Bougouni : l’équivalent de 46 H/j est utilisé en main d’œuvre, pour un coût de
27.600 FCFA par hectare de champ de fonio.
- Le coût par Kg de fonio est compris entre 65 à 70 francs CFA.
- Transformation
La pénibilité de la transformation souvent artisanale et manuelle du fonio joue sur le coût
de vente du produit. L'amélioration des techniques post-récolte est donc essentielle pour
faciliter la transformation du produit brut, réduire la pénibilité du travail des femmes et
accroître la qualité du produit commercialisé. La difficulté du décorticage, encore le plus
souvent réalisée manuellement par les femmes, constitue le frein majeur à la production.
Le fonio constitue également un défi pour la recherche en termes de production et de
transformation : mécanisation de la récolte, le lavage et le dessablage du fonio et aide à
la diffusion des nouveaux équipements mis au point (nettoyeurs, séchoirs).
Les pratiques traditionnelles pendant et après la récolte du fonio sont souvent harassantes
pour les paysans et leur famille. La récolte du fonio est une opération exclusivement
manuelle et le fauchage est très exigeant en main-d’œuvre (20 à 30 hommes-jours par
hectare). Les efforts de mécanisation ont concerné :
- des batteuses plus adaptées,
- en matière de nettoyage, des équipements adaptés comme un tarare, un crible rotatif
et un canal de vannage qui sont les matériels les mieux à même de répondre aux
besoins de producteurs soucieux d’améliorer la qualité du fonio paddy.
- Commercialisation
Le Mali passe d’un peu plus de 20 000 tonnes à près de 40 000 tonnes (trasform et exporté,
l’année) Par ailleurs, les statistiques d’importations et d’exportations n’étant pas
disponible il est fort probable que la consommation réelle notamment au Mali soit très
5,78 5,56
5,75
61,07
21,84
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
 |
55 55 |
▲back to top |
48
largement sous-estimée. Nous pouvons simplement constater que cette hausse de la
production est contemporaine de l’introduction et de la diffusion du décortiqueur GMBF.
La totalité des producteurs qui commercialise leur fonio estime que leurs revenus a
augmenté grâce à la vente du fonio : 50 % estiment cette augmentation très importante,
40 % l’estiment moyennement importante, 10 % peu importante.
Les indications sur les niveaux de production chez les productrices de Bamako,
permettent de considérer une offre autour de 1 000 tonnes de fonio sous forme précuite
Aujourd'hui, le fonio commercialisé est produit par des petites entreprises et vendu non
seulement sur les marchés urbains locaux, mais également aux africains émigrés en
Europe et aux Etats-Unis. En effet plusieurs petites entreprises privées, notamment au
Mali se sont développées pour couvrir les marchés d'exportation. La demande des
consommateurs est forte en raison de ses qualités nutritionnelles, et parce qu'il permet de
diversifier l’offre en céréales.
D’une façon générale, les producteurs notent une augmentation du prix de vente du fonio.
Avant 2012, les producteurs vendaient le kg de fonio décortiqué (non blanchi) entre 225
et 250 F CFA/kg. En 2015-2016, les producteurs ont vendu leur fonio entre 235 et 350 F
CFA/kg entre octobre et janvier et jusqu’à 450 F CFA/kg en mai 2016.
A Tominian, bien que le fonio représente 20 % à 25 % de la production céréalière totale,
les ventes du fonio représentent plus que 80 % des ventes totales de céréales. L’expansion
du secteur de la transformation du fonio à Bamako serait à l’origine de cette augmentation
de ventes de fonio dans le cercle de Tominian grâce à un réseau confirmé de
commercialisation.
Les formes commercialisées sont le fonio non décortiqué, le fonio décortiqué lavé et le
fonio précuit.
- Consommateurs
Le fonio est habituellement consommé sous forme de couscous ou de bouillies mais de
nombreuses autres préparations culinaires sont possibles (djouka, farine de
complément…)
La production ne peut pas satisfaire la demande nationale ; il y a des importations de la
Guinée à certain moment de l’année.
Cette demande nationale est en augmentation continue en raison de l’accroissement de la
population.
 |
56 56 |
▲back to top |
49
IX. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES
ENQUETEES DE LA FILIERE FONIO ET NOMBRE DE
TRAVAILLEURS EXISTANTS
9.1. Répartition géographique des entreprises enquêtées de la filière
fonio
Le Fonio, est produit dans deux (2) localités : à Diakabougou dans la commune de
Sakoïba où la coopérative Benkadi emploie 30 personnes, à Tominian l’UACT utilise
prêt de 700 producteurs. Quant aux unités de transformation et de commercialisation elles
sont concentrées dans les zones de production, celles de la transformation du fonio à
Ségou et à Tominian.
Tableau 52 : Entreprises enquêtées de la filière fonio
Filière Entreprises Répartition géographique des
entreprises enquêtées
Région Cercle Commune
Fonio Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian
(UATC) production
Tominian Tominian
Coopérative Djigiyaton Baraouéli Kalaké_
Coopérative Benkaditon Diakobougou Sakoïba
Unité Mme NONI Ségou Ségou Ségou
Association Sinsinbéré Ségou Ségou Ségou
La ségovienne de Commerce et
Agroalimentaire – SECA
Ségou Ségou Ségou
Association Femina Ségou Ségou Ségou
Coopérative Djèkafo Bla Bla
Unité Saran San San
Unité de transformation des céréales FASO
YIRIWA
San San
CFUACT Tominian Tominian
Coopérative Benkaditon Ségou Diakabougou Sakaoïba
Association SinSinBéré Ségou Ségou
Unité de transformation des céréales Faso
Yiriwa
San San
Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian
(UACT) transformation
Tominian Tominian
Coopérative des Femmes de CFUACT_ Tominian Tominian
Unité Saran San San
Source : Kara Consult enquête 2018
 |
57 57 |
▲back to top |
50
9.2. Nombre d’entreprises enquêtées filière fonio
La phase terrain a décelé 18 entreprises dans les chaînes de valeur fonio répartis comme
suit :
Tableau 53 : Nombre d’entreprises enquêtées
Filière Chaînes de Valeur Total
Production Transformation Commercialisation
Fonio 2 11 5 18
Source : Kara-Consult, Enquête de terrain 2018
9.3. Nombre de salariés existants filière fonio
Filière fonio : 2 595 soit 1 416 hommes et 1 179 femmes
- Entreprises de production : 2 052 travailleurs dont 1 369 hommes et 683 femmes ;
- Entreprises de transformation : 517 travailleurs dont 30 hommes et 487 femmes ;
- Entreprises de commercialisation, 26 travailleurs dont 17 hommes et 9 femmes.
Figure 7 : Chaîne de valeur fonio
9.4. Typologie des entreprises enquêtées de la filière fonio
La typologie des entreprises des chaînes de valeur de fonio se répartissent en deux grandes
catégories : les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises.
Dans les entreprises de PMI le résultat de l’enquête est le suivant : 2 dans la chaîne de valeur
production et 3 dans la chaîne de valeur transformation.
Au niveau des PME il y a 9 dans la chaîne de valeur transformation et 9 dans celle de la
commercialisation. Mais il faut reconnaître que les petites et moyennes entreprises de
0
500
1000
1500
2000
2500
H F Total
Main d’œuvre
Fonio Production
Fonio
Transformation
Fonio
Commercialisation
 |
58 58 |
▲back to top |
51
transformation et de commercialisation bien qu’ayant une avancée significative de
mécanisation, restent encore tributaire d’une grande dose de méthode artisanale.
Tableau 54 : Typologie des entreprises filière fonio enquêtées
Filières/chaînes Entreprises
PMI Localisation Total
Fonio production Union des Agriculteurs du Cercle de
Tominian ( UATC)
Losi tominian 1
Coopérative Benkadi Diakobougou 1
Filières/chaînes Entreprises
Transformation PMI Localisation Total
Fonio/transformation
La ségovienne de Commerce et
Agroalimentaire – SECA
Dar salam
Ségou
1
Unité de transformation des céréales
FASO YIRIWA
Médine San 1
Union des Agriculteurs du Cercle de
Tominian ( UATC)
Losi tominian 1
PME Localisation Total
Coopérative Benkaditon Halimata
Coulibaly
Diakabougou
Ségou
1
Association SinSinBéré__Mme
Tamboura, Sala Maïga
Pélingana_sud
Ségou
1
Unité de transformation des céréales
Faso Yiriwa Sidy Coulibaly
Médine__San 1
Union des Agriculteurs du Cercle de
Tominian UACT Pierre Théra
Losi Tominian 1
Coopérative des Femmes de Union
des Agriculteurs du Cercle de
Tominian CFUACT_ M’Barka Koné
Losi Tominian 1
Fonio transformation
Coopérative Jigiyaton de Mme Sylla
Nana Sylla
Kalaké
Baraouéli
1
Coopérative Benkadi de Halimata
Coulibaly
Diakabougou 1
Unité de Noni de Mme Noni Pélingana sud
–Ségou
1
Association Sinsinbéré de Me
Sangaré Habibatou Traoré
Pélingana sud
–Ségou
1
Association Femina Mme Coulibaly
Aoua Kamaté
Hypodrome
extension
Ségou
1
Coopérative Djèkafo Mme Djiré
Mariam Diaré
Bla 1
:Unité Saran de Mme Togo Saran
Diony
Lafiabougou
San
1
Unité de transformation des céréales
FASO YIRIWA de Sidy Coulibaly
:Médine San 1
CFUACTde ___M’Barka Koné Losi Tominian 1
Source : Kara Consult enquête 2018
 |
59 59 |
▲back to top |
52
9.5. Typologie des emplois/métiers des entreprises enquêtées
Les types d’emplois/métiers recensés dans les chaînes de valeurs de la filière fonio se
répartissent en emplois classiques et en emplois nouveaux
Tableau 55 : Typologie des emplois
Filière Chaîne de valeur/
Maillon
Métier Emploi
Classique Nouveau
Fonio Production
Producteur/ Chef
d’exploitation
agricole
Conducteur d’engins, laboureur,
transporteur
Mécanicien
Gardien, Gestionnaire, Magasinier,
Manœuvre, Comptable,
Electricien
Soudeur
Forgeron
Ouvrier agricole cultures sèches
Chargé du battage
mécanique,
Animateur,
Coordinateur,
Transformation Transformateurs
Fonio
Meunier, transporteur
Gardien, Gestionnaire,
Magasinier, Manœuvre,
Comptable,
Agent chargé du pré
cuisson
Ouvrier-souffleur
Commercialisation Agent commercial Transporteur
Magasinier, Manœuvre,
Comptable, Vendeur, Gardien
9.6. Description des emplois/métiers de la chaîne de valeurs filière fonio
9.6.1. Description des emplois/métiers nouveaux filière fonio
Outre le métier de chargé de pré-cuisson, de l’ouvrier-souffleur les autres ont été décrits
au niveau de la filière riz.
Les tableaux ci-dessous présentent la description des emplois/métiers nouveaux non
décrits.
 |
60 60 |
▲back to top |
53
Tableau 56 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Agent chargé de
pré cuisson du fonio
Intitulé de l’emploi/métier
Agent chargé de pré cuisson du fonio.
Code
Appellation principale
Agent chargé de pré cuisson
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Préparer et précuire le
produit
Connaître la qualité du produit et les
techniques de pré- cuisson du fonio
Connaître les bonnes pratiques
d’hygiène et de fabrication
(BPH/BPF) du produit
Réceptionner le fonio ; vérifier la
qualité du fonio, peser,
tamiser/cribler, laver, essorer, sécher
et conditionner
Respecter les bonnes pratiques
d’hygiène
Conditions d’accès : Niveau DEF ou premier cycle fondamental
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Conditions générales d’exercice
S’exerce en groupe ou seul dans un atelier
Lieux d’exercice
Atelier de production
Conditions de travail
Endurance, persévérance, travail dans la chaleur et
parfois dans la fumée
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Capacité physique requise
9.6.2. Description des emplois/ métiers classiques
Outre les emplois/métiers forgeron, électricien et soudeur, les autres ont été décrits dans
la filière riz les emplois/métiers classiques non décrits répondent a la description
suivante : il s’agit
Tableau 57 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Forgeron
Intitulé de l’emploi/métier
Forgeron
Code 60107
Appellation principale
Forgeron
Appellation spécifique
Activités de base Connaissance Savoir faire
Fabriquer et concevoir des
pièces de rechange
Connaissance du processus de
fusion et de transformation du
fer ainsi que les alliages
Savoir tenir la pince, utiliser le soufflet,
savoir tenir un burin
Conditions d’accès : Avoir le DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Gérer un atelier Techniques de gestion d’un
atelier
Savoir réparer des pièces de machines,
savoir appliquer les techniques de
fabrication d’une pièce de machine
Conditions générales d’exercice
Travail nécessitant promptitude dans l’application des règles sécurité
Lieux d’exercice
L’emploi s’exerce au sein d’une forge
Conditions de travail
Le travail s’effectue avec la manipulation de charges dans un
environnement bruyant et une chaleur parfois élevée.
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
L’activité nécessite une bonne condition physique
 |
61 61 |
▲back to top |
54
Tableau 58 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Soudeur
Intitulé de l’emploi/métier
Soudeur
Code : 60113
Appellation principale
Soudeur
Appellation spécifique
Menuisier métallique, soudeur à arc
Activités de base Connaissance Savoir faire
Effectue des opérations de soudure
et confection de pièces
Connaître les techniques de
soudure
Connaitre toutes les techniques
de construction métalliques
lire des dessins techniques, mesurer,
tracer, découper, assembler les
pièces métalliques,
Conditions d’accès : Avoir le DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Reconstitution de pièces
Réalisation d’ouvrages métalliques
Connaissances théoriques des
résistances des ouvrages
métalliques
Réaliser rapidement des ouvrages
métalliques résistants
Conditions générales d’exercice
Travail nécessitant promptitude dans l’application des règles de sécurité
Lieux d’exercice
S’exerce au sein d’un atelier
Conditions de travail
Manipulation de charge dans un environnement bruyant, le port
d’équipement de protection dans le travail requis
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Bonne condition physique
Tableau 59 : Description des emplois/métiers des chaînes de valeurs : Electricien
Intitulé de l’emploi/métier
Electricien
Code : 17111
Appellation principale
Electricien
Appellation spécifique
Electricien
Activités de base Connaissance Savoir faire
Procéder aux installations électriques et
des machines, en effectuer l’entretien et
la réparation
Connaissances en
électricité
Connaître les règles de
sécurité
Utiliser les appareils de mesure ;
Distinguer les circuits électriques ;
Diagnostiquer les pannes ;
dépanner en toute sécurité
Conditions d’accès : Niveau DEF
Activités spécifiques Connaissances Savoir-faire
Lecture de schémas électriques ; entretien
des moteurs électriques ; utilisation des
appareils de mesure et de contrôle
Connaissance minimum
du primaire et en
électricité connaissance
en électromécanique
Lire un schéma électrique, utiliser
les appareils et mesures électriques
entretenir un moteur électrique,
dépanner, utiliser l’outil
informatique
Conditions générales d’exercice
Travail seul
Lieux d’exercice
Entreprise
Conditions de travail
Travail en hauteur, risques, danger
Capacité généralement liées à l’emploi/métier
Capacité physique, sens d’observation
Fonctions de travail des métiers de la filière fonio
Les autres emplois/métiers ayant fait l’objet d’une description dans la filière riz, seuls les
métiers de forgeron, de soudeur et d’électricien sont pris en compte dans les tableaux
suivants.
 |
62 62 |
▲back to top |
55
Tableau 60 : Fiche de fonction de travail Forgeron
Intitulé de la fonction Forgeron
Description Il fabrique des pièces
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission la réparation et la fabrication de pièces du
matériel mécanique
Activités Fabriquer et concevoir des pièces de rechange
Gérer un atelier
Compétences requises
Savoir Connaissance du processus de fusion et de transformation du
fer ainsi que les alliages
Techniques de gestion d’un atelier
Savoir-faire Savoir tenir la pince, utiliser le soufflet, savoir tenir un burin
Savoir réparer des pièces de machines, savoir appliquer les
techniques de fabrication d’une pièce de machine
Savoir-être (comportement) Promptitude dans l’application des règles d’hygiène
Qualifications (diplôme) CAP forge
Critères de performance Bonne maîtrise des techniques de fabrication et de réparation
d’une pièce
Relations de travail Travaille avec les différents responsables
Tableau 61 : Fiche de fonction de travail Soudeur
Intitulé de la fonction Soudeur
Description Effectue des opérations de soudure et confection de pièces
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il a pour mission la réalisation et la soudure du matériel en
panne
Activités Effectue des opérations de soudure et confection de pièces
Reconstitution de pièces
Réalisation d’ouvrages métalliques
Compétences requises
Savoir Connaître les techniques de soudure
Connaitre toutes les techniques de construction métalliques
Connaissances théoriques des résistances des ouvrages
métalliques
Savoir-faire lire des dessins techniques, mesurer, tracer, découper,
assembler les pièces métalliques
Réaliser rapidement des ouvrages métalliques résistants
Savoir-être (comportement) Promptitude dans l’application des règles d’hygiène
Qualifications (diplôme) Cap en soudure
Critères de performance Bonne maîtrise des techniques de soudure et de réparation
d’une pièce
Relations de travail Travaille avec les différents responsables
 |
63 63 |
▲back to top |
56
Tableau 62 : Fiche de fonction de travail Electricien
Intitulé de la fonction Electricien
Description Il s’occupe de l’électrification de l’entreprise fourniture
d’électricité
Positionnement dans la hiérarchie Relève du responsable de l’entreprise
Missions Il s’occupe du réseau électrique au sein de l’entreprise.
Activités Procéder aux installations électriques et des machines, en
effectuer l’entretien et la réparation
Lecture de schémas électriques ; entretien des moteurs
électriques ; utilisation des appareils de mesure et de contrôle
Compétences requises
Savoir Connaissances en électricité
Connaître les règles de sécurité
Connaissance minimum du primaire et en électricité
connaissance en électromécanique
Savoir-faire Utiliser les appareils de mesure ; Distinguer les circuits
électriques ; Diagnostiquer les pannes ; dépanner en toute
sécurité
Lire un schéma électrique, utiliser les appareils et mesures
électriques entretenir un moteur électrique, dépanner, utiliser
l’outil informatique
Savoir-être (comportement) Ponctualité, courtoisie, promptitude
Qualifications (diplôme) BT électricité bâtiment
Critères de performance Bonne maîtrise du système électricité
Relations de travail Travaille avec tous les responsables de l’entreprise
9.7. Qualification par type d'emploi (emplois types, emplois cibles,
emplois sensibles, emplois clés) filière fonio
Au niveau des chaînes de valeurs de la filière fonio
Peuvent être des emplois sensibles : le métier d’ouvrier-souffleur, le chargé du battage
mécanique, le coordinateur dans la chaîne de valeur production et le Chargé de pré-
cuisson du fonio dans la chaîne de valeur transformation.
Peuvent devenir des emplois cibles : le métier de coordinateur, de battage mécanique dans
la chaîne de valeur production ; le Chargé de pré-cuisson et de forgeron dans la chaîne de
valeur transformation.
Ces emplois sensibles et emplois cibles doivent faire l’objet d’une attention particulière
au moment de l’élaboration des programmes qui doivent prendre en compte ces
évolutions.
 |
64 64 |
▲back to top |
57
Tableau 63 : Qualification emploi/métier : Métiers spécifiques à la filière fonio
Emploi/métier Qualification
Emploi type Emploi cible Emploi sensible Emploi clé
Chargé du battage mécanique : X X X
Animateur X
Coordinateur X X X
Chargé du pré-cuisson du fonio X X X
Forgeron X X
Ouvrier-souffleur X
 |
65 65 |
▲back to top |
58
Les formations à créer pour les emplois/métiers nouveaux
Les formations à développer doivent être orientées vers les acteurs des emplois métiers nouveaux. Ils sont définis en compétence, objectifs de
formation, en qualification professionnelle visées, en durée et en modalités de formation (cf tableau ci-dessous).
Tableau 64 : Formation à développer pour les acteurs des métiers emplois nouveaux
Emploi/métier Compétence nécessaire Besoin de
formation
Objectif de
la
formation
Qualification
nécessaire
Durée de la
formation
Stratégie de
mise en
œuvre
Modalités de
formation
Mécanisme d
financement
Agent chargé de
l’étuvage,
Identifier la qualité du riz,
exécuter les travaux de
l’étuvage, conditionner le
produit étuvé
Techniques de
l’étuvage
Améliorer le
rendement
de l’agent de
l’étuvage
CQP 4 semaines APC Alternance
Chargé de
l’extraction
d’huile
Assurer les travaux de
pesage, tamisage, lavage,
de séchage, moulure et de
pressage. Il réalise aussi des
travaux de concassage et de
l’étuvage.
Techniques de
production d’huile
Améliorer
les
prestations
de l’agent
CQP 4 semaines APC Alternance
Coordinateur,
Planifier les activités de
l’entreprise, évaluer la
réalisation des activités de
l’entreprise
Techniques de
planification et
d’évaluation des
activités d’une
entreprise
Améliorer le
rendement
du
coordinateur
CQP 2 semaines APC Alternance
Ouvrier
Souffleur
Il assure les travaux de
réception, soufflage,
pesage, de conditionnent et
de stockage
Techniques de
soufflage
Rendre le
souffleur
plus
compétitif
CQP 4 semaines APC Alternance
Animateur Assurer le labour,
entretenir les plants,
préparer les récoltes
Techniques de
labour et d’entretien
des plants
Renforcer les
capacités de
l’ouvrier
CAP 2 ans APC Alternance
 |
66 66 |
▲back to top |
59
Emploi/métier Compétence nécessaire Besoin de
formation
Objectif de
la
formation
Qualification
nécessaire
Durée de la
formation
Stratégie de
mise en
œuvre
Modalités de
formation
Mécanisme d
financement
Chargé du
battage
mécanique
Battre le du fonio, vanner
et conditionner et stocker le
fonio
Techniques de
battage
Améliorer la
qualité du
produit
CQP 4 semaines APC Alternance
Agent chargé de
la pré-cuisson
Réceptionner le fonio ;
vérifier la qualité du fonio,
procéder à la pesée, réaliser
le tamisage/ criblage, laver,
essorer, sécher et
conditionner
Techniques de pré-
cuisson du fonio
Améliorer la
qualité du
fonio
CQP 4 semaines APC Alternance
 |
67 67 |
▲back to top |
60
X. DESCRIPTION DES DISPOSITIFS DE FORMATION
EXISTANTS
Le répertoire des opérateurs de formation de la région de Ségou, tiré de la liste des centres
ouverts mis à jour le 06 janvier 2016 de la Direction Nationale de la Formation
professionnelle, offre aux entreprises 151 Centres de formation répartis comme suit :
Ségou ville : 50, Bla 13, Tominian 11, Baraoueli 12, Macina 13, Niono 20, San 32.
L’échantillon choisi pour la cause de l’étude portant sur les filières riz, sésame et fonio a
porté essentiellement sur les centres agro pastoraux assez structurés. Ce critère a conduit
les experts à retenir 4 Centres à Ségou et 2 à Yorosso de la zone couverte par l’étude.
Mais suite à l’analyse des emplois/métiers, il est apparu qu’un nombre important de ces
centres non retenus peuvent contribuer au renforcement des capacités des acteurs des
métiers dits classiques.
10.1. Offre de formation existante
L’offre de formation comprend le dispositif de formation et les curricula servant de base
à l’acquisition des compétences des formés.
Les centres de formation rencontrés au nombre de 6 : 4 sont publics et 2 privés, 4 sont
dans la ville de Ségou, les 2 autres dans la ville de Yorosso. .Ils sont tous dotés
d’infrastructures de salles de classes adéquates, de salles informatiques Des ateliers de
formation pratique.
Les programmes de formation, tous certifiés soit par la DNETP (4) soit par la DNFP (2),
s’articulent autour des filières de formation en transformation agroalimentaire, en
production de semences, en Production de culture de céréales sèches, en Agriculture et
en Entreprise agricole. Il ressort de l’analyse de ces centres que :
- ils se professionnalisent de plus en plus ;
- ils visent à satisfaire les compétences des acteurs du secteur de l’agriculture ;
- ils tentent de coller à la réalité des besoins de l’économie ;
- ils cherchent à lier théorie et pratique dans la formation.
Mais il faut reconnaître que les filières dispensées dans ces centres offrent peu de
possibilités aux acteurs des métiers nouveaux des filières riz, fonio et sésame. C’est-à-
dire donc que le champ de couverture des formations existantes a un taux peu satisfaisant.
Institut de formation professionnelle –IFP
Ce Centre Privé, créé par la décision N° 07206 du 05 juin 2007, prépare les titulaires du
DEF au CAP et au BT2. Il a un effectif de 504 élèves dont 282 hommes et 222 femmes
et dispose d’un programme de formation certifié par la Direction Nationale de
l’Enseignement technique et Professionnelle DNEFP.
 |
68 68 |
▲back to top |
61
Spécialité enseignées : Agronomie, électroménager, dépanneur frigoriste, élevage et forêt
Tableau 65 : Nombre d’élèves formés :
Hommes Femmes Total
Agroalimentaire 11 34 45
Electroménager 40 5 45
Moteur dépanneur frigoriste 17 6 23
Il développe un partenariat avec les Entreprises publiques, Entreprises privées et les
Organisations faitières.
Le coût moyen annuel de la formation/par apprenant dans ce centre est de 110.000 pour
les élèves du CAP et de 135.000 pour ceux du BT. Il est financé par le budget de l’Etat
qui y envoie des apprenants, les prestations de service, les inscriptions et les frais de
scolarité.
Le centre prépare en quatre (4) années de formation les élèves titulaires du DEF au Brevet
de Technicien en Agro-pastoral et en trois (3) ans les titulaires du DEF au CAP, dans les
filières électroménager et en moteur dépanneur frigoriste.
Il dispose de :
- 23 salles de cours,
- 1 bureau pour enseignant,
- 1 salle informatique de 35 places,
- 4 formateurs,
- Atelier : Labo et clinique
Ecole de Formation Professionnelle Agro-sylvo-pastorale EFPASP
Cet Etablissement privé, a été créé par Décision de création N°040711 du 29 mars 2004
et ouvert en 2011 grâce à la Décision 110146 du 27 mai 2011. L’EFPASP forme a un
diplôme de BT agropastoral et en Certificat de qualification professionnelle (CQP). Il a
un effectif total de 140 élèves dont 96 hommes et 44 femmes.
Son programme de formation certifié par la DNFP permet le développement des
formations en : Embouche, Maraîchage, Aviculture, Transformation agroalimentaire,
Production de semence, Production de culture de céréales sèches, Fonio, Riz, Sésame,
Arboriculture, machinisme agricole.
 |
69 69 |
▲back to top |
62
Tableau 66 : Nombre formés en moyenne par an et par filière
Hommes Femmes Total
Embouche 13 7 20
Aviculture 8 12 20
Maraîchage 13 127 140
Production de semence 12 8 20
Production de culture de céréales sèches 14 6 20
Fonio, 22 4 26
Le centre a déjà inséré 3 sortants en emploi salarié et 6 en auto emploi. Mais, il faut noter
que120 femmes sont déjà en production.
Il développe un partenariat avec les Entreprises publiques, privées et les Organisations
faitières à travers des Stages pratiques des apprenants en entreprise, des visites
d’entreprise ou sous forme de Cours dispensés par les professionnels de l’entreprise dans
le centre.
Le coût moyen annuel de la formation est de 180.000 et ses financements proviennent
des prestations de service, des frais d’inscription et des frais de scolarité. Le Centre
dispose de :
- 12 salles de cours dont 4 fonctionnelles,
- 1 bureau pour enseignant,
- 23 formateurs,
- 1 Atelier clinique,
- 1 champ expérimental 3 ha de maraîchage et 4 ha pour la saison d’hivernage
Ecole Secondaire Agropastorale ESAP
L’école secondaire agropastorale est un établissement public créé par deux Décisions.
Celle portant N°|04-0713/MEN-SG du 29 mars 2004 du Ministère de l’Education
Nationale et celle N°10-133/MEFP-SG du 11 mai 2010 du Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle. Elle est rendue opérationnelle par la décision d’ouverture N°
09-2953/MEALN-SG du 16 octobre 2009 du Ministère de l’Education et de
l’Alphabétisation.
L’école délivre à la fin de la formation en quatre (4) années un diplôme de BT
agropastorale. Elle prépare également les enfants à un certificat de qualification
professionnelle (CQP).
Elle forme avec le programme officiel du Ministère de l’Education Nationale en :
Entreprise agricole, Elevage, embouche, maraîchage, aviculture, cultures sèches, et
production de semences
L’école a un effectif de 214 dont 142 hommes et 72 femmes.
 |
70 70 |
▲back to top |
63
Tableau 67 : Nombre de formés en moyenne par an et par filière
Hommes Femmes Total
Entreprise agricole 30 20 50
Elevage 40 10 50
Embouche 20 15 35
Maraîchage 20 13 33
Aviculture, 20 10 30
Cultures sèches 20 00 20
Production de semences 20 00 20
Parmi les sortants, 50 ont eu un emploi salarié et 188 sont en auto emploi. Elle collabore,
dans le cadre du partenariat, avec les Entreprises publiques, les Entreprises privées et les
Organisations faitières dans les activités de Formation alternée en entreprise, de Stage
pratique des apprenants en entreprise, de Visite d’entreprise ou par des cours dispensés
par les professionnels de l’entreprise dans le centre.
La formation d’un élève coûte en moyenne 185.000 et ses sources de financement
proviennent du : Budget de l’Etat. En matière d’infrastructure, l’école dispose
- 10 salles de cours,
- 1 bureau pour enseignant,
- 1 salle informatique,
- 27 formateurs,
- 1 ferme de 2 ha,
- 1 clinique.
Centre Agropastorale de Ségou CAPS
Le Centre agropastorale de Ségou est un établissement privé créé par Arrêté N° 99-
0381/MESSRS6SG du12 mars 1999 Elle est rendue opérationnelle par Arrêté d’ouverture
N°99-02039/MESSRS-SG du 10 septembre 1999. L’école délivre à la fin de la formation
en quatre (4) années un diplôme de BT agropastorale. Elle prépare également les enfants
à un Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Elle forme avec un programme certifié par la Direction Nationale de l’Enseignement
Technique et Professionnelle –Division Etudes et Programmes dans les spécialités :
Agronomie, Elevage et forêt.
L’école a un effectif de 208 dont 129 hommes et 79 femmes.
Tableau 68 : Nombre de formés en moyenne par an et par filière
Filières Hommes Femmes Total
Agropastorale 129 79 208
60 % des sortants de cette école sont en emploi salarié et 30 % en auto emploi :
 |
71 71 |
▲back to top |
64
Elle collabore, dans le cadre du partenariat, avec les Entreprises publiques, les Entreprises
privées dans les activités de Formation alternée en entreprise, de Stage pratique des
apprenants en entreprise, de Visite d’entreprise ou par des cours dispensés par les
professionnels de l’entreprise dans le centre.
La formation d’un élève coûte en moyenne 135.000 et ses sources de financement
proviennent des Prestations de service, des frais d’inscription et des frais de scolarité
En matière d’infrastructure, l’école dispose
- 13 salles de cours,
- 1 bureau pour enseignants,
- 1 salle informatique,
- 23 formateurs,
- 1 parc d’animaux de 500 m2,
- 1 champ d’expérimentation-jardin potager de 1 ha.
Centre de formation Professionnelle de Yorosso CFPY
Le Centre agropastorale de Ségou est un établissement public créé par Décision
005/P.C.R SIK du 11 juillet 2013. L’école prépare les élèves du milieu déscolarisé à un
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Elle forme avec un programme certifié par la Direction Nationale de la Formation
Professionnelle DNFP et a un effectif de 33 élèves dont 28 hommes et 5 femmes.
L’école enseigne les filières, Apiculture, Aviculture, Céréaliculture, Elevage porcin,
Embouche des ruminants, Maraîchage, Pisciculture, Transformation agroalimentaire et a
déjà mis à la disposition du monde du travail 206 jeunes en CQP
Tableau 69 : Nombre de formés en moyenne par an et par filière
Filières Hommes Femmes Total
Apiculture, 10 10 20
Aviculture, 15 15 30
Céréaliculture 8 8 16
Elevage porcin 5 5 10
Embouche des ruminants 20 20 40
Maraîchage 15 15 30
Pisciculture 10 10 20
Transformation agroalimentaire 5 15 20
206
Parmi les sortants, 70 sont en auto emploi. Elle collabore, dans le cadre du partenariat,
avec les, les Entreprises privées et les Organisations faitières dans les activités de Stage
pratique des apprenants en entreprise, de Visite d’entreprise.
La formation d’un élève coûte en moyenne 25.000 et ses sources de financement
proviennent du : Budget de l’Etat, Collectivités locales, partenaires techniques et
financiers, Prestation de service, frais d’inscription.
 |
72 72 |
▲back to top |
65
En matière d’infrastructure, l’école dispose
- 2 salles de cours,
- 1 bureau pour enseignant,
- 1 salle informatique,
- 16 formateurs,
- 1 Atelier,
- 12 ha de champ expérimental,
- des Etangs de pisciculture.
Centre de Formation Multifonctionnelle Mariam Traoré : CFMMT Yorosso
Le Centre de formation multifonctionnelle Mariam Traoré de Yorosso est un
établissement public créé par Décision ? L’école prépare les élèves du milieu déscolarisé
et des titulaires du DEF à un Certificat de qualification professionnelle (CQP).
Elle forme avec un programme certifié par la Direction Nationale de la Formation
Professionnelle DNFP et a un effectif de 110 élèves dont 67 hommes et 43 femmes.
L’école enseigne les filières de Transformation agroalimentaire, de Pisciculture,
d’électricité bâtiment, de Maraîchage, d’élevage, d’agriculture, de restauration, et de
Mécanique des engins à 2 roues.
Tableau 70 : Nombre de formés : formez-vous en moyenne par an et par filière
Filières Hommes Femmes Total
Transformation agroalimentaire 2 18 20
Agriculture 15 10 25
Elevage, 10 5 15
Electricité bâtiment 16 4 20
Pisciculture 9 6 15
Mécanique des engins à 2 roues 15 00 15
Restauration 10 10
Parmi les sortants, 70 sont en auto emploi. Elle collabore, dans le cadre du partenariat,
avec les entreprises publiques, les entreprises privées et les organisations faitières dans
les activités de Stage pratique des apprenants en entreprise, de Visite d’entreprise, d’appui
financier, d’équipements, et de formation alternée.
La formation d’un élève coûte en moyenne 137.500 et ses sources de financement
proviennent du : Budget de l’Etat, des partenaires techniques et financiers locaux, des
Prestations de service et des frais d’inscription.
En matière d’infrastructure, l’école dispose
- 3 salles de cours,
- 1 bureau pour enseignant,
 |
73 73 |
▲back to top |
66
- 1 salle informatique,
- 10 formateurs pour les cours théoriques dont 5 pour les cours pratiques,
- pas d’atelier,
- 1 étang de pisciculture,
- pas de champ expérimental.
Champ de couverture des formations existantes
Le champ de couverture s’entend ici d’abord, par le nombre suffisant des centres de
formation à même de satisfaire les besoins des entreprises en ressources humaines de
qualité et ensuite par la qualité des compétences mises à la disposition des entreprises
opérant dans les chaînes de valeurs des filières riz, fonio et sésame. A la lumière de la
description du dispositif existant, il apparaît nettement que ces centres ne répondent pas
suffisamment non seulement aux qualifications professionnelles souhaitées des acteurs
des emplois/métiers nouveaux, mais surtout qu’ils ne couvrent pas les besoins de
formation des entreprises.
Cependant l’exploitation de la revue documentaire permet de découvrir d’autres
opportunités de structures de formation. Celle du PRODEFPE indique qu’en dehors des
centres de formation enquêtés, le secteur de l’agriculture dispose au niveau national
d’importants dispositifs qui équipés et adaptés peuvent contribuer à améliorer le champ
de couverture du dispositif existant. L’état des lieux du dispositif de formation agricole
réalisé à ce niveau fait mention de l’existence de centres de formation en Formations
diplômantes comme les Centres d’Apprentissage Agricole (CAA), qui ont pour mission
principale de réaliser la formation initiale des Agents de base appelés Agents Techniques
d’Agriculture (ATA), formation sanctionnée par le CAPA (Certificat d’Aptitude
Professionnelle en Agriculture). Ils assurent également la formation continue du
personnel d’encadrement par des stages de perfectionnement et de recyclage et la
formation des producteurs.
La durée du cycle pour le CAPA est de deux (2) ans assortie de travaux pratiques (TP) et
d’un stage pratique sur le terrain (dans les offices, les projets et programmes de
développement rural).
Centre d’Apprentissage Agricole (CAA) de Samé,
Le centre de Samé dispose de :
- 4 salles de cours d’une capacité de 35 places chacune ;
- 4 bureaux pour enseignant sans ordinateur ;
- 70 ha de parcelles destinées aux travaux pratiques ;
- 1 étable pour bovins ; 1 bergerie pour petits ruminants ; 1 poulailler ; des claviers pour
la cuniculture ;
- 1 bibliothèque avec 1 530 ouvrages mais non équipée en outil informatique ;
 |
74 74 |
▲back to top |
67
Le corps enseignant compte 14 formateurs ayant en moyenne 4 ans d’expérience dans
l’enseignement.
L’établissement a formé de 2001 à 2009 :
- 253 titulaires du CAPA, dont 34 filles ;
- 30 titulaires du BTA, dont 2 filles ;
Centre d’Apprentissage Agricole (CAA) de Samanko,
Ce centre dispose de :
- 6 salles de cours d’une capacité de 27 places chacune ;
- 1 bureau pour enseignant sans ordinateur ;
- 70 ha de parcelles destinées aux travaux pratiques ;
- 2 parcs à bovin ;
- 1 bibliothèque pauvre en documents et non équipée en outil informatique ;
- 15 ordinateurs avec connexion internet irrégulière et à faible débit.
Les enseignements sont regroupés en quatre sections (production agricole ; production
animale ; machinisme agricole et environnement).
Le corps enseignant compte 17 formateurs ayant en moyenne 12 ans d’expérience dans
l’enseignement.
L’établissement a formé de 2001 à 2009 :
- 336 titulaires du CAPA, dont 254 garçons et 72 filles ;
- 25 titulaires du BTA, dont 21 garçons et 4 filles ;
- 50 titulaires du BTVA.
Centre d’Apprentissage Agricole (CAA) de M’Pessoba,
Centre d’Apprentissage Agricole (CAA) de Dioro
A côté de ces centres de formations professionnelle, le Ministère de l’Education de base,
de l’Alphabétisation et des Langues Nationales a sous sa tutelle des établissements
publics secondaires Ce sont :
- l’Institut de Formation Professionnelle Malick Sidibé de Koutiala, (ex-lycée
technique agricole de Koutiala), dans la région de Sikasso ;
- l’Institut de Formation Professionnelle de Bankass, dans la région de Mopti ;
- l’Institut de Formation Professionnelle de Macina, région de Ségou ;
- l’Institut de Formation Professionnelle de Bla, région de Ségou.
 |
75 75 |
▲back to top |
68
Ces établissements qui sont sous la tutelle du Ministère de l’Education de base, de
l’Alphabétisation et des Langues Nationales, délivrent en quatre (4) années après le DEF,
le Brevet de Technicien agro-pastoral.
Dans le dispositif de formation agro-sylvo-pastorale au Mali, il y a des établissements
privés de niveau secondaire. Il s’agit de :
- Centre de Formation Agro-pastoral (CFAP) de Bamako, créé en 1986 et implanté
dans le district de Bamako ;
- Centre Agro-pastoral de Ségou (CAPS), créé en 1999 et implanté dans la ville de
Ségou ;
- Centre de Formation Professionnelle pour la Promotion de l’Agriculture au Sahel
(CFPPAS) de Gao, créé en 1999 et implanté dans la ville de Gao ;
- Centre de Formation Polytechnique Rural (CFPR) de Kita, créé en 2000 et
implanté dans la ville de Kita ;
- Centre Ba Siga Kané de Torodo (CBSK), Kati, région de Koulikoro ;
- Centre Polytechnique Secondaire de Koulikoro (CPSK) ;
- Ecole d’Agriculture du Bélédougou de Kati (EAB-K) ;
- Ecole de Formation Agropastorale de Wayerma (EFAPW), Sikasso ;
- Ecole Privée Agropastorale du District (EPAD), Bamako ;
- Institut de Formation Agro-sylvo-pastorale de Bamako (IFAB).
Ces établissements préparent tous en quatre (4) années de formation les élèves titulaires
du DEF au Brevet de Technicien Agro-pastoral. Les inscriptions sont libres, individuelles
et payantes. Ils reçoivent aussi sur orientation du Ministère de l’Education de base, de
l’Alphabétisation et des Langues Nationales, des titulaires du DEF de la filière
gouvernementale.
Les établissements publics de formation supérieure existent aussi
L'IPR/IFRA de Katibougou forme actuellement quatre (4) niveaux :
- le niveau technicien supérieur ouvert aux titulaires du baccalauréat (séries sciences
biologiques et sciences exactes) ou diplôme équivalent sur examen de dossier pour
une formation de deux (2 ) ans débouchant sur l’obtention du diplôme universitaire
de technicien supérieur (DUTS) dans les domaines des productions végétales,
animales, des eaux et forêts et du génie rural. ;
- Le niveau ingénieur (en Agronomie, Zootechnie et Eaux et forêts), ouvert aux
titulaires du DEUG - Diplôme d’Etudes Universitaires Générales ou du DUTS -
Diplôme Universitaire de Technicien Supérieur, sur concours pour une formation de
trois (3) ans ;
- La maîtrise en vulgarisation agricole, ouvert aux professionnels de la vulgarisation
titulaires du diplôme de Technicien en agriculture, élevage, eaux et forêts et génie
rural, pour une formation de quatre (4) années ;
 |
76 76 |
▲back to top |
69
- La licence en agroéconomie, ouverte en octobre 2009, aux titulaires du baccalauréat
(séries sciences biologiques et sciences exactes).
L’institut dispose de :
- 24 salles de cours d’une capacité de 34 places chacune ; d’un amphithéâtre de 300
places ;
- 42 bureaux pour enseignant équipés d’ordinateurs connectés à l’internet à haut débit ;
la connexion est irrégulière ;
- 40 ha de parcelles destinées aux travaux pratiques ;
- 02 parcs à bovin ; 01 porcherie ; 03 box pour petits ruminants ; 03 poulaillers d’une
capacité totale de 3500 pondeuses, 1 salle d’incubation ;
- 1 bibliothèque dotée de 5 729 ouvrages et équipée d’un ordinateur connecté à
l’internet à haut débit. La connexion est irrégulière ;
- 06 salles d’informatique dont 02 pour enseignant et 04 pour étudiants, dotée chacune,
en moyenne, de 15 ordinateurs par salle, avec une connexion internet irrégulière mais
à haut débit.
Les établissements privés de formation supérieure participent à la formation du monde
agricole.
L’Université Mandé Bukari (UMB) est le seul établissement privé supérieur faisant de
la formation agro sylvo pastorale. L’UMB a été créée en 1999. Elle a déjà offert des
formations universitaires (DEUG en sciences de la nature en 2 ans après le bac ;
d’ingénieurs agronomes, d’ingénieurs zootechniciens et des eaux et forêts en 3 ans après
le DEUG) et des formations post-universitaires (DEA en 2 ans après la maîtrise et
Doctorat en 3 ans après le DEA) en environnement, sociologie rurale, économie rurale et
technologie alimentaire. A partir d’octobre 2009, l’UMB s’est engagée dans le système
LMD (Licence, Master, Doctorat).
L’établissement dispose de :
- 6 salles de cours de 26 places chacune ;
- 1 bureau pour enseignant avec un ordinateur connecté à l’internet haut débit ;
- 1 bibliothèque centrale ;
- 1 salle informatique dotée de 10 ordinateurs fixes connectés à l’internet haut débit,
Remarque : De l’analyse générale de ces informations, il ressort que les établissements
du dispositif de formation agricole sont, d’une manière générale relativement assez dotés
en infrastructures de formation.
On note également des structures de formation agricole qualifiante
 |
77 77 |
▲back to top |
70
Les Centres d’animation rurale (CAR)
Ces centres furent créés pour la formation de jeunes agriculteurs. Ils sont nés de la fusion
du Service civique et des écoles saisonnières. Placés sous la tutelle du Ministère de
l'Agriculture, ils sont actuellement au nombre de 53 dont 12 Centres d'Animation Rurale
Mixte (CARM) pour jeunes couples et 41 ordinaires pour jeunes célibataires masculins.
La formation continue des producteurs et du personnel d’encadrement/ conseil agricole. Cette
formation continue des producteurs et celle du personnel d’encadrement sont assurées
en majeure partie par les services centraux et leurs structures déconcentrées au niveau
régional et local
Remarques
L’analyse de tout ce dispositif indique que les acteurs des métiers nouveaux repérés dans
l’enquête ne sont pas suffisamment pris en compte dans ces différentes structures de
formation.
Les besoins non satisfaits en matière de qualification professionnelle
Pour le moment, les besoins en formation de qualification professionnelle des acteurs
des emplois/métiers nouveaux, Chargé du battage mécanique, Animateur, Coordinateur,
Chargé de l’étuvage, Chargé de l’extraction d’huile, Ouvrier-souffleur, Agent chargé du
pré cuisson ne sont pas couverts par les centres de formation enquêtés. Aucune filière ne
prend en compte les besoins de qualification de ces besoins nouveaux au niveau des
centres visités et au niveau national. A ces besoins nouveaux non satisfaits, il faut ajouter
toute cette main-d’œuvre, en charge des tâches au niveau des chaînes de valeurs des
filières riz, fonio et sésame, formée sur le tas et dont la qualification n’est pas prise en
compte. Elle constitue aussi un besoin important non satisfait en qualification
professionnelle comme l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau 71 : Main d’œuvre utilisée pour réaliser les tâches au niveau des entreprises
enquêtées
Filière Chaîne de valeur Total
Production Transformation Commercialisation
Main d’œuvre
Riz 5090 107 10 5 207
Fonio 730 517 26 1 273
Sésame 2052 130 29 2 211
Total 7872 754 65 8 691
Le secteur de l’agriculture constitue un vivier important de besoins de formation selon le
PRODEFPE qui cite le document de Recensement Général de l’Agriculture réalisé en
2004 estimant la population agricole à 8 912 459 personnes, (soit 78 % de la population
totale) dont :
- 75 % sont des agro/éleveurs,
 |
78 78 |
▲back to top |
71
- 10 % - des éleveurs exclusifs ;
- 9 % - des agriculteurs exclusifs ;
- 6 % sont des pêcheurs.
Cette population Agricole est répartie entre 805 194 exploitations Agricoles composées
de 1 374 215 ménages, soit une taille moyenne de 11 personnes par exploitation ou 6,5
personnes par ménage (Résultats du Recensement Général de l’Agriculture, août 2006).
Niveau de qualification de la population agricole
Selon le niveau de qualification, la population agricole est composée de :
- 11 922 producteurs de niveau supérieur,
- 87 945 producteurs de niveau secondaire,
- 209 207 producteurs de niveau fondamental 2,
- 291 364 alphabétisés,
- 978 057 producteurs de niveau fondamental 1,
- 5 495 163 producteurs non alphabétisés,
Le tableau 7 ci-dessous en fournit les détails.
Tableau 72 : Répartition de la population agricole selon le sexe et le niveau d’instruction
Niveau Masculin % Féminin % Total
Supérieur 9515 0,2 2 407 0,1 11 922
Secondaire général 60 880 1,3 27 065 0,6 87 945
Fondamental 2 144 855 3,2 64 352 1,5 209 207
Autres :
Alphabétisé 199 089 4,4 92 275 2,1 291 364
Fondamental 1 593 266 13 384 791 8,9 978 057
Non concerné 815 718 17,8 740 666 17,1 1556 384
Analphabète 2 553 691 55,9 2 941 472 67,7 5 495 163
Total 4 570 569 100 4 341 891 100 8 912 459
Source : RGA, 2004 présenté par le PRODEFPE
Remarque : Il ressort du tableau ci-dessus que les niveaux de formation sont faibles car
ceux du supérieur, secondaire général et fondamental 2 ne représentent que 3,46 %. Les
producteurs alphabétisés ne représentent que 3,26 %. La grande majorité des producteurs,
soit 93,28 %, ont un niveau de formation assez bas.
 |
79 79 |
▲back to top |
72
XI. BESOINS PREVISIONNELS EN RESSOURCES HUMAINES
POUR CHAQUE METIER
Pour le besoin de l’enquête, les experts ont fait recourt au répertoire de l’Etude
Identification des Organisations professionnelles et des Centres pouvant servir
d’Incubateur pour le Financement de projets de jeunes et de femmes dans la région de
Ségou et le cercle de Yorosso. Cette étude a permis de découvrir 42 entreprises.
Malheureusement, ces entreprises ne répondent pas au besoin de l’enquête. Mais, les
acteurs des différentes filières ont aidé les experts à découvrir effectivement 31 autres
entreprises cadrant avec les filières et les chaînes de valeur de la zone de l’enquête.
La quasi-totalité des entreprises enquêtées souhaitent augmenter leur chiffre d’affaire
dans les années à venir dans la perspective d’accroitre leur capacité de production et
conséquemment procéder à de nouveaux recrutements. Ceci impliquerait l’expression de
nouveaux besoins en ressources humaines. En se focalisant sur les 73 entreprises du
répertoire des entreprises, il est possible, dans le souci d’extrapolation de prévoir les
ressources humaines. La main d’œuvre des 31 entreprises visitées par métier/emploi est
connue. Celle des 42 autres entreprises est calculée sur la base des 31.
Tableau 73 : Besoins prévisionnels en ressources humaines
Métier/emploi Ressources humaines actuelles Besoins prévisionnels
Gardien 31 42
Gestionnaire 31 31
Magasinier 31 31
Manœuvre, 334 453
Comptable 31 31
Mécanicien 11 11
Riziculteur 1
Ouvrier 1924 2607
Gérant 31 31
Vendeur 31 31
Meunier, 17 17
Conducteur d’engins, 4 6
Chargé du battage, 4 6
Ouvrier agricole -culture irriguées, 100 136
Animateur, 4 6
Coordinateur, 4 6
Chef d’exploitation agricole 4 6
Ouvrier agricole cultures sèches 200 271
Chargé de l’étuvage 3 5
Chargé du battage 12 16
Ouvrier- Souffleur 11 15
Chargé de l’extraction d’huile 6 8
Electricien, 2 3
Soudeur 2 3
forgeron 3 5
Agent chargé de la pré-cuisson 22 29
 |
80 80 |
▲back to top |
73
Coût de la formation
D’une manière générale, la formation d’un apprenant coûte en moyenne 25.000 F CFA
et au maximum 180.000 F CFA
Tableau 74 : Coût et financement des formations existantes
Coûts moyens Minimum Maximum Moyenne
Commune 1 3 2
Coût moyen annuel de la formation par
apprenant ? 25 000 180 000 102500
Source : Kara Consult, enquête de terrain 2018
Les sources de financement des centres de formation sont diverses. Elles proviennent de
l’Etat, des collectivités, des partenaires financiers locaux, des prestations de service et des
frais d’inscription.
Tableau 75 : Source de financement
Source de Financement Minimum Maximum Moyenne
Commune 1 3 2
Budget de l'état 6 100 000 30 000 000 4 550 000
Collectivités locales 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Partenaires financier locaux 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Quel est le coût moyen annuel de la formation
par apprenant ?
25 000 180 000 102 500
Prestation de service 500 000 1 472 500 986 250
Source frais d'inscription 50 000 600 000 325 000
Source : Kara-Consult, enquête de terrain 2018
 |
81 81 |
▲back to top |
74
XII. PROPOSITION DES ELEMENTS DE STRATEGIE
L’importance de l’agriculture dans l’économie du pays a amené les autorités à mettre en
place une stratégie globale de formation agricole visant une synergie d’action. Cette
stratégie intègre les politiques et stratégie Nationales et Régionales en matière de
formation Professionnelle (qualifiante, résidentielles, par apprentissage). De l’analyse de
ces politiques, il loisible de retenir :
12.1. Emploi et politique de formation professionnelle
Le besoin d’adapter les qualifications et les compétences de la main-d’œuvre à la
demande des entreprises et autres acteurs économiques est la principale raison d’être des
dispositifs de formation de la politique de l’emploi. Ce besoin concerne aussi bien le
secteur formel que le secteur informel. Plus le degré d’adéquation entre les compétences
et qualifications de la main-d’œuvre et celles demandées sur le marché du travail est faible
plus le besoin de formation est fort. L’existence d’un chômage structurel important est
souvent considérée comme un indicateur de cette mauvaise adéquation entre l’offre et la
demande de travail. Il y a une relation étroite entre les compétences acquises dans le
système de formation initiale (type et niveau) et le besoin de dispositifs de formation dans
le cadre de la politique de l’emploi.
Les périodes de forte croissance économique et de diversification économique sont
généralement associées à des changements dans les compétences et qualifications
demandées sur le marché du travail. L’adaptation continue du système de formation
initiale est nécessaire pour répondre à cette dynamique et améliorer l’employabilité des
sortants du système éducatif. A contrario, le manque d’adaptation, ou une adaptation lente
et imparfaite, du système de formation initiale va se traduire par une demande de
dispositifs de formation de la politique de l’emploi. Les dispositifs de formation de la
politique de l’emploi servent en fait à combler le déficit d’adaptation du système de
formation initiale. Les dispositifs de formation de la politique de l’emploi contribuent
ainsi à compléter les compétences et qualifications des participants et à augmenter leurs
chances d’obtenir un travail plus stable et mieux rémunéré. Au niveau plus
macroéconomique, ces dispositifs permettent d’éviter des pénuries de main-d’œuvre
qualifiée dans certains métiers et branches d’activités et par là même prévenir l’apparition
de tensions inflationnistes. Le rôle palliatif de la politique de l’emploi ne peut être
qu’imparfait en raison des ressources humaines et matérielles limitées dont elle dispose.
Le Mali connait des taux de chômage élevés pour les sortants du système d’enseignement
technique et professionnel. Les enquêtes EPAM pour 2004, 2007 et 2010 le confirment.
Ces taux plus élevés que le taux de chômage moyen indiquent l’existence d’une mauvaise
adéquation entre les compétences et qualifications acquises dans le système scolaire et
celles demandées sur le marché du travail. Seule une proportion limitée de jeune a accès
aux filières techniques et professionnelles de l’enseignement secondaire. Seuls 6,6 % des
 |
82 82 |
▲back to top |
75
jeunes de 16-18 ans suivaient un tel cursus d’enseignement en 2008-2009. Cinq pour cent
(5 %) des 16-18 ans suivaient une formation pour l’obtention d’un brevet de technicien
(BT) alors que 1,4 % des 16-18 ans suivaient une formation menant à un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP). La grande majorité de ces formations sont dispensées
dans des écoles privées. La majorité des élèves de CAP suivent des formations tertiaires.
Les jeunes filles sont surreprésentées dans ces formations.
Les faiblesses de l’enseignement technique et professionnel constituent un sujet de
préoccupation au Mali. Son coût supérieur à celui des pays à niveau de développement
équivalent, la mauvaise adéquation des compétences obtenues dans l’enseignement
technique et professionnel aux besoins des entreprises et autres employeurs, la trop
grande place donnée aux formations préparant à des métiers dans le secteur tertiaire, la
faible importance de la filière agricole malgré la place dominante du secteur dans
l’économie, les contenus de formation technique et professionnelle souvent obsolètes et
une structure d’incitation pour les écoles privées qui ne va pas dans le sens des
compétences demandées sur le marché du travail sont les critiques les plus fréquentes. Il
est bon d’ajouter que les faiblesses de l’enseignement technique et professionnel ne sont
pas le seul résultat des facteurs propres à cette filière d’enseignement. Elles reflètent aussi
les faibles acquis de connaissance dans l’école fondamentale et le bas niveau d’un grand
nombre d’élèves entrant dans le secondaire technique et professionnelle. En effet, les
évaluations faites par le Ministère de l’Education Nationale indiquent que 87 % des élèves
de sixième année sont en dessous du niveau de maîtrise souhaité en sciences,
mathématiques et technologie et 72 % en dessous du niveau de maîtrise souhaité en
langue et communication. C’est parmi ces élèves que la majeure partie des élèves du
secondaire technique et professionnelle sont recrutés.
Les décideurs publics maliens sont conscients des problèmes de l’enseignement technique
et professionnel et du besoin de le réformer pour soutenir le processus de diversification
de l’économie.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement malien a adopté une Politique Nationale de
la Formation Professionnelle (PNFP) en juillet 2009. Elle vise le développement des
ressources humaines pour la productivité et la compétitivité. Elle prend en charge les
besoins de formation des actifs des secteurs productifs, des agents des services de l’Etat
et des Collectivités territoriales ainsi que l’insertion socioéconomique des jeunes et des
femmes.
Pour mettre en œuvre la PNFP le gouvernement a élaboré un plan d’action, le Programme
Décennal de la Formation Professionnelle pour l’Emploi (PRODEFPE), adopté en
Conseil des Ministres en décembre 2011. Le PRODEFPE est un domaine prioritaire du
CSCRP 2012-2017. Le programme cible « les travailleurs des secteurs productifs en
activité, y compris en milieu rural, les finalistes CED, les sortants des CAF, CAFé, les
diplômés en recherche d’emplois, les jeunes déscolarisés, les jeunes non orientés (après
DEF ou Bac) ». Le PRODEFPE est un nouveau programme qui va être mis en œuvre
 |
83 83 |
▲back to top |
76
parallèlement aux systèmes de formation technique et professionnelle existants dans
l’enseignement secondaire comme supérieur. Il constitue maintenant la référence
nationale en matière de formation technique et professionnelle. Il intègre l’ensemble des
politiques, stratégies et programmes de développement sectoriels existants. Le
PRODEFPE se veut un cadre fédérateur qui associe pour sa mise en œuvre l’ensemble
des acteurs institutionnels (départements ministériels techniques, collectivités
territoriales, organisations professionnelles et chambres consulaires), en misant sur la
mise en place d’un partenariat fort et actif avec le secteur privé et en s’inscrivant dans le
processus de décentralisation en cours.
Les effectifs des dispositifs d’apprentissage et de formation (continue, qualifiante et
promotionnelle) envisagés par le PRODEFPE sont considérables. Ensemble ils
représentent quelques 590 000 participants par an, qu’on peut comparer avec les 22 500
participants aux dispositifs de formation des structures du MEFP en 2009. Environ 90 %
des personnes à former appartiennent à l’agriculture et au secteur de la pêche. Il reste
quelques 59 000 places d’apprentissage et de formation pour les autres secteurs, soit plus
du double du nombre de participants aux dispositifs mis en œuvre en 2009. Un objectif
prioritaire du PRODEFPE est de renforcer les capacités de conception, de pilotage et de
suivi des formations pour les métiers des filières économiques porteuses. Pas moins de
148 métiers en font partie.
Un autre objectif central du PRODEFPE est la réhabilitation de centres et structures de
formation existante et la création de huit nouveaux centres. La mise en œuvre du
PRODEFPE s’inscrit dans le processus de décentralisation en cours en mettant l’accent
sur le renforcement des capacités au niveau des collectivités territoriales.
12.2. Emploi et développement rural : la mise en œuvre de la LOA
Adoptée le 16 août 2006, la Loi d'Orientation Agricole (LOA) constitue le socle de la
politique générale de développement agricole du Mali à l'horizon 2025. Elle traduit la
volonté de l'ensemble des partenaires du secteur de passer d'une agriculture de subsistance
à une agriculture intensive et diversifiée, capable de satisfaire les besoins croissants du
pays, et tournée vers la conquête des marchés sous régionaux et mondiaux. La LOA
embrasse non seulement les activités agricoles mais également les activités situées en
amont et en aval : enregistrement et immatriculation des entreprises agricoles,
aménagement du territoire, question foncière, maîtrise de l’eau, formation
professionnelle, recherche, financement, intrants et équipements, labellisation des
produits agricoles, organisation des filières agricoles, etc.
La promotion de l’emploi rural repose sur une vision, qui est de :
- révéler le potentiel des zones rurales comme moteurs de la croissance, de création
d’emplois, de développement équitable et de résilience aux crises ;
- remplacer le stéréotype d’un milieu rural « arriéré » et « manquant d’attrait », par
 |
84 84 |
▲back to top |
77
des images axées sur son potentiel et ses opportunités ;
- prendre des mesures pour remédier aux déficits de travail décent et autres déficits
structurels qui
- investir dans les hommes et les femmes des zones rurales, surtout les jeunes, afin
de les aider à réaliser leur potentiel ;
- démontrer qu’investir dans le développement rural est à la fois éthiquement et
économiquement sain.
Les principes directeurs pour l’emploi rural dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi
d’Orientation Agricole seront les suivants :
- promouvoir dans les zones rurales une croissance durable sur les plans économique,
social et environnemental ;
- promouvoir des conditions favorables à des entreprises durables dans les zones
rurales (activités agricoles ou non) ;
- améliorer l’accès des petits producteurs aux débouchés sur le marché en favorisant
leur participation aux chaînes de valeur nationale et mondiale ;
- augmenter les possibilités d’emploi rural hors agriculture ;
- rendre l’emploi rural plus attrayant pour les jeunes ;
- attirer les investissements privés dans les zones rurales ;
- accroître les investissements dans les biens et services collectifs en milieu rural dans
certains domaines (infrastructures, éducation, santé, eau, assainissement) ;
- améliorer l’accès à l’éducation et aux qualifications dans les zones rurales par une
mise en œuvre effective des dispositions de l’Arrêté interministériel N°10-
2114/MA-MEP-MEA-MEFP-SG du 16 juillet 2010 déterminants les métiers de
l’Agriculture, de l’élevage, la pêche et la foresterie ;
- renforcer l’étendue et l’ampleur des services financiers dans les zones rurales en
saisissant les opportunités qu’offre le Fonds National d’Appui à l’Agriculture
(FNDA) ;
- favoriser l’accès aux terres et à leur utilisation à des fins productives par une mise
en œuvre effective des dispositions du Décret N° 08-768/P-RM du 29 décembre
2008 fixant les modalités d’enregistrement et d’immatriculation des exploitations
agricoles familiales et entreprises agricoles ;
- promouvoir la fixation d’un salaire minimum pour les activités agricoles ;
- recourir à des approches territoriales (décentralisation et dynamisation des
économies locales) pour promouvoir l’emploi rural (agricole et non agricole) ;
- sur la base de ces principes directeurs, le partenariat entre les services de
l’agriculture et ceux de l’Emploi doit en principe contribuer à :
- la promotion de très petites et petites entreprises en zones rurales (identification des
zones potentielles d’implantation de TPE/PE/ME en milieu rural ; conception et
financement de projets viables en matière de création de valeur ajoutée en milieu
rural ; mise en place, au profit des collectivités locales décentralisées et des
entrepreneurs potentiels, d’un système d’aide à la formulation de projets, recherche
de possibilités de financement, adaptées à la création de petites et moyennes
entreprises dans le milieu rural ; mise en place d’une batterie de mesures pour
l’encouragement et le développement des petites et moyennes entreprises dans le
milieu rural) ;
- la diversification des activités économiques en milieu rural (installation de petites
unités de transformation des produits agricoles, en accordant des facilités
financières et en stimulant l’organisation des opérateurs en coopératives de
production et de service, dans la perspective de promotion locale des activités
 |
85 85 |
▲back to top |
78
productives ; promotion des filières agricoles porteuses sur les plans économiques
et financiers; développement des activités de production de contre–saison,
transformation, artisanat, etc., susceptibles de lutter contre le sous-emploi
saisonnier, caractéristique des différents systèmes de culture en milieu rural) ;
- l’accès des jeunes ruraux aux ressources foncières et surtout financières (promotion
du crédit rural orienté vers les activités suivantes : élevage, agriculture, pêche, en
accordant une attention particulière aux zones défavorisées ; identification des
besoins en services financiers des jeunes ruraux ; mise en place de mécanismes
incitatifs d’épargne adaptée aux besoins des jeunes ; mise en place des mécanismes
de refinancement permettant l’expansion des systèmes financiers décentralisés en
milieu rural ; etc.) ;
- la promotion des technologies (identification des technologies agricoles,
industrielles et artisanales déjà disponibles, accessibles et prêtes à être vulgarisées ;
formation, information et sensibilisation des jeunes ruraux à l’adoption de ces
technologies ; constitution de banques de données sur les technologies mises au
point à l’intention d’organisations professionnelles de jeunes ruraux ; etc.).
Quant à la stratégie d’intervention, elle est basée sur l’approche filière. Il est
privilégié la réalisation de zones industrielles et de zones franches afin de favoriser la
création de nouvelles unités industrielles dans les filières les plus porteuses afin de
développer des pôles régionaux de croissance économique et de prospérité sociale.
Cinq filières sont considérées comme hautement stratégiques : i) les oléagineux et
produits de cueillette (karité, gomme arabique), ii) les fruits et légumes (mangues, pomme
de terre, tomate, échalote, haricot vert, pois sucré, hibiscus), iii) les produits animaux
(bétail, viande, lait, poisson, cuirs et peaux), iv) les céréales sèches (riz, maïs), v) les
matériaux de construction (ciment, chaux, plâtres).
La stratégie vise une articulation entre l’agriculture, où travaille la majeure partie de
la population active, et l’industrie avec comme perspective l’implantation dans les zones
de grande production agricole, de nouvelles unités industrielles de transformation de
produits primaires. Pour ce faire, il est prévu des mesures d’accompagnement des
entreprises, telles que le développement d’un réseau dense de petites et moyennes
entreprises, le développement du partenariat interbranches, le renforcement de la
formation professionnelle, le renforcement des mécanismes de financement actuels et la
création de nouveaux instruments comme le Fonds National de Développement Agricole
(FNDA), le Fonds National d’Investissement, le Fonds National de Garantie10
d’Investissement, le crédit-bail et le capital-risque.
Quinze axes stratégiques d’intervention ayant directement ou indirectement des
incidences sur l’emploi et la productivité du travail seront mise en œuvre pour améliorer
l’environnement des entreprises industrielles, la compétitivité des entreprises
industrielles existantes, encourager la création de nouvelles unités industrielles. Il s’agit,
entre autres, de : i) l’amélioration du climat des affaires ; ii) le développement des
infrastructures ; iii) la facilitation de l’accès au financement ; iv) la promotion de la
normalisation, de la qualité, de la propriété industrielle et de la maintenance industrielle ;
v) l’organisation des pôles industrielles ; vi) la promotion de l’innovation et des transferts
 |
86 86 |
▲back to top |
79
de technologies ; vii) le développement des capacités et des compétences ; viii)
l’initiation et le soutien à des projets porteurs ; ix) la création de centres techniques et
d’incubateurs de nouvelles technologies.
Les actions à réaliser liées aux axes stratégiques sus cités font l’objet de plans
triennaux. Ces plans doivent faire l’objet d’une évaluation externe indépendante dont les
conclusions et recommandations sont soumises au Cadre Partenarial d’Orientation et de
Suivi de l’Emploi et de la Formation Professionnelle présidé par la Primature.
En ce qui concerne le développement du secteur privé, considéré comme le moteur de la
croissance économique et pourvoyeur d’emploi, deux instruments majeurs : la Loi
d’Orientation du secteur privé (LOSP) et un nouveau code des investissements.
Les orientations stratégiques de la loi d’orientation du secteur privé sont :
- instaurer un environnement des affaires plus propice au développement des activités
économiques sociales et culturelles, plus particulièrement dans les filières
prioritaires ;
- œuvrer à l’émergence de grappes industrielles compétitives, bâties sur des filières
porteuses d’avantages compétitifs pour le Mali ;
- développer des entreprises nationales capables d’être compétitives et de créer de la
richesse dans les filières cibles ; notamment les petites et moyennes industries ;
- valoriser la production nationale par l’orientation de la consommation intérieure
vers cette production ;
- favoriser la migration rapide du secteur informel vers le secteur moderne structuré.
L’objectif général de la LOSP est de contribuer à la réalisation d’une croissance forte
et soutenue, en mesure de créer des emplois durables et de réduire la pauvreté. Cet objectif
s’articule autour de deux objectifs spécifiques :
i) assainir l’environnement des affaires pour le rendre plus propice au développement des
entreprises privées, particulièrement dans les filières cibles par :
- la simplification des règles juridiques, fiscales et administratives et l’allègement de
la fiscalité le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire dans le domaine des
affaires ;
- le renforcement des capacités des administrations économiques pour les rendre plus
efficaces ;
- la modernisation et le développement des infrastructures, notamment dans les
domaines des transports, de l’accès à l’énergie à prix compétitif, de l’accès aux
technologies de l’information et de la communication ;
- l’amélioration de l’intermédiation financière et de l’accès à des services financiers
adaptés.
ii) renforcer les capacités des entreprises nationales pour les rendre compétitives sur les
marchés national et international, par :
- l’amélioration du système de gouvernance des entreprises ;
- l’amélioration de la qualité des biens et services ; ainsi que le respect des normes
 |
87 87 |
▲back to top |
80
internationales ;
- l’amélioration de la capacité des organisations professionnelles d’appui aux
entreprises ;
- la création, la restructuration ou la mise à niveau d’entreprises dans les filières
cibles ;
- la promotion du partenariat public/privé ;
- la mise en œuvre de mécanismes visant à favoriser l’accès direct ou indirect des très
petites entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) et des grandes
entreprises (GE) nationales aux marchés publics ;
- la mise en œuvre de programmes visant à valoriser la production nationale auprès
des consommateurs maliens ;
- l’appui au développement du potentiel d’exportation de la production nationale ;
- le renforcement de la concertation et du Partenariat Etat/secteur privé ;
- la promotion des zones franches ;
- la valorisation par les entreprises nationales des brevets d’invention tombés dans le
domaine public ;
- la professionnalisation du secteur privé à travers un meilleur encadrement du
secteur informel en vue de faciliter sa transition vers le secteur formel ;
- les instruments et mécanismes suivants pourront être utilisés pour renforcer les liens
entre la politique de développement industriel et la politique nationale de l’emploi.
12.3 Vision et point de vue des acteurs et plus particulièrement des
organisations professionnelles et interprofessions (riz, fonio et sésame)
A cet égard, il convient de revoir le mode de la formation : renforcer la formation par
apprentissage qui, pour être efficace et pratique, doit se faire par alternance (à l’école et
en entreprise). La formation qualifiante qui offre aux jeunes plus de compétences
répondant aux besoins des entreprises doit être privilégiée pour les PMI/MPE. Dans la
préconisation de la formation en région, il serait difficile de comprendre que les
programmes de formation devant servir à la formation des ressources humaines des
entreprises sans la participation des acteurs des plateformes des organisations
professionnelles et interprofessions (riz, fonio et sésame). Au demeurant, une action
soutenue de mise à niveau des professionnels permettra de mieux atteindre l’objectif de
qualité tant attendu de la formation professionnelle.
12.4. Options stratégiques pour le développement de l'offre de formation
La qualité de la formation professionnelle dépend en grande partie de la qualité de l’offre
de formation. Dès lors il importe de préconiser des offres adaptées aux réalités
économiques des régions en privilégiant l’approche par compétence, quand on sait que
l’APC a l’avantage de mettre l’accent sur l’apprenant et l’acquisition des aptitudes
pratiques, le partenariat entreprise/école/ professionnels au moment de la formulation des
curricula.
 |
88 88 |
▲back to top |
81
L’ancien système qui était axé sur la préparation de jeunes à la tête bien faite a montré
ses limites et la méthode de certification de la formation axé sur la diplomation s’avère
caduque parce qu’ignorant les détenteurs des acquis par expérience (VAE).
L’introduction du certificat de qualification professionnelle (CQP) offrirait plus de
chance à ce type de ressources humaines.
Le plus souvent la formation est faite sans trop se soucier de l’insertion des sortants. Ce
qui a poussé à croire que l’école malienne forme pour le chômage. L’opportunité est
donnée, en région de corriger cette tendance par la mise en place d’une stratégie
d’insertion des sortants des écoles. La formation alternée et les stages pratiques en
entreprise aideront les jeunes à se familiariser avec les modes de travail et peut nourrir en
eux, des projets de création de leur propre unité de production.
L’auto emploi ne peut se promouvoir sans une véritable politique de soutien au
financement des initiatives des jeunes porteurs de projet. A ce titre, il faut favoriser et
faciliter l’octroi de crédit de financement des projets viables des jeunes qui ont opté pour
ce système d’insertion économique.
XIII. RENFORCEMENT DE CAPACITE DES AGENTS DE L'ONEF
ET DE L'INIFORP
Les Termes de référence préconisent l’organisation d’un atelier sera à l’intention des
agents de l’ONEF et de l’INFORP. L’objectif de cet atelier est de pérenniser les acquis
de cette étude en termes de maîtrise de la démarche méthodologique adoptée pour la
réalisation de l'étude, et surtout de la mise en œuvre du rapport en ses parties portant sur
les emplois/métiers. Il sera mis à la disposition des structures participantes, une copie de
la documentation comportant le contenu des modules et de la méthode pédagogique
adoptée avant la tenue de l’atelier.
 |
89 89 |
▲back to top |
82
XIV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
14.1. Conclusions
L’ étude portant identification dans la zone d'intervention du programme PIC III (cercles
de Baraouéli, Bla, San, Ségou, Tominian en région de Ségou et le cercle de Yorosso dans
la région de Sikasso) de l'offre de formation existante, des besoins non satisfaits en
matière de qualification professionnelle, des perspectives d'emplois induites s’est bien
déroulée dans l’ensemble.
La méthodologie utilisée a été participative et a impliqué tous les acteurs concernés des
entreprises de production, de transformation, de commercialisation des trois filières riz
sésame et fonio et les responsables des centres de formation visités.
Cette étude a permis d’identifier, dans la zone concernée du programme PIC III, les
entreprises des chaînes de valeurs des filières riz, sésame et fonio assorties de leurs main
d’œuvres, les emplois métiers classiques et nouveaux assorties de leurs descriptions et de
leurs fiches fonction de travail.
Elle a permis aussi d’identifier et de décrire l’offre de formation existante, les besoins de
formation non satisfaits des emplois métiers nouveaux en matière de qualification
professionnelle et les perspectives d’emplois induites de ces trois (3) chaînes de valeur.
Au total, la phase terrain a décelé 6 entreprises dans les trois chaînes de valeur du riz, 7
dans les chaînes de sésame et 18 dans celles du fonio, soit un total de 31 entreprises. La
filière fonio comporte le plus grand nombre d’entreprises (18). Ces entreprises emploient
un nombre important de travailleurs dont 5 207 pour le riz, 2 595 pour le fonio et 889 pour
le sésame.
Pour satisfaire aux besoins de formation de cette main d’œuvre, six (6) centres de
formation ont été enquêtés, tous certifiés par l’autorité compétente. Au regard des
qualifications existantes dans ces centres, il apparaît nettement que les besoins de
formation nouveaux décelés au niveau des chaînes de valeur ne sont pas pris en compte.
14.2. Recommandations
- doter les centres de formation, en fonction des besoins, de tous les équipements
complémentaires nécessaires pour maximiser la réussite de la formation des acteurs
des métiers identifiés ;
- organiser des formations de mise à niveau (perfectionnement technique et
pédagogique) des formateurs des centres de formation de la zone concernée en
fonction des besoins identifiés pour améliorer la qualité d’apprentissages des acteurs
des métiers identifiés ;
 |
90 90 |
▲back to top |
83
- développer la charte des compétences de chaque emploi/métier nouveau ;
- élaborer au besoin, des programmes de formation pour chaque emploi métier et
associer les organisations professionnelles dans l’élaboration de ces programmes de
formation ;
- dans l’élaboration des programmes et de leur mise en application, tenir compte des
emplois sensibles, les emplois cibles et les emplois clés en concertation avec les
responsables des entreprises compte tenu des évolutions technologiques ;
- mettre en place une démarche pédagogique adéquate : formation par alternance,
méthode APC ;
- mettre en place une démarche de Valorisation des Acquis par Expériences (VAE) pour
les acteurs qui ont appris leur métier sur le tas
 |
91 91 |
▲back to top |
84
BIBLIOGRAPHIE
Doc- PRODEFPE- 1ère Phase : Programme Triennal 2015-2017- janvier 2015
Lux-DEV - Rapport de l’étude de pré-formulation sur les filières agricoles- ML021
CIRAD-La mécanisation du décorticage du fonio Au Mali et au Burkina Faso-juin 2016
Afrique Verte – capitalisation d’information sur la filière Fonio- Octobre 2005
Fiche technique sésame : Agricultural commodity Technicals cards from BNDA
CFC-KIT-IFDC-Projets Sésame : Amélioration de la Production et de la Transformation
du Sésame orientées vers l’Exportation. Décembre 2013
Yacouba M COULIBALY,A.ouologuem : Etude sur les chaines de valeur riz au Mali
Documents du PRODEFPE
COULIBALY B, DIARRA Y M, MAIGA H et SISSOKO M S, Les bas-fonds dans la
partie sud de la région de Kayes : diagnostic à partir d'une enquête. In "Aménagement
et mise en valeur des bas-fonds au Mali".
DIARRA Salifou B, TRAORE P, KEITA F, L’inclusion des femmes, des jeunes et des
pauvres dans la chaine de valeur du riz au mali. OMA 2014
Etude Identification des Organisations professionnelles et des Centres pouvant servir
d’Incubateur pour le Financement de projets de jeunes et de femmes dans la région de
Ségou et le cercle de Yorosso- PAFIP-2010.
Liste des centres ouverts mis à jour le 06/01/2016 de la Direction Nationale de la
Formation professionnelle.
 |
92 92 |
▲back to top |
85
ANNEXES
Liste des personnes rencontrées
N° Prénom/Nom Fonction Lieu Contact
1 Mme Sylla Nana Sylla Secrétaire administratif coopérative jigiya Kalaké 66674810
2 Siradou Sylla Chargée de commercialisation coopérative jigiya Kalaké
3 Bati Cissé Trésorière coopérative jigiya Kalaké 94 88 62 52
4 Mamadou Sagara Directeur Institut de formation professionnelle Ségou 76 33 73 29
5 Amadou Koné Groupement Appui au développement de base –
GADB
Ségou 21 73 22 26 /
73 18 16 95
6 Mamadou Lamine Traoré Groupement Appui au développement de base –
GADB
Ségou 21 73 22 26
7 Sidiki Tangara ONEF Ségou
8 Oumar Pérou Chef Division Formation CR Ségou 66 79 76 21
9 Joël Simoné Assistant ingénierie formation Lux- Dev Ségou
10 Siaka Dembélé Président Conseil Régional Ségou 66 18 04 18
11 Tiémoko Diarra Secrétaire général Conseil de Cercle Ségou 76 22 31 42
12 Mme Noni Fatoumata Traoré Promotrice Ségou 65 11 46 45/
79 04 22 32
13 Mme Sanagré Habibatou Traoré Présidente Association Sinsinbéré Ségou 63 34 79 59
74_56 02 14
14 Abdoulaye Sangaré Entrepreneur UPROBEK Ségou 76 38 61 57
63 34 79 54
15 Mme Djiré Mariam Diaré Présidente Coopérative Jèkafo Bla 75 34 92 20
16 Moctar Traoré Président ARPASO San 79 02 83 13
17 Sory Ibrahim Dembélé Gérant ARPASO San 66 64 37 45
73 55 00 18
18 Ali Sanogo San 79 02 99 77
19 Sidy Coulibaly Promoteur Entreprise Faso Yiriwa San 78 24 42 90
66 93 15 03
21 Amos Traoré Vice-président UACT Tominian 76 24 87 12
22 Pierre Théra Secrétaire à la production UACT Tominian 76 87 23 98
23 Réné Koné Trésorier comptable UACT Tominian 73 03 26 10
24 M’Barka Koné Chargée de commercialisation UACT Tominian 76 87 24 12
25 Moïse Mounkoro Trésorier caissier UACT Tominian 73 03 26 11
26 Abdoul Karim Goïta Secrétaire général Conseil de Cercle Yorosso
27 Mahamadou Cissé Directeur Centre de formation Professionnelle Yorosso 66 09 20 00
76 18 06 17
28 Ali Bamba Directeur adjoint centre de formation
multifonctionnelle Mariam Traoré
Yorosso 73 43 53 63
69 63 93 23
29 Halimata Coulibaly Présidente Coopérative Benkaditon Ségou 63 29 40 97
30 Mme Thiéro Djénéba Cissé Promotrice La ségovienne de Commerce et
Agroalimentaire – SECA
Ségou 66 84 94 00/
75 61 56 86
31 Mme Coulibaly Aoua Kamaté Vice-présidente Association Femina Ségou 76 53 50 64/
63 07 00 90
32 Mme Togo Saran Diony Promotrice Unité Saran San 76 14 41 21/
65 93 65 88
33 Mme Coulibaly Korotoumou Traoré Vice-présidente ARPASO San 76 18 08 50
34 Mme Sanogo Fatoumata Soumaré Promotrice Malowoussou Sanké N°1 San 75 22 66 65
35 Adama Tangara Secrétaire administratif Coopérative Benkadi Ségou 67 83 18 81
36 Mme Tamboura, Sala Maïga Vice- présidente, chargée de la
commercialisation Association SinSinBéré
Ségou 77 54 51 81
37 Oumar Traoré Chargé équipement et infrastructure ARPASO San 76 28 30 88/
66 28 30 88
38 Lamine Koné Chargé de commercialisation UACT Tominian 70 30 04 18
 |
93 93 |
▲back to top |
86
Tableau No1 : Compte d’exploitation d’un hectare de riz en zone Office du Niger
Désignation des postes Unités Quantités PU (F CFA) Montant (F CFA)
Semence améliorée (R2) kg 60 275 16 500
Installation entretien pépinière ha 1 10000 10 000
Labour et puddlage ha 1 50000 50 000
Arrachage des plants ha 1 12500 12 500
Transport et distribution des plants ha 1 12500 12 500
Repiquage ha 1 25000 25 000
DAP/NPKS ha 2 14000 28 000
Urée ha 4 14000 56 000
Engrais organique Profeba ha 20 1500 30 000
Désherbage ha 1 20000 20 000
Moisson ha 1 25000 25 000
Mise en moyette ha 1 10000 10 000
Mise en gerbier ha 1 15000 15 000
Sacs vides sac 70 260 18 200
Frais de battage sac 7 80 000
Frais de transport des sacs sac 63 250 15 750
Main œuvre saisonnier Mois 6 12 500 75 000
Total charges opérationnelles FCFA 499 450
Frais redevance eau FCFA 1 67000 67000
Total des charges FCFA 566 450
Coût du kg de paddy 5250 108 566 450
Valeur de la production 5250 150 787500
Marge nette 221 050
Source : (Nyèta Conseils, 2014)
 |
94 94 |
▲back to top |
87
Tableau No2 : Compte d’exploitation d’un hectare de sésame
Sésame Unités Quantité P.U FCFA/ha
Chargés
Nettoyage parcelle Jours 3 500 1 500
Labour Jours 2 5 600 11 200
Semences kg 2 1 000 2 000
Semis pers 5 750 4 500
Démariage et repiquage pers 5 750 3 750
Sarclage pers 6 750 4 500
Récolte pers 6 750 4 500
Battage vannage pers 3 750 2 250
Location bâche 1 200 200
Sacherie sacs 4 275 1 100
Corde sacs 4 25 100
Aiguille 1 50 50
MO 4 25 100
Transport champs domicile sacs 4 100 400
Transport domicile zone de
collecte
sacs 4 250 1 000
Nettoyage au crible 4 250 1 000
Divers
Total : 38 150
NB : certaine charge doivent être ajustées en fonction du mode de conduite de la culture
Produits
Sésame kg 317 250 79 250
CA 79 250
Marge Nette 41 100
Coût de production (F
CFA/KG)
120
Source : BNDA-Fiche technique sésame, Version 1.0
Copyright @ 2024 | ONEF .