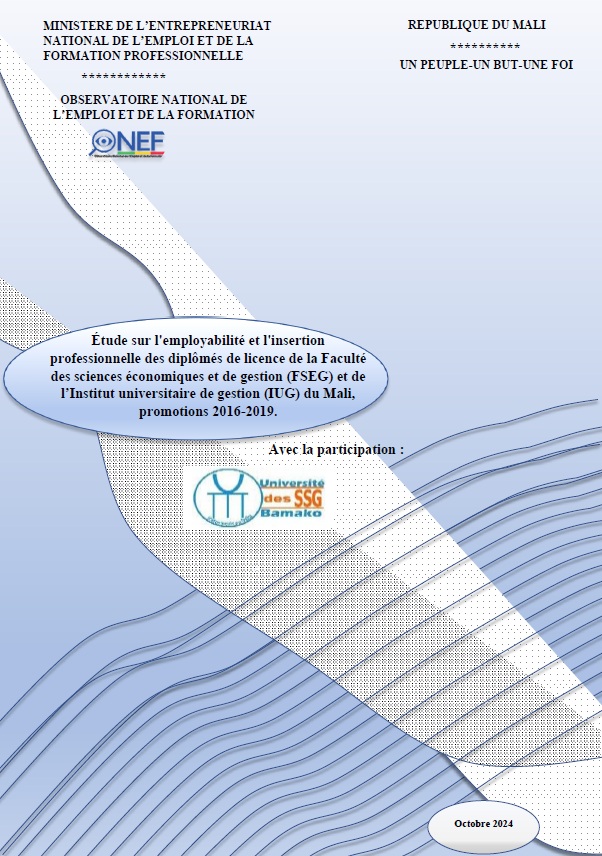Avec la participation : A MINISTERE DE L’ENTREPRENEURIAT NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA...
 |
Avec la participation : A MINISTERE DE L’ENTREPRENEURIAT NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA... |
 |
1 1 |
▲back to top |
1
Avec la participation :
A
MINISTERE DE L’ENTREPRENEURIAT
NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
************
* OBSERVATOIRE NATIONAL DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Étude sur l'employabilité et l'insertion
professionnelle des diplômés de licence de la Faculté
des sciences économiques et de gestion (FSEG) et de
l’Institut universitaire de gestion (IUG) du Mali,
promotions 2016-2019.
REPUBLIQUE DU MALI
**********
* UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
Octobre 2024
 |
2 2 |
▲back to top |
2
Table des matières
LISTES DES TABLEAUX .......................................................................................................................................... 3
LISTES DES GRAPHIQUES ...................................................................................................................................... 4
LISTES DES ANNEXES ............................................................................................................................................. 6
SIGLES ET ABREVIATIONS .................................................................................................................................... 7
RESUME EXECUTIF .................................................................................................................................................. 8
INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 9
METHOLODOGIE .................................................................................................................................................... 11
2.1. Méthodologie enquête qualitative ............................................................................................................. 11
2.2. Méthodologie enquête quantitative ........................................................................................................... 12
2.3. Formation du personnel terrain ................................................................................................................. 16
2.4. Collecte des données ................................................................................................................................. 16
2.5. Contrôle de la qualité du travail sur le terrain ........................................................................................... 17
2.6. Traitement et analyse des données ............................................................................................................ 17
2.7. Production du rapport provisoire ............................................................................................................... 18
RESULTATS DE L’ETUDE ..................................................................................................................................... 19
3.1. Evaluation des programmes de formation ................................................................................................. 19
3.2. Profil sociodémographique des diplômés.................................................................................................. 24
3.3. Cursus universitaires des diplômés ........................................................................................................... 31
3.4. Situation actuelle des diplômés sur le marché du travail .......................................................................... 37
3.5. Parcours d’insertion professionnelle ......................................................................................................... 77
3.6. Employabilité des diplômés ...................................................................................................................... 83
CONCLUSION ........................................................................................................................................................ 102
RECOMMANDATIONS ......................................................................................................................................... 104
ANNEXES ............................................................................................................................................................... 106
REFERENCE ........................................................................................................................................................... 109
 |
3 3 |
▲back to top |
3
LISTES DES TABLEAUX
Tableau 1 : Répartition des entretiens transcrits ........................................................................................................................ 11
Tableau 2 : Répartition de la base de données ........................................................................................................................... 12
Tableau 3 : Répartition de la population mère, de l’échantillon et du coefficient d’extrapolation .......................................... 14
Tableau 4 : Répartition de la population mère, de l’échantillon redressé et du coefficient d’extrapolation révisé ................. 14
Tableau 5 : Répartition des diplômés par sexe et région ............................................................................................................ 24
Tableau 6 : Répartition des diplômés selon l’âge et sexe ........................................................................................................... 25
Tableau 7 : Proportion des diplômés selon le statut matrimonial et sexe.................................................................................. 25
Tableau 8 : Répartition des diplômés par filière et IESRS ........................................................................................................ 25
Tableau 9 : Nombre de personnes dans le ménage selon le sexe du diplômé ........................................................................... 27
Tableau 10 : Répartition des diplômés selon le nombre de personnes exerçant une activité économique dans le ménage .... 29
Tableau 11 : Répartition des diplômés selon le nombre d'enfants à leur charge dans le ménage ........................................... 30
Tableau 12 : Répartition des diplômés selon le choix de formation et le sexe .......................................................................... 31
Tableau 13 : Proportion des modes d'obtention du stage au cours de la formation selon la filière des diplômés (%) ............ 34
Tableau 14 : Satisfaction des diplômés par rapport à la formation selon l’IESRS (%) ........................................................... 35
Tableau 15 : Satisfaction des diplômés par rapport à la formation selon le sexe (%) .............................................................. 36
Tableau 16 : Répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et le sexe .................................................... 40
Tableau 17 : Répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et l’IESRS ................................................. 41
Tableau 18 : Répartition des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et le sexe ............................................................. 42
Tableau 19 : Répartition des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et l’IESRS .......................................................... 43
Tableau 20 : Nombre d’emplois occupé par les diplômés selon le sexe .................................................................................... 44
Tableau 21 : Nombre d’emplois occupé par les diplômés selon le sexe .................................................................................... 45
Tableau 22 : Type d’entreprise des diplômés par sexe ............................................................................................................... 50
Tableau 23 : Type d’entreprise des diplômés par IESRS ........................................................................................................... 51
Tableau 24 : Canaux de recherche par sexe (%) ....................................................................................................................... 59
Tableau 25 : Canaux de recherche par IESRS (%) ................................................................................................................... 60
Tableau 26 : Canaux de recherche par IESRS (%) ................................................................................................................... 60
Tableau 27 : Motifs pour la poursuite de la formation par sexe ............................................................................................... 72
Tableau 28 : Motifs pour la poursuite de la formation par IESRS ........................................................................................... 73
Tableau 29 : Prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation par sexe ....................................................... 74
Tableau 30 : Prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation par IESRS ................................................... 75
Tableau 31 : Niveau d’exécution des tâches par les diplômés selon le type d’entreprise (%) .................................................. 87
Tableau 32 : Niveau d’exécution des tâches par les diplômés selon l’IESRS fréquenté par le diplômé (%) ........................... 87
 |
4 4 |
▲back to top |
4
LISTES DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Proportion des diplômés selon le statut des deux parents (%) ........................................................................... 26
Graphique 2 : Proportion des diplômés selon la catégorie socioprofessionnelle des deux parents (%) ................................... 27
Graphique 3 : Proportion de personnes dans le ménage selon la filière de formation du diplômé (%) ................................... 28
Graphique 4 : Proportion de personnes exerçant une activité économique dans le ménage selon la filière (%) .................... 29
Graphique 5 : Proportion de diplômés selon le nombre d'enfants à leur charge par filière (%) ............................................. 30
Graphique 6 : Proportion de diplômés selon le choix de formation et le sexe par filière (%) .................................................. 32
Graphique 7 : Stage des diplômés au moment (%) .................................................................................................................... 32
Graphique 8 : Proportion des modes d'obtention du stage au cours de la formation selon le sexe des diplômés (%) ............. 33
Graphique 9 : Taux d’insertion selon le sexe ............................................................................................................................. 37
Graphique 10 : Taux d’insertion par IESRS.............................................................................................................................. 38
Graphique 11 : Taux d’insertion par filière de formation ......................................................................................................... 39
Graphique 12 : Taux d’insertion selon la situation actuelle des parents des diplômés ............................................................ 39
Graphique 13 : Proportion des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et la filière de formation (%) ................ 41
Graphique 14 : Proportion des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et la filière de formation (%) ......................... 44
Graphique 15 : Nombre d’emplois occupé par les diplômés selon la filière de formation (%) ................................................ 46
Graphique 16 : Revenu mensuel des diplômés en emploi par sexe (%) .................................................................................... 47
Graphique 17 : Revenu mensuel des diplômés en emploi par IESRS (%) ................................................................................ 48
Graphique 18 : Revenu mensuel des diplômés en emploi par filière de formation (%) ............................................................ 49
Graphique 19 : Type d’entreprise des diplômés selon les filières .............................................................................................. 52
Graphique 20 : Proportion de diplômés en emploi formel par sexe (%) ................................................................................... 53
Graphique 21 : Proportion de diplômés en emploi formel par IESRS (%) ............................................................................... 54
Graphique 22 : Proportion de diplômés en emploi formel par filière de formation.................................................................. 55
Graphique 23: Taux de chômage selon le sexe .......................................................................................................................... 57
Graphique 24: Taux de chômage par IESRS ............................................................................................................................. 58
Graphique 25: Taux de chômage par filière de formation ........................................................................................................ 59
Graphique 26 : Proportion des diplômés qualifiés pour le poste et sexe ................................................................................... 61
Graphique 27 : Proportion des diplômés qualifiés par IESRS .................................................................................................. 62
Graphique 28 : Proportion des diplômés qualifiés par filière de formation .............................................................................. 63
Graphique 29 : Inadéquation du domaine d’études des diplômés par sexe .............................................................................. 64
Graphique 30 : Inadéquation du domaine d’études des diplômés par IESRS .......................................................................... 65
Graphique 31 : Inadéquation du domaine d’études des diplômés par filière de formation ...................................................... 66
Graphique 32 : Taux d’insertion et inadéquation des postes selon le sexe ............................................................................... 67
Graphique 33 : Taux d’insertion et inadéquation des postes selon l’IESRS ............................................................................ 68
Graphique 34 : Taux d’insertion et inadéquation des postes selon l’IESRS ............................................................................ 69
Graphique 35: Proportion de diplômés ayant repris ou continué une formation par sexe (%) ................................................ 70
Graphique 36: Proportion de diplômés ayant repris ou continué une formation par IESRS (%) ........................................... 71
Graphique 37: Proportion de diplômés ayant repris ou continué une formation par filière (%) ............................................. 72
Graphique 38: Motifs pour la poursuite de la formation par filière de formation (%) ............................................................. 74
Graphique 39: Prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation par sexe (%) ............................................. 76
Graphique 40 : Trajectoires types d’insertion des diplômés ...................................................................................................... 77
Graphique 41 : Parcours d’accès progressif et durable à un emploi ........................................................................................ 78
Graphique 42 : Parcours de passage de la formation, via le chômage, vers l'emploi ............................................................... 78
Graphique 43 : Parcours de Chômage persistant ...................................................................................................................... 79
Graphique 44 : Parcours de chômage vers l'emploi .................................................................................................................. 79
Graphique 45 : Parcours d’insertion et sexe .............................................................................................................................. 80
Graphique 46 : Parcours d’insertion et IESRS .......................................................................................................................... 81
Graphique 47 : Parcours d’insertion et filière de formation ..................................................................................................... 82
Graphique 48 : Taille de l’entreprise .......................................................................................................................................... 83
Graphique 49 : Taille de l’entreprise selon le type d’entreprise ................................................................................................ 84
Graphique 50 : Taille de l’entreprise selon l’IESRS du diplômé .............................................................................................. 84
Graphique 51 : Reconnaissance des diplômes dans l’entreprise selon le type d’entreprise ..................................................... 85
Graphique 52 : Reconnaissance des diplômes dans l’entreprise selon l’IESRS du diplômé .................................................... 86
Graphique 53 : Effectif des recrues selon la taille de l’entreprise ............................................................................................. 88
 |
5 5 |
▲back to top |
5
Graphique 54 : Effectif des recrues selon le type d’entreprise .................................................................................................. 89
Graphique 55 : Satisfaction relative au rendement des diplômés par type d’entreprise (%) .................................................... 90
Graphique 56 : Satisfaction relative au rendement des diplômés par IESRS fréquenté (%) ................................................... 91
Graphique 57 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux compétences des diplômés....................................... 92
Graphique 58 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux compétences selon l’IESRS .................................... 93
Graphique 59 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux savoirs ou connaissances ........................................ 94
Graphique 60 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux savoirs ou connaissances selon l’IESRS ................ 96
Graphique 61 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport au savoir-être .................................................................. 97
Graphique 62 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport au savoir-être selon l’IESRS ......................................... 98
Graphique 63 : Attentes et satisfaction des entreprises par rapport au savoir-faire ................................................................. 99
Graphique 64 : Attentes et satisfaction des entreprises par rapport au savoir-faire selon l’IESRS ....................................... 101
 |
6 6 |
▲back to top |
6
LISTES DES ANNEXES
Annexe 1 : Attentes en termes de compétences (%) ................................................................................................................. 106
Annexe 2 : Attentes au regard de leurs savoirs ou connaissances (%) ................................................................................... 106
Annexe 3 : Proportion de capital humain déprécié (%) ........................................................................................................... 107
Annexe 4 : Attentes au regard de leurs savoir-être ou comportements (%) ............................................................................ 107
Annexe 5 : Attentes au regard de leurs savoir-faire ou habileté (%) ....................................................................................... 108
 |
7 7 |
▲back to top |
7
SIGLES ET ABREVIATIONS
ANPE Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
APEJ Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
CAMES Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur
CDD Contrat à Durée Déterminé
CDI Contrat à Durée Indéterminé
CREDD Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
FCFA Franc de la Communauté financière africaine
FSEG Faculté des Sciences Economique et de gestion
IES Institution d’enseignement supérieur
IESRS Institution d’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique
IUG Institut Universitaire de Gestion
LMD Licence Master Doctorat
MESRS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques
NAEMA Nomenclature d’Activité des États Membres d’AFRISTAT
OI Organisation Internationale
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
ONG Organisme Non Gouvernementale
PADES Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur
PEJ I et II Programme Emploi Jeunes 1 et 2
REESAO Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest
SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
UIG Institut Universitaire de Gestion
USSGB Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
 |
8 8 |
▲back to top |
8
RESUME EXECUTIF
Ce rapport, élaboré par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation (ONEF), analyse l'insertion
professionnelle et l'employabilité des diplômés en sciences économiques et en gestion de la FSEG et de
l’IUG au Mali. Il présente les résultats d'une enquête approfondie portant sur l'évaluation des programmes
de formation, les caractéristiques sociodémographiques, les parcours académiques et professionnels, ainsi
que les perspectives d'emploi. Pour mener à bien cette enquête, une méthodologie intégrant des approches
qualitatives et quantitatives a été adoptée. Les outils de collecte de données ont été destinés aux diplômés
ayant obtenu une licence à la FSEG et à l'IUG, ainsi qu'aux enseignants, aux personnels administratifs de
ces institutions, et aux employeurs de ces diplômés.
L'évaluation des programmes de formation démontre que, malgré l'instauration du système LMD depuis
2008, des disparités persistent dans l'adéquation des formations sur le marché de l'emploi. Les diplômés de
l'IUG se disent globalement satisfaits de leur formation, tandis que 40 % des diplômés de la FSEG signalent
une inadéquation. Les partenaires privés sont encouragés à renforcer leur collaboration avec les
établissements d'enseignement pour répondre aux évolutions du marché.
Au niveau sociodémographique, la majorité des diplômés se concentre à Bamako, avec des différences de
genre et de statut socio-économique notables. Les femmes font face à des obstacles dans certaines régions,
et les responsabilités familiales impactent leur insertion professionnelle.
Concernant le cursus, une majorité significative de diplômés n’a pas effectué de stage, ce qui suggère un
déséquilibre entre la théorie et la pratique. Ce manque d'expérience pratique est un facteur amenuisant à un
taux d'insertion global de 69,9 %, dont 79,5 % d’hommes et 49,9 % de femmes. La dynamique de l'emploi
montre que 22,6 % des diplômés gagnent moins que le SMIG malien, signalant une vulnérabilité accrue,
en particulier pour les femmes. Le chômage s'établit à 18,8 %, touchant plus sévèrement les femmes (32,1
%). La recherche d’emploi s’effectue principalement par le biais de réseaux personnels, une approche qui
varie selon les filières. L'analyse de l’inadéquation des qualifications montre que seuls 9,6 % des diplômés
occupent des postes adaptés à leur qualification, tandis que 93,6 % souffrent d'une dépréciation de leur
capital humain, ce qui souligne la nécessité d’un ajustement des programmes éducatifs. Quant aux taux de
retour en formation, 4,6 % des diplômés poursuivent leurs études pour acquérir de nouvelles compétences,
montrant une motivation accrue chez les femmes. Les parcours d’insertion professionnelle révèlent que 77
% des diplômés accèdent à des emplois, mais 15 % restent au chômage. Les facteurs de réussite incluent la
filière d’études, où certaines spécialisations, comme l'organisation et gestion des organisations, offrent de
meilleures perspectives d'emploi.
Enfin, l'analyse des caractéristiques des entreprises révèle que la majorité des diplômés sont recrutés par
des petites et moyennes entreprises. Les employeurs expriment une satisfaction générale concernant les
compétences des diplômés, bien qu'il y ait des attentes spécifiques à améliorer, notamment en
communication et en créativité.
En somme, ce rapport souligne l'importance d'adapter les programmes de formation aux réalités du marché
de l'emploi, de renforcer les partenariats avec le secteur privé, et de mettre en place des politiques d'insertion
qui tiennent compte des différences de genre et de région, afin d'améliorer l'employabilité et la qualité de
vie des diplômés maliens en sciences économiques et gestion.
 |
9 9 |
▲back to top |
9
1.INTRODUCTION
La question de l'emploi des diplômés constitue un enjeu majeur pour les autorités politiques et
administratives au Mali. En réponse à ce défi, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre, conformément
aux orientations du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
(CREDD). Parmi ces initiatives figurent le Programme Emploi Jeunes (PEJ I et II), la Politique Nationale
de l’Emploi, et la Politique Nationale de la Formation Professionnelle. L’objectif global de la Politique
Nationale de l’Emploi, adoptée en 2014, est de créer davantage d'opportunités d'emplois décents, tant en
milieu urbain qu'en milieu rural, avec la perspective de réduire le chômage des jeunes diplômés des
universités et des grandes écoles à long terme.
Le Gouvernement du Mali bénéficie également du soutien de partenaires au développement, dont la Banque
Mondiale. Cette dernière a financé le Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur
(PADES), un projet terminé qui visait à renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur
pour former des diplômés hautement qualifiés, capables de répondre aux besoins du marché du travail.
Depuis son opérationnalisation en 2015, l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) a
joué un rôle crucial en collectant, centralisant, traitant, analysant et diffusant des informations sur l’emploi
et la formation au Mali. Dans ce cadre, l’ONEF a réalisé plusieurs études thématiques, dont un rapport en
2021 sur l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés des institutions publiques
d’enseignement supérieur pour la cohorte 2015-2018, financé par le PADES. Ce rapport a permis de
quantifier divers indicateurs relatifs à la situation professionnelle des diplômés.
Les résultats de cette étude ont conduit à des recommandations, notamment en ce qui concerne l’orientation
des bacheliers vers des domaines universitaires spécifiques. Cependant, l’étude a révélé que les diplômés
dans des domaines tels que les Sciences Économiques et de Gestion, les Sciences Juridiques, Politiques et
de l’Administration, et les Lettres, Langues et Arts passent en moyenne 21 mois en chômage et sont souvent
surqualifiés pour les postes qu'ils occupent.
Avant de mettre en œuvre les recommandations, il semble pertinent d’approfondir l’analyse des données
concernant ces domaines universitaires pour mieux orienter les décisions politiques. Dans cette optique,
l’ONEF a décidé de mener cette année une étude sur l’insertion professionnelle et l’employabilité des
diplômés Sciences économiques et de gestion, une filière influente.
Cette étude vise principalement à retracer le parcours des diplômés sur le marché du travail, en analysant
leur insertion professionnelle, leur situation de chômage, ainsi que leurs choix de reprise de formation. Plus
spécifiquement, elle a pour objectifs de :
• Cartographier les secteurs d’insertion des diplômés en sciences économiques et de gestion des
institutions publiques d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et préciser les modes
d’accès à l’emploi ainsi que la durée moyenne de l’insertion.
• Analyser les éléments susceptibles d’améliorer l’employabilité des diplômés des institutions
d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
 |
10 10 |
▲back to top |
10
• Étudier les possibilités de collaboration entre les institutions d'enseignement supérieur et le secteur
professionnel pour former des ressources humaines plus compétentes et répondant aux besoins du
marché de l’emploi.
• Examiner le système de formation des diplômés (aspects pédagogiques et gouvernance) et proposer
des améliorations pour renforcer la responsabilité sociétale des universités en matière d’insertion
professionnelle.
 |
11 11 |
▲back to top |
11
2.METHOLODOGIE
L’analyse des termes de référence, en particulier des objectifs, nous a conduit à adopter à la fois une
approche qualitative et une approche quantitative. La première approche a concerné les enseignants et le
personnel administratif de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) et de l’Institut
Universitaire de Gestion (IUG) à travers l’administration de deux guides d'entretien. La seconde approche
nous a permis d’adresser deux questionnaires distincts : l'un destiné aux diplômés de licence de la FSEG et
de l’IUG, promotion 2016-2019 et l'autre aux employeurs de ces diplômés.
2.1. Méthodologie enquête qualitative
Pour cette approche méthodologique, deux guides d’entretien ont été élaborés en fonction des objectifs de
l’étude concernant l’évaluation de la formation au sein de la FSEG et de l’IUG. Ces guides d’entretien ont
ensuite été soumis aux enseignants et au personnel administratif de ces deux établissements d'enseignement
supérieur.
Les questions abordées dans ces deux guides d’entretien couvrent plusieurs aspects clés, notamment :
• contenu du programme de formation ;
• évaluation de la qualité de la formation ;
• suggestions d'amélioration ;
• moyens d'améliorer l'employabilité des diplômés ;
• évaluation de l'efficacité des modules du programme de licence en sciences économiques et de
gestion.
Les informations recueillies lors de ces entretiens ont été transcrites et analysées afin de présenter les
résultats dans ce rapport. A cet effet, des questions ont été adressées aux cadres de la FSEG et de l’IUG
selon la répartition dans le tableau 1.
Tableau 1 : Répartition des entretiens transcrits
IESRS
Nombre de cadres interviewé
Personnel Administratif Enseignant
FSEG 9 10
IUG 7 9
Ensemble général 16 19
Source : Bases de données Personnel administratif & Enseignant-ONEF 2024
 |
12 12 |
▲back to top |
12
2.2. Méthodologie enquête quantitative
2.2.1. Enquêtes auprès des diplômés
2.2.1.1. Base de sondage
Les travaux de centralisation des données, orchestrés par l’ONEF en étroite collaboration avec l'Université
des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), ont abouti à la constitution d'une base de données
de 4 798 diplômés de licence, promotion 2016-2019, de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
de Bamako (FSEG) et de l’Institut Universitaire de Gestion de Bamako (IUG). L’analyse de cette base de
données a permis de développer une stratégie de collecte de données efficace.
Tableau 2 : Répartition de la base de données
Filière Nombre de diplômés
Assurance banque finance 1122
Economie 1679
Gestion 1734
Organisation et gestion des organisations 77
Création et gestion d’entreprises 118
Sciences et techniques commerciales 68
Ensemble 4 798
Source : Répertoire des diplômés de licence FSEG & IUG, promotion 2016-2019
Compte tenu du grand nombre de diplômés, un échantillonnage a été réalisé afin de réduire les coûts de
l’étude tout en garantissant la précision des résultats. Ce processus d'échantillonnage a été soigneusement
conçu pour assurer une représentativité adéquate des diplômés dans l'échantillon final, en tenant compte
des diverses variables démographiques et académiques. De cette manière, l’étude vise à fournir des résultats
fiables et exploitables pour les différentes parties prenantes.
2.2.1.2. Échantillonnage
Grâce à la qualité de la base de sondage, caractérisée par son exhaustivité et sa fiabilité, nous avons opté
pour le sondage probabiliste plutôt que le sondage empirique. En effet, comparé au sondage empirique, le
sondage probabiliste offre l'avantage de fournir une plus grande précision des résultats. En particulier, nous
avons choisi le sondage stratifié, un type de sondage très courant qui permet d'améliorer la précision tout
en respectant les contraintes budgétaires.
2.2.1.2.1. Variables de stratification :
Pour garantir l’homogénéité dans la stratification, il est crucial d’utiliser la variable la plus discriminante
entre les groupes constitués. En pratique, cela signifie rechercher la variable la plus corrélée avec la variable
d’intérêt et la plus explicative. Une stratification peut être encore améliorée en croisant plusieurs variables
explicatives.
Il est important de noter que le processus de stratification nécessite la disponibilité d’informations
auxiliaires au niveau de chaque individu. La recherche de la variable de stratification se base souvent sur
des études antérieures portant sur le même sujet. Cette méthode de recherche peut être qualifiée de
qualitative, tandis qu'il existe aussi des méthodes quantitatives qui utilisent des analyses statistiques pour
créer des typologies de population, formant ainsi des ensembles d’individus similaires.
En se basant sur l’expérience internationale en matière d’enquêtes d’insertion, la variable de stratification
adoptée pour cette étude combine la filière de formation et l’institution d’enseignement supérieur (IES). En
 |
13 13 |
▲back to top |
13
fonction des nomenclatures adoptées pour les filières de formation et les IESRS, nous avons pu constituer
six croisements, formant ainsi six strates distinctes.
Il est important de noter que chaque individu de la population à enquêter doit appartenir à une et une
seule strate.
2.2.1.2.2. Calcul de la taille de l’échantillon :
Nous optons pour cette étude à un sondage stratifié à allocation non proportionnelle.
On suppose que :
✓ ??soit le nombre de strates dans notre population de diplômés ?? ;
✓ ??ℎ soit la taille de la population de la strate ℎ ;
✓ ??ℎ soit le taux d’insertion des diplômés de la strate ℎ ;
✓ ??ℎ soit la taille de l’échantillon qu’on va tirer de la strate ℎ ;
La taille de l’échantillon dépend de plusieurs paramètres dont notamment le budget alloué et le degré de
précision souhaité. Notre but étant de calculer la taille optimale ??ℎ pour chaque strate et ainsi la taille totale
de l’échantillon ?? soit : ?? = ∑ ??ℎ
??
ℎ=1 .
Dans cette étude, les strates obtenues du croisement IESRS avec les filières de formation nous donnent des
tailles de strates variant entre 51 et 257 dont aucune strate de taille inférieur à 30.
En supposant que notre variable intérêt ??ℎ (taux d’insertion) suit la loi normale, le calcul de précision se
fait selon la formule suivante :
??ℎ = 1,96 ∗ √??ℎ ∗
(1 − ??ℎ)
??ℎ
∗ ( 1 −
??ℎ
??ℎ
)
Signifie
1
??ℎ
=
??ℎ
2
1,962∗ ??ℎ∗(1− ??ℎ)
+
1
??ℎ
➔Signifie ??ℎ =
1
??ℎ
2
1,962∗ ??ℎ∗(1− ??ℎ)
+
1
??ℎ
Ainsi nous obtenons la formulation suivante pour le taux de sondage ??ℎ
??ℎ = {
1 ???? ??ℎ ≤ 30
??ℎ
??ℎ
???? 30 ≤ ??ℎ < ??ℎ
Nous supposons aussi que le taux de réponse visé pour cette enquête est de 80%. Nous allons donc
augmenter (là où c’est possible) la taille de chaque strate de 20% pour éviter le recours à une liste de
remplacement. Cette méthode souvent utilisée dans des enquêtes individuelles consiste à remplacer les
individus non localisés par d’autres individus « similaires ». Même si elle permet d’augmenter le taux de
réponse elle introduit souvent un biais dans les estimations de l’étude.
 |
14 14 |
▲back to top |
14
2.2.1.2.3. Plan de sondage
L’ONEF avait le choix entre trois scénarios de sondage :
❖ Scénario 1 : Ce scénario propose un seuil de confiance de 3%, le plus exigeant en termes de
précision statistique. Un échantillon de 2 182 individus est nécessaire pour atteindre cet objectif,
soit 45,5% de la population totale.
❖ Scénario 2 : Ce scénario propose un seuil de confiance de 5%. Pour atteindre ce niveau de précision,
un échantillon de 889 individus est requis, soit 18,5% de la population totale.
❖ Scénario 3 : Ce scénario propose un seuil de confiance de 10%. Pour atteindre ce niveau de
précision, un échantillon de 235 individus est nécessaire, soit 4,9% de la population totale.
En tenant compte des coûts de la collecte des données, le scénario 2 a été retenu.
2.2.1.2.4. Analyse de l’échantillon
Afin de procéder à la sélection de l’échantillon, une procédure a permis de créer une base de données
contenant les individus sélectionnés avec le poids de chacun. Cette information sur le poids des diplômés
de l’échantillon a permis de faire le redressement. Ainsi lors de l’exploitation des résultats, les indicateurs
ont été extrapolés sur toute la population des diplômés.
Le tableau ci-dessous donne une répartition de la population mère, de l’échantillon et du coefficient
d’extrapolation initial
Tableau 3 : Répartition de la population mère, de l’échantillon et du coefficient d’extrapolation
Filière Population mère Echantillon Coefficient d'extrapolation initial
Assurance banque finance 1122 207 5,424363138
Economie 1679 253 6,635561453
Gestion 1734 257 6,743368208
Organisation et gestion des organisations 77 54 1,421011819
Création et gestion d’entreprises 118 67 1,759111352
Sciences et techniques commerciales 68 51 1,335385892
Ensemble 4798 889
Source : Répertoire des diplômés de licence FSEG & IUG, promotion 2016-2019
2.2.1.2.5. Correction post-collecte des données
Après la collecte des données, des déséquilibres ont été constatés dans la répartition de l’échantillon. Pour
corriger ces déséquilibres, des techniques de redressement ont été appliquées. Cela a inclus le réajustement
du poids de chaque individu de l’échantillon. Ces pondérations ajustent les résultats afin que les sous-
groupes sous-représentés soient davantage pris en compte dans l'analyse finale, tandis que les sur-
représentés sont ajustés à la baisse.
Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population mère, l’échantillon redressé, ainsi que le
coefficient d’extrapolation révisé.
Tableau 4 : Répartition de la population mère, de l’échantillon redressé et du coefficient d’extrapolation révisé
Filière Population mère Echantillon redressé Coefficient d'extrapolation révisé
Assurance banque finance 1122 207 5,42028986
Economie 1679 253 6,63636364
Gestion 1734 257 6,74708171
Organisation et gestion des organisations 77 54 1,42592593
Création et gestion d’entreprises 118 67 1,76119403
Sciences et techniques commerciales 68 40 1,7
Ensemble 4798 878
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
15 15 |
▲back to top |
15
2.2.1.3. Questionnaire insertion
Pour répondre aux objectifs assignés à l'étude, calculer les indicateurs et évaluer l'insertion professionnelle
des diplômés de la FSEG et de l'IUG, le questionnaire a été structuré autour des thèmes suivants :
✓ Module pour les antécédents sociodémographiques ;
✓ Cursus de formation ;
✓ Situation professionnelle au moment de l’enquête ;
✓ Calendrier professionnel.
2.2.2. Enquêtes auprès des employeurs des diplômés
Cette partie décrit la méthodologie de réalisation de l’enquête sur la satisfaction des employeurs des
diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019. Elle se base sur la construction de la
base de données, l’élaboration du questionnaire ainsi les thèmes abordés dans le questionnaire.
2.2.2.1. Base de données de l’enquête satisfaction
La population de l’étude se compose des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG,
promotion 2016-2019, ainsi que des diplômés eux-mêmes lorsqu’ils sont chefs d’entreprise ou en auto-
emploi. L’enquête a inclus toutes les entreprises (employeurs ou auto-employeurs) où ces diplômés
exercent un emploi adéquat, c’est-à-dire en lien avec la formation reçue dans leurs IESRS, qu’ils soient
salariés ou employeurs.
Ces entreprises peuvent être situées partout au Mali ou ailleurs. La liste des entreprises a été constituée à
partir des données recueillies lors de l’enquête sur l’insertion des diplômés de licence de la FSEG et de
l’IUG, promotion 2016-2019. Lors de cette enquête, une série de question a été posée aux diplômés pour
identifier et localiser les entreprises dans lesquelles ils travaillent. En cas de multiples employeurs
successifs, la priorité a été donnée à l’entreprise où le diplômé a passé le plus de temps.
2.2.2.2. Élaboration du questionnaire satisfaction
En raison des contraintes budgétaires, le questionnaire utilisé pour l’enquête de satisfaction des employeurs
des diplômés des IESRS du Mali, réalisée en 2020, a été réutilisé pour collecter les données auprès des
employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019. Ce questionnaire de
2020 identifiait les attentes des employeurs des diplômés de licence de la promotion 2015-2018 dans trois
domaines de compétences, à savoir : le savoir (connaissance), le savoir-être (comportement) et le savoir-
faire (habilité).
Pour rappel, l’ONEF avait organisé un atelier avec un échantillon d’employeurs issus de l’enquête sur
l’insertion des diplômés des IESRS du Mali pour identifier leurs attentes par rapport à chaque domaine de
compétence. Les informations recueillies à cette occasion avaient permis à l’ONEF d’élaborer un
questionnaire sur la satisfaction des employeurs.
Ce questionnaire contient toutes les informations nécessaires au calcul de l’indicateur principal : le taux de
satisfaction des employeurs. Chaque employeur a été interrogé sur les compétences du diplômé qu’il a
recruté, permettant ainsi une évaluation précise de la satisfaction des employeurs.
 |
16 16 |
▲back to top |
16
Pour atteindre les objectifs de l’étude, le questionnaire élaboré a été structuré autour des principaux
éléments suivants :
✓ Identification de l’entreprise
✓ Rôle et reconnaissance du diplômé au sein de l’entreprise
✓ Recrutement et suivi des employés
✓ Attentes et satisfaction des employeurs
2.3. Formation du personnel terrain
Au total, quatorze agents de l’ONEF ont été formés pendant trois jours pour la collecte des données. La
formation s'est déroulée en français et en bamanankan pour permettre aux agents enquêteurs de maîtriser
les formulations les plus appropriées. Les deux premiers jours ont été consacrés à la formation théorique.
Le troisième jour, une enquête pilote a été organisée pour tester et améliorer les outils de collecte. À l’issue
de cette formation, chaque agent de terrain possédait une connaissance approfondie de son rôle, garantissant
ainsi une efficacité maximale lors des travaux de collecte sur le terrain. Enfin, les cibles ont été réparties
entre les agents enquêteurs.
2.4. Collecte des données
La collecte des données auprès des différentes cibles a duré vingt jours. Des procédures strictes ont été
mises en place pour assurer la qualité des données. Les superviseurs vérifiaient régulièrement le travail des
enquêteurs et corrigeaient les erreurs éventuelles.
Pour éviter les biais, les outils de collecte ont été administrés comme suit :
✓ l’enquêteur demande à l’enquêté un espace isolé ou il peut lui poser les questions sans risque
d’interférence d’autres personnes susceptibles de nuire à la qualité de l’entretien ;
✓ faire l’interview en face à face ou au téléphone si le superviseur direct pense que l’accès à
l’enquêté est difficile;
✓ le questionnaire n’est pas auto-administré. en aucun cas l’enquêteur ne doit laisser le
questionnaire avec l’espoir de le récupérer après remplissage ;
✓ l’enquêteur pose toutes les questions comme indiqué au cours de la formation en veillant au
respect des filtres et en relançant les questions difficiles le plus possible ;
Par ailleurs, tout comme l'administration des outils de collecte, l'enregistrement des réponses est également
crucial pour la qualité des données. Ainsi, il est essentiel d'observer les règles élémentaires suivantes au
cours des interviews :
✓ pour les questions pré-codées, écrire les codes correspondants aux réponses données ;
✓ pour les questions semi-fermées (pour lesquelles, il y a « autre à préciser » en bas de la liste
proposée), inscrire de façon lisible les autres mentions du répondant en vérifiant à chaque fois
si ces mentions ne se regroupent pas avec des propositions de réponse figurant déjà sur les
questionnaires ;
✓ a la fin de l’interview, l’enquêteur vérifiait sur place que toutes les questions ont été posées et
qu’il a noté toutes les réponses. en cas d’omission, il posait les questions manquantes puis
enregistrait les réponses. il a été instruit aux différents agents enquêteurs d’éviter
impérativement les omissions de réponses.
 |
17 17 |
▲back to top |
17
2.5. Contrôle de la qualité du travail sur le terrain
Comme dans toute investigation statistique, la qualité et la validité des résultats dépendent du strict respect
de la méthodologie de collecte des données. Pour cette étude, l'objectif initial était de réaliser des interviews
auprès de tous les diplômés inclus dans l'échantillon. Cependant, face à l'impossibilité d'interviewer
l'ensemble de l'échantillon, des corrections post-collecte ont été effectuées. Ces corrections visent à ajuster
les données recueillies afin de garantir qu'elles reflètent fidèlement la structure de la base de données
initiale.
Les procédures de correction post-collecte comprennent des techniques de redressement des données et des
ajustements pondérés pour compenser les non-réponses ou les biais potentiels. Ces ajustements permettent
d'assurer que les résultats de l'étude restent représentatifs et statistiquement valides. Les superviseurs et les
analystes de données ont travaillé en étroite collaboration pour identifier et corriger toute anomalie ou
incohérence dans les réponses, en utilisant des méthodes éprouvées de validation des données.
Ainsi, même lorsque l'objectif initial de l'interview complète n'a pas été atteint, les mesures correctives
appliquées garantissent une structure des données conforme à celle de la base de données initiale,
permettant ainsi d'obtenir des résultats fiables et précis.
2.6. Traitement et analyse des données
Le traitement des données statistiques a été réalisé de manière méthodique et rigoureuse. Après la collecte
des données via l'application KOBOTOOLBOX, celles-ci ont été soumises à un processus de traitement
statistique utilisant le logiciel SPSS. Ce processus comprenait la vérification de la qualité des données,
l'élimination d'éventuelles erreurs ou valeurs aberrantes, ainsi que la transformation des données brutes en
indicateurs significatifs.
L'équipe chargée du traitement des données a également veillé à respecter les normes éthiques en matière
de confidentialité et de protection des données, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité des informations
collectées. Une collaboration étroite avec les enquêteurs a été maintenue tout au long du processus pour
assurer une interprétation correcte des résultats et une réponse appropriée aux objectifs de l'étude.
L'analyse des données statistiques a été menée de manière approfondie et méthodique afin d'extraire des
informations pertinentes. Après la collecte et le traitement des données, l'équipe d'analyse a examiné la
relation entre les résultats de l'étude et les questions et préoccupations spécifiées dans les termes de
référence. Les données collectées ont été considérées comme des observations, classées et triées pour
déduire des constatations et des propositions relatives à la problématique.
 |
18 18 |
▲back to top |
18
2.7. Production du rapport provisoire
La production du rapport provisoire a été une étape cruciale pour communiquer les résultats de l'étude. Une
description détaillée des méthodes de collecte et de traitement des données a été incluse pour assurer la
transparence et la reproductibilité de l'étude. Ensuite, les résultats obtenus ont été présentés de manière
claire et concise, incluant des tableaux, des graphiques et des analyses pour illustrer les principales
constatations.
Des discussions approfondies en utilisant des résultats en lien avec les objectifs de l'étude ont été suivies
de recommandations pratiques basées sur les constatations. Enfin, une synthèse des principaux
enseignements de l'étude a été réalisée, mettant en lumière les implications pour les parties prenantes et les
futures recherches.
Le rapport provisoire a subi plusieurs cycles de révision. Une équipe de relecteurs au sein de l’ONEF a
d'abord apporté ses contributions, avant que le document soit soumis au correcteur de l’ONEF. Par la suite,
le rapport a été validé par les comités technique et scientifique de l’ONEF pour garantir l'exactitude et la
clarté des informations présentées.
Après sa validation finale lors de la réunion du comité scientifique du 09 janvier 2025, le rapport a été
présenté aux parties prenantes et diffusé auprès des différents publics cibles pour partager les résultats et
les recommandations de l’étude.
Avant de présenter les résultats de l'étude sur l'insertion professionnelle et l'employabilité des diplômés de
la FSEG et de l'IUG du Mali, promotion 2016-2019, il est essentiel de détailler la méthodologie employée
pour mener cette recherche. Celle-ci a débuté par une analyse de la traçabilité des parcours professionnels
des diplômés, examinant leur emploi, leur chômage ou leur engagement dans de nouvelles formations. Les
opinions des enseignants et du personnel administratif de la FSEG et de l'IUG ont également été recueillies.
En outre, nous avons évalué la satisfaction des employeurs vis-à-vis des diplômés (leurs employés).
Ce rapport est structuré en six sections principales couvrant les domaines suivants : (i) l'évaluation des
programmes de formation, (ii) le profil sociodémographique des diplômés, (iii) le cursus universitaire des
diplômés, (iv) la situation professionnelle des diplômés au moment de l'enquête, (v) les parcours d'insertion
professionnelle et (vi) l'employabilité des diplômés. Enfin, la conclusion et les recommandations mettront
en lumière les principaux enseignements de cette étude.
 |
19 19 |
▲back to top |
19
3.RESULTATS DE L’ETUDE
3.1. Evaluation des programmes de formation
Les données analysées dans cette section proviennent de l'enquête menée en août-septembre 2024 par
l'Observatoire national de l'emploi et de la formation (ONEF) sur l'insertion professionnelle et
l'employabilité des diplômés en sciences économiques et en gestion du Mali (cohorte 2016-2019). Cette
enquête a impliqué le personnel administratif et enseignant de la FSEG (Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion) et de l'IUG (Institut Universitaire de Gestion). Deux guides d'entretien distincts ont été
élaborés pour interroger ces deux groupes. Les informations recueillies au cours de ces entretiens ont été
transcrites et analysées, fournissant les résultats présentés dans cette section.
3.1.1. Personnel enseignant
Cette sous-section synthétise les résultats d'entretiens réalisés avec seize administrateurs de la Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) et de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG). Ces
administrateurs ont été identifiés et interrogés sur divers aspects, notamment le programme de formation et
les partenariats de leur institution d'enseignement supérieur et de recherche (IESRS). Les thèmes abordés
incluent leur évaluation de la qualité et de l’adéquation de la formation des diplômés, les besoins
d’amélioration de celle-ci, les mesures à mettre en place pour renforcer l’employabilité des diplômés, ainsi
que les initiatives visant à améliorer la qualité du personnel enseignant.
3.1.1.1. Programme de formation
Depuis 2008, le Mali a instauré le Système du Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l’enseignement
supérieur, suivant le décret N°08-790/P-RM, du 31 décembre 2008. Il a été mis en vigueur à l’IUG en 2009.
C’est à partir de 2015 que le système LMD est entré en vigueur à la Faculté des sciences économiques et
de gestion (FSEG).
L’enquête auprès des cadres des administrations universitaires de l’IUG et de la FSEG, révèle que les
formations à leurs niveaux sont dispensées suivant le référentiel élaboré par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifiques (MESRS). Selon les répondants ce référentiel répond aux
exigences des autres référentiels notamment ceux du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (CAMES) et du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest
(REESAO).
3.1.1.2. Qualité et adéquation de la formation
La totalité du personnel administratif interrogé au sein de l’IUG affirme qu’il y a une adéquation entre les
formations dispensées à l’IUG et le marché de l’emploi. Ils indiquent aussi être satisfaits, voire très satisfaits
de la qualité des diplômés formés au sein de leur institution au cours de ces dernières années. Quant à la
FSEG, 60% du personnel administratif interrogé affirment qu’il y a une adéquation entre les programmes
de formation de la FSEG et le marché du travail. Cependant, 40% affirment une inadéquation entre les
programmes dispensés et le marché de travail. Quant au niveau et la qualité des diplômés formés à la FSEG
au cours de ces dernières années, 70% des répondants affirment leur satisfaction contre 30% des répondants.
 |
20 20 |
▲back to top |
20
Par ailleurs, les répondants affirment à l’IUG qu’ils sont globalement satisfaits du volume horaire de travail
exécuté par les enseignants. Quant à la FSEG, 60% des répondants affirment une satisfaction, contre 40%
qui indiquent une insatisfaction par rapport au volume horaire de travail exécuté par les enseignants.
Dans le cadre de la diversification des programmes de formation pour une prise en compte des besoins du
secteur privé, les répondants affirment que pour la FSEG, il serait optimal de mettre en place entre autres,
(i) un cadre d’échange sur les besoins des employeurs potentiels ; (ii) l’adaptation des formations aux
mutations technologiques du moment ; (iii) et l’incitation des étudiants à opter pour les filières
entrepreneuriales.
Cependant, ils affirment que les diplômés sont confrontés à quelques difficultés pour accéder aux emplois,
notamment, le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi pour certaines filières qui disposent déjà
d'un nombre important de diplômés formés et la situation conjoncturelle qui affecte le marché de l’emploi.
3.1.1.3. Besoins d'amélioration de la formation
Afin de pouvoir améliorer la formation au niveau des Institutions d’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, les répondants proposent entre autres les recommandations suivantes :
• Pour l’IUG, nous pouvons noter le renforcement des relations avec les entreprises, en les faisant
participer à l'élaboration des programmes de formation ; et l’adaptation des contenus des
programmes aux nouvelles évolutions en cours, notamment la digitalisation.
• Quant à la FSEG, les propositions ont porté principalement sur la mise de l’accent sur la formation
pratique au cours du cursus des étudiants ; et le couplage des programmes existants avec un
programme de formation en entrepreneuriat.
3.1.1.4. Amélioration de la qualité du personnel enseignant de licence
professionnelle
En analysant la qualité du personnel enseignant, environ 80% du personnel administratif interviewé pensent
que l’IUG dispose d’une ressource humaine suffisante contre 20% qui pensent plutôt que la ressource
humaine à la disposition de l’institut n’est pas suffisante pour assurer la formation des étudiants.
Contrairement à l’IUG, 80% des répondants de la FSEG indiquent une insuffisance notoire de ressources
humaines pour la formation des étudiants contre 20% seulement, qui jugent que la ressource humaine à la
FSEG est suffisante pour assurer la formation des étudiants. Par ailleurs 70% des répondants ont exprimé
leurs insatisfactions des conditions de travail des enseignants de la FSEG, contre 30% qui estiment que les
conditions de travail actuelles sont satisfaisantes. En revanche ceux de l’IUG ont exprimé unanimement
qu’ils sont insatisfaits, voire très insatisfaits des conditions de travail des enseignants au sein de leur
établissement.
En réponse à la question sur la satisfaction du niveau de compétences des enseignants, la quasi-totalité des
répondants affirment une satisfaction quant aux compétences des enseignants qui interviennent dans la
formation des étudiants en licence. En plus, ils affirment être satisfaits de la compatibilité entre domaine
d’expertise des enseignants et les modules dispensés.
 |
21 21 |
▲back to top |
21
3.1.1.5. Réflexions sur l’amélioration de l’employabilité
Les pistes de réflexion pour l’amélioration de l’employabilité des diplômés proposées par le personnel
administratif de l’IUG vont de la collaboration avec les partenaires employeurs, à la relecture des
programmes de façon périodique en vue de leurs adaptations aux besoins du marché; mais aussi à la mise
en place de partenariats entre les structures de formation, les employeurs (État) et les entreprises privées.
En ce qui concerne la FSEG, les répondants indiquent, le développement du partenariat avec le monde privé
et la prise en compte des besoins du secteur privé dans l'élaboration des programmes de formation ; la
promotion de l’entreprenariat privé et l’instauration du programme de stage de fin de cycle à travers un
partenariat avec les employeurs privés afin d’améliorer l’employabilité des diplômés.
3.1.2. Personnel enseignant
Cette sous-section présente l'analyse des entretiens menés dans le cadre de l'enquête sur l'insertion
professionnelle et l'employabilité des diplômés en Sciences économiques et de gestion au Mali, couvrant la
cohorte 2016-2019. Au total, dix-neuf entretiens ont été réalisés auprès des enseignants de la Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) et de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG).
3.1.2.1. Programme de formation
La quasi-totalité des répondants affirment que les programmes sont établis à partir d’un référentiel.
Cependant, ils estiment que toutes les conditions ne sont pas réunies pour former les étudiants selon le
référentiel de compétences, d’où l’intérêt d’apporter des améliorations.
En réponse à la question de savoir si les programmes de formation respectent les exigences du référentiel
utilisé, 78% des enseignants de l’IUG répondent à la négation contre 22% selon lesquels les programmes
respectent au mieux les exigences du référentiel. Quant à la FSEG, 67% des répondants pensent que les
programmes respectent les exigences du référentiel contre 33%.
3.1.2.2. Qualité et adéquation de la formation
Les idées des enseignants interrogés divergent sur la question de l’adéquation entre les formations
dispensées et les emplois sur le marché du travail au sein des répondants de la FSEG. En effet, 40% des
enseignants de la FSEG estiment qu’il y a une adéquation entre les programmes de formation de la FSEG
et les besoins du marché du travail, et jugent que les contenus des programmes enseignés sont conformes
aux besoins du marché du travail; de même ils pensent que les filières de formation sont adaptées à la
demande du marché du travail.
En revanche, 60% des répondants pensent que les formations et les filières de formation de la FSEG ne sont
pas adaptées aux besoins du marché du travail, et estiment que celle-ci doivent être réorientées vers les
besoins actuels du marché. Quant aux répondants de l’IUG, ils affirment dans leur totalité qu’il y a une
adéquation entre les programmes de formation et le marché de l’emploi. En effet, les répondants affirment
que les diplômés de l’IUG sont assez sollicités sur le marché du travail et que les filières de formation
répondent parfaitement aux besoins des demandeurs de travail.
S’agissant de la satisfaction des enseignants par rapport à la qualité des diplômés au cours des trois dernières
années, les enseignants de l’IUG affirment tous être satisfaits de la qualité des étudiants formés. Pour la
 |
22 22 |
▲back to top |
22
FSEG, les avis sont partagés entre 60% pour ceux qui ont affirmé leurs satisfactions, contre 40% qui
s’estiment insatisfaits de la qualité des étudiants formés au cours des trois dernières années.
Par conséquent, les enseignants proposent quelques actions pouvant contribuer à améliorer
significativement les chances d’emplois pour les diplômés des IESRS :
Pour l’IUG, nous pouvons noter entre autres, (i) le partenariat entre le public et le privé afin de corriger les
lacunes dans les programmes de formations; (ii) la mise à jour des maquettes de formation; et (iii)
l’amélioration continue des programmes de formation et des enseignements.
Pour la FSEG, elles concernent (i) l’adaptation des filières de formation aux attentes du marché et
l’amélioration de la qualité des enseignements; (ii) et la mise en place d’une synergie d’action entre les
ISERS et les décideurs dans le cadre de l’élaboration des programmes.
3.1.2.3. Besoins d'amélioration de la formation
En vue d’améliorer les programmes de formation, pour l’employabilité et l’insertion professionnelle des
diplômés. Les répondants de l’IUG et de la FSEG ont un certain nombre de propositions :
Pour l’IUG, nous pouvons citer, la révision des programmes avec une implication du monde professionnel.
Par ailleurs, les enseignants estiment aussi qu’il sera intéressant de mener une enquête auprès des
employeurs pour une meilleure identification de leurs besoins en termes de compétences.
En outre, les répondants ont proposé l’insertion de nouveaux programmes de formation en lien avec les
innovations actuelles ; et la tenue des conseils de perfectionnement pour améliorer l’employabilité des
diplômés de l’IUG. En revanche, certains enseignants estiment déjà que les filières de l’IUG répondent déjà
aux besoins des employeurs, d’où le non nécessité d’aller vers une quelconque reforme.
Les propositions au niveau de le FSEG vont de l’adaptation des programmes de formation aux besoins du
marché avec les volumes requis, à l’amélioration des conditions dans lesquelles les enseignements sont
dispensés. En plus les enseignants de la FSEG estiment que les programmes doivent prendre en compte les
stages et formations en entreprenariat avec les employeurs afin de rechausser le taux d’insertion des
diplômés. En plus, ils estiment que les échanges avec les acteurs de l’emploi autour des programmes de
formations et l’orientation des formations uniquement vers les filières porteuses et axées plus sur les
pratiques et la culture de l’entreprenariat pourrait améliorer l’employabilité des diplômés de la FSEG.
3.1.2.4. Fonctionnalité des modules de licence professionnelle
La quasi-totalité des enseignants de l’IUG (90%) affirment que les enseignements se font conformément
aux normes établies par le ministère de tutelle de l’enseignement supérieur contre 10% qui affirment un
non-respect des normes d’enseignement. En effet les enseignants de l’IUG dans leur majorité estiment que
les volumes horaires sont suffisants pour couvrir les programmes d’enseignement.
Au niveau de la FSEG les avis divergent quant à la fonctionnalité des modules de formation. Suivant les
enquêtes, 60% des répondants affirment que les enseignements sont dispensés conformément au référentiel
défini et que les programmes enseignés permettent de donner des compétences multiples pour affronter le
marché du travail. Cependant, 10% des répondants ont indiqué un dysfonctionnement dans l’enseignement
des modules compte tenu de la pléthore d’effectif et l’insuffisance des infrastructures d’accueil. 30% ont
été sans opinion quant à la fonctionnalité des modules de formation.
 |
23 23 |
▲back to top |
23
3.1.2.5. Réflexions sur l’amélioration de l’employabilité
Les enquêtes ont permis d’identifier quelques pistes de réflexions pour améliorer l’employabilité des
diplômés de la FSEG et de l’IUG.
Pour l’IUG les pistes proposées sont entre autres : (i) la révision des programmes de formation avec
l’implication des partenaires professionnels et la formation des formateurs pour une meilleure transmission
du savoir; (ii) la réalisation des enquêtes de sondage auprès des employeurs pour une meilleure prise en
comptes du marché du travail; (iii) la mise en place des comités pédagogiques pour les unités
d’enseignement en vue d’assurer une meilleure coordination des activités pédagogiques (iv) le
renforcement des institutions d’enseignement supérieur et de recherches en équipements et personnel
qualifiés.
En ce qui concerne la FSEG, les suggestions des répondants ont plutôt porté sur : la tenue d’un diagnostic
du marché de l’emploi pour identifier les filières de formation devant faire objet d’une transformation;
l’ouverture de nouvelles filières porteuses avec la fermeture de certaines filières dont les emplois sont déjà
saturés. L’instauration d’un programme de stage obligatoire à travers le partenariat avec les entreprises
privées afin de faciliter l’acquisition d’expériences pratiques et l’accès aux emplois.
 |
24 24 |
▲back to top |
24
3.2. Profil sociodémographique des diplômés
Cette section est consacrée à la présentation des résultats concernant l’identité des diplômés, le statut
professionnel des parents et le pouvoir économique des ménages des diplômes.
3.2.1. Identité des diplômés
Sur les 4798 diplômés étudiés, une majorité réside dans le District de Bamako, qui abrite plus de 70 % des
diplômés, suivie de la région de Koulikoro avec 11,6 % et de Kayes avec 3,9 %. Les régions de Mopti,
Bougouni et Koutiala présentent chacune un faible pourcentage de 1,1 %, tandis qu’aucun diplômé n’a été
enquêté dans les régions de Kidal, Taoudéni, Nara et Douentza. Cette répartition indique que Bamako est
un pôle majeur de formation et d'emploi.
En ce qui concerne la répartition par genre, 68,8 % des hommes et 74,9 % des femmes diplômés sont basés
à Bamako. La région de Koulikoro montre une répartition quasi équitable, avec 11,7 % d'hommes et 11,6
% de femmes. En revanche, la région de Sikasso présente une proportion plus élevée d'hommes (4,0 %) par
rapport aux femmes (2,0 %). Les régions de Ségou et de Mopti affichent également des effectifs réduits,
avec une légère prédominance masculine. Tombouctou, Kidal et Taoudéni ne comptent aucun diplômé
féminin, suggérant des obstacles supplémentaires pour celles-ci.
Les régions de Ménaka et Nioro montrent des effectifs très limités, majoritairement masculins, tandis que
Kita et Bougouni présentent une tendance similaire. Enfin, la région de Bandiagara a une faible proportion
de diplômées, avec 2,1 % d'hommes contre 0,4 % de femmes, indiquant ainsi des défis similaires à ceux
relevés dans d'autres zones moins peuplées.
La répartition des diplômés par sexe et par région met en lumière une forte concentration de diplômés à
Bamako, tout en illustrant une tendance générale à une majorité masculine dans plusieurs régions.
Tableau 5 : Répartition des diplômés par sexe et région
Région
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 123 3,8 65 4,2 188 3,9
Koulikoro 378 11,7 181 11,6 559 11,6
Sikasso 130 4,0 32 2,0 162 3,4
Ségou 41 1,3 40 2,6 81 1,7
Mopti 40 1,2 13 0,9 53 1,1
Tombouctou 20 0,6 0 0,0 20 0,4
Gao 39 1,2 4 0,2 43 0,9
Kidal 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Taoudenni 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ménaka 4 0,1 0 0,0 4 0,1
Nioro 16 0,5 0 0,0 16 0,3
Kita 35 1,1 24 1,5 59 1,2
Dioïla 7 0,2 0 0,0 7 0,1
Nara 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bougouni 45 1,4 5 0,3 50 1,1
Koutiala 46 1,4 8 0,5 54 1,1
San 19 0,6 12 0,8 31 0,6
Douentza 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bandiagara 67 2,1 7 0,4 74 1,5
Bamako 2226 68,8 1171 74,9 3397 70,8
Ensemble 3236 100,0 1562 100,00 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
25 25 |
▲back to top |
25
L’analyse des données relatives aux tranches d’âges des diplômés montre que la plupart des diplômés de la
FSEG et de l’IUG sont des jeunes âgés de 25 à 34 ans, avec une majorité d’hommes. Les femmes sont
toutefois proportionnellement plus nombreuses dans les tranches d’âge extrêmes (20-24 ans et plus de 34
ans).
Tableau 6 : Répartition des diplômés selon l’âge et sexe
Tranche d’âge
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
20-24 ans 66 2,1 52 3,3 118 2,5
25-34 ans 3168 97,9 1503 96,2 4671 97,3
Plus de 34 ans 2 0,1 7 0,5 9 0,2
Ensemble 3236 100,0 1562 100,0 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Dans la population des diplômés étudiés, 61 % sont célibataires et 39 % mariés. Chez les hommes, 70,9 %
se déclarent célibataires, ce qui pourrait s'expliquer par des choix de vie façonnés par des facteurs
économiques, culturels ou éducatifs.
En effet, les hommes diplômés ont tendance à donner la priorité à leur carrière avant de s'engager dans le
mariage. Contrairement aux femmes, la priorité semble être donner au mariage après la fin de la formation,
soit 59,5% sont engagées dans un mariage. Le très faible pourcentage de divorcés ou de séparés, qui s'établit
à seulement 0,1 % chez les femmes, pourrait témoigner soit d'une stabilité significative dans les mariages,
soit d'un manque d'informations sur ce statut. Il est essentiel de garder à l'esprit que ces données reflètent
la situation à un moment donné et que le statut matrimonial de ces individus peut évoluer avec le temps.
Tableau 7 : Proportion des diplômés selon le statut matrimonial et sexe
Statut
matrimonial
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Célibataire 2295 70,9 632 40,4 2927 61,0
Marié(e) 941 29,1 929 59,5 1870 39,0
Divorcé/séparé (e) 0 0,0 1 0,1 1 0,0
Ensemble 3236 100,0 1562 100,0 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Le tableau ci-dessous met en évidence une forte concentration des diplômés dans certaines filières à la
FSEG, tandis que l'IUG se distingue par une spécialisation dans des domaines liés à l'entrepreneuriat et à
la gestion organisationnelle. La majorité des diplômés provient des filières de la FSEG, avec un total de 4
535 étudiants, alors que l'IUG en compte seulement 263. Cette concentration élevée de diplômés dans les
filières classiques de la FSEG pourrait avoir un impact sur leur insertion professionnelle, tandis que les
diplômés de l'IUG, formés dans des domaines plus spécifiques, pourraient bénéficier d’opportunités
différentes, notamment dans l'entrepreneuriat et la gestion.
Tableau 8 : Répartition des diplômés par filière et IESRS
Filière
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Assurance banque finances 1122 24,7 0 0,0 1122 23,4
Economie 1679 37,0 0 0,0 1679 35,0
Gestion 1734 38,2 0 0,0 1734 36,1
Création et gestion d’entreprises 0 0,0 118 44,9 118 2,5
Organisation et gestion des organisations 0 0,0 77 29,3 77 1,6
Sciences et techniques commerciales 0 0,0 68 25,9 68 1,4
Ensemble 4535 100,0 263 100,0 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
26 26 |
▲back to top |
26
3.2.2. Statut socio-professionnel des parents
Le graphique ci-dessous met en lumière des disparités significatives entre les pères et les mères des
diplômés de l'IUG et de la FSEG. Les pères sont majoritairement en emploi (36,2 %) ou à la retraite (16,1
%), tandis qu'une proportion importante (22,4 %) est sans emploi. En revanche, les mères sont largement
sans emploi (65,9 %), avec une très faible part en retraite (2,6 %). Le taux de décès des pères (25,3 %) est
également bien plus élevé que celui des mères (6,7 %), suggérant des différences d'espérance de vie et de
participation économique entre les sexes. Ces chiffres révèlent des inégalités de genre marquées, tant en
termes d'accès à l'emploi que de conditions de vie.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 1 : Proportion des diplômés selon le statut des deux parents (%)
On constate que la majorité des pères (44,4 %) et des mères (57,6 %) sont des travailleurs indépendants, ce
qui suggère une forte présence de l'auto-emploi ou de l'entrepreneuriat informel. Parmi les pères, 21,4 %
occupent des postes de cadres supérieurs ou d'ingénieurs, contre seulement 7,6 % des mères, ce qui met en
évidence une sous-représentation féminine dans ces fonctions de haut niveau. Cependant, les mères sont
plus nombreuses dans la catégorie des "cadres moyens et agents de maîtrise" (22,4 %) que les pères (14,2
%), suggérant une différence dans les responsabilités professionnelles entre les sexes.
36,2%
22,4%
16,1%
25,3%24,7%
65,9%
2,6%
6,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Emploi Sans emploi Retraité Décédé
Père Mère
 |
27 27 |
▲back to top |
27
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 2 : Proportion des diplômés selon la catégorie socioprofessionnelle des deux parents (%)
3.2.3. Pouvoir économique des ménages des diplômés
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des diplômés selon la taille du ménage et le sexe, mettant en
lumière des différences significatives entre les situations familiales des hommes et des femmes diplômés.
Dans les ménages de moins de 5 personnes, les femmes représentent une proportion plus élevée (44,7 %)
par rapport aux autres catégories, tandis que les hommes constituent 55,3 % de ce groupe. Cela pourrait
suggérer que les femmes diplômées vivent plus souvent dans des ménages de taille réduite. En ce qui
concerne les ménages de 5 à 10 personnes, les hommes sont largement majoritaires (67,1 %), contre 32,9
% pour les femmes. Cela indique que les hommes diplômés sont plus enclins à vivre dans des ménages de
taille moyenne. Pour les ménages de plus de 10 personnes, on observe une forte prédominance masculine,
avec 75,4 % d'hommes diplômés contre 24,6 % de femmes. Cela laisse penser que les hommes diplômés
sont plus nombreux à vivre dans des familles nombreuses.
En résumé, les données révèlent que les hommes diplômés tendent à vivre dans des ménages plus grands
(5 personnes ou plus), tandis que les femmes sont davantage présentes dans des ménages plus petits. Ce
lien entre la taille du ménage et le sexe des diplômés peut refléter des facteurs culturels ou sociaux
influençant la répartition des responsabilités familiales et l'environnement de vie des diplômés. Ces
dynamiques familiales pourraient également jouer un rôle dans leur parcours professionnel et leur insertion
sur le marché du travail.
Tableau 9 : Nombre de personnes dans le ménage selon le sexe du diplômé
Personnes dans le ménage
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Moins de 5 personnes 518 55,3 418 44,7 936 100,0
5 à 10 personnes 1571 67,1 769 32,9 2340 100,0
Plus de 10 personnes 1147 75,4 375 24,6 1522 100,0
Ensemble 3236 67,4 1562 32,6 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
21,4%
14,2%
7,3%
3,5%
3,4%
2,8%
44,4%
0,8%
0,0%
2,3%
7,6%
22,4%
5,0%
1,9%
0,7%
1,6%
57,6%
1,7%
1,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
Cadre moyen, agent de maîtrise
Employé, ouvriers qualifiés
Employé, ouvrier semi qualifié
Manœuvre
Patron, employeur
Travailleur à son propre compte
Associé
Apprenti
Aide familial
Mère Père
 |
28 28 |
▲back to top |
28
Les données du graphique ci-dessus montrent la répartition des diplômés de la FSEG et de l’IUG au Mali
selon la taille du ménage et la filière de formation. Chaque filière présente des tendances spécifiques quant
à la composition des ménages, ce qui permet de dégager certaines observations intéressantes.
Globalement, 48,8 % des diplômés vivent dans des ménages de taille moyenne, tandis que 31,7 % se
trouvent dans des ménages de plus de 10 personnes, et 19,5 % dans des ménages plus petits. Les filières
qui attirent davantage d’entrepreneurs, comme la Création et gestion d’entreprises, présentent une
proportion plus élevée de diplômés vivant dans de petits ménages, tandis que les filières, telles que
l’Assurance Banque Finances et l’Économie, ont une répartition plus marquée dans les ménages de taille
moyenne à grande. Ces différences peuvent avoir des répercussions sur les modes de vie et les
responsabilités familiales des diplômés, influençant potentiellement leur parcours professionnel et leurs
choix d’insertion sur le marché du travail.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 3 : Proportion de personnes dans le ménage selon la filière de formation du diplômé (%)
Dans l'ensemble, 67,4 % des diplômés proviennent de ménages avec une majorité d'hommes actifs
économiquement, contre 32,6 % de femmes. Les hommes diplômés sont majoritairement issus de ménages
avec un plus grand nombre de personnes exerçant une activité économique, en particulier dans les familles
comptant de 2 à 10 personnes actives. À l'inverse, les femmes diplômées semblent plus souvent provenir
de ménages avec un seul membre économiquement actif ou de ménages de taille moyenne (2 à 5 personnes).
Ces données montrent que les hommes diplômés vivent souvent dans des ménages où plusieurs personnes
contribuent économiquement, ce qui pourrait leur offrir une certaine stabilité ou un soutien économique
supplémentaire. En revanche, les femmes diplômées sont plus fréquemment issues de ménages où l’activité
économique est concentrée entre une ou deux personnes, ce qui pourrait avoir des répercussions sur leur
indépendance économique et sur la manière dont elles abordent le marché du travail. Cette situation peut
également influencer leurs opportunités professionnelles et les dynamiques familiales qui les entourent.
16,4%
18,2%
22,2%
29,7%
27,3%
7,4%
19,5%
52,7%
44,3%
51,0%
46,6%
39,0%
54,4%
48,8%
30,9%
37,5%
26,8%
23,7%
33,8%
38,2%
31,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Moins de 5 personnes 5 à 10 personnes Plus de 10 personnes
 |
29 29 |
▲back to top |
29
Tableau 10 : Répartition des diplômés selon le nombre de personnes exerçant une activité économique dans le ménage
Personnes exerçant une activité économique
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Une seule personne 1072 62,40 646 37,60 1718 100,00
2 à 5 personnes 1679 68,80 763 31,20 2442 100,00
5 à 10 personnes 440 76,70 134 23,30 574 100,00
Plus de 10 personnes 45 69,60 19 30,40 64 100,00
Ensemble 3235 67,40 1562 32,60 4798 100,00
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
En considérant l'ensemble des filières, on observe que 50,9 % des diplômés proviennent de ménages avec
2 à 5 personnes économiquement actives, tandis que 35,8 % vivent dans des ménages avec une seule
personne active. Les ménages avec 5 à 10 actifs représentent 12 %, et ceux avec plus de 10 actifs seulement
1,3 %. Ces données montrent une tendance générale où les diplômés des sciences économiques et de gestion
viennent majoritairement de ménages de taille moyenne, avec une légère prédominance pour les ménages
plus petits dans certaines filières comme la Gestion et la Création et gestion d'entreprises, ce qui pourrait
avoir un impact sur leur approche du marché du travail et leur capacité à soutenir financièrement des
ménages plus restreints.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 4 : Proportion de personnes exerçant une activité économique dans le ménage selon la filière (%)
Sur l’ensemble des diplômés, 67,4 % sont des hommes et 32,6 % des femmes, ce qui reflète la composition
générale de la population étudiée. Il apparaît que la majorité des diplômés n’ont pas d’enfants à charge, et
que parmi ceux qui en ont, la répartition des responsabilités parentales entre hommes et femmes est
relativement équilibrée dans la catégorie "1 à 5 enfants". Cependant, dans les catégories "pas d'enfants" et
"plus de 5 enfants", les hommes prédominent.
Les différences observées pourraient refléter des disparités socioculturelles qui influencent la prise de
responsabilités parentales chez les diplômés. Les femmes diplômées sont légèrement plus nombreuses dans
la catégorie des "1 à 5 enfants", ce qui peut suggérer que les femmes jonglent plus souvent entre leur carrière
et leurs obligations parentales. Ces différences de responsabilités familiales peuvent avoir des implications
sur la disponibilité et les choix de carrière des diplômés, les femmes, en particulier, pouvant être confrontées
à des défis spécifiques en matière d’équilibre entre travail et famille. Les diplômés masculins, bien qu’ils
31,9%
30,8%
42,8%
46,3%
35,2%
27,5%
35,8%
48,8%
54,9%
48,2%
43,3%
61,1%
55,0%
50,9%
17,4%
13,4%
7,4%
9,0%
3,7%
17,5%
12,0%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Une seule personne 2 à 5 personnes 5 à 10 personnes Plus de 10 personnes
 |
30 30 |
▲back to top |
30
soient majoritaires dans les catégories "pas d’enfants" et "plus de 5 enfants", semblent bénéficier d'une plus
grande flexibilité quant à la gestion des responsabilités familiales. Ces dynamiques peuvent également
influencer leur insertion professionnelle, en particulier pour ceux qui doivent concilier famille et travail.
Tableau 11 : Répartition des diplômés selon le nombre d'enfants à leur charge dans le ménage
Enfants en charge
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Pas d'enfants en charge 2435 76,3 757 23,7 3192 100,0
1 à 5 enfants 788 49,7 798 50,3 1586 100,0
Plus de 5 enfants 13 66,5 7 33,5 20 100,0
Ensemble 3236 67,4 1562 32,6 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
En prenant l’ensemble des filières, 66,5 % des diplômés n’ont pas d’enfants à charge, tandis que 33,1 %
ont entre 1 et 5 enfants, et seulement 0,4 % ont plus de 5 enfants. Cela montre une prédominance des
diplômés sans responsabilités parentales, en particulier dans les filières comme Création et Gestion
d’Entreprises. Les filières où une proportion plus importante de diplômés a des enfants, comme Sciences
et Techniques Commerciales, peuvent indiquer que ces étudiants ont une plus grande maturité ou ont atteint
un stade de leur vie où ils combinent vie professionnelle et responsabilités familiales.
Les différences dans les responsabilités familiales selon les filières pourraient influencer les trajectoires
professionnelles des diplômés. Par exemple, les filières comme Création et Gestion d’Entreprises semblent
favoriser les individus sans enfants, probablement en raison des exigences élevées en termes de temps et
d'investissement personnel. En revanche, les filières comme Sciences et Techniques Commerciales ou
Économie, où une plus grande proportion de diplômés a des enfants, pourraient offrir davantage de
flexibilité ou attirer des individus ayant déjà des responsabilités familiales. Ces facteurs pourraient avoir un
impact sur l'insertion professionnelle et les choix de carrière des diplômés, en fonction de leurs obligations
familiales.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 5 : Proportion de diplômés selon le nombre d'enfants à leur charge par filière (%)
67,6%
65,6%
65,8%
82,1%
66,7%
62,5%
66,5%
32,4%
34,0%
33,5%
17,9%
33,3%
37,5%
33,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Pas d'enfants en charge 1 à 5 enfants Plus de 5 enfants
 |
31 31 |
▲back to top |
31
3.3. Cursus universitaires des diplômés
L'analyse des parcours scolaires des diplômés se concentrera exclusivement sur le choix des filières à la
FSEG et à l'IUG, les stages réalisés durant leur formation et l'appréciation de celle-ci par les diplômés.
3.2.1. Choix de la formation
En ce qui concerne le choix de leur formation, une vaste majorité des diplômés (94,4%) ont opté pour un
parcours correspondant à leurs propres choix. En revanche, une minorité a suivi des recommandations,
3,2% sur la suggestion d'un parent et 1,1% grâce à des relations personnelles. De plus, les influences
extérieures telles que celles des formateurs, des employeurs, ainsi que la publicité et les réseaux sociaux,
demeurent marginales, avec des proportions respectives de 0,5%, 0,3% et 0,1%. Il est également notable
que 0,4% des diplômés ont fait leur choix par le biais d'autres moyens.
Par ailleurs, il semble que les femmes soient davantage influencées par des suggestions parentales, ce qui
pourrait indiquer une dynamique familiale différente selon le genre. Ainsi, bien que les influences familiales
jouent un rôle, les décisions de formation semblent principalement être le fruit d'un choix personnel.
Tableau 12 : Répartition des diplômés selon le choix de formation et le sexe
Choix de formation
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Choix personnel 3086 95,4 1444 92,4 4530 94,4
Relation personnelle 33 1,0 18 1,1 51 1,1
Suggestion d'un parent 62 1,9 94 6,0 156 3,2
Suggestion d’un formateur 16 0,5 6 0,4 22 0,5
Suggestion d’un employeur 13 0,4 0 0,0 13 0,3
Publicité et réseaux sociaux 7 0,2 0 0,0 7 0,1
Autre 19 0,6 0 0,0 19 0,4
Ensemble 3236 100,0 1562 100,0 4798 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
En considérant l’ensemble des diplômés, on note que 94,4 % des diplômés déclarent avoir fait leur choix
de formation par un motif personnel, ce qui est très encourageant en termes d’engagement et de motivation.
Les autres motifs, tels que les suggestions familiales ou l’influence des formateurs, restent en retrait, bien
qu'ils montrent que des facteurs externes peuvent influencer certains groupes, en particulier dans des
domaines comme l’Organisation et Gestion des Organisations.
Ces choix de formation peuvent être directement liés aux parcours professionnels futurs des diplômés. Un
choix personnel peut suggérer une plus grande satisfaction au travail et une meilleure intégration
professionnelle, tandis qu'un choix influencé par des relations personnelles ou des recommandations peut
indiquer un cheminement moins autonome. Ainsi, l'importance du choix personnel dans la formation
pourrait également avoir des répercussions sur l’insertion professionnelle, les diplômés plus autonomes
étant probablement plus résilients face aux défis du marché du travail.
Les choix de formation des diplômés des différentes filières sont majoritairement influencés par des
motivations personnelles, soulignant l'importance de l'intérêt et de la passion dans le parcours académique.
Cependant, certaines filières, comme Organisation et Gestion des Organisations, montrent une influence
plus forte des relations personnelles et des recommandations familiales, suggérant une dynamique
différente qui pourrait influencer les perspectives de carrière et d'insertion professionnelle des diplômés
dans ces domaines.
 |
32 32 |
▲back to top |
32
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 6 : Proportion de diplômés selon le choix de formation et le sexe par filière (%)
3.2.2. Stage au moment de la formation
Seulement 28,2 % des diplômés ont rapporté avoir participé à des stages pratiques, ce qui montre que peu
d’étudiants ont eu l'occasion d'acquérir une expérience pratique durant leur formation. En revanche, une
majorité notable de 71,8 % des répondants n'a pas effectué de stages. Ce chiffre élevé soulève des
inquiétudes quant à l'équilibre entre la formation théorique et pratique. Il est crucial que les programmes de
formation offrent davantage d'opportunités pratiques pour développer les compétences des apprenants et
améliorer leur employabilité.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 7 : Stage des diplômés au moment (%)
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Choix personnel Relation personnelle Suggestion d'un parent Suggestion d’un formateur
Suggestion d’un employeur Publicité et réseaux sociaux Autre
28,2
71,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Ayant fait des stages pratiques N'ayant pas fait de stages pratiques
 |
33 33 |
▲back to top |
33
Les modes d’obtention des stages sont étroitement liés aux choix de formation et à l'insertion
professionnelle des diplômés. La prédominance des diplômés qui trouvent leur stage par une démarche
personnelle témoigne d'une volonté d'engagement et d'initiative, ce qui pourrait être lié à un choix de
formation en accord avec leurs intérêts.
En somme, ces modes d’obtention révèlent des différences marquées entre les sexes, avec des implications
significatives pour l'insertion professionnelle des diplômés. Les hommes semblent plus proactifs dans leur
recherche de stages, tandis que les femmes comptent davantage sur leurs réseaux personnels. Cela souligne
la nécessité d'initiatives spécifiques visant à renforcer l'autonomie des diplômés, notamment des femmes,
afin de les préparer efficacement aux réalités du marché du travail et de les aider à surmonter les obstacles
liés aux inégalités de genre dans l'accès aux opportunités professionnelles.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 8 : Proportion des modes d'obtention du stage au cours de la formation selon le sexe des diplômés (%)
Les modes d’obtention des stages varient selon les filières, révélant des différences importantes dans les
stratégies adoptées par les diplômés en fonction de leur domaine d’études. La majorité des diplômés, quel
que soit leur domaine, obtiennent leur stage par une démarche personnelle. Cette tendance est
particulièrement prononcée dans les filières comme la Création et gestion d’entreprises (64,6 %) et
Assurance banque finances (53,7 %), reflétant une forte initiative individuelle.
En parallèle, les relations personnelles jouent un rôle clé dans des filières comme la Gestion (60,5 %) et
l'Économie (52,5 %). Cela souligne l'importance des réseaux sociaux et professionnels pour ces diplômés
dans l’obtention de leur stage.
Par ailleurs, l'importance de l’établissement de formation et de l’établissement de stage varie également.
Par exemple, les diplômés en Sciences et techniques commerciales bénéficient largement de l’appui de leur
établissement de formation (32,4 %), tandis que cette option reste marginale dans d’autres filières.
Globalement, ces données montrent que les stratégies d’obtention de stages diffèrent selon les filières, ce
qui pourrait influencer l’insertion professionnelle des diplômés. Celles-ci révèlent aussi que certaines
63,5%
50,7%
2,2%
4,2%
1,3%
0,0%
55,2%
61,0%
1,7%
3,4%
6,0%
1,1%
60,5%
54,5%
2,0%
3,9%
3,0%
0,4%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Démarche personnelle
Relation personnelle
Formateur
Etablissement de formation
Etablissement de stage
Autre
Ensemble Femme Homme
 |
34 34 |
▲back to top |
34
filières nécessitent une plus grande autonomie, tandis que d’autres permettent de tirer davantage parti des
réseaux ou du soutien institutionnel.
Tableau 13 : Proportion des modes d'obtention du stage au cours de la formation selon la filière des diplômés (%)
Mode
d'obtention
Assurance
banque
finances
Economie Gestion Création et
gestion
d’entreprises
Organisation
et gestion des
organisations
Sciences et
techniques
commerciales
Ensemble
Démarche
personnelle
53,7 60,7 58,0 64,6 50,0 97,3 60,5
Relation
personnelle
63,4 52,5 60,5 38,5 50,0 13,5 54,5
Formateur 2,4 1,6 2,5 1,5 0,0 0,0 2,0
Etablissement
de formation
2,4 3,3 2,5 0,0 0,0 32,4 3,9
Etablissement
de stage
14,6 1,6 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0
Autre 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,4
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
3.2.3. Évaluation de la formation par les diplômés
Les données du tableau ci-dessous montrent la satisfaction des diplômés de la Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion (FSEG) et de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG) en ce qui concerne leur
formation, en mettant en avant quelques différences notables entre les deux institutions.
Concernant l'adaptation des programmes de formation au marché de l'emploi, les deux institutions affichent
des taux de satisfaction presque identiques : 91,3 % pour la FSEG et 91,2 % pour l'IUG. Toutefois, un
pourcentage légèrement plus élevé de diplômés de l'IUG exprime un désaccord (8,8 % contre 7,1 % à la
FSEG). Cette similitude dans les perceptions indique que, globalement, les deux institutions offrent des
programmes perçus comme étant en phase avec les besoins du marché.
En ce qui concerne la préparation des diplômés à un emploi actuel ou futur, les résultats sont également
proches entre les deux établissements, avec un taux d'accord de 91,4 % pour l'ensemble. Les diplômés de
l'IUG (92,4 %) se montrent légèrement plus satisfaits que ceux de la FSEG (91,3 %). Cela pourrait refléter
une meilleure perception de l'adéquation entre la formation à l'IUG et les compétences requises pour le
marché du travail.
Quant à la qualité des cours magistraux et des travaux dirigés, une majorité des diplômés des deux
institutions est d'accord, bien que l'IUG enregistre un taux d'accord légèrement plus élevé (92,5 %) que la
FSEG (91,6 %). Cette légère différence pourrait témoigner de la perception d'une meilleure organisation
pédagogique à l'IUG.
Un écart plus marqué apparaît lorsqu'il s'agit de l'évaluation des enseignants par les apprenants. À l'IUG,
85,0 % des diplômés affirment avoir eu la possibilité d’évaluer leurs enseignants, contre 76,0 % à la FSEG.
Ce résultat pourrait signaler une plus grande implication des étudiants de l'IUG dans le processus
d’amélioration continue de la qualité de l’enseignement.
Bien que les diplômés de la FSEG et de l'IUG expriment des niveaux de satisfaction généralement similaires
sur la plupart des critères, ceux de l'IUG semblent légèrement plus satisfaits sur certains aspects, tels que la
préparation à l’emploi et l’opportunité d’évaluer les enseignants. Ces résultats suggèrent que les approches
pédagogiques et le lien avec le marché du travail sont perçus de manière quelque peu différente entre ces
deux institutions, avec une légère préférence des diplômés de l'IUG.
 |
35 35 |
▲back to top |
35
Tableau 14 : Satisfaction des diplômés par rapport à la formation selon l’IESRS (%)
Degré de satisfaction FSEG IUG Ensemble
Les programmes de formation étaient adaptés au marché de l'emploi Désaccord 7,1 8,8 7,2
Accord 91,3 91,2 91,3
Ne sait pas 1,5 0,0 1,5
La formation m'a bien préparé pour un emploi actuel ou futur Désaccord 6,8 7,0 6,8
Accord 91,3 92,4 91,4
Ne sait pas 1,8 0,7 1,8
Les cours magistraux et les travaux dirigés étaient de qualité, tant en
contenu qu'en pertinence et diversité
Désaccord 6,2 7,5 6,2
Accord 91,6 92,5 91,7
Ne sait pas 2,2 0,0 2,1
Les apprenants évaluent les enseignants
Désaccord 18,3 14,3 18,1
Accord 76,0 85,0 76,5
Ne sait pas 5,7 0,7 5,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Concernant l'adaptation des programmes de formation au marché de l'emploi, une large majorité des
diplômés se dit satisfaite, avec 91,3 % d'entre eux en accord. Toutefois, une légère différence est observée
entre les sexes : 92,8 % des femmes contre 90,6 % des hommes sont d'avis que les programmes étaient bien
adaptés. Ce constat suggère que les femmes perçoivent une meilleure adéquation entre leur formation et les
exigences du marché du travail.
En ce qui concerne la préparation à un emploi actuel ou futur, 96,0 % des femmes estiment que leur
formation les a bien préparées, contre 89,1 % des hommes. Cette différence significative pourrait indiquer
que les femmes diplômées se sentent plus confiantes quant à leur capacité à s'insérer dans le monde du
travail.
Pour ce qui est de la qualité des cours magistraux et des travaux dirigés, les deux sexes partagent une
opinion similaire, avec 93,0 % des femmes et 91,0 % des hommes exprimant leur satisfaction. Cela montre
un consensus général quant à la pertinence et à la diversité du contenu pédagogique.
Cependant, l’évaluation des enseignants par les apprenants montre un niveau de satisfaction plus mitigé.
Seuls 76,5 % des diplômés sont d'accord sur le fait qu'ils ont eu l'opportunité d'évaluer leurs enseignants,
avec des taux légèrement plus faibles pour les femmes (75,2 %) que pour les hommes (77,1 %). Ce point
pourrait soulever des questions sur la participation active des étudiants dans l'amélioration continue de
l'enseignement.
Ces résultats globaux révèlent un haut degré de satisfaction chez les diplômés quant à leur formation, bien
que les femmes semblent généralement plus satisfaites, en particulier en ce qui concerne la préparation à
l'emploi et l'adaptation des programmes au marché. Cette tendance pourrait indiquer une différence dans la
perception des opportunités professionnelles ou dans la qualité de l'accompagnement reçu pendant la
formation.
 |
36 36 |
▲back to top |
36
Tableau 15 : Satisfaction des diplômés par rapport à la formation selon le sexe (%)
Degré de satisfaction
Sexe
Homme Femme Ensemble
Les programmes de formation étaient adaptés au marché de l'emploi
Désaccord 8,0 5,6 7,2
Accord 90,6 92,8 91,3
Ne sait pas 1,4 1,6 1,5
La formation m'a bien préparé pour un emploi actuel ou futur
Désaccord 8,6 3,2 6,8
Accord 89,1 96,0 91,4
Ne sait pas 2,3 0,8 1,8
Les cours magistraux et les travaux dirigés étaient de qualité, tant en
contenu qu'en pertinence et diversité
Désaccord 6,9 5,0 6,2
Accord 91,0 93,0 91,7
Ne sait pas 2,1 2,1 2,1
Les apprenants évaluent les enseignants
Désaccord 18,7 16,8 18,1
Accord 77,1 75,2 76,5
Ne sait pas 4,3 7,9 5,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
37 37 |
▲back to top |
37
3.4. Situation actuelle des diplômés sur le marché du
travail
Cette section se concentrera sur l'analyse de la situation des diplômés sur le marché du travail au moment
de l’enquête, en examinant les aspects liés à l'emploi, au chômage, à l'inactivité et à la reprise de formation.
En outre, une analyse de la sous-utilisation de la main-d'œuvre sera proposée, en mettant l'accent sur la
dévalorisation du capital humain et l'adéquation verticale des compétences.
3.4.1. Emploi
L'emploi peut être défini comme un contrat entre deux parties, l'employeur et l'employé, pour la réalisation
d'un travail en échange d'une rémunération, dans le cadre d'une profession. Pour un travailleur indépendant,
il s'agit de la réalisation de multiples contrats implicites ou explicites dans l'exercice de sa profession.
3.4.1.1. Taux d’insertion
Le taux d'insertion des diplômés représente la proportion de diplômés employés au moment de l'enquête,
par rapport à l'ensemble de la population étudiée. Il constitue un indicateur clé du niveau de participation
des diplômés au marché du travail. Un taux d'insertion élevé reflète une forte implication des diplômés dans
des activités productives.
Les données présentées mettent en évidence une différence notable entre les taux d'insertion professionnelle
des hommes et des femmes diplômés de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) et de
l’Institut Universitaire de Gestion (IUG). Le taux d'insertion des hommes s'élève à 79,5 %, tandis que celui
des femmes est nettement inférieur, à 49,9 %, conduisant à un taux global de 69,9 %.
Cette disparité entre les sexes peut être attribuée à des inégalités persistantes sur le marché du travail, où
les femmes font face à des obstacles plus importants pour accéder à l'emploi après leur formation. Ces
obstacles peuvent inclure des stéréotypes de genre, une répartition traditionnelle des rôles, ou encore des
responsabilités familiales plus lourdes pour les femmes.
Cette situation souligne la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour favoriser l'insertion
professionnelle des femmes, notamment en promouvant des politiques plus inclusives et en assurant une
égalité des chances dans l'accès à l'emploi.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 9 : Taux d’insertion selon le sexe
79,5%
49,9%
69,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Homme Femme Ensemble
 |
38 38 |
▲back to top |
38
Le taux d'insertion professionnelle par Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESRS)
reflète l'intégration des diplômés sur le marché du travail en fonction de leur institution de formation. Ces
taux mesurent la proportion de diplômés employés au moment de l'enquête par rapport à l'ensemble des
diplômés de chaque institution.
Les résultats montrent une similarité entre les deux institutions observées. Le taux d'insertion des diplômés
de la FSEG est de 69,9 %, tandis que celui des diplômés de l'IUG est légèrement inférieur, à 69,5 %. Le
taux global d'insertion pour l'ensemble des diplômés de la FSEG et de l’IUG s'établit à 69,9 %.
Cette uniformité relative entre les institutions suggère que, bien que les parcours académiques puissent
varier, l'impact de ces institutions sur l'insertion des diplômés semble être similaire. Toutefois, il est
important d'explorer d'autres facteurs, tels que la qualité de l’emploi pour approfondir l’analyse.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 10 : Taux d’insertion par IESRS
L’analyse du taux d'insertion professionnelle par filière de formation met en lumière des disparités notables
entre les différentes spécialités. Ces taux mesurent la proportion de diplômés employés au moment de
l'enquête, reflétant ainsi l'adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché du travail.
Les résultats montrent que la filière « Organisation et gestion des organisations » enregistre le taux
d'insertion le plus élevé, avec 79,6 %, suivie des filières « Économie » (73,5 %) et « Sciences et techniques
commerciales » (72,5 %). Ces chiffres indiquent que les diplômés de ces filières ont une meilleure
intégration sur le marché du travail, ce qui pourrait être lié à une forte demande pour leurs compétences
spécifiques ou à un réseau professionnel plus structuré.
En revanche, les filières comme « Création et gestion d'entreprises » (61,2 %) et « Gestion » (65,0 %)
présentent des taux d'insertion plus bas. Cela pourrait indiquer que les diplômés de ces filières rencontrent
davantage des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel, probablement en raison de la saturation
du marché ou d’une concurrence plus forte.
L’ensemble des filières montre un taux d’insertion global de 69,9 %, ce qui reflète une bonne intégration
des diplômés en sciences économiques et de gestion sur le marché de l’emploi. Cependant, les disparités
entre les filières soulignent l’importance de diversifier les approches d’accompagnement et d'adapter les
programmes de formation aux réalités spécifiques du marché de chaque secteur.
69,9%
69,5%
69,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
FSEG
IUG
Ensemble
 |
39 39 |
▲back to top |
39
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 11 : Taux d’insertion par filière de formation
L'analyse du taux d'insertion professionnelle des diplômés en fonction de la situation actuelle des parents
révèle des variations subtiles mais intéressantes. Ces taux illustrent la proportion de diplômés employés au
moment de l'enquête, en tenant compte de l'emploi, du statut de retraité, ou du décès des parents.
Globalement, les diplômés dont les parents sont en emploi affichent un taux d'insertion légèrement
supérieur pour les mères (70,5 %) par rapport aux pères (69,9 %). Ce résultat peut s'expliquer par l'influence
potentielle des mères actives sur l'aspiration professionnelle et l'autonomie des diplômés, notamment dans
un contexte où le soutien familial joue un rôle important.
Les diplômés dont les parents sont sans emploi présentent des taux légèrement plus élevés pour les pères
(72,6 %) que pour les mères (69,8 %). Cela pourrait traduire une pression économique plus forte sur ces
jeunes à entrer sur le marché du travail.
Les taux d’insertion pour les diplômés dont les parents sont retraités ou décédés montrent des résultats
comparables (environ 65 % à 70 %), ce qui suggère que la situation économique des parents n'a pas de lien
significatif avec les résultats professionnels des diplômés dans ces cas.
Dans l’ensemble, le taux d’insertion reste relativement stable (69,9 %), quelle que soit la situation parentale.
Ces résultats indiquent que, bien que le soutien familial soit important, la situation professionnelle des
parents n’est pas un facteur déterminant de l’insertion professionnelle des diplômés de la FSEG et de l’IUG.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 12 : Taux d’insertion selon la situation actuelle des parents des diplômés
61,2%
65,0%
72,0%
72,5%
73,5%
79,6%
69,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Création et gestion d’entreprises
Gestion
Assurance banque finances
Sciences et techniques commerciales
Economie
Organisation et gestion des organisations
Ensemble
69,9%
72,6%
64,6%
70,6% 69,9%
70,5%
69,8%
65,6%
69,4%
69,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Emploi Sans emploi Retraité Décédé Ensemble
Père Mère
 |
40 40 |
▲back to top |
40
3.4.1.2. Statut dans l’activité
Le tableau ci-dessous sur la répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l'activité et le sexe
révèle des différences significatives dans les rôles occupés par les hommes et les femmes sur le marché du
travail.
En ce qui concerne les salariés, les hommes représentent 54,9 % des diplômés en emploi, contre 40,1 %
pour les femmes. Cette disparité pourrait refléter un accès plus limité des femmes aux postes salariés,
potentiellement en raison de facteurs liés à la discrimination ou aux rôles traditionnels dans le milieu
professionnel.
Par ailleurs, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à exercer en tant qu'indépendantes ou
patronnes, avec 51,4 % contre 37,0 % pour les hommes. Cela pourrait s'expliquer par une plus grande
tendance des femmes à entreprendre des activités indépendantes, peut-être en raison d'une flexibilité
recherchée face aux responsabilités familiales, ou d'un manque d'opportunités salariées.
Enfin, le pourcentage de diplômés occupant un statut d'aide familial reste faible pour les deux sexes (8,1 %
pour les hommes et 8,5 % pour les femmes), ce qui montre une part limitée de diplômés se tournant vers
ce type d'activité.
Dans l’ensemble, ces données soulignent la persistance de disparités entre les sexes en termes de statut dans
l'activité. Les hommes dominent les emplois salariés, tandis que les femmes tendent à se diriger vers des
activités indépendantes, ce qui indique une nécessité d'encourager une plus grande égalité dans l'accès aux
différents types d'emplois.
Tableau 16 : Répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et le sexe
Statut dans l’activité
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 1412 54,9 313 40,1 1725 51,5
Indépendant / Patron 952 37,0 401 51,4 1353 40,4
Aide familial 208 8,1 66 8,5 274 8,2
Ensemble 2572 100,0 780 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Le tableau ci-dessous sur la répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et l’IESRS
montre des variations notables entre les diplômés de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
(FSEG) et ceux de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG).
Les diplômés de l’IUG semblent occuper davantage des postes salariés (65,0 %) par rapport à ceux de la
FSEG (50,7 %). Ce constat peut refléter des différences dans la préparation des diplômés aux exigences du
marché du travail, les programmes de l’IUG étant potentiellement plus orientés vers des emplois salariés,
avec des compétences immédiatement applicables en entreprise.
En revanche, la proportion de diplômés exerçant en tant qu'indépendants ou patrons est plus élevée chez
ceux issus de la FSEG (41,3 %) par rapport à l’IUG (23,5 %). Cela pourrait indiquer que les diplômés de
la FSEG sont davantage poussés à créer leur propre emploi ou à entreprendre, peut-être en raison de la
diversité de leurs formations et de la flexibilité de leurs compétences.
Enfin, la part des aides familiaux est plus ou moins équivalente dans les deux établissements, bien que
légèrement plus élevée à l’IUG (11,5 %) par rapport à la FSEG (8,0 %).
 |
41 41 |
▲back to top |
41
Dans l’ensemble, ces données révèlent des différences de trajectoire professionnelle entre les diplômés
selon leur IESRS. Cela souligne la nécessité de prendre en compte ces variations dans les stratégies
d'insertion professionnelle, afin de mieux accompagner les diplômés selon leur profil et les spécificités de
leur formation.
Tableau 17 : Répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et l’IESRS
Statut dans l’activité
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 1606 50,7 119 65,0 1725 51,5
Indépendant / Patron 1310 41,3 43 23,5 1353 40,4
Aide familial 253 8,0 21 11,5 274 8,2
Ensemble 3169 100,0 183 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Le tableau ci-dessous présente une répartition des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et la
filière de formation, révélant des différences notables dans les trajectoires professionnelles en fonction des
spécialisations.
Les diplômés en « Création et gestion d’entreprises » se distinguent avec une proportion très élevée de
salariés (80,5 %), ce qui peut sembler paradoxal pour une filière orientée vers l’entrepreneuriat. Cela peut
indiquer que, bien que formés pour créer leur propre entreprise, ces diplômés préfèrent ou trouvent plus
facilement un emploi salarié. En revanche, ceux ayant suivi une formation en « Assurance banque finances
» sont majoritairement indépendants ou patrons (53,7 %), ce qui peut refléter la nature plus autonome des
métiers dans ce secteur.
Les filières « Économie » et « Sciences et techniques commerciales » montrent une répartition équilibrée
entre les statuts de salarié et indépendant, avec respectivement 52,7 % et 51,7 % de diplômés salariés, et
36,0 % et 37,9 % de diplômés indépendants. Ces résultats pourraient s'expliquer par les opportunités de
carrière dans ces domaines, qui offrent une flexibilité entre l'entrepreneuriat et l'emploi salarié.
Les diplômés en « Organisation et gestion des organisations » présentent un pourcentage élevé d’aides
familiaux (14,0 %), ce qui pourrait être lié à des responsabilités familiales ou à des formes d’emploi
informel plus fréquentes dans ce secteur.
La répartition des diplômés par statut d’activité reflète les dynamiques spécifiques à chaque filière. Elle
souligne également l’importance d’adapter les stratégies d’insertion professionnelle en fonction des
particularités des domaines de formation, afin d’accompagner les diplômés dans leur intégration sur le
marché du travail.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 13 : Proportion des diplômés en emploi selon leur statut dans l’activité et la filière de formation (%)
42,3%
52,7%
54,5%
80,5%
58,1%
51,7%
51,5%
53,7%
36,0%
38,3%
9,8%
27,9%
37,9%
40,4%
4,0%
11,3%
7,2%
9,8%
14,0%
10,3%
8,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Salarié Indépendant / Patron Aide familial
 |
42 42 |
▲back to top |
42
3.4.1.3. Secteur d’activité
La répartition des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et le sexe, met en évidence des disparités
marquées dans les choix sectoriels entre hommes et femmes. Le secteur des services domine pour les
hommes, avec 54,6 % des diplômés masculins employés dans ce domaine, tandis que 41,3 % des femmes
travaillent dans ce secteur. Cela montre que les hommes semblent davantage orientés vers des emplois dans
les services, souvent liés à l'administration, la gestion ou d'autres activités professionnelles et techniques.
En revanche, le secteur du commerce attire une proportion significativement plus élevée de femmes (57,2
%) que d'hommes (33,7 %). Ce secteur, généralement plus accessible et flexible, pourrait être préféré par
les femmes en raison des opportunités de travail indépendant ou de petites entreprises, qui offrent souvent
des horaires plus flexibles et peuvent être compatibles avec des responsabilités familiales.
L'industrie, avec seulement 0,2 % de femmes contre 7,8 % d’hommes, est le secteur le plus masculinisé.
Cela reflète probablement les stéréotypes de genre et les barrières structurelles qui limitent l'accès des
femmes aux métiers industriels. Quant à l’agriculture, il représente une faible part de l'emploi global pour
les diplômés, bien que les hommes y soient plus représentés (3,9 %) que les femmes (1,3 %).
Ces tendances soulignent la nécessité de renforcer l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les
différents secteurs d'activité, notamment en promouvant l'accès des femmes à des secteurs sous-représentés
comme l'industrie et en soutenant leur intégration dans les secteurs plus formels comme les services. Cela
pourrait également impliquer des mesures pour favoriser l'autonomie économique des femmes,
particulièrement dans le commerce où elles sont fortement représentées.
Tableau 18 : Répartition des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et le sexe
Secteur
d’activité
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Agriculture 99 3,9 10 1,3 109 3,3
Industrie 200 7,8 2 0,2 202 6,0
Commerce 868 33,7 446 57,2 1314 39,2
Service 1405 54,6 322 41,3 1727 51,5
Ensemble 2572 100,0 780 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
La répartition des diplômés en emploi selon leur secteur d’activité et l’IESRS, notamment la Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) et l’Institut Universitaire de Gestion (IUG) montre que le
secteur des services est dominant pour les deux institutions, avec 51,4 % des diplômés de la FSEG et 53 %
de ceux de l'IUG employés dans ce secteur. Cela reflète la forte demande pour des compétences en gestion,
finance, et administration dans les activités de service, un secteur en pleine croissance au Mali. Les
diplômés de ces deux établissements semblent particulièrement bien préparés pour des carrières dans les
services, où la polyvalence et les compétences techniques sont cruciales.
Le commerce, deuxième secteur le plus représenté, emploie 39,2 % des diplômés de la FSEG et 39,3 % de
ceux de l'IUG, ce qui montre une orientation commune des deux institutions vers cette activité. Le
commerce offre des opportunités d'entrepreneuriat et d'emploi dans des entreprises de distribution ou
d'import-export, favorisant l'insertion professionnelle rapide des diplômés.
L’industrie reste minoritaire, avec seulement 6,2 % des diplômés de la FSEG et 3,3 % de ceux de l'IUG
employés dans ce secteur. Cette faible proportion pourrait indiquer une adéquation limitée des formations
en sciences économiques et gestion avec les besoins industriels, ou encore des barrières à l'accès au secteur
pour ces diplômés.
 |
43 43 |
▲back to top |
43
L'agriculture, bien que stratégique pour l'économie du Mali, n'attire qu'une faible proportion de diplômés
des deux établissements (3,2 % pour la FSEG et 4,4 % pour l'IUG). Cette répartition suggère que les
diplômés des sciences économiques et gestion sont moins enclins à s’orienter vers ce secteur, malgré son
importance pour l'économie nationale, et qu'il existe une marge de progression pour attirer davantage de
diplômés vers les métiers agricoles, notamment à travers des formations plus ciblées.
Les diplômés de la FSEG et de l'IUG s'insèrent majoritairement dans les secteurs des services et du
commerce, avec une moindre représentation dans l'industrie et l'agriculture. Cette répartition pourrait servir
de base pour ajuster les programmes de formation afin de mieux répondre aux besoins des secteurs sous-
représentés.
Tableau 19 : Répartition des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et l’IESRS
Secteur
d’activité
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Agriculture 101 3,2 8 4,4 109 3,3
Industrie 196 6,2 6 3,3 202 6,0
Commerce 1242 39,2 72 39,3 1314 39,2
Service 1630 51,4 97 53,0 1727 51,5
Ensemble 3169 100,0 183 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les données du tableau ci-dessous mettent en lumière la répartition des diplômés en emploi selon leur
secteur d’activité et leur filière de formation. Il est clair que le secteur des services domine dans presque
toutes les filières, notamment pour les diplômés en Création et gestion d’entreprises (56,1 %), Organisation
et gestion des organisations (60,5 %) et Gestion (54,5 %). Cette tendance montre que les compétences
acquises dans ces filières sont fortement adaptées aux besoins du secteur tertiaire, en pleine expansion au
Mali, où des fonctions de gestion, de conseil et de services aux entreprises sont recherchées.
Le secteur du commerce occupe la deuxième place, particulièrement pour les diplômés en Sciences et
techniques commerciales, où 58,6 % des diplômés trouvent un emploi. Cela reflète bien la nature
commerciale de la formation, qui les prépare à occuper des postes dans la vente, la distribution et le
marketing. Les diplômés des autres filières, comme Assurance, banque, finances (47 %) et Économie (36,6
%), sont également nombreux à travailler dans ce secteur, bien que dans une moindre mesure. Le secteur
de l'industrie reste minoritaire pour la plupart des filières, à l'exception de celle en Économie, où 8,6 % des
diplômés sont employés. Ce chiffre montre que cette filière prépare relativement bien ses diplômés aux
métiers liés à la production industrielle et à la gestion économique des entreprises industrielles, bien que
cela reste une tendance globale limitée.
Quant à l'agriculture, elle attire peu de diplômés, sauf en Création et gestion d'entreprises, où 9,8 % des
diplômés trouvent un emploi. Ce pourcentage reflète peut-être la capacité de cette filière à encourager
l'entrepreneuriat dans les domaines agricoles, secteur crucial pour l'économie du Mali.
En fin, les diplômés des sciences économiques et de gestion sont majoritairement insérés dans les secteurs
des services et du commerce, tandis que les secteurs de l’industrie et de l'agriculture restent sous-
représentés. Cela montre une orientation vers des métiers plus tertiaires et suggère la possibilité d’adapter
les formations afin d’accroître la participation des diplômés dans les secteurs industriel et agricole.
 |
44 44 |
▲back to top |
44
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 14 : Proportion des diplômés en emploi selon le secteur d’activité et la filière de formation (%)
3.4.1.4. Nombre d’emploi occupés de la fin de la formation à nos jours
La répartition du nombre d'emplois occupés par les diplômés en fonction de leur sexe révèle qu'une majorité
significative, soit 85,3 %, occupe un seul emploi depuis la fin de leur formation, avec une légère différence
entre les hommes (86,1 %) et les femmes (82,5 %). Ce résultat indique que la plupart des diplômés de la
FSEG et de l'IUG parviennent à atteindre une certaine stabilité professionnelle.
Cependant, une proportion notable de diplômés a changé d'emploi, avec 11,0 % d'entre eux ayant occupé
au moins deux emplois depuis la fin de leur formation. Cela pourrait s'expliquer par un désir d'améliorer
leurs revenus ou de diversifier leurs compétences. Ce phénomène est légèrement plus fréquent chez les
femmes (11,9 %) que chez les hommes (10,7 %), suggérant une tendance chez les femmes à multiplier les
expériences professionnelles pour compenser les difficultés d'accès à des postes stables ou bien rémunérés.
Enfin, une petite fraction des diplômés, représentant 3,8 %, indique avoir occupé entre trois et quatre
emplois. Ce cas est plus courant chez les femmes (5,5 %) que chez les hommes (3,2 %), ce qui pourrait
refléter une plus grande précarité professionnelle ou la nécessité de garantir des sources de revenus face à
l'instabilité du marché du travail.
Dans l'ensemble, ces données illustrent une réalité complexe, bien que la majorité des diplômés occupent
un seul emploi depuis la fin de leur formation, une minorité a changé d'emploi à plusieurs reprises. Cela
pourrait nécessiter des ajustements dans les politiques d'accompagnement professionnel, en particulier pour
les femmes.
Tableau 20 : Nombre d’emplois occupé par les diplômés selon le sexe
Nombre d’emplois occupé
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Un emploi occupé 2214 86,1 644 82,5 2858 85,3
Deux emplois occupés 275 10,7 93 11,9 368 11,0
Trois à cinq emplois occupés 83 3,2 43 5,5 126 3,8
Ensemble 2572 100,0 780 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
L’analyse des données du nombre d’emplois occupés par les diplômés selon leur IESRS, révèle des
tendances intéressantes sur le marché du travail pour les diplômés des filières de la FSEG et de l’IUG.
2,7%
8,6%
6,0%
2,4%
4,7%
3,4%
6,0%
47,0%
36,6%
36,5%
31,7%
32,6%
58,6%
39,2%
47,0%
51,6%
54,5%
56,1%
60,5%
37,9%
51,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Agriculture Industrie Commerce Service
 |
45 45 |
▲back to top |
45
Premièrement, une majorité écrasante des diplômés, soit 85,2 % de l'ensemble, occupe un seul emploi.
Cette proportion est particulièrement élevée pour ceux issus de la FSEG, atteignant 86,1 %, tandis que le
pourcentage est plus bas pour l’IUG, à 69,9 %. Cette différence significative suggère que les diplômés de
la FSEG ont plus de chances de se stabiliser dans un emploi unique après leur formation.
En revanche, la proportion de diplômés ayant occupé au moins deux emplois depuis la fin de la formation
est de 11,0 % du total, avec des variations entre les deux institutions. Les diplômés de l'IUG ont un taux de
21,3 % pour ceux ayant occupé au moins deux emplois, contre seulement 10,4 % pour ceux de la FSEG.
Ce constat pourrait être interprété comme une indication que les diplômés de l'IUG rencontrent plus de
difficultés à trouver un emploi stable, ce qui les pousse à chercher des opportunités supplémentaires pour
améliorer leurs revenus.
Enfin, un petit pourcentage, soit 3,8 %, des diplômés a déclaré avoir occupé entre trois et cinq emplois
depuis la fin de la formation. Cette tendance est plus marquée parmi les diplômés de l'IUG, où 8,7 % des
répondants affirment avoir eu plusieurs emplois, contre 3,5 % pour la FSEG. Cela pourrait suggérer une
précarité professionnelle plus élevée pour les diplômés de l'IUG, qui pourraient être contraints de multiplier
les emplois en raison d’un marché du travail difficile ou de la nécessité d’accumuler des expériences
professionnelles.
Ces données mettent en lumière des disparités entre les diplômés des deux instituts, soulignant une tendance
générale vers la stabilisation dans un emploi unique, mais aussi les défis rencontrés par certains diplômés,
en particulier ceux de l'IUG, qui semblent avoir un recours plus fréquent aux emplois multiples. Cela
soulève des questions importantes sur l'adéquation des programmes de formation avec les exigences du
marché du travail et sur la nécessité d'initiatives ciblées pour améliorer l'insertion professionnelle des
diplômés, notamment ceux issus de l'IUG.
Tableau 21 : Nombre d’emplois occupé par les diplômés selon le sexe
Nombre d’emplois occupé
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Un emploi occupé 2730 86,1 128 69,9 2857 85,2
Deux emplois occupés 329 10,4 39 21,3 368 11,0
Trois à cinq emplois occupés 110 3,5 16 8,7 126 3,8
Ensemble 3169 100,0 183 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
L'analyse des données concernant le nombre d'emplois occupés par les diplômés selon leur filière de
formation met en évidence des tendances variées quant à la stabilité de l'emploi et aux changements
d'emploi au sein des différentes filières.
Dans l'ensemble, 85,3 % des diplômés affirment avoir occupé un seul emploi depuis la fin de leur formation,
ce qui indique une stabilisation professionnelle relativement élevée. Les filières d' « Assurance, Banque et
Finances » ainsi qu'Economie affichent les proportions les plus élevées, respectivement 87,9 % et 88,2 %.
Ces résultats suggèrent que les diplômés de ces domaines réussissent à s'insérer de manière stable sur le
marché du travail.
À l'inverse, les diplômés en Organisation et Gestion des Organisations présentent une réalité différente,
avec seulement 46,5 % d'entre eux ayant occupé un emploi unique depuis leur formation. En effet, cette
filière a la proportion la plus élevée de diplômés ayant changé d'emploi au moins une fois (32,6 %), ainsi
qu'un pourcentage notable de 20,9 % ayant changé d'emploi deux à quatre fois. Cette situation pourrait
refléter une précarité professionnelle plus marquée pour ces diplômés, possiblement due à des difficultés
 |
46 46 |
▲back to top |
46
d'intégration dans le marché du travail ou à des inadaptations entre leurs compétences et les exigences du
secteur.
Les résultats sont également intéressants pour la filière Gestion, où 13,2 % des diplômés ont changé
d'emploi au moins une fois, suggérant une recherche active d'opportunités plus satisfaisantes ou mieux
rémunérées. D'autre part, la filière Sciences et Techniques Commerciales affiche un faible pourcentage de
changements d'emploi, avec 82,8 % ayant occupé un emploi unique et 17,2 % ayant changé au moins une
fois. Ce modèle pourrait indiquer que les diplômés de cette filière parviennent à trouver des emplois
satisfaisants dès le départ.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 15 : Nombre d’emplois occupé par les diplômés selon la filière de formation (%)
3.4.1.5. Revenu mensuel moyen
L'analyse des revenus mensuels des diplômés en emploi, répartis par sexe, révèle des différences notables
quant à la répartition des salaires et montre également une concentration significative dans les tranches
inférieures.
En premier lieu, 22,6 % des diplômés en emploi perçoivent un revenu mensuel inférieur au SMIG, une
proportion préoccupante qui touche davantage les femmes (30,9 %) que les hommes (20,1 %). Cette
situation pourrait refléter une vulnérabilité accrue des femmes sur le marché du travail, marquée par des
difficultés à accéder à des emplois mieux rémunérés ou plus stables.
La majorité des diplômés, soit 38,5 %, perçoivent un revenu mensuel compris entre 40 000 et 75 000 FCFA,
un segment où les hommes (39,5 %) et les femmes (35,3 %) sont relativement proches. Ce revenu, bien que
supérieur au SMIG, reste modeste et pourrait indiquer que beaucoup de diplômés, bien qu'ayant un emploi,
ne bénéficient pas encore d'une rémunération leur permettant d'améliorer significativement leur qualité de
vie.
En ce qui concerne les revenus supérieurs à 75 000 FCFA, la proportion des diplômés décroît avec
l'augmentation du revenu. Par exemple, seuls 16,8 % des diplômés gagnent entre 75 001 et 100 000 FCFA,
avec une nette différence entre les hommes (18,5 %) et les femmes (11,0 %). Cette tendance se poursuit
pour les tranches de revenu plus élevées. Notamment, 6,1 % des hommes perçoivent plus de 200 000 FCFA,
contre 5,6 % des femmes, indiquant que bien que les écarts se réduisent dans cette tranche, les hommes
restent surreprésentés parmi les plus hauts revenus.
87,9%
88,2%
82,6%
80,5%
46,5%
82,8%
85,3%
10,1%
8,1%
13,2%
14,6%
32,6%
17,2%
11,0%
2,0%
3,8%
4,2%
4,9%
20,9%
0,0%
3,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Un emploi occupé Deux emplois occupés Trois à cinq emplois occupés
 |
47 47 |
▲back to top |
47
Les données soulignent des inégalités de rémunération entre les sexes, les hommes étant plus nombreux
dans les tranches de revenu élevées, tandis que les femmes sont davantage concentrées dans les tranches
inférieures. Ce constat pourrait refléter des barrières structurelles qui freinent l’accès des femmes à des
postes mieux rémunérés, tels que des écarts de compétences perçues, des responsabilités familiales ou des
pratiques discriminatoires dans certains secteurs.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 16 : Revenu mensuel des diplômés en emploi par sexe (%)
L'analyse des revenus mensuels des diplômés en emploi, selon l’IESRS, montre des disparités significatives
entre les diplômés de la FSEG et ceux de l'IUG. Ces écarts peuvent être interprétés en lien avec la structure
des programmes de formation, la spécialisation des filières, et les opportunités du marché du travail.
Les diplômés de la FSEG sont plus nombreux à percevoir un revenu mensuel inférieur au SMIG malien de
40 000 FCFA, avec 23,1 % contre 13,7 % pour l’IUG. Ce taux est préoccupant, surtout pour les diplômés
de la FSEG, et reflète soit une plus grande difficulté à trouver des emplois bien rémunérés, soit une forte
présence dans des secteurs moins payants ou informels. Le contraste avec l'IUG, où une plus faible
proportion de diplômés est dans cette tranche de revenus, pourrait témoigner d'une meilleure adéquation
des compétences des diplômés de l'IUG avec le marché du travail ou une concentration dans des secteurs
plus rémunérateurs.
Les tranches intermédiaires de revenus (40 000 à 75 000 FCFA et 75 001 à 100 000 FCFA) sont dominées
par les diplômés des deux institutions, bien que la majorité des diplômés se trouve dans la tranche 40 000
à 75 000 FCFA. Environ 39,1 % des diplômés de la FSEG et 29,0 % de ceux de l'IUG perçoivent un revenu
dans cette fourchette. Les diplômés de la FSEG sont également plus nombreux à se situer dans la tranche
75 001 à 100 000 FCFA (17,1 % contre 9,8 % pour l'IUG), suggérant que bien que plus de diplômés de la
FSEG perçoivent de bas revenus, une part notable parvient à accéder à des salaires moyens.
Les diplômés de l'IUG sont proportionnellement plus nombreux à percevoir des salaires supérieurs à 100
000 FCFA, en particulier dans la tranche de revenus dépassant 200 000 FCFA, où 18,6 % des diplômés de
l'IUG se trouvent contre seulement 5,3 % pour ceux de la FSEG. Cette situation pourrait s’expliquer par la
nature des emplois occupés par les diplômés de l'IUG, souvent orientés vers des secteurs comme la gestion
ou le commerce, qui sont potentiellement plus rémunérateurs. Par ailleurs, 9,3 % des diplômés de l'IUG se
20,1%
30,9%
22,6%
39,5%
35,3%
38,5%
18,5%
11,0%
16,8%
2,7%
6,3%
3,6%
7,5%
5,8%
7,1%
1,0%
2,8%
1,4%
4,5%
2,3%
4,0%
6,1%
5,6%
6,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Homme
Femme
Ensemble
Moins de 40 000 FCFA 40 000 à 75 000 FCFA 75 001 à 100 000 FCFA 100 001 à 125 000 FCFA
125 001 à 150 000 FCFA 150 001 à 175 000FCFA 175 001 à 200 000 FCFA Plus de 200 000 FCFA
 |
48 48 |
▲back to top |
48
situent dans la tranche 125 001 à 150 000 FCFA, contre 6,9 % pour ceux de la FSEG, montrant une tendance
générale à des salaires plus élevés chez les diplômés de l'IUG.
Bien que la majorité des diplômés des deux institutions se concentrent dans les tranches de revenu
inférieures, les diplômés de l'IUG semblent bénéficier d'opportunités salariales plus élevées que ceux de la
FSEG. Les politiques d’accompagnement professionnel devraient tenir compte de ces disparités afin
d’améliorer l'accès à des emplois mieux rémunérés, en particulier pour les diplômés de la FSEG, qui sont
plus exposés à des salaires bas, et de renforcer les stratégies d’insertion professionnelle adaptées aux
spécificités de chaque institution.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 17 : Revenu mensuel des diplômés en emploi par IESRS (%)
Les données présentées dans le graphique ci-après révèlent une répartition hétérogène des revenus mensuels
des diplômés des différentes filières de la FSEG et de l’IUG. Une analyse croisée de ces données met en
lumière plusieurs dynamiques intéressantes concernant l'insertion professionnelle des diplômés en termes
de rémunération.
Un fait préoccupant est que près de 22,6 % des diplômés perçoivent un revenu inférieur au SMIG malien,
avec des écarts notables selon les filières. Par exemple, les diplômés en Assurance, Banque et Finances
(29,5 %) ainsi que ceux en Sciences et Techniques Commerciales (27,6 %) sont les plus affectés par des
revenus en dessous du SMIG. Cette proportion plus élevée pourrait refléter des emplois dans des secteurs
informels ou des situations d’emplois précaires.
En revanche, les diplômés en Création et Gestion d’Entreprises (12,2 %) et en Organisation et Gestion des
Organisations (4,7 %) sont proportionnellement moins touchés par des revenus en dessous du SMIG. Cela
peut suggérer que ces filières offrent des opportunités d'emploi plus stables ou mieux rémunérées dès le
début de la carrière.
La majorité des diplômés se situe dans la tranche de revenu intermédiaire (40 000 à 100 000 FCFA), ce qui
montre une certaine stabilité salariale post-formation. Environ 38,5 % des diplômés perçoivent un salaire
dans la fourchette 40 000 à 75 000 FCFA, notamment dans les filières Gestion (41,3 %) et Économie (37,6
%). Toutefois, une part importante des diplômés dans les secteurs Création et Gestion d’Entreprises (24,4
%) et Sciences et Techniques Commerciales (27,6 %) se trouve dans cette fourchette, ce qui pourrait
23,1%
13,7%
22,6%
39,1%
29,0%
38,5%
17,1%
9,8%
16,7%
3,5%
4,4%
3,6%
6,9%
9,3%
7,1%
1,2%
5,5%
1,4%
3,7%
9,8%
4,0%
5,3%
18,6%
6,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
FSEG
IUG
Ensemble
Moins de 40 000 FCFA 40 000 à 75 000 FCFA 75 001 à 100 000 FCFA 100 001 à 125 000 FCFA
125 001 à 150 000 FCFA 150 001 à 175 000FCFA 175 001 à 200 000 FCFA Plus de 200 000 FCFA
 |
49 49 |
▲back to top |
49
indiquer une tendance à l'auto-emploi ou à des débuts difficiles en termes de rémunération dans ces
domaines.
Les tranches salariales de 75 001 à 100 000 FCFA sont également bien représentées, notamment en
Économie (17,7 %) et en Assurance, Banque et Finances (16,8 %), ce qui reflète un niveau de salaire
légèrement supérieur, mais qui reste encore modeste compte tenu du coût de la vie.
Une proportion plus faible de diplômés, soit environ 10,7 %, perçoit un salaire supérieur à 100 000 FCFA,
ce qui correspond à des emplois mieux rémunérés et plus stables. Les diplômés des filières en Organisation
et Gestion des Organisations (30,2 %) et en Création et Gestion d’Entreprises (17,1 %) dominent cette
catégorie, ce qui montre que ces secteurs peuvent offrir des opportunités financières plus attractives à long
terme.
Les diplômés en Sciences et Techniques Commerciales et en Assurance, Banque et Finances sont également
représentés dans cette catégorie, mais dans une moindre mesure, avec respectivement 6,9 % et 3,4 % dans
la tranche de revenu supérieure à 200 000 FCFA.
Bien que la majorité des diplômés se trouvent dans les tranches de revenus intermédiaires, une partie non
négligeable continue de percevoir des salaires inférieurs au SMIG, notamment dans certaines filières
comme l’Assurance banque finance et les Sciences et techniques commerciales. Les diplômés des filières
en Création et gestion d’entreprises et en Gestion des organisations semblent avoir de meilleures
perspectives salariales.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 18 : Revenu mensuel des diplômés en emploi par filière de formation (%)
3.4.1.6. Type d’entreprise
Les données ci-dessous présentent la répartition des diplômés de la FSEG et de l’IUG selon le type
d’entreprise qui les emploie, en fonction de leur sexe. Elles mettent en évidence une forte concentration des
diplômés dans le secteur privé, des disparités de genre dans certains types d’organisations, et une faible
représentation dans les secteurs publics et parapublics.
La majorité des diplômés, soit 83,6 %, travaillent dans des entreprises privées, secteur dominé par
l'informel. Cette répartition est similaire entre les hommes (83,9 %) et les femmes (82,8 %), ce qui montre
que le secteur privé constitue la principale source d'emploi pour les deux sexes. Ce constat reflète
29,5%
23,7%
18,0%
12,2%
4,7%
27,6%
22,6%
38,3%
37,6%
41,3%
24,4%
34,9%
27,6%
38,5%
16,8%
17,7%
16,8%
9,8%
9,3%
10,3%
16,7%
4,7%
3,8%
2,4%
4,9%
4,7%
3,4%
3,6%
4,0%
8,1%
7,8%
9,8%
4,7%
13,8%
7,1%
1,3%
0,5%
1,8%
4,9%
4,7%
6,9%
1,4%
3,4%
4,8%
7,2%
17,1%
30,2%
6,9%
6,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Moins de 40 000 FCFA 40 000 à 75 000 FCFA 75 001 à 100 000 FCFA 100 001 à 125 000 FCFA
125 001 à 150 000 FCFA 150 001 à 175 000FCFA 175 001 à 200 000 FCFA Plus de 200 000 FCFA
 |
50 50 |
▲back to top |
50
l’évolution du marché du travail au Mali, où les opportunités dans le secteur public sont limitées, forçant
les diplômés à se tourner vers le privé pour leur insertion professionnelle.
Le secteur public emploie une proportion réduite de diplômés, avec seulement 8,4 % d'entre eux travaillant
dans l’administration publique. Cela témoigne de la rareté des débouchés dans ce secteur, due notamment
aux restrictions budgétaires, aux gels de recrutement ou à la forte concurrence pour les postes. Il est à noter
que les hommes sont légèrement plus nombreux dans ce secteur (9,0 %) que les femmes (6,7 %).
Les entreprises publiques et parapubliques emploient encore moins de diplômés, avec seulement 1,5 % de
l’ensemble. Fait intéressant, les femmes sont davantage représentées dans ce secteur (2,4 %) comparé aux
hommes (1,2 %), peut-être en raison de politiques d’équité ou d'un accès plus ciblé. Les ONG absorbent
2,8 % des diplômés, avec une légère surreprésentation des femmes (3,6 %) par rapport aux hommes (2,6
%). Les ONG, souvent perçues comme offrant des conditions de travail plus flexibles, semblent attirer
davantage de femmes. Les entreprises associatives et les organisations internationales représentent une
petite part des employeurs, avec respectivement 0,8 % et 0,4 % des diplômés. Les hommes y sont
légèrement plus représentés que les femmes, ce qui pourrait indiquer un accès limité pour ces dernières
dans ces structures.
Enfin, 2,5 % des diplômés travaillent comme personnel de maison ou au sein de ménages, un indicateur de
la précarité pour certains diplômés n’ayant pas trouvé d'emploi dans des secteurs plus formels. Ce type de
travail est plus fréquent chez les femmes (3,7 %) que chez les hommes (2,1 %), ce qui pourrait refléter une
pression sociale ou économique obligeant les femmes à accepter des emplois moins qualifiés.
Bien que la majorité des diplômés de la FSEG et de l’IUG trouvent un emploi dans le secteur privé, les
femmes sont davantage représentées dans les secteurs parapublic, associatif et domestique, soulignant ainsi
des inégalités d'accès à des emplois plus stables et mieux rémunérés.
Tableau 22 : Type d’entreprise des diplômés par sexe
Type d'entreprise
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Administration publique 231 9,0 52 6,7 283 8,4
Entreprise publique ou parapublique 31 1,2 19 2,4 50 1,5
Entreprise privée 2157 83,9 646 82,8 2803 83,6
ONG 67 2,6 28 3,6 95 2,8
Entreprise associative 24 0,9 2 0,2 26 0,8
Organisation internationale 8 0,3 4 0,5 12 0,4
Ménage/ Personnel de maison 54 2,1 29 3,7 83 2,5
Ensemble 2572 100,0 780 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Le tableau ci-dessous présente la répartition des diplômés de la FSEG et de l'IUG selon le type d’entreprise
où ils travaillent, et met en évidence des différences notables entre ces deux institutions en termes
d'insertion professionnelle, notamment dans les secteurs publics, privé et parapublic.
La majorité des diplômés, soit 83,6 %, sont employés dans des entreprises privées, ce qui confirme le rôle
prépondérant de ce secteur en tant que principal employeur des diplômés en sciences économiques et
gestion. Cette tendance est plus marquée chez les diplômés de la FSEG (84,9 %) comparé à ceux de l'IUG
 |
51 51 |
▲back to top |
51
(62,6 %), ce qui suggère que les diplômés de la FSEG trouvent plus facilement un emploi dans le secteur
privé.
Concernant l’administration publique, 8,4 % des diplômés y travaillent, avec une répartition légèrement
différente entre les deux institutions : 8,3 % pour la FSEG et 10,9 % pour l’IUG. Bien que minoritaire, ce
secteur attire un peu plus les diplômés de l’IUG.
Les entreprises publiques et parapubliques emploient une faible proportion des diplômés, soit 1,5 % au
total. L’IUG y est toutefois mieux représentée avec 3,6 % contre 1,4 % pour la FSEG, suggérant des
préférences ou des opportunités différentes entre les diplômés des deux institutions dans ce secteur. Les
ONG absorbent 2,8 % des diplômés, avec une surreprésentation plus marquée parmi les diplômés de l’IUG
(6,2 %) que chez ceux de la FSEG (2,7 %). Ces organisations, souvent perçues comme offrant des
conditions de travail plus flexibles, semblent être une option plus attractive pour les diplômés de l’IUG.
Les organisations internationales et les entreprises associatives représentent une petite part des employeurs,
avec respectivement 0,4 % et 0,8 % des diplômés. Les diplômés de l'IUG y sont davantage présents,
notamment dans les organisations internationales (2,7 % contre 0,2 % pour la FSEG), ce qui pourrait révéler
des opportunités distinctes pour ces diplômés.
Tableau 23 : Type d’entreprise des diplômés par IESRS
Type d'entreprise
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Administration publique 263 8,3 20 10,9 283 8,4
Entreprise publique ou parapublique 43 1,4 7 3,6 50 1,5
Entreprise privée 2689 84,9 114 62,6 2803 83,6
ONG 84 2,7 11 6,2 95 2,8
Entreprise associative 24 0,8 2 1,0 26 0,8
Organisation internationale 7 0,2 5 2,7 12 0,4
Ménage/ Personnel de maison 59 1,9 24 13,0 83 2,5
Ensemble 3169 100,0 183 100,0 3352 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Le graphique ci-dessous montre la répartition des diplômés des différentes filières de la FSEG et de l’IUG
selon le type d’entreprise où ils travaillent. Il révèle des variations importantes en fonction des filières,
notamment en ce qui concerne l’administration publique, les entreprises privées, et les ONG.
L’entreprise privée reste le principal employeur des diplômés, absorbant en moyenne 83,6 % d’entre eux,
bien que cette proportion varie selon les filières. Par exemple, les diplômés en Assurance, banque et
finances sont les plus nombreux à travailler dans ce secteur (88,6 %), suivis de ceux en Gestion (84,4 %)
et en Économie (82,8 %). Cependant, cette proportion baisse significativement pour les diplômés en
Création et gestion d’entreprises (58,5 %) et en Organisation et gestion des organisations (51,2 %), ce qui
pourrait s’expliquer par la nature de ces filières qui encouragent l’entrepreneuriat ou des choix
professionnels plus diversifiés.
En ce qui concerne l’administration publique, 8,4 % des diplômés y sont employés, avec des variations
importantes entre les filières. Les diplômés en Création et gestion d’entreprises sont surreprésentés dans ce
secteur (17,1 %), tandis que les diplômés en Assurance, banque et finances sont les moins nombreux à y
accéder (6,0 %). Ces résultats peuvent refléter des compétences spécifiques recherchées dans les différents
ministères ou administrations publiques.
Les entreprises publiques ou parapubliques, bien qu'employant seulement 1,5 % des diplômés en moyenne,
sont plus présentes parmi les diplômés en Organisation et gestion des organisations (6,9 %) et en Assurance,
 |
52 52 |
▲back to top |
52
banque et finances (2,0 %). Cette tendance montre une certaine préférence pour les diplômés de ces filières
dans les secteurs publics ou parapublics, qui offrent souvent des emplois plus stables.
Les ONG emploient 2,8 % des diplômés en moyenne, avec une représentation plus importante dans les
filières comme Création et gestion d’entreprises (9,8 %) et Organisation et gestion des organisations (7,0
%). Ce résultat pourrait être lié à l’attrait des ONG pour des compétences en gestion de projet ou
d’organisations. Les diplômés en Sciences et techniques commerciales n'y sont pas représentés, ce qui peut
indiquer un désintérêt ou une inadéquation de cette filière avec les besoins des ONG.
Enfin, un phénomène marquant est la proportion de diplômés en Organisation et gestion des organisations
qui travaillent comme personnel de maison ou dans les ménages (30,2 %). Cela pourrait refléter un manque
d’opportunités dans des secteurs plus formels pour ces diplômés, ou une insertion professionnelle plus
précaire. Comparativement, les autres filières présentent des taux beaucoup plus faibles dans cette
catégorie.
Ces données montrent ainsi que les diplômés des différentes filières ont des parcours d'insertion
professionnelle distincts, fortement influencés par les spécificités des compétences acquises et les besoins
des divers secteurs du marché de l’emploi.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 19 : Type d’entreprise des diplômés selon les filières
3.4.1.7. Formalité de l’emploi
Le tableau ci-dessous présente la répartition des diplômés en emploi selon la formalité de leur emploi,
désagrégée par sexe. Les données révèlent une forte prédominance du secteur informel dans l’insertion
professionnelle des diplômés de la FSEG et de l’IUG, avec des différences notables entre les sexes.
86,8 % des diplômés occupent des emplois informels, ce qui montre la grande dépendance du marché de
l'emploi malien à l’informel. L’emploi informel étant généralement non réglementé, il inclut souvent des
emplois avec des conditions de travail précaires et peu ou pas de protection sociale. Cette tendance est
légèrement plus marquée chez les hommes (87,2 %) que chez les femmes (85,1 %). Ces chiffres reflètent
la difficulté pour la majorité des diplômés à accéder à des emplois formels, où la stabilité et les avantages
sociaux sont généralement meilleurs.
6,0%
9,1%
9,0%
17,1%
7,0%
6,9%
8,4%
88,6%
82,8%
84,4%
58,5%
51,2%
82,8%
83,6%
30,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Administration publique Entreprise publique ou parapublique Entreprise privée ONG
Entreprise associative Organisation internationale Ménage/ Personnel de maison
 |
53 53 |
▲back to top |
53
En revanche, 13,2 % des diplômés occupent des emplois formels, plus accessible aux femmes (14,9 %)
qu’aux hommes (12,8 %), bien que la différence soit modeste. Cette surreprésentation des femmes dans le
secteur formel pourrait être liée à leur insertion dans des entreprises ou des ONG qui offrent des contrats
plus réguliers et stables, ou à des efforts d'équité de genre.
La faible proportion de diplômés occupant un emploi formel met en évidence la nécessité de renforcer les
mécanismes d'accès à des emplois mieux structurés et réglementés. Les politiques publiques doivent ainsi
viser à promouvoir la formalisation des emplois et à améliorer les conditions dans le secteur informel, tout
en renforçant l'accès des jeunes diplômés à des postes formels.
Bien que l’emploi informel reste la principale source d'emploi pour les diplômés, des efforts doivent être
faits pour améliorer leur accès à des emplois formels, plus sécurisés et offrant des avantages sociaux, afin
de garantir une insertion professionnelle plus durable et de qualité.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 20 : Proportion de diplômés en emploi formel par sexe (%)
Environ 86,8 % des diplômés occupent des emplois informels, ce qui met en évidence la prépondérance de
ce secteur dans l'économie malienne. Cependant, une distinction importante se dessine entre les diplômés
de la FSEG et ceux de l'IUG. Tandis que 87,6 % des diplômés de la FSEG occupent un emploi informel,
seulement 71,4 % des diplômés de l'IUG sont dans la même situation. Cela signifie que les diplômés de
l'IUG accèdent à des emplois formels à un taux nettement plus élevé, avec 28,6 % d'entre eux occupant des
postes formels, contre 12,4 % pour ceux de la FSEG.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette disparité. D'une part, l'IUG semble mieux préparer ses diplômés
aux exigences du marché de l'emploi formel, probablement grâce à des programmes académiques qui
mettent davantage l'accent sur les compétences recherchées par les employeurs. D'autre part, la FSEG, qui
semble davantage orientée vers le secteur informel, reflète les réalités du marché du travail où de
nombreuses opportunités sont souvent non réglementées.
Il est également crucial de prendre en compte le contexte économique général au Mali, où le secteur
informel constitue une source essentielle d'emploi pour de nombreux jeunes diplômés. Néanmoins, la
87,2% 85,1% 86,8%
12,8% 14,9% 13,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Homme Femme Ensemble
Informel Formel
 |
54 54 |
▲back to top |
54
prévalence de l'informel peut poser des défis, notamment la précarité de l'emploi, l'absence de protections
sociales et de conditions de travail réglementées.
Ces données soulignent la nécessité d'une attention particulière pour améliorer les opportunités d'emploi
formel, notamment pour les diplômés de la FSEG. Des politiques éducatives et économiques ciblées
pourraient favoriser la création d'emplois formels, tout en incitant les diplômés à se tourner vers des
carrières offrant des conditions de travail plus stables et des perspectives d'avenir prometteuses.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 21 : Proportion de diplômés en emploi formel par IESRS (%)
Le graphique ci-dessous présente la répartition des diplômés en emploi formel et informel selon leur filière
de formation. Les données révèlent que, quelle que soit la filière, la majorité des diplômés occupent des
emplois informels, bien que des variations existent entre les différentes spécialités.
Globalement, 86,8 % des diplômés occupent des emplois informels, ce qui met en évidence l'importance
de ce secteur dans l'insertion professionnelle des diplômés. Cette tendance est particulièrement prononcée
dans des filières comme l'Assurance banque finances (87,9 % dans l'informel) et la Gestion (88,0 % dans
l'informel), où la majorité des diplômés n'accède pas à des emplois formels, bien que ces filières soient
généralement perçues comme ayant une structure formelle.
Certaines filières se démarquent par un pourcentage plus élevé de diplômés occupant un emploi formel. Par
exemple, la filière Création et gestion d’entreprises affiche la plus forte proportion de diplômés en emploi
formel, avec 33,3 % de ses diplômés dans cette filière. De même, les filières Organisation et gestion des
organisations (25,8 % dans le secteur formel) et Sciences et techniques commerciales (24,5 % dans le
secteur formel) présentent également une représentation significative dans l'emploi formel par rapport aux
autres filières. Ces résultats indiquent que les diplômés de ces filières bénéficient d'un meilleur accès à des
emplois structurés, probablement en raison de la pertinence de leurs compétences par rapport aux exigences
des entreprises formelles et de l'entrepreneuriat formel.
Ces différences entre les filières peuvent s'expliquer par les caractéristiques spécifiques des marchés de
l'emploi liés à chaque filière. Par exemple, les diplômés en Création et gestion d’entreprises pourraient
bénéficier de compétences plus axées sur l'entrepreneuriat et la gestion structurée d'entreprises, ce qui
favorise leur intégration dans le secteur formel. À l'inverse, les diplômés en Assurance banque finances ou
87,6%
71,4%
86,8%
12,4%
28,6%
13,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Informel Formel
 |
55 55 |
▲back to top |
55
en Gestion, bien que souvent perçus comme des filières liées au formel, semblent majoritairement orientés
vers l'informel, probablement en raison de l’importance des activités non régulées dans ces filières au Mali.
Les données mettent en évidence que, malgré la prédominance du secteur informel pour la majorité des
diplômés, certaines filières offrent de meilleures perspectives d'emploi formel. Cela souligne la nécessité
de politiques ciblées pour encourager la formalisation des emplois, tout en tenant compte des spécificités
des différentes filières de formation.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 22 : Proportion de diplômés en emploi formel par filière de formation
87,9%
87,1%
88,0%
66,7%
74,2%
75,5%
86,8%
12,1%
12,9%
12,0%
33,3%
25,8%
24,5%
13,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Informel Formel
 |
56 56 |
▲back to top |
56
3.4.2. Chômage
Les personnes au chômage sont définies comme toutes les personnes en âge de travailler qui n’étaient pas
en emploi, avaient effectué des activités de recherche d’emploi durant une période récente spécifiée, et
étaient disponibles pour l’emploi si la possibilité d’occuper un poste de travail existait.1
Cette partie fait ressortir non seulement la structure du taux de chômage, mais aussi les canaux de recherche
utilisés par les diplômés chômeurs.
3.4.2.1. Taux de chômage
Le taux de chômage permet d’appréhender les défaillances ou les déséquilibres qui caractérisent le marché
du travail. Il mesure la proportion, dans la population active, des personnes actives qui sont sans travail, à
la recherche d’un travail et disponibles pour travailler dans un emploi.
Les données révèlent des écarts notables dans le taux de chômage des diplômés de la FSEG (Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion) et ceux de l'IUG (Institut Universitaire de Gestion) au Mali selon le
sexe. Le taux de chômage global est de 18,8 %, mais une différence significative apparaît entre les hommes
et les femmes. Le taux de chômage des hommes est relativement faible, à 12,4 %, tandis que celui des
femmes atteint 32,1 %, soit près de trois fois plus élevé. Cette disparité suggère que les femmes diplômées
rencontrent beaucoup plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail que leurs homologues
masculins.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence. D'une part, les attentes socioculturelles et les normes
de genre peuvent limiter l'accès des femmes à certaines opportunités professionnelles, notamment dans des
secteurs traditionnellement dominés par les hommes. D'autre part, les contraintes liées aux responsabilités
familiales et domestiques, qui pèsent souvent davantage sur les femmes, peuvent également restreindre
leurs possibilités d'emploi ou leur mobilité professionnelle.
De plus, les femmes diplômées pourraient faire face à des discriminations sur le marché du travail, où elles
sont parfois perçues comme moins disponibles, ce qui pourrait expliquer ces taux de chômage plus élevés.
Il est également possible que les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritairement présentes offrent
moins d'opportunités d'emploi, ou que ces secteurs soient plus vulnérables à des fluctuations économiques.
Cette situation met en lumière l'importance de mettre en place des politiques ciblées pour réduire le
chômage féminin, notamment à travers des programmes de soutien à l'entrepreneuriat, des mesures
d'accompagnement spécifiques et la promotion de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi. Encourager
l'insertion des femmes dans des secteurs économiques dynamiques, y compris le secteur informel, pourrait
contribuer à réduire ces écarts.
En fin, les écarts significatifs dans les taux de chômage selon le sexe soulignent les défis supplémentaires
auxquels les femmes diplômées sont confrontées sur le marché du travail malien. Il est essentiel d'adopter
des stratégies pour promouvoir l'égalité de genre et améliorer l'accès des femmes à des emplois décents et
formels.
1 Rapport Profil du chômage et du sous-emploi au Mali, Septembre 2015, ONEF
 |
57 57 |
▲back to top |
57
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 23: Taux de chômage selon le sexe
Les données sur le taux de chômage selon l'institution d'enseignement supérieur révèlent des différences
notables entre les diplômés de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) et ceux de
l'Institut Universitaire de Gestion (IUG).
Le taux de chômage global est de 18,8 %, mais cette moyenne cache une disparité entre les deux institutions.
Les diplômés de la FSEG affichent un taux de chômage légèrement inférieur, à 18,6 %, tandis que ceux de
l'IUG enregistrent un taux de chômage plus élevé, à 21,9 %.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence. L'IUG, bien que spécialisé dans la gestion, semble
préparer ses étudiants à un marché du travail qui offre moins d'opportunités d'insertion rapide ou qui
demande des qualifications plus spécialisées. Ce taux de chômage plus élevé pour les diplômés de l'IUG
peut également s'expliquer par des attentes salariales plus élevées ou une préférence pour des emplois
formels, qui sont plus rares et plus compétitifs.
À l'inverse, les diplômés de la FSEG, avec un taux de chômage légèrement inférieur, pourraient être plus
flexibles ou mieux adaptés aux exigences du marché de l'emploi informel, qui domine largement l'économie
malienne. Ils semblent également plus enclins à accepter des opportunités dans divers secteurs, ce qui
contribue à un taux de chômage plus bas comparé à leurs homologues de l'IUG.
Ces données montrent l'importance de mieux aligner les formations des deux institutions avec les réalités
et les exigences du marché du travail. Il est également essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat,
particulièrement pour les diplômés de l'IUG, afin de diversifier leurs options d'emploi et d'encourager
l'innovation.
En conclusion, les différences dans les taux de chômage entre les diplômés de la FSEG et de l'IUG
soulignent l'importance d'ajuster les programmes de formation pour répondre aux besoins du marché et
d'améliorer les mécanismes d'accompagnement pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes
diplômés.
12,4%
32,1%
18,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Homme Femme Ensemble
 |
58 58 |
▲back to top |
58
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 24: Taux de chômage par IESRS
Les données sur le taux de chômage par filière de formation montrent des disparités importantes entre les
différents domaines d'études pour les diplômés de la FSEG et de l’IUG. Le taux de chômage global est de
18,8 %, mais il varie considérablement en fonction de la filière.
Les diplômés en organisation et gestion des organisations et en économie présentent les taux de chômage
les plus bas, respectivement à 9,3 % et 12,3 %. Ces filières semblent offrir des débouchés plus stables ou
être mieux alignées avec les besoins actuels du marché du travail, où les compétences en gestion
organisationnelle et en analyse économique sont très demandées. Ces diplômés pourraient également
bénéficier d'une plus grande polyvalence dans les secteurs d'activité, ce qui facilite leur insertion
professionnelle.
En revanche, les filières liées à la gestion (25,3 %), à la création et gestion d’entreprises (26,9 %), et aux
sciences et techniques commerciales (27,5 %) affichent les taux de chômage les plus élevés. Ces résultats
peuvent indiquer que ces domaines, bien que très populaires, sont plus saturés, avec une concurrence accrue
pour les postes disponibles. Le nombre important de diplômés dans ces filières pourrait dépasser les
capacités d'absorption du marché du travail, notamment dans un contexte économique où les opportunités
d'emploi formel sont limitées.
Il est intéressant de noter que la filière assurance, banque et finances, souvent perçue comme un domaine
offrant de nombreuses opportunités professionnelles, enregistre un taux de chômage intermédiaire à 17,9
%. Bien que ce secteur soit dynamique, il semble que les diplômés puissent rencontrer des difficultés à
intégrer immédiatement des postes formels, en raison d'une spécialisation pointue ou de la concurrence
pour des emplois bien rémunérés.
En conclusion, les différences de taux de chômage entre les filières soulignent l'importance pour les jeunes
diplômés de prendre en compte les réalités du marché du travail lors de leur choix d'orientation. Les filières
comme l'économie et la gestion des organisations offrent de meilleures perspectives d'insertion
professionnelle, tandis que les secteurs comme la gestion et le commerce sont plus concurrentiels et
demandent peut-être une adaptation ou des stratégies d'accompagnement plus ciblées pour faciliter l'accès
18,6%
21,9%
18,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
FSEG IUG Ensemble
 |
59 59 |
▲back to top |
59
à l'emploi. Il serait pertinent de renforcer les formations dans ces filières saturées, notamment en
développant des compétences en entrepreneuriat et en innovation pour mieux préparer les diplômés à créer
leurs propres opportunités d'emploi.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 25: Taux de chômage par filière de formation
3.4.2.2. Canaux de recherche d’emploi
Le tableau ci-après présente une analyse des canaux de recherche d’emploi utilisés par les diplômés des
sciences économiques et de gestion au Mali, en fonction du sexe. Il en ressort que les relations personnelles
et le contact direct avec les employeurs restent les deux principales méthodes utilisées par les diplômés,
quel que soit leur sexe.
L'analyse des canaux de recherche d’emploi révèle que les diplômés de la FSEG et de l’IUG privilégient
largement les réseaux personnels et les contacts directs avec les employeurs. Les différences de genre, bien
que présentes, ne sont pas très marquées, à l'exception de l'usage des petites annonces et du recours aux
concours. Le faible taux de recours aux structures publiques et à l’entrepreneuriat souligne la nécessité de
renforcer l’appui institutionnel et l’accompagnement des jeunes diplômés dans leur insertion
professionnelle.
Tableau 24 : Canaux de recherche par sexe (%)
Canaux de recherche d'emploi Homme Femme Ensemble
Relations personnelles 56,6 57,5 57,1
Directement auprès de l'employeur 50,2 45,2 47,4
Petites annonces, médias 45,0 59,9 53,3
ANPE 16,4 16,4 16,4
Bureau de Placement Privé 10,7 7,5 9,0
Concours 31,8 26,1 28,6
Cherche à créer une entreprise 0,0 1,7 0,9
Autre moyen 2,5 1,0 1,7
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les données révèlent des différences notables entre les diplômés de la FSEG et de l’IUG en termes de
méthodes privilégiées pour accéder au marché du travail. Tout d’abord, les relations personnelles sont le
canal le plus utilisé pour chercher un emploi, en particulier par les diplômés de l’IUG, dont 87,2 % y ont
recours, contre 55,9 % pour ceux de la FSEG. Cette forte dépendance aux réseaux personnels chez les
diplômés de l’IUG pourrait refléter un marché du travail local plus fermé ou un manque d’accès aux canaux
plus formels de recherche d’emploi.
9,3%
12,3%
17,9%
25,3%
26,9%
27,5%
18,8%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Organisation et gestion des organisations
Economie
Assurance banque finances
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
 |
60 60 |
▲back to top |
60
En revanche, le contact direct avec les employeurs est plus fréquent chez les diplômés de la FSEG (47,6
%) que chez ceux de l’IUG (37,7 %). Cette tendance peut indiquer que les diplômés de la FSEG prennent
davantage l'initiative de postuler directement auprès des entreprises, tandis que ceux de l'IUG semblent plus
dépendants de leur réseau.
Cette analyse des canaux de recherche d’emploi montre que les diplômés de la FSEG et de l’IUG adoptent
des stratégies de recherche différentes, influencées par leurs réseaux, leurs préférences et les opportunités
disponibles. Tandis que les diplômés de la FSEG semblent privilégier des canaux plus formels comme les
annonces et le contact direct avec les employeurs, ceux de l’IUG sont plus enclins à s’appuyer sur leurs
relations personnelles et à explorer d’autres voies, comme les bureaux de placement privé et les concours.
Tableau 25 : Canaux de recherche par IESRS (%)
Canaux de recherche d'emploi FSEG IUG Ensemble
Relations personnelles 55,9 87,2 57,9
Directement auprès de l'employeur 47,6 37,7 47,0
Petites annonces, médias 54,6 47,6 54,2
ANPE 16,9 22,4 17,3
Bureau de Placement Privé 8,7 26,4 9,8
Concours 30,8 39,3 31,3
Cherche à créer une entreprise 0,7 2,7 0,8
Autre moyen 0,7 23,5 2,1
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les résultats révèlent une diversité dans l'utilisation des canaux de recherche d'emploi en fonction des
spécialisations, mettant en lumière les différences d'approches entre les filières. Tout d'abord, les relations
personnelles sont le canal de recherche le plus fréquent, notamment dans les filières de Création et gestion
d’entreprises (89,5 %) et d'Organisation et gestion des organisations (100,0 %). Cela souligne l'importance
des réseaux dans ces domaines, où les opportunités d'emploi sont souvent obtenues grâce à des contacts
personnels ou professionnels. À l'inverse, ce canal est moins utilisé par les diplômés en Gestion (51,5 %)
et en Assurance banque finances (52,6 %), où le processus de recrutement semble être davantage formalisé.
Le contact direct avec les employeurs est largement favorisé par les diplômés en Gestion (57,6 %), ce qui
suggère que cette filière facilite l'accès direct aux entreprises. En revanche, ce canal est moins utilisé par
les diplômés en Sciences et techniques commerciales (18,2 %), où les relations personnelles semblent avoir
une plus grande importance.
Ainsi, l'analyse montre que les diplômés des différentes filières adoptent des stratégies variées de recherche
d'emploi, en fonction des caractéristiques et des réalités du marché de l'emploi dans leur domaine. Par
exemple, les diplômés en Création et gestion d’entreprises utilisent une large gamme de canaux, tandis que
ceux en Sciences et techniques commerciales semblent privilégier des approches plus informelles.
Tableau 26 : Canaux de recherche par IESRS (%)
Canaux de recherche d'emploi
Assurance
banque
finances
Economie Gestion
Création et
gestion
d’entreprises
Organisation
et gestion des
organisations
Sciences et
techniques
commerciales
Ensemble
Relations personnelles 52,6 64,5 51,5 89,5 100,0 81,8 57,1
Directement auprès de
l'employeur
31,6 45,2 57,6 42,1 40,0 18,2 47,4
Petites annonces, médias 63,2 58,1 47,0 63,2 20,0 36,4 53,3
ANPE 28,9 6,5 15,2 10,5 20,0 27,3 16,4
Bureau de Placement Privé 15,8 0,0 7,6 47,4 0,0 0,0 9,0
Concours 36,8 38,7 18,2 63,2 40,0 9,1 28,6
Cherche à créer une entreprise 0,0 0,0 1,5 5,3 0,0 0,0 ,9
Autre moyen 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 72,7 1,7
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
61 61 |
▲back to top |
61
3.4.3. Analyse de l’inadéquation des qualifications 2
Cette sous-section examine l'adéquation des postes occupés par les diplômés au moment de l'enquête, en
se concentrant sur deux aspects : l'inadéquation du niveau d’études et l’inadéquation du domaine d’études.
L'inadéquation du niveau d’études se produit lorsque le niveau d’études de la personne en emploi ne
correspond pas au niveau d’études requis pour faire son travail. L’inadéquation du domaine d’études
survient lorsque le domaine d’études de la personne en emploi ne correspond pas au domaine d’études
requis pour faire son travail. Bien que ces indicateurs aient leurs limites, ils fournissent des informations
précieuses sur la qualité des emplois occupés par les diplômés de la FSEG et de l’IUG.
3.4.3.1. Inadéquation du niveau d’études
L'analyse des données relatives à l'inadéquation entre le niveau d’études des diplômés et les postes ou
inadéquation verticale qu'ils occupent révèle des disparités significatives entre les sexes. Dans l'ensemble,
seulement 9,6 % des diplômés sont considérés comme qualifiés pour leurs postes respectifs, tandis qu'une
majorité écrasante, soit 90,4 %, se retrouve en situation de surqualification.
Lorsque l'on décompose ces chiffres par sexe, on observe que 10,4 % des hommes sont qualifiés pour leurs
postes, contre seulement 7,0 % des femmes. Ce constat met en lumière une tendance préoccupante : les
femmes sont surqualifiées à un taux plus élevé (93,0 %) que leurs homologues masculins (89,6 %). Cela
soulève des questions importantes sur les opportunités d'emploi et les conditions de travail des diplômées,
qui semblent être davantage en décalage avec les exigences des postes qu'elles occupent.
La prédominance de la surqualification parmi les diplômés, tant masculins que féminins, indique un
déséquilibre sur le marché du travail. Cela reflète un manque d'adéquation entre les compétences acquises
au cours des études et celles requises par les employeurs. De plus, cette situation peut être exacerbée par
des facteurs structurels qui limitent l'accès des diplômées à des postes correspondant réellement à leurs
qualifications.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 26 : Proportion des diplômés qualifiés pour le poste et sexe
L'analyse des données relatives à l'inadéquation verticale parmi les diplômés de la FSEG et de l'IUG met
en évidence des différences marquées dans le niveau de qualification par rapport aux postes occupés. Dans
2 Directives concernant la mesure de l’inadéquation des qualifications et des compétences des personnes en emploi (20e Conférence
internationale des statisticiens du travail Genève, 10-19 octobre 2018)
10,4% 7,0% 9,6%
89,6% 93,0% 90,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Homme Femme Ensemble
Qualifiés Surqualifiés
 |
62 62 |
▲back to top |
62
l'ensemble, 9,6 % des diplômés sont qualifiés pour les emplois qu'ils occupent, tandis qu'une majorité
significative, soit 90,4 %, est surqualifiée pour ces postes.
En examinant ces chiffres par institution, il est frappant de constater que seulement 8,6 % des diplômés de
la FSEG sont qualifiés pour leur poste, par rapport à 28,0 % pour ceux de l'IUG. Cela suggère que les
diplômés de l'IUG réussissent mieux à se positionner dans des rôles en adéquation avec leur niveau de
qualification. En revanche, la proportion élevée de surqualification parmi les diplômés de la FSEG,
atteignant 91,4 %, souligne un déséquilibre alarmant sur le marché du travail pour cette institution.
Cette disparité peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, elle pourrait indiquer que les
diplômés de l'IUG bénéficient d'une formation plus ciblée, les préparant mieux aux exigences du marché
de l'emploi. D'autre part, elle peut également suggérer que les diplômés de la FSEG se heurtent à des
difficultés pour trouver des emplois appropriés, les poussant à accepter des postes en dessous de leur
qualification.
En fin, les résultats soulignent une nécessité urgente d'améliorer l'adéquation entre les compétences des
diplômés et les exigences du marché du travail, particulièrement pour ceux issus de la FSEG. Des initiatives
ciblées pour renforcer la pertinence des programmes éducatifs et mieux préparer les étudiants aux réalités
du marché de l'emploi pourraient contribuer à réduire le taux de surqualification et à améliorer les
perspectives professionnelles des diplômés.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 27 : Proportion des diplômés qualifiés par IESRS
Les données sur l'inadéquation verticale selon les filières de formation révèlent des différences notables
entre les spécialités en termes de qualification des diplômés pour leurs postes. Dans l'ensemble, seulement
9,6 % des diplômés de la FSEG et de l’IUG sont qualifiés pour le poste qu'ils occupent, tandis que 90,4 %
sont surqualifiés.
En analysant par filière, les diplômés en Création et gestion d’entreprises (34,1 %) et en Organisation et
gestion des organisations (34,9 %) affichent des taux nettement plus élevés de qualification pour leurs
postes que ceux des autres domaines. Cela peut s'expliquer par la nature plus polyvalente de ces formations,
qui semblent offrir aux diplômés un éventail de compétences directement applicables dans leur secteur
d’emploi.
8,6%
28,0%
9,6%
91,4%
72,0%
90,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Qualifiés Surqualifiés
 |
63 63 |
▲back to top |
63
À l'inverse, les filières telles que l’Assurance banque finances et l’Économie montrent des taux de
surqualification très élevés, atteignant respectivement 94,6 % et 91,9 %. Ces résultats suggèrent que les
diplômés de ces filières trouvent difficilement des postes correspondant à leur niveau de formation, ce qui
les conduit à accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Les diplômés en Sciences et techniques
commerciales et en Gestion sont aussi majoritairement surqualifiés, avec des taux de 89,7 % et 88,6 %
respectivement.
Ces résultats révèlent la persistance de l'inadéquation entre les compétences acquises dans certaines filières
et les besoins du marché de l'emploi, surtout dans les domaines plus spécialisés comme l'économie ou
l’Assurance banque finances. Pour réduire cette surqualification, des ajustements dans les programmes de
formation et une meilleure articulation entre les filières académiques et le marché du travail pourraient être
envisagés, notamment dans les secteurs où la surqualification est la plus prononcée.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 28 : Proportion des diplômés qualifiés par filière de formation
3.4.3.2. Inadéquation du domaine d’études
Les données indiquent que 52,1 % des diplômés trouvent un emploi correspondant à leur domaine d’études,
tandis que 47,9 % se retrouvent dans une situation d’inadéquation de domaine d’études. En analysant ces
données par sexe, on constate que 56,2 % des femmes travaillent dans un domaine en adéquation avec leurs
études, un chiffre supérieur à celui des hommes, pour lesquels ce taux est de 50,9 %. Cette différence peut
suggérer que, bien que les femmes aient plus de facilité à trouver un emploi dans leur domaine de formation,
cela ne garantit pas que leur niveau d’études corresponde aux exigences des postes qu'elles occupent.
Cette inadéquation entre le niveau de qualification et le poste est illustrée par les chiffres mentionnés
précédemment : seuls 9,6 % des diplômés sont considérés comme qualifiés pour leurs postes. Dans le détail,
10,4 % des hommes sont qualifiés pour leurs fonctions, contre seulement 7,0 % des femmes. Autrement
dit, bien que les femmes puissent plus fréquemment trouver un emploi dans leur domaine, elles sont aussi
confrontées à un taux de surqualification plus élevé (93,0 % contre 89,6 % pour les hommes), ce qui reflète
un déséquilibre persistant sur le marché du travail.
Cette surqualification accrue chez les femmes, malgré une meilleure adéquation de leur domaine d’études,
soulève des questions sur les obstacles structurels auxquels elles peuvent être confrontées pour accéder à
des postes correspondant pleinement à leur niveau d’études. Il est possible que des facteurs tels que les
5,4% 8,1%
11,4%
34,1% 34,9%
10,3% 9,6%
94,6% 91,9%
88,6%
65,9% 65,1%
89,7% 90,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Assurance banque
finances
Economie Gestion Création et gestion
d’entreprises
Organisation et
gestion des
organisations
Sciences et
techniques
commerciales
Ensemble
Qualifiés Surqualifiés
 |
64 64 |
▲back to top |
64
stéréotypes de genre ou des barrières à l’accès aux postes de responsabilité limitent les opportunités pour
les diplômées, les confinant souvent à des postes ne valorisant pas pleinement leurs compétences.
En somme, les données montrent une tendance où les femmes, bien qu'ayant une adéquation de domaine
d’études légèrement supérieure à celle des hommes, demeurent surqualifiées pour les emplois qu'elles
occupent. Ce constat révèle une inadéquation double : non seulement entre le niveau de qualification et les
exigences du poste, mais aussi entre les opportunités professionnelles réelles et les compétences acquises
lors de leurs études. Ces données mettent en lumière un déséquilibre dans le marché du travail, qui pourrait
être atténué par des politiques visant à aligner les formations sur les besoins du marché et à promouvoir
l'égalité d'accès aux postes qualifiés, en particulier pour les femmes.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 29 : Inadéquation du domaine d’études des diplômés par sexe
Dans l'ensemble, 52,1 % des diplômés trouvent un emploi correspondant à leur domaine d’études, tandis
que 47,9 % sont dans une situation d’inadéquation de domaine d’études. En décomposant ces résultats par
institution, on observe que 66,7 % des diplômés de l'IUG travaillent dans un domaine en adéquation avec
leur formation, contre 51,3 % pour les diplômés de la FSEG. Ce constat souligne que les diplômés de l'IUG
semblent mieux alignés sur leur domaine d’études par rapport aux diplômés de la FSEG.
Cette meilleure adéquation de domaine d’études parmi les diplômés de l'IUG peut être liée aux données
précédentes sur la qualification et la surqualification. En effet, on a vu que 28 % des diplômés de l'IUG
étaient qualifiés pour les postes qu'ils occupent, contre seulement 8,6 % pour les diplômés de la FSEG.
Ainsi, non seulement les diplômés de l'IUG parviennent davantage à obtenir un emploi dans leur domaine
d’études, mais ils sont aussi mieux positionnés dans des postes correspondant à leur niveau de qualification.
Cela renforce l'idée que l'IUG semble mieux préparer ses diplômés aux exigences spécifiques du marché
de l’emploi, ou que ces diplômés bénéficient d'un environnement plus favorable pour accéder à des postes
alignés avec leur formation et leurs compétences.
En revanche, la forte inadéquation de domaine d’études pour les diplômés de la FSEG, qui atteint 48,7 %,
s'ajoute au problème de surqualification déjà identifié, où 91,4 % des diplômés de cette institution occupent
des postes en dessous de leur niveau de qualification. Cela indique que, pour de nombreux diplômés de la
50,9%
56,2%
52,1%
49,1%
43,8%
47,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Homme Femme Ensemble
Adéquation du domaine d’études Inadéquation du domaine d’études
 |
65 65 |
▲back to top |
65
FSEG, non seulement leur niveau d’études est supérieur à celui exigé par leur poste, mais en plus, ce poste
ne correspond pas à leur domaine de formation initial. Cette double inadéquation suggère des difficultés
structurelles pour les diplômés de la FSEG à trouver des postes adaptés à leur formation et à leur niveau de
qualification.
Ces disparités entre les deux institutions mettent en évidence un déséquilibre dans l'adéquation formation-
emploi qui pourrait être abordé par des mesures spécifiques pour adapter les programmes de la FSEG aux
besoins du marché du travail, et pour faciliter l’insertion professionnelle des diplômés dans des postes
correspondant à la fois à leur domaine et à leur niveau d’études.
En somme, ces résultats soulignent l'importance de développer des stratégies d'adaptation des formations
aux exigences du marché pour améliorer l'employabilité des diplômés, en particulier pour ceux issus de la
FSEG.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 30 : Inadéquation du domaine d’études des diplômés par IESRS
Dans la filière Assurance banque finances, seulement 42,3 % des diplômés occupent des postes
correspondant à leur domaine d'études, tandis que 57,7 % sont en inadéquation. Ce constat, corroboré par
les taux de surqualification très élevés (94,6 %) mentionnés précédemment, indique que ces diplômés
peinent à trouver des emplois adaptés à leur niveau de formation. Pour la filière Économie, le taux
d’adéquation est de 55,9 %, tandis que 44,1 % des diplômés sont inadaptés à leurs postes. Bien que la
majorité soit relativement bien placée, ce taux d'inadéquation soulève des questions sur l'adéquation des
compétences enseignées aux exigences des employeurs. La surqualification élevée (91,9 %) observée dans
ce domaine illustre cette inadéquation, incitant à une réflexion sur les programmes de formation.
La filière Gestion présente un taux d’adéquation de 52,7 % et une inadéquation de 47,3 %. Ces résultats
montrent une situation intermédiaire, où presque la moitié des diplômés occupent des postes qui ne
51,3%
66,7%
52,1%
48,7%
33,3%
47,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Adéquation du domaine d’études Inadéquation du domaine d’études
 |
66 66 |
▲back to top |
66
correspondent pas à leurs compétences. Cela peut être lié à la diversité des métiers en gestion, qui peut
parfois rendre difficile le placement des diplômés dans des rôles spécifiques.
Les diplômés en Création et gestion d’entreprises affichent un taux d’adéquation notable de 68,3 %, avec
seulement 31,7 % en inadéquation. Ce résultat est encourageant et souligne la pertinence de cette formation,
qui semble mieux préparer les étudiants aux exigences du marché. Cela est en accord avec l'idée que les
compétences acquises dans cette filière sont polyvalentes et directement applicables, permettant aux
diplômés de mieux s'intégrer dans le monde professionnel.
Pour la filière Organisation et gestion des organisations, le taux d’adéquation est de 46,5 %, avec une
inadéquation de 53,5 %. Cela met en évidence un défi similaire à celui rencontré dans d'autres domaines,
où les diplômés sont souvent confrontés à des emplois ne correspondant pas à leur formation.
Enfin, la filière Sciences et techniques commerciales se démarque avec un impressionnant taux de 89,7 %
de diplômés qualifiés pour leurs postes, et seulement 10,3 % en inadéquation. Cette performance
exceptionnelle souligne que les compétences acquises dans ce domaine répondent mieux aux besoins du
marché, contrastant fortement avec les résultats des autres filières, notamment celles affichant des taux de
surqualification élevés.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 31 : Inadéquation du domaine d’études des diplômés par filière de formation
42,3%
55,9% 52,7%
68,3%
46,5%
89,7%
52,1%
57,7%
44,1% 47,3%
31,7%
53,5%
10,3%
47,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Assurance
banque finances
Economie Gestion Création et
gestion
d’entreprises
Organisation et
gestion des
organisations
Sciences et
techniques
commerciales
Ensemble
Adéquation du domaine d’études Inadéquation du domaine d’études
 |
67 67 |
▲back to top |
67
3.4.3.3. Qualité des emplois
L'analyse des données concernant la qualité des emplois montre une nette disparité entre les sexes en termes
de taux d'insertion et d'adéquation des postes. En moyenne, 69,9 % des diplômés sont insérés
professionnellement, mais seulement 9,6 % d'entre eux sont qualifiés pour les postes qu'ils occupent. Ce
faible taux de qualification reflète une inadéquation marquée entre les compétences acquises en formation
et les exigences des emplois occupés.
En détaillant selon le sexe, les hommes affichent un taux d'insertion de 79,5 %, nettement supérieur à celui
des femmes qui est de 49,9 %. Cette différence indique que les hommes accèdent plus facilement au marché
du travail. Toutefois, cette insertion ne se traduit pas nécessairement par une adéquation des postes, car
seulement 10,4 % des hommes sont qualifiés pour leur emploi. Chez les femmes, la situation est encore
plus préoccupante, avec seulement 7,0 % d'entre elles qualifiées pour leurs postes, soulignant une double
contrainte : un accès plus difficile au marché du travail et une plus grande inadéquation une fois insérée.
Ces données révèlent un déséquilibre significatif entre l'insertion professionnelle et la qualité des emplois,
particulièrement pour les femmes. Cela suggère la nécessité de renforcer les efforts pour améliorer
l'adéquation formation-emploi, notamment en ciblant les secteurs où les femmes sont sous-représentées ou
confrontées à des obstacles d'insertion et de qualification. En définitive, une meilleure préparation des
diplômés aux exigences du marché de l'emploi, en particulier pour les femmes, est essentielle pour une
insertion plus qualitative.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 32 : Taux d’insertion et inadéquation des postes selon le sexe
Les données relatives au taux d'insertion et à l'adéquation des postes selon les institutions d’enseignement
supérieures et de recherche (IESRS) montrent une situation globalement similaire en termes d'insertion,
mais des différences marquées en ce qui concerne la qualification pour les postes occupés.
En moyenne, 69,9 % des diplômés de la FSEG et 69,5 % de ceux de l'IUG sont insérés sur le marché du
travail, ce qui témoigne d'une performance relativement homogène en matière d'accès à l'emploi pour les
deux institutions. Cependant, la grande différence réside dans l'adéquation des postes occupés. À la FSEG,
seulement 8,6 % des diplômés sont qualifiés pour leurs postes, ce qui suggère une importante inadéquation
entre la formation reçue et les exigences des emplois obtenus. À l'IUG, ce pourcentage est beaucoup plus
élevé, avec 27,0 % des diplômés qui sont qualifiés pour les postes qu'ils occupent. Cette différence pourrait
79,5%
49,9%
69,9%
10,4%
7,0% 9,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Homme Femme Ensemble
Taux insertion Qualifiés pour le poste
 |
68 68 |
▲back to top |
68
s'expliquer par des programmes plus adaptés aux besoins du marché de l'emploi formel à l'IUG, ou encore
par une meilleure préparation des étudiants à intégrer des postes qui correspondent à leur niveau de
qualification.
En résumé, bien que les deux institutions affichent des taux d'insertion similaires, l'IUG semble offrir une
meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Cette situation reflète l'importance d'adapter les
curriculums académiques aux réalités du marché du travail, notamment pour les diplômés de la FSEG, où
l'inadéquation des postes occupés reste un défi majeur.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 33 : Taux d’insertion et inadéquation des postes selon l’IESRS
Les données révèlent des disparités significatives en termes de taux d'insertion et de qualification des
diplômés selon la filière de formation. Globalement, le taux d'insertion moyen est de 69,9 %, mais les
différentes filières affichent des performances variées à la fois en termes de taux d'insertion et d'adéquation
des postes.
Les filières de l'Organisation et gestion des organisations et de l'Économie se distinguent par un taux
d'insertion relativement élevé de 79,6 % et 73,5 %, respectivement. Cependant, la proportion de diplômés
qualifiés pour leurs postes dans la filière de l'Organisation et gestion des organisations est particulièrement
notable, avec 34,9 % des diplômés occupant des postes correspondant à leur niveau de qualification, un
résultat nettement supérieur à la moyenne générale de 9,6 %. Cette tendance se reflète également dans la
filière Création et gestion d'entreprises, où 34,1 % des diplômés sont qualifiés pour leurs postes, bien que
le taux d'insertion soit légèrement plus bas à 61,2 %. Cela peut s'expliquer par le fait que ces deux filières
préparent mieux leurs diplômés à des rôles spécifiques dans le secteur formel, ou qu'elles offrent des
compétences directement applicables dans la gestion d'organisations ou d'entreprises.
En revanche, les filières comme Assurance banque finances et Sciences et techniques commerciales, bien
que présentant des taux d'insertion respectifs de 72,0 % et 72,5 %, affichent des taux relativement faibles
de diplômés qualifiés pour leurs postes (5,4 % et 10,3 %). Cela suggère que les diplômés de ces filières,
bien qu'ils parviennent à s'insérer sur le marché de l'emploi, occupent souvent des postes qui ne
correspondent pas à leur niveau de qualification, ce qui pourrait être le signe d'une inadéquation entre la
formation reçue et les besoins du marché du travail dans ces secteurs.
69,9% 69,5% 69,9%
8,6%
27,0%
9,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Taux insertion Qualifiés pour le poste
 |
69 69 |
▲back to top |
69
La filière Gestion présente un taux d'insertion plus bas à 65,0 %, avec 11,4 % des diplômés qualifiés pour
leurs postes. Cela pourrait indiquer que, bien que l'insertion soit plus difficile, les diplômés qui trouvent un
emploi sont relativement mieux adaptés à leur poste que ceux de certaines autres filières.
En conclusion, cette analyse met en lumière l'importance de la filière de formation dans l'insertion
professionnelle et la qualité des emplois obtenus. Les diplômés de certaines filières semblent mieux
préparés à occuper des postes correspondant à leur niveau de qualification, tandis que d'autres filières,
malgré un bon taux d'insertion, affichent des niveaux élevés de surqualification.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 34 : Taux d’insertion et inadéquation des postes selon l’IESRS
72,0% 73,5%
65,0%
61,2%
79,6%
72,5%
69,9%
5,4%
8,1%
11,4%
34,1% 34,9%
10,3% 9,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Assurance banque
finances
Economie Gestion Création et
gestion
d’entreprises
Organisation et
gestion des
organisations
Sciences et
techniques
commerciales
Ensemble
Taux insertion Qualifiés pour le poste
 |
70 70 |
▲back to top |
70
3.4.4. Retour en formation
Cette section présente une analyse du contexte de reprise ou de poursuite de la formation, des motivations
des diplômés et de leur capacité à prendre des décisions face à une offre d'emploi.
3.4.4.1. Diplômés ayant repris la formation
Les données montrent que 4,6 % des diplômés de la promotion 2016-2019 de la FSEG et de l'IUG ont
choisi de reprendre ou de poursuivre une formation après l'obtention de leur diplôme de licence. Il est
intéressant de noter que cette tendance varie selon le sexe, avec 6,3 % des femmes qui ont repris la
formation, contre 3,8 % des hommes.
Cette différence peut être attribuée à plusieurs facteurs. D'une part, les femmes pourraient ressentir un
besoin plus important d'acquérir des compétences supplémentaires pour améliorer leur employabilité ou
accéder à des postes mieux rémunérés, compte tenu des disparités observées sur le marché de l'emploi entre
les sexes. D'autre part, il se peut que les femmes soient confrontées à des défis supplémentaires lors de leur
insertion professionnelle, les incitant à retourner à la formation pour augmenter leurs chances d'obtenir un
emploi qualifié.
En revanche, la proportion relativement faible d'hommes ayant repris une formation pourrait s'expliquer
par une perception différente des opportunités d'évolution professionnelle. Ce phénomène pourrait aussi
indiquer que les hommes se contentent plus souvent des premières opportunités d'emploi, même si elles ne
correspondent pas parfaitement à leurs qualifications, tandis que les femmes sont plus enclines à chercher
des moyens d'améliorer leur profil avant de s'engager pleinement dans le marché du travail.
Ces écarts mettent en évidence l'importance de prendre en compte les différences de genre dans l'élaboration
des politiques d'insertion professionnelle et de formation continue, afin de répondre aux besoins spécifiques
de chaque groupe.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 35: Proportion de diplômés ayant repris ou continué une formation par sexe (%)
Les données indiquent que 4,6 % des diplômés de licence de la FSEG et de l'IUG (promotion 2016-2019)
ont repris ou continué une formation après l'obtention de leur diplôme. Toutefois, une différence notable
apparaît entre les deux institutions : 4,7 % des diplômés de la FSEG ont poursuivi une formation
supplémentaire, contre seulement 3,1 % des diplômés de l'IUG.
3,8%
6,3%
4,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Homme Femme Ensemble
 |
71 71 |
▲back to top |
71
Cette distinction peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, les diplômés de la FSEG pourraient
ressentir une plus grande nécessité de renforcer leurs compétences ou de se spécialiser davantage pour
améliorer leurs perspectives d'emploi. Cela pourrait également refléter les réalités du marché du travail, où
les diplômés de la FSEG doivent peut-être faire face à une concurrence plus forte ou à une inadéquation
entre les compétences acquises et les besoins du marché.
En revanche, le taux plus faible de reprise de formation chez les diplômés de l'IUG pourrait indiquer une
meilleure adéquation entre leur formation initiale et les opportunités d'emploi disponibles. Cela correspond
également aux données antérieures qui montrent que les diplômés de l'IUG ont un meilleur accès au secteur
formel, ce qui pourrait limiter leur besoin de poursuivre une formation complémentaire.
Ces résultats soulignent l'importance de la qualité de la formation initiale et son adéquation avec le marché
du travail, mais aussi la nécessité pour certaines filières ou institutions de proposer des options de formation
continue adaptées aux réalités de chaque secteur.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 36: Proportion de diplômés ayant repris ou continué une formation par IESRS (%)
Les résultats montrent que la proportion de diplômés ayant repris ou poursuivi une formation après
l'obtention de leur diplôme de licence varie de manière significative selon la filière. En moyenne, 4,6 % des
diplômés de la FSEG et de l’IUG ont choisi de continuer leur formation. Toutefois, cette moyenne cache
des écarts notables entre les différentes spécialités.
Les filières de Création et gestion d'entreprises (6,0 %) et d'Assurance banque finances (5,3 %) enregistrent
les taux les plus élevés de poursuite de formation. Cela pourrait s'expliquer par la nécessité pour les
diplômés de ces domaines d'acquérir des compétences plus pointues ou d'obtenir des certifications
supplémentaires afin de répondre aux exigences spécifiques de leurs secteurs respectifs.
En revanche, certaines filières, comme les Sciences et techniques commerciales (0,0 %) et l'Organisation
et gestion des organisations (1,9 %), affichent des taux de reprise de formation nettement plus faibles. Cela
peut indiquer que les diplômés de ces filières considèrent que leur formation initiale est suffisante pour
répondre aux besoins du marché de l'emploi, ou que ces filières offrent des opportunités professionnelles
immédiates sans nécessiter une spécialisation supplémentaire.
Ces différences reflètent les caractéristiques propres à chaque filière et la perception des diplômés quant à
l'importance d'une formation complémentaire pour améliorer leur employabilité. Cela met également en
lumière la diversité des parcours de formation continue et la manière dont les diplômés de différentes
filières ajustent leurs compétences en fonction des opportunités et des exigences du marché du travail.
4,7%
3,1%
4,6%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
FSEG IUG Ensemble
 |
72 72 |
▲back to top |
72
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 37: Proportion de diplômés ayant repris ou continué une formation par filière (%)
3.4.4.2. Motivations pour la poursuite de la formation
Les résultats du tableau ci-après révèlent que les principales motivations pour la poursuite de la formation,
chez les diplômés de la FSEG et de l’IUG, sont largement dominées par l'acquisition de nouvelles
compétences. En effet, 85,6 % des diplômés déclarent poursuivre leurs études pour enrichir leurs
compétences. Cette tendance indique une forte conscience des diplômés concernant la nécessité d'une
formation continue afin de rester compétitifs sur le marché de l'emploi, qui évolue constamment.
Cependant, la recherche de stabilité de l'emploi est également un facteur motivant pour 8,6 % des diplômés,
bien que cette motivation soit plus marquée chez les femmes (12,3 %) que chez les hommes (5,7 %). Cette
différence pourrait s'expliquer par des préoccupations spécifiques au genre en matière de sécurité
professionnelle, les femmes pouvant être plus enclines à rechercher une stabilité accrue dans des contextes
d'incertitude.
Enfin, un petit pourcentage de diplômés (5,9 %) mentionne d'autres raisons pour poursuivre leurs études,
sans que l'amélioration du salaire ne figure parmi les motifs exprimés. Le fait que 0 % des diplômés aient
cité l'amélioration salariale comme motivation suggère que l'objectif principal est davantage lié à
l'amélioration des compétences et à la sécurisation de leur emploi, plutôt qu'à des attentes immédiates de
rémunération.
Ces données montrent que les diplômés adoptent une approche proactive face aux exigences du marché du
travail, en priorisant l'acquisition de compétences qui les rendent plus polyvalents et résilients, surtout dans
un environnement professionnel de plus en plus concurrentiel.
Tableau 27 : Motifs pour la poursuite de la formation par sexe
Motifs
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Amélioration du salaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Acquisition de nouvelles compétences 110 89,4 80 81,0 190 85,6
Stabilité de l'emploi 7 5,7 12 12,3 19 8,6
Autre 6 4,9 7 6,7 13 5,9
Ensemble 123 100,0 99 100,0 222 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les données du tableau ci-après montrent que la poursuite de la formation pour l'acquisition de nouvelles
compétences est la motivation principale pour les diplômés, quel que soit l'institut d'enseignement supérieur
de recherche (IESRS). Les diplômés de la FSEG (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion) sont
0,0%
1,9%
4,3%
4,7%
5,3%
6,0%
4,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Sciences et
techniques
commerciales
Organisation et
gestion des
organisations
Economie Gestion Assurance banque
finances
Création et
gestion
d’entreprises
Ensemble
 |
73 73 |
▲back to top |
73
85,0 % à indiquer cette motivation, tandis que ceux de l'IUG (Institut Universitaire de Gestion) atteignent
100 %. Cela souligne l'importance attribuée par les diplômés de ces deux institutions à la nécessité de
développer et renforcer leurs compétences pour rester compétitifs sur le marché du travail.
Concernant la stabilité de l'emploi, cette raison est mentionnée par 8,8 % des diplômés de la FSEG, mais
aucun diplômé de l'IUG n'a exprimé cette préoccupation. Cela peut s'expliquer par des différences dans les
perspectives d'emploi ou dans le profil des étudiants issus de ces deux institutions. Les diplômés de la FSEG
semblent plus soucieux de sécuriser leur poste, probablement en raison de la nature de leurs débouchés
professionnels.
Enfin, 6,2 % des diplômés de la FSEG citent des motifs divers pour justifier la poursuite de leur formation,
tandis que là encore, aucun diplômé de l'IUG n'a mentionné d'autres raisons.
Ces résultats révèlent que, bien que la plupart des diplômés poursuivent une formation pour enrichir leurs
compétences, les préoccupations en matière de sécurité de l'emploi varient selon l'institution, la FSEG
semblant avoir une population étudiante plus préoccupée par la stabilité dans leur parcours professionnel.
Tableau 28 : Motifs pour la poursuite de la formation par IESRS
Motifs
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Acquisition de nouvelles compétences 182 85,0 8 100,0 190 85,6
Stabilité de l'emploi 19 8,8 0 0,0 19 8,6
Autre 13 6,2 0 0,0 13 5,9
Ensemble 214 100,0 8 100,0 222 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les résultats montrent des motivations différenciées pour la poursuite de la formation selon les filières,
avec une prédominance de l'acquisition de nouvelles compétences. Par exemple, les diplômés en Création
et gestion d’entreprises et en Organisation et gestion des organisations sont unanimes (100 %) à poursuivre
leur formation pour renforcer leurs compétences. Cette tendance peut être liée à la nécessité de rester
compétitif dans des filières où l'entrepreneuriat et la gestion d'organisations exigent une mise à jour
constante des compétences.
Dans des domaines comme Assurance banque finances (90,9 %) et Gestion (91,7 %), l'acquisition de
nouvelles compétences est également le motif principal, mais une minorité (respectivement 9,1 % et 8,3 %)
cite la stabilité de l'emploi comme raison de continuer à se former. Cela suggère que dans ces filières, les
diplômés peuvent voir la formation continue comme un moyen d'assurer leur maintien dans un
environnement professionnel exigeant.
Les diplômés en Économie montrent une diversité plus marquée dans leurs motivations : si 72,7 %
poursuivent une formation pour acquérir de nouvelles compétences, 18,2 % invoquent d'autres raisons.
Cette diversité pourrait être due à la polyvalence de cette filière, où les diplômés peuvent se diriger vers des
carrières très différentes nécessitant des compétences variées.
À l'inverse, les diplômés en Sciences et techniques commerciales n'ont pas poursuivi de formation, ce qui
pourrait indiquer une insertion professionnelle rapide ou la suffisance des compétences acquises durant la
formation initiale pour répondre aux exigences du marché du travail dans ce domaine.
 |
74 74 |
▲back to top |
74
En somme, les motivations pour la poursuite de la formation varient en fonction des filières, reflétant à la
fois les exigences spécifiques des secteurs et les aspirations des diplômés dans leur carrière.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 38: Motifs pour la poursuite de la formation par filière de formation (%)
3.4.4.3. Décision face à une offre d'emploi pendant la formation
Les résultats de la prise de décision face à une offre d'emploi pendant la formation montrent que la majorité
des diplômés, hommes comme femmes, choisissent d’accepter l'emploi tout en poursuivant leurs études en
parallèle. Cette option est retenue par 72,7 % des répondants, avec une légère différence entre les hommes
(73,2 %) et les femmes (71,7 %). Cela indique que, pour beaucoup, l'entrée sur le marché du travail n'est
pas perçue comme un obstacle à la poursuite de la formation, mais plutôt comme une opportunité à concilier
les deux.
Cependant, une proportion non négligeable des diplômés, soit 23,5 %, décide de mettre la formation en
pause pour accepter une offre d'emploi. Cette tendance est légèrement plus marquée chez les femmes (27,3
%) que chez les hommes (20,3 %). Ce choix pourrait refléter des contraintes financières ou des priorités
professionnelles qui amènent certains diplômés à privilégier l'emploi à court terme, avec l’intention de
reprendre la formation ultérieurement.
Enfin, une minorité, 3,9 % des diplômés, refuse l'offre d'emploi pour se concentrer pleinement sur leurs
études. Ce choix est plus fréquent chez les hommes (6,5 %) que chez les femmes (1,0 %), ce qui pourrait
s'expliquer par une volonté de maximiser les bénéfices de la formation avant d'entrer sur le marché du
travail, ou par des différences dans les opportunités d'emploi perçues.
Tableau 29 : Prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation par sexe
Prise de décision
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Accepter l'emploi et continuer la formation/études en parallèle 90 73,2 71 71,7 161 72,7
Accepter l'emploi et mettre la formation/études en pause 25 20,3 27 27,3 52 23,5
Refuser l'emploi pour se concentrer sur la formation/études 8 6,5 1 1,0 9 3,9
Ensemble 123 100,0 99 100,0 222 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les données issues de l'enquête révèlent des différences intéressantes entre les diplômés de la FSEG et ceux
de l'IUG concernant leur prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation. Pour la majorité
des diplômés, accepter l'emploi tout en poursuivant la formation reste la stratégie privilégiée. Cette tendance
90,9%
72,7%
91,7%
100,0%
100,0%
85,6%
9,1%
9,1%
8,3%
8,6%
18,2%
5,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Acquisition de nouvelles compétences Stabilité de l'emploi Autre
 |
75 75 |
▲back to top |
75
est plus marquée chez les diplômés de la FSEG avec 72,9 %, contre 62,4 % chez ceux de l'IUG. Cela montre
une plus grande flexibilité des diplômés de la FSEG dans la gestion des deux responsabilités en parallèle.
Concernant ceux qui choisissent de mettre leur formation en pause pour accepter un emploi, la différence
est frappante : 24,3 % des diplômés de la FSEG optent pour cette solution, alors que ce choix est inexistant
chez les diplômés de l'IUG. Cette disparité pourrait être liée aux conditions de marché spécifiques ou aux
opportunités d'emploi disponibles pour les deux groupes de diplômés. Les diplômés de l'IUG semblent
moins enclins à sacrifier leur formation, peut-être parce qu'ils estiment que la valeur de leur diplôme est
plus élevée à long terme.
Enfin, une proportion très minoritaire de diplômés, particulièrement élevée chez les diplômés de l'IUG
(37,6 %), choisit de refuser l'offre d'emploi pour se concentrer uniquement sur leurs études. Ce
comportement contraste fortement avec celui des diplômés de la FSEG, où seuls 2,8 % d'entre eux font ce
choix. Ce dernier point pourrait suggérer une approche plus prudente des diplômés de l'IUG quant à la
gestion de leur capital humain, en préférant terminer leur formation avant d'intégrer le marché du travail.
Tableau 30 : Prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation par IESRS
Prise de décision
FSEG IUG Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Accepter l'emploi et continuer la formation/études en parallèle 156 72,9 5 62,4 161 72,7
Accepter l'emploi et mettre la formation/études en pause 52 24,3 0 0,0 52 23,5
Refuser l'emploi pour se concentrer sur la formation/études 6 2,8 3 37,6 9 3,9
Ensemble 214 100,0 8 100,0 222 100,0
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Les résultats de l'enquête révèlent des disparités importantes dans la prise de décision face à une offre
d'emploi pendant la formation en fonction des filières. Globalement, 72,7 % des diplômés choisissent de
continuer leur formation tout en acceptant l'emploi, tandis que 23,5 % préfèrent mettre en pause leur
formation, et une petite proportion de 3,9 % décide de refuser l'emploi pour se concentrer sur leurs études.
En examinant les résultats par filière, les diplômés en assurance banque finances et en gestion sont les plus
enclins à poursuivre leur formation tout en travaillant, avec respectivement 82 % et 83 % de ce choix. Ces
données montrent une certaine capacité d'adaptation et de gestion des deux engagements simultanément
dans ces filières. Dans la filière économie, une proportion importante (45,5 %) des diplômés préfère mettre
leur formation en pause pour accepter l'emploi, ce qui peut indiquer une pression particulière à s'insérer
rapidement sur le marché du travail ou des opportunités d'emploi attractives nécessitant une implication
immédiate.
Les diplômés en création et gestion d'entreprises montrent une plus grande diversité dans leurs choix : 75
% continuent leur formation tout en travaillant, mais 25 % choisissent de refuser l'offre pour se concentrer
sur leurs études, soulignant l'importance qu'ils accordent à l'achèvement de leur formation avant d'intégrer
le marché du travail.
Un cas particulier se présente pour les diplômés en organisation et gestion des organisations, où 100 %
d'entre eux préfèrent refuser l'emploi pour terminer leurs études, une tendance qui pourrait refléter la
spécificité de cette filière ou la perception que le diplôme complet est crucial pour de meilleures
perspectives professionnelles.
 |
76 76 |
▲back to top |
76
Ces résultats mettent en lumière que les stratégies adoptées face à une offre d'emploi varient non seulement
selon le sexe ou l'institution de formation, mais également en fonction de la filière d'études, reflétant des
dynamiques de marché et des attentes spécifiques à chaque domaine.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 39: Prise de décision face à une offre d'emploi en cours de formation par sexe (%)
82,0%
55,0%
83,0%
75,0%
72,7%
9,1%
45,5%
16,7%
23,5%
9,1%
25,0%
100,0%
3,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Assurance banque finances
Economie
Gestion
Création et gestion d’entreprises
Organisation et gestion des organisations
Sciences et techniques commerciales
Ensemble
Accepter l'emploi et continuer la formation/études en parallèle Accepter l'emploi et mettre la formation/études en pause
Refuser l'emploi pour se concentrer sur la formation/études
 |
77 77 |
▲back to top |
77
3.5. Parcours d’insertion professionnelle
Cette section du rapport propose une analyse des parcours d'insertion professionnelle des diplômés de
licence de la FSEG et de l'IUG, promotion 2016-2019. Cette analyse repose sur le calendrier professionnel
reconstitué par les diplômés lors d'une enquête menée entre août et septembre 2024, couvrant la période
depuis l'obtention de leur diplôme jusqu'à la date de l'entretien, soit environ 56 mois. Le questionnaire
permet ainsi de suivre, mois par mois, l'évolution de la situation professionnelle des diplômés sur le marché
du travail, depuis la fin de leurs études jusqu'à la date de l'enquête.
3.5.1. Typologie des parcours d’entrée dans la vie active des diplômés
En effet, nous avons identifié quatre trajectoires types dont les diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG,
promotion 2016-2019 ont suivi. Les résultats montrent que plus de 77% des diplômés finissent par accéder
à l'emploi, bien que certains mettent plus de temps à y parvenir. Les 15% confrontés au chômage persistant
sont un signe de dysfonctionnements qui pourraient être liés à des facteurs structurels, économiques, ou à
des décalages entre l'offre éducative et les besoins du marché. Par ailleurs, les diplômés qui empruntent des
parcours alternatifs, comme le recours à la formation pour s'insérer, démontrent la nécessité de stratégies
adaptatives pour s'ajuster aux réalités du marché.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 40 : Trajectoires types d’insertion des diplômés
3.5.1.1. Accès progressif et durable à un emploi
53,7 % des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019, ont suivi un parcours
d’insertion marqué par un accès progressif et durable à l'emploi. En moyenne, au cours des cinquante-six
mois suivant la fin de leur formation en licence, 74,2 % de ces diplômés ont occupé un poste. Au fil de ce
parcours, le taux d’insertion a considérablement augmenté, passant de 32,3 % en janvier 2020 à 95,3 % en
août 2024. Cependant, 51,6 % de ces diplômés ont occupé un emploi salarié, et 88,9 % d'entre eux n’ont
eu qu'un seul emploi durant la période de janvier 2020 à août 2024. Il est à noter que seulement 14,1 % des
emplois occupés par ces diplômés sont de nature formelle.
7,8%
53,7%
23,5%
15,0%Passage de la formation, via le
chômage, vers l'emploi
Accès progressif et durable à un
emploi
Chômage vers l'emploi
Chômage persistant
 |
78 78 |
▲back to top |
78
Source : Enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés en Sciences économiques et de gestion du Mali (cohorte 2016-2014), ONEF 2024
Graphique 41 : Parcours d’accès progressif et durable à un emploi
3.5.1.2. Passage de la formation, via le chômage, vers l'emploi
Soixante-dix-huit pourcents des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019 sont
passés de la formation, via le chômage pour occuper un emploi. Entre janvier 2021 et mars 2022, 80,9 %
des diplômés de ce parcours étaient encore en formation. Par la suite, ils ont souvent connu une transition
marquée par une période de chômage avant d’accéder à un emploi. Ce n’est qu’à partir de janvier 2022 que
l’insertion professionnelle de ces diplômés a véritablement débuté, avec un taux passant de 4,9 % en janvier
2022 à 48,5 % en juillet 2024. Cependant, malgré cette progression significative, l’accès à l’emploi reste
tardif et les postes obtenus sont souvent de faible qualité, comme en témoigne le fait que seulement 6,4 %
des diplômés ont décroché un emploi formel.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 42 : Parcours de passage de la formation, via le chômage, vers l'emploi
3.5.1.3. Chômage persistant
Quinze pourcents des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019 ont connu un
parcours marqué par un chômage persistant. En 2020, 20,1 % des diplômés étaient encore en formation
entre janvier et décembre. Cependant, cette formation n'a pas suffi à leur permettre d'accéder à un emploi.
En effet, après sa fin, le taux de chômage a considérablement augmenté, passant de 68,4 % en décembre
2020 à 90,9 % en janvier 2021, tandis que le taux d'insertion professionnelle restait pratiquement nul. Par
la suite, entre janvier 2021 et août 2024, 90,6 % de ces diplômés sont restés en moyenne au chômage,
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
janv-20 juil-20 janv-21 juil-21 janv-22 juil-22 janv-23 juil-23 janv-24 juil-24
0%
20%
40%
60%
80%
100%
janv-20 juil-20 janv-21 juil-21 janv-22 juil-22 janv-23 juil-23 janv-24 juil-24
 |
79 79 |
▲back to top |
79
atteignant un pic de 95,7 % en avril 2023. Toutefois, une amélioration a été constatée à partir de mars 2024,
lorsque le taux d'insertion a progressivement augmenté, passant de 9,0 % en mars à 18,8 % en août 2024.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 43 : Parcours de Chômage persistant
3.5.1.4. Chômage vers l'emploi
Vingt-trois pourcents et demi % des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019 ont
suivi un parcours de sortie de chômage vers l’emploi. Au début de l'année 2020, aucun diplômé n'avait
encore accédé à un emploi. Cependant, dès janvier 2021, la situation s'améliore avec 11,3 % des diplômés
en poste, et ce pourcentage continue de croître régulièrement pour atteindre 57,4 % en août 2024. Ce
parcours d'insertion professionnelle reflète une progression constante, bien que toujours en cours, vers un
accès durable à l'emploi pour la majorité des diplômés après 56 mois.
À l'inverse, la courbe du chômage suit une tendance décroissante. En janvier 2020, 50,2 % des diplômés
étaient au chômage, mais ce taux diminue progressivement, bien que marqué par quelques fluctuations,
pour atteindre 36,9 % en août 2024. Cette réduction du chômage, particulièrement visible à partir de la fin
de 2022, correspond à une amélioration notable de l'accès à l'emploi.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 44 : Parcours de chômage vers l'emploi
0%
20%
40%
60%
80%
100%
janv-20 juil-20 janv-21 juil-21 janv-22 juil-22 janv-23 juil-23 janv-24 juil-24
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
janv-20 juil-20 janv-21 juil-21 janv-22 juil-22 janv-23 juil-23 janv-24 juil-24
 |
80 80 |
▲back to top |
80
3.5.2. Facteurs influençant l’insertion professionnelle
Dans de nombreuses études sur l'insertion professionnelle des diplômés menées à travers le monde, il est
clairement établi que des facteurs tels que le sexe du diplômé continue d'exercer une influence significative
sur leur insertion professionnelle. Cette sous-section se concentrera sur l'analyse de ces facteurs
déterminants dans le processus d'intégration des diplômés sur le marché du travail.
3.5.2.1. Sexe comme facteur d’insertion professionnelle
L'analyse des parcours d'insertion par sexe montre des inégalités marquées entre hommes et femmes, tant
en termes d'accès à un emploi durable qu'en matière de chômage persistant. Les femmes semblent davantage
exposées à des périodes de chômage prolongé et rencontrent plus de difficultés pour accéder à un emploi
stable après leur formation. Ces résultats soulignent la nécessité de politiques spécifiques pour réduire ces
écarts, notamment des mesures pour améliorer l'accès des femmes au marché du travail, combattre les
discriminations et faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 45 : Parcours d’insertion et sexe
3.5.2.2. IESRS comme facteur d’insertion professionnelle
Les diplômés des deux institutions, la FSEG et l'IUG, présentent des taux similaires et relativement élevés
d'accès à un emploi durable (environ 53%). Toutefois, les diplômés de la FSEG semblent effectuer une
transition plus rapide de la formation à l'emploi, tandis que ceux de l'IUG connaissent plus fréquemment
une période de chômage, ou y restent plus longtemps. En revanche, un plus grand nombre de diplômés de
l'IUG choisissent de suivre des formations après une phase de chômage, ce qui pourrait leur permettre de
renforcer leurs compétences et d'améliorer leurs perspectives professionnelles à long terme.
6,0%
11,7% 7,8%
63,1%
34,3%
53,7%
9,8%
25,8%
15,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Homme Femme Ensemble
Passage de la formation, via le chômage, vers l'emploi Accès progressif et durable à un emploi Chômage vers l'emploi Chômage persistant
 |
81 81 |
▲back to top |
81
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 46 : Parcours d’insertion et IESRS
3.5.2.3. Filière comme facteur d’insertion professionnelle
Les données du graphique ci-dessous révèlent des variations significatives dans les trajectoires d'insertion
professionnelle des diplômés, en fonction des filières de formation suivies. Chaque filière présente des
caractéristiques propres qui influencent le passage à l'emploi, la persistance du chômage ou l'accès à un
emploi stable. Ces disparités sont le reflet des dynamiques spécifiques à chaque secteur et de la demande
du marché du travail pour les compétences acquises.
Le pourcentage de diplômés traversant une période de chômage avant de trouver un emploi varie selon les
filières. Les diplômés en création et gestion d’entreprises (20,9%) et en sciences et techniques commerciales
(15%) sont les plus concernés par ce parcours, ce qui indique des difficultés initiales d'insertion. En
revanche, les diplômés en organisation et gestion des organisations ne connaissent pas ce type de parcours
(0%), suggérant que cette filière offre de meilleures opportunités d'emploi immédiat.
L'accès à un emploi durable est également inégal selon les filières. Les diplômés en organisation et gestion
des organisations (72,2%) et en économie (58,9%) accèdent plus facilement à un emploi stable, reflétant
une forte demande pour ces compétences. À l'inverse, les diplômés en création et gestion d’entreprises
(38,8%) et en gestion (47,1%) connaissent des taux plus faibles d'accès à un emploi durable, probablement
en raison de la nature entrepreneuriale de ces formations, où de nombreux diplômés optent pour des projets
personnels plutôt que pour des emplois stables.
La transition directe du chômage à l'emploi est particulièrement notable chez les diplômés en gestion (30%)
et en économie (21,7%), illustrant la capacité de ces filières à faciliter une réinsertion rapide après une
période de chômage. À l'opposé, les diplômés en sciences et techniques commerciales (2,5%) éprouvent
plus de difficultés à passer du chômage à l'emploi, ce qui pourrait révéler une inadéquation entre les
compétences acquises et les opportunités du marché.
Le chômage persistant est particulièrement présent chez les diplômés en création et gestion d’entreprises
(31,3%) et en sciences et techniques commerciales (27,5%), signalant un risque accru de rester sans emploi
7,5%
12,9%
7,8%
53,7%
53,9%
53,7%
24,3% 10,9% 23,5%
14,5%
22,3%
15,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Passage de la formation, via le chômage, vers l'emploi Accès progressif et durable à un emploi Chômage vers l'emploi Chômage persistant
 |
82 82 |
▲back to top |
82
sur le long terme dans ces filières. Cela peut s'expliquer par une saturation du marché ou une demande
insuffisante pour certaines compétences spécifiques. Les diplômés en organisation et gestion des
organisations (5,6%) et en économie (12,3%) sont les moins touchés par ce phénomène, ce qui témoigne
de meilleures perspectives d'insertion dans ces secteurs.
En fin, l'analyse des parcours d'insertion selon les filières met en évidence des disparités importantes. Les
filières comme organisation et gestion des organisations et économie offrent de meilleures perspectives
d'emploi stable et une insertion plus rapide, tandis que les filières orientées vers la création d'entreprises et
les sciences commerciales posent davantage de défis en matière de chômage persistant et de transition vers
l'emploi.
Source : Enquête auprès des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 47 : Parcours d’insertion et filière de formation
10,2% 7,1% 6,2%
20,9%
15,0%
7,8%
56,5% 58,9%
47,1%
38,8%
72,2%
55,0%
53,7%
14,5% 12,3% 16,7%
31,3%
5,6%
27,5%
15,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Assurance banque
finances
Economie Gestion Création et gestion
d’entreprises
Organisation et gestion
des organisations
Sciences et techniques
commerciales
Ensemble
Passage de la formation, via le chômage, vers l'emploi Accès progressif et durable à un emploi Chômage vers l'emploi Chômage persistant
 |
83 83 |
▲back to top |
83
3.6. Employabilité des diplômés
Cette section présente les caractéristiques des entreprises qui ont recruté des diplômés de la FSEG et de
l’IUG de la promotion 2016-2019. Elle analyse la taille des entreprises, le rôle et les tâches des diplômés
au sein de celles-ci, ainsi que la dynamique de leur recrutement. Par ailleurs, elle examine les attentes des
employeurs et évalue leur degré de satisfaction quant à l'emploi de ces diplômés.
3.6.1. Caractéristiques des entreprises ayant recruté les diplômés
Les entreprises sont d'abord présentées telles que révélées par l'enquête. Ensuite, leurs caractéristiques sont
analysées à travers une classification basée sur la taille de l'entreprise, le type d'entreprise, le rôle des
diplômés au sein de l'entreprise et l'évaluation de l'exécution des tâches par les diplômés.
3.6.1.1. Taille des entreprises
Les données sur la taille des entreprises qui ont recruté des diplômés en sciences économiques et gestion
de la cohorte 2016-2019 révèlent une répartition intéressante. La majorité des diplômés ont été embauchés
par des entreprises de petite et moyenne taille. En effet, 35,2% des entreprises qui les ont recrutés comptent
entre 10 et 49 salariés, tandis que 33,0% ont entre 50 et 250 salariés. Les très petites entreprises, ayant
moins de 10 salariés, représentent 25,0% des recruteurs. Enfin, seulement une minorité de 6,8% des
diplômés ont été embauchés par de grandes entreprises comptant plus de 250 salariés.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 48 : Taille de l’entreprise
L'analyse globale de ces données révèle que les entreprises de taille moyenne (10-49 et 50-250 salariés)
sont les plus fréquentes dans tous les types d'organisations, représentant une proportion significative des
diplômés employés. Les entreprises privées et les ONG jouent un rôle clé dans l'emploi des diplômés,
surtout dans des entreprises de taille moyenne, tandis que les grandes entreprises (plus de 250 salariés) sont
peu représentées. Les très petites structures (moins de 10 salariés) sont présentes principalement dans le
secteur public et privé, mais sont presque inexistantes dans les ONG et les organisations internationales.
Ce panorama montre la diversité des structures employant les diplômés, mais aussi certaines limitations,
notamment l'absence de très grandes entreprises, en particulier dans les secteurs publics et ONG.
25,0%
35,2%
33,0%
6,8%
Moins de 10 salariés 10-49 salariés 50-250 salariés Plus de 250 salariés
 |
84 84 |
▲back to top |
84
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 49 : Taille de l’entreprise selon le type d’entreprise
L'analyse des données montre que la majorité des diplômés de la FSEG et de l'IUG trouvent un emploi dans
des entreprises de taille moyenne, avec une prédominance plus marquée dans les entreprises de 10 à 49
salariés pour les diplômés de la FSEG (38,5 %), tandis que les diplômés de l'IUG sont plus représentés dans
les entreprises de 50 à 250 salariés (47,8 %). Les très petites entreprises (moins de 10 salariés) accueillent
une proportion plus importante de diplômés de la FSEG que de l'IUG, tandis que les grandes entreprises de
plus de 250 salariés restent une minorité pour les deux groupes.
Cette répartition reflète des stratégies d'insertion différentes : les diplômés de la FSEG semblent plus
présents dans les petites et moyennes entreprises, tandis que ceux de l'IUG s'insèrent davantage dans des
entreprises de taille intermédiaire, notamment les structures comptant entre 50 et 250 salariés.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 50 : Taille de l’entreprise selon l’IESRS du diplômé
33,3% 31,7%
25,0%
33,3% 34,9%
40,0%
35,2%
33,3%
25,4%
60,0%
100,0%
33,0%
7,9% 6,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Entreprise publique ou
parapublique
Entreprise privée ONG Organisation
internationale
Ensemble
Moins de 10 salariés 10-49 salariés 50-250 salariés Plus de 250 salariés
27,7%
17,4%
25,0%
38,5%
26,1%
35,2%
27,7%
47,8%
33,0%
6,2% 8,7% 6,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Moins de 10 salariés 10-49 salariés 50-250 salariés Plus de 250 salariés
 |
85 85 |
▲back to top |
85
3.6.1.2. Rôle des diplômés dans l’entreprise
Dans l'ensemble, 28,4 % des employeurs estiment que le diplôme est indispensable pour obtenir un emploi,
avec une reconnaissance particulièrement marquée dans les organisations internationales (100 %) et
l'administration publique (45,5 %). Ce pourcentage est nettement plus bas dans les entreprises privées (27
%) et les ONG (20 %), où d'autres critères semblent jouer un rôle prépondérant.
Par ailleurs, 43,2 % des employeurs reconnaissent l'importance du diplôme tout en étant ouverts à d'autres
qualifications, notamment dans les entreprises publiques (66,7 %) et les ONG (70 %), ce qui reflète une
certaine souplesse dans leurs critères de recrutement. En revanche, 26,1 % des employeurs n'appliquent pas
de politique spécifique concernant les diplômes, surtout dans le secteur privé (31,7 %), ce qui peut indiquer
que des compétences pratiques ou l'expérience professionnelle sont souvent privilégiées. Et, seulement 2,3
% des employeurs se disent indécis sur la question, montrant ainsi que la majorité des recruteurs ont une
position claire quant à l'importance des qualifications académiques.
L'analyse révèle une reconnaissance variable des diplômes selon les secteurs. Les organisations
internationales et l'administration publique accordent plus de poids aux diplômes, tandis que le secteur privé
et les ONG adoptent des critères de sélection plus flexibles. Cette diversité reflète les attentes et priorités
spécifiques des employeurs en fonction de leur domaine d'activité.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 51 : Reconnaissance des diplômes dans l’entreprise selon le type d’entreprise
Globalement, 28,4 % des employeurs estiment que le diplôme est essentiel pour décrocher un emploi, avec
une reconnaissance légèrement supérieure pour les diplômés de l'IUG (30,4 %) comparé à ceux de la FSEG
(27,7 %). Par ailleurs, 43,2 % des employeurs reconnaissent l'importance des diplômes, tout en étant ouverts
à d'autres qualifications, une ouverture plus marquée pour les diplômés de l'IUG (60,9 %) que pour ceux
de la FSEG (36,9 %).
45,5%
27,0%
20,0%
100,0%
28,4%
36,4%
66,7%
39,7%
70,0%
43,2%
18,2%
31,7%
10,0%
26,1%
33,3% 1,6% 2,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Administration
publique
Entreprise
publique ou
parapublique
Entreprise privée ONG Organisation
internationale
Ensemble
Je ne sais pas
Non, il n’y a pas de politique à cet égard
Oui, mais d’autres diplômes peuvent être pris en considération
Oui, ce diplôme est essentiel pour obtenir ce genre d’emploi dans notre entreprise
 |
86 86 |
▲back to top |
86
À l'inverse, 26,1 % des employeurs n'ont pas de politique spécifique en matière de diplômes, une proportion
nettement plus élevée pour les diplômés de la FSEG (33,8 %) que pour ceux de l'IUG (4,3 %), suggérant
que le diplôme de l'IUG joue un rôle plus structurant dans les processus de recrutement. En outre, 2,3 %
des employeurs ne savent pas comment le diplôme influence leur processus de recrutement, cette incertitude
étant plus fréquente pour les diplômés de l'IUG (4,3 %) que pour ceux de la FSEG (1,5 %).
L'analyse montre que le diplôme de l'IUG est perçu comme plus déterminant que celui de la FSEG dans les
recrutements. Bien que les employeurs restent ouverts à d'autres qualifications, ils semblent accorder une
plus grande importance au diplôme de l'IUG, témoignant d'une moindre flexibilité par rapport à celui de la
FSEG. Cela reflète des attentes et des pratiques de recrutement légèrement distinctes selon l'institution de
formation.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 52 : Reconnaissance des diplômes dans l’entreprise selon l’IESRS du diplômé
3.6.1.3. Exécution des tâches
L'analyse des données du tableau ci-dessous révèle la perception des employeurs concernant la capacité des
diplômés à exécuter les tâches en fonction du type d'entreprise. Les résultats montrent une satisfaction
globale des employeurs, notamment en ce qui concerne l'attitude professionnelle et la maîtrise des
connaissances théoriques. Les entreprises publiques et les organisations internationales affichent des
niveaux d'approbation plus élevés, tandis que les entreprises privées et les ONG ont des attentes plus
variées, notamment en ce qui concerne l'initiative, la productivité immédiate et la spécialisation.
27,7% 28,4%
36,9%
60,9%
43,2%
33,8%
26,1%
1,5% 4,3% 2,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
FSEG IUG Ensemble
Je ne sais pas
Non, il n’y a pas de politique à cet égard
Oui, mais d’autres diplômes peuvent être pris en considération
Oui, ce diplôme est essentiel pour obtenir ce genre d’emploi dans notre entreprise
 |
87 87 |
▲back to top |
87
Tableau 31 : Niveau d’exécution des tâches par les diplômés selon le type d’entreprise (%)
Exécution des tâches
Administration
publique
Entreprise
publique ou
parapublique
Entreprise
privée
ONG Organisation
internationale
Total
Connaissances
théoriques
Accord 81,8 100,0 90,5 90,0 100,0 89,8
Désaccord 18,2 0,0 9,5 10,0 0,0 10,2
Non applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Attitude à l’égard
du travail
Accord 100,0 100,0 96,8 100,0 100,0 97,7
Désaccord 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 2,3
Non applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Initiative
créatrice
Accord 90,9 100,0 95,2 90,0 100,0 94,3
Désaccord 0,0 0,0 4,8 10,0 0,0 4,5
Non applicable 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Planification du
travail
Accord 90,9 100,0 95,2 90,0 100,0 94,3
Désaccord 9,1 0,0 4,8 10,0 0,0 5,7
Non applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Immédiatement
plus productif
Accord 90,9 100,0 92,1 80,0 100,0 90,9
Désaccord 9,1 0,0 7,9 20,0 0,0 9,1
Non applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spécialiser dans
le domaine de
l’entreprise
Accord 72,7 100,0 85,7 90,0 100,0 85,2
Désaccord 18,2 0,0 6,3 0,0 0,0 6,8
Non applicable 9,1 0,0 7,9 10,0 0,0 8,0
Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Dans l'ensemble, les diplômés de la FSEG et de l'IUG montrent de solides compétences dans l'exécution
de leurs tâches. Les employeurs valorisent particulièrement l'attitude professionnelle et les connaissances
théoriques, mais les diplômés de l'IUG sont perçus comme ayant de meilleures compétences en matière
d'initiative, de planification et de spécialisation. Les résultats indiquent également que, bien que les
diplômés de la FSEG soient généralement bien appréciés, certains domaines, comme la productivité
immédiate et la spécialisation, nécessitent une attention particulière pour améliorer leur reconnaissance sur
le marché du travail.
Tableau 32 : Niveau d’exécution des tâches par les diplômés selon l’IESRS fréquenté par le diplômé (%)
Exécution des tâches FSEG IUG Total
Connaissances
théoriques
Accord 90,8 87,0 89,8
Désaccord 9,2 13,0 10,2
Non applicable 0,0 0,0 0,0
Attitude à l’égard du
travail
Accord 96,9 100,0 97,7
Désaccord 3,1 0,0 2,3
Non applicable 0,0 0,0 0,0
Initiative créatrice
Accord 92,3 100,0 94,3
Désaccord 6,2 0,0 4,5
Non applicable 1,5 0,0 1,1
Planification du travail
Accord 93,8 95,7 94,3
Désaccord 6,2 4,3 5,7
Non applicable 0,0 0,0 0,0
Immédiatement plus
productif
Accord 92,3 87,0 90,9
Désaccord 7,7 13,0 9,1
Non applicable 0,0 0,0 0,0
Spécialiser dans le
domaine de l’entreprise
Accord 81,5 95,7 85,2
Désaccord 7,7 4,3 6,8
Non applicable 10,8 0,0 8,0
Total 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
88 88 |
▲back to top |
88
3.6.2. Recrutement dans les entreprises
Cette partie analyse les dynamiques de recrutement et de rendement des diplômés de la FSEG et de l'IUG,
basées sur les données issues de l'enquête sur la satisfaction des employeurs. Il met en lumière les tendances
du marché de l'emploi entre 2019 et 2026, ainsi que la progression du rendement des diplômés au fil du
temps.
3.6.2.1. Évolution et perspectives de recrutements
L'analyse des données concernant le recrutement dans les entreprises employant des diplômés de la FSEG
et de l'IUG, en fonction de leur taille, met en lumière les tendances d'embauche, tant pour la période de
2019 à aujourd'hui que pour les deux années à venir (2025 et 2026).
En faisant le bilan des recrutements passés et prévus, on constate que les entreprises ont recruté 1945
diplômés depuis 2019, tandis qu'elles prévoient d'en embaucher 927 dans les deux années à venir. Ce total
révèle une contraction significative du marché de l'emploi pour cette spécialité, avec une réduction de près
de 50 % des recrutements anticipés.
Les données illustrent une évolution des pratiques de recrutement. Bien que certaines catégories
d'entreprises, notamment les plus petites, affichent une volonté d'accroître leurs effectifs, le total des
recrutements projetés pour les années à venir indique une tendance à la baisse. Cette situation nécessite une
attention particulière de la part des institutions de formation afin d'adapter leurs programmes aux besoins
évolutifs du marché de l'emploi.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 53 : Effectif des recrues selon la taille de l’entreprise
L'analyse des données concernant les recrutements effectués entre 2019 et 2024, ainsi que les prévisions
pour 2025 et 2026, offre un aperçu significatif des tendances d'embauche selon le type d'entreprise.
Depuis 2019, un total de 1945 diplômés a été recruté, avec une prédominance marquée du secteur privé,
qui a embauché 1522 diplômés. Ce chiffre souligne le rôle central des entreprises privées dans l'emploi des
diplômés de la FSEG et de l'IUG. D'autres secteurs, comme l'administration publique, ont également
apporté une contribution notable avec 172 recrutements, tandis que les ONG ont recruté 241 diplômés,
illustrant ainsi leur engagement envers le secteur social. En revanche, les entreprises publiques ou
54
272
674
945
1945
45
386
256 240
927
0
500
1000
1500
2000
2500
Moins de 10 salariés 10-49 salariés 50-250 salariés Plus de 250 salariés Ensemble
Recrutements de 2019 à 2024 Prévision pour 2025 et 2026
 |
89 89 |
▲back to top |
89
parapubliques et les organisations internationales ont enregistré des chiffres relativement faibles, avec
seulement 6 et 4 recrutements respectivement.
Pour les deux années à venir, les prévisions indiquent un total de 927 recrutements, ce qui représente une
diminution significative par rapport aux années précédentes. Cette baisse est particulièrement accentuée
dans le secteur privé, où les prévisions descendent à 620 recrutements. Ce déclin pourrait refléter une
contraction de l'emploi dans ce secteur, éventuellement due à une saturation du marché ou à une
réévaluation des besoins en main-d'œuvre. Les prévisions pour les ONG et l'administration publique, avec
respectivement 122 et 176 recrutements, suggèrent que ces secteurs continueront à embaucher, bien que
dans des proportions plus modestes par rapport au secteur privé.
En mettant en perspective les données passées et les prévisions, il devient évident que le marché de l'emploi
pour les diplômés de la FSEG et de l'IUG est en pleine transformation. Alors que le secteur privé a
longtemps été le principal employeur, la tendance actuelle indique une contraction significative, ce qui
pourrait être le signe de changements économiques ou d'ajustements stratégiques au sein des entreprises.
Les autres secteurs, bien qu'ils montrent une volonté de continuer à recruter, ne compenseront pas la baisse
projetée dans le secteur privé.
En résumé, cette analyse des recrutements passés et des prévisions à venir met en lumière une évolution
préoccupante du marché de l'emploi pour les diplômés de la FSEG et de l'IUG, caractérisée par une
réduction notable des opportunités, notamment dans le secteur privé. Cette situation appelle à une réflexion
urgente de la part des institutions de formation sur l'adéquation de leurs programmes avec les réalités du
marché, afin de mieux préparer les diplômés à un environnement professionnel en mutation.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 54 : Effectif des recrues selon le type d’entreprise
172
6
1522
241
4
1945
176
6
620
122
3
927
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Administration
publique
Entreprise
publique ou
parapublique
Entreprise privée ONG Entreprise
associative
Organisation
internationale
Ménage/
Personnel de
maison
Ensemble
Recrutements de 2019 à 2024 Prévision pour 2025 et 2026
 |
90 90 |
▲back to top |
90
3.6.2.2. Rendement des diplômés
Les résultats indiquent que, bien que le rendement des diplômés varie selon le secteur et la durée de leur
emploi, il existe une tendance générale à une amélioration constante de la performance au fur et à mesure
que les diplômés acquièrent de l’expérience. Après un an de travail, les diplômés atteignent un niveau de
performance qui satisfait quasiment tous les employeurs, quel que soit le type d'entreprise. Les
administrations publiques semblent toutefois éprouver plus de difficultés à obtenir des niveaux de
rendement élevés dès les premiers mois, contrairement aux ONG et organisations internationales qui
affichent une plus grande satisfaction dès le début.
En fin, ces résultats suggèrent que le temps d'adaptation des diplômés peut varier selon le secteur, mais que
dans l'ensemble, ils parviennent à démontrer leur efficacité après une année complète de travail.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 55 : Satisfaction relative au rendement des diplômés par type d’entreprise (%)
Au terme d’une année, la satisfaction des employeurs atteint 100 % pour les deux groupes, indiquant que,
quel que soit l’établissement fréquenté, les diplômés finissent par répondre pleinement aux attentes des
employeurs. Toutefois, les diplômés de l’IUG montrent une adaptation plus rapide dès les premiers mois
de travail, tandis que ceux de la FSEG prennent davantage de temps pour s'adapter avant d'atteindre un
niveau de satisfaction équivalent après un an.
Ces résultats suggèrent que, bien que les diplômés de l’IUG soient perçus comme plus performants à court
terme, ceux de la FSEG rattrapent progressivement leur retard pour finalement obtenir une satisfaction
quasi égale de la part des employeurs. Cette analyse met en évidence l'importance de l'adaptation au poste
et la manière dont celle-ci peut varier en fonction de la formation initiale.
45,5%
66,7%
63,5%
80,0%
100,0%
63,6%63,6%
100,0%
76,2%
90,0%
77,3%
100,0%
93,7%
100,0%
95,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Administration
publique
Entreprise publique
ou parapublique
Entreprise privée ONG Organisation
internationale
Ensemble
Après trois mois de travail. Après six mois de travail. Après un an de travail.
 |
91 91 |
▲back to top |
91
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 56 : Satisfaction relative au rendement des diplômés par IESRS fréquenté (%)
56,9%
82,6%
63,6%
70,8%
95,7%
77,3%
93,8%
100,0%
95,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FSEG IUG Ensemble
Après trois mois de travail. Après six mois de travail Après un an de travail
 |
92 92 |
▲back to top |
92
3.6.3. Attentes et satisfaction des employeurs
Lors de l'embauche, les employeurs peuvent avoir des attentes diversifiées concernant les compétences
requises pour le poste, classées en fortes, modérées ou faibles selon la compétence. Cependant, afin
d'évaluer plus précisément la satisfaction des employeurs, nous nous concentrerons exclusivement sur les
fortes attentes et la satisfaction réelle exprimée par ces employeurs. Chaque compétence, dans les trois
domaines clés (savoirs ou connaissances, savoir-être ou comportement, et savoir-faire ou habileté), fera
l’objet d’une analyse détaillée basée sur un taux synthétique de satisfaction. Il est important de noter que
seules les fortes attentes exprimées par les employeurs de diplômés seront prises en compte dans cette
comparaison.
3.6.3.1. Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux compétences
Les données fournies permettent de comparer les attentes des employeurs avec leur taux de satisfaction
concernant les compétences des diplômés de licence de la FSEG et de l'IUG, promotion 2016-2019.
Globalement, les employeurs expriment des attentes de 72,8 % par rapport aux compétences des diplômés,
avec un taux de satisfaction général de 70,6 %. Bien que ces données révèlent des écarts mineurs entre les
attentes et la satisfaction, elles témoignent d'une adéquation relative entre la formation reçue par les
diplômés et les exigences du marché du travail.
En termes de savoirs ou connaissances, les attentes des employeurs s'élèvent à 66,4 %, tandis que leur
satisfaction est légèrement inférieure, à 62,5 %. Cela montre un écart modéré entre ce que les employeurs
espéraient en termes de connaissances et ce qu'ils ont réellement observé chez les diplômés. Concernant le
savoir-être ou comportement, les attentes sont nettement plus élevées, atteignant 87,5 %, avec un taux de
satisfaction de 83,9 %. Même si un léger décalage persiste, les employeurs semblent globalement satisfaits
du comportement des diplômés, cette compétence étant la mieux notée.
Pour le savoir-faire ou habileté, les attentes se situent à 64,5 %, tandis que la satisfaction des employeurs
est légèrement supérieure, à 65,4 %. Cela suggère que les diplômés ont répondu, voire légèrement dépassé
les attentes dans cette catégorie.
Cela met en lumière l'importance de continuer à améliorer certains aspects, notamment les savoirs ou
connaissances, pour mieux répondre aux attentes des employeurs.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 57 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux compétences des diplômés
66,4%
87,5%
64,5%
72,8%
62,5%
83,9%
65,4%
70,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Savoirs ou de connaissances Savoir-être ou comportement Savoir-faire ou habileté Global
Attentes Satisfaction
 |
93 93 |
▲back to top |
93
Globalement, les employeurs ont des attentes de 71,4 % pour la FSEG et de 76,8 % pour l'IUG. Le taux de
satisfaction général est de 67,8 % pour la FSEG, contre 78,5 % pour l'IUG, ce qui reflète une meilleure
adéquation des compétences des diplômés de l'IUG par rapport aux attentes des employeurs.
Pour les savoirs ou connaissances, les attentes des employeurs sont de 65,2 % pour les diplômés de la FSEG
et de 69,6 % pour ceux de l'IUG. Cependant, le taux de satisfaction montre un écart important entre les
deux institutions : 57,1 % pour la FSEG contre 78,0 % pour l'IUG. Ce décalage suggère que les diplômés
de l'IUG sont perçus comme mieux préparés en termes de connaissances que ceux de la FSEG. En ce qui
concerne le savoir-être ou comportement, les attentes sont similaires pour les deux institutions, atteignant
87,3 % pour la FSEG et 88,0 % pour l'IUG. La satisfaction est également relativement proche, avec 83,3
% pour la FSEG et 85,9 % pour l'IUG. Cela montre que, bien que les attentes ne soient pas totalement
comblées, les employeurs sont globalement satisfaits du comportement des diplômés, avec un léger
avantage pour l'IUG. Pour le savoir-faire ou habileté, les attentes des employeurs diffèrent davantage : 61,5
% pour la FSEG contre 72,8 % pour l'IUG. La satisfaction suit cette même tendance, avec 63,1 % pour la
FSEG et 71,7 % pour l'IUG. Ainsi, bien que les diplômés de la FSEG paraissent répondre de manière
adéquate aux attentes des employeurs en matière de compétences pratiques, leur niveau de satisfaction reste
inférieur à celui des diplômés de l'IUG, dont les attentes des employeurs étaient plus élevées.
En somme, bien que les deux institutions présentent des résultats globalement positifs, les diplômés de
l'IUG semblent répondre de manière plus satisfaisante aux attentes des employeurs, notamment en ce qui
concerne les savoirs ou connaissances.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 58 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux compétences selon l’IESRS
3.6.3.2. Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux savoirs
Les données montrent une analyse détaillée des attentes des employeurs par rapport aux savoirs ou
connaissances des diplômés, et leur niveau de satisfaction.
En ce qui concerne la connaissance des outils informatiques, les attentes des employeurs atteignent 65,5 %,
tandis que la satisfaction est légèrement inférieure, à 60,9 %. Cet écart suggère que les diplômés ne
maîtrisent pas complètement les outils informatiques selon les attentes du marché du travail. Pour la
rédaction administrative et la gestion des documents, les attentes sont de 63,5 %, mais la satisfaction tombe
à 52,3 %, ce qui révèle un écart important. Les compétences en gestion documentaire et en rédaction
65,2%
87,3%
61,5%
71,4%69,6%
88,0%
72,8%
76,8%
57,1%
83,3%
63,1%
67,8%
78,0%
85,9%
71,7%
78,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Savoirs ou de connaissances Savoir-être ou comportement Savoir-faire ou habileté Global
Attentes FSEG Attentes IUG Satisfaction FSEG Satisfaction IUG
 |
94 94 |
▲back to top |
94
semblent être une faiblesse chez les diplômés, nécessitant une amélioration pour répondre davantage aux
attentes des employeurs.
En revanche, pour les langues de communication, les attentes des employeurs sont élevées à 73,9 %, et la
satisfaction atteint presque ce niveau avec 72,4 %. Cela indique une bonne adéquation entre les
compétences linguistiques des diplômés et les besoins du marché. En matière de droit du travail, les attentes
sont également à 73,9 %, mais la satisfaction est légèrement plus faible, à 69,0 %. Bien que les diplômés
aient une bonne compréhension du droit du travail, il existe encore un petit écart à combler.
Les employeurs attendent aussi des diplômés une connaissance générale du domaine à un niveau élevé de
81,8 %, et la satisfaction est presque à la hauteur avec 79,5 %. Cela montre que les diplômés possèdent une
bonne maîtrise des connaissances spécifiques à leur secteur, contribuant de manière significative à la
satisfaction globale des employeurs. Pour la culture générale, les attentes sont faibles à 39,8 %, mais la
satisfaction dépasse les attentes avec 41,2 %. Cet indicateur, bien que secondaire, semble ne pas constituer
un point de préoccupation majeur pour les employeurs.
Enfin, en examinant les savoirs ou connaissances globalement, les attentes atteignent 66,4 %, avec une
satisfaction légèrement inférieure à 62,5 %. Cela suggère que bien que les diplômés possèdent un ensemble
de connaissances qui répond aux exigences de base, il existe encore des marges de progression,
particulièrement dans des domaines comme la gestion documentaire et la connaissance des outils
informatiques, qui impactent négativement la satisfaction des employeurs. En revanche, les compétences
en langues de communication et la connaissance générale du domaine sont les aspects qui contribuent le
plus positivement à la satisfaction des employeurs.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 59 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux savoirs ou connaissances
Les données montrent une comparaison des attentes et de la satisfaction des employeurs vis-à-vis des
diplômés de la FSEG et de l'IUG en matière de savoirs ou de connaissances. Pour la connaissance des outils
informatiques, les employeurs attendent 62,3 % des diplômés de la FSEG et 73,9 % de ceux de l'IUG.
Cependant, la satisfaction diffère fortement : 51,6 % pour la FSEG contre 87,0 % pour l'IUG. Cela montre
65,5%
63,5%
73,9%
73,9%
81,8%
39,8%
66,4%
60,9%
52,3%
72,4%
69,0%
79,5%
41,2%
62,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
Connaissance des outils informatique
Rédaction administrative et gestion du document
Langues de communication
Droit du travail
Connaissance générale du domaine
Culture générale
Savoirs ou de connaissances
Satisfaction Attentes
 |
95 95 |
▲back to top |
95
une meilleure maîtrise des outils informatiques par les diplômés de l'IUG, ce qui contribue de manière
significative à leur satisfaction élevée dans ce domaine.
En ce qui concerne la rédaction administrative et la gestion des documents, les attentes sont relativement
proches entre les deux institutions : 64,5 % pour la FSEG et 60,9 % pour l'IUG. Toutefois, la satisfaction
est plus faible, avec 50,8 % pour la FSEG et 56,5 % pour l'IUG. Cet écart montre que, bien que les attentes
soient modérées, les diplômés des deux institutions ne parviennent pas à y répondre entièrement, soulignant
la nécessité d'améliorer ces compétences.
Pour les langues de communication, les attentes sont plus élevées pour les diplômés de la FSEG (75,4 %)
que pour ceux de l'IUG (69,6 %). Cependant, la satisfaction est beaucoup plus forte pour l'IUG, atteignant
90,9 %, contre 66,2 % pour la FSEG. Cet écart suggère que les diplômés de l'IUG répondent bien mieux
aux besoins des employeurs en termes de compétences linguistiques, ce qui agit positivement sur leur
satisfaction.
Concernant le droit du travail, les attentes sont similaires pour les deux institutions, avec 73,8 % pour la
FSEG et 73,9 % pour l'IUG. Toutefois, la satisfaction est légèrement plus élevée pour l'IUG (77,3 %) par
rapport à la FSEG (66,2 %). Bien que les diplômés des deux institutions soient perçus comme ayant une
bonne compréhension du droit du travail, ceux de l'IUG semblent mieux répondre aux attentes des
employeurs.
La connaissance générale du domaine est un aspect clé, où les attentes des employeurs atteignent 80,0 %
pour la FSEG et 87,0 % pour l'IUG. La satisfaction est particulièrement élevée pour l'IUG, à 95,7 %, contre
73,8 % pour la FSEG. Les diplômés de l'IUG surpassent donc clairement les attentes des employeurs dans
ce domaine, ce qui agit fortement sur la satisfaction globale.
En ce qui concerne la culture générale, les attentes sont plus faibles pour les deux institutions : 35,4 % pour
la FSEG et 52,2 % pour l'IUG. Cependant, la satisfaction reste relativement faible, à 33,9 % pour la FSEG
et 60,9 % pour l'IUG, bien que l’IUG obtienne un meilleur score dans ce domaine. Bien que la culture
générale ne soit pas une priorité pour les employeurs, une légère amélioration de cette compétence semble
avoir un impact positif sur la satisfaction.
En résumé, les compétences en outils informatiques, langues de communication et connaissance générale
du domaine sont les principaux facteurs qui influencent la satisfaction des employeurs, particulièrement en
faveur des diplômés de l'IUG. À l’inverse, des domaines comme la rédaction administrative et la gestion
des documents, ainsi que la culture générale, restent des points à améliorer pour les deux institutions.
 |
96 96 |
▲back to top |
96
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 60 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport aux savoirs ou connaissances selon l’IESRS
3.6.3.3. Attentes et satisfaction des employeurs par rapport au savoir-être
Les données fournies analysent les attentes des employeurs par rapport au savoir-être des diplômés, ainsi
que leur niveau de satisfaction. En ce qui concerne l'intérêt pour le métier, les attentes des employeurs
s'élèvent à 90,9 %, tandis que la satisfaction est légèrement inférieure, à 85,2 %. Cet écart indique que bien
que les diplômés montrent un intérêt significatif pour leur métier, les employeurs aimeraient voir cette
passion se traduire par des performances encore plus convaincantes. Pour la capacité à travailler sous
pression, les attentes des employeurs sont de 87,5 %, et la satisfaction est de 83,0 %. Cela montre que les
diplômés sont généralement capables de gérer la pression, bien qu'il reste une marge d'amélioration pour
répondre pleinement aux attentes.
L’esprit d’équipe est un aspect particulièrement bien noté, avec des attentes de 92,0 % et une satisfaction
de 93,2 %. Cela suggère que les diplômés excellent dans ce domaine, dépassant même les attentes des
employeurs, ce qui contribue positivement à leur satisfaction. Concernant la ponctualité, les attentes sont
très élevées à 95,5 %, et la satisfaction correspond parfaitement à ce niveau, également à 95,5 %. Cela
indique que les diplômés respectent ce critère fondamental, ce qui est essentiel pour les employeurs. Pour
la conscience professionnelle, les attentes des employeurs sont de 90,9 %, tandis que la satisfaction s’élève
à 89,8 %. Bien que les diplômés montrent un bon niveau de conscience professionnelle, il y a encore un
léger écart à combler pour satisfaire pleinement les employeurs.
En ce qui concerne la maîtrise de soi, les attentes sont de 83,0 %, et la satisfaction est légèrement plus basse,
à 81,8 %. Cela indique que les employeurs souhaitent une meilleure gestion des émotions et du
comportement de la part des diplômés. L’être créatif est un domaine où les attentes s'élèvent à 68,2 %, mais
la satisfaction est beaucoup plus faible, à 56,8 %. Cet écart important souligne un besoin d'amélioration en
termes de créativité, qui semble être une compétence moins développée chez les diplômés. Pour le respect
du règlement intérieur, les attentes sont élevées à 92,0 %, tandis que la satisfaction est de 86,4 %. Bien que
les diplômés respectent généralement les règlements, les employeurs aimeraient un engagement plus fort à
cet égard.
62,3%
64,5%
75,4%
73,8%
80,0%
35,4%
65,2%
73,9%
60,9%
69,6%
73,9%
87,0%
52,2%
69,6%
51,6% 50,8%
66,2%
66,2%
73,8%
33,9%
57,1%
87,0%
56,5%
90,9%
77,3%
95,7%
60,9%
78,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Connaissance des
outils
informatique
Rédaction
administrative et
gestion du
document
Langues de
communication
Droit du travail Connaissance
générale du
domaine
Culture générale Savoirs ou de
connaissances
Attentes FSEG Attentes IUG Satisfaction FSEG Satisfaction IUG
 |
97 97 |
▲back to top |
97
En examinant le savoir-être ou comportement dans son ensemble, les attentes des employeurs atteignent
87,5 %, tandis que la satisfaction est de 83,9 %. Cela montre que, bien que les diplômés répondent en grande
partie aux attentes, certaines compétences, notamment la créativité et le respect du règlement intérieur,
nécessitent encore des améliorations pour augmenter la satisfaction globale des employeurs.
En résumé, les compétences les plus satisfaisantes chez les diplômés sont l’esprit d’équipe et la ponctualité,
qui dépassent les attentes des employeurs. À l’inverse, la créativité et le respect des règlements apparaissent
comme des domaines nécessitant une attention particulière pour améliorer la satisfaction des employeurs.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 61 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport au savoir-être
Les données fournissent une comparaison des attentes et du niveau de satisfaction des employeurs
concernant le savoir-être des diplômés de la FSEG et de l'IUG. Pour l'intérêt pour le métier, les attentes
sont similaires entre les deux institutions, avec 90,8 % pour la FSEG et 91,3 % pour l'IUG. Cependant, la
satisfaction des employeurs est légèrement plus élevée pour la FSEG (86,2 %) que pour l'IUG (82,6 %), ce
qui montre que les diplômés de la FSEG répondent mieux aux attentes en termes d'engagement
professionnel. En ce qui concerne la capacité à travailler sous pression, les attentes sont plus élevées pour
la FSEG (90,8 %) que pour l'IUG (78,3 %). Néanmoins, la satisfaction reste proche pour les deux
établissements, avec 83,1 % pour la FSEG et 82,6 % pour l'IUG, indiquant que les diplômés des deux
institutions parviennent à gérer la pression de manière équivalente, malgré des attentes initiales différentes.
L'esprit d’équipe est une compétence essentielle, avec des attentes élevées pour les deux institutions : 93,8
% pour la FSEG et 87,0 % pour l'IUG. La satisfaction des employeurs atteint 90,8 % pour la FSEG, mais
les diplômés de l'IUG se distinguent particulièrement dans ce domaine, atteignant une satisfaction parfaite
de 100 %, surpassant ainsi les attentes. La ponctualité est un autre critère où les attentes sont très similaires
: 95,4 % pour la FSEG et 95,7 % pour l'IUG. La satisfaction est légèrement plus élevée pour la FSEG (96,9
%) comparée à l'IUG (91,3 %), ce qui montre que les diplômés de la FSEG respectent davantage cette
exigence. Pour la conscience professionnelle, les attentes des employeurs sont presque identiques : 90,8 %
90,9%
87,5%
92,0%
95,5%
90,9%
83,0%
68,2%
92,0%
87,5%
85,2%
83,0%
93,2%
95,5%
89,8%
81,8%
56,8%
86,4%
83,9%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Intérêt pour le métier
Travail sous pression
Esprit d’équipe
Ponctualité
Conscience professionnelle
Maîtrise de soi
Être créatif
Respect du règlement intérieur
Savoir-être ou comportement
Satisfaction Attentes
 |
98 98 |
▲back to top |
98
pour la FSEG et 91,3 % pour l'IUG. Cependant, la satisfaction est plus élevée pour les diplômés de l'IUG
(95,7 %) que pour ceux de la FSEG (87,7 %), suggérant que les diplômés de l'IUG se distinguent par leur
conscience professionnelle. La maîtrise de soi montre des attentes très élevées pour l'IUG (100,0 %) par
rapport à la FSEG (76,9 %). La satisfaction reste relativement proche pour les deux institutions, avec 82,6
% pour l'IUG et 81,5 % pour la FSEG, bien que les attentes envers les diplômés de l'IUG soient beaucoup
plus exigeantes. Concernant la créativité, les attentes sont modérées pour les deux institutions, avec 67,7 %
pour la FSEG et 69,6 % pour l'IUG. La satisfaction est cependant inférieure, à 56,9 % pour la FSEG et 56,5
% pour l'IUG, révélant que les diplômés des deux institutions peinent à répondre aux attentes en matière de
créativité.
En fin, pour le savoir-être ou comportement global, les attentes sont comparables : 87,3 % pour la FSEG et
88,0 % pour l'IUG. La satisfaction suit également une tendance similaire, avec 83,3 % pour la FSEG et 85,9
% pour l'IUG. Les compétences qui influencent le plus positivement la satisfaction des employeurs sont
l’esprit d’équipe, la ponctualité et la conscience professionnelle, particulièrement chez les diplômés de
l'IUG. En revanche, la créativité et le respect des règles nécessitent des améliorations, notamment pour les
diplômés de la FSEG.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 62 : Attentes et satisfaction des employeurs par rapport au savoir-être selon l’IESRS
3.6.3.4. Attentes et satisfaction des employeurs par rapport au savoir-faire
Les données illustrent les attentes des employeurs vis-à-vis du savoir-faire des diplômés de la FSEG et de
l'IUG, ainsi que leur niveau de satisfaction. Concernant la communication en français, les attentes des
employeurs s'élèvent à 73,9 %, tandis que la satisfaction est légèrement supérieure, à 74,7 %. Cela montre
que les diplômés maîtrisent globalement bien cette compétence, satisfaisant même légèrement au-delà des
attentes. Cependant, pour la communication en anglais, les attentes sont faibles (19,3 %), et la satisfaction
est encore plus basse, à 14,5 %, ce qui révèle un déficit important dans cette compétence chez les diplômés,
un domaine nécessitant des améliorations. La communication dans une autre langue nationale présente un
contraste intéressant : bien que les attentes soient de 36,4 %, la satisfaction atteint 59,3 %, ce qui montre
que les diplômés surpassent largement les attentes dans ce domaine, un point positif pour les employeurs.
90,8%
90,8%
93,8%
95,4%
90,8%
76,9%
67,7%
92,3%
87,3%
91,3%
78,3%
87,0%
95,7%
91,3%
100,0%
69,6%
91,3%
88,0%
86,2% 83,1%
90,8%
96,9%
87,7% 81,5%
56,9%
83,1%
83,3%82,6% 82,6%
100,0%
91,3%
95,7%
82,6%
56,5%
95,7%
85,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Intérêt pour le
métier
Travail sous
pression
Esprit d’équipe Ponctualité Conscience
professionnelle
Maîtrise de soi Être créatif Respect du
règlement
intérieur
Savoir-être ou
comportement
Attentes FSEG Attentes IUG Satisfaction FSEG Satisfaction IUG
 |
99 99 |
▲back to top |
99
En ce qui concerne la capacité à gérer et organiser le bureau, les attentes sont de 64,8 %, avec une
satisfaction légèrement inférieure à 62,4 %. Cela suggère que les diplômés parviennent presque à répondre
aux attentes des employeurs, mais une amélioration est encore possible pour combler cet écart. La
compétence à identifier que les besoins de l’entreprise montre une situation inverse : les attentes sont de
68,2 %, tandis que la satisfaction dépasse légèrement ce niveau, atteignant 73,6 %. Cela indique que les
diplômés font preuve d'une bonne compréhension des besoins organisationnels, satisfaisant mieux que
prévu dans ce domaine. La maîtrise des outils de travail est l'un des aspects les plus cruciaux, avec des
attentes très élevées (96,6 %). Toutefois, la satisfaction est légèrement inférieure (90,9 %), ce qui souligne
que, bien que les diplômés soient performants, ils n’atteignent pas entièrement les attentes élevées des
employeurs.
La capacité à accomplir les tâches confiées, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel, présente des
attentes élevées (90,9 %) et une satisfaction légèrement inférieure (86,4 %), montrant que les diplômés sont
globalement performants, mais qu’il reste des marges de progression. Pour la rédaction de rapports, les
attentes atteignent 65,9 %, tandis que la satisfaction est légèrement en deçà, à 61,6 %. Cela indique un
besoin d'amélioration dans cette compétence, essentielle pour les activités administratives.
Enfin, les compétences qui influencent le plus positivement la satisfaction des employeurs sont la
communication en langues nationales et l’identification des besoins de l’entreprise. Cependant, des efforts
sont à fournir dans les domaines de la communication en anglais, de la maîtrise des outils de travail et de
la rédaction de rapports pour améliorer la satisfaction.
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 63 : Attentes et satisfaction des entreprises par rapport au savoir-faire
Les données sur les attentes et la satisfaction des employeurs à l'égard des diplômés de la FSEG et de l'IUG
révèlent des dynamiques importantes concernant les compétences professionnelles. Les attentes en matière
de communication en français sont nettement plus élevées à l'IUG (95,7 %) qu'à la FSEG (66,2 %), et cette
différence se reflète dans la satisfaction, avec un taux de 91,3 % pour l'IUG contre 68,8 % pour la FSEG.
Bien que les diplômés de l'IUG répondent mieux aux attentes, un écart persiste à la FSEG, suggérant une
légère inadéquation à combler.
73,9%
19,3%
36,4%
64,8%
68,2%
96,6%
90,9%
65,9%
64,5%
74,7%
14,5%
59,3%
62,4%
73,6%
90,9%
86,4%
61,6%
65,4%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Communiquer couramment en français
Communiquer couramment en anglais
Communiquer couramment dans une autre langue nationale
Gérer et organiser le bureau
Identifier les besoins de l’entreprise
Maîtrise les outils de travail
Accomplir les tâches confiées
Rédiger un rapport
Savoir-faire ou habileté
Satisfaction Attentes
 |
100 100 |
▲back to top |
100
En ce qui concerne la communication en anglais, les attentes sont faibles dans les deux institutions, mais
elles sont plus basses à la FSEG (16,9 %) qu'à l'IUG (26,1 %). Toutefois, la satisfaction est encore inférieure
aux attentes, avec 11,9 % pour la FSEG et 20,0 % pour l'IUG, ce qui souligne la nécessité d'améliorer cette
compétence clé pour renforcer la compétitivité internationale des diplômés.
La communication dans une autre langue nationale suscite des attentes plus élevées à l'IUG (47,8 %) qu'à
la FSEG (32,3 %), et la satisfaction suit cette tendance, atteignant 66,7 % à l'IUG contre 57,1 % à la FSEG.
Cette compétence est donc davantage valorisée et satisfaite, surtout à l'IUG, reflétant l'importance accordée
par les entreprises à la maîtrise des langues locales.
En matière de gestion et d'organisation du bureau, les attentes à l'IUG (82,6 %) sont supérieures à celles de
la FSEG (58,5 %), et la satisfaction est également plus élevée à l'IUG (78,3 % contre 56,5 %). Cela suggère
que les diplômés de l'IUG sont mieux formés dans ce domaine, peut-être en raison d'une approche plus
pratique de leur formation.
Curieusement, pour la capacité à identifier les besoins de l'entreprise, les attentes sont plus élevées à la
FSEG (72,3 %) qu'à l'IUG (56,5 %), mais la satisfaction est également plus forte à la FSEG (78,1 % contre
60,9 %). Cela montre que les diplômés de la FSEG sont perçus comme plus aptes à répondre aux besoins
des entreprises, malgré des attentes plus faibles à l'IUG.
Quant à la maîtrise des outils de travail, les attentes sont extrêmement élevées à l'IUG (100 %) et presque
aussi élevées à la FSEG (95,4 %), avec une satisfaction respective de 95,7 % et 89,2 %. Cela montre une
bonne adéquation entre les compétences enseignées et les exigences professionnelles dans les deux
institutions.
Pour l'accomplissement des tâches confiées, les attentes sont également élevées dans les deux institutions
(90,8 % à la FSEG et 91,3 % à l'IUG), mais la satisfaction est légèrement inférieure, avec un taux de 86,2
% pour la FSEG et 87,0 % pour l'IUG. Cet écart minime suggère que, bien que les employeurs soient
globalement satisfaits, ils voient encore une petite marge d'amélioration.
La rédaction de rapports est un domaine où l'IUG affiche des attentes (82,6 %) et des niveaux de satisfaction
(73,9 %) plus élevés que la FSEG (60,0 % pour les attentes et 57,1 % pour la satisfaction), indiquant que
les diplômés de l'IUG semblent mieux préparés à cette tâche cruciale dans le milieu professionnel.
En résumé, l'IUG surpasse généralement la FSEG dans la majorité des compétences, notamment la
communication, la gestion administrative et la rédaction de rapports, tandis que les diplômés de la FSEG
se distinguent positivement dans l'identification des besoins de l'entreprise, avec un taux de satisfaction
supérieur dans ce domaine. Pour améliorer la satisfaction globale, il serait judicieux de renforcer la maîtrise
de l'anglais et l'accomplissement des tâches, où les écarts entre attentes et satisfaction restent les plus
notables. Ces observations suggèrent que l'alignement des compétences avec les attentes des entreprises
varie selon l'institution, et qu'une adaptation des programmes de formation serait nécessaire pour combler
ces lacunes.
 |
101 101 |
▲back to top |
101
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Graphique 64 : Attentes et satisfaction des entreprises par rapport au savoir-faire selon l’IESRS
66,2%
16,9%
32,3%
58,5%
72,3%
95,4%
90,8%
60,0% 61,5%
95,7%
26,1%
47,8%
82,6%
56,5%
100,0%
91,3%
82,6%
72,8%
68,8%
11,9%
57,1%
56,5%
78,1%
89,2% 86,2%
57,1%
63,1%
91,3%
20,0%
66,7%
78,3%
60,9%
95,7%
87,0%
73,9%
71,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Communiquer
couramment en
français
Communiquer
couramment en
anglais
Communiquer
couramment
dans une autre
langue
nationale
Gérer et
organiser le
bureau
Identifier les
besoins de
l’entreprise
Maîtrise les
outils de travail
Accomplir les
tâches confiées
Rédiger un
rapport
Savoir-faire ou
habileté
Attentes FSEG Attentes IUG Satisfaction FSEG Satisfaction IUG
 |
102 102 |
▲back to top |
102
CONCLUSION
Ce rapport met en lumière les défis et opportunités rencontrés par les diplômés des institutions FSEG
(Faculté des Sciences Économiques et de Gestion) et IUG (Institut Universitaire de Gestion) du Mali, à
travers une étude détaillée qui couvre divers aspects de leur parcours d'insertion professionnelle entre 2019
et 2024.
Bien que le système de formation soit structuré autour de l'approche LMD (Licence-Master-Doctorat)
depuis 2008, des disparités persistantes existent dans l'adéquation des formations avec le marché du travail.
L'IUG obtient de meilleures évaluations par rapport à la FSEG concernant l'adéquation des contenus
pédagogiques. Il est crucial d'améliorer les programmes en encourageant des partenariats avec le secteur
privé, en intégrant des évolutions technologiques et en renforçant la promotion de l'entrepreneuriat pour
répondre aux attentes du marché.
Le profil des diplômés montre une surreprésentation des hommes dans le marché du travail, tandis que les
femmes rencontrent des défis supplémentaires liés à la maternité et à des obstacles éducatifs. Le
déséquilibre régional, plus marqué dans des zones comme Kidal et Taoudéni, illustre des inégalités d'accès
à l'éducation pour les femmes, nécessitant des politiques ciblées pour promouvoir une plus grande
inclusivité.
Une majorité des diplômés n’ont effectué aucun stage et il existe un écart significatif entre la théorie et la
pratique dans la formation. La forte proportion de diplômés se déclarant satisfaits de l’adéquation de leur
formation avec le marché du travail souligne cependant un clivage entre la perception et la réalité de
l’employabilité.
Le taux global d'insertion est de près de 70 %, mais on observe une disparité prononcée selon le sexe : 80
% pour les hommes contre environ 50 % pour les femmes. Les résultats montrent également que certaines
filières offrent de meilleures perspectives d'emploi alors que d'autres, notamment les carrières
entrepreneuriales, peinent à assurer une insertion adéquate. Les femmes, en particulier, souffrent d’une
vulnérabilité accrue sur le marché du travail, avec un taux de chômage beaucoup plus élevé.
Une majorité de diplômés sont surqualifiés pour leurs postes, ce qui pose des questions sur la pertinence
des programmes éducatifs et leur alignement avec les besoins du marché. La double inadéquation, où les
diplômés se trouvent dans des postes qui ne correspondent ni à leurs qualifications ni à leur formation,
soulève des préoccupations quant à l’investissement économique dans l’éducation et à la motivation des
diplômés.
La majorité des diplômés sont employés par des petites et moyennes entreprises, et bien que le diplôme soit
un facteur important, d'autres compétences sont également cruciales pour le recrutement. Les employeurs
expriment un niveau de satisfaction assez élevé pour les savoir-être, mais soulignent également des
domaines nécessitant des améliorations, notamment en matière de créativité et de réactivité.
Les prévisions indiquent une contraction significative des recrutements dans les années à venir, notamment
dans le secteur privé, ce qui souligne la nécessité d'adapter les formations aux besoins du marché et
d'améliorer la préparation des diplômés.
 |
103 103 |
▲back to top |
103
En fin, bien que des progrès aient été réalisés, il existe un besoin critique de transformation au niveau des
politiques éducatives et d'employabilité des diplômés au Mali pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans un
marché du travail en rapide mutation.
 |
104 104 |
▲back to top |
104
RECOMMANDATIONS
Pour répondre aux défis identifiés dans l'insertion professionnelle et l'employabilité des diplômés des
institutions FSEG et IUG au Mali, il est essentiel de formuler des recommandations ciblées destinées à
différents acteurs impliqués dans le système éducatif, le marché du travail, et les politiques publiques. Voici
des recommandations selon les acteurs concernés :
Pour les Instituts de Formation (FSEG et IUG) :
➢ Renforcer l'approche LMD : Poursuivre le développement et l'adaptation des programmes de
formation en fonction des besoins du marché, en intégrant des parcours plus pratiques.
➢ Promouvoir les stages : Établir des programmes obligatoires de stages en entreprise pour tous les
étudiants afin de réduire l'écart entre la théorie et la pratique.
➢ Favoriser les partenariats avec le secteur privé : Créer des collaborations avec des entreprises
pour définir des programmes de formation adaptés et favoriser le co-développement de projets.
Pour le Gouvernement et les Autorités Éducatives :
➢ Renforcer la mise en place des politiques inclusives : Développer des politiques visant à améliorer
l'accès à l'éducation pour les femmes et à stimuler leur employabilité, en offrant des bourses ou des
programmes de soutien.
➢ Encourager l'entrepreneuriat : Lancer des initiatives pour inciter les diplômés à créer leurs
entreprises, notamment à travers des formations spécifiques à l'entrepreneuriat et des financements
accessibles pour les start-ups.
➢ Évaluer et ajuster les systèmes pédagogiques : Mettre en place des mécanismes d’évaluation
réguliers des programmes éducatifs afin de garantir leur adéquation avec le marché du travail.
Pour les Employeurs et le Secteur Privé :
➢ S'engager dans la formation continue des employés : Mettre en place des programmes de
formation continue pour développer les compétences des employés actuels et futurs.
➢ Collaborer avec les institutions d'enseignement : Participer à la définition des curricula en offrant
leur expertise sur les compétences recherchées sur le marché.
➢ Améliorer la visibilité des opportunités d'emploi : Créer des plateformes de mise en relation entre
les diplômés et les entreprises pour faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail.
Pour les Organisations de la Société Civile et les ONG :
➢ Sensibiliser sur l'égalité des genres : Promouvoir des campagnes de sensibilisation pour encourager
l'inclusion des femmes dans le marché du travail et lutter contre les stéréotypes de genre.
➢ Fournir un soutien aux jeunes diplômés : Offrir des programmes d’accompagnement et de mentorat
pour aider les diplômés à naviguer dans le marché du travail.
➢ Promouvoir l'apprentissage et le développement des compétences : Organiser des ateliers et des
séances de formation sur les compétences recherchées, notamment en matière de créativité et
d'innovation.
 |
105 105 |
▲back to top |
105
Pour les Organismes Internationaux et les Partenaires au Développement :
➢ Investir dans le développement des compétences : Financer des programmes qui visent à améliorer
les compétences techniques et non techniques des diplômés.
➢ Établir des échanges internationaux : Promouvoir des programmes d'échanges ou de stages à
l'étranger pour élargir les perspectives des diplômés et améliorer leur employabilité.
➢ Soutenir des projets pilotes : Lancer ou soutenir des projets innovants dans le domaine de l'éducation
et de l'emploi susceptibles d'être reproduits à plus grande échelle.
La mise en œuvre de ces recommandations nécessite un effort concerté entre les différentes parties
prenantes pour garantir un système éducatif plus réactif aux besoins du marché du travail et une insertion
professionnelle réussie pour tous les diplômés, en particulier les femmes et les populations défavorisées.
Cela nécessitera également une évaluation continue des actions entreprises afin d’adapter les politiques et
les stratégies aux évolutions du marché et des contextes socio-économiques.
 |
106 106 |
▲back to top |
106
ANNEXES
Annexe 1 : Attentes en termes de compétences (%)
Compétence FSEG IUG Ensemble
Savoirs ou de connaissances
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 1,5 4,3 2,3
Fortes 98,5 95,7 97,7
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Savoir-être ou comportement
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 3,1 0,0 2,3
Fortes 96,9 100,0 97,7
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Savoir-faire
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 13,8 0,0 10,2
Fortes 86,2 100,0 89,8
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Annexe 2 : Attentes au regard de leurs savoirs ou connaissances (%)
Savoirs ou connaissances FSEG IUG Ensemble
Connaissance des outils informatique
Sans attentes 1,6 0,0 1,2
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 36,1 26,1 33,3
Fortes 62,3 73,9 65,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Rédaction administrative et gestion du document
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 35,5 39,1 36,5
Fortes 64,5 60,9 63,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Langues de communication
Sans attentes 0,0 4,3 1,1
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 24,6 26,1 25,0
Fortes 75,4 69,6 73,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Droit du travail
Sans attentes 0,0 4,3 1,1
Faibles 1,5 4,3 2,3
Moyennes 24,6 17,4 22,7
Fortes 73,8 73,9 73,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Connaissance générale du domaine
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 3,1 0,0 2,3
Moyennes 16,9 13,0 15,9
Fortes 80,0 87,0 81,8
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Culture générale
Sans attentes 4,6 0,0 3,4
Faibles 1,5 0,0 1,1
Moyennes 58,5 47,8 55,7
Fortes 35,4 52,2 39,8
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
107 107 |
▲back to top |
107
Annexe 3 : Proportion de capital humain déprécié (%)
Filière de formation Dépréciés Non dépréciés Ensemble
Assurance banque finances 98,0 2,0 100,0
Economie 95,7 4,3 100,0
Gestion 90,4 9,6 100,0
Création et gestion
d’entreprises
75,6 24,4 100,0
Organisation et gestion des
organisations
74,4 25,6 100,0
Sciences et techniques
commerciales
89,7 10,3 100,0
Ensemble 93,6 6,4 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
Annexe 4 : Attentes au regard de leurs savoir-être ou comportements (%)
Savoir-être ou comportements FSEG IUG Ensemble
Intérêt pour le métier
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 9,2 8,7 9,1
Fortes 90,8 91,3 90,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Travail sous pression
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 1,5 0,0 1,1
Moyennes 7,7 21,7 11,4
Fortes 90,8 78,3 87,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Esprit d’équipe
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 6,2 13,0 8,0
Fortes 93,8 87,0 92,0
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Ponctualité
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 4,6 4,3 4,5
Fortes 95,4 95,7 95,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Conscience professionnelle
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 9,2 8,7 9,1
Fortes 90,8 91,3 90,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Maîtrise de soi
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 23,1 0,0 17,0
Fortes 76,9 100,0 83,0
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Être créatif
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 3,1 0,0 2,3
Moyennes 29,2 30,4 29,5
Fortes 67,7 69,6 68,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Respect du règlement intérieur
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 7,7 8,7 8,0
Fortes 92,3 91,3 92,0
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
108 108 |
▲back to top |
108
Annexe 5 : Attentes au regard de leurs savoir-faire ou habileté (%)
Savoir-faire FSEG IUG Ensemble
Communiquer couramment en français
Sans attentes 1,5 0,0 1,1
Faibles 7,7 0,0 5,7
Moyennes 24,6 4,3 19,3
Fortes 66,2 95,7 73,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Communiquer couramment en anglais
Sans attentes 35,4 13,0 29,5
Faibles 18,5 30,4 21,6
Moyennes 29,2 30,4 29,5
Fortes 16,9 26,1 19,3
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Communiquer couramment dans une autre langue nationale
Sans attentes 3,1 21,7 8,0
Faibles 9,2 4,3 8,0
Moyennes 55,4 26,1 47,7
Fortes 32,3 47,8 36,4
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Gérer et organiser le bureau
Sans attentes 4,6 0,0 3,4
Faibles 4,6 0,0 3,4
Moyennes 32,3 17,4 28,4
Fortes 58,5 82,6 64,8
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Identifier les besoins de l’entreprise
Sans attentes 1,5 0,0 1,1
Faibles 1,5 0,0 1,1
Moyennes 24,6 43,5 29,5
Fortes 72,3 56,5 68,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Maîtrise les outils de travail
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 4,6 0,0 3,4
Fortes 95,4 100,0 96,6
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Accomplir les tâches confiées
Sans attentes 0,0 0,0 0,0
Faibles 0,0 0,0 0,0
Moyennes 9,2 8,7 9,1
Fortes 90,8 91,3 90,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Rédiger un rapport
Sans attentes 3,1 0,0 2,3
Faibles 4,6 0,0 3,4
Moyennes 32,3 17,4 28,4
Fortes 60,0 82,6 65,9
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur la satisfaction des employeurs des diplômés de licence de la FSEG et de l’IUG, promotion 2016-2019-ONEF 2024
 |
109 109 |
▲back to top |
109
REFERENCE
• Évaluation technique de l’enquête pilote EUROGRADUATE et étude de faisabilité de sa mise en
œuvre à grande échelle, juillet 2020.
• Insertion des diplômés de l’enseignement technique et professionnel au Mali, promotion 2013.
• Étude élargie sur l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés des institutions
publiques d’enseignement supérieur du Mali (cohorte 2015-2018), 2020.
• Projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 fixant la
grille indiciaire unifiée des personnels relevant des statuts des fonctionnaires de l’État, des
collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires.
Copyright @ 2024 | ONEF .