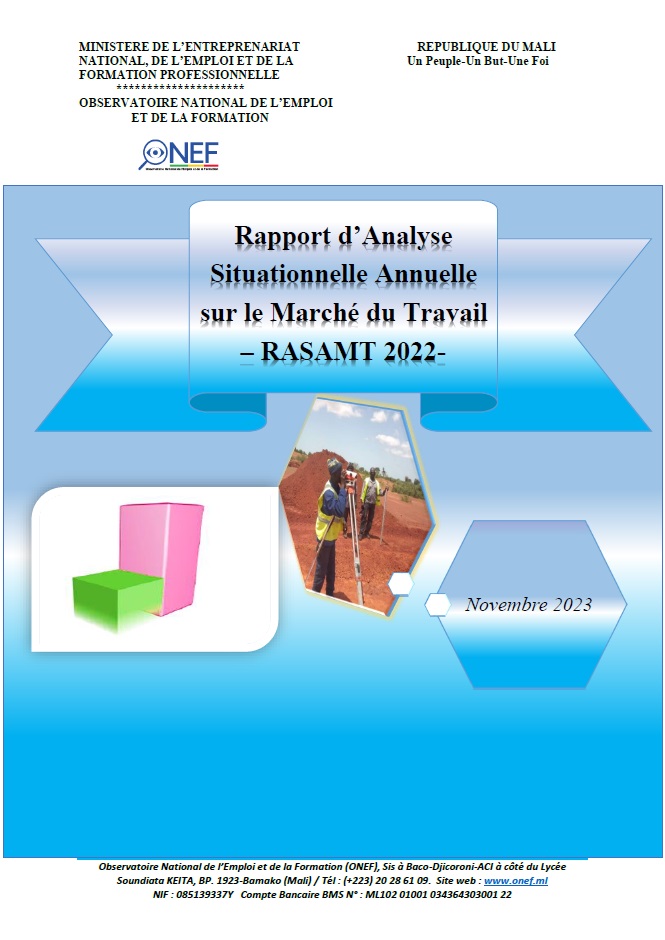MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT REPUBLIQUE DU MALI NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA Un...
 |
MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT REPUBLIQUE DU MALI NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA Un... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT REPUBLIQUE DU MALI
NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA Un Peuple-Un But-Une Foi
FORMATION PROFESSIONNELLE
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF), Sis à Baco-Djicoroni-ACI à côté du Lycée
Soundiata KEITA, BP. 1923-Bamako (Mali) / Tél : (+223) 20 28 61 09. Site web : www.onef.ml
NIF : 085139337Y Compte Bancaire BMS N° : ML102 01001 034364303001 22
Novembre 2023
Rapport d’Analyse
Situationnelle Annuelle
sur le Marché du Travail
– RASAMT 2022-
 |
2 2 |
▲back to top |
ii
Equipe d’élaboration du rapport
Coordination technique
M. Boubacar DIALLO Directeur Général, ONEF
Mme Aoua dite Saran DEMBELE Directrice Générale Adjointe, ONEF
Comité de rédaction
M. Boubacar DIALLO Directeur Général, ONEF
Mme Aoua dite Saran DEMBELE Directrice Générale Adjointe, ONEF
M. Makan SISSOKO Chef Département études d'évaluation des incidences des
politiques et programmes publics sur l’emploi et la formation,
ONEF
M. N’Faly SIAMAN Chef Département études sur les qualifications et l’emploi, ONEF
M. Ousmane DIALL Chef Département études conjoncturelles et prospectives du
marché du travail, ONEF
M. Adama Andé TOGO Chef de service études conjoncturelles du marché du travail, ONEF
Mme Kadia Bagayoko Chef de Service études prospectives du marché du travail, ONEF
Sidy Boly Chef de Division des Statistiques de la Conjoncture, INSTAT
Administration et Gestion
M. Ibrahima Yala DIALLO Agent Comptable, ONEF
Mme Sohayata Attaher MAIGA Chef Service Administration et Gestion des Ressources Humaines,
ONEF
M. Bandiougou KEITA Chef Cellule de Communication et des Relations Publiques, ONEF
M. Siaka KONATE Chef Département Administratif et Financier, ONEF
M. Oumar OUOLOGUEM Chef Cellule Contrôle Interne et Suivi Evaluation, ONEF
Mme Oumou KEITA Chef Section Comptabilité Matières, ONEF
Mme Sétou DOUMBIA Secrétaire de Direction, ONEF
Comité Scientifique
Président
M. Mahamadou Zibo MAIGA
Coordinateur de la Cellule Technique du CSLP
Membres
Pr. Drissa SAMAKE
Directeur Général, CNRST
Pr. Anna TRAORE Recteur par Intérim, USSGB
Pr. Alou Ag Agousoum Directeur Général, IPU
Pr. Samba Ousmane SOW Directeur Général, INSP
Dr. François KONE Directeur Général, CERCAP
Dr. Modibo Sylla Directeur Général, IER
Dr. Issa BOUARE Directeur Général Adjoint, INSTAT
M. Bamoussa KONE Directeur National, DNPD
Comité de lecture
Cheick Fanta Mady TRAORE Expert Formation
 |
3 3 |
▲back to top |
iii
Table des matières
Equipe d’élaboration du rapport ..........................................................................................................ii
Liste des tableaux ................................................................................................................................... v
Liste des graphiques .............................................................................................................................. vi
Sigles et abréviations ............................................................................................................................ vii
Résumé analytique ................................................................................................................................. x
Introduction ........................................................................................................................................... 1
Méthodologie .......................................................................................................................................... 2
1. Définitions des concepts ................................................................................................................ 3
1.1. Population en emploi ............................................................................................................... 3
1.2. Travail ..................................................................................................................................... 3
1.3. Population en âge de travailler ................................................................................................ 3
1.4. Chômeur .................................................................................................................................. 3
1.5. Chômage combiné à la main-d’œuvre potentielle ................................................................... 3
1.6. Main d’œuvre .......................................................................................................................... 4
1.7. Taux d’emploi ......................................................................................................................... 4
1.8. Taux d’emploi informel ........................................................................................................... 4
2. Situation économique, financière, sociale et démographique .................................................... 5
2.1. Situation économique .............................................................................................................. 5
2.2. Situation financière .................................................................................................................. 6
2.3. Situation éducative .................................................................................................................. 8
2.4. Situation démographique ....................................................................................................... 11
3. Enseignements et formation professionnelle ............................................................................. 12
3.1. Enseignement technique et professionnel ............................................................................. 12
3.2. Enseignement supérieur......................................................................................................... 14
3.2.1. Universités et Instituts ................................................................................................... 14
3.2.2. Grandes écoles et Instituts ............................................................................................. 26
3.3. Ressources humaines formées à l’extérieur du Mali en 2022 ............................................... 39
3.3.1. Profil des ressources humaines formées à l’extérieur ................................................... 39
3.3.2. Financement des formations à l’extérieur ..................................................................... 41
3.3.3. Evaluation des coûts de formation des diplômes étrangers non reconnus ..................... 42
3.4. Formation professionnelle ..................................................................................................... 43
3.4.1. Effectifs dans les Centres de Formation professionnelle ............................................... 43
3.4.2. FAFPA ........................................................................................................................... 44
3.5. Flux des nouveaux diplômés entrants potentiels sur le marché du travail en 2023-2024 ..... 45
3.5.1. Flux des nouveaux diplômés de l’Enseignement Secondaire technique et Professionnel
entrants potentiels sur le marché du travail ................................................................................... 45
3.5.2. Flux des nouveaux diplômés des Universités publiques entrants potentiels sur le marché
du travail 46
3.5.3. Flux des nouveaux diplômés des Instituts et grandes écoles publiques entrants
potentiels sur le marché du travail ................................................................................................. 46
3.5.4. Flux des nouveaux diplômés formés à l’extérieur du Pays entrants potentiels sur le
marché du travail ........................................................................................................................... 47
4. Marché du travail ........................................................................................................................ 48
4.1. Situation de l’emploi et du chômage ..................................................................................... 48
4.1.1. Population active et taux d’activités .............................................................................. 48
4.1.2. Taux d’emploi informel ................................................................................................. 50
4.1.3. Emploi selon le secteur institutionnel ............................................................................ 51
4.1.4. Chômage ........................................................................................................................ 52
4.1.5. Sous-emploi lié à la durée du travail ............................................................................. 53
4.1.6. Inactivité ........................................................................................................................ 54
4.2. Intermédiation ....................................................................................................................... 56
 |
4 4 |
▲back to top |
iv
4.2.1. Demandes d’emplois ..................................................................................................... 57
4.2.2. Offres d’emplois ............................................................................................................ 60
4.2.3. Placements ..................................................................................................................... 62
4.3. Créations d’emplois et employabilité .................................................................................... 65
5. Sécurité sociale ............................................................................................................................. 71
5.1. Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire ............................. 71
5.2. Caisse Malienne de Sécurité Sociale ..................................................................................... 71
5.3. Agence Malienne de Mutualité Sociale ................................................................................. 72
5.4. Agence Nationale d'Assistance Médicale (ANAM) .............................................................. 76
5.5. Institut National de Prévoyance Sociale ................................................................................ 77
5.5.1. Les cotisations ............................................................................................................... 77
5.5.2. Les prestations ............................................................................................................... 78
5.5.3. Les prestations des structures socio-sanitaires .............................................................. 80
5.5.4. Les conventions internationales de sécurité sociale ...................................................... 82
6. Dialogue social ............................................................................................................................. 84
6.1. Gestion des conflits collectifs ................................................................................................ 84
6.2. Visas de contrats de travail .................................................................................................... 86
6.3. Règlement des litiges individuels .......................................................................................... 88
6.4. Accidents de travail et maladies professionnelles ................................................................. 88
6.5. Licenciements des travailleurs par branche d’activités et par motif de licenciement ........... 89
7. Migration ...................................................................................................................................... 93
Conclusion et Recommandations ....................................................................................................... 95
 |
5 5 |
▲back to top |
v
Liste des tableaux
Tableau 1: Croissance du PIB réel, de la consommation des ménages et de l'investissement (en %) ..................... 6
Tableau 2: Evolution de la part des secteurs dans le PIB (en %) ............................................................................ 6
Tableau 3: Evolution du Taux Brut de Scolarisation (TBS) par sexe (en %) .......................................................... 9
Tableau 4: Evolution du taux d’achèvement (TA) par sexe (en %) ..................................................................... 10
Tableau 5: Répartition de la population du Mali en 2022 selon la région et le sexe (en nombre d’habitants) ...... 11
Tableau 6: Résultat des examens par niveau de diplôme ...................................................................................... 13
Tableau 7: Répartition des étudiants des Universités du Mali selon le sexe (en effectif et en %)......................... 15
Tableau 8: Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par sexe selon le niveau d'étude et la faculté ....... 17
Tableau 9: Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par niveau d’étude selon la filière de chaque
faculté/institut........................................................................................................................................................ 18
Tableau 10: Répartition des étudiants de l'ULSHB par faculté/institut, par classe et par sexe ............................. 19
Tableau 11: Répartition des étudiants de l'ULSHB par faculté/institut et par sexe selon la filière ....................... 20
Tableau 12: Répartition des étudiants de l'USJPB par année et par sexe .............................................................. 22
Tableau 13: Répartition des étudiants de l'USSGB par sexe selon la faculté et le niveau d’étude ........................ 23
Tableau 14: Répartition des étudiants de l'USTTB par sexe selon la faculté/institut et le niveau d’étude (année
académique 2022-2023) ........................................................................................................................................ 24
Tableau 15: Répartition des étudiants de l'USTTB par sexe selon la filière ......................................................... 25
Tableau 16: Répartition des étudiants des grandes écoles par genre ..................................................................... 26
Tableau 17: Répartition des étudiants du CERFITEX (année scolaire 2021/2022) par filière et sexe .................. 27
Tableau 18: Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) du CERFITEX par filière .............................. 28
Tableau 19: Répartition des étudiants de l'ENETP (année scolaire 2021-2022) par sexe selon le niveau d’étude et
la classe ................................................................................................................................................................. 28
Tableau 20: Répartition des étudiants de l'ENETP (année scolaire 2021-2022) par sexe selon la filière ............. 29
Tableau 21: Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) de l'ENI-ABT par sexe selon le niveau d’étude
.............................................................................................................................................................................. 30
Tableau 22: Répartition des étudiants de l’ENSUP (2021-2022) par sexe selon le niveau d’étude ...................... 31
Tableau 23: Répartition des étudiants de l’Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication
(ESJSC) ................................................................................................................................................................. 31
Tableau 24: Répartition des étudiants de l’IHERI-AB de Tombouctou au métier du livre par sexe (2021-2022)
selon la classe ........................................................................................................................................................ 32
Tableau 25: Effectifs des étudiants de l'INFSS par sexe selon le niveau d’étude et la classe ............................... 33
Tableau 26: Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) par sexe selon le niveau d’étude et la classe . 33
Tableau 27: Répartition des étudiants de l’INFTS (année scolaire 2021/2022) par sexe selon la filière .............. 34
Tableau 28: Répartition des étudiants de l’INJS par sexe selon le cycle et le niveau d’étude .............................. 35
Tableau 29: Répartition des étudiants de l’INJS par filière selon le cycle et le niveau d’étude ............................ 35
Tableau 30: Répartition des étudiants de l’IPR/IFRA (Année académique 2022/2023) par sexe selon le niveau
d’étude et la classe ................................................................................................................................................ 36
Tableau 31: Répartition des étudiants de l’IPR/IFRA (Année académique 2022/2023) par sexe selon la filière 37
Tableau 32: Situation des doctorants inscrits en 2020/2021 selon la nationalité.................................................. 38
Tableau 33 : Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) de l’IZSEJB par filière et sexe ..................... 39
Tableau 34: Répartition des étudiants formés à l’extérieur par type diplôme obtenu ........................................... 40
Tableau 35: Répartition des effectifs dans les CFP public et Privé en 2022 par région et par sexe ...................... 44
Tableau 36: Formation de la population active en 2022 selon le secteur (en FCFA et %) .................................... 45
Tableau 37: Répartition des nouveaux diplômés de l’Enseignement secondaire technique et professionnel ....... 46
Tableau 38: Répartition des diplômés potentiels entrants potentiel sur le marché du travail selon les Universités
par sexe ................................................................................................................................................................. 46
Tableau 39: Répartition des diplômés potentiels selon les Instituts ou grandes école par sexe ............................ 47
Tableau 40: Répartition des diplômés formés à l’étranger selon le type de diplôme par sexe .............................. 47
Tableau 41: Répartition de la population en âge de travailler par statut vis-à-vis de la main-d'œuvre ................. 48
Tableau 42: Répartition de la population active ou main d’œuvre ........................................................................ 49
Tableau 43: Taux d’activités par caractéristique sociodémographique (en %) ..................................................... 50
Tableau 44 : Taux d’emploi informel selon le sexe (en %) ................................................................................... 51
Tableau 45: Répartition des actifs occupés par milieu et par sexe selon le secteur institutionnel ......................... 52
Tableau 46: Evolution du taux combiné du chômage et de la main d’œuvre potentielle de 2014 à 2022 ............. 53
Tableau 47: Taux de sous-emploi (en %) .............................................................................................................. 54
Tableau 48: Répartition en % des inactifs par raison d'inactivité .......................................................................... 55
Tableau 49: Répartition en % des inactifs selon les moyens utilisés pour survivre .............................................. 56
Tableau 50: Demandes d’emploi enregistrées par caractéristique sociodémographique ....................................... 59
Tableau 51: Demandes d’emploi enregistrées par qualification et métier demandé ............................................. 60
 |
6 6 |
▲back to top |
vi
Tableau 52: Offres d’emploi enregistrées par Bureaux caractéristique sociodémographique ............................... 61
Tableau 53: Offres d’emploi enregistrées par qualification et métier offert ......................................................... 62
Tableau 54: Placements effectués par sexe selon la structure de placement et la qualification ............................ 63
Tableau 55: Placements effectués par sexe selon le métier ................................................................................... 64
Tableau 56: Evolution des emplois créés de 2019 à 2022 ..................................................................................... 65
Tableau 57: Répartition du nombre d’emplois créés par trimestre et par branche d’activités du secteur privé .... 66
Tableau 58: Répartition du nombre d’emplois publics créés par type .................................................................. 67
Tableau 59: Répartition des stagiaires par Dispositif de formation et de qualification 2022 selon le sexe ........... 68
Tableau 60: Répartition des demandes de formation enregistrées en CREE, GERME et autres modules par région
et sexe.................................................................................................................................................................... 69
Tableau 61: Récapitulatif des placements en stage de qualification par région et par sexe .................................. 70
Tableau 62: Indicateurs de la protection sociale ................................................................................................... 71
Tableau 63: Situation des pensionnés de la CMSS par région au 31 décembre 2022 ........................................... 72
Tableau 64: Situation des mutuelles de santé au 31 décembre 2022 ..................................................................... 73
Tableau 65: Situation des ressources (entrées) en 2022 ........................................................................................ 74
Tableau 66: Situation des prestations par les mutuelles en 2022 .......................................................................... 75
Tableau 67: Taux de couverture du risque maladie par les mutuelles de santé en 2022 ....................................... 76
Tableau 68: Taux de couverture nationale des indigents ....................................................................................... 77
Tableau 69: Répartition des cotisations par structure (en millions FCFA) .......................................................... 77
Tableau 70: Répartition des nouveaux dossiers d’assurés et de prestations reçus en 2022 ................................... 78
Tableau 71: Répartition des bénéficiaires par catégorie d’assurés et par sexe ...................................................... 79
Tableau 72: Répartition des bénéficiaires par branche et montant des prestations ............................................... 80
Tableau 73: Répartition des bénéficiaires de pensions par type de pension et par sexe ........................................ 80
Tableau 74: Nombre de prestations en faveur des accidentés de travail ............................................................... 81
Tableau 75: Activités de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles .................................. 81
Tableau 76: Activités médicales curatives ............................................................................................................ 82
Tableau 77: Situation des prestations payées aux travailleurs maliens de l’extérieur ........................................... 83
Tableau 78: Situation des pensions et rentes maliennes payées à l’extérieur du Mali .......................................... 83
Tableau 79: Répartition des conflits collectifs par caractéristique sociodémographique ...................................... 85
Tableau 80: Visa de contrats de travail ................................................................................................................. 87
Tableau 81: Visa des contrats des travailleurs expatriés ....................................................................................... 88
Tableau 82: Litiges individuels selon le règlement et par région .......................................................................... 88
Tableau 83: Accident de travail et maladies professionnelles par région .............................................................. 89
Tableau 84: Licenciement des travailleurs par région et par motif ....................................................................... 90
Tableau 85: licenciement des travailleurs par région et par motif du 1er janvier au 31 décembre 2022 .............. 91
Tableau 86: Evolution des effectifs des maliens reconduits par continent de 2016 à 2022................................... 93
Tableau 87: Evolution des indicateurs clés de la migration de 2018 à 2022 ......................................................... 94
Liste des graphiques
Graphique 1: Pyramide des âges du Mali en 2022 (en milliers de personnes) ...................................................... 12
Graphique 2: Répartition des diplômés par domaine de formation ....................................................................... 41
Graphique 3: Répartition des étudiants par pays d'accueil .................................................................................... 41
Graphique 4: Placements effectués par région ...................................................................................................... 64
Graphique 5: Situation du cofinancement en 2022 ............................................................................................... 73
Graphique 6: Evolution du transfert de fonds des migrants en milliards de F CFA de 2012 à 2022 .................... 94
 |
7 7 |
▲back to top |
vii
Sigles et abréviations
AMAMUS Agence Malienne de la Mutualité Sociale
AMO Assurance Maladie Obligatoire
ANAM Agence Nationale d’Assistance Médicale
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
APEJ Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
ASACO Associations de santé communautaire
AVD Agriculture Vivrière et Durable
BAC Baccalauréat
BAD Banque Africaine de Développement
BIT Bureau international du Travail
BPP Bureau Privé de Placement
BT Brevet de Technicien
BTP Bâtiment Travaux Publics
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CEDEAO Communautaire Economique des Etats de L’Afrique de L’Ouest
CERFITEX Centre de Recherche et de Formation pour L’industrie Textile
CFA Comptabilité Finance Audit
CFP Centre de Formation Professionnelle
CIC Carte d’Identité Consulaire
CL Candidat Libre
CMSS Caisse Malienne de Sécurité Sociale
CNECE Centre National d’Examen et de Concours de l’Éducation
Covid-19 La Maladie à coronavirus 2019
CREDD Cadre stratégique pour la Relance économique et le Développement durable
CREE Créer votre Entreprise
DEA Diplôme d’Etude Approfondie
DEF Diplôme d’Etude Fondamentale
DEUG Diplôme d’Etude Universitaire Générale
DNFP Direction Nationale de la Formation Professionnelle
DNP Direction Nationale de la Population
DNPD Direction Nationale de la Planification et du Développement
DNPSES Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire
DNT Direction nationale du travail
EJOM Emploi des Jeunes Crée les Opportunités au Mali
EMOP Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages
ENETP Ecole Nationale D’enseignement Technique et Professionnel
ENI-ABT École Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré
ENSUP École Normale Supérieure
 |
8 8 |
▲back to top |
viii
ESJSC Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication
ETP Ecole des Travaux Publics
ETT Entreprises des Travaux Temporaires
FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
FAGES Faculté du Génie et des Sciences
FAMA Faculté d’Agronomie et de Médecine Animale
FAPH Faculté de Pharmacie
FASSO Faculté des sciences sociales
FBCF Formation Brute du Capital Fixe
FCFA Franc de la Communauté financière africaine
FDPRI Faculté de Droit Privé
FDPU Faculté de Droit Public
FHG Faculté d'Histoire et de Géographie
FIER
Le projet de Formation professionnelle, Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des
jeunes Ruraux
FLSL Faculté des Lettres, Langues et Sciences du Langage
FMOS Faculté de Médecine et d’Odonto Stomatologie
FSAP Faculté des Sciences Administratives et Politique
FSEG Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
FSHSE Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education
FST Faculté des Sciences et Techniques
GERME Gérer Mieux votre Entreprise
HIMO Haute Intensité de la Main d’Œuvre
IC Institut Confucius
IFM Institut de Formation des Maîtres
IFP Institut de Formation Professionnelle
IHERI-ABT
L’Institut des Hautes Etudes et des Recherches Islamiques Ahmed Baba de
Tombouctou
INFSS Institut National de formation en Sciences de la Santé
INFTS Institut National de Formation en Travail Social
INJS Institut National de la Jeunesse et des Sports
INPS Institut National de Prévoyance Sociale
INSTAT Institut National de la Statistique
IPR/IFRA Institut Polytechnique Rural de formation et de Recherche Appliquée
IPU Institut de Pédagogie Universitaire
ISA Institut des Sciences Appliquées
IUFP institut Universitaire de Formation Professionnelle
IUG Institut Universitaire de Gestion
IUT Institut Universitaire de Technologie
IZSEJB Institut Zayed des Sciences Economiques et Juridiques de Bamako
LMD Licence Master Doctorat
LuxDev Agence Luxembourgeoise pour la Coopération et le Développement
MDC Missions diplomatiques et consulaire
 |
9 9 |
▲back to top |
ix
MEFP Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
MER Micro Entreprise Rurale
OI Organisme International
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONMOE Office National de la Main-d’œuvre et de l’Emploi
PIB Produit Intérieur Brut
PROCEJ Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes
PSA Production et Santé Animale
PTI Plan Triennal d’Investissement
RAMED Régime d’Assistance Médicale
RASAMT Rapport d’Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail
RAVEC Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil
SCN Système de Comptabilité Nationale
SU3 le taux combiné du chômage et de la main-d'œuvre potentielle
UEMOA Union Economique Monétaire Ouest Africain
USA United States of America (les Etats-Unis d’Amérique)
ULSHB Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako
USJPB Université des Sciences Juridique et Politique de Bamako
USSGB Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
USTTB Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako
VA Vulgarisation Agricole
 |
10 10 |
▲back to top |
x
Résumé analytique
Le Rapport d’Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail (RASAMT) est une
production phare de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF). Il donne
des informations nécessaires relatives au marché du travail sur la base de l’année précédente
(2022). Il est destiné à tous les utilisateurs et lecteurs des informations statistiques du marché
du travail.
Les informations contenues dans ce document proviennent des structures publiques et
parapubliques du Mali. Ces structures se retrouvent principalement dans les ministères en
charge de l’emploi, du travail, de la formation professionnelle, de l’économie et des finances,
de l’éducation nationale, de l’enseignement technique, de l’enseignement supérieur, du
développement social, du dialogue social et de la migration.
Les différentes parties du RASAMT 2022 sont : (i) définitions des concepts, (ii) situation
économique, financière, sociale et démographique, (iii) enseignement et formation
professionnelle, (iv) marché du travail, (v) sécurité sociale, (vi) dialogue social et (vii)
migration. Avant ces parties, ce rapport donne un résumé analytique, une introduction, des
objectifs, une méthodologie et se termine par une conclusion et des recommandations.
A la différence des RASAMT précédents, le RASAMT 2022 contient les données du Régime
d’Assistance Médicale (RAMED) et de l’Institut des Hautes Etudes et de Recherches
Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI-ABT).
Par ailleurs, la mise en œuvre du projet de Formation professionnelle, Insertion et Appui à
l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux (FIER) prenant fin en 2021, ce rapport ne contient pas des
informations sur ce projet.
Situation économique, financière, éducative et démographique
En 2022, le taux de croissance de l’activité économique est estimé à 3,7% contre 3,1% en 2021.
Le taux de croissance de 2022 s’explique principalement par la forte croissance du secteur
primaire avec une prévision de 7,2%.
En 2022, l'agrégat "Recettes et dons" a atteint 2 360,8 milliards de FCFA, dont 1 687,2 milliards
de FCFA provenant des recettes budgétaires, 630,6 milliards de FCFA des établissements
nationaux (EPN) et 43,1 milliards de FCFA de dons. Les recettes totales réalisées à la fin
décembre 2022 se sont élevées à 1 800,1 milliards de FCFA, contre 1 819,4 milliards de FCFA
en 2021, soit une diminution de 2,2%. En ce qui concerne les dépenses, elles se sont élevées à
2 937,3 milliards de FCFA en 2022, dont 2 942,3 milliards de FCFA de dépenses définitives et
-5,0 milliards de FCFA de prêts nets. Le taux de pression fiscale est passé de 15,5% en 2021 à
13,5% en 2022, soit une diminution de 2,0 points de pourcentage. Le solde global, y compris
les dons, s'est établi à -576,5 milliards de FCFA en 2022, contre 520,8 milliards de FCFA en
2021.
 |
11 11 |
▲back to top |
xi
En 2022, l'accès à l'éducation reste un défi majeur pour de nombreux maliens, en particulier les
enfants vivant dans des zones d'insécurité. Nous avons observé une hausse du taux brut de
scolarisation (TBS) pour les cycles préscolaires, fondamental I et fondamental II entre
2019/2020 et 2021/2022, excepté le préscolaire et le niveau secondaire technique (en
proportion). On a remarqué aussi une hausse du taux d’achèvement (TA) dans la plupart des
niveaux d’éducation et pour les deux sexes au fil du temps.
Le Mali est confronté à un important défi de croissance démographique rapide, qui a des
répercussions sur les demandes sociales telles que l’éducation, la santé, l’emploi, les
infrastructures, etc. Entre 1987 et 2022, la population malienne a plus que doublé en 35 ans,
passant de 7 696 348 habitants en 1987 à environ 21 697 317 habitants en 2022 (selon les
projections 2010-2035 de la Direction Nationale de la Population – DNP). La population
malienne présente une pyramide des âges très jeune qui s’amincit progressivement avec l’âge.
Enseignements et formation professionnelle
Au Mali, en 2022, les universités maliennes comptaient 117 695 étudiants dont 27,0% de
femmes et 73,0% d’hommes. En revanche, 46,2% (54 427 étudiants) de cet effectif se trouvaient
dans l’Université des Sciences Sociales et Gestion de Bamako (USSGB), soit la plus importante
population d’étudiants. Par contre, l’effectif de l’Université de Ségou ne représente que 7,3%
(8 612 des étudiants), soit la plus faible proportion d’étudiants enregistrée en 2022.
Au cours de l’année académique 2021-2022, les grandes écoles maliennes comptaient 12 553
étudiants dont 72,9% de garçons. L’effectif des étudiants des grandes écoles a connu une
augmentation de 11,8% entre l’année académique 2020-2021 (11 231 étudiants) et celle 2021-
2022 (12 553 étudiants).
En 2022, un total de 3 019 étudiants ayant poursuivi leur formation à l'étranger a réussi à
décrocher leur diplôme. Parmi eux, 1 965 étaient des hommes et 1 054 étaient des femmes.
Selon la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD), les coûts estimatifs de
formation à l’étranger étaient de trois milliards huit cent soixante millions de francs CFA (3 860
000 000). Parmi les coûts globaux de formation à l’étranger, la mobilisation des fonds propres
représentait 54,2%.
En 2022, 4 571 apprenants ont suivi leur formation dans les centres de formation professionnelle
agréés par le ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle. Cependant, le
nombre de formés a diminué de 29,6% par rapport à l'année précédente. Plus de la moitié (52,3%)
des formateurs agréés sont dans les régions de Koulikoro et Ségou ainsi que dans le District de
Bamako.
En 2022, les dépenses totales consacrées à la formation de la population active se sont élevées
à 81 947 067 FCFA, se répartissant en deux secteurs : 62 779 737 CFA, (76,6%) ont été investis
dans le secteur non structuré et 19 167 330 CFA (23,4%) ont été alloués au secteur moderne.
Le nombre de microentreprises consolidées par le PROCEJ s’élevait à 341.
 |
12 12 |
▲back to top |
xii
Marché du travail
En 2022, la population en âge de travailler était de 10 686 311 personnes dont 53,6% de
femmes. La population active était de 6 872 554 personnes (soit 64,3% de la population en âge
de travailler). Le taux d’activités est de 60,9% sur le plan national, dont 76,8% pour les hommes
et 47,1% pour les femmes. Presque la totalité (96,6%) des emplois sont informels avec
respectivement 98,2% pour les femmes et 95,6% pour les hommes. Les emplois se répartissent
selon le secteur institutionnel en 82,9% des entreprises privées, 12,5% du personnel de maison,
3,4% du secteur public, 0,7% des ONG, organisations internationales et associations, et enfin
0,5% des entreprises privées formelles.
Le taux combiné du chômage et de la main d’œuvre potentielle est 6,1% dont 8,1% pour les
femmes et 4,6% pour les hommes. Le taux de sous-emploi est de 17,9% dont 23,9% pour les
femmes et 13,5% pour les femmes. Cette année, 4 673 demandes d’emplois ont été enregistrées
pour 1 434 offres. L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a fait 1 914 placements.
Entre 2019 et 2022, en moyenne 46 493 emplois ont été créés par an. Depuis l’effet néfaste de
la pandémie de COVID-19 sur la création d’emplois, nous constatons une augmentation
progressive du nombre d’emplois créés où il atteint 61 719 emplois en 2022 dont le secteur
public 50,8% des emplois créés. Plus de six emplois visés sur dix sont des contrats à durée
déterminée. Les cinq branches d’activités les plus pourvoyeuses d’emplois dans le secteur privé
en 2022 sont : « Activités pour la Santé Humaine et l’Action Sociale » (6 288 emplois) ; «
Activités de Services de Soutien et de Bureau » (5 575 emplois) ; « Activités Extractives »
(3 867 emplois) ; « Activités des Organisations Extraterritoriales » (2 678 emplois) et les «
Activités d’Enseignement » (2 256 emplois). Les emplois publics sont en majorité (57,4%) des
emplois générés par les projets, programmes et agences d’insertion (auto-emplois).
Sécurité sociale
En 2022, le Mali a 1 400 Associations de Santé Communautaire (ASACO), 97 mutuelles de
santé et 17 017 sociétés coopératives fonctionnelles. Plus de la moitié (53,4%) des mutuelles
de santé ne sont pas cofinancées. Le District de Bamako et les régions de Ségou, Sikasso et
Kayes représentent respectivement 22,3% ; 19,4% ; 17,0% et 10,2% des mutuelles de santé.
Sur l’ensemble des mutuelles de santé, le coût des prestations s’élevait à 959 891 493 FCFA
dont 620 671 715 FCFA de cotisations recouvrées et 379 633 555 FCFA du montant du
cofinancement sur 490 163 bénéficiaires inscrits et 228 947 bénéficiaires à jour.
Le nombre de pensionnés à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale était 59 738 personnes dont
65,5% de civils. Au Régime d’Assistance Médicale (RAMED), 1 034 413 indigents sont
immatriculés sur 1 303 486 indigents prévus soit un taux de couverture de 79,4%. Toutes les
cotisations de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ont connu une croissance
annuelle positive. En 2022, les prestations de l’INPS sont de 21 472 nouveaux assurés
immatriculés au régime général, 4 666 nouveaux assurés volontaires immatriculés, 73 595
nouveaux assurés AMO immatriculés, 7 697 nouveaux bénéficiaires d’allocations familiales et
210 nouvelles victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles.
 |
13 13 |
▲back to top |
xiii
Dialogue social
En 2022, 58 conflits ont été enregistrés par la Direction Nationale du Travail (DNT) dont 41,4%
sont des mots d’ordre levés, 34,5% des mots d’ordre observés, 19,0% des mots d’ordre
suspendus, 3,4% des mots d’ordre observés et suspendus par la suite, et enfin 1,7% des mots
d’ordre retirés. En 2022, 1 240 litiges individuels ont été soumis à l’inspection du travail, parmi
lesquels 849 litiges sont réglés en conciliation ; 364 transmis au tribunal et 23 classés en
instance. Il y a eu 211 cas d’accidents de travail déclarés en 2022.
Cette année, 40 988 contrats de travail ont été visés par les inspecteurs de travail dont 15 149
Contrats à Durée Indéterminé (CDI) et 25 839 Contrats à Durée Déterminée (CDD). Parmi ces
contrats, 1 134 sont visés pour les travailleurs expatriés. Le licenciement a touché 2 697
travailleurs dont 1 833 cas de motif économique, 465 cas pour faute professionnelle, 301 cas
pour abandon, 67 cas de faute lourde et 31 cas de rupture conventionnelle.
Migration
Le nombre des maliens reconduits était de 6 574 personnes, et l’intégralité des reconduits venait
des pays d’Afrique. Le nombre des cartes d’identité consulaires envoyées dans les missions
diplomatiques et consulaires a fortement diminué en 2022, passant de 121 000 cartes en 2021
à 28 000 cartes en 2022. Il en est de même pour les passeports transmis aux missions
diplomatiques et consulaires avec 18 578 passeports transmis en 2022 contre 23 996 en 2021.
Le montant total du transfert de fonds des migrants était de 507,6 milliards de FCFA en 2022
contre 516,6 milliards de fcfa en 2021.
 |
14 14 |
▲back to top |
1
Introduction
Le rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail est un document contenant
des informations qui concernent d’une manière ou d’une autre le marché du travail ou qui
peuvent l’influencer. Il est produit en réponse à la demande de plus en plus croissante des
utilisateurs d’informations statistiques sur le marché du travail. Cette demande concourt à la
réalisation de la mission principale de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
qui est de faire de la recherche et des études afin de fournir aux décideurs et aux usagers des
informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail, au niveau national et
régional, pour une meilleure régulation de ce marché.
L’ONEF met en place un dispositif permanent pour produire régulièrement les statistiques
fiables sur le marché du travail. En effet, les systèmes d’informations sur le marché du travail
en Afrique francophone faisant défaut, les productions statistiques sont loin d’être fiables.
C’est dans ce contexte qu’est proposée la réalisation du présent Rapport d’Analyse
Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail (RASAMT-2021). Le RASAMT est une
publication des données conjoncturelles et annuelles en rapport avec la situation socio-
économique du pays. Il s’agit aussi de mettre à la disposition des acteurs concernés (décideurs
politiques, les partenaires publics et privés, les chercheurs et les particuliers etc.) des
informations actualisées, pertinentes sur des indicateurs tels que l’intermédiation, le dialogue
social, etc.
Ce rapport renseigne donc un ensemble d’indicateurs et d’informations essentielles pour une
bonne connaissance de l’état et de l’évolution de la situation sur le marché du travail au Mali.
Il peut permettre de déceler les perturbations, de prendre des décisions ou de donner des
orientations. Ainsi, la prise en compte des données sur le marché du travail par les décideurs
nécessite des dispositifs statistiques de qualité. Conscient de ce fait, l’ONEF s’engage à un suivi
conjoncturel des données sur le marché du travail pour mieux orienter les programmes et les
politiques relatifs à la formation et à l’emploi au Mali.
Le présent rapport s’inscrit dans la suite logique des différentes publications faites par
l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation.
Objectifs
L’objectif général de cette étude est de produire un ensemble d’informations sur le marché du
travail portant sur les données de l’année 2022. De façon spécifique, cette étude vise à :
- fournir des données relatives à la situation économique, financière, éducative et
démographique ;
- donner des informations sur l’enseignement et la formation professionnelle ;
- analyser les données relatives à l’emploi et à l’information sur le marché du travail ;
- fournir les données sur le dialogue social et la sécurité sociale ;
 |
15 15 |
▲back to top |
2
- donner un état de la migration au Mali.
Méthodologie
La méthodologie adoptée porte sur la revue documentaire, la collecte des données au niveau
des structures productrices d’informations statistiques de l’administration publique et des
secteurs privés, ensuite l’analyse des données et enfin la rédaction du rapport.
La collecte des données concerne l’ensemble du pays et quelques informations du marché du
travail des maliens de l’extérieur. Cette collecte est organisée et supervisée par l’ONEF, et dix
(10) jours étaient programmés pour ladite collecte mais elle s’est étendue sur 35 jours. En effet,
la collecte était programmée sur les semaines du 07 au 18 août 2023, alors qu’elle a réellement
fini le 02 octobre 2023. Sachant la difficulté de collecte des données du RASAMT en amont,
les agents de l’ONEF ont assuré eux-mêmes le rôle d’enquêteurs.
Une correspondance de collecte des données pour l’élaboration du RASAMT et un canevas de
renseignement ont été envoyés aux structures productrices des informations statistiques du
marché du travail
Après la collecte des données auprès des structures productrices des informations statistiques
en lien avec le marché du travail, le département des études conjoncturelles et prospectives du
marché du travail de l’ONEF a procédé à la mise en cohérence des informations collectées. La
mise en cohérence est faite à l’aide d’Excel. Elle consiste principalement à voir et à corriger les
totaux des modalités et les pourcentages (à un chiffre après la virgule) pour chaque tableau des
structures productrices des données sur le marché du travail autre que l’ONEF.
Les données des créations d’emplois ainsi que de l'Enquête Modulaire et Permanente auprès
des Ménages (EMOP) sont des bases de données de ce rapport. L’analyse est faite par une
équipe technique multidisciplinaire composée des agents de l’ONEF et des personnes
ressources.
 |
16 16 |
▲back to top |
3
1. Définitions des concepts
Les concepts définis dans ce rapport permettront de faciliter leur compréhension. Ces concepts
sont les principaux indicateurs du marché du travail se rapportant tantôt à la personne humaine
ou à son collectif, tantôt à l'activité ou à la situation dans laquelle se trouve la personne ou son
collectif.
1.1. Population en emploi
La population en emploi comprend toutes les personnes en âge de travailler qui, durant une
courte période de référence (7 derniers jours), étaient engagées dans une activité visant à
produire des biens ou à fournir des services en échange d’une rémunération ou d’un profit.
1.2. Travail
Le travail comprend toutes les activités effectuées par des personnes de tout sexe et tout âge
afin de produire des biens ou fournir des services destinés à la consommation par des tiers ou à
leur consommation personnelle. Il exclut les activités qui n’impliquent pas la production de
biens ou de services (par exemple, la mendicité et le vol), le fait de prendre soin de soi (par
exemple, la toilette personnelle et l’hygiène) et les activités qui ne peuvent pas être réalisées
par une autre personne que soi-même (par exemple, dormir, apprendre et les activités de
loisirs)1.
1.3. Population en âge de travailler
La population en âge de travailler comprend toutes les personnes des deux sexes ayant atteint
l’âge légal du travail. La limite inférieure suggérée par le BIT est de 15 ans, âge révolu. Les
pays ont cependant la possibilité de l’adapter à leur propre contexte. Il ne doit en aucun cas être
inférieur à 13 ans, âge révolu. Au Mali, la limite est de 15 ans.
1.4. Chômeur
Le chômeur est défini comme toute personne en âge de travailler qui n’était pas en emploi, qui
avait effectué des activités de recherche d’emploi durant une période récente spécifiée, et était
actuellement disponible pour l’emploi si la possibilité d’occuper un poste de travail existait.
1.5. Chômage combiné à la main-d’œuvre potentielle
Il comprend toutes les personnes sans emploi, n’ayant pas travaillé (ne serait-ce qu’une heure)
lors de la semaine précédant le passage de l’agent enquêteur, ayant recherché ou non un emploi
1 Source : Résolution de la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail :
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/normativeinstrument/wcms_233215.pdf
 |
17 17 |
▲back to top |
4
au cours du mois précédant le passage de l’agent enquêteur et disponibles pour travailler
immédiatement si l’on leur offrait un emploi.
1.6. Main d’œuvre
La main d’œuvre fait référence à l’offre de travail du moment pour la production de biens et de
services en échange d’une rémunération ou d’un profit. Les personnes hors de la main-d’œuvre
sont les personnes en âge de travailler qui ne sont ni en emploi, ni au chômage durant la courte
période de référence.
1.7. Taux d’emploi
C'est le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui est en emploi par rapport à la
population totale âgée de 15 ans et plus.
1.8. Taux d’emploi informel
Le taux d’emploi informel est défini comme étant le pourcentage des personnes en emploi
informel par rapport à la population totale en emploi.
 |
18 18 |
▲back to top |
5
2. Situation économique, financière, sociale et démographique
La reprise amorcée en 2021 s’est renforcée en 2022 en dépit des effets collatéraux de
l’application de l’embargo décrété par la CEDEAO contre le Mali durant près de sept mois, de
même que les implications de la guerre en Ukraine. En effet, malgré la contraction de la
production cotonnière, le taux de croissance de l’activité économique est estimé à 3,7% contre
3,1% en 2021, traduisant la résilience de l’économie malienne.
2.1. Situation économique
Pour analyser la santé économique du pays entre 2018 et 2022, les indicateurs clés sont la
croissance réelle du PIB par secteur d'activité, la consommation finale des ménages, ainsi que
l'évolution des secteurs d'activité dans le PIB au cours de cette période. Ces indicateurs sont
présentés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous.
En 2018, le PIB réel a connu une croissance de 4,9%, démontrant une augmentation solide de
l'activité économique. Cette tendance s'est poursuivie en 2019 avec une croissance de 5,0%.
Cependant, en 2020, le PIB réel a subi une contraction de 1,4%, en raison des effets négatifs de
la pandémie de Covid-19. En 2021, le PIB a rebondi avec une croissance de 3,1% et cette
tendance positive s’est poursuivie en 2022 avec une croissance de 3,7%.
En ce qui concerne les différents secteurs économiques, le secteur primaire a connu une
croissance de 7,3% en 2018. Cependant, cette croissance s'est ralentie à 2,1% en 2019 et a
ensuite chuté de manière significative en 2020 avec une baisse de 4,5%. Cependant, le secteur
primaire montre des signes de reprise avec une contraction plus faible de 3,9% en 2021, suivie
d'une forte croissance de 7,2% prévue pour 2022, en lien avec l’augmentation de la production
céréalière évaluée à 10 098 303 tonnes. Quant au secteur secondaire, il a enregistré une
croissance solide de 9,3% en 2018, suivie d'une augmentation de 4,7% en 2019. En 2020, ce
secteur a connu une légère baisse de 0,2% avant de rebondir en 2021 avec une croissance de
5,1%. Cependant, en 2022, le secteur secondaire a enregistré une baisse de 1,1%. En ce qui
concerne le secteur tertiaire, il présente une croissance stable de 3,6% en 2018, suivie d'une
augmentation à 5,2% en 2019. En 2020, il enregistre une croissance modérée de 1,5% et
continue sa croissance en 2021 avec un taux de 7,3%. Enfin, il a légèrement ralenti en 2022
avec une croissance de 5,0% grâce au regain d’intensité de l’activité économique surtout à la
suite de la levée de l’embargo imposé par la CEDEAO.
En ce qui concerne la formation brute de capital fixe (FBCF), elle a enregistré une baisse de
1,2% en 2018 mais a connu une forte croissance de 11,4% en 2019. En 2020, elle a chuté de
manière significative avec un taux de croissance de -8,2%. Cependant, elle se redresse en 2021
avec une croissance de 3,5%, mais connaît une baisse de 6,5% en 2022, du fait essentiellement
des implications de la mise en application de l’embargo et de la guerre en Ukraine.
.
 |
19 19 |
▲back to top |
6
En ce qui concerne la consommation finale des ménages, on observe une croissance de 3,7%
en 2018, qui se maintient à 5,0% en 2019. En 2020, elle ralentit légèrement avec une croissance
de 3,2% mais rebondit en 2021 avec une croissance de 6,3%. Enfin, elle connaît une légère
baisse en 2022 avec une croissance de 4,6%.
Tableau 1: Croissance du PIB réel, de la consommation des ménages et de l'investissement (en %)
2018 2019 2020 2021 2022
Produit Intérieur Brut (PIB) 4,9 5,0 -1,4 3,1 3,7
Primaire 7,3 2,1 -4,5 -3,9 7,2
Secondaire 9,3 4,7 -0,2 5,1 -1,1
Tertiaire 3,6 5,2 1,5 7,3 5,0
Consommation finale des ménages 3,7 5,0 3,2 6,3 4,6
FBCF -1,2 11,4 -8,2 3,5 -6,5
Source : INSTAT, Comptes nationaux, nouvelle série, 2022
L'analyse (tableau 2) des croissances et des parts des secteurs dans le PIB du Mali au cours des
cinq dernières années. Entre 2018 et 2022, la part du secteur primaire dans le PIB a connu une
diminution progressive. Elle est passée de 32,1% à 30,3%. La part du secteur secondaire dans
le PIB est restée relativement stable entre 2018 et 2021 autour de 23%. Cependant, en 2022,
une baisse a été observée, ramenant cette part à 22,8%. Pour le secteur tertiaire, il a
progressivement augmenté sa part dans le PIB tout au long de la période étudiée. De 38,0% en
2018, il est passé à 40,1% en 2022.
Les taxes indirectes qui représentaient initialement 6,8% du PIB en 2018, ont augmenté
légèrement en 2019 à 7,5%, puis sont revenues à leur niveau initial en 2022. Bien que ces
variations puissent être influencées par des réformes fiscales ou des politiques économiques,
elles sont restées globalement stables sur la période considérée.
Tableau 2: Evolution de la part des secteurs dans le PIB (en %)
2018 2019 2020 2021 2022
Secteur primaire 32,1 31,6 31,2 29,2 30,3
Secteur secondaire 23,1 23,2 23,4 23,9 22,8
Secteur tertiaire 38,0 37,8 38,4 39,8 40,1
Taxes indirectes (moins subventions) 6,8 7,5 7,0 7,1 6,8
Total (PIB aux prix du marché) 100 100 100 100 100
Source : INSTAT, Comptes nationaux, nouvelle série, 2022
2.2. Situation financière
En 2022, l'agrégat "Recettes et dons" a atteint 2360,8 milliards de FCFA, dont 1687,2 milliards
de FCFA provenant des recettes budgétaires, 630,6 milliards de FCFA des établissements
nationaux (EPN) et 43,1 milliards de FCFA de dons. Ces chiffres montrent des évolutions par
 |
20 20 |
▲back to top |
7
rapport à l'année précédente. En effet, les recettes et dons ont augmenté de 0,6% pour atteindre
2347,6 milliards de FCFA. En revanche, les recettes budgétaires ont connu une baisse de 2,9%
en raison de l'embargo imposé par la CEDEAO et l'UEMOA, de la fermeture des frontières, de
l'insécurité dans certaines zones de production et de la guerre en Ukraine.
Les recettes totales réalisées à fin décembre 2022 se sont élevées à 1800,1 milliards de FCFA,
contre 1819,4 milliards de FCFA à la même période en 2021, soit une diminution de 2,2%.
Cette diminution est principalement imputable aux impôts indirects, qui sont passés de 1148,5
milliards de FCFA en 2021 à 1111,7 milliards de FCFA en 2022, en raison de la situation
économique du pays.
Les recettes fiscales nettes ont également diminué, passant de 1721,2 milliards de FCFA en
2021 à 1706,6 milliards de FCFA en 2022, soit une baisse de 0,8% en raison de la crise
multidimensionnelle que traverse le pays. Les recettes non fiscales, quant à elles, ont augmenté
de 1,1%, passant de 94,1 milliards de FCFA en 2021 à 95,2 milliards de FCFA en 2022.
En ce qui concerne les dépenses, elles se sont élevées à 2937,3 milliards de FCFA en 2022,
dont 2942,3 milliards de FCFA de dépenses définitives et -5,0 milliards de FCFA de prêts nets.
Les dépenses courantes ont augmenté de 6,7% avec 1851,9 milliards de FCFA en 2022 contre
1686,7 milliards de FCFA en 2021, principalement en raison de l'augmentation des dépenses
du personnel de 13,2%. Les transferts et subventions ont également augmenté de 11,2%, passant
de 328,3 milliards de FCFA en 2021 à 365,1 milliards de FCFA en 2022, en raison de l'impact
des accords avec les syndicats et des transferts monétaires vers les ménages vulnérables en
raison de l'insécurité et de la pandémie de COVID-19.
Les dépenses de biens et services ont diminué de 2,3%, passant de 436,3 milliards de FCFA en
2021 à 426,1 milliards de FCFA à la fin décembre 2022, en raison des restrictions budgétaires
causées par l'insuffisance des ressources financières. Les dépenses en capital ont également
diminué, passant de 642,3 milliards de FCFA en 2021 à 459,8 milliards de FCFA en 2022, soit
une baisse de 28,4%. Cette diminution est due au non-respect des engagements de certains
partenaires en matière de financement extérieur, en particulier les prêts qui ont diminué de
40,8%. Le financement intérieur a également diminué, passant de 495,2 milliards de FCFA en
2021 à 365 milliards de FCFA en 2022, en raison de la situation économique du pays.
Le taux de pression fiscale est passé de 15,5% en 2021 à 13,5% en 2022, soit une diminution
de 2,0 points de pourcentage. Cette baisse s'explique par la faible mobilisation des recettes
fiscales et les efforts du gouvernement pour atténuer les sanctions économiques et financières
imposées par la CEDEAO et l'UEMOA ainsi que les conséquences de la guerre en Ukraine.
Le solde global, y compris les dons, s'est établi à -576,5 milliards de FCFA en 2022, contre
520,8 milliards de FCFA en 2021. En pourcentage du PIB, il était de -4,9% en 2022, tout comme
en 2021. Le déficit budgétaire, dons inclus, s'est élevé à 576,5 milliards de FCFA en 2022,
contre 520,8 milliards de FCFA en 2021. Cette détérioration est due à la faible mobilisation des
 |
21 21 |
▲back to top |
8
recettes fiscales, qui sont passées de 1641,2 milliards de FCFA en 2021 à 1590,7 milliards de
FCFA en 2022, soit une diminution de 3,0%. En outre, le déficit budgétaire global hors dons
s'est établi à -619,5 milliards de FCFA en 2022, soit -5,3% du PIB, contre -587,2 milliards de
FCFA en 2021, soit -5,5% du PIB.
Au 31 décembre 2022, l'encours de la dette publique à moyen et long terme s'élève à 5918,9
milliards de FCFA, comparé à 5521,8 milliards de FCFA au 31 décembre 2021. Cette dette se
décompose en une dette intérieure de 2567,2 milliards de FCFA, représentant 43,4% du total
de la dette publique, et une dette extérieure de 3351,7 milliards de FCFA, soit 56,6% du total.
2.3. Situation éducative
En 2022, l'accès à l'éducation reste un défi majeur pour de nombreux maliens, en particulier les
enfants vivant dans des zones d'insécurité. Les écoles ont été détruites et le personnel enseignant
a été victime d'intimidation, d'agression physique et de blessures, Ceci a eu comme conséquence
la fermeture de nombreuses écoles et l’arrêt de nombreux financements des partenaires
techniques et financiers pour l'éducation de base, pourtant fondamentale pour le pays.
Dans cette sous-section, nous examinons les taux bruts de scolarisation et d'achèvement pour
évaluer l'accès et la réussite scolaire. Le taux de scolarisation mesure le nombre d'élèves inscrits
dans un cycle d'enseignement par rapport à la population de la tranche d'âge correspondante,
tandis que le taux d'achèvement (pour le premier et le deuxième cycle) indique le pourcentage
d'élèves qui ont terminé leur 6ème ou 9ème année d'études sur la population d'enfants ayant
l'âge correspondant (12 ans ou 15 ans). Ces indicateurs permettent de mesurer le niveau de
participation et de réussite scolaire dans un groupe d'âge donné.
Les tableaux ci-dessous présentent les tendances des taux bruts de scolarisation et d’achèvement
de l'enseignement préscolaire, fondamental et secondaire de 2019 à 2022 au Mali.
L'enseignement préscolaire au Mali est principalement urbain et peu développé.
Le cycle du fondamental dure 9 ans, dont 6 ans pour le premier cycle (Fondamental I) et 3 ans
pour le second cycle (Fondamental II). Le cycle secondaire général est d'une durée de 3 ans,
tandis que le BT et le CAP durent respectivement 4 ans et 2 ans.
Les données ci-dessous indiquent une hausse du taux brut de scolarisation (TBS) pour les cycles
préscolaires, fondamental I et fondamental II entre 2019/2020 et 2021/2022 excepté le
préscolaire et le niveau secondaire technique. Au niveau de la préscolarisation, on observe une
diminution légère du taux brut de scolarisation, passant de 7,9% en 2019-2020 à 6,9% en 2021-
2022. Cela concerne à la fois les garçons (8,1% à 6,6%) et les filles (7,9% à 7,2%). Concernant
le fondamental I, le TBS a légèrement fluctué au cours des années, passant de 79,2% en 2019-
2020 à 79,6% en 2021-2022. Les garçons de cycle d’enseignement ont connu une évolution de
82,9% à 81,8% pour le TBS, tandis que les filles ont connu une augmentation de 75,3% à 77,4%.
Pour le fondamental II, on observe une légère évolution du TBS, atteignant 50,8% en 2021-
2022. Le TBS des garçons a légèrement baissé entre 2019-2020 et 2021-2022 passant de 52,3%
à 51,7%, tandis que celui des filles est passé de 48,4% à 49,8% pour la même période.
 |
22 22 |
▲back to top |
9
Au niveau du secondaire général, le taux brut de scolarisation a connu une augmentation
significative, passant de 24,2% en 2019-2020 à 29,4% en 2021-2022. Cette augmentation est
présente chez les garçons (26,5% à 31,3%) et les filles (21,8% à 27,4%). Concernant le
secondaire technique, le taux brut de scolarisation est resté relativement stable au fil des années,
avec de légères augmentations. Il atteint 0,4% en 2021-2022, aussi bien pour les garçons que
pour les filles. En ce qui concerne les niveaux CAP et BT, on observe une légère augmentation
du taux brut de scolarisation. Pour le CAP, le taux passe de 2,6% en 2019-2020 à 3,8% en 2021-
2022, avec des variations similaires chez les garçons et les filles. Pour le BT, le taux évolue de
5,0% à 6,1%, également avec des hausses similaires pour les deux sexes. Ces faibles taux
soulignent la difficulté des pouvoirs publics à sensibiliser la population à l'importance de
l'enseignement technique, un secteur à fort potentiel d'employabilité pour les jeunes.
Sur les périodes concernées, on constate que les garçons ont généralement des taux de
scolarisation plus élevés que les filles dans toutes les catégories éducatives. L'écart entre les
sexes est plus prononcé dans le Fondamental I et le secondaire général, où les garçons affichent
des taux significativement plus élevés.
Tableau 3: Evolution du Taux Brut de Scolarisation (TBS) par sexe (en %)
2019-2020 2020-2021 2021-2022
Le Taux Brut de Préscolarisation (TBP) 7,9 6,9 6,9
Garçon 8,1 6,7 6,6
Fille 7,9 7,2 7,2
Evolution du TBS au Fondamental I 79,2 78,6 79,6
Garçon 82,9 81,2 81,8
Fille 75,3 75,9 77,4
Evolution du TBS au Fondamental II 50,4 47,9 50,8
Garçon 52,3 49,7 51,7
Fille 48,4 46,0 49,8
Evolution du TBS au secondaire général 24,2 27,7 29,4
Garçon 26,5 30,4 31,3
Fille 21,8 24,9 27,4
Evolution du TBS au secondaire technique 0,4 0,6 0,4
Garçon 0,4 0,6 0,4
Fille 0,3 0,5 0,4
Evolution du TBS niveau CAP 2,6 2,7 3,8
Garçon 3,2 3,2 3,7
Fille 2,1 2,2 3,8
TBS niveau BT 5,0 5,6 6,1
Garçon 5,6 6,1 6,4
Fille 4,4 5,1 5,7
Source : CPS/Education, Rapport d'analyse des indicateurs, 2022
 |
23 23 |
▲back to top |
10
En examinant le tableau ci-dessous, on remarque une hausse du taux d’achèvement (TA) dans
la plupart des niveaux d’éducation et pour les deux sexes au fil du temps. Au niveau du
Fondamental I, on observe une augmentation régulière du taux d'achèvement global. En 2019-
2020, ce taux était de 43,0%, puis il a augmenté à 51,6% en 2020-2021 et à 54,0% en 2021-
2022. Les garçons ont également connu une augmentation significative de leur taux
d'achèvement, passant de 41,3% en 2019-2020 à 54,8% en 2021-2022. Les filles ont maintenu
un taux légèrement supérieur à celui des garçons, atteignant 44,6% en 2019-2020. En ce qui
concerne le Fondamental II, le taux d'achèvement global est resté relativement stable au cours
des années, passant de 34,9% en 2019-2020 à 37,1% en 2021-2022. Les garçons ont
généralement obtenu des taux d'achèvement légèrement plus élevés que les filles en 2021-2022,
avec respectivement 37,3% et 36,8%. Au niveau du secondaire général, on observe une
amélioration continue du taux d'achèvement global. En 2019-2020, ce taux était de 18,4%, puis
il a augmenté à 22,1% en 2021-2022. Les garçons ont également connu une augmentation
significative, passant de 19,8% en 2019-2020 à 24,2% en 2021-2022. Les filles ont également
montré des améliorations, bien que légèrement moins marquées, avec des taux allant de 16,8%
à 19,9%. Concernant le secondaire technique, les taux d'achèvement sont généralement très bas
et relativement stables au fil des années avec 0,2% et 0,3% pour les filles et les garçons en
2021-2022. Au niveau du secondaire professionnel (CAP et BT), les taux d'achèvement sont
plus élevés que pour le secondaire technique, mais restent relativement faibles. Les garçons ont
généralement des taux d'achèvement légèrement plus élevés que les filles pour ce cycle
d’enseignement.
Tableau 4: Evolution du taux d’achèvement (TA) par sexe (en %)
2019-2020 2020-2021 2021-2022
Evolution du TA au Fondamental I 43,0 51,6 54,0
Garçon 41,3 53,4 54,8
Fille 44,6 49,7 53,2
Evolution du TA au Fondamental II 34,9 36,2 37,1
Garçon 37,1 39,0 37,3
Fille 32,6 33,3 36,8
Evolution du TA du secondaire général 18,4 19,8 22,1
Garçon 19,8 22,0 24,2
Fille 16,8 17,6 19,9
Evolution du TA au secondaire technique 0,4 0,3 0,3
Garçon 0,4 0,3 0,3
Fille 0,3 0,2 0,2
TA au secondaire professionnel niveau CAP 2,2 1,7 2,3
Garçon 2,7 2,2 2,2
Fille 1,8 1,1 2,3
TA au secondaire professionnel niveau BT 2,4 2,9 3,2
Garçon 2,8 3,2 3,0
Fille 1,9 2,7 3,4
Source : CPS/Education, Rapport d'analyse des indicateurs, 2022
 |
24 24 |
▲back to top |
11
2.4. Situation démographique
Le Mali est confronté à un important défi de croissance démographique rapide, qui a des
répercussions sur les demandes sociales telles que l’éducation, la santé, l’emploi, les
infrastructures, etc. Entre 1987 et 2022, la population malienne a plus que doublé en 35 ans,
passant de 7 696 348 habitants en 1987 à environ 21 697 317 habitants en 2022 (selon les
projections 2010-2035 de la Direction Nationale de la Population – DNP). Cette projection de
la DNP indique que la population malienne en 2022 était composée de 50,4% de femmes et
49,6% d’hommes. Les régions du Nord et le District de Bamako présentent la particularité
d’avoir une proportion d’hommes supérieure à celle des femmes (Gao, Kidal et Bamako). À
Tombouctou, le nombre d’hommes est équivalant à celui des femmes. Kidal a la plus faible
population tandis que Sikasso a la plus forte population.
Tableau 5: Répartition de la population du Mali en 2022 selon la région et le sexe (en nombre
d’habitants)
Hommes Femmes Ensemble
Kayes 1 468 300 1 508 994 2 977 294
Koulikoro 1 793 682 1 823 530 3 617 212
Sikasso 1 947 268 2 000 094 3 947 362
Ségou 1 727 380 1 764 744 3 492 125
Mopti 1 503 882 1 537 022 3 040 904
Tombouctou 504 135 503 611 1 007 746
Gao 405 640 404 245 809 885
Kidal 54 263 46 899 101 162
Bamako 1 355 487 1 348 140 2 703 627
Ensemble Pays 10 760 038 10 937 279 21 697 317
Source : DNP, 2022
La population malienne présente une pyramide des âges très jeune qui s’amincit
progressivement avec l’âge. Environ 45,0% de la population a moins de quinze ans, tandis que
la tranche d’âge économiquement active (15-64 ans) représente environ 52,7% de la population
totale. Les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) représentent 46,8% de la population totale
des femmes et les enfants de moins de cinq ans constituent 17,3% de la population totale. Ces
données soulignent le potentiel dynamique du pays et mettent en évidence la nécessité de
renforcer les politiques publiques ciblées sur la jeunesse.
 |
25 25 |
▲back to top |
12
Graphique 1: Pyramide des âges du Mali en 2022 (en milliers de personnes)
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données de la DNP, 2022
3. Enseignements et formation professionnelle
Cette partie du rapport analyse les effectifs de l’enseignement et de la formation dans plusieurs
domaines, y compris l’enseignement technique et professionnel, l’enseignement supérieur, la
formation professionnelle et les ressources humaines formées à l’extérieur. L’objectif de ces
formations est de développer les compétences des jeunes et de leur permettre d’acquérir les
compétences nécessaires pour exercer un métier.
3.1. Enseignement technique et professionnel
L’analyse de cette section est basée sur les données du tableau 6 qui résume les résultats des
examens nationaux conduisant à l’obtention des diplômes du DEF ; CAP ; BT1 ; BT2 ; BAC
(général et technique) ; IFM et Agro pastoral (BT et BT2). Ces résultats sont ensuite désagrégés
par nombre d’inscrits ; présents ; admis et par sexe.
Ainsi sur les 472 578 inscrits aux examens nationaux en 2022 au total, l’analyse révèle que 428
381 candidats se sont présentés, dont 230 673 hommes et 197 706 femmes. Cet effectif a
légèrement diminué comparativement à 2021 où on avait au total 428 454 candidats, soit une
diminution de 73 candidats. Quant aux candidats admis, leur nombre en 2022 s’élevait à
158 422 (dont 71 116 femmes et 87 306 femmes). En outre, on relève que quel que soit le
diplôme, plus d’hommes sont admis que de femmes, avec le plus grand écart constaté au niveau
du BAC général (avec 6 089 candidats masculins supplémentaires) et le plus petit écart est
1 890
1 628
1 428
1 224
1 004
805
659
556
459
360
264
180
123
85
52
28
15
1 856
1 600
1 404
1 207
997
808
669
571
480
388
299
222
165
122
79
45
25
2 000 1 500 1 000 500 - 500 1 000 1 500 2 000
0-4 ans
5-9 ans
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80 ans et plus
Femme Homme
 |
26 26 |
▲back to top |
13
constaté au niveau du BT1, avec 56 candidats masculins supplémentaires. Ces chiffres montrent
l’importance pour le gouvernement de continuer ses efforts dans l’amélioration de l’éducation
des filles.
L’analyse selon le diplôme montre que le Diplôme d'Etude Fondamentale (DEF), examen
national essentiel qui permet l'accès aux formations de l'enseignement technique et
professionnel, a enregistré 209 705 candidats présents en 2022. Parmi ceux-ci, 100 377 ont été
admis, dont 48 534 femmes et 51 843 hommes. Concernant l'examen du BAC général, 32 941
candidats ont été déclarés admis, sur les 161 636 présents, dont 19 515 hommes et 13 426
femmes. Parmi les admis, 3 160 étaient des candidats libres. Par contre, on note le faible nombre
de candidats présents et admis au BAC technique (respectivement 1 773 et 319) et parmi ces
admis, on relève 4 candidats libres (3 hommes et une femme).
En ce qui concerne l'examen de fin d'année pour l'obtention du Certificat d'aptitude
professionnelle (CAP), on a enregistré 17 738 candidats, dont 12 362 candidats libres et 5 376
candidats réguliers. Parmi les candidats présents, 7 970 candidats ont réussi l'examen, soit un
taux de réussite de 44,9%. On note ici que le taux de réussite des candidats réguliers est
supérieur à celui des candidats libres soit 47,8% contre 43,6%. En outre, on constate que le
nombre inscrit de candidats libres au CAP est nettement supérieur à celui des candidats réguliers
(soit 14 935 contre 5 921).
Par ailleurs, en comparant les résultats des examens du BT2 et du BT1, on note que le taux de
réussite des candidats au BT2 était plus élevé. En effet sur des effectifs de candidats présents
de 9 618 au BT2 et 21 331 au BT1, on relève des effectifs d’admis respectif de 5 534 contre
6 945 (soit un taux de réussite de 72,2% au BT2 contre 25,9% au BT1). Et enfin, on relève que
les IFM, ont enregistré 3 553 candidats admis sur 3 577 candidats présents en 2022, une légère
diminution du taux de réussite (99,3%) comparativement à 2021 où il était à 100% (soit 3 553
admis sur 3 553 présent).
Tableau 6: Résultat des examens par niveau de diplôme
Examen Statut
INSCRITS PRESENTS ADMIS
Fille Garçon Total Fille Garçon Total Fille Garçon Total
DEF
REG 102 629 107 338 209 967 97 356 102 041 199 397 46 674 49 739 96 413
CL 6 413 6 864 13 277 5 043 5 265 10 308 1 860 2 104 3 964
TOTAL 109 042 114 202 223 244 102 399 107 306 209 705 48 534 51 843 100 377
CAP
REG 2 088 3 833 5 921 1 984 3 392 5 376 633 1 937 2 570
CL 6 212 8 723 14 935 5 026 7 336 12 362 1 487 3 913 5 400
TOTAL 8 300 12 556 20 856 7 010 10 728 17 738 2 120 5 850 7 970
BT1
REG 9 903 10 583 20 486 7 795 8 304 16 099 2 385 2 235 4 620
CL 2 669 4 127 6 796 2 086 3 146 5 232 354 560 914
TOTAL 12 572 14 710 27 282 9 881 11 450 21 331 2 739 2 795 5 534
BT2
REG 3 426 3 388 6 814 3 215 3 200 6 415 2 252 2 847 5 099
CL 1 813 2 021 3 834 1 444 1 759 3 203 640 1 206 1 846
TOTAL 5 239 5 409 10 648 4 659 4 959 9 618 2 892 4 053 6 945
BAC
général
REG 68 155 84 496 152 651 61 950 77 049 138 999 12 318 17 463 29 781
CL 10 658 18 077 28 735 8 734 13 903 22 637 1 108 2 052 3 160
 |
27 27 |
▲back to top |
14
TOTAL 78 813 102 573 181 386 70 684 90 952 161 636 13 426 19 515 32 941
BAC
technique
REG 713 1 050 1 763 657 975 1 632 107 208 315
CL 57 122 179 44 97 143 1 3 4
TOTAL 770 1 172 1 942 701 1 072 1 773 108 211 319
IFM
(Fin cycle) TOTAL 1 086 2 535 3 621 1 081 2 496 3 577 1 066 2 487 3 553
Agro pastoral
(BT+BT2) TOTAL 1 566 2 033 3 599 1 291 1 710 3 001 231 552 783
Totaux
examens
REG 189 566 215 256 404 822 175 329 199 167 374 496 65 666 77 468 143 134
CL 27 822 39 934 67 756 22 377 31 506 53 885 5 450 9 838 15 288
TOTAL 217 388 255 190 472 578 197 706 230 673 428 381 71 116 87 306 158 422
Source : CNECE, Résultats 2022
3.2. Enseignement supérieur
Pour une meilleure compréhension de l’évolution des effectifs de l’enseignement supérieur,
nous avons classé les universités et les instituts en un groupe, et les grandes écoles en un autre
groupe à part. Pour le premier groupe l’effectif est souvent très élevé. En revanche dans le
second groupe, les effectifs sont faibles et bénéficient des formations de pointe. L’accès aux
formations du second groupe se fait généralement par voie de concours.
3.2.1. Universités et Instituts
De 1996 à 2010, le Mali avait seulement une seule Université, celle de Bamako. Durant l’année
2010, l’Université de Ségou a été créée. En 2011, l’Université de Bamako a été scindée en
quatre universités. Aujourd’hui, ces cinq universités représentent les universités publiques du
Mali que sont l’Université de Ségou, l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de
Bamako (ULSHB), l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB),
l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) et l’Université des
Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB). Les universités sont
constituées de Facultés et d’Instituts.
Au Mali, en 2022, les universités maliennes comptaient 117 695 étudiants dont 27,0% de
femmes et 73,0% d’hommes. En revanche, 46,2% (54 427 étudiants) de cet effectif se trouvaient
dans l’USSGB, soit la plus importante population d’étudiants. Par contre, l’effectif de
l’Université de Ségou représente 7,3% (8 612 des étudiants), soit la plus faible proportion
d’étudiants enregistrée en 2022.
L’analyse détaillée des universités montre qu’aucune université n’a un effectif inférieur à 5000
étudiants. On y trouve 54 427 étudiants à l’USSGB dont 40 543 sont de la Faculté des Sciences
Economique et de Gestion (FSEG), soit 74,5% de cette université. L’ULSHB vient en deuxième
position avec 18,4% de l’ensemble des étudiants, la part de la Facultés des Langues et des
Sciences du Langage (FLSL) est la plus importante soit 70,9%. L’USJPB occupe la troisième
place avec un effectif de 20 454 étudiants (17,4% de l’ensemble). Dans cette université, près de
4 étudiants sur dix (38,8%) sont à la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP).
Les étudiants de l’USTTB représentent 10,7% (12 571) de l’ensemble des étudiants des
 |
28 28 |
▲back to top |
15
universités publiques et parmi les étudiants de cette université ceux de la Faculté de Médecine
et d’Odontostomatologie (FMOS) regroupent les 40,9%. Dans l’Université de Ségou, la Faculté
des Sciences Sociales représente plus de 4 étudiants sur 10 (45,5%).
Les effectifs d'étudiants au sein des Instituts sont généralement plus restreints que dans les
facultés, à l'exception de l'Institut Universitaire de Formation Professionnelle (IUFP) de
l'Université de Ségou. En effet, l'IUFP compte 9,2% de l'ensemble des étudiants de l'université,
un pourcentage plus élevé que ceux des autres Instituts qui ont enregistré un pourcentage
inférieur à 8%.
Selon le sexe, la population masculine est majoritaire dans l’ensemble (62,2%), dans toutes les
universités comme dans toutes les facultés et tous les Instituts. Le pourcentage des filles
étudiantes dépasse le tiers dans toutes les universités sauf dans l’ULSHB (32,0%). En effet, le
pourcentage des filles étudiantes atteint le maximum dans l’USJPB avec 46,4% de cette
université et plus précisément dans la FDPRI où il atteint 47,7%.
Tableau 7: Répartition des étudiants des Universités du Mali selon le sexe (en effectif et en %2)
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Universités de Ségou 5 613 65,2 2 999 34,8 8 612 7,3
FAGES 412 84,9 73 15,1 485 5,6
FAMA 2 402 70,3 1 014 29,7 3 416 39,7
FASSO 2 292 58,4 1 630 41,6 3 922 45,5
IUFP 507 64,3 282 35,7 789 9,2
ULSHB 14 706 68,0 6 925 32,0 21 631 18,4
FLSL 10 914 71,2 4 423 28,8 15 337 70,9
FSHSE 3 584 60,6 2 329 39,4 5 913 27,3
IC 48 64,9 26 35,1 74 0,3
IUT 160 52,1 147 47,9 307 1,4
USJPB 10 972 53,6 9 482 46,4 20 454 17,4
FDPRI 2 553 52,3 2 330 47,7 4 883 23,9
FDPU 4 037 52,8 3 605 47,2 7 642 37,4
FSAP 4 382 55,3 3 547 44,7 7 929 38,8
USSGB 33 793 62,1 20 634 37,9 54 427 46,2
FSEG 23 537 58,1 17 006 41,9 40 543 74,5
FHG 8 483 77,8 2 418 22,2 10 901 20,0
IUG 1 773 59,4 1 210 40,6 2 983 5,5
USTTB 8 151 64,8 4 420 35,2 12 571 10,7
FAPH 891 52,7 800 47,3 1 691 13,5
FMOS 3 426 66,7 1 714 33,3 5 140 40,9
FST 3 142 65,6 1 650 34,4 4 792 38,1
ISA 692 73,0 256 27,0 948 7,5
Total 73 235 62,2 44 460 37,8 117 695 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les universités du Mali
2 Les pourcentages de garçon et fille sont en ligne (addition de ces deux pourcentages donne 100%) ; pour le
pourcentage du Total (dernière colonne), les pourcentages des universités en (gras) sont en colonne ainsi que les
pourcentages des facultés/instituts sont en colonne et ils donnent la répartition de l’université selon les facultés et
instituts.
 |
29 29 |
▲back to top |
16
Les cinq tableaux suivants vont analyser en détail chacune des cinq universités publiques du
Mali. Ces tableaux sont généralement présentés (i) selon les Facultés et Instituts (en gras) dans
la première colonne au-dessus de ses classes, (ii) selon le sexe en effectif et en pourcentage
ligne, (iii) et la dernière colonne « Total) en pourcentage colonne pour les facultés et instituts
de l’université et pour les classes de chaque faculté ou institut.
L’université de Ségou est un établissement public à caractère scientifique, technologique et
culturel, créée le 10 mars 2013. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la
politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec un
enseignement basé sur le système LMD (Licence Master Doctorat).
En 2022, l'Université de Ségou comptait 8 612 étudiants, dont 65,2% sont des garçons et 34,8%
sont des filles. Cette répartition suggère une prédominance masculine dans l'université.
L’université de Ségou a trois facultés et un institut, à savoir : la Faculté du Génie et des Sciences
(FAGES) avec 5,6% des étudiants, la Faculté d’Agronomie et de Médecine Animale (FAMA)
avec 39,7%, la Faculté des Sciences Sociales (FASSO) avec 45,5% et l’Institut Universitaire
de Formation Professionnelle (IUFP) avec 9,2%.
L'analyse de la répartition des étudiants de l'Université de Ségou par sexe, niveau d'études et
faculté révèle des tendances intéressantes. Pour la FAGES, qui regroupe les niveaux de Licence
1, Licence 2 et Licence 3, on constate une nette prédominance des garçons, représentant
respectivement 82,3%, 87,7% et 89,6% des effectifs. Ainsi, les garçons constituent 84,9% des
étudiants de cette faculté, tandis que les filles ne représentent que 15,1%. Concernant la FAMA,
la tendance est similaire, avec une majorité de garçons dans tous les niveaux. La Licence 1
compte 68,9% de garçons et 31,1% de filles, la Licence 2 à 72,2% de garçons et 27,8% de filles,
et la Licence 3 à 73,1% de garçons et 26,9% de filles. Au total, la FAMA compte 70,3% de
garçons et 29,7% de filles parmi ses étudiants. La FASSO, quant à elle, présente des variations,
avec un pourcentage de garçons plus bas, bien que les garçons restent majoritaires. Pour la
Licence 1, 56,7% sont des garçons et 43,3% sont des filles. La Licence 2 à 65,1% de garçons
et 34,9% de filles, tandis que la Licence 3 compte 61,3% de garçons et 38,7% de filles. Dans
l'ensemble, la FASSO est composée de 58,4% de garçons et 41,6% de filles. Enfin, à l’IUFP,
on observe des pourcentages similaires, avec 63,0% de garçons et 37,0% de filles en Licence
1, 80,0% de garçons et 20,0% de filles en Licence 2, et 66,8% de garçons et 33,2% de filles en
Licence 3. Au total, l’IUFP est composée de 64,3% de garçons et 35,7% de filles parmi ses
étudiants.
Globalement, les garçons sont majoritaires à l’université de Ségou, représentant 65,2% du total
des étudiants, tandis que les filles comptent pour 34,8%. Ces variations de genre au sein des
différentes facultés et niveaux d'études reflètent des tendances significatives, qui peuvent être
utiles pour les politiques d'égalité des genres et les stratégies d'équité au sein de cette
l'université.
 |
30 30 |
▲back to top |
17
Tableau 8: Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par sexe selon le niveau d'étude et
la faculté
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FAGES 412 84,9 73 15,1 485 5,6
Licence 1 233 82,3 50 17,7 283 58,4
Licence 2 93 87,7 13 12,3 106 21,9
Licence 3 86 89,6 10 10,4 96 19,8
FAMA 2 402 70,3 1 014 29,7 3 416 39,7
Licence 1 1 440 68,9 651 31,1 2 091 61,2
Licence 2 520 72,2 200 27,8 720 21,1
Licence 3 442 73,1 163 26,9 605 17,7
FASSO 2 292 58,4 1 630 41,6 3 922 45,5
Licence 1 1 633 56,7 1247 43,3 2 880 73,4
Licence 2 340 65,1 182 34,9 522 13,3
Licence 3 319 61,3 201 38,7 520 13,3
IUFP 507 64,3 282 35,7 789 9,2
Licence 1 340 63,0 200 37,0 540 68,4
Licence 2 4 80,0 1 20,0 5 0,6
Licence 3 163 66,8 81 33,2 244 30,9
Total 5 613 65,2 2 999 34,8 8 612 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’université de Ségou
L’examen du tableau ci-dessous fait apparaître clairement que le nombre d'étudiants diminue à
mesure qu'ils progressent dans les niveaux de licence. Cette tendance est particulièrement
notable à la FAGES, où le nombre d'étudiants passe de 283 en Licence 1 à 96 en Licence 3. En
revanche, la FAMA maintient relativement des niveaux stables d'effectifs étudiants avec 2 091
en Licence 1, 720 en Licence 2 et 605 en Licence 3. A la FASSO, on constate un faible nombre
d'étudiants en Licence 3 par rapport aux autres niveaux, passant de 2 880 en Licence 1 à 520 en
Licence 3.
Une analyse de la répartition par filière révèle des disparités significatives entre les différentes
facultés. Au niveau de la FAGES, la filière GC) était la plus prisée, regroupant respectivement
53% des étudiants en Licence 1, 52,8% en Licence 2 et 66,7% en Licence 3. À l'inverse, la
FAMA attirait la majorité des étudiants dans la filière AE, représentant 77,3% en Licence 1,
74,9% en Licence 2 et 77,4% en Licence 3. La FASSO se distinguait par une forte présence des
filières AT et CO, captant respectivement 43,9% et 34,6% des étudiants en Licence 1.
En termes d'effectifs globaux, l'ensemble des facultés et instituts comptait un total de 8 612
étudiants, répartis comme suit : 5 794 en Licence 1, 1 353 en Licence 2 et 1 465 en Licence 3.
 |
31 31 |
▲back to top |
18
Tableau 9: Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par niveau d’étude selon la filière
de chaque faculté/institut
Licence 1 Licence 2 Licence 3 Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
FAGES 283 100,0 106 100,0 96 100,0 485 100,0
ELECT 55 19,4 3 2,8 23 24,0 81 16,7
GC 150 53,0 56 52,8 64 66,7 270 55,7
GE 24 8,5 46 43,4 0 0,0 70 14,4
GM 54 19,1 1 0,9 9 9,4 64 13,2
FAMA 2 091 100,0 720 100,0 605 100,0 3 416 100,0
AE 1 617 77,3 539 74,9 468 77,4 2 624 76,8
AVD 145 6,9 62 8,6 50 8,3 257 7,5
GR 39 1,9 14 1,9 15 2,5 68 2,0
HA 76 3,6 17 2,4 20 3,3 113 3,3
HAQ 18 0,9 10 1,4 0 0,0 28 0,8
PSA 155 7,4 60 8,3 52 8,6 267 7,8
TAA 41 2,0 18 2,5 0 0,0 59 1,7
FASSO 2 880 100,0 522 100,0 520 100,0 3 922 100,0
AT 1 263 43,9 255 48,9 259 49,8 1 777 45,3
CO 997 34,6 205 39,3 190 36,5 1 392 35,5
DDL 272 9,4 0 0,0 0 0,0 272 6,9
SO 348 12,1 62 11,9 71 13,7 481 12,3
IUFP 540 100,0 5 100,0 244 100,0 789 100,0
3ER 41 7,6 0 0,0 15 6,1 56 7,1
AB 67 12,4 0 0,0 0 0,0 67 8,5
AG 91 16,9 0 0,0 38 15,6 129 16,3
CFA 217 40,2 5 100,0 135 55,3 357 45,2
GI 36 6,7 0 0,0 17 7,0 53 6,7
MC 88 16,3 0 0,0 39 16,0 127 16,1
Total 5 794 67,3 1 353 15,7 1 465 17,0 8 612 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’université de Ségou
L’Université des Langues et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) est créée par
l’Ordonnance N° 2011-019/P-RM du 28 septembre 2011. Le Décret N° 2011-736/PRM du 03
novembre 2011 fixe son organisation et ses modalités de fonctionnement. Elle a pour mission
de contribuer à la formation supérieure et à la recherche au service du développement. Sa vision
est de réhabiliter le système universitaire et d’instituer une société du savoir et de la
connaissance.
L’ULSHB est composée de deux facultés et deux instituts. Ses facultés et instituts sont la
Faculté des Langues et des Sciences du Langage (FLSL), la Faculté des Sciences Humaines et
des Sciences de l’Education (FSHSE), l’Institut Confucius (IC) et l’Institut Universitaire de
Technologies (IUT).
Entre les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, le nombre d’étudiants de l’ULSHB est
passé de 14 162 à 21 631 soit 7 469 étudiants de plus en une année ou une augmentation de
52,7%. Durant l’année universitaire 2021/2022, les garçons représentaient 68,0% des étudiants
de l’ULSHB. Plus de 98% des étudiants de l’ULSHB sont dans les facultés et moins de 2% sont
dans les instituts.
 |
32 32 |
▲back to top |
19
Par rapport au nombre d’étudiants par faculté/institut, plus de sept étudiants sur dix (70,9%) de
l’ULSHB étaient dans la Faculté des Langues et des Sciences du Langage (FLSL), 27,3% la
Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Education (FSHSE), 1,4% dans l’Institut
Universitaire de Technologies (IUT) et 0,3% dans l’Institut Confucius (IC).
Le nombre d’étudiants attendus sur le marché du travail à la fin de l’année universitaire sont
des étudiants en dernier niveau (dernière classe) d’un cursus. Pour l’ULSHB les fins de cursus
sont la licence 3 et le DUT 2. Donc, 5 091 sont attendus sur le marché du travail de l’ULSHB.
Comme la répartition selon la faculté/ l’institut, la majorité des futurs acteurs du marché du
travail (sortants) sont des étudiants des facultés (86,6%). A noter que seulement le cycle DUT
n’existe qu’à l’IUT.
Globalement, les filles représentent 32,0% des étudiants de l’ULSHB. Mais, derrière ce
pourcentage global des filles, nous remarquons que le pourcentage des filles n’a jamais atteint
30% dans la FLSL alors qu’il est toujours supérieur à la moyenne dans la FSHSE, l’IC et IUT.
Les filles ont un pourcentage plus élevé dans l’IUT (47,9%), elles sont mêmes majoritaires à la
licence 2 de cet institut.
Tableau 10: Répartition des étudiants de l'ULSHB par faculté/institut, par classe et par sexe
Faculté /Classe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FLSL 10 914 71,2 4 423 28,8 15 337 70,9
Licence 1 6 626 70,1 2 827 29,9 9 453 61,6
Licence 2 1 991 74,6 677 25,4 2 668 17,4
Licence 3 2 297 71,4 919 28,6 3 216 21,0
FSHSE 3 584 60,6 2 329 39,4 5 913 27,3
Licence 1 1 916 58,8 1 345 41,2 3 261 55,1
Licence 2 609 67,5 293 32,5 902 15,3
Licence 3 1 059 60,5 691 39,5 1 750 29,6
IC 48 64,9 26 35,1 74 0,3
Licence 1 26 66,7 13 33,3 39 52,7
Licence 2 5 55,6 4 44,4 9 12,2
Licence 17 65,4 9 34,6 26 35,1
IUT 160 52,1 147 47,9 307 1,4
DUT 1 42 56,0 33 44,0 75 24,4
DUT 2 18 60,0 12 40,0 30 9,8
Licence 1 50 51,5 47 48,5 97 31,6
Licence 2 15 41,7 21 58,3 36 11,7
Licence 3 35 50,7 34 49,3 69 22,5
Total 14 706 68,0 6 925 32,0 21 631 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ULSHB
L’ensemble des filières de l’ULSHB sont dans le tableau ci-dessous en donnant le poids de
chaque filière au sein de la faculté ou de l’institut (pourcentage colonne). Globalement, les
filières ayant plus de plus de 1 000 étudiants sont l’Anglais (5 196), l’Arabe (5 173), les Lettres
(3 421), les Sciences de l’Éducation (2 430) et la Socio-Anthropologie (1 882).
 |
33 33 |
▲back to top |
20
Les filières Anglais et Arabe viennent en première et deuxième position en termes de nombre
d’étudiants avec respectivement 33,9% et 33,7% des étudiants de la FSLB ; elles sont suivies
de la filière des Lettres. Dans la FSHSE, les Sciences de l’Éducation représentent 41,1% des
étudiants et la Socio-Anthropologie 31,8% des étudiants. Le Mandarin est la seule filière de
l’IC. La Communications des organisations (33,3) et les classes du DUT (34,2) sont les plus
grandes filières de l’Institut Universitaire de Technologie.
Les filières des lettres de faculté des langues et des sciences du langage (FLSL), les sciences de
l’éducation de la FSHSE et la communication des organisations de l’IUT sont plus féminines
que masculines. En effet, 42,2% des filles de l’IUT étudiaient dans la filière communication
des organisations contre 25,0% des garçons de ce même institut. Dans la faculté des sciences
humaines et des sciences de l’éducation (FSHSE), plus de la moitié (50,6%) des filles avaient
choisi la filière sciences de l’éducation alors qu’on a 34,9% des garçons de cette faculté qui
étudiaient dans la même filière. Parmi les filles de la faculté des langues et des sciences du
langage, 32,2% étaient dans la filière des lettres, alors qu’ils étaient 18,3% des garçons de la
FLSL à choisir les lettres. Les filières Arabe de FLSL et MML de l’IUT sont plus masculines
que féminines.
Tableau 11: Répartition des étudiants de l'ULSHB par faculté/institut et par sexe selon la filière
Faculté / filière
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FLSL 10 914 100,0 4 423 100,0 15 337 100,0
Allemand 401 3,7 227 5,1 628 4,1
Anglais 3 655 33,5 1 541 34,8 5 196 33,9
Russe 40 0,4 11 0,2 51 0,3
Arabe 4 281 39,2 892 20,2 5 173 33,7
Lettres 1 996 18,3 1 425 32,2 3 421 22,3
Sciences du Langage 541 5,0 327 7,4 868 5,7
FSHSE 3 584 100,0 2 329 100,0 5 913 100,0
Philosophie 398 11,1 93 4,0 491 8,3
Socio-Anthropologie 1 237 34,5 645 27,7 1 882 31,8
Anthropologie 16 0,4 8 0,3 24 0,4
Sociologie 534 14,9 281 12,1 815 13,8
Sciences de l'Éducation 1 252 34,9 1 178 50,6 2 430 41,1
Psychologie 147 4,1 124 5,3 271 4,6
IC 48 100,0 26 100,0 74 100,0
Mandarin 48 100,0 26 100,0 74 100,0
IUT 160 100,0 147 100,0 307 100,0
Communication des organisations 40 25,0 62 42,2 102 33,2
Mise en scène 12 7,5 11 7,5 23 7,5
Numérisation 13 8,1 13 8,8 26 8,5
MLAD 60 37,5 45 30,6 105 34,2
MML 44 27,5 16 10,9 60 19,5
Total 14 706 100,0 6 925 100,0 21 631 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ULSHB
 |
34 34 |
▲back to top |
21
L’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)3 créée par l’ordonnance
n°2011-022/P-RM du 28 septembre 2011, ratifiée par la Loi n°2011-080 du 29 décembre 2011,
a vocation à la fois nationale, sous régionale et internationale. Elle a pour mission d’organiser
des formations supérieures, pratiques et spécialisées, des formations supérieures
professionnalisées, des formations postuniversitaires ainsi que des formations continues. En
outre, elle conduit des programmes de recherche et d’innovation scientifiques et participe à la
réalisation d’expertise dans ses multiples domaines de compétences.
L’USJPB comprend la Faculté de Droit Privé (FDPRI), la Faculté de Droit Public (FDPU) et la
Faculté des Sciences Administratives et Politique (FSAP). La fin des études à l’USJPB est
sanctionnée par le diplôme de licence (à la fin de la classe de licence 3).
Durant l’année universitaire 2021-2022, l’USJPB comptait 20 454 étudiants dont 46,4% filles.
Les étudiants se répartissent en 38,8% dans la faculté des sciences administratives et politique,
37,4% dans la faculté de droit public et 23,9% dans la faculté de droit privé. Entre deux années
universitaires, l’USJPB a connu une augmentation de 81,9% de l’effectif d’étudiants. En effet,
le nombre d’étudiants de l’USJPB était de 11 244 étudiaient durant l’année universitaire 2020-
2021 contre 20 454 actuellement (année universitaire 2021-2022). Il est à noter que la faculté
de droit privé connait depuis 2020 des chevauchements des années universitaires. Au total 1 429
étudiants suivaient encore l’année universitaire 2020-2021 durant l’année universitaire 2021-
2022. Courant 2022, il n’y avait de classe de licence 3 à la FDPRI.
Toutes les facultés de l’USJPB ont vu une augmentation de l’effectif de leurs étudiants durant
l’année universitaire 2021-2022 par rapport à l’année universitaire 2020-2021. En effet, la
FDPU et la FSAP ont reçu plus que le double d’étudiants en 2022 qu’elles n’avaient en 2021.
Ces facultés ont respectivement 7 642 et 7 929 étudiants de l’année universitaire 2021-2022
contre respectivement 3 206 et 3 229 étudiants de l’année universitaire 2020-2021, soient des
augmentations de 138,4% et 145,6%.
Dans toutes les facultés de l’USJPB, les étudiants de sexe masculin sont majoritaires,
globalement les garçons représentent 53,6% des étudiants de cette université. La différence
entre les garçons et filles est faible dans la FDPRI où qu’elle n’ait que de 4,6% (52,3% de
garçons contre 47,7% de filles). Dans toutes les classes de l’USJPB, les filles sont seulement
majoritaires dans la licence 1 de l’année universitaire 2020-2021.
3 www.usjpb.edu.ml
 |
35 35 |
▲back to top |
22
Tableau 12: Répartition des étudiants de l'USJPB par année et par sexe
Faculté/Classe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FDPRI 2 553 52,3 2 330 47,7 4 883 23,9
Licence 1 (2020-2021) 55 46,2 64 53,8 119 2,4
Licence 2 (2020-2021) 326 53,9 279 46,1 605 12,4
Licence 3 (2020-2021) 396 56,2 309 43,8 705 14,4
Licence 1 (2021-2022) 1 656 51,3 1 575 48,7 3 231 66,2
Licence 2 (2021-2022) 120 53,8 103 46,2 223 4,6
FDPU 4 037 52,8 3 605 47,2 7 642 37,4
Licence 1 3 087 51,8 2 869 48,2 5 956 77,9
Licence 2 470 54,7 390 45,3 860 11,3
Licence 3 480 58,1 346 41,9 826 10,8
FSAP 4 382 55,3 3 547 44,7 7 929 38,8
Licence 1 3 309 55,1 2 697 44,9 6 006 75,7
Licence 2 658 55,5 528 44,5 1 186 15,0
Licence 3 415 56,3 322 43,7 737 9,3
Total 10 972 53,6 9 482 46,4 20 454 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’USJPB
L’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)4 a été créée par
l’Ordonnance N°2011-021/P-RM du 28 septembre 2011. Le Décret N°2011-731/P-RM du 03
novembre 2011 en fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement.
L’USSGB est composée de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG), de la
Faculté d’Histoire et de Géographie (FHG) et l’Institut Universitaire de Gestion (IUG). Elle
forme les étudiants aux niveaux licence et maîtrise.
Durant l’année universitaire 2021-2022, l’USSGB comptait 54 427 étudiants dont 62,1% de
garçons. Près de trois quart (74,5%) de cette université sont à la FSEG, un cinquième (20,0%)
à la FHG et 5,5% à l’IUG. De l’année universitaire 2020-2021 (55 395 étudiants) à l’année
universitaire 2021-2022 (54 427 étudiants), l’USSGB a connu une diminution en effectif de
968 étudiants soit une baisse de 1,7%.
Quels que soient la faculté et institut, les étudiants dans les petites classes sont plus nombreux
que ceux des grandes classes (sauf entre la licence 2 et la licence 3 de l’IUG). En effet, la licence
1 représente 81,9% d’étudiants de la FSEG, 67,4% d’étudiants de la FHG et 61,0% de ceux de
l’IUG.
Globalement, les filles représentent plus d’un tiers (37,9%) d’étudiants de l’USSGB. Quels que
soient la faculté, l’institut et la classe, les étudiants de sexe masculin sont toujours majoritaires
à l’USSGB. La différence entre les garçons et les filles est plus grande à la faculté d’histoire et
de géographie (FHG) où les filles représentent moins du quart d’étudiants. Elles n’atteignent
même pas le cinquième (20%) dans les classes supérieures à la licence 1 de FHG.
4 www.ussgb.edu.ml
 |
36 36 |
▲back to top |
23
Tableau 13: Répartition des étudiants de l'USSGB par sexe selon la faculté et le niveau d’étude
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FSEG 23 537 58,1 17 006 41,9 40 543 74,5
Licence 1 18 768 56,5 14 449 43,5 33 217 81,9
Licence 2 2 935 64,8 1 592 35,2 4 527 11,2
Licence 3 1 834 65,5 965 34,5 2 799 6,9
FHG 8 483 77,8 2 418 22,2 10 901 20,0
Licence 1 5 529 75,2 1 820 24,8 7 349 67,4
Licence 2 1 687 82,0 371 18,0 2 058 18,9
Licence 3 1 116 84,2 210 15,8 1 326 12,2
Maitrise 151 89,9 17 10,1 168 1,5
IUG 1 773 59,4 1 210 40,6 2 983 5,5
Licence 1 1 091 59,9 729 40,1 1 820 61,0
Licence 2 347 59,9 232 40,1 579 19,4
Licence 3 335 57,4 249 42,6 584 19,6
Total 33 793 62,1 20 634 37,9 54 427 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’'USSGB
L'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)5 est issue
de la précédente université de Bamako scindée en quatre (4) universités thématiques en fin
2011. L'USTTB est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel,
créée par l'Ordonnance N° 2011-020/P-RM du 28 septembre 2011.
L'USTTB est composée de trois facultés et d'un institut à savoir la Faculté de Pharmacie
(FAPH), la Faculté de Médecine et d’Odonto Stomatologie (FMOS), la Faculté des Sciences et
Techniques (FST) et l’Institut des Sciences Appliquées (ISA). Elle forme les étudiants jusqu’à
l’obtention des diplômes de licence, master et doctorat.
Durant l’année universitaire 2022-2023, l’USTTB comptait 12 571 étudiants dont 35,2% de
filles. Selon l’ordre de grandeur du pourcentage d’étudiants de l’USTTB, nous avons 40,9% à
la FMOS, 38,1% à la FST, 13,5% à la FAPH et 7,5% à l’ISA.
Dans la faculté de Médecine et d’Odonto Stomatologie (FMOS), plus de la moitié (53,9%) des
étudiants sont à la 1ère année. D’ailleurs, à part la 1ère année qui a 2 770 étudiants, aucune classe
de FMOS n’a atteint un effectif de 600 étudiants, spécifiquement les étudiants à la recherche
d’un master représentent 1% d’étudiants de cette faculté (54 étudiants dans les classes de master
1 et master 2). La faculté de pharmacie forme les étudiants jusqu’à l’obtention d’un master ou
d’un doctorat. Près de six étudiants sur dix (59,2%) de la FAPH étaient à la 1ère année. Les
étudiants à la recherche d’un master représentent 2,3% (Master 1 et Master 2) des étudiants de
la FAPH. La faculté des sciences et techniques (FST) forme les étudiants jusqu’à l’obtention
d’une licence. A la FST, plus de sept étudiants sur dix sont à la licence 1. L’effectif d’étudiants
5 www.usttb.edu.ml
 |
37 37 |
▲back to top |
24
de la FST décroit de la licence 1 à la licence 3. L’institut des Sciences Appliquées forme les
étudiants jusqu’à l’obtention d’une licence. L’institut avait 948 étudiants dont 42,5% étaient en
classe de licence 1 et le reste était partagé presque équitablement entre la licence 2 et la licence
3.
Les garçons sont majoritaires dans toutes les facultés ainsi que dans l’institut de l’USTTB. Ils
représentent globalement 64,8% d’étudiants. La différence entre les garçons et filles est minime
à la FAPH où les filles représentent 47,3% d’étudiants. Quand nous poussons l’analyse jusqu’au
niveau classe, les filles sont majoritaires seulement au Master 2 de FMOS, la 1ère année et 5e
année de FAPH.
Tableau 14: Répartition des étudiants de l'USTTB par sexe selon la faculté/institut et le niveau
d’étude (année académique 2022-2023)
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FMOS 3 426 66,7 1 714 33,3 5 140 40,9
1ère année 1 770 63,9 1 000 36,1 2 770 53,9
2ème année 245 64,3 136 35,7 381 7,4
3e année 307 65,7 160 34,3 467 9,1
4e année 377 75,4 123 24,6 500 9,7
5e année 358 71,0 146 29,0 504 9,8
6e année 343 73,9 121 26,1 464 9,0
Master 1 12 54,5 10 45,5 22 0,4
Master 2 14 43,8 18 56,3 32 0,6
FAPH 891 52,7 800 47,3 1 691 13,5
1ère année 496 49,6 505 50,4 1001 59,2
2ème année 106 54,9 87 45,1 193 11,4
3e année 81 61,4 51 38,6 132 7,8
4e année 97 65,5 51 34,5 148 8,8
5e année 77 47,8 84 52,2 161 9,5
Master 1 19 61,3 12 38,7 31 1,8
Master 2 15 60,0 10 40,0 25 1,5
FST 3 142 65,6 1 650 34,4 4 792 38,1
Licence 1 2 208 63,2 1 288 36,8 3496 73,0
Licence 2 520 72,6 196 27,4 716 14,9
Licence 3 414 71,4 166 28,6 580 12,1
ISA 692 73,0 256 27,0 948 7,5
Licence 1 310 76,9 93 23,1 403 42,5
Licence 2 202 74,3 70 25,7 272 28,7
Licence 3 180 65,9 93 34,1 273 28,8
Total 8 151 64,8 4 420 35,2 12 571 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’USTTB
L’USTTB a des filières multiples et variées surtout dans sa faculté des sciences techniques
(FST). Cette université a 29 filières dont 23 filières pour la FST.
La FMOS a comme filière la médecine générale et l’odontostomatologie des niveaux master et
doctorat. La médecine générale regroupe 96,3% d’étudiants de FMOS. La faculté de pharmacie
a la seule filière de pharmacie en master et en doctorat. Les 23 filières de FST sont listées dans
le tableau ci-dessous ; les filières atteignant 10% de son effectif d’étudiants sont : la géologie
(17,1%), la science biologique (14,7%) et la biochimie microbiologie (10,3%). L’ISA a trois
filières que sont la chimie appliquée, le génie biologique et le génie électrique informatique
industriel.
 |
38 38 |
▲back to top |
25
Les filières génie biologie de l’ISA, science biologique et biochimie microbiologie ont plus de
pourcentage de filles et de pourcentage de garçons. Mais, le pourcentage d’hommes ayant choisi
les filières génie électrique informatique industrielle de l’ISA, et ressources minérales et
énergétiques est supérieur à celui des filles ayant choisi ces filières.
Tableau 15: Répartition des étudiants de l'USTTB par sexe selon la filière
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FMOS 3 426 100,0 1 714 100,0 5 140 100,0
Médecine Générale 3 330 97,2 1 620 94,5 4 950 96,3
Odontostomatologie 70 2,0 66 3,9 136 2,6
Master de FMOS 26 0,8 28 1,6 54 1,1
FAPH 891 100,0 780 100,0 1 671 100,0
Pharmacie 857 96,2 758 97,2 1 615 96,6
Master en pharmacie 34 3,8 22 2,8 56 3,4
FST 3 142 100,0 1 651 100,0 4 793 100,0
Maintenance et Réseau Informatique 191 6,1 92 5,6 283 5,9
Géologie 560 17,8 261 15,8 821 17,1
Réseaux Télécoms 217 6,9 90 5,5 307 6,4
Science Biologique 327 10,4 376 22,8 703 14,7
Microbiologie et Application 71 2,3 82 5,0 153 3,2
Ressources Minérales et Energétiques 277 8,8 51 3,1 328 6,8
Biochimie Microbiologie 257 8,2 235 14,2 492 10,3
Electronique et Système Electrique 113 3,6 15 0,9 128 2,7
Chimie Sciences de la Vie 98 3,1 55 3,3 153 3,2
Génie Logiciel 125 4,0 38 2,3 163 3,4
Statistique Informatique Décisionnelle 74 2,4 30 1,8 104 2,2
Mathématiques 199 6,3 59 3,6 258 5,4
Chimie Structure de la Matière 81 2,6 66 4,0 147 3,1
Physique Chimie 61 1,9 26 1,6 87 1,8
Physiologie Animale Nutrition-Neuroscience 7 0,2 5 0,3 12 0,3
de Géologie Appliquée 244 7,8 93 5,6 337 7,0
Chimie de l’Environnement 3 0,1 - 0,0 3 0,1
Electronique et Environnement 71 2,3 27 1,6 98 2,0
Physique Appliquée 12 0,4 4 0,2 16 0,3
Mécatronique et Robotique 54 1,7 11 0,7 65 1,4
Physique Théorique 64 2,0 7 0,4 71 1,5
Cartographie et Géomatique 4 0,1 1 0,1 5 0,1
Chimie des Matériaux 32 1,0 27 1,6 59 1,2
ISA 692 100,0 256 100,0 948 100,0
Chimie Appliquée 202 29,2 77 30,1 279 29,4
Génie Biologique 194 28,0 135 52,7 329 34,7
Génie Electrique Informatique Industrielle 296 42,8 44 17,2 340 35,9
Total 8 151 100,0 4 401 100,0 12 552 100,0
 |
39 39 |
▲back to top |
26
3.2.2. Grandes écoles et Instituts
Les grandes écoles publiques au Mali sont au nombre de 12. Elles sont :
- Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (CERFITEX) ;
- Ecole Nationale d’Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) ;
- Ecole Nationale d’Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT) ;
- Ecole Normale Supérieure (ENSUP) ;
- Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication (ESJSC) ;
- Institut des Hautes Etudes et des Recherches Islamiques Ahmed-Baba (IHERI-AB) ;
- Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) ;
- Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) ;
- Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) ;
- Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) ;
- Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) ;
- Institut Zayed des Sciences Economiques et Juridiques de Bamako (IZSEJB).
Au cours de l’année académique 2021-2022, les grandes écoles maliennes comptaient 12 553
étudiants dont 72,9% de garçons. L’effectif des étudiants des grandes écoles a connu une
augmentation de 11,8% entre l’année académique 2020-2021 (11 231 étudiants) et celle 2021-
2022 (12 553 étudiants).
L’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) représente
plus du quart (26,8%) des étudiants des grandes écoles. En plus de l’IPR/IFRA, les grandes
écoles regroupant plus de 10% des étudiants de l’ensemble sont l’ENI-ABT (17,6%), l’ENSUP
(13,7%), l’INFSS (11,3%) et l’ENETP (11,6%).
Bien que les filles représentent seulement 27,1% des étudiants des grandes écoles, elles sont
majoritaires à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), à l’Institut National de
Formation en Sciences de Santé (INFSS) et l’Institut National de Formation en Travail Social
(INFTS). Les grandes écoles ayant plus de 80% des étudiants garçons sont l’ENSUP (90,2%),
l’IPU (86,6%) et l’ENI-ABT (84,6%).
Tableau 16: Répartition des étudiants des grandes écoles par genre
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
CERFITEX 186 73,8 66 26,2 252 2,0
ENETP 1 094 75,2 361 24,8 1 455 11,6
ENI-ABT 1 870 84,6 341 15,4 2 211 17,6
ENSUP 1 553 90,2 169 9,8 1 722 13,7
ESJSC 38 52,1 35 47,9 73 0,6
IHERI-AB 39 73,6 14 26,4 53 0,4
INFSS 634 44,7 784 55,3 1 418 11,3
INFTS 347 45,9 409 54,1 756 6,0
INJS 97 30,7 219 69,3 316 2,5
IPR/IFRA 2 536 75,3 833 24,7 3 369 26,8
IPU 310 86,6 48 13,4 358 2,9
IZSEJB 448 78,6 122 21,4 570 4,5
Total 9 152 72,9 3 401 27,1 12 553 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les grandes écoles
 |
40 40 |
▲back to top |
27
- Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (CERFITEX)
La Loi n°04-003 du 14 janvier 20046 crée le Centre de Recherche et de Formation pour
l’Industrie Textile (CERFITEX) dont la mission est d’assurer la formation initiale et continue
et de contribuer à la promotion de la recherche dans le domaine des textiles et annexes au niveau
national, sous régional et régional. Le Décret n°04-061-P-RM du 04 mars 2004 fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de Recherche et de Formation pour
l’Industrie Textile.
Le CERFITEX a formé 252 apprenants durant l’année académique 2021-2022 dont 26,2% de
filles. Il forme les apprenants jusqu’à l’obtention du certificat de technicien supérieur, de
licence et du master. Plus de la moitié (55,2%) des étudiants de CERFITEX sont à la recherche
d’une licence alors que 41,3% étaient dans les classes de technicien supérieur et 3,6% à la
recherche d’un master.
Les garçons représentent globalement plus de sept étudiants sur dix (73,8%) du CERFITEX.
Les filles sont seulement majoritaires dans la classe de 3ème année de technicien supérieur.
Tableau 17: Répartition des étudiants du CERFITEX (année scolaire 2021/2022) par filière et sexe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 114 82,0 25 18,0 139 55,2
Licence1 53 79,1 14 20,9 67 48,2
Licence 2 31 81,6 7 18,4 38 27,3
Licence 3 30 88,2 4 11,8 34 24,5
Master 8 88,9 1 11,1 9 3,6
Master 1 5 100,0 0 0,0 5 55,6
Master 2 3 75,0 1 25,0 4 44,4
Technicien Supérieur 64 61,5 40 38,5 104 41,3
3ème Année 26 49,1 27 50,9 53 51,0
4ème Année 38 74,5 13 25,5 51 49,0
Total 186 73,8 66 26,2 252 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par le CERFITEX
Le Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (CERFITEX) forme les
étudiants dans cinq filières. La technologie texte (TT) et la chimie appliquée (CA) sont les
filières à la fois dispensées aux niveaux des cycles de technicien supérieur et de la licence. La
filière mécanique et maintenance industrielle (MMI) et la filière génie électrique et
informatique industriel (GEII) sont dispensées uniquement respectivement aux niveaux cycles
technicien supérieur et licence. Le master du CERFITEX est en génie industriel seulement.
Le génie électrique et informatique industriel (GEII) est la filière la plus convoitée par les
étudiants du CERFITEX avec 106 étudiants sur 252. Dans le cycle technicien supérieur, plus
de deux tiers (67,5%) des filles font la filière chimie appliquée alors que 56,3% des garçons de
ce cycle font la MMI. Plus de huit garçons sur dix (81,6%) de la licence étudiaient le GEII
pendant 52% de filles de ce cycle font la même filière.
6 https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC156169/
 |
41 41 |
▲back to top |
28
Tableau 18: Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) du CERFITEX par filière
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 114 100,0 25 100 139 100,0
TT 7 6,1 0 0 7 5,0
GEII 93 81,6 13 52,0 106 76,3
CA 14 12,3 12 48,0 26 18,7
Master 8 100,0 1 100,0 9 100,0
MGI 8 100,0 1 100,0 9 100,0
Technicien Supérieur 64 100,0 40 100,0 104 100,0
TT 7 10,9 9 22,5 16 15,4
MMI 36 56,3 4 10,0 40 38,5
CA 21 32,8 27 67,5 48 46,2
Total 186 100,0 66 100,0 252 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par le CERFITEX
- ENETP
L’Ecole Nationale d’Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) est créée par
l’Ordonnance n°10-032/P-RM du 04 août 2010 et ratifiée par la Loi n°2011-042 du 15 juillet
2011. Elle assure en cinq (5) ans après le baccalauréat et tout diplôme équivalent, en trois (3)
ans après le DUT ou la licence et tout diplôme équivalent, une formation universitaire
sanctionnée par le master. Elle assure une formation initiale en Licence-Master-Doctorat.
L’accès à l’ENETP se fait par voie de concours, soit sur étude du dossier suivi de test.
Durant l’année scolaire 2021-2022, l’ENETP comptait 1 455 étudiants dont plus du trois quart
(75,2%) étaient des garçons. Le cycle licence regroupait 67,6% des étudiants de l’ENETP
contre 32,4% pour le cycle master.
Tableau 19: Répartition des étudiants de l'ENETP (année scolaire 2021-2022) par sexe selon le
niveau d’étude et la classe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 724 73,7 259 26,3 983 67,6
Licence 1 237 75,2 78 24,8 315 32,0
Licence 2 294 71,5 117 28,5 411 41,8
Licence 3 193 75,1 64 24,9 257 26,1
Master 370 78,4 102 21,6 472 32,4
Master 1 212 79,7 54 20,3 266 56,4
Master 2 158 76,7 48 23,3 206 43,6
Total général 1 094 75,2 361 24,8 1 455 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENETP
A l’ENETP, il y a neuf filières à savoir : Comptabilité Gestion (24,2% des étudiants de
l’ENETP), Bureautique Communication (17,8%), Bâtiments et travaux publics (13,8%),
 |
42 42 |
▲back to top |
29
Exploitation minière (13,3%), Aménagements hydrauliques (7,5%), Electrotechnique (6,6%),
Génie mécanique (6,3%), Energétique (5,4%) et Electronique (5,2%).
Bien que les garçons soient majoritaires dans toutes les filières l’ENETP, le pourcentage de
garçons dans les filières comme bureautique communication, comptabilité gestion et
énergétique est inférieur à la moyenne (75,2%). Le pourcentage de filles dépassant la moyenne
(24,8%) dans les filières suivantes : bureautique communication, comptabilité gestion,
énergétique et aménagements hydrauliques.
Tableau 20: Répartition des étudiants de l'ENETP (année scolaire 2021-2022) par sexe selon la
filière
Spécialité
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bâtiments et travaux publics 169 84,1% 32 15,9% 201 13,8%
Bureautique Communication 160 61,8% 99 38,2% 259 17,8%
Comptabilité Gestion 264 75,0% 88 25,0% 352 24,2%
Electronique 60 80,0% 15 20,0% 75 5,2%
Electrotechnique 80 83,3% 16 16,7% 96 6,6%
Energétique 53 67,9% 25 32,1% 78 5,4%
Aménagements Hydrauliques 77 70,6% 32 29,4% 109 7,5%
Génie Mécanique 79 85,9% 13 14,1% 92 6,3%
Exploitation Minière 152 78,8% 41 21,2% 193 13,3%
Total général 1 094 75,2% 361 24,8% 1 455 100,0%
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENETP
- ENI-ABT
Créée le 14 avril 1939, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT)
a subi plusieurs mutations allant de l’Ecole des Travaux Publics formant des dessinateurs
jusqu’à la formation des ingénieurs de conception dans plusieurs domaines. Elle commença
comme Ecole des Travaux Publics (ETP) destinée à former des adjoints techniques en Travaux
Publics. La première réforme de l’enseignement érigea l’ETP en Ecole Nationale d’Ingénieurs
(ENI) en 1962. Elle a alors été régie dans son organisation et son fonctionnement par le décret
N° 96-378/P-RM du 31 décembre 1996. En juin 2006 l’ENI, fut baptisée7 du nom de son
premier Directeur Malien Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT).
Durant l’année scolaire 2021-2022, ENI-ABT comptait 2 211 étudiants dont 84,6% de filles.
ENI-ABT offre les diplômes de technicien supérieur, licence professionnelle, licence (générale)
et master. Plus de deux tiers (68,1%) des étudiants de l’ENI-ABT sont à la recherche d’une
licence (générale), 24,5% sont dans les classes de master, 5,7% pour l’obtention du diplôme de
technicien supérieur et 1,6% sont à la recherche d’une licence professionnelle. Parmi les 2048
étudiants de la licence (générale) et du master, 613 sont en phase finale (les classes de licence 3
et master 2).
7 www.eni-abt.ml
 |
43 43 |
▲back to top |
30
Quelle que soit la classe, le pourcentage des filles n’a jamais atteint les 20% des étudiants. Les
filles représentent 15,4% des étudiants de l’ENI-ABT. Les filles sont minoritaires (8,3%) dans
les classes de licence professionnelle.
Tableau 21: Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) de l'ENI-ABT par sexe selon le
niveau d’étude
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 1 277 84,8 229 15,2 1 506 68,1
Licence 1 758 85,5 129 14,5 887 58,9
Licence 2 232 82,0 51 18,0 283 18,8
Licence 3 287 85,4 49 14,6 336 22,3
Master 452 83,4 90 16,6 542 24,5
Master 1 222 83,8 43 16,2 265 48,9
Master 2 230 83,0 47 17,0 277 51,1
Technicien Supérieur 108 85,0 19 15,0 127 5,7
Génie Civil 69 80,2 17 19,8 86 67,7
Technicien supérieur 39 95,1 2 4,9 41 32,3
Licence
Professionnelle
33 91,7 3 8,3 36 1,6
Génie Electrique 4 100,0 - 0,0 4 11,1
Géologie et Mines 29 90,6 3 9,4 32 88,9
Total 1 870 84,6 341 15,4 2 211 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENI-ABT
- ENSUP
Créée en 1962, l’Ecole Normale Supérieure, géant de la formation des enseignants a joué un
rôle déterminant dans la formation au Mali. La Loi n° 2012 -044 du 16 novembre 2012 8portant
modification de l’Ordonnance n°10-026/P-RM du 04 août 2010 portant création de l’Ecole
Normale Supérieure de Bamako, confère à l’ENSUP les missions suivantes :
- la formation initiale professionnelle et continue des Professeurs de l’Enseignement
Secondaire et de l’Enseignement universitaire;
- la formation post universitaire ;
- le perfectionnement,
- la recherche scientifique, technologique et pédagogique ;
- la préparation aux concours d’agrégation de l’enseignement secondaire ;
- le développement et la diffusion des connaissances et du savoir-faire.
Au cours de l’année universitaire 2021-2022, l’ENSUP comptait 1 722 étudiants dont 90,2 des
hommes. L’ENSUP forme les étudiants jusqu’à l’obtention d’une licence ou d’un master. Les
étudiants de la licence représentent 57,3% et ceux du master, 42,7%.
8 https://dg-enseignementsup.ml/wp-content/uploads/2022/08/Loi_Creation_N%C2%B02012_044_ENSup.pdf
 |
44 44 |
▲back to top |
31
Les femmes représentent 9,8% des étudiants de l’ENSUP. Le pourcentage des femmes en phase
finale est toujours supérieur au pourcentage moyen des femmes. En effet, les femmes de la
licence 3 représentent 12,7% des étudiants de ce niveau alors que les femmes ne représentent
que 7,7% en licence. Il en est de même pour les femmes du master 2 qui représentent 16,2%
des étudiants alors que les femmes représentent 12,6% des classes de master.
Tableau 22: Répartition des étudiants de l’ENSUP (2021-2022) par sexe selon le niveau d’étude
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 910 92,3 76 7,7 986 57,3
Licence 1 310 95,4 15 4,6 325 33,0
Licence 2 353 93,4 25 6,6 378 38,3
Licence 3 247 87,3 36 12,7 283 28,7
Master 643 87,4 93 12,6 736 42,7
Master 1 317 91,4 30 8,6 347 47,1
Master 2 326 83,8 63 16,2 389 52,9
Total 1 553 90,2 169 9,8 1 722 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENSUP
- ESJSC
L'Etat du Mali a créé par la Loi n°2015-009 du 5 Mars 20159, un Etablissement Public à
caractère Scientifique et Technologique doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, dénommé Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication,
en abrégé ESJSC.
L’ESJSC offre une licence professionnelle dans la seule filière qui est le journalisme. Durant
l’année scolaire 2021-2022, cette école comptait 73 étudiants dont 47,9% de filles. Le nombre
d’étudiants a connu une légère baisse passant de 75 étudiants en année scolaire 2020-2021 à 73
étudiants de l’année scolaire 2021-2022.
Tableau 23: Répartition des étudiants de l’Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la
Communication (ESJSC)
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence professionnelle I 10 41,7 14 58,3 24 32,9
Licence professionnelle II 14 58,3 10 41,7 24 32,9
Licence professionnelle III 14 56,0 11 44,0 25 34,2
Total 38 52,1 35 47,9 73 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ESJSC
9 https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/creation-de-lecole-superieure-de
 |
45 45 |
▲back to top |
32
- IHERI-ABT
L'Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed-Baba (IHERI-ABT)10, connu
avant 1999 sous le nom de Centre de documentation et de recherche Ahmed-Baba (CEDRAB).
Le CEDRAB a connu la transformation en Institut des Hautes Etudes et de Recherches
Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI-ABT) suivant l’Ordonnance N° 99-44/ P-RM
du 30 septembre incluant dans ses missions le volet enseignement universitaire et post
universitaire. Le Décret N°2016-0536/PRM du 3 Août 2016 fixe son organisation. L’Institut
doit son nom au savant du XVIe siècle, Ahmed Baba.
L’Institut des Hautes Etudes et des Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou
(IHERI-ABT) avaient durant l’année scolaire 2021-2022, 53 étudiants dont 73,6% de garçons.
IHERI forme les étudiants au niveau DUT dans la seule filière du métier du livre. Cet institut à
la première année DUT et la deuxième année DUT. La première comptait 30 étudiants et la
deuxième année 23 étudiants.
Tableau 24: Répartition des étudiants de l’IHERI-AB de Tombouctou au métier du livre par sexe
(2021-2022) selon la classe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
DUT1 19 63,3% 11 36,7% 30 56,6%
DUT2 20 87,0% 3 13,0% 23 43,4%
Total 39 73,6% 14 26,4% 53 100,0%
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IHERI-ABT
- INFSS
L’Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) est un établissement public à
caractère scientifique, technologique et culturel, créé par l’Ordonnance n°04-032/P-RM du 23
septembre 2004.
Courant l’année scolaire 2021-2022, l’INFSS comptait 1 418 étudiants dont 55,3% filles. Le
cycle Licence contenait 68,3% des étudiants de cet institut et le cycle master 31,7%. L’INFSS
a connu une baisse du nombre d’étudiants, passant de 1 894 étudiants de l’année scolaire 2020-
2021 à 1 418 étudiants de l’année scolaire 2021-2022, soit une diminution de 25,1%.
Bien que les filles soient globalement majoritaires (55,3%) à l’INFSS, les garçons sont
majoritaires dans les classes de master où ils représentent 67,3%.
10 https://iheriabt.gouv.ml/iheri-ab-2/
 |
46 46 |
▲back to top |
33
Tableau 25: Effectifs des étudiants de l'INFSS par sexe selon le niveau d’étude et la classe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 331 34,2 637 65,8 968 68,3
Licence 1 118 33,4 235 66,6 353 36,5
Licence 2 105 36,1 186 63,9 291 30,1
Licence 3 108 33,3 216 66,7 324 33,5
Master 303 67,3 147 32,7 450 31,7
Master 1 178 70,9 73 29,1 251 55,8
Master 125 62,8 74 37,2 199 44,2
Total 634 44,7 784 55,3 1418 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’INFSS
- INFTS
Durant l’année scolaire 2021-2022, 756 étudiants étaient à l’INFTS dont 54,1% de filles.
L’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) forme les étudiants jusqu’à
l’obtention des diplômes du technicien supérieur, de licence et de master. Le cycle licence
représente 60,7% des étudiants, le cycle technicien supérieur 30,3% et le cycle master 9,0%.
Les garçons représentent globalement 45,9% des étudiants de cet institut, mais ils représentent
67,6% du cycle master.
Tableau 26: Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) par sexe selon le niveau d’étude
et la classe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Technicien supérieur 94 41,0 135 59,0 229 30,3
DUT 1 55 43,7 71 56,3 126 55,0
DUT2 39 37,9 64 62,1 103 45,0
Licence 207 45,1 252 54,9 459 60,7
Licence 1 67 44,1 85 55,9 152 33,1
Licence 2 47 42,7 63 57,3 110 24,0
Licence 3 93 47,2 104 52,8 197 42,9
Master 46 67,6 22 32,4 68 9,0
Master 1 22 61,1 14 38,9 36 52,9
Master 2 24 75,0 8 25,0 32 47,1
Total 347 45,9 409 54,1 756 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’INFTS
A l’INFTS, la première année licence est en tronc commun. La première année licence
représentait 20,1% des étudiants. Les étudiants sont plus dans les filières comme (i) travail
social spécialiste en protection sociale (17,2%), (ii) développement communautaire spécialiste
en économie social et (iii) professionnel en travail social.
Il y a une différence significative (5%) entre les garçons et les filles dans les filières de :
 |
47 47 |
▲back to top |
34
- travail social spécialiste en protection sociale où 20,0% de filles sont dans cette filière contre
13,8% de garçons ;
- protection sociale où 10,5% de filles sont dans cette filière contre 5,5% de garçons ;
- professionnel en travail social où 13,3% de garçons sont dans cette filière contre 5,4% de
filles.
Tableau 27: Répartition des étudiants de l’INFTS (année scolaire 2021/2022) par sexe selon la
filière
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Tronc-Commun en L1 67 44,1 85 55,9 152 20,1
Action-Hum 29 60,4 19 39,6 48 6,3
Animation, Chang 21 45,7 25 54,3 46 6,1
Dev-C 18 51,4 17 48,6 35 4,6
développement communautaire
/Economie sociale 46 46,5 53 53,5 99 13,1
Eco-sociale-solidaire 2 66,7 1 33,3 3 0,4
Gestion des institutions sociales 11 36,7 19 63,3 30 4,0
Gestion des Organisations 6 66,7 3 33,3 9 1,2
professionnel en travail social 46 67,6 22 32,4 68 9,0
Projet communautaire 15 75,0 5 25,0 20 2,6
Protection-Sociale 19 30,6 43 69,4 62 8,2
Sécurité-Sociale 11 25,0 33 75,0 44 5,8
Travail social et solidaire 8 80,0 2 20,0 10 1,3
travail social spécial /protection sociale 48 36,9 82 63,1 130 17,2
Total 347 45,9 409 54,1 756 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’INFTS
- INJS11
L’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) comptait 316 étudiants dont 69,3% de
filles. L’INJS a connu une augmentation de 8,6% du nombre d’étudiants entre l’année scolaire
2020-2021 (291 étudiants) et l’année scolaire 2021-2022 (316 étudiants).
Cet institut forme les étudiants au cycle moyen qui dure quatre années et au cycle de licence
professionnelle. Près de trois étudiants sur quatre (74,7%) fréquentaient le cycle moyen contre
25,3 de la licence professionnelle.
11 Dans les tableaux de l’INJS les modalités suivantes : Homme, Femme, STASE-JL et STAPS sont en pourcentage
ligne où la somme des pourcentages Homme et Femme donne 100% ainsi que STASE-JL et STAPS donne 100%
pour chaque ligne. Le Total est en pourcentage colonne où la somme de cycle moyen et licence professionnelle
donne 100% et la somme de la 1ère année à la 4ème année donne aussi 100%.
 |
48 48 |
▲back to top |
35
Tableau 28: Répartition des étudiants de l’INJS par sexe selon le cycle et le niveau d’étude
Cycle et niveau d'étude
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Cycle moyen 81 34,3 155 65,7 236 74,7
1ère Année 25 34,7 47 65,3 72 30,5
2ème Année 17 28,8 42 71,2 59 25,0
3ème Année 20 37,7 33 62,3 53 22,5
4ème Année 19 36,5 33 63,5 52 22,0
Licence professionnelle 16 20,0 64 80,0 80 25,3
Total 97 30,7 219 69,3 316 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’INJS
Il y a deux filières à l’INJS à savoir : (i) la Science technique en application de la science de
l’éducation jeunesse et loisir (STASE-JL) et (ii) la Science technique en application de la
science physique et sportive (STAPS). Globalement, 50,6 des étudiants sont à STASE-JL et
49,4% à STAPS. C’est seulement à la licence professionnelle que le nombre d’étudiants à
STAPS (46) est supérieur à celui de STASE-JL (34).
Tableau 29: Répartition des étudiants de l’INJS par filière selon le cycle et le niveau d’étude
Cycle et niveau d'étude
STASE-JL STAPS Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Cycle moyen 126 53,4 110 46,6 236 74,7
1ère Année 40 55,6 32 44,4 72 30,5
2ème Année 29 49,2 30 50,8 59 25,0
3ème Année 30 56,6 23 43,4 53 22,5
4ème Année 27 51,9 25 48,1 52 22,0
Licence professionnelle 34 42,5 46 57,5 80 25,3
Total 160 50,6 156 49,4 316 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’INJS
- IPR/IFRA
L’Institut Polytechnique12 a vu le jour en 1965 et sa création fut officialisée par l’ordonnance
n°34 du 24 juin 1969 et son organisation fixée par décret n°116 du 7 juillet 1969. Il a été créé
avec la fusion des infrastructures du Collège Technique Agricole (CTA), de l’École Normale
de Katibougou et de l’École des Assistants d’Élevage de Bamako. En 1995, dans le cadre d’une
approche intégrée du développement du Sahel, un séminaire sous régional placé sous l’égide
de l’UNESCO et tenu à Bamako recommanda la restructuration de l’IPR en un Institut de
Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA). A partir d’août 2010, l’établissement a été
érigé en Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique (EPST) avec
autonomie de gestion.
Durant l’année académique 2022/2023, IPR/IFRA comptait 3 369 étudiants dont 75,3% de
garçons. Il forme les étudiants jusqu’à l’obtention des diplômes de technicien supérieur, de
12 https://www.ipr-ifra.edu.ml/wordpress/presentation/historique/
 |
49 49 |
▲back to top |
36
licence, d’ingénieur et de maîtrise. La durée des cycles est deux ans pour le technicien
supérieur, trois ans pour la licence et le diplôme d’ingénieur, et quatre ans pour la maîtrise. Les
étudiants se répartissent en 49,5% dans les classes de licence, 34,9% dans les classes de
technicien supérieur, 10,5% dans les classes d’ingénieur et 5,1% dans les classes de maîtrise.
C’est seulement dans la classe de licence 1 que le pourcentage des garçons n’atteint pas 70%
des étudiants, sinon toutes les classes de l’IPR/IFRA ont plus de sept garçons sur dix étudiants.
Au niveau maîtrise, les filles ne représentent que 9,3% des étudiants.
Tableau 30: Répartition des étudiants de l’IPR/IFRA (Année académique 2022/2023) par sexe
selon le niveau d’étude et la classe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Technicien Supérieur 918 78,1 258 21,9 1 176 34,9
1ère Année 491 78,6 134 21,4 625 53,1
2e Année 427 77,5 124 22,5 551 46,9
Licence 1 175 70,4 493 29,6 1 668 49,5
Licence 1 482 66,1 247 33,9 729 43,7
Licence 2 381 74,3 132 25,7 513 30,8
Licence 3 312 73,2 114 26,8 426 25,5
Ingénieur 287 81,3 66 18,7 353 10,5
1ère Année 98 88,3 13 11,7 111 31,4
2e Année 99 73,9 35 26,1 134 38,0
3e Année 90 83,3 18 16,7 108 30,6
Maîtrise 156 90,7 16 9,3 172 5,1
1ère Année 36 87,8 5 12,2 41 23,8
2e Année 43 86,0 7 14,0 50 29,1
3e Année 35 94,6 2 5,4 37 21,5
4e Année 42 95,5 2 4,5 44 25,6
Total 2 536 75,3 833 24,7 3 369 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IPR/IFRA
IPR/IFRA forme les étudiants dans cinq domaines principaux à savoir : (i) eaux et forêts et du
génie rural, (ii) sciences et techniques agricoles, (iii) sciences et techniques d’élevage, (iv)
sciences économiques et sociales, et (v) sciences fondamentales et de base. Au sein de ces cinq
domaines, nous avons vingt (20) filières (voir le tableau ci-dessous).
Parmi ces vingt filières, trois filières atteignent chacune 10% des étudiants de l’IPR/IFRA :
agroéconomie (11,1%), agrobusiness (10,9%) et production des cultures vivrières et
industrielles (10,7%). Les filières comme agriculture durable (9,8%), aménagement hydro
agricole (8,6%), zootechnie (5,6%), agronomie (5,4%) et la vulgarisation agricole (5,1%)
atteignaient plus de 5% des étudiants. Les filières peu fréquentées par les étudiants (moins de
2% de l’ensemble) sont technologie et qualité des aliments, halieutique et aquaculture, eaux et
forêts, santé animale, et machinisme agricole.
 |
50 50 |
▲back to top |
37
Parmi les filles de l’IPR/IFRA, 17,0% étudiaient l’agrobusiness et 14,0% étudiaient
l’agroéconomie. Parmi les garçons de l’IPR/IFRA, 11,4% étudiaient la production des cultures
vivrières et industrielles et 10,1% étudiaient l’agroéconomie. En faisant la différence le
pourcentage des garçons et celui des filles, nous concluons que la filière agrobusiness est plus
féminisée que masculinisée alors que la filière aménagement hydro agricole est plus
masculinisée que féminisée. En effet, la filière agrobusiness est constituée de 8,8% de
l’ensemble des garçons de l’institut et 17,0% de l’ensemble des filles ; alors que la filière
aménagement hydro agricole est constituée de 9,9% des garçons et 4,8% des filles.
Tableau 31: Répartition des étudiants de l’IPR/IFRA (Année académique 2022/2023) par sexe
selon la filière
Filières
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Aménagement et gestion des ressources forestières
et halieutiques
79 3,1 40 4,8 119 3,5
Agronomie 157 6,2 26 3,1 183 5,4
Agrobusiness 224 8,8 142 17,0 366 10,9
Agriculture durable 251 9,9 80 9,6 331 9,8
Agroéconomie 257 10,1 117 14,0 374 11,1
Aménagement et gestion des ressources forestières 76 3,0 26 3,1 102 3,0
Aménagement hydro agricole 250 9,9 40 4,8 290 8,6
Amélioration et production des plantes et semences 106 4,2 23 2,8 129 3,8
Eaux et forêts 40 1,6 16 1,9 56 1,7
Gestion intégrée de la fertilité du sol 69 2,7 32 3,8 101 3,0
Halieutique et aquaculture 34 1,3 20 2,4 54 1,6
Machinisme agricole 56 2,2 7 0,8 63 1,9
Production avicole 96 3,8 31 3,7 127 3,8
Production des cultures vivrières et industrielles 288 11,4 73 8,8 361 10,7
Production horticole 72 2,8 49 5,9 121 3,6
Production de viande 103 4,1 25 3,0 128 3,8
Santé animale 45 1,8 13 1,6 58 1,7
Technologie et qualité des aliments 24 0,9 21 2,5 45 1,3
Vulgarisation agricole 156 6,2 16 1,9 172 5,1
Zootechnie 153 6,0 36 4,3 189 5,6
Total 2 536 100,0 833 100,0 3 369 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IPR/IFRA
- IPU
C'est par la loi N°2018-043 du 27 juin 2018 que l'Institut de pédagogie universitaire (IPU) a été
créé au Mali comme un établissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel.
Le 31 décembre 2021 Arrêté n°2021-6005/MESRS-SG13 portant création et organisation de
l’Ecole doctorale Droit Economie Sciences Sociales Lettres et Art du Mali, cette école remplace
l’IPU.
13 https://sgg-mali.ml/JO/2022/mali-jo-2022-03.pdf [site visité le 18/10/2023]
 |
51 51 |
▲back to top |
38
Au cours de l’année académique 2020-2021, au total 358 doctorants se sont inscrits à l’Institut
de Pédagogie Universitaire (IPU) dont 86,6% d’hommes et 14,4% de femmes. Les étrangers
représentaient 7,8% des doctorants.
Tableau 32: Situation des doctorants inscrits en 2020/2021 selon la nationalité
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Malien 286 86,6 44 14,3 330 92,2
Etranger 24 85,7 4 14,3 28 7,8
Total 310 86,6 48 14,4 358 100
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IPU
- IZSEJB
L’Institut Zayed des Sciences Economiques et Juridiques de Bamako (IZSEJB) a été créé par
la Loi14 n°2016-054 du 20 décembre 2016. L’Institut Zayed des Sciences Economiques et
Juridiques de Bamako a pour missions d’assurer la formation des bacheliers issus des
établissements d’enseignement secondaire dont le médium principal d’enseignement est la
langue arabe et d’assurer la formation continue et la recherche dans les domaines de l’économie,
de la gestion et du droit.
Durant l’année universitaire 2021/2022, l’IZSEJB comptait 570 étudiants dont 78,6% garçons.
Cet institut forme les étudiants jusqu’à l’obtention d’une licence. Les étudiants se répartissaient
dans les trois classes de licence en 53,2% pour la première année (licence 1), 17,5% pour la
deuxième année et 29,3% pour la troisième année licence.
En licence 1, les étudiants ont le choix entre les sciences économiques et de gestion (50,2%), et
les sciences juridiques politiques et de l’administration (49,8%). Il y a deux filières en licence
2 à savoir la gestion des ressources humaines et la filière du juriste islamique et de magistrature.
La fin de cycle de licence est composée de quatre filières : finance islamique (36,5%), droits
des affaires comparé (30,5%), informatique de gestion (16,8%) et traduction (16,2%).
Les filles représentent globalement 21,4% des étudiants de l’IZSEJB. Quelle que soit la classe
ou la filière, les garçons sont toujours majoritaires. Les filles de l’IZSEJB sont nombreuses
dans la licence 1 surtout dans les sciences juridiques politiques et de l’administration.
14 https://sgg-mali.ml/JO/2016/mali-jo-2016-53.pdf [site visité le 18/10/2023]
 |
52 52 |
▲back to top |
39
Tableau 33 : Répartition des étudiants (année scolaire 2021/2022) de l’IZSEJB par filière et sexe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Licence 1 219 72,3 84 27,7 303 53,2
Sciences économiques et de gestion 117 77,0 35 23,0 152 50,2
Sciences juridiques politiques et de
l’administration 102 67,5 49 32,5 151 49,8
Licence 2 88 88,0 12 12,0 100 17,5
GRH 40 80,0 10 20,0 50 50,0
Juriste Islamique et de Magistrature 48 96,0 2 4,0 50 50,0
Licence 3 141 84,4 26 15,6 167 29,3
Finance Islamique 54 88,5 7 11,5 61 36,5
Droit des Affaires Comparé 40 78,4 11 21,6 51 30,5
Informatique de Gestions 23 82,1 5 17,9 28 16,8
Traduction 24 88,9 3 11,1 27 16,2
Total 448 78,6 122 21,4 570 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IZSEJB
3.3. Ressources humaines formées à l’extérieur du Mali en 2022
Cette partie traite du profil des ressources humaines formées à l’extérieur, l’évaluation du
financement des formations à l’extérieur et la répartition des étudiants par pays d'accueil.
3.3.1. Profil des ressources humaines formées à l’extérieur
En 2022, un total de 3 019 étudiants ayant poursuivi leur formation à l'étranger a réussi à
décrocher leur diplôme. Parmi eux, 1 965 étaient des hommes et 1 054, des femmes. Peu
importe le type d'établissement où ils ont suivi leur formation, il est important de noter que la
proportion d'hommes parmi ces étudiants est supérieure à celle des femmes.
En ce qui concerne la répartition des diplômes par type d'établissement, 42,2% des diplômés
sont issus d'universités, 33,8% ont suivi des formations postuniversitaires, et 24% ont obtenu
des diplômes de niveau secondaire et autres. À noter que, dans tous les cas, la proportion
d'hommes formés à l'étranger est plus élevée que celle des femmes.
Plus de huit diplômés sur dix (83,8%) ayant suivi une formation universitaire détiennent un
diplôme de Licence/BAC+3, tandis que seulement 3,7% possèdent un diplôme de Maîtrise. En
ce qui concerne les diplômés postuniversitaires, 81,6% ont obtenu un diplôme de
Master/MBA/ING, ce qui représente la proportion la plus élevée. Seulement 4,3% d'entre eux
ont obtenu un Doctorat en médecine ou en pharmacie. Il est important de noter que cette
proportion a considérablement chuté par rapport à 2021, passant de 78,6% en 2021 à seulement
4,3% en 2022. Quelle que soit la nature du diplôme, la proportion d'hommes formés à l'étranger
reste plus élevée que celle des femmes.
 |
53 53 |
▲back to top |
40
Les diplômés de niveau secondaire et autres en provenance de l'étranger sont moins nombreux.
Cependant, 63,5% d'entre eux ont obtenu des diplômes tels que le DEF/BEPC/BFM/CEP.
Parmi ces diplômés, 50,7% sont des femmes. En revanche, 33,6% ont réussi à obtenir leur
baccalauréat à l'étranger. Il est intéressant de noter que cette proportion a considérablement
diminué, passant de 89,7% en 2021 à 33,6% en 2022.
Tableau 34: Répartition des étudiants formés à l’extérieur par type diplôme obtenu
Femme Homme Total
effectif % effectif % effectif %
Diplôme postuniversitaire 263 25,8 758 74,2 1 021 33,8
CES/DES 10 23,3 33 76,7 43 4,2
Docteur (médecine et pharmacie) 17 38,6 27 61,4 44 4,3
Doctorat 13 12,9 88 87,1 101 9,9
Master/MBA/ING 223 26,8 610 73,2 833 81,6
Diplôme universitaire 438 34,4 836 65,6 1 274 42,2
BTS/DUT/DEUG/DTS 49 30,8 110 69,2 159 12,5
Licence/BAC+3 380 35,6 688 64,4 1 068 83,8
Maîtrise 9 19,1 38 80,9 47 3,7
Diplôme secondaire et autres 353 48,8 371 51,2 724 24,0
BAC 111 45,7 132 54,3 243 33,6
BT2/BT1/DT/CAP 9 42,9 12 57,1 21 2,9
DEF/BEPC/BFM/CEP 233 50,7 227 49,3 460 63,5
Total 1 054 34,9 1 965 65,1 3 019 100,0
Source : DNPD, rapport d’activités 2022
L'analyse du graphique 2 nous permet de constater que parmi les 3 019 étudiants ayant suivi
leur formation à l'étranger, la majorité, soit 2 274 d'entre eux, étaient des étudiants. Les hommes
prédominent nettement dans cette catégorie, avec 1 547 hommes par rapport à 727 femmes. En
ce qui concerne les élèves, leur nombre total s'élève à 645, répartis-en 332 hommes et 313
femmes. De plus, 100 stagiaires ont également suivi des formations à l'étranger, parmi lesquels
86 étaient des hommes et 14 des femmes. Qu'il s'agisse de n'importe quel domaine de formation,
il est évident que les hommes sont plus nombreux.
313
727
14
332
1 547
86
645
2 274
100
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Elève Etudiant Stagiaire
Femme Homme Total
 |
54 54 |
▲back to top |
41
Graphique 2: Répartition des diplômés par domaine de formation
Source : DNPD, rapport d’activités 2022
En 2022, les étudiants, élèves et stagiaires se sont répartis sur les quatre continents majeurs, à
savoir l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. En termes de répartition par pays d'accueil, le
Maroc a accueilli le plus grand nombre d’étudiants, soit 580, suivi de l'Algérie avec 534, et la
Côte d'Ivoire avec 312 étudiants.
En ce qui concerne l'Europe, la France est en tête avec 215 étudiants, suivie de la Russie avec
36 étudiants, tandis que seuls 34 individus ont été formés dans d'autres pays européens.
En Amérique, le Canada a accueilli 40 étudiants, suivi par les États-Unis d'Amérique avec 20
étudiants. Les autres pays du continent américain ont formé 42 étudiants.
L'Inde et la Chine ont enregistré les effectifs les plus élevés sur le continent asiatique, avec
respectivement 48 et 37 étudiants formés. L'Arabie saoudite occupe la troisième position avec
17 étudiants formés. Néanmoins, le reste du continent asiatique a formé seulement 6 étudiants.
Graphique 3: Répartition des étudiants par pays d'accueil
Source : DNPD, rapport d’activités 2022
3.3.2. Financement des formations à l’extérieur
Dans le cadre de la coopération bi et multilatérale, un nombre important de formations des
étudiants maliens à l’extérieur bénéficie de l’octroi d’une bourse d’études. Celle-ci est souvent
octroyée suivant un certain nombre de critères dont celui du mérite est le plus déterminant. La
forme d’une bourse peut changer d’un partenaire à l’autre, mais très généralement l’on retrouve
les différents types de bourses ci-après :
- les aides personnalisées au logement (APL) ;
- les allocations logement à caractère social ;
- les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;
- les aides d’urgence ;
1
6
17
17
20
34
36
37
40
42
48
59
92
148
178
196
215
312
407
534
580
0 100 200 300 400 500 600 700
Non détermine
Turquie
Etats Unis
Russie
Canada
Inde
Niger
Tunisie
France
Autres pays d'Afrique
Maroc
 |
55 55 |
▲back to top |
42
- l’aide au mérite ;
- l’aide à la mobilité internationale.
Les stagiaires peuvent aussi bénéficier de la prise en charge de leurs formations à travers la
mobilisation des mécanismes nationaux de financement de la formation.
Pour les fonctionnaires, il s’agit :
- du fonds pour la formation des agents de l’Etat géré par le ministère en charge de la
fonction publique ;
- des ressources mises à la disposition des départements ministériels par le budget
national pour la formation de leurs agents ;
- des financements prévus pour la formation des ressources humaines du pays dans les
métiers liés aux mines dans le cadre de la mise œuvre des contrats miniers gérés par le
ministère en charge de ce secteur ;
- des financements prévus pour la formation des différents programmes et projets mis en
œuvre par les départements ministériels et leurs services.
Les stagiaires du secteur privé peuvent se faire financer à travers :
- les lignes dédiées au financement du plan de formation de leurs entreprises et ou de
leurs organisations ;
- les financements du fonds d’appui à la formation et à l’apprentissage (FAFPA) pour les
entreprises à jour dans le paiement de la taxe de formation professionnelle.
La dernière source importante de financement des formations à l’extérieur est relative à la
mobilisation des fonds propres. Il s’agit :
- des fonds mobilisés par les parents pour financer la formation des étudiants ;
- des fonds propres mobilisés par les stagiaires pour financer leurs formations ;
- des crédits à l’investissement-formation mobilisés auprès des banques et organismes
spécialisés dans le financement des formations.
3.3.3. Evaluation des coûts de formation des diplômes étrangers non reconnus
Hypothèses de calcul des coûts
Pour les pays d’Afrique : un coût approximatif moyen est 3 000 000 FCFA par an et par
étudiant malien pour tous frais confondus (frais pédagogiques, logement, nourriture, matériels
didactiques, etc.). Les coûts des formations pour la licence (trois ans après le baccalauréat), le
master (deux ans après la licence) et le doctorat (trois ans après le master) s’obtiennent ainsi
qu’il suit :
Licence à 9 000 000 FCFA en trois ans ;
Master à 6 000 000 FCFA en deux ans ;
Doctorat à 9 000 000 FCFA en trois ans.
 |
56 56 |
▲back to top |
43
Pour les pays d’Europe et d’Asie : un coût approximatif moyen de 4 000 000 FCFA par an et
par étudiant tous frais confondus composés de frais pédagogiques, logement, nourriture,
matériels didactiques, etc. Les coûts pour ces continents sont :
Licence à 12 000 000 FCFA en trois ans ;
Master à 8 000 000 FCFA en deux ans ;
Doctorat à 12 000 000 FCFA en trois ans.
Pour les pays d’Amérique : un coût approximatif moyen de 5 000 000 FCFA par an et par
étudiant tous frais confondus composés de frais pédagogiques, logement, nourriture, matériels
didactiques, etc. Les coûts pour ces continents sont :
Licence à 15 000 000 FCFA en trois ans ;
Master à 10 000 000 FCFA en deux ans ;
Doctorat à 15 000 000 FCFA en trois ans.
Estimation des coûts de formation à l’étranger
Selon la DNPD, les coûts estimatifs de formation à l’étranger étaient de trois milliards huit cent
soixante millions de francs CFA (3 860 000 000). Parmi les coûts globaux de formation à
l’étranger, la mobilisation des fonds propres représentait 54,2%. Il est à noter que 8,7% des
études financées ne sont pas reconnues par le Mali. En effet, le montant des formations dont les
diplômes en rejet, était de trois cent trente-cinq millions de francs CFA (335 000 000). Les
diplômes en rejet sont entièrement financés par les fonds propres des parents d’élèves/étudiants.
3.4. Formation professionnelle
3.4.1. Effectifs dans les Centres de Formation professionnelle
En 2022, 5 266 apprenants étaient inscrits dans les centres de formation professionnelle publics
et privés. Le District de Bamako, disposait de près d’un quart (24,3 %) des effectifs, suivi de la
région de Koulikoro avec 17,4 % des apprenants. Les femmes représentaient 45,3 % des
effectifs. Aucun centre fonctionnel n’a été enregistré dans les régions de Kidal, Taoudenni,
Ménaka, Nara et Douentza.
 |
57 57 |
▲back to top |
44
Tableau 35: Répartition des effectifs dans les CFP public et Privé en 2022 par région et par sexe
Région
Sexe
Total
Homme Femme
effectif % effectif % effectif %
Kayes 51 1,8 463 19,4 514 9,8
Koulikoro 265 9,2 650 27,3 915 17,4
Sikasso 448 15,6 0 0,0 448 8,5
Ségou 302 10,5 0 0,0 302 5,7
Mopti 169 5,9 329 13,8 498 9,5
Tombouctou 57 2,0 45 1,9 102 1,9
Gao 238 8,3 142 6,0 380 7,2
Nioro 15 0,5 37 1,6 52 1,0
Kita 10 0,3 40 1,7 50 0,9
Dioïla 88 3,1 0 0,0 88 1,7
Bougouni 117 4,1 90 3,8 207 3,9
Koutiala 93 3,2 117 4,9 210 4,0
San 98 3,4 0 0,0 98 1,9
Bandiagara 4 0,1 119 5,0 123 2,3
Bamako 926 32,1 353 14,8 1 279 24,3
Total 2 881 100,0 2 385 100,0 5 266 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agrées, ONEF 2022
3.4.2. FAFPA
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) a pour mission
essentielle de contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement malien en matière
de Formation Professionnelle Qualifiante, Continue et par Apprentissage.
A ce titre, il est chargé :(i) d’apporter une assistance technique et financière aux entreprises et
autres opérateurs économiques des secteurs moderne et non structuré, ainsi qu’aux organismes
de formation privés et parapublics de droit malien dans le cadre de l’élaboration et de la
réalisation de leurs plans et projets de formation ou d’équipement ; et (ii) de mener des études
spécifiques pour mieux informer les décideurs sur les orientations du Fonds.
En 2022, les dépenses totales consacrées à la formation de la population active se sont élevées
à 81 947 067 CFA, se répartissant en deux secteurs : 62 779 737 CFA, soit 76,6 %, investis
dans le secteur non structuré, tandis que 19 167 330 CFA, équivalant de 23,4 %, ont été alloués
au secteur moderne. En termes d'effectifs, on a constaté que 585 femmes ont suivi des
formations, parmi lesquelles 458 étaient actives dans le secteur non structuré et 127 dans le
secteur moderne. En revanche, pour les hommes, 396 d'entre eux ont été formés, dont 203
travaillaient dans le secteur non structuré et 193 dans le secteur moderne.
En analysant de manière approfondie, il est intéressant de noter que le sous-secteur de l'Industrie
a enregistré des effectifs de formation moins importants, mais il a reçu le financement le plus
élevé, atteignant 8 913 130 FCFA. En ce qui concerne le secteur non structuré, 448 individus
 |
58 58 |
▲back to top |
45
actifs dans l'artisanat ont bénéficié de formations, avec un investissement total de 38 841 989
FCFA.
Tableau 36: Formation de la population active en 2022 selon le secteur (en FCFA et %)
Secteurs/Sous-secteurs
Effectif Financement
Homme Femme Ensemble Montant %
Secteur moderne 193 127 320 19 167 330 23,4
Sous-secteur BTP-Mines 75 75 150 6 690 600 34,9
Sous-secteur Industries 72 18 90 8 913 130 46,5
Sous-secteur Services 46 34 80 3 563 600 18,6
Secteur non structuré 203 458 661 62 779 737 76,6
Monde rural 29 55 84 10 363 854 16,5
Artisanat 140 308 448 38 841 989 374,8
Tertiaire 34 95 129 13 573 894 34,9
Total 396 585 981 81 947 067 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par le FAFPA
3.5. Flux des nouveaux diplômés entrants potentiels15 sur le marché du travail en 2023-
2024
En 2022, on comptait 41 010 nouveaux diplômés entrants potentiels sur le marché du travail en
2023-2024, parmi lesquels 19 251 (46,6 %) sont des diplômés de l'enseignement technique et
professionnel (CAP, BT et IFM). L'enseignement supérieur (universités, instituts, grandes
écoles et diplômés formés à l'extérieur du pays) comptait 21 759 diplômés entrants potentiels
sur le marché du travail, soit 53,1 % des diplômés. Ces statistiques font ressortir un déséquilibre
entre le cycle secondaire technique et professionnel et le cycle supérieur. Elles ne prennent pas
en compte les statistiques des universités et instituts privés.
Graphique 4 : Nouveaux diplômés entrants potentiels sur le marché du travail par type d’enseignement
Source : Universités, Instituts et grandes écoles publics, 2022
3.5.1. Flux des nouveaux diplômés de l’Enseignement Secondaire technique et
Professionnel entrants potentiels sur le marché du travail
En 2022, au total 19 251 élèves ont réussi aux différents examens de l’enseignement technique
et professionnel dont 67,2% sont des garçons et moins d’un tiers (32,8%) de filles. Quel que
soit le type de diplôme, les garçons sont plus nombreux que les filles. Par ailleurs, les femmes
sont plus représentées parmi les diplômés du BT2 (41,6%) que dans l’ensemble des diplômés.
15 Ces effectifs estimés sont constitués des étudiants en fin de cycle de Licence, de Master 2, d’Ingénieurs, de
techniciens supérieurs, des IFM et des admis aux examens de fin de cycle du CAP, du BT2 en 2022.
19 251
14 754
4 689
2 316
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Enseignement Secondaire
technique et Professionnel
Universités publiques Instituts et grandes écoles
publics
Diplômés formés à
l’extérieur du Pays
 |
59 59 |
▲back to top |
46
Tableau 37: Répartition des nouveaux diplômés de l’Enseignement secondaire technique et professionnel
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
CAP 5 850 73,4 2 120 26,6 7 970 41,4
BT2 4 053 58,4 2 892 41,6 6 945 36,1
IFM (Fin cycle) 2 487 70,0 1 066 30,0 3 553 18,5
Agro pastoral (BT+BT2) 552 70,5 231 29,5 783 4,1
Total 12 942 67,2 6 309 32,8 19 251 100
Source : Centre National des Examens et Concours
3.5.2. Flux des nouveaux diplômés des Universités publiques entrants potentiels sur le
marché du travail
Au total, 14 754 diplômés potentiels ont été dénombrés dans les cinq universités du Mali en
2022 dont 67,3% de garçons contre 32,7% de filles. L'Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB) et l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako
(USSGB) sont les plus représentées en termes de diplômés. Ainsi, elles représentent plus de
deux tiers (67,6%) de l’effectif total des diplômés des universités de 2022 dont 34,5% pour la
première et 33,1 pour la seconde. De l’ensemble des diplômés des universités, 12,1% sont sortis
de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB), 10,4% de l’Université
des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) et 9,9% de l’Université
de Ségou. De toutes ces universités, les femmes diplômées sont proportionnellement plus
importantes à l’USJPB avec 43,2% contre 32,7% pour l’ensemble.
Tableau 38: Répartition des diplômés potentiels entrants potentiel sur le marché du travail selon les Universités par sexe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Université de Ségou 1 010 68,9 455 31,1 1 465 9,9
Faculté du Génie et des Sciences 86 89,6 10 10,4 96 0,7
Faculté d’Agronomie et de Médecine Animale 442 73,1 163 26,9 605 4,1
Faculté des sciences sociales 319 61,3 201 38,7 520 3,5
Institut Universitaire de Formation Professionnelle 163 66,8 81 33,2 244 1,7
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako 3 426 67,3 1 665 32,7 5 091 34,5
Faculté des Lettres, Langues et Sciences du Langage 2 297 71,4 919 28,6 3 216 21,8
Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education 1 059 60,5 691 39,5 1 750 11,9
Institut Confucius 17 65,4 9 34,6 26 0,2
Institut Universitaire de Technologie 53 53,5 46 46,5 99 0,7
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 1 015 56,8 771 43,2 1 786 12,1
Faculté de Droit Privé 120 53,8 103 46,2 223 1,5
Faculté de Droit Public 480 58,1 346 41,9 826 5,6
Faculté des Sciences Administratives et Politiques 415 56,3 322 43,7 737 5,0
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 3 436 70,5 1 441 29,5 4 877 33,1
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 1 834 65,5 965 34,5 2 799 19,0
Faculté d'Histoire et de Géographie 1 267 84,8 227 15,2 1 494 10,1
Institut Universitaire de Gestion 335 57,4 249 42,6 584 4,0
Université des Sciences, des Techniques et Technologiques de Bamako 1 043 67,9 492 32,1 1 535 10,4
Faculté de Médecine et d’Odonto Stomatologie 357 72,0 139 28,0 496 3,4
Faculté de Pharmacie 92 49,5 94 50,5 186 1,3
Faculté des Sciences et Techniques 414 71,4 166 28,6 580 3,9
Institut des Sciences Appliquées 180 65,9 93 34,1 273 1,9
Total 9 930 67,3 4 824 32,7 14 754 100,0
Source : Universités du Mali
3.5.3. Flux des nouveaux diplômés des Instituts et grandes écoles publiques entrants
potentiels sur le marché du travail
En 2022 les diplômés des instituts et grandes écoles sont au nombre de 4 689 dont près de trois
quart (73,2%) sont des hommes et un peu plus d’un quart des femmes qui se répartissent entre
 |
60 60 |
▲back to top |
47
les six (6) instituts et cinq (5) grandes écoles. Les diplômés potentiels des grandes écoles
représentent 43,2% dont la grande majorité à l'Ecole nationale d'Ingénieurs – Abderhamane
Baba Touré (ENI-ABT) avec 16,5% et à l’Ecole Normal Supérieur (14,3%). Dans les grandes
écoles, les femmes diplômées sont proportionnellement plus importantes dans l’Ecole
Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication avec 44,0% contre 26,8% pour
l’ensemble. Par ailleurs, on constate que sur les 2 664 diplômés potentiels des instituts, soit
56,8% de l’effectif total des diplômés, 1 129 se trouvent à l’Institut Polytechnique Rural de
Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA), 523 à l’Institut National de Formation en
Sciences de la Santé (INFSS), 332 à l’Institut National de Formation des travailleurs sociaux et
358 à l’Institut de Pédagogie Universitaire (IPU). Les autres instituts se répartissent les 320
diplômés potentiels restants. Il s’agit de l’Institut Zayed des Sciences Economiques et
Juridiques de Bamako (IZSEJB), l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) et
l'Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed-Baba (IHERI-AB) avec
respectivement 167, 132 et 23 diplômés potentiels.
Tableau 39: Répartition des diplômés potentiels selon les Instituts ou grandes école par sexe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Grandes écoles 1 667 82,3 358 17,7 2 025 43,2
Centre de Recherche et de Formation pour les Industries Légères et Textiles
(CERFITEX)
71 79,8 18 20,2 89 1,9
Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) 351 75,8 112 24,2 463 9,9
Ecole nationale d'Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT) 658 84,8 118 15,2 776 16,5
École normale supérieure de Bamako (ENSup) 573 85,3 99 14,7 672 14,3
Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de Communication 14 56,0 11 44,0 25 0,5
Instituts 1 766 66,3 898 33,7 2 664 56,8
Ahmed Baba Institute of Higher Learning and Islamic Research (IHERI-AB) 20 87,0 3 13,0 23 0,5
Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) 233 44,6 290 55,4 523 11,2
Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS) 156 47,0 176 53,0 332 7,1
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) 35 26,5 97 73,5 132 2,8
Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) 871 77,1 258 22,9 1 129 24,1
Institut Zayed des Sciences Économiques et Juridiques de Bamako (IZSEJB) 141 84,4 26 15,6 167 3,6
Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)
310 86,6 48 13,4 358 7,6
Total 3 433 73,2 1 256 26,8 4 689 100
Source : Universités du Mali/Instituts et grandes écoles
3.5.4. Flux des nouveaux diplômés formés à l’extérieur du Pays entrants potentiels sur le
marché du travail
Au total, 2 316 étudiants ont été formés à l’étranger en 2022, parmi lesquels plus de deux tiers
(69,3%) sont des jeunes hommes contre 30,7% de femmes. Plus de la moitié (55,0%) ont eu le
diplôme universitaire et 44,1% ont eu le diplôme postuniversitaire. Une petite portion de
maliens a obtenu le diplôme BT, DT ou CAP à l’extérieur (21 diplômés, soit 0,9% des diplômés
étrangers).
Tableau 40: Répartition des diplômés formés à l’étranger selon le type de diplôme par sexe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Diplôme postuniversitaire 758 74,2 263 25,8 1 021 44,1
Diplôme universitaire 836 65,6 438 34,4 1 274 55,0
Diplôme secondaire technique et professionnel 12 57,1 9 42,9 21 0,9
Total 1 606 69,3 710 30,7 2 316 100
Source : DNPD, rapport d’activités 2022
 |
61 61 |
▲back to top |
48
4. Marché du travail
Le marché du travail est l’espace virtuel dans lequel se rencontrent, d’une manière plus ou
moins organisée, la demande et l’offre de toutes les formes de travail. L'analyse du marché du
travail se traite à travers la situation de l'emploi et du chômage, l'intermédiation et enfin la
création d'emploi et l'employabilité des arrivants sur le marché du travail.
4.1. Situation de l’emploi et du chômage
De 2013 à 2022, nous remarquons de façon générale que les données de l’emploi sont collectées
au troisième passage de l'Enquête permanente modulaire auprès des ménages (EMOP) conduite
au cours du dernier trimestre de l'année, exception faite de l’année 2021, où les données ont été
collectées au deuxième trimestre de l’année. Ainsi, en 2022, la population en âge de travailler
(les 15 ans et plus) est estimée à plus de 10,6 millions de personnes dont 53,6% sont des
femmes. Les personnes en emploi et les chômeurs représentent plus de 64,3% qui constituent
la main d’œuvre et 0,5% en main-d'œuvre potentielle et plus d’un tiers (35,2%) de personnes
sont autre hors main-d'œuvre. La population hors main-d'œuvre est structurée de la main-
d'œuvre potentielle et autre hors main-d'œuvre.
Tableau 41: Répartition de la population en âge de travailler par statut vis-à-vis de la main-
d'œuvre
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
En emploi 3 805 366 76,8 2 696 777 47,1 6 502 143 60,8
Chômeur 177 967 3,6 192 443 3,4 370 410 3,5
Main-d'œuvre potentielle 6 865 0,1 45 133 0,8 51 998 0,5
Autre hors main-d'œuvre 966 996 19,5 2 794 763 48,8 3 761 759 35,2
Total 4 957 195 46,4 5 729 116 53,6 10 686 311 100,0
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
4.1.1. Population active et taux d’activités
Selon les données de l’EMOP 2022, la population active ou main-d'œuvre est estimée à plus de
6,8 millions de personnes dont 42,0% de femmes et 58,0% d'hommes. Près que huit sur dix
(77,2%) de cette main-d'œuvre vivent en milieu rural et un peu plus d’un cinquième (22,8%)
restant en milieu urbain dont un peu plus de la moitié à Bamako (11,9%). En 2022, les régions
de forte concentration de main-d'œuvre sont Sikasso (21,5%), Ségou (17,5), Kayes (15,2%) et
Mopti (14,1%). Les tranches d'âge 25-35 ans et 41-64 représentent plus de la moitié (62,3%)
de la main d’œuvre au Mali avec respectivement 31,9% et 30,4%. Par niveau d'éducation,
seulement 8,9% de la main d’œuvre ont le niveau secondaire et plus, dont 5,7% chez les femmes
et 11,1% chez les hommes. Une fois de plus environ, sept sur dix personnes (67,1%) de cette
population n’ont aucun niveau d’éducation. Les femmes sont encore plus touchées que les
hommes (73,7% contre 62,3%).
 |
62 62 |
▲back to top |
49
Tableau 42: Répartition de la population active ou main d’œuvre
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Milieu
Urbain 963 311 24,2 603 994 20,9 1 567 305 22,8
Bamako 490 592 12,3 325 817 11,3 816 409 11,9
Autre urbain 472 719 11,9 278 177 9,6 750 896 10,9
Rural 3 020 023 75,8 2 285 226 79,1 5 305 248 77,2
Région
Kayes 533 491 13,4 514 190 17,8 1 047 681 15,2
Koulikoro 611 384 15,3 222 428 7,7 833 812 12,1
Sikasso 715 726 18,0 762 089 26,4 1 477 814 21,5
Ségou 722 593 18,1 477 008 16,5 1 199 602 17,5
Mopti 570 111 14,3 398 419 13,8 968 531 14,1
Tombouctou 184 639 4,6 159 888 5,5 344 527 5,0
Gao 63 375 1,6 11 190 0,4 74 565 1,1
Kidal 21 025 0,5 4 625 0,2 25 650 0,4
Taoudenni 7 861 0,2 296 0,0 8 157 0,1
Ménaka 62 536 1,6 13 270 0,5 75 806 1,1
Bamako 490 592 12,3 325 817 11,3 816 409 11,9
Classe
d'âge
15 - 24 ans 727 181 18,3 616 298 21,3 1 343 479 19,5
25 - 35 ans 1 114 847 28,0 1 074 929 37,2 2 189 776 31,9
36 - 40 ans 594 616 14,9 411 304 14,2 1 005 920 14,6
41 - 64 ans 1 367 781 34,3 720 077 24,9 2 087 859 30,4
Plus de 64 ans 178 909 4,5 66 612 2,3 245 521 3,6
Niveau
d'éducation
Aucun 2 482 225 62,3 2 128 689 73,7 4 610 914 67,1
Primaire 1 059 509 26,6 593 927 20,6 1 653 436 24,1
Secondaire 300 056 7,5 119 048 4,1 419 105 6,1
Supérieur 141 543 3,6 47 556 1,6 189 099 2,8
Total 3 983 334 58,0 2 889 220 42,0 6 872 554 100,0
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
Le taux d’activités est le rapport entre la main-d'œuvre et la population en âge de travailler.
Ainsi, ce taux est de 60,9% sur le plan national, dont 76,8% pour les hommes et 47,1% pour les
femmes. Le taux d’activités est plus élevé en milieu rural (63,8%) qu'en milieu urbain (52,2%).
Il est aussi très faible dans les régions de Gao avec 29,0% dont 4,7% chez les femmes,
Koulikoro (35,1% avec 16,0% pour les femmes) et de Ménaka (38,4%, avec 9,4% chez les
femmes). Le taux d’activités est plutôt très élevé à Tombouctou (80,9%, dont 69,8% pour les
femmes), Sikasso (77,6% et 71,9% pour les femmes) et Kayes (73,1% et 64,4% chez les
femmes). Cette fois-ci le taux d’activités augmente de 15-24 ans jusqu’à 36-40 ans, ensuite il
décroît de 41-64 ans pour les plus de 64 ans dont respectivement 75,0% ; 32,9% et 55,8 ; 20,3%
pour les femmes. Il est faible pour la population en âge de travailler de niveau d'éducation
secondaire (41,3%) et le plus fort taux pour la population aucun niveau (64,3%). Le taux
d’activités de la population en âge de travailler de niveau supérieur est de 51,8%. Les taux
d’activités des femmes les plus élevés s’observent dans les régions de Sikasso (71,9%),
Tombouctou (69,8) et de Kayes (64,4%), tandis que pour les hommes, les plus forts taux se
trouvent à Tombouctou (93,7%), Ségou (85,5%) et Sikasso (84,7%). Quel que soit le sexe, le
plus actif de la population en âge de travailler se trouve dans la tranche d’âge 36-40 ans
 |
63 63 |
▲back to top |
50
Tableau 43: Taux d’activités par caractéristique sociodémographique (en %)
Homme Femme Total
Zone de
résidence
Urbain 71,1 35,5 52,2
Bamako 70,6 37,9 53,4
Autre urbain 71,6 33,2 51,0
Rural 78,8 51,0 63,8
Région
Kayes 83,8 64,4 73,1
Koulikoro 56,0 16,0 35,1
Sikasso 84,7 71,9 77,6
Ségou 85,5 49,6 66,5
Mopti 81,7 47,0 63,1
Tombouctou 93,7 69,8 80,9
Gao 57,3 4,7 29,0
Kidal 84,2 10,4 45,3
Taoudenni 78,7 1,9 41,6
Ménaka 70,2 9,4 38,4
Bamako 70,6 37,9 53,4
Classe d'âge de
travail
15 - 24 ans 50,7 32,8 40,8
25 - 35 ans 90,1 54,0 67,9
36 - 40 ans 94,7 59,0 76,0
41 - 64 ans 91,6 55,8 75,0
Plus de 64 ans 42,9 20,3 32,9
Niveau
d'éducation
Aucun 82,7 51,1 64,3
Primaire 74,0 42,6 59,3
Secondaire 54,7 23,9 41,3
Supérieur 64,1 29,6 51,8
Total 76,8 47,1 60,9
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
4.1.2. Taux d’emploi informel
L’emploi informel se définit surtout par rapport aux conditions d’exercice des employés aussi
bien dans leur emploi principal que secondaire. De façon opérationnelle, dans les unités de
production (formelle, informelle) et dans les ménages, les employés sont considérés être en
emploi informel si au moins l’une des conditions suivantes n’est pas remplie : - paiement par
l’employeur d’indemnité de protection de sécurité sociale ; - congés de maladie rémunérés ; -
congés annuels rémunérés ou compensation éventuelle. L’emploi informel est le nombre total
d’emplois informels, que ce soit dans des entreprises du secteur formel, des entreprises du
secteur informel ou des ménages; y compris les employés occupant un emploi informel ;
employeurs et travailleurs à leur compte employés dans leur propre entreprise du secteur
informel; membres de coopératives informelles de producteurs; travailleurs familiaux
contribuant dans des entreprises du secteur formel ou informel; et travailleurs à leur compte
engagés dans la production de biens à l’usage exclusif de leur ménage (sur la base de la 17ème
CIST). 55 Le taux d'emploi informel est le pourcentage de la population en emploi informel
dans la population en emploi. L'emploi informel est défini comme un emploi qui ne procure
pas de protection sociale et n'accorde pas de congés payés ou de congés maladie. Depuis des
 |
64 64 |
▲back to top |
51
années, l’une des caractéristiques importantes de l'emploi au Mali est qu'il est principalement
informel, c’est-à-dire un emploi sans protection sociale, sans congés maladie ni congés payés.
Ainsi, en 2022, la quasi-totalité (96,6%) des emplois sont informels avec respectivement 98,2%
pour les femmes et 95,6% pour les hommes. L’emploi informel concerne 98,0 % de l'emploi
rural contre respectivement 91,7% de l'emploi urbain. Le taux d’emploi informel des femmes
est plus important que celui des hommes quelle que soit la catégorie sociodémographique,
exception faite des jeunes de moins de 25 ans et ceux de niveau secondaire où les taux d’emploi
informel des hommes sont légèrement supérieurs à ceux des femmes. Cependant, parmi les
jeunes de moins de 25 ans, et ceux de niveau secondaires les emplois occupés par les hommes
(99,6%) ;(75,9%) sont plus informels que ceux occupés par les femmes (99,4%) ; (72,8%). On
constate cette fois ci que c’est à partir du niveau d’éducation aucun, que le taux d'emploi
informel baisse significativement jusqu’à atteindre 57,6% pour le niveau d’instruction
supérieur. Par ailleurs, l’emploi des femmes de niveau fondamental et aucun reste presque
informel. Pour les hommes, le taux d’emplois informels cette fois-ci baisse progressivement à
partir d’aucun niveau (99,1%) à (97,2%) pour le niveau fondamental ; (75,9%) pour le niveau
secondaire et enfin à 56,6% pour le niveau supérieur.
Tableau 44 : Taux d’emploi informel selon le sexe (en %)
Homme Femme Total
Zone de résidence
Urbain 89,9 94,9 91,7
Bamako 89,2 95,1 91,4
Autre urbain 90,6 94,7 92,0
Rural 97,3 98,9 98,0
Classe d’âge
15 - 24 ans 99,6 99,4 99,5
25 - 35 ans 94,8 98,0 96,4
36 - 40 ans 94,1 96,7 95,2
41 - 64 ans 94,3 98,1 95,6
Plus de 64 ans 99,3 100,0 99,5
Niveau d'éducation
Aucun niveau 99,1 99,8 99,4
Primaire 97,2 98,7 97,7
Secondaire 75,9 72,8 75,1
Supérieur 56,6 61,6 57,6
Total 95,6 98,2 96,6
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2021
4.1.3. Emploi selon le secteur institutionnel
Les secteurs institutionnels regroupent les unités institutionnelles ayant des comportements
économiques similaires caractérisés par leur fonction principale et la nature de leur activité. La
primauté de l'emploi informel se traduit par le poids important des entreprises privées
informelles dans la répartition de l'emploi. Ainsi, nous remarquons que la majorité (82,9%) de
la population en emploi est dans le secteur d’entreprise privée informelle contre 3,4% pour le
secteur public, 0,5% pour les entreprises privées formelles et 0,7% en faveur des organismes
internationaux et la société civile (ONG et associations). Le personnel de maison représente
une proportion de 12,5% de l'emploi au Mali, dont 3,3% à Bamako mais 8% des femmes dans
 |
65 65 |
▲back to top |
52
le District contre 0,5% des hommes de Bamako. Les entreprises privées formelles sont aussi
remarquables en milieu urbain, principalement dans les autres villes urbaines que dans la zone
rurale. Dans ce milieu, le secteur public y est aussi le plus concentré, avec 7,5% des emplois à
Bamako ; 7,8% dans les autres villes urbaines contre 2,2% en milieu rural.
Tableau 45: Répartition des actifs occupés par milieu et par sexe selon le secteur institutionnel
Milieu et sexe
Secteur
public
Entreprise
privée
formelle
Entreprise
privée
informelle
ONG,
Organisations
internationales,
association
Personnel de
maison
Total
Urbain
Homme 9 1,9 84,5 1,6 3 100
Femme 5,3 0,3 84,7 0,9 8,8 100
Total 7,7 1,3 84,6 1,4 5,1 100
Bamako
Homme 8,4 1,7 87,8 1,5 0,5 100
Femme 6,1 0,5 84,8 0,6 8 100
Total 7,5 1,2 86,7 1,2 3,3 100
Autre
urbain
Homme 9,6 2 81,1 1,7 5,6 100
Femme 4,4 0,1 84,5 1,3 9,6 100
Total 7,8 1,4 82,3 1,6 7 100
Rural
Homme 3 0,5 80,7 0,6 15,1 100
Femme 1,1 0 84,7 0,4 13,7 100
Total 2,2 0,3 82,4 0,5 14,5 100
Emploi
Homme 4,4 0,8 81,6 0,9 12,2 100
Femme 1,9 0,1 84,7 0,5 12,8 100
Total 3,4 0,5 82,9 0,7 12,5 100
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
4.1.4. Chômage
Le chômage est la situation d’une personne en âge de travailler qui, n’est pas en emploi, a
effectué des activités de recherche d’emploi durant une période récente spécifiée, et est
disponible pour l’emploi si la possibilité d’occuper un poste de travail existe. Il est un
phénomène très préoccupant dans tous les pays. Les causes du chômage sont multiples et
varient d’un pays à un autre. Dans la plupart des pays en développement, le chômage
s’expliquerait par la forte croissance démographique et l’incapacité de l’économie à créer plus
d’emplois. Du point de vue économique, le chômage est interprété comme la résultante d'un
déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Le taux de chômage de la
population de 15 ans et plus est estimé à 6,1% en 2022 contre 7,8% en 2021. Cette baisse
pourrait s’expliquer par le fait que la collecte de 2022 s’est réalisée au quatrième trimestre de
l’année où la plupart des emplois dominants (emplois agricoles) sont en activités. Une fois de
plus de 2013 à 2022, comme toujours le taux est plus élevé en milieu urbain que rural, plus
élevé aussi pour les femmes que pour les hommes. Les écarts vont de 5,8 points de pourcentage
entre les hommes et les femmes en 2021 à 0,2 points de pourcentage en 2022 et entre les urbains
et les ruraux de 2,1 points de pourcentage en 2013 à 4,7 points de pourcentage en 2022. Le taux
de chômage a augmenté progressivement entre 2013 et 2016 et inversement jusqu’en 2020, puis
 |
66 66 |
▲back to top |
53
a connu une décroissance de 2021 à 2022. Pendant les mêmes périodes, cette observation est
identique en milieu rural et chez les hommes.
Tableau 46: Evolution du taux combiné du chômage et de la main d’œuvre potentielle de 2014 à
2022
Sexe et milieu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Homme 7,3 8,1 8,4 7,7 7,6 5,0 4,7 5,4 4,6
Femme 9,3 10,8 11,4 10,2 9,2 6,6 6,1 11,2 8,1
Urbain 11,9 11,7 12,1 12,0 12,0 10,2 10,6 11,6 10,5
Rural 7,1 8,7 9,0 7,9 7,0 4,2 3,7 6,9 6,9
Total 8,2 9,4 9,7 8,8 8,3 5,7 5,3 7,8 6,1
Source : ONEF, à partir des données EMOP
4.1.5. Sous-emploi lié à la durée du travail
Le sous-emploi comprend les personnes actives occupées au sens du BIT qui remplissent l'une
des conditions suivantes : Elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et
sont disponibles pour le faire, qu'elles recherchent activement un emploi ou non. Elles
travaillent à temps partiel (et sont dans une situation autre que celle décrite ci-dessus) ou à
temps complet, mais ont travaillé moins que d'habitude pendant une semaine de référence en
raison de chômage partiel (chômage technique) ou mauvais temps. Le taux de sous-emploi
représente la part dans l'emploi des personnes qui ont travaillé moins que ce qu'elles auraient
souhaité. Le taux de sous-emploi de la main-d'œuvre en emploi est de 17,9%, et les femmes
sont plus touchées que les hommes, avec 23,9% des femmes en emploi contre 13,5% chez les
hommes. Il est plus important en milieu urbain (22,2%) surtout à Bamako (21,3%), avec
respectivement 35,9% et 36,1% pour les femmes. Le taux de sous-emploi reste élevé, voire très
élevé à Ménaka (51,4% avec 58,3% pour les femmes). Le taux de sous-emploi de Ménaka est
suivi de ceux de Kidal et de Gao avec respectivement 44,0% et 36,3%. A contrario, les taux
sont relativement bas à Tombouctou (7,4%) et Sikasso (8,6%). Cette fois-ci, quel que soit la
région, le taux de sous-emplois des femmes est plus élevé que celui des hommes. Le sous-
emploi réparti dans les différentes tranches d'âge est plus important au niveau des personnes
âgées de 15-24 ans, de la tranche des 25-35 ans avec des taux respectifs de 22,5% et 20,8%,
contre une moyenne de 17%. Quel que soit le groupe d'âge, les taux sont plus accentués chez
les femmes que chez les hommes, à des écarts très importants qui vont des 10,9 points de
pourcentage à 15,8 points. A partir de 15-24 ans, jusqu’à 41-64 ans, le taux de sous-emploi des
femmes descend de tranche en tranche d’âge, tandis que les plus faibles taux des hommes
s’observent dans les tranches d’âge de 41 – 64 ans, chez les plus de 64 ans, et enfin chez les 36
– 40 ans avec respectivement 9,7%, 11,8% et 14,4%. Cette fois ci, le taux de sous-emploi a
augmenté au fur et à mesure que le niveau d’éducation augmente jusqu’au niveau secondaire,
avant de chuter au niveau supérieur. Chez les femmes, le taux est plus élevé chez les actifs
ayant le niveau secondaire (48,0%), que celles ayant les niveaux supérieur (41,7%) et
fondamental (37,5%). La main d’œuvre en emploi pour ceux qui sont d’aucun niveau est moins
sous-employée que les autres catégories par contre. Le taux de sous-emploi des femmes de
niveau secondaire (48,0%) est plus élevé que chez les actifs occupés de niveau supérieur
 |
67 67 |
▲back to top |
54
(41,7%). Ce sont chez les hommes que le plus fort taux de sous-emploi s’observe au niveau
secondaire (22,3%).
Tableau 47: Taux de sous-emploi (en %)
Homme Femme Total
Zone de résidence
Urbain 13,2 35,9 22,2
Bamako 11,3 36,1 21,3
Autre urbain 15,3 35,7 23,1
Rural 13,6 20,7 16,6
Région
Kayes 7,9 31,6 19,6
Koulikoro 20,7 49,6 28,8
Sikasso 6,8 10,3 8,6
Ségou 18,7 19,9 19,2
Mopti 11,4 21,4 15,5
Tombouctou 2,9 12,5 7,4
Gao 30,0 70,2 36,3
Kidal 36,9 75,3 44,0
Taoudenni 9,9 42,9 11,1
Ménaka 49,9 58,3 51,4
Bamako 11,3 36,1 21,3
Classe d'âge de travail
15 - 24 ans 16,0 30,1 22,5
25 - 35 ans 16,2 25,5 20,8
36 - 40 ans 14,4 21,8 17,5
41 - 64 ans 9,7 17,6 12,5
Plus de 64 ans 11,8 21,7 14,5
Education
Aucun 11,7 18,2 14,7
Primaire 14,3 37,5 22,8
Secondaire 22,3 48,0 30,1
Supérieur 20,4 41,7 25,9
Total 13,5% 23,9 17,9
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
4.1.6. Inactivité
Les inactifs sont des individus ayant l’âge de travailler, mais qui n’étaient ni en emploi, ni au
chômage. Les principales raisons d'inactivité sont les activités ménagères (femmes au foyer)
pour 17,9% des raisons, la scolarité (47,2%), qui constituent plus de sept dixième des inactifs.
La retraite et l’invalidité représentent respectivement 4,8% et 5,8% des inactifs du Mali. La
scolarité est le principal motif d'inactivité chez les hommes (58,3%), en raison de la plus forte
et plus longue scolarisation des garçons comparativement aux filles. Il en est de même pour le
milieu urbain (63,2% dont 67,4% pour Bamako) par rapport à celui rural. Ainsi la scolarisation
reste au Mali un phénomène urbain et masculin. Les femmes sont principalement au foyer
(30,7%). Dans les régions de Kidal (32,5%), Ménaka (30,5%) et Taoudenni (26,4%) un peu
moins d’un tiers des inactifs sont des femmes au foyer. Cette proportion est moins importante
à Sikasso (7,6%) et Kayes (11,3%). Les inactifs de 25-40 ans sont majoritairement des femmes
au foyer. Ainsi, 95,7% des femmes inactifs de 36-40 ans sont des femmes au foyer et 90,9% de
la tranche 25-35 ans le sont également. La femme au foyer est majoritairement analphabète
(26,5%). Par ailleurs, la majorité des inactifs de niveau fondamental et plus sont en cours de
scolarité/étudiant (86,0%) pour le niveau fondamental, (76,7%) pour le secondaire et (74,6%)
pour le niveau supérieur).
 |
68 68 |
▲back to top |
55
Tableau 48: Répartition en % des inactifs par raison d'inactivité
Invalide ou en
maladie de
longue durée
En cours
de
scolarité,
étudiant
Retraité
/
vieillard
Gros-
sesse
Femme
au
foyer
Rentier Autres Total
Sexe de
l'individu
Homme 7,1 58,3 4,9 0,0 0,0 0,1 29,6 100
Femme 4,9 39,2 4,7 0,2 30,7 0,0 20,3 100
Total 5,8 47,2 4,8 0,1 17,9 0,1 24,2 100
Zone de
résidence
Urbain 3,2 63,2 4,8 0,1 17,9 0,1 10,6 100
Bamako 2,5 67,4 5,4 0,1 17,3 0,1 7,3 100
Autre urbain 3,9 59,2 4,4 0,1 18,4 0,2 13,9 100
Rural 6,7 41,6 4,8 0,1 17,9 0,1 28,9 100
Région
Kayes 3,9 56,4 5,8 0,4 11,3 0,2 22,0 100
Koulikoro 1,6 43,6 4,7 0,0 25,1 0,0 24,9 100
Sikasso 3,6 54,4 5,5 0,2 7,6 0,0 28,6 100
Ségou 18,9 36,9 2,9 0,1 22,6 0,2 18,5 100
Mopti 1,3 37,8 6,2 0,0 15,6 0,0 39,1 100
Tombouctou 12,1 42,9 1,2 0,1 14,1 0,0 29,5 100
Gao 5,7 38,7 2,8 0,0 30,0 0,2 22,6 100
Kidal 0,6 25,1 2,6 0,1 32,5 0,2 39,0 100
Taoudenni 4,0 28,2 2,0 0,0 26,4 0,0 39,4 100
Ménaka 28,3 12,0 4,2 0,0 30,5 0,1 24,9 100
Bamako 2,5 67,4 5,4 0,1 17,3 0,1 7,3 100
Classe
d'âge de
travail
15 - 24 ans 1,7 54,8 0,0 0,5 28,2 0,2 14,6 100
25 - 35 ans 2,0 4,6 0,0 0,1 90,9 0,0 2,3 100
36 - 40 ans 2,5 1,3 0,0 0,4 95,7 0,0 0,0 100
41 - 64 ans 10,9 1,0 18,1 0,0 51,9 0,4 17,8 100
Plus de 64
ans
19,1 1,4 70,1 0,1 3,7 0,2 5,4 100
Education
Aucun 10,0 10,4 7,8 0,1 26,5 0,1 45,1 100
Primaire 1,7 86,0 1,0 0,1 8,2 0,1 3,0 100
Secondaire 1,1 76,7 5,6 0,2 15,3 0,1 1,0 100
Supérieur 0,4 74,6 9,5 0,0 13,5 0,0 1,9 100
Total 5,8 47,2 4,8 0,1 17,9 0,1 24,2 100
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
Les Aides (famille, fils/filles, amis, voisin) permettent à (98,3%) des inactifs de subvenir
principalement à leurs besoins. Ils sont suivis de loin par les pensions du travail ou autres
pensions (veuvage, divorce, orphelinat) pour 1,1% des inactifs et marginalement l'épargne, la
bourse, la rente ou la mendicité (0,6% pour ces 4 moyens réunis). L'aide joue relativement plus
favorable chez les femmes que chez les hommes (98,7% contre 97,6%). Comparativement aux
femmes, les hommes dépendent un peu plus de la pension (1,6%) et d'épargne (0,3%). Une fois
de plus les inactifs de niveau supérieur ont un peu moins besoin des aides (80,3% contre 98,3%
en moyenne nationale), mais utilisent plus les pensions pour subvenir à leur besoin (8,3% pour
1,1% pour la moyenne nationale. A Kidal, les inactifs utilisent quasiment les aides (98,3%) et
 |
69 69 |
▲back to top |
56
les pensions pour survivre (1,5%). Par groupe d’âge, la mendicité concerne les inactifs de 36 à
64 ans. La bourse est le revenu des étudiants de niveau supérieur.
Tableau 49: Répartition en % des inactifs selon les moyens utilisés pour survivre
Pension
de travail
Autre
pension
Aide Rente Epargne Mendicité Bourse Total
Sexe de
l'individu
Homme 1,0 0,6 97,6 0,2 0,3 0,0 0,2 100
Femme 0,2 0,5 98,7 0,2 0,2 0,0 0,2 100
Total 0,5 0,6 98,3 0,2 0,2 0,0 0,2 100
Zone de
résidence
Urbain 1,1 1,0 96,8 0,4 0,3 0,1 0,4 100
Bamako 1,4 1,2 95,9 0,5 0,4 0,1 0,6 100
Autre urbain 0,9 0,8 97,8 0,3 0,2 0,0 0,1 100
Rural 0,3 0,4 98,8 0,2 0,2 0,0 0,1 100
Région
Kayes 0,3 1,0 98,2 0,0 0,3 0,0 0,1 100
Koulikoro 0,6 0,6 98,5 0,1 0,0 0,0 0,2 100
Sikasso 0,3 0,2 99,4 0,0 0,0 0,0 0,1 100
Ségou 0,5 0,3 98,9 0,1 0,2 0,0 0,0 100
Mopti 0,2 0,2 99,2 0,2 0,0 0,0 0,2 100
Tombouctou 0,6 0,2 96,4 2,7 0,0 0,0 0,0 100
Gao 0,1 1,0 94,5 0,1 4,1 0,0 0,1 100
Kidal 0,2 1,3 98,3 0,0 0,1 0,0 0,1 100
Taoudenni 0,0 2,5 97,3 0,0 0,0 0,2 0,0 100
Ménaka 0,2 0,8 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Bamako 1,4 1,2 95,9 0,5 0,4 0,1 0,6 100
Classe
d'âge de
travail
15 - 24 ans 0,0 0,5 98,5 0,0 0,2 0,0 0,7 100
25 - 35 ans 0,0 0,5 99,2 0,1 0,1 0,0 0,1 100
36 - 40 ans 0,4 0,4 98,4 0,0 0,6 0,1 0,1 100
41 - 64 ans 1,9 0,9 94,5 0,8 1,6 0,3 0,1 100
Plus de 64
ans
6,8 1,9 87,5 2,7 0,9 0,0 0,1 100
Education
Aucun 0,3 0,4 98,5 0,3 0,3 0,0 0,1 100
Primaire 0,3 0,7 98,9 0,1 0,0 0,0 0,0 100
Secondaire 3,6 0,8 94,6 0,4 0,5 0,0 0,2 100
Supérieur 6,8 1,5 80,3 0,1 1,5 0,0 9,7 100
Total 0,5 0,6 98,3 0,2 0,2 0,0 0,2 100
Source : ONEF, à partir des données EMOP 2022
4.2. Intermédiation
L’objet de l’intermédiation est de favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande
d’emploi par la mise en place d’un mécanisme adéquat d’accompagnement, d’orientation et de
conseil des demandeurs d’emploi et des entreprises. Son domaine couvre également toutes les
actions visant à renforcer l’employabilité des demandeurs d’emploi ainsi que la prospection
auprès des entreprises pour recueillir leurs besoins en personnel et en formation. Selon l’Article
6 de la C088 de l’OIT14, le service de l'emploi doit être organisé de manière à assurer
l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs. A cette fin, il doit, entre autres,
aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des
 |
70 70 |
▲back to top |
57
travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises; plus particulièrement, il doit,
conformément aux règles formulées sur le plan national : i) enregistrer les demandeurs
d'emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur expérience et de leurs
goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques
et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu'il y a lieu, une orientation, une formation ou
une réadaptation professionnelles ; 14 Convention (n° 88) concernant l'organisation du service
de l'emploi (Adoption: San Francisco, 31ème session CIT (09 juil. 1948) et entrée en vigueur:
10 août 1950) ; Ratifiée par le Mali le 12 avril 2016. 61 ii) obtenir des employeurs des
informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur les conditions
que doivent remplir les travailleurs qu'ils recherchent pour occuper ces emplois ; iii) diriger
vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques
requises ; iv) organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un
autre, lorsque le bureau consulté en premier lieu n'est pas en mesure de placer convenablement
les candidats ou de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d'autres
circonstances le justifient. Au Mali, cette mission est le cœur de métier de l’Agence Nationale
Pour l’Emploi (ANPE), le Service d’Emploi Public et les Bureaux de Placement Payant et les
Entreprises de Travail Temporaires (BPP/ETT). L’ANPE et les BPP/ETT travaillent en
synergie dans la mise en œuvre des activités d’intermédiation et utilisent les concepts et
méthodologies partagés pour l’enregistrement des demandes et offres d’emplois et les
placements effectués. La présente partie traite les données relatives aux demandes et offres
d’emploi enregistrées ainsi les placements effectués au cours de l’année 2022 par l’ANPE
(Bureau de placement public) et par les BPP/ETT (Bureaux de placement privés).
4.2.1. Demandes d’emplois
Généralement une demande d’emploi est une lettre manuscrite de demande d’emploi adressée
à une structure pour l’obtention d’un emploi d’où l’expression de mettre sa force de travail à la
disposition d’un futur employeur. Elle se manifeste au niveau des bureaux de placement public
et privés par une inscription sur leur registre de demande d’emploi. Les demandeurs d’emploi
ou chercheurs d’emploi sont l’ensemble des personnes qui ont pris sur une période donnée, des
dispositions spécifiques pour chercher un emploi salarié ou non. Ce sont l’ensemble des
chômeurs et des travailleurs à la recherche d’un autre emploi. Ces personnes sont de deux (2)
types : - le premier type est celui des personnes ayant déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi,
et qui de ce fait recherchent un nouvel emploi ; - le second type est celui des personnes qui
n’ont jamais travaillé et qui sont à la recherche d’un premier emploi : ce sont des demandeurs
de premier emploi ou des chômeurs de première insertion ou des primo demandeurs. En 2022,
4673 demandes d’emplois ont été enregistrées contre 3 998 en 2021 soit une augmentation de
16,8%. On constate que malgré les dispositions du Code du Travail qui en son Article 350
stipule, entre autres, que les bureaux de placement payant sont tenus de communiquer à l’Office
National de la Main-d’œuvre et de l’Emploi (ONMOE, actuelle ANPE) les informations
relatives aux placements effectués, et ainsi qu’un exemplaire de déclaration d’ouverture
d’établissement ou de chantier. Le refus de communiquer à l’ONMOE les informations
contenues dans le présent article est puni des peines sanctionnant le refus de répondre aux
enquêtes statistiques ; les BBP / ETT ; seules les données de l’ANPE ont été centralisées pour
 |
71 71 |
▲back to top |
58
les demandes d’emplois. Cela malgré la mise à disposition d’outils d’enregistrement des
demandes d’emploi à travers le Registre Officiel des Demandes et offres d’Emplois (RODE).
Les bureaux ne transmettent pas régulièrement les données à leur niveau, et l’ANPE qui doit
les centraliser pour les transmettre à l’ONEF aux fins d’analyse, n’organise plus d’opérations
de collecte semestrielles auprès des BPP/ETT pour la remontée des statistiques. Il faut noter
également une insuffisance de ressources humaines aux niveaux des BPP/ETT et la pratique
actuelle de certains Bureaux Privés de Placement et les Entreprises de Travaux Temporaires
(BPP/ETT) qui consiste à ne pas avoir une base de données globale pour l’ensemble des
demandeurs d’emplois enregistrés mais uniquement une base de données pour les candidats à
une offre spécifique donnée. Les demandeurs d’emploi sont majoritairement des hommes
71,4% contre 28,6% de femmes. Les régions de Bamako et de Kayes ont enregistré le plus de
demandes d’emploi. Presqu’un tiers des demandes d’emplois est enregistré à Bamako (31,2%).
Cette fois-ci un peu moins d’un chercheur d’emploi sur deux n’a pas 30 ans (47,6% ou ont un
âge inférieur à 30 ans). Cette jeunesse est plus marquée chez les filles que chez les garçons
(49% des filles non pas 30 ans contre 47% des garçons). Les niveaux d’instruction les plus
dominants sont « Non spécifié » 23,9 ; « Secondaire Technique et Professionnelle » 21,8 ; «
DEUG / DUT / Licence », 16,2%.
 |
72 72 |
▲back to top |
59
Tableau 50: Demandes d’emploi enregistrées par caractéristique sociodémographique
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Structure de
placement
ANPE 3 338 71,4 1 335 28,6 4 673 100,0
BPP/ETT - - - -
Situation du
demandeur
Occupé 151 68,6 69 31,4 220 4,7
Chômeur 2 416 72,4 922 27,6 3 338 71,4
Non spécifié 771 69,1 344 30,9 1 115 23,9
Région
Kayes 740 73,8 263 26,2 1 003 21,5
Koulikoro 173 61,1 110 38,9 283 6,1
Sikasso 333 69,1 149 30,9 482 10,3
Ségou 198 72,3 76 27,7 274 5,9
Mopti 230 63,7 131 36,3 361 7,7
Tombouctou 178 77,1 53 22,9 231 4,9
Gao 196 85,2 34 14,8 230 4,9
Kidal 85 54,5 71 45,5 156 3,3
Taoudéni 24 61,5 15 38,5 39 0,8
Ménaka 109 69,9 47 30,1 156 3,3
Bamako 1 072 73,5 386 26,5 1 458 31,2
Classe d'âge
Moins de 20 ans 49 60,5 32 39,5 81 1,7
20 à 24 ans 723 69,1 323 30,9 1 046 22,4
25 à 29 ans 796 72,6 300 27,4 1 096 23,5
30 à 39 ans 792 72,4 302 27,6 1 094 23,4
40 à 59 ans 206 85,8 34 14,2 240 5,1
60 ans et plus 1 100,0 - 0,0 1 0,0
Non spécifié 771 69,1 344 30,9 1 115 23,9
Niveau
d'éducation
Aucun niveau 82 84,5 15 15,5 97 2,1
Alphabétisé 465 82,9 96 17,1 561 12,0
1er Cycle fondamental 320 86,5 50 13,5 370 7,9
2ème Cycle fondamental 138 68,7 63 31,3 201 4,3
Secondaire Général 137 71,4 55 28,6 192 4,1
Secondaire Technique et
Professionnelle
710 69,6 310 30,4 1 020 21,8
DEUG/DUT/Licence 460 60,8 296 39,2 756 16,2
Maîtrise et plus 255 70,6 106 29,4 361 7,7
Non spécifié 771 69,1 344 30,9 1115 23,9
Total 3 338 71,4 1 335 28,6 4 673 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ANPE
Les 44,2% des demandeurs d’emploi ont une qualification (39% de cadres et agents de maîtrise
et 5,2% d’ouvriers et d’emplois qualifiés). Les métiers les plus recherchés sont : « Activités
d’administration publique », 26,9 % ; suivies de « Immobilier location et services aux
entreprises » 22,7%. Les métiers les moins recherchés sont entre autres : - Extraction et
traitement de minéraux ; activités des ménages - Production et distribution d’électricité de gaz
et d’eau ; les activités financières - Activités à caractère collectif ou personnel ; - Pêche
Pisciculture et aquaculture ; - Hôtels restauration et tourisme. Ces métiers ont été identifiés dans
l’EODEL15 comme des filières porteuses d’emplois et de revenus. Mais moins de 1,5% des
demandeurs d’emploi recherche ces métiers. En somme, pour améliorer la situation actuelle, il
serait nécessaire de mettre un accent particulier sur le développement et la mise en œuvre des
actions d’information et de sensibilisation à l’emploi. Ces initiatives doivent être multipliées à
 |
73 73 |
▲back to top |
60
l’endroit des étudiants et des chercheurs d’emplois pour mieux les orienter sur le marché de
l’emploi et de la formation professionnelle
Tableau 51: Demandes d’emploi enregistrées par qualification et métier demandé
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Qualification
Cadres supérieurs 627 64,7 342 35,3 969 20,7
Cadres moyens et agents de
maîtrise 540 63,1 316 36,9 856 18,3
Ouvriers qualifiés 127 70,9 52 29,1 179 3,8
Ouvriers spécialisés 458 81,2 106 18,8 564 12,1
Employés qualifiés 65 97,0 2 3,0 67 1,4
Employés spécialisés 5 38,5 8 61,5 13 0,3
Manœuvres et assimilés 745 81,9 165 18,1 910 19,5
Non spécifié 771 69,1 344 30,9 1 115 23,9
Métier
recherché
Agriculture, Chasse et
Sylviculture 93 80,2 23 19,8 116 2,5
Extraction et traitement de
minéraux 1 100,0 0 0,0 1 0,0
Pêche, Pisciculture et
aquaculture 13 86,7 2 13,3 15 0,3
Activités de Fabrication 132 91,7 12 8,3 144 3,1
Production et distribution
d’électricité, de gaz et d’eau - - - - - -
Bâtiments, Travaux Publics 159 88,3 21 11,7 180 3,9
Commerce, Vente et location 36 54,5 30 45,5 66 1,4
Hôtels, restauration et
tourisme 14 34,1 27 65,9 41 0,9
Transports, activités des
auxiliaires de transport et
communications 327 95,3 16 4,7 343 7,3
Activités financières 7 36,8 12 63,2 19 0,4
Immobilier, location et
services aux entreprises 822 77,5 239 22,5 1 061 22,7
Activités d’administration
publique 774 61,7 481 38,3 1 255 26,9
Education – Formation 123 66,8 61 33,2 184 3,9
Santé et action sociale 50 48,1 54 51,9 104 2,2
Activités à caractère collectif
ou personnel 16 59,3 11 40,7 27 0,6
Activité des ménages - 0,0 2 100,0 2 0,0
Non spécifié 771 69,1 344 30,9 1 115 23,9
Total 3 338 71,4 1335 28,6 4 673 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ANPE
4.2.2. Offres d’emplois
C’est une demande de travail émanant des entreprises, des services et des personnes. L’offre
d’emploi, c’est l’action de proposer un contrat, un service ou un marché à une personne en
situation de recherche d’emploi. L’offre d’emploi des entreprises et services est généralement
fonction de critères de la Catégorie Socioprofessionnelle (CSP) ou de Qualification, de la
spécialité ou du profil, de l’expérience, du diplôme souhaité, etc. Une offre est égale à un poste
 |
74 74 |
▲back to top |
61
de travail. Les postes proposés aux candidats à l’embauche sont soit des emplois nouveaux soit
des emplois de remplacement. En 2022, les bureaux de placement public et privés ont enregistré
1434 offres d’emplois contre 3676 soit une diminution de 60,9%. Cette fois ci, seul l’ANPE a
enregistré 1434 offres d’emplois soit la totalité des offres d’emplois enregistrée. Ainsi tous les
emplois enregistrés fournissent une précision sur le « Type d’emploi offert », ainsi que sur la «
Durée de l’emploi offert ». 99,7% des offres enregistrées et spécifiés sous de nouveaux postes
de travail contre 0,3% de remplacement. Un peu plus d’un quart (1/4) des offres soit 25,2% ont
été enregistrées à Ségou ; et 24,1% dans le District de Bamako.
Tableau 52: Offres d’emploi enregistrées par Bureaux caractéristique sociodémographique
Effectif %
Structure de placement
Offres de l’ANPE 1 434 100,0
Offres des BPP et ETT - -
Type d'emploi offert
Nouveau poste 1 430 99,7
Remplacement 4 0,3
Durée de l'emploi offert
Moins de 3 mois 479 33,4
3 à 6 mois 37 2,6
6 à 12 mois 434 30,3
12 à 24 mois 141 9,8
Plus de 24 mois 343 23,9
Région
Kayes 84 5,9
Koulikoro 49 3,4
Sikasso 244 17,0
Ségou 362 25,2
Mopti 66 4,6
Tombouctou 75 5,2
Gao 40 2,8
Kidal 49 3,4
Taoudenni 40 2,8
Ménaka 79 5,5
Bamako 346 24,1
Total 1 434 100,0%
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ANPE
Nous constatons que cette fois-ci à la lumière de l’interprétation du tableau 50 concernant les
offres d’emploi enregistrés par qualification et métier offert, toutes les offres fournissent des
précisions et des qualifications du poste, sur le domaine du métier.
 |
75 75 |
▲back to top |
62
Tableau 53: Offres d’emploi enregistrées par qualification et métier offert
Effectif %
Qualification
Cadre supérieur 467 32,6
Cadre moyen (Technicien et agent de maîtrise) 357 24,9
Ouvriers qualifiés 114 7,9
Employés qualifiés 288 20,1
Ouvriers spécialisés (ou non qualifiés) 3 0,2
Employés spécialisés (ou non qualifiés) - 0,0
Manœuvres et assimilés 205 14,3
Métiers
Agriculture, Chasse et Sylviculture 99 6,9
Pêche, Pisciculture et aquaculture - 0,0
Extraction et traitement de minéraux 2 0,1
Activités de Fabrication 25 1,7
Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 2 0,1
Construction de Bâtiments, génie civil 44 3,1
Commerce, Vente et location 21 1,5
Hôtels et restaurants 1 0,1
Transports, activités des auxiliaires de transport et
communications
14 1,0
Activités financières 1 0,1
Immobilier, location et services aux entreprises 229 16,0
Activités d’administration publique 610 42,5
Education – Formation 77 5,4
Santé et action sociale 288 20,1
Activités à caractère collectif ou personnel 21 1,5
Activité des ménages - 0,0
Total 1 434 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ANPE
4.2.3. Placements
Selon le Bureau international du Travail (BIT), les offices de main d’œuvre créés par l’Etat,
étaient les seuls intermédiaires entre les demandeurs d’emploi et les employeurs potentiels. Le
nouveau Code du travail a levé le monopole de placement à l’Etat. L’Office National de la
Main-d’œuvre et de l’Emploi (ONMOE) a été restructuré en 2001 en Agence Nationale Pour
l’Emploi (ANPE). Des Bureaux de Placement Privés (BPP) et des Entreprises de Travail
Temporaires (ETT) ont été autorisés à exercer sur le marché du travail, aux côtés des services
publics d’emplois. Selon l’Article 11 de la C088 de l’OIT18 qui stipule que : les autorités
compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace
entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives ;
l’ANPE a établi un partenariat étroit avec les BPP/ETT à travers un Protocole avec le
CONABEM (Conseil National des Bureaux de Placement Payant et Entreprises de travail
Temporaire) en 2014. Ce Protocole a pour objet de définir les axes de partenariat possible entre
l’ANPE et le CONABEM dans leurs actions de mise en œuvre de la Politique Nationale de
l’Emploi. Spécifiquement, il s’applique, entre autres, aux domaines suivants : - Activités
d’intermédiation ; - Collecte et transmission des données ; - Formation et perfectionnement ; -
Accompagnement ; - Renforcement de capacités ; - Etudes et recherches ; - Information,
sensibilisation et communication. Le Comité de Suivi mis en place dans le cadre de ce protocole
ne fonctionne pas selon les normes statutaires. Les transmissions des données relatives aux
 |
76 76 |
▲back to top |
63
demandes et offres d’emplois et les placements effectués sont timides souvent inexistantes
malgré les dispositions législatives qui obligent les BPP à transmettre les statistiques sur les
demandes et offres d’emplois et les placements effectués à l’ANPE. C’est pourquoi les données
traitées dans cette partie sont uniquement celles issues des activités de l’ANPE. Il y a lieu de
dynamiser le partenariat entre le Service d’Emploi Public (ANPE) et les BPP/ETT
(CONABEM).
Tableau 54: Placements effectués par sexe selon la structure de placement et la qualification
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Structure de
placement
ANPE 1 479 100,0 435 100,0 1 914 100,0
BPP/ETT - - - - - -
Qualification
Cadre supérieur 224 15,1 95 21,8 319 16,7
Cadre moyen 301 20,4 135 31,0 436 22,8
Ouvriers qualifiés 56 3,8 18 4,1 74 3,9
Employés qualifiés 70 4,7 24 5,5 94 4,9
Ouvriers spécialisés 2 0,1 - 0,0 2 0,1
Employés spécialisés 3 0,2 2 0,5 5 0,3
Manœuvres et assimilés 95 6,4 7 1,6 102 5,3
Non spécifié 728 49,2 154 35,4 882 46,1
Total 1 479 100,0 435 100,0 1 914 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ANPE
En 2022, les bureaux de placement public et privés ont effectué 1914 placements contre 2497
en 2021 soit une diminution de 23,3%. La non satisfaction globale des offres enregistrées est
de 23,3% en 2022 contre 67,9% en 2021. Les placements effectués par l’ANPE en 2022 sont
au nombre de 1914 dont 77,2% d’hommes et 22,8% de femmes. La majorité des placements
effectués n’ont pas fourni de précision sur les caractéristiques du poste occupé. Il s’agit du
domaine du métier, la qualification et le niveau d’instruction du placé. Cela est consécutif à la
qualité de l’enregistrement des offres d’emplois reçues par les bureaux de placement. 46,1%
des placements effectués ne fournissent pas de précisions sur les caractéristiques du poste
occupé. L’analyse est portée sur les données spécifiées. Seulement cinq (5) domaines de métiers
regroupent près de 54% des placements effectués spécifiés. Il s’agit de « Activités
d’administration publique », 24,2% ; « Construction de Bâtiments génie civil », 6,7% ; «
Immobilier location et services aux entreprises » 5,6% ; « Agriculture, chasse et sylviculture »
5,1 ; « Education-formation », 4,0%.
Le tableau 52 nous renseigne que 1914 placements ont été effectués en 2022 dont 77,2% des
personnes placées étaient des hommes. Plus de sept (7) sur dix (10) soit 46,1% des placements
effectués par les bureaux de placement public et privés n’ont pas renseigné les caractéristiques
sur la qualification et le niveau d’éducation. Parmi les placements effectués par les bureaux et
dont la qualification est spécifiée, les cadres supérieurs et les manœuvres et assimilés dépassent
chacun le cinquième. Les employés spécialisés (ou non qualifiés) et qualifiés représentaient des
faibles pourcentages des personnes placées. Pour le niveau d’éducation hormis les non
spécifiés, les personnes ayant les niveaux d’instruction secondaire technique professionnel et
 |
77 77 |
▲back to top |
64
aucun (néant) dépassaient chacun les quatre. Les personnes ayant seulement le permis de
conduire, des niveaux d’éducation du premier cycle ou du second cycle représentaient chacun
un faible pourcentage des placées.
Tableau 55: Placements effectués par sexe selon le métier
Métier
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Agriculture, Chasse et Sylviculture 87 5,9 11 2,5 98 5,1
Pêche, Pisciculture et aquaculture 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Extraction et traitement de minéraux 1 0,1 1 0,2 2 0,1
Activités de Fabrication 48 3,2 7 1,6 55 2,9
Production et distribution d’électricité, de
gaz et d’eau 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Construction de Bâtiments, génie civil 107 7,2 21 4,8 128 6,7
Commerce, Vente et location 22 1,5 18 4,1 40 2,1
Hôtels et restaurants 1 0,1 0 0,0 1 0,1
Transports, activités des auxiliaires de
transport et communications 16 1,1 5 1,1 21 1,1
Activités financières 0 0,0 2 0,5 2 0,1
Immobilier, location et services aux
entreprises 71 4,8 37 8,5 108 5,6
Activités d’administration publique 322 21,8 142 32,6 464 24,2
Education – Formation 59 4,0 18 4,1 77 4,0
Santé et action sociale 15 1,0 18 4,1 33 1,7
Activités à caractère collectif ou
personnel 2 0,1 1 0,2 3 0,2
Activité des ménages 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Non spécifié 728 49,2 154 35,4 882 46,1
Total 1 479 100,0 435 100,0 1 914 100,0
Près que (1/3) des placements sont effectués à Sikasso (32,5%) ou à Ségou (17,2%). La
performance de Sikasso est consécutive aux efforts de prospection de la part des acteurs chargés
de l’intermédiation au niveau local. Il s’agit de la Direction régionale de l’ANPE et des
BPP/ETT.
Graphique 4: Placements effectués par région
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ANPE
0
48
48
80
119
122
150
170
224
330
623
0 100 200 300 400 500 600 700
Taoudéni
Kidal
Ménaka
Gao
Mopti
Tombouctou
Koulikoro
Bamako
Sikasso
Ségou
Kayes
 |
78 78 |
▲back to top |
65
4.3. Créations d’emplois et employabilité
Bien que le taux d’emploi soit accepté comme l'une des principales variables
macroéconomiques et couramment utilisé pour examiner la performance de l'économie, il peut
refléter avec exactitude l'état de santé du marché du travail. Il est la proportion de personnes
disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler. Le taux d'emploi reflète la capacité
d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'œuvre.
Cette partie s’intéresse aux informations sur les créations d’emplois, le dispositif de formation
et de qualification, le programme de formation professionnelle, la situation des demandes de
formation et la situation de financement des projets.
La moyenne annuelle de l’évolution des emplois créés de 2019 à 2022 est de 43 926,3 mais
nous observons une diminution de plus de 9 000 emplois en 2020. Cette situation pourrait
s’expliquer par les crises politico-institutionnelles et la pandémie du COVID 19. Cette
pandémie a perturbé le monde du travail avec des conséquences massives sur l'emploi, les
revenus et la productivité. Elle a mis des milliers de travailleurs et d'entreprises dans une
situation d'extrême vulnérabilité. Bien que les effets négatifs des crises sur l'économie soient
réels, l’analyse des données sur les créations d’emplois révèle qu’après l’année 2020, beaucoup
de progrès ont été réalisés entre 2021 et 2022 (52 903 et 59 416 emplois créés) presque le
double de celle de l’année 2020. Il faut noter qu’en 2020, aucun enregistrement n’a été signalé
au compte des Projets, Programmes d’Investissement en infrastructures et des Projets,
Programmes, Agences d'insertion.
Sur un total de 61 719 emplois créés en 2022, 59 416 étaient des créations nettes et 2 303, des
pertes d’emplois. Ces créations nettes étaient réparties entre le secteur privé (30 368 emplois)
et le secteur public (31 351 emplois). En ce qui concerne les emplois générés par le secteur
public, 17 988 ont été générés par les Projets, Programmes, Agences d'insertion, 11 566 étaient
générés par la fonction Publique d’Etat et des Collectivités et des Forces Armées et de Sécurité
et 1 797 à travers par les Projets, Programmes d'investissement en infrastructure. Enfin, il faut
noter une déperdition de 2 303 emplois en 2022.
Tableau 56: Evolution des emplois créés de 2019 à 2022
Type d'emplois
2019 2020 2021 2022
Moyenne
annuelle
Emplois créés par le secteur privé 23 592 28 463 25 031 30 368 26 863,5
Emplois créés par le secteur public 14 867 1 736 30 564 31 351 19 630
Emplois permanents (recrutements fonctions
Etat, Collectivité, Forces armées et Sécurité)
6 314 1 736 3 524 11 566 5 785
Emplois générés par les Projets, Programmes
d'investissements en infrastructure 7 279 - 2 137 1 797 2 803
Auto-Emplois générés par les Projets,
Programmes, Agences d'insertion 1 274 - 24 903 17 988 11 041
Total emplois créés 38 459 30 199 55 595 61 719 46 493
Pertes d’emplois 2 337 2 935 2 692 2 303 2 566,8
Total création nette d’emplois 36 122 27 264 52 903 59 416 43 926,3
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les points focaux emploi, 2022
 |
79 79 |
▲back to top |
66
Toutefois, lorsque l'on évalue les 30 368 emplois créés par type de contrat en 2022 à travers le
secteur privé, la dominance revient aux Contrats à Durée Déterminée (CDD) qui est de 18 268
soit 60,1% contre 12 100 soit 39,9% d’emplois permanents comme Contrats à Durée
Indéterminée (CDI). Près de 8 créations d’emplois sur 10 dans le secteur privé sont au profit
des hommes, 78,1% d’hommes contre 21,9% de femmes.
Les branches d’activités les plus pourvoyeuses d’emplois dans le secteur privé sont : « Activités
pour la Santé Humaine et l’Action Sociale » (6 288 emplois) ; « Activités de Services de Soutien
et de Bureau » (5 575 emplois) ; « Activités Extractives » (3 867 emplois) ; « Activités des
Organisations Extraterritoriales » (2 678 emplois) et les « Activités d’Enseignement » (2 256
emplois). Ces cinq (5) branches en elles seules ont généré 20 634 emplois soient 67,9% des
emplois. A cela, d’autres activités sont moyennement représentées telles que les Autres
Activités de Services N.C.A (1 927 emplois) ; le commerce (1 720 emplois) ;) ; la Construction
(938) et les Activités d’Administration Publique (984 emplois). Apparemment, on sous-estime
l'ampleur réelle des défis que pose le marché du travail puisqu'un grand nombre de personnes
travaillent sous le contrat à durée déterminée (CDD).
Tableau 57: Répartition du nombre d’emplois créés par trimestre et par branche d’activités du
secteur privé
Trimestre
CDD CDI
Total
Homme Femme Total Homme Femme Total
Trimestre 1 4 674 1 280 5 954 3 396 883 4 279 10 233
Trimestre 2 3 758 739 4 497 2 120 731 2 851 7 348
Trimestre 3 2 728 741 3 469 1 832 536 2 368 5 837
Trimestre 4 3 220 1 128 4 348 2 018 584 2 602 6 950
Agriculture, Sylviculture, Pêche 320 74 394 94 20 114 508
Activités Extractives 2 026 111 2 137 1 657 43 1 700 3 837
Activités de Fabrication 540 25 565 271 27 298 863
Production et Distribution D’électricité et de Gaz 22 9 31 74 3 77 108
Production et Distribution d’Eau, Assainissement,
Traitement des Déchets et Dépollution
161 19 180 58 24 82 262
Construction 653 24 677 250 11 261 938
Commerce 625 280 905 613 202 815 1 720
Transports et Entreposage 216 27 243 216 32 248 491
Hébergement et Restauration 204 53 257 112 31 143 400
Information et Communication 108 36 144 173 39 212 356
Activités Financières et d’Assurance 346 157 503 183 89 272 775
Activités Immobilières 24 6 30 3 3 6 36
Activités Spécialisées, Scientifiques et Techniques 135 35 170 94 30 124 294
Activités de Services de Soutien et de Bureau 2 231 608 2 839 1 897 839 2 736 5 575
Activités d’Administration Publique 205 68 273 532 179 711 984
Enseignement 597 308 905 1 057 294 1 351 2 256
Activités pour la Santé Humaine et l’Action
Sociale
3 128 1 224 4 352 1 275 661 1 936 6 288
Activités Artistiques, Sportives et Récréatives 20 2 22 6 1 7 29
Autres Activités de Services N.C.A. 1 235 322 1 557 307 63 370 1 927
Activités Spéciales des Ménages 23 9 32 7 4 11 43
Activités des Organisations Extraterritoriales 1 561 491 2 052 487 139 626 2 678
Total 14 380 3 888 18 268 9 366 2 734 12 100 30 368
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les points focaux emploi, 2022
 |
80 80 |
▲back to top |
67
Sur les 31 351 emplois publics générés en 2022, 19 008 soit 60,6% étaient occupés par des
hommes contre 12 343 soit 39,4% par des femmes.
Suivant les 11 566 emplois générés à travers les recrutements dans les fonctions Publiques
d’Etat et des Collectivités et des Forces Armées et de Sécurité, 9 622 soit 83,2% étaient des
hommes contre 1 944 soit 16,8% de femmes. La proportion de ces hommes qui ont décroché
un emploi en 2022 est largement supérieure à leur moyenne d’ensemble (60,6%).
Sur un total de 1 797 emplois générés par les Projets, Programmes d’Investissement, 1 391 soit
77,4% étaient des hommes contre 406 soit 22,6% de femmes. Il faut noter que cette part des
hommes ayant eu un emploi dans ces Projets, Programmes d’Investissement est aussi
supérieure à la moyenne de leur ensemble.
Quant aux 17 988 emplois générés par les programmes et agences d’insertion notamment à
travers des activités de promotion de l’auto-emploi en 2022, 9 993 soit 55,6% étaient des
hommes contre 7 995 soit 44,4% de femmes. Cette-fois ci, ces emplois sont plus qu’envahis
par les femmes que par les hommes. Cela peut s’expliquer par l’application des lois basées sur
les femmes notamment la prise en compte des programmes mis en œuvre dans le cadre de
l’autonomisation des femmes en 2022. A noter que la part des femmes dans ces programmes et
agences d’insertion est très importante que celle des femmes.
Tableau 58: Répartition du nombre d’emplois publics créés par type
Type d’emploi public
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Recrutements dans les fonctions Publiques d’Etat et
des Collectivités, et des Forces armées et de Sécurité 9 622 83,2% 1 944 16,8% 11 566 36,9%
Emplois générés par les Projets, Programmes
d’investissement 1 391 77,4% 406 22,6% 1 797 5,7%
Emplois générés par les projets, programmes et
agences d'insertion (auto-emplois) 7 995 44,4% 9 993 55,6% 17 988 57,4%
Total 19 008 60,6% 12 343 39,4% 31 351 100,0%
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les points focaux emploi, 2022
Les stages de formation professionnelle ont été initiés en 1992 par l’Ordonnance n°92-
O22/PCTSP du 13 avril 1992 et son décret d’application n°92-128/PM-RM du 18 Avril 1992.
Leur objectif est de permettre aux jeunes diplômés d’acquérir une expérience professionnelle
en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Cette ordonnance a été prise pour tenter de
résoudre l’épineuse équation « pas de travail, pas d’expérience ; pas d’expérience car pas de
travail ».
Le stage de formation professionnelle est une sous composante du Programme Emploi Jeunes
(PEJ) qui est en sa deuxième génération. Le PEJ II est mis en œuvre par l’APEJ. Les données
analysées sur le stage de formation professionnelle sont celles fournies par l’APEJ.
Dans le cadre du renforcement de l’employabilité des jeunes dans le secteur des infrastructures,
l’APEJ organise des programmes de formation en chantiers-école en partenariat avec les
collectivités locales à travers des formations en technique HIMO.
 |
81 81 |
▲back to top |
68
Un autre aspect intéressant de l'analyse du marché du travail est l'analyse des dispositifs de
formation et de qualification. En analysant le tableau ci-dessous, il ressort que parmi les
dispositifs de formation réalisés en 2022, 87 jeunes ont bénéficié de stage de formation
professionnelle mais force est de constater que sur l’ensemble des bénéficiaires de ce stage,
près de trois quart (73,6%) étaient des femmes. Pour la formation en technique HIMO à travers
l’APEJ, 120 jeunes ont bénéficié dont 100 jeunes femmes et 20 jeunes hommes. Les domaines
d’activités retenus ont été, entre autres, le pavage/dallage de roche, l’aménagement/la
réhabilitation de pistes rurales en terre, l’aménagement hydro agricole et l’enrichissement des
forêts. Il faut noter que l’ANPE à travers ses composantes CREE et GERME a formé un nombre
important de jeunes dont 492 pour la formation en gestion d’entreprise (GERME) et 484 pour
la formation en création d’entreprise (CREE). Force est de constater qu’à part le dispositif de
formation « création d’entreprise (CREE) », la proportion des femmes dépasse largement celles
des hommes dans les autres dispositifs de formation tels que le stage de formation
professionnelle (73,6%), la formation en technique HIMO (83,3%) et la formation en gestion
d’entreprise GERME (58,7%).
Tableau 59: Répartition des stagiaires par Dispositif de formation et de qualification 2022 selon
le sexe
Dispositif de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Stage de formation professionnelle 23 26,4 64 73,6 87 100,0
Formation en technique HIMO 20 16,7 100 83,3 120 100,0
Formation en création d’entreprise (CREE) 301 62,2 183 37,8 484 100,0
Formation en gestion d’entreprise
(GERME)
203 41,3 289 58,7 492 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données du rapport d’activités 2022 de l’APEJ
De façon globale, 1268 demandes de formation ont été enregistrées en CREE, GERME et autres
modules en 2022, dont parmi eux, 28,9% étaient enregistrés dans la région de Koulikoro, 23,2%
à Gao, 15,8% dans le District de Bamako, 10,7% à Mopti et 10,3% à Kayes. La proportion des
demandes de formation enregistrées dans les régions de Sikasso, Kidal et Tombouctou est très
faible avec des proportions respectives de 5,5%, 3,2% et 2,4%.
Suivant les 484 demandes de formation enregistrées en CREE, 301 demandes ont été formulées
par des hommes et 183 par les femmes. Il faut noter que parmi ces demandes, 136 soit 28% ont
été formulés dans la région de Mopti, suivis par celles du District de Bamako. Aucuns jeunes
des régions de Tombouctou, Ménaka et Taoudenni n’a demandé une formation en CREE.
Pour les 492 demandes de formation enregistrées en GERME à travers l’ANPE, 203 ont été
formulées par les hommes contre 289 pour les femmes, la proportion de femmes ayant demandé
une formation en GERME est importante que celle des hommes (289 contre 203). On observe
que parmi ces demandes enregistrées en GERME, 246 soit 50% de ces demandes ont été
formulées dans la région de Gao et 29% à Koulikoro. On observe également que ce module de
 |
82 82 |
▲back to top |
69
formation GERME n’a intéressé aucun jeune des régions de Sikasso, Tombouctou, Mopti,
Kidal, Ménaka et de Taoudenni.
En ce qui concerne les 292 demandes sur les autres modules, 135 des demandeurs étaient des
hommes contre 157 femmes. La région de Koulikoro vient en tête avec 171 soit 58,5% de
demandeurs suivie par la région de Kayes avec 90 soit 30,8% de demandeurs des autres
modules de formation. La demande sur les autres modules a été formulée seulement dans les
trois (3) régions du Mali (Kayes, Koulikoro et de Tombouctou).
Tableau 60: Répartition des demandes de formation enregistrées en CREE, GERME et autres
modules par région et sexe
Région
CREE GERME
AUTRES
MODULES
Total
H F T H F T H F T H F T
Kayes 40 0 40 0 0 0 40 50 90 80 50 130
Koulikoro 30 20 50 47 99 146 93 78 171 170 197 367
Sikasso 30 40 70 0 0 0 0 0 0 30 40 70
Mopti 102 34 136 0 0 0 0 0 0 102 34 136
Tombouctou 0 0 0 0 0 0 2 29 31 2 29 31
Kidal 26 14 40 0 0 0 0 0 0 26 14 40
Ménaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gao 15 33 48 103 143 246 0 0 0 118 176 294
Taoudéni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bamako 58 42 100 53 47 100 0 0 0 111 89 200
Total 301 183 484 203 289 492 135 157 292 639 629 1268
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données du rapport d’activités 2022 de l’APEJ
Selon le tableau ci-dessous, il ressort que l’APEJ a effectué 87 placements en stage de
qualification à travers 19 entreprises dont 11 dans la région de Ségou, 4 à Koulikoro, 2 dans le
District de Bamako et 2 à Sikasso. Suivant les 87 placements en stage de qualification, 64
étaient du sexe masculin contre 23 femmes.
Le niveau de placement en stage de qualification varie d’une région à l’autre. Il est surtout élevé
à Bamako avec 48 jeunes placés, suivi par la région de Ségou avec 15 jeunes placés. Les
résultats nous révèlent aussi que dans les régions de Koulikoro et de Sikasso, 14 et 10 ont été
respectivement placés. On peut conclure qu’en se référant au taux de réalisation, la prévision
annuelle a été strictement respectée.
 |
83 83 |
▲back to top |
70
Tableau 61: Récapitulatif des placements en stage de qualification par région et par sexe
Région/District
Sexe
Total
placement
Prévision
annuelle
Taux de
réalisation
Nombre
d'entreprises
impliquées Homme Femme
Koulikoro 9 5 14 14 100,0 4
Sikasso 7 3 10 10 100,0 2
Ségou 12 3 15 15 100,0 11
Bamako 36 12 48 48 100,0 2
Total 64 23 87 87 100,0 19
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données du rapport d’activités 2022 de l’APEJ
 |
84 84 |
▲back to top |
71
5. Sécurité sociale
Dans cette partie nous analysons la sécurité sociale à travers les activités de la Direction
Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES), de la Caisse Malienne
de Sécurité Sociale (CMSS), de l’Agence Malienne de Mutualité Sociale (AMAMUS) et de
l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS).
5.1. Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire
La Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPS-ES) au Mali
est une institution gouvernementale qui gère et supervise divers programmes et politiques liés
à la protection sociale et à l’économie solidaire dans le pays. Elle est chargée de coordonner les
activités liées à la protection sociale, à l’économie solidaire et d’autres initiatives visant à
améliorer les conditions de vie des citoyens maliens.
Ce tableau indique les informations sur l’effectif et le pourcentage d'organisations
fonctionnelles dans chaque catégorie. En effet, sur 1 686 associations communautaires, 1 400
environ 83% d'entre elles sont fonctionnelles, 35 926 sont des sociétés coopératives dont 17 017
sont fonctionnels, soit environ 47,4% et pour les mutuelles, environ 47,1%.
Tableau 62: Indicateurs de la protection sociale
Nombre total Nombre fonctionnel % fonctionnel
ASACO 1 686 1 400 83,0
Mutuelles de santé 206 97 47,1
Sociétés coopératives 35 926 17 017 47,4
Source : DNPSES, rapport d’activités 2022
5.2. Caisse Malienne de Sécurité Sociale
La CMSS gère plusieurs régimes de sécurité sociale au Mali, notamment le régime d’assurance
maladie, le régime de retraite, le régime d’allocations familiales, et d’autres régimes visant à
protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques liés à la maladie, à la vieillesse, à
l’invalidité etc.
La situation des pensionnés de la CMSS par région au 31/12/2022 est de 59 738 dont 39 129
civils soit 65,5% et 20 609 militaires soit 34,5%. Quant aux régions, Bamako enregistre plus
de la moitié soit 54,6%, suivie de la région de Ségou avec 10,4%, 90% dans la région de Sikasso
et 9,0% dans la région de Koulikoro. En ce qui concerne les civils, plus de huit (84,5%) des
pensionnés de la CMSS sont de la région de Bougouni contre 15,5% de pensionnés militaires.
 |
85 85 |
▲back to top |
72
Tableau 63: Situation des pensionnés de la CMSS par région au 31 décembre 2022
Civil Militaire Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Etranger 12 92,3 1 7,7 13 0,0
Bamako 22 604 69,3 10 025 30,7 32 629 54,6
Kayes 2582 76,1 812 23,9 3394 5,7
Koulikoro 2206 40,9 3188 59,1 5394 9,0
Sikasso 3773 67,0 1859 33,0 5632 9,4
Ségou 4024 64,8 2188 35,2 6212 10,4
Mopti 1954 71,1 794 28,9 2748 4,6
Tombouctou 739 56,3 574 43,7 1313 2,2
Gao 958 49,8 964 50,2 1922 3,2
Kidal 62 27,0 165 71,7 230 0,4
Bougouni 212 84,5 39 15,5 251 0,4
Total 39 129 65,5% 20 609 34,5% 59 738 100,0%
Source : CMSS, rapport d’activités 2022
5.3. Agence Malienne de Mutualité Sociale
La mutualité sociale est un mécanisme de protection sociale qui repose sur la solidarité entre
les membres d’une mutuelle ou d’une coopérative, visant à fournir des services de santé et
d’autres avantages sociaux à ses adhérents.
Selon les données du tableau ci-dessous, plus de la moitié des mutuelles de santé (53,4%) ne
sont pas cofinancées, tandis que 46,6% des mutuelles sont cofinancées. Le cofinancement
implique souvent la participation financière d'entités gouvernementales, d'organisations
internationales ou d'autres partenaires pour soutenir le fonctionnement des mutuelles.
Ces données indiquent une répartition inégale des mutuelles de santé dans différentes régions
du Mali. Bamako enregistre la plus grande proportion de mutuelles, soit 22,4%, suivie de Ségou
19,4%, Sikasso 17% et Kayes 10,2%. Ces régions semblent avoir une plus grande présence de
mutuelles de santé.
Les régions de Gao, Kidal, Ménaka et Taoudenni enregistrent la plus faible proportion de
mutuelles de santé. Cela peut indiquer une moins grande présence ou un besoin moins pressant
de mutuelles dans ces régions.
Pour la situation dans les régions de Kidal, Taoudenni et Ménaka, les données révèlent que dans
ces régions, les mutuelles de santé sont principalement cofinancées, ce qui signifie qu'elles
reçoivent un soutien financier externe en plus des cotisations des membres. Ménaka est la seule
parmi ces régions à ne pas avoir de mutuelles non cofinancées, ce qui peut refléter un besoin de
financement externe plus important pour maintenir ces mutuelles en activité.
Cette analyse laisse voir des disparités régionales en ce qui concerne les mutuelles de santé au
Mali, et ces informations peuvent être utiles pour orienter les politiques de santé et de protection
sociale dans le pays.
 |
86 86 |
▲back to top |
73
Tableau 64: Situation des mutuelles de santé au 31 décembre 2022
Cofinancées Non cofinancées Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 17 81,0 4 19,0 21 10,2
Koulikoro 11 55,0 9 45,0 20 9,7
Sikasso 29 82,9 6 17,1 35 17,0
Ségou 21 52,5 19 47,5 40 19,4
Mopti 7 41,2 10 58,8 17 8,3
Tombouctou 5 33,3 10 66,7 15 7,3
Gao 2 25,0 6 75,0 8 3,9
Kidal 0 0,0 2 100,0 2 1,0
Taoudenni 0 - 0 - 0 0,0
Ménaka 0 0,0 2 100,0 2 1,0
Bamako 4 8,7 42 91,3 46 22,3
Total 96 46,6 110 53,4 206 100,0
Source : AMAMUS, 2021
Le montant total du cofinancement a connu une baisse significative en 2022 par rapport à
l'année précédente. En 2021, le montant était de 415 253 204 FCFA, tandis qu'en 2022, il est
tombé à 379 633 555 FCFA, soit une diminution de 35 619 649 FCFA. Cette baisse pourrait
être due à divers facteurs tels que des changements dans les politiques de financement ou des
variations dans les besoins financiers des mutuelles.
En 2022, parmi les régions spécifiques mentionnées, Mopti reçoit le plus grand montant de
cofinancement avec 120 797 820 FCFA, soit 31,8% du total. Kayes suit avec 65 049 600 FCFA,
soit 17,1%, tandis que le District de Bamako reçoit 50 685 600 FCFA, soit 3,4% et Sikasso 48
920 325 FCFA soit 12,9%. Par ailleurs, Ménaka, Kidal, Taoudenni n’ont pas pu recouvrer.
Cette mesure peut indiquer l'efficacité des régions dans le recouvrement des cotisations par
rapport à leurs actifs financiers totaux.
Graphique 5: Situation du cofinancement en 2022
Source : AMAMUS, 2022
0
0
0
533 750
2 311 270
33 035 100
48 920 325
50 685 600
58 300 090
65 049 600
120 797 820
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
8,7%
12,9%
13,4%
15,4%
17,1%
31,8%
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 140 000 000
Taoudéni
Kidal
Ménaka
Gao
Tombouctou
Ségou
Sikasso
Bamako
Koulikoro
Kayes
Mopti
 |
87 87 |
▲back to top |
74
Dans ce tableau les données nous indiquent la répartition des bénéficiaires inscrits, des
bénéficiaires à jour, des coûts de recouvrement et des montants encaissés dans différentes
régions, ainsi que le nombre de cofinancements dans certaines de ces régions. Dans l’ensemble
on enregistre 490 163 bénéficiaires inscrits, dont Kayes représente 148 457 inscrits, Bamako
enregistre 87 124 inscrits, Mopti 77 976 inscrits et le plus faible nombre est à Gao avec 4 047
inscrits.
Quant aux bénéficiaires ayant accompli leurs obligations, ils sont au total 228 947 parmi
lesquels le District de Bamako enregistre le grand nombre de bénéficiaires 237 145, suivi de
Kayes 77 309 bénéficiaires, Mopti 30 595, Tombouctou 6 163 et le plus faible nombre est
observé à Gao avec 528.
En ce qui concerne le coût de recouvrement, on enregistre au total 620 671 715FCFA dont une
très partie est recouvrée à Mopti pour un montant de 133 447 685 FCFA, à Kayes, il est
recouvré 122 142 110 FCFA, Koulikoro recouvre 106 529 500FCFA et Sikasso
99 487 500FCFA. Bamako recouvre 94 638 050FCFA et la région Où on trouve moins de
recouvrement est la région de Gao avec 587 400FCFA.
Le montant global des ressources est de 959 891 493FCFA. Mopti encaisse 223 705 182
FCFA, Bamako encaisse 263 783 999FCFA. Ainsi, au total on enregistre 96 partenariats qui
sont repartis suivant les régions. La région de Sikasso enregistre 29 cofinancements, 21 à Ségou
et 17 à Kayes. Le constat est que parmi ces régions, la région de Kidal, Taoudenni, Ménaka
n’ont pas des entrées en 2022.
Tableau 65: Situation des ressources (entrées) en 2022
Région Cofinancées
Bénéficiaires
inscrits
Bénéficiaires
à jour
Cotisations
recouvrées
Montant du
cofinancement
Coût des
prestations
Kayes 17 148 457 77 309 122 142 110 65 049 600 169 068 545
Koulikoro 11 49 728 32 784 106 529 590 58 300 090 78 982 029
Sikasso 29 65 862 29 473 99 487 500 48 920 325 151 146 099
Ségou 21 45 181 14 950 47 248 050 33 035 100 62 188 532
Mopti 7 77 976 30 595 133 447 685 120 797 820 223 705 182
Tombouctou 5 11 788 6 163 16 591 330 2 311 270 10 081 107
Gao 2 4 047 528 587 400 533 750 936 000
Kidal 0 0 0 0 0 0
Taoudenni 0 0 0 0 0 0
Ménaka 0 0 0 0 0 0
Bamako 4 87 124 37 145 94 638 050 50 685 600 263 783 999
Total 96 490 163 228 947 620 671 715 379 633 555 959 891 493
Source : AMAMUS, 2022
En 2022, le total des prestations s'élevait à 716 739 956. Les femmes étaient majoritaires parmi
les bénéficiaires de prestations, avec 421 866 497 contre 294 873 459 pour les hommes. Au
total, il y avait 123 689 bénéficiaires de prestations, parmi lesquels les femmes étaient
également en plus grand nombre avec 69 831, contre 53 .858 hommes. En ce qui concerne les
régions, la région de Mopti était celle où les femmes bénéficiaires de prestations étaient les plus
 |
88 88 |
▲back to top |
75
nombreuses, avec 22 749 bénéficiaires, comparativement à 18 383 hommes. La région de
Sikasso suivait avec 13 087 femmes contre 12 529 hommes.
Le montant total des prestations versé aux femmes de la région de Sikasso était nettement plus
élevé que celui versé aux hommes, avec 88 886 581 pour les femmes et 57 707 654 pour les
hommes. Dans toutes les régions, quel que soit le nombre de bénéficiaires, les femmes étaient
majoritaires en termes de montants de prestations. Ces informations révèlent que les femmes
étaient plus nombreuses parmi les bénéficiaires de prestations en 2022 et qu'elles ont également
reçu des montants plus importants dans certaines régions. Cela peut refléter des besoins
spécifiques ou des politiques de prestations sociales visant à soutenir les femmes dans les
activités économiques.
Tableau 66: Situation des prestations par les mutuelles en 2022
Région
Effectif des bénéficiaires des
Prestations Montant des Prestations
Homme Femme Total Homme Femme Total
Kayes 6 937 11 188 18 125 42 051 597 79 647 763 121 699 360
Koulikoro 7 065 10 419 17 484 1 711 035 2 409 046 4 120 081
Sikasso 12 529 13 087 25 616 57 707 654 88 886 581 146 594 235
Ségou 5 870 7 973 13 843 30 001 592 44 636 558 74 638 150
Mopti 18 383 22 749 41 132 118 508 560 147 559 484 266 068 044
Tombouctou 396 671 1 067 1 686 130 2 803 068 4 489 198
Gao 97 142 239 344 000 687 200 1 031 200
Bamako 2 581 3 602 6 183 42 862 891 55 236 797 98 099 688
Total 53 858 69 831 123 689 294 873 459 421 866 497 716 739 956
Source : AMAMUS, 2022
L’analyse relève au total 206 mutuelles de santé et mutuelles mixtes en 2022, ce qui représente
une légère diminution par rapport à l'année précédente où il y en avait 220. La région de Ségou
a le plus grand nombre de mutuelles de santé et mutuelles mixtes avec 40, suivie de Sikasso
avec 35, et Kayes avec 21. Quant à la population totale du Mali en 2022, elle était de 21 697
000 personnes et la population cible des mutuelles de santé est de 16 923 660 personnes.
Le taux de couverture moyen du risque maladie par les mutuelles est de 2,9% dans l'ensemble
des régions, ce qui représentait une baisse d'un point par rapport à l'année précédente. Le
meilleur taux de couverture est observé à Kayes avec 6,4%, suivi de Bamako avec 4,1%. Les
régions, comme Kidal, Taoudenni et Ménaka, les taux de couverture sont probablement plus
faibles ou même nuls, car pratiquement dans ces régions tous les bénéficiaires sont inscrits à
part les régions de Kidal, Taoudenni et Ménaka. Cela indique que dans ces régions, il peut y
avoir des défis ou des lacunes dans la couverture du risque maladie par les mutuelles.
 |
89 89 |
▲back to top |
76
Tableau 67: Taux de couverture du risque maladie par les mutuelles de santé en 2022
Région
Nombre de
mutuelles de
santé et mixte
Population
actualisée
Nombre total de
bénéficiaires
inscrits
Population cible
des mutuelles (78%
Population totale)
Taux de
couverture
(%)
Kayes 21 2 977 250 148 457 2 322 255 6,4
Koulikoro 20 3 617 159 49 728 2 821 384 1,8
Sikasso 35 3 947 304 65 862 3 078 897 2,1
Ségou 40 3 492 074 45 181 2 723 818 1,7
Mopti 17 3 040 860 77 976 2 371 871 3,3
Tombouctou 15 1 007 731 11 788 786 030 1,5
Gao 8 809 873 4 047 631 701 0,6
Kidal 2 0 0 0 -
Taoudéni 0 0 0 0 -
Ménaka 2 101 161 0 78 905 0,0
Bamako 46 2 703 588 87 124 2 108 798 4,1
Total 206 21 697 000 490 163 16 923 660 2,9
Source : AMAMUS, 2022
5.4. Agence Nationale d'Assistance Médicale (ANAM)
Agence Nationale d’Assistance Médicale16 « ANAM » est un Etablissement Public National à
Caractère Administratif) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; créé par
la loi N°09-031/AN-RM du 27 juillet 2009. Le Décret N°09-554/P-RM du 12 octobre 2009 fixe
les détails de l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’ANAM. Elle est placée sous
la tutelle du Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire. L’Agence Nationale
d’Assistance Médicale a pour mission la gestion du Régime d’Assistance Médicale (RAMED).
Le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) a été mis en place pour lutter contre la précarité
sanitaire et garantir un certain niveau d’accès aux soins de santé pour les couches les plus
défavorisées de la population.
Le taux de couverture nationale des indigents au Mali est de 79,4%. Cela signifie que près de
79,4% de la population indigente du pays bénéficie d'une forme de couverture médicale ou
d'aide spécifique. La prévision nationale pour la couverture des indigents est de 5%, ce qui
représente un total de 1 303 486 personnes. Ces personnes bénéficient probablement d'une
assistance médicale ou d'un programme de couverture spécifique en raison de leur statut
d'indigents. La majorité de ces indigents se trouve à Bamako, avec 266 530 personnes, suivie
de Sikasso avec 223 855 personnes. La région de Kidal semble avoir le plus faible nombre
d'indigents bénéficiant de cette couverture.
16 https://rsu.gouv.ml/portail/anam/ [Site visité le 14/11/2023]
 |
90 90 |
▲back to top |
77
Tableau 68: Taux de couverture nationale des indigents
Région Prévision Nationale (5%) Total Immatricules Taux de couverture (%)
Kayes 195 800 113 044 57,7
Koulikoro 201 333 156 836 77,9
Sikasso 223 855 231 721 103,5
Ségou 152 642 111 217 72,9
Mopti 156 891 145 858 93,0
Tombouctou 58 971 22 934 38,9
Gao 42 567 38 002 89,3
Kidal 4 897 913 18,6
Bamako 266 530 213 888 80,2
Total 1 303 486 1 034 413 79,4
Source : ANAM, 2022
5.5. Institut National de Prévoyance Sociale
Pour l’Institut National de Prévoyance Sociale, nous évoquons les cotisations, les prestations
des structures socio-sanitaires et les conventions internationales de sécurité sociale.
5.5.1. Les cotisations
En 2022, sur une prévision de 228 593 millions de FCFA, il y’a eu une réalisation de 220 949
millions FCFA, soit un taux de réalisation de 96,7%. Ce taux a baisé comparativement à l’année
précédente ou on avait obtenu un taux de réalisation de 100,7% sur une prévision de 193 673
millions FCFA. L’INPS seul a réalisé 164 295 millions FCFA en 2022 pour une prévision de
167 018 millions FCFA soit un taux de réalisation de 98,4%. La réalisation de l’AMO est
estimée à 49 909 millions FCFA pour une prévision de 53 403 millions soit un taux de
réalisation de 93,5%. L’ANPE a pu recouvrer 7 718 millions FCFA des cotisations alors qu’elle
avait prévu 7 599 millions FCFA soit un taux de réalisation de 106,6%. Et sur une prévision
de 572 millions, l’ONEF a pu réaliser 581 millions FCFA soit un taux de réalisation de 101,6%.
En outre, le taux de croissance annuelle est de 14,1%, ce qui représente une hausse par rapport
à 2021, où le taux était de -6,1%. Cela indique une amélioration de la performance financière
globale en 2022 par rapport à l’année précédente.
Tableau 69: Répartition des cotisations par structure (en millions FCFA)
Structure
2021 2022 Taux de
réalisation
Croissance
annuelle Réalisation Prévision Réalisation
INPS 162 084 167 018 164 295 98,4% 1,4%
AMO 42 488 53 403 49 909 93,5% 17,5%
ANPE 6 722 7 599 7 718 101,6% 14,8%
ONEF 506 572 581 101,6% 14,8%
Total 193 673 228 593 220 949 96,7% 14,1%
Source : INPS, rapport d’activités 2021 et 2022
 |
91 91 |
▲back to top |
78
5.5.2. Les prestations
L'analyse de ce tableau met en évidence les chiffres liés aux nouveaux dossiers d'assurés et aux
prestations reçus en 2022. Suivant la même année, un total de 107 640 de nouveaux dossiers
d'assurés enregistre un taux de réalisation global de 251,4%, ce qui signifie que le nombre de
nouveaux dossiers enregistrés en 2022 dépasse considérablement le chiffre de l'année
précédente, qui était de 30 636. Cela indique une augmentation significative de l'activité.
En outre, 73 595 nouveaux assurés AMO ont été immatriculés en 2022. Il semble n'y avoir
aucune réalisation dans ce groupe, ce qui peut être un point d'attention ou une particularité. Et
pour les nouveaux assurés immatriculés au régime général, il y a eu 21 472 nouveaux assurés
immatriculés au régime général, ce qui représente un taux de réalisation de 17,6%. Quant aux
nouveaux bénéficiaires d'allocations familiales, 7 697 nouveaux bénéficiaires d'allocations
familiales ont été enregistrés, avec un taux de réalisation de 15,7%. Pour les nouveaux assurés
volontaires immatriculés, 46 664 ont été enregistrés en 2022, mais ce groupe a un taux de
réalisation de -11,6%, ce qui indique un écart négatif par rapport à l'objectif attendu. Enfin, 210
nouvelles victimes d'Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (ATMP) ont été
enregistrées en 2022, avec un taux de réalisation de -53,9%. De nouveau, un taux de réalisation
négatif. Cela peut nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre pourquoi le taux
de réalisation est négatif.
Tableau 70: Répartition des nouveaux dossiers d’assurés et de prestations reçus en 2022
2021 2022 Taux de réalisation
Nouveaux assurés immatriculés au régime général 18 254 21 472 17,6%
Nouveaux assurés volontaires immatriculés 5 276 4 666 -11,6%
Nouveaux assurés AMO immatriculés 73 595 -
Nouveaux bénéficiaires d'allocations familiales 6 650 7 697 15,7%
Nouvelles victimes d’ATMP 456 210 -53,9%
Total 30 636 107 640 251,4%
Source : INPS, rapport d’activités 2021 et 2022
Ce tableau d’écrit la répartition des bénéficiaires par catégorie d’assurés et par sexe. Sur un
effectif de 635 370 bénéficiaires, les femmes représentent 58,6% sur un effectif de 372 326
contre 263 044 hommes soit 41,4%.
En effet, la proportion des bénéficiaires par catégorie d’assurés ayant droits des enfants
représentent 71,4%, 23,2% ayants droits conjoints, et seulement 5,4% sont des principaux
assurés. Parmi ces bénéficiaires 92,5% de femmes ont des droits conjoints contre 7,5% des
hommes. Les hommes représentent une majorité parmi les principaux assurés, soit 54,4% et les
femmes constituent 45,6% des principaux assurés et 51% de femmes des bénéficiaires ont des
droits des enfants contre 49%.
En résumé, les femmes sont majoritaires parmi l'ensemble des bénéficiaires, et elles ont
principalement des droits conjoints et des droits des enfants. Les hommes, quant à eux, sont
plus fréquemment des assurés principaux. La répartition entre les sexes varie en fonction de la
 |
92 92 |
▲back to top |
79
catégorie d'assurés, avec une prédominance des femmes parmi les bénéficiaires ayant des droits
des enfants et une prédominance des hommes parmi les principaux assurés.
Tableau 71: Répartition des bénéficiaires par catégorie d’assurés et par sexe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Assurés principaux 18 739 54,4 15 706 45,6 34 445 5,4
Ayants droits conjoints 11 037 7,5 136 117 92,5 147 154 23,2
Ayants droits enfants 222 348 49,0 231 423 51,0 453 771 71,4
Total 263 044 41,4 372 326 58,6 635 370 100,0
Source : INPS, rapport d’activités 2022
Le tableau ci-dessous fournit des informations importantes sur la répartition des bénéficiaires
et l'évolution des montants des prestations sur une période de deux ans. Les pensionnés
représentent la grande majorité des bénéficiaires, soit 83,5% de l’ensemble, la proportion des
allocations familiales représente 14,4%, les accidents de travail et maladies professionnelles et
les assurances volontaires représentent des proportions plus faibles, respectivement 1,5% et
0,6%.
En 2021, le montant alloué aux bénéficiaires était de 95 285 967 286 FCFA. Ce montant est
passé à 94 429 178 829 FCFA, ce qui fait que la croissance annuelle en 2022, qui est de -0,9%,
est en baisse par rapport à celle de 2021, qui était de 8,49%. Cela indique que la croissance des
montants alloués aux bénéficiaires a ralenti par rapport à l'année précédente.
De même, les assurés volontaires ont eu un impact significatif sur la croissance annuelle des
montants alloués aux bénéficiaires au cours des deux dernières années, contribuant à hauteur
de 57,7%. Cela montre que l'augmentation du nombre d'assurés volontaires a contribué à la
croissance des prestations.
En définitif, la majorité des bénéficiaires sont des pensionnés, et les allocations familiales, les
accidents de travail et maladies professionnelles représentent une part plus petite. Les montants
alloués aux bénéficiaires ont légèrement diminué d'une année à l'autre, avec un taux de
croissance négatif en 2022 par rapport à 2021. Cependant, il est important de noter que les
assurés volontaires ont eu un impact positif sur la croissance des montants alloués aux
prestations au cours des deux dernières années.
 |
93 93 |
▲back to top |
80
Tableau 72: Répartition des bénéficiaires par branche et montant des prestations
2021 2022 Croissance
annuelle Montant % Montant %
Allocations familiales 13 476 250 000 14,1% 13 631 668 389 14,4% 1,2%
Pensions 80 085 696 808 84,0% 78 841 911 794 83,5% -1,6%
Accidents du travail et
maladies professionnelles
1 387 169 978 1,5% 1 424 278 146 1,5% 2,7%
Assurance volontaire 336 850 500 0,4% 531 320 500 0,6% 57,7%
Total 95 285 967 286 100,0% 94 429 178 829 100,0% -0,9%
Source : INPS, rapport d’activités 2021 et 2022
Au regard de ce tableau, le montant reçu par les bénéficiaires par type de pension est de
73 191 083 112 FCFA, dont 43 526 395 164 FCFA soit 59,5% consacrés au payement de
pension normale, 17 310 957 972 FCFA soit 23,7% destinés à l’anticipation volontaire et
11 263 584 744 FCFA soit 15,4% consacrés au payement de pension de révision.
Sur un effectif de 65 227, la part des femmes représente 37 248 soit 57,1% et les hommes
27 977 soit 42,9%. Parmi les types de pensions, les pensionnaires de réversion sont
majoritairement représentés soit 49,0%, les pensionnaires normaux représentent 32,6% et les
anticipations volontaires occupent 15,4%. Les allocations de familles représentent 1,2%, la part
des bénéficiaires de pension orpheline est de 1% et les allocations de survivant et anticipation
maladie représentent 0,2%.
De manière spécifique, la quasi-totalité des bénéficiaires de pension de réversion sont les
femmes contre 4% des hommes, suivies des allocations de survivant avec 84% de femmes
comparativement 16% d’hommes.
Tableau 73: Répartition des bénéficiaires de pensions par type de pension et par sexe
Homme Femme Total Montant
Effectif % Effectif % Effectif % FCFA %
Allocation de solidarité 716 89,7 82 10,3 798 1,2 193 565 652 0,3
Allocation de survivant 19 16,0 100 84,0 119 0,2 65 970 672 0,1
Anticipation maladie 86 71,7 34 28,3 120 0,2 286 077 780 0,4
Anticipation volontaire 7 850 78,3 2 175 21,7 10 025 15,4 17 310 957 972 23,7
Pension de réversion 1 285 4,0 30 686 96,0 31 971 49,0 11 263 584 744 15,4
Pension d'invalidité 200 82,6 42 17,4 242 0,4 531 360 912 0,7
Pension normale 17 615 82,7 3 673 17,3 21 288 32,6 43 526 395 164 59,5
Pension orpheline 208 31,3 456 68,7 664 1,0 13 170 216 0,0
Total 27 977 42,9 37 248 57,1 65 227 100,0 73 191 083 112 100,0
Source : INPS, rapport d’activités 2021 et 2022
5.5.3. Les prestations des structures socio-sanitaires
Les prestations des structures socio-sanitaires se réfèrent aux services et soins offerts par des
établissements de santé et de services sociaux. Ces prestations visent à répondre aux besoins de
 |
94 94 |
▲back to top |
81
la population en matière de santé et de bien-être. Les structures socio-sanitaires peuvent
comprendre divers types d'organisations, notamment les hôpitaux, les cliniques, les centres de
santé, les maisons de retraite, les services de soins à domicile, les centres de réadaptation, les
centres de santé mentale, et bien d'autres.
Ce tableau fournit des données concernant les prestations en faveur des accidentés de travail
pour les années 2021 et 2022. Dans l’ensemble, le nombre d'accidentés de travail a
considérablement augmenté en 2022 par rapport à 2021, avec une hausse de 171,0%.
Cependant, cette augmentation varie en fonction du type de prestation, avec une baisse de
11,7% pour le remboursement des frais médicaux, une forte hausse de 275% pour les avis sur
les évacuations des accidentés de travail, et une augmentation non précisée pour les avis sur les
taux d'incapacité permanente partielle. Les données montrent également la répartition de
l'effectif en 2022 entre les différentes prestations.
Tableau 74: Nombre de prestations en faveur des accidentés de travail
2021 2022 Croissance annuelle
Remboursements frais médicaux des accidents de travail 60 53 -11,7
Remboursements frais médicaux des rentiers de France 126 319 153,2
Avis sur les évacuations des accidentés de travail 4 15 275,0
Contrôles médicaux des accidentés de travail pour rentes 68 444 552,9
Visites médicales de mise en invalidité 15 22 46,7
Avis sur les taux d’incapacité permanente partielle 106 174 64,2
Total 379 1 027 171,0
Source : INPS, rapport d’activités 2022
Le tableau suivant est relatif aux activités de prévention des accidents de travail et maladies
professionnelles. Le taux de réalisation estimé en 2022, s’élève à 124,6% pour les visites
médicales d’embauche, 63% pour les visites d’entreprise, 62,9% pour les visites médicales
périodiques. Les campagnes d’information et de sensibilisation représentent 25%. L’objectif
visé en 2022 n’a pas été atteint avec un taux d’évolution de 117,2% contrairement en 2021 où
le taux était à la baisse de 100%. Le nombre d’activités des accidents de travail et maladies
professionnelles a augmenté quel que soit le type d’activités avec des taux de croissance
annuelle de 117,2% pour les visites d’entreprises, les visites médicales périodiques 39,4% et
visites médicales d’entreprise 10,7%.
Tableau 75: Activités de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles
Activités
Réalisation
2021
Prévision
2022
Réalisation
2022
Taux
Réalisation
(%)
Taux
Evolution
(%)
Visites médicales
d’embauche
5 627 5 000 6 231 124,6 10,7
Visites médicales
périodiques
4507 10 000 6 285 62,9 39,4
Visites d’entreprise 29 100 63 63,0 117,2
Campagnes d’information
et de sensibilisation
1 4 1 25,0 0,0
Séminaire de formation 0 2 0 0,0 -
Source : INPS, rapport d’activités 2022
 |
95 95 |
▲back to top |
82
Ce tableau mentionne les données sur l'évolution des activités médicales curatives en 2022 par
rapport à 2021. Le nombre total d'activités médicales curatives est passé de 103 590 en 2021 à
132 722 en 2022, ce qui représente une augmentation de 28,1%. Le nombre de consultations
médicales curatives générales est passé de 85 829 en 2021 à 104 434 en 2022, soit une
augmentation de 104,4%. De même, le nombre de consultations médicales curatives
spécialisées est passé de 3 088 en 2021 à 3 334 en 2022, ce qui représente une augmentation de
72,2%. Ainsi, le nombre d'examens d'imagerie médicale est passé de 5 000 en 2021 à 5 675 en
2022, ce qui représente une augmentation de 113,5%.
Dans l'ensemble, quel que soit le type de prestation médicale, les activités ont connu une
croissance de 28,1 en 2022 par rapport à 2021. Ces chiffres indiquent une augmentation
significative des activités médicales curatives en 2022 par rapport à l'année précédente, avec
des taux de croissance variables selon le type de prestation. Il semble y avoir une demande
croissante de services médicaux, en particulier pour les consultations médicales générales et les
examens d'imagerie médicale.
Tableau 76: Activités médicales curatives
Prestations
Réalisations
2021
Prévisions
2022
Réalisations
2022
Taux
Réalisation
()
Taux de
croissance
Consultations médicales curatives
générales
85 829 100 000 104 434 104,4 21,7
Consultations médicales curatives
spécialisées
3 088 4 620 3 334 72,2 8,0
Examens biomédicaux 9 687 30 000 18 887 63,0 95,0
Examens d'imagerie médicale 4 340 5 000 5 675 113,5 30,8
Autres Examens para cliniques 646 1 110 392 35,3 -39,3
Total 103 590 140 730 132 722 94,3 28,1
Source : INPS, rapport d’activités 2022
5.5.4. Les conventions internationales de sécurité sociale
Les conventions internationales de sécurité sociale sont des accords conclus entre deux ou
plusieurs pays pour coordonner et harmoniser les systèmes de sécurité sociale afin de garantir
la protection sociale des personnes qui se déplacent d'un pays à un autre. Ces conventions visent
à éviter les doubles cotisations, à faciliter l'accès aux prestations sociales et à garantir la
continuité de la protection sociale pour les travailleurs migrants, les membres de leurs familles
et d'autres personnes déplacées.
Ce tableau nous donne des informations sur les allocations familiales versées aux travailleurs
maliens de l'extérieur, en mettant en évidence les montants alloués et les pays d'origine.
Le montant total des allocations familiales versées aux travailleurs maliens de l'extérieur est de
787 107 704 FCFA et la prévision totale des allocations familiales pour l'ensemble des
travailleurs maliens de l'extérieur s'élève à 11 411 619 893 FCFA repartis entre 8 518
travailleurs maliens de l'extérieur bénéficiant des allocations familiales.
 |
96 96 |
▲back to top |
83
Parmi ces pays, les allocations familiales en provenance de la France s’élèvent à 787 107 704
FCFA. Ce montant diffère en fonction des pays, suivant les accords bilatéraux où des lois en
vigueur dans le pays. Cependant, il semble que les données concernant les allocations familiales
en provenance d'autres pays tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Gabon soient peu
ou pas disponibles. Cela signifie peut-être que les informations sur les allocations familiales
provenant de ces pays ne sont pas actuellement accessibles, ou les détails n'ont pas été fournis.
Tableau 77: Situation des prestations payées aux travailleurs maliens de l’extérieur
Pays
Pensions Allocations Familiales
Effectifs Montants Effectifs Montants
France 6750 10 620 569 391 1439 787 107 704
Burkina Faso 22 4 996 118 - -
Côte d'Ivoire 1651 709 879 044 - -
Gabon 92 76 175 340 - -
TOTAL 8518 11 411 619 893 1439 787 107 704
Source : INPS, rapport d’activités 2022
Les informations issues de ce tableau donnent un aperçu des montants versés aux bénéficiaires
de pensions et de rentes maliennes vivant à l'étranger, en fonction des pays où ils résident.
En ce qui concerne les pensionnés maliens de l'extérieur, le montant total accordé est de
554 035 359 FCFA et les rentiers reçoivent un total de 886 244 FCFA. En France, le montant
accordé aux pensionnés résidant est de 537 613 608 FCFA et les rentiers reçoivent 866 244
FCFA. Au Burkina Faso le montant total payé est de 12 986 019 FCFA pour 4 bénéficiaires.
De même, au Sénégal et au Togo, les montants sont respectivement de 2 519 740 FCFA ; 915
992 FCFA repartis entre 2 bénéficiaires au total, un dans chaque pays.
Tableau 78: Situation des pensions et rentes maliennes payées à l’extérieur du Mali
Pays
Pensions Rentes
Effectifs Montants Effectifs Montants
France 117 537 613 608 2 866 244
Burkina Faso 4 12 986 019 - -
Togo 1 915 992 - -
Sénégal 1 2 519 740 -
Total 123 554 035 359 2 866 244
Source : INPS, rapport d’activités 2022
 |
97 97 |
▲back to top |
84
6. Dialogue social
Cette section du rapport s’intéresse au dialogue social à travers la gestion des conflits, les
contrats de travail et d’autres aspects très pertinents pour le travail décent. En effet, le Mali qui
est signataire des conventions internationales du BIT relatives aux droits élémentaires assurant
la santé, la sécurité au travail, le droit à l’association et à la protection sociale, connait souvent
des conflits collectifs à travers le pays et dans les entreprises et services publics. Nonobstant
ces désaccords sociaux, la liberté syndicale et d’expression est un acquis pour le travailleur
malien depuis longtemps. Outre ces conventions, des dispositifs juridiques sont soulignés dans
le Statut Général des Fonctionnaires et dans le Code du travail. Ainsi cette section mesure
l’énergie du Dialogue social au Mali.
6.1. Gestion des conflits collectifs
L’analyse des données de la répartition des conflits collectifs par région et entreprise selon le
type (tableau 76), montre un total de 58 conflits enregistrés courant 2022. A travers les régions,
c’est Kayes qui enregistre le plus grand nombre de conflits, soit 12, parmi lesquels quatre (4)
observés, trois (3) suspendus et le reste levé. Ensuite vient le District de Bamako avec neuf (9)
conflits enregistrés. Dans l’ensemble, c’est la toute nouvelle région de Bougouni qui enregistre
le plus faible nombre de conflits, soit deux (2), tous levés. Ceci pourrait s’expliquer par le faible
nombre d’entreprises à Bougouni. Dans au moins trois (3) cas, la durée était déclarée illimitée.
Une grande partie de ces conflits était plutôt enregistrée dans le secteur privé, étant donnée la
crise multidimensionnelle que traverse le pays, et conduisant à des résiliences chez les
représentants des travailleurs du public.
 |
98 98 |
▲back to top |
85
Tableau 79: Répartition des conflits collectifs par caractéristique sociodémographique
REGION/NIVEAU
NATIONAL
ENTREPRISES
CONCERNEES PAR LA
GREVE
NOMBRE
DE
CONFLITS
DUREE DE
LA GREVE
OBSERVATIONS
KAYES
SEMOS SA 1 72h Mot d'ordre observé
SEMOS SA 1 120h Mot d'ordre levé
WATS 1 96h Mot d'ordre observé
BLY Mali SA 1 96h Mot d'ordre observé
BLY Mali SA 1 120h Mot d'ordre levé
BLY Mali SA 1 240h Mot d'ordre suspendu
FEKOLA SA 1 96h Mot d'ordre levé
SAER-EMPLOI PW MINING 1 72h Mot d'ordre levé
SEMOS SA 1 72h Mot d'ordre levé
SAER-EMPLOI PW MINING 1 72h Mot d'ordre suspendu
BSWC MALI 1 72h Mot d'ordre observé
SEMAF SA 1 48h Mot d'ordre suspendu
Total 12 - -
KOULIKORO
APPM-ASKA 1 48h Mot d'ordre observé
CMM 1 72h Mot d'ordre levé
Mali Steel 1 72h Mot d'ordre observé
Total 3 - -
SIKASSO
Enseignement catholique de Sikasso 1 48h Mot d'ordre suspendu
UMO/ORICA/Syama 1 72h Mot d’ordre levé
Saer-emploi écologue Syama 1 48h Mot d’ordre levé
SFTP Syama 1 96h Mot d'ordre suspendu
SFTP Syama 1 96h Mot d'ordre levé
SFTP Syama 1 96h Mot d'ordre levé
Enseignement catholique de Sikasso 1 120h Mot d'ordre observé
SFTP Syama 1 120h Mot d'ordre levé
Enseignement catholique 1 120h Mot d'ordre levé
Total 9 - -
GAO
ECOLOG 1 144h Mot d'ordre observé
Secteur du Développement rural 1 72h Mot d'ordre levé
Secteur public et privé 1 72h Mot d'ordre observé
Total 3 - -
BOUGOUNI
Faboula Gold 1 72h Mot d'ordre levé
Escorte Sécurité KOMANA 1 48h Mot d'ordre levé
Total 2 - -
BAMAKO
UBIPHARM MALI SA 1 72h Mot d'ordre levé
MADAR 1 48h Mot d'ordre levé
Mairie de la Commune II du District
de Bamako
1 72h Mot d'ordre observé
UBA Bank 1 48h Mot d'ordre levé
Enseignement catholique de
Bamako
1 120h Mot d'ordre levé
Ecole Privée "Kalanso 2" 1 ND Mot d'ordre levé
GEXTEL 1 48h Mot d'ordre levé
ECOSUP 1 72h Mot d'ordre observé
Polyclinique d'Iran 1 48h Mot d'ordre levé
Total 9 - -
NIVEAU
NATIONAL
Etablissements d'enseignement 1 120h Mot d'ordre observé
PMU MALI 1 72h Mot d'ordre levé
Etablissements d'enseignement 1 Illimitée Mot d'ordre levé
Télécommunications 1 120h Mot d'ordre retiré
UBI PHARMA MALI SA 1 72h Mot d'ordre observé
Total Energy, Vivo Energy, Ola
Energy et Oryx Energy
1 72 Mot d'ordre observé
Total Energy, Vivo Energy, Ola
Energy et Oryx Energy
1 120h Mot d'ordre observé
Banque UBA 1 48h Mot d'ordre suspendu
 |
99 99 |
▲back to top |
86
REGION/NIVEAU
NATIONAL
ENTREPRISES
CONCERNEES PAR LA
GREVE
NOMBRE
DE
CONFLITS
DUREE DE
LA GREVE
OBSERVATIONS
BIM SA 1 72h Mot d'ordre suspendu
OSTAR OIL 1 Illimitée Mot d'ordre suspendu
ORABANK SA 1 72h Mot d'ordre suspendu
ASECNA-MALI 1 72h Mot d'ordre observé
Banque of Africa Mali 1 72h Mot d'ordre observé
BTL MALI/PSM 1 72h Mot d'ordre observé
Yara Oil 1 72h Mot d'ordre suspendu
Association BEREBEN 1 72h Mot d'ordre observé
Sociétés de transports SYNACOR 1 Illimitée Mot d'ordre observé et
suspendu par la suite
Association BEREBEN 1 96h Mot d'ordre observé
Atlantique Microfinance 1 72h Mot d'ordre observé et
suspendu par la suite
Institut Géographique du Mali 1 72h Mot d'ordre suspendu
Total 20 - -
TOTAL GENERAL 58 préavis de grève gérés
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
6.2. Visas de contrats de travail
En 2022, ce sont 40 988 contrats de travail qui ont été établis dont 15 149 Contrats à Durée
Indéterminé (CDI) et 25 839 de Contrats à Durée Déterminée (CDD).
L’analyse par sexe révèle que d’une manière générale, les hommes avaient bénéficié de plus de
contrats de travail que les femmes. En effet, plus du triple des visas de contrats de travail dans
l’ensemble ont bénéficié aux hommes, soit 19 581 CDD et 11 622 CDI pour les hommes contre
6 258 et 3 527 enregistrés chez les femmes.
Par localité, c’est le District de Bamako qui enregistrait le plus grand nombre de visa de
contrats, soit 22 521 au total en 2022, suivi de la région de Kayes et celle de Sikasso. En termes
de valeurs extrêmes, on note qu’aucun visa de contrat CDD n’a été enregistré pour les femmes
à Nioro contre seulement deux (2) visas de contrat CDI au bénéfice des femmes dans la même
localité, alors que les hommes bénéficiaient respectivement de 42 et de 32 CDD et CDI. La
région de Ménaka, non industrialisée et faiblement urbanisée présente zéro contrat CDI et 161
CDD pour les deux sexes.
D’une manière générale, quel que soit le sexe, la répartition spatiale du nombre de visas de
contrats de travail, montre que les régions de Kidal, Taoudenni, Ménaka situées au nord du pays
et les régions un peu plus au centre et à l’Ouest constituées de Douentza, Nioro, Dioïla, Nara et
San enregistrent de très faibles nombres de Visas de contrat. Ces régions ont en commun un
certain nombre d’aspects tel que l’insécurité omniprésente, une faible densité démographique
et un faible taux d’urbanisation.
 |
100 100 |
▲back to top |
87
Tableau 80: Visa de contrats de travail
Région
Contrats à durée Déterminée (CDD) Contrats à durée Indéterminée (CDI) Total
général Homme Femme Total Homme Femme Total
Kayes 1 564 194 1 758 1 555 222 1 777 3 535
Koulikoro 732 257 989 1 157 398 1 555 2 544
Sikasso 1 068 209 1 277 1 277 185 1 462 2 739
Ségou 1 408 323 1 731 560 217 777 2 508
Mopti 1 308 400 1 708 504 152 656 2 364
Tombouctou 659 176 835 218 34 252 1 087
Gao 1 355 198 1 553 482 58 540 2 093
Kidal 97 7 104 35 2 37 141
Taoudenni 8 4 12 48 3 51 63
Ménaka 126 35 161 - - - 161
Bougouni 298 42 340 59 36 95 435
Dioïla 4 1 5 28 3 31 36
Nioro 42 - 42 32 2 34 76
Koutiala 120 118 238 142 34 176 414
Nara 15 4 19 6 4 10 29
San 60 20 80 43 12 55 135
Douentza 80 28 108 7 2 9 117
Bamako 10 637 4 242 14 879 5 469 2 163 7 632 22 511
Total 19 581 6 258 25 839 11 622 3 527 15 149 40 988
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
En termes de visa des contrats de travailleurs expatriés, l’analyse des données du tableau 78,
indique clairement que ce sont les pays de la CEDEAO qui réunissent le plus grand nombre de
travailleurs maliens avec 551, dont 382 CDD et 169 CDI, suivis des autres pays d’Afriques
regroupant ensemble 300 visas de contrat. L’Amérique enregistre le plus petit nombre de Visas,
avec 17 au total, dont 16 CDD et 1 CDI.
La répartition selon le sexe montre une tendance globalement analogue au précèdent cas, à
savoir plus de visas de contrat aux hommes avec 999 au total sur les 1134, CDD et CDI
combinés. Cette structure générale de faible bénéficiaire féminin, se retrouve au niveau de tous
les continents. Aucun visa de contrat n’a été enregistré au bénéficie des femmes sur les
continents d’Amérique et d’Océanie.
 |
101 101 |
▲back to top |
88
Tableau 81: Visa des contrats des travailleurs expatriés
Zones
CDD CDI Total
général Homme Femme Total Homme Femme Total
CEDEAO 334 48 382 155 14 169 551
Autres pays d’Afriques 236 17 253 38 9 47 300
Amériques 16 0 16 1 0 1 17
Europe 57 35 92 3 4 7 99
Asie, Proche et Moyen-Orient 117 7 124 13 1 14 138
Océanie 29 0 29 0 0 0 29
Total 789 107 896 210 28 238 1134
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
6.3. Règlement des litiges individuels
Le rapport annuel d’activité de la Direction Nationale du Travail (DNT), montrait qu’en 2022,
sur l’ensemble du territoire, et en termes de litiges individuels, 1 240 litiges restaient soumis ;
849 litiges réglés en conciliation ; 364 transmis au tribunal et 23 classés en instance.
Sur l’ensemble des litiges soumis, 766 cas étaient enregistrés à Bamako, alors que la nouvelle
région de Diola n’a vu que deux soumissions.
Au regard des données transmises par la DNT, on peut déduire que les travailleurs et
employeurs arrivent à un règlement en conciliation dans la plupart des cas (soit dans 540 cas).
La région de Taoudenni et San, sont les seuls à n’avoir enregistré aucun litige transmis au
tribunal. Dans la région de Kayes cependant, les litiges sont plutôt transmis au tribunal que
réglé en conciliation (soit 35 cas contre 26).
Tableau 82: Litiges individuels selon le règlement et par région
Région
Litiges
soumis
Litiges réglés en
conciliation
Litiges transmis au
Tribunal
Litiges classés en
instance
Kayes 69 26 35 8
Koulikoro 120 89 31 0
Sikasso 34 17 17 0
Ségou 106 64 42 0
Mopti 84 69 15 0
Tombouctou 17 16 1 0
Gao 10 2 3 5
Taoudenni 6 6 0 0
Bougouni 14 10 1 2
Dioïla 2 0 2 0
Koutiala 3 1 2 0
San 9 9 0 0
Bamako 766 540 215 8
Total général 1 240 849 364 23
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
6.4. Accidents de travail et maladies professionnelles
Le tableau 80 résume les accidents de travail et maladies professionnelles survenues par région.
On constate ainsi que 211 accidents de travail et maladies professionnelles ont été déclarés dont
 |
102 102 |
▲back to top |
89
les plus fréquents enregistrés à Bamako, avec113 cas, Bamako est suivi de Kayes avec 35 cas.
San et Tombouctou n’avaient enregistré qu’un seul cas chacun. On constate que la plupart des
accidents et maladies rapportés ont fait l’objet d’une enquête, à l’exception des régions de
Kayes et Koulikoro où le nombre d’enquêtes (respectivement à 21 et 6 enquêtes), est inférieure
au nombre d’accidents et maladies professionnelles rapportés (Respectivement de 35 et 15). En
outre, peu de cas n’ont pas fait l’objet d’arrêt de travail. En effet, quelle que soit la région, au
total 28 accidents n’ont pas fait objet d’arrêt de travail.
On note également que dans sept (7) cas, l’accident ou la maladie professionnelle a été mortelle.
Ce sont les régions de Kayes, Ségou, Tombouctou et Bougouni qui n’ont rapporté aucun
accident ou maladie professionnelle mortelle.
Tableau 83: Accident de travail et maladies professionnelles par région
Région
Nombre de
cas
d’accidents
déclarés
Enquêtes
Cas
Mortels
Incapacités Nombre
d’accident
sans arrêt de
travail
IT de 1 à
4 j
P/t 10 de 5
j à 1 mois
P/ t 11 de
plus d’un
mois
PP 100
Kayes 35 21 0 2 4 7 0 8
Koulikoro 15 6 1 0 1 1 0 2
Sikasso 18 18 1 0 2 4 0 11
Ségou 6 6 0 0 6 0 0 0
Tombouctou 1 1 0 0 0 1 0 0
Gao 2 2 1 1 0 0 0 0
Bougouni 2 2 0 0 1 1 0 0
Koutiala 18 17 1 10 6 1 0 0
San 1 1 1 0 0 0 0 0
Bamako 113 112 2 13 33 57 0 7
Général 211 186 7 26 53 72 0 28
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
6.5. Licenciements des travailleurs par branche d’activités et par motif de licenciement
L’analyse des données du tableau 81, révèle qu’en 2022, un total de 2697 licenciement de
travailleurs a été constaté par la DNT. Parmi ces cas, on remarque que les situations les plus
fréquentes étaient constitués de fautes professionnelles/mauvaise manière de servir/manque de
confiance ou insécurité (soit 465 cas), pouvant être imputés aux travailleurs, suivi des cas
d’abandon ou de démission (soit 301 cas). Les licenciements les plus fréquents étaient d’ordre
économique avec 1833 cas. Aucun cas de décès et maladie n’a été rapporté comme motif de
licenciement. On note également que le District de Bamako a enregistré la majorité des cas de
licenciement dus à des fautes lourdes, soit 66 sur les 67 situations enregistrées avec un seul cas
enregistré à Ségou.
Par région, les cas les plus fréquents de licenciement étaient observés dans la région de Sikasso
(1 219 cas) suivie de Bamako avec 660. La région de Ménaka, déjà pauvre en termes de visa
de contrat enregistre le plus petit nombre de cas, seulement deux dont un cas de faute
professionnelle et un autre cas d’abandon ou de démission.
 |
103 103 |
▲back to top |
90
Tableau 84: Licenciement des travailleurs par région et par motif
Région
Motif
Total Motif
économique
Fautes professionnelles/ Mauvaise
manière de servir/ Manque de
confiance/ Insécurité
Abandon/
Démission
Rupture
conventionnelle
Décès et
maladies
Fautes
lourdes/ Vol
Kayes 233 75 20 2 0 0 330
Koulikoro 121 45 8 7 0 0 181
Sikasso 1 203 12 2 2 0 0 1 219
Ségou 58 9 10 0 0 1 78
Mopti 55 20 6 1 0 0 82
Tombouctou 46 9 12 4 0 0 71
Gao 11 25 5 0 0 0 41
Kidal 31 0 2 0 0 0 33
Ménaka 0 1 1 0 0 0 2
Bamako 75 269 235 15 0 66 660
Total 1 833 465 301 31 0 67 2 697
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
Courant l’année 2022, les données de la DNT montrent à partir du tableau 82 que les branches
d’activité ayant enregistré le plus fréquemment de licenciements sont constitués par les services
fournis à la collectivité-services sociaux et services personnels (585 cas en tout à travers les
régions), sans comptabiliser les secteurs d’activités non définies de Bamako.
Les licenciements sur tout le territoire dans cette branche (collectivité-services sociaux et
services personnels) d’activité étaient principalement dus à des raisons économiques. Ce chiffre
doit ainsi constituer une préoccupation des gouvernants vu la sensibilité de la question du travail
parce qu’elle impacte directement la politique de décentralisation du pays. Le motif de départ
à la retraite est donné uniquement à Kayes tandis que le motif d’invalidité apparait uniquement
à Tombouctou, soit un seul cas. La région de Tombouctou présente le plus grand nombre de
motif dont le plus fréquent est d’ordre économique avec 401cas enregistrés par la DNT.
D’ailleurs, dans l’ensemble du pays, la plupart des licenciements étaient dus à des motifs
économiques (soit 995), suivis des motifs de fautes professionnelles. Le District de Bamako,
plus riche en contrats de travail et mieux urbanisé que le reste du pays, est la seule localité où
au moins tous les motifs étaient évoqués à l’exception de l’invalidité ou du départ à la retraite.
 |
104 104 |
▲back to top |
91
Tableau 85: licenciement des travailleurs par région et par motif du 1er janvier au 31 décembre
2022
Région
Branches17
d’activités
économiques
Cas de rupture
Motif
écono-
mique
Fautes
profes-
sionnelles
Fautes
lourdes
Abandon
de poste
Démis-
sion
Rupture
conven-
tionnelle
Inva-
lidité
Départ
à la
retraite
Total
Kayes
2 166 140 0 12 5 3 0 10 336
4 1 0 0 0 1 1 0 0 3
5 47 1 0 1 0 0 0 0 49
6 21 5 0 2 0 0 0 0 28
8 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 1 8 1 1 1 0 0 0 12
10 2 8 0 2 0 0 0 0 12
Total 238 163 1 18 7 4 0 10 441
Koulikoro
3 15 12 0 3 0 0 0 0 30
4 13 2 0 0 0 0 0 0 15
5 5 1 0 3 0 1 0 0 10
6 11 0 0 0 0 0 0 0 11
9 24 21 0 2 0 0 0 0 47
Total 68 36 0 8 0 1 0 0 113
Sikasso
1 24 10 0 0 0 0 0 0 34
2 47 36 0 2 1 11 0 0 97
10 0 0 0 4 4 0 0 0 8
Total 71 46 0 6 5 11 0 0 139
Ségou
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 1 0 2 12 0 0 0 0 15
6 1 0 3 7 4 0 0 0 15
7 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 0 1 2 0 0 0 0 0 3
9 11 0 0 0 0 0 0 0 11
10 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Total 16 2 7 21 4 0 0 0 50
Mopti 9 52 15 0 7 0 0 0 0 74
Tombouctou
5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 22 4 0 4 4 7 0 0 41
10 0 1 0 4 0 0 1 0 6
Total 22 6 0 8 4 7 1 0 48
GAO 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17
1 = Agriculture, Chasse, Sylviculture et Pêche
2 = Industrie extractive
3 = Industrie manufacturière
4 = Electricité-Gaz et Eau
5 = Bâtiments et Travaux Publics
6= Commerces Gros-Détails-Hôtel-Restaurants
7 = Transports-Entrepôts-Communication
8 = Banques-assurances et Affaires Immobilières
9 = services fournis à la collectivité-services sociaux et services personnels
10 = Secteurs mal définis.
 |
105 105 |
▲back to top |
92
Région
Branches17
d’activités
économiques
Cas de rupture
Motif
écono-
mique
Fautes
profes-
sionnelles
Fautes
lourdes
Abandon
de poste
Démis-
sion
Rupture
conven-
tionnelle
Inva-
lidité
Départ
à la
retraite
Total
8 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 401 11 4 7 4 2 0 0 429
Total 401 12 4 7 5 2 0 0 431
Kidal 9 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Taoudenni 9 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Bougouni 2 3 0 0 2 0 10 0 0 15
Dioïla
4 1 1 0 0 0 0 0 0 2
8 0 2 0 0 0 0 0 0 2
9 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Total 4 3 0 2 0 10 0 0 19
Koutiala
6 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 2 0 2 0 0 0 0 4
10 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 1 3 0 2 0 0 0 0 6
San
6 0 3 0 1 4 0 0 0 8
9 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 0 3 0 2 4 0 0 0 9
Douentza 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bamako ND 121 281 106 313 175 42 0 0 1038
Ensemble 995 573 119 396 204 77 1 10 2 375
Source : Rapport annuel d’activités 2022, Direction nationale du travail (DNT)
 |
106 106 |
▲back to top |
93
7. Migration
En considérant l’évolution de l’ensemble des maliens reconduits à la frontière de 2016 à 2022,
on constate une augmentation globale du nombre des reconduits passant de 1 065 en 2016 à
6 574 en 2022, avec un pic constaté en 2019 de 8 202 personnes et une baisse légère entre 2021
et 2022. La seule année qui a enregistré une baisse notoire de cette tendance fut en 2022 quand
seulement 1 679 personnes ont été reconduites aux frontières. Ces chiffres, cependant doivent
être pris avec précaution en tenant compte du contexte sécuritaire national.
Par continent, c’est le continent africain qui a reconduit plus de monde et quelle que soit l’année,
avec un maximum de 7 546 reconduites observées en 2018 et de 29 248 au total, depuis 2016.
Après l’Afrique, c’est le continent Asie-Océanie qui a procédé a plus de reconduites, avec 2
571 depuis 2016 et le plus grand contingent en 2019 (soit 632). Et enfin, quel que soit le
continent, l’année 2019 a été marqué par une reconduite record de maliens aux frontières, soit
un minimum de 600 par continent et un maximum de 5 412 en Afrique.
Tableau 86: Evolution des effectifs des maliens reconduits par continent de 2016 à 2022
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Afrique 553 2 773 7 546 5 412 1 679 4 718 6 567 29 248
Europe 61 3 13 1 129 22 63 7 1 298
Amérique 2 7 14 1 029 10 1 0 1 063
Asie-Océanie 449 370 420 632 204 496 0 2 571
Total 1 065 3 153 7 993 8 202 1 915 5 278 6 574 34 180
Source : Annuaire statistique 2022, CPS/CI
Le Tableau 84, renseigne sur l’évolution des indicateurs clés de la migration de 2018 à 2022.
Vu la diversification des indicateurs, une analyse de l’évolution par indicateur, serait à même
d’offrir plus d’informations sur le tableau. Ainsi en commençant par le RAVEC, en 2021 et
2022 aucun enregistrement n’a eu lieu, ceci est dû au changement de mécanisme par les
autorités à l’époque à cause du faible taux de recensement de la population en général et des
maliens de l’extérieur en particulier. Pour les années de 2018 à 2020 cependant, l’état a
enregistré un total de 452 900 personnes à travers ses chancelleries à l’étranger. Quant au
nombre de CIC envoyé dans les MDC et Passeports transmis aux MDC, on note une évolution
en dents de scie avec des pics observés en 2021 pour les deux (soit respectivement 121 000 et
23 996).
Pour les projets de réinsertion de femmes qui étaient à 130 en 2019, aucun n’a été enregistré en
2022. La même année a enregistré également le plus grand nombre de maliens à l’extérieur
réinsérés soit 1802 et aucun enregistrement en 2022. En outre, dans le cadre du TOKTEN,
aucune thèse de doctorat encadré et aucune nouvelle structure n’a fonctionné en 2020, 2021 et
2022. Et enfin, les missions de sensibilisation en faveur des maliens de l’extérieur qui ont
également évolué en dents de scie, sont en légère hausse, avec 7 missions enregistrées en 2022
contre 3 l’année qui a précédée.
 |
107 107 |
▲back to top |
94
Tableau 87: Evolution des indicateurs clés de la migration de 2018 à 2022
2018 2019 2020 2021 2022
CIC envoyées dans les MDC 92 100 111 200 86 000 121 000 28 000
Passeports transmis aux MDC 19 590 7 190 11 612 23 996 18 578
Projets de réinsertion de femmes financés 4 130 10 59 0
Maliens de l’extérieur insérés ou réinsérés 568 1 802 230 392 0
Thèses de doctorat encadrées dans le cadre du TOKTEN 2 4 0 0 0
Nouvelles structures enregistrées dans le cadre du TOKTEN 3 3 0 0 0
Maliens de l'extérieur recensés à travers le RAVEC 452 900 452 900 452 900 0 0
Dossiers litigieux traités 3 6 9 4 4
Missions d'identification et de sensibilisation en faveur des
maliens de l'extérieur
4
8
2
3
7
Total 565 174 573 243 97 863 598 354 46 589
Source : Annuaire statistique 2021, CPS/CI
Outre l’évolution des indicateurs clés de la migration, la tendance générale de l’évolution du
transfert de fonds des migrants indiquée par le graphique 6 est croissante, en dents de scie, avec
des périodes de forts transferts observés en 2019 d’un montant total de 587 milliards de FCFA.
Ce montant chute cependant considérablement l’année suivante jusqu’à seulement 479,8
milliards en 2020, année marquée par la crise de la COVID 19, pour répartir en légère hausse
en 2021 et 2022.
Source : Annuaire statistique 2022, CPS/CI
Graphique 6: Evolution du transfert de fonds des migrants en milliards de F CFA de 2012 à 2022
317,0
430,0 431,0
471,0 485,6
486,7
538,0
587,0
479,8
516,6 507,6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 |
108 108 |
▲back to top |
95
Conclusion et Recommandations
1. Conclusion
Le rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail est une réponse à la
demande croissante d’informations statistiques sur le marché du travail. Les données du présent
rapport sont un ensemble des statistiques officielles qui traitent de la main-d’œuvre, de
l’éducation, l’enseignement, les comptes nationaux, la démographie, le marché du travail et de
leurs caractéristiques. L’objectif général de ce rapport est de produire un ensemble
d’informations sur le marché du travail axé sur les données de l’année 2022.
Ce rapport est une compilation des données des structures publiques et parapubliques du Mali.
Après la revue documentaire en vue d’améliorer les précédentes productions (prendre en
compte les nouvelles réalités du marché du travail), une série de visites dans les structures
productrices ou détentrices a été menée par l’ONEF afin de recueillir ces informations. Ensuite,
ces informations sont traitées, analysées, et enfin ces informations sont examinées par le comité
technique et validées par le comité scientifique de l’ONEF.
Il y a une amélioration de l’activité économique par rapport à l’année précédente, mais
l’insécurité affecte les services sociaux de base tels que l’éducation, la santé et la liberté de
circulation. Les universités et les grandes écoles continuent à recevoir un nombre de plus en
plus important d’étudiants pendant que le nombre d’apprenants des centres de formation
professionnelle diminue.
Comme la population globale, la population en âge de travailler connait une augmentation, mais
le taux d’activités connait une baisse en 2022. Bien qu’il y ait des efforts pour améliorer le
marché du travail malien, l’informalité, la précarité et le bas salaire restent les caractéristiques
structurelles de l’emploi au Mali.
Les autorités maliennes étendent la sécurité sociale au-delà des employés et employeurs. La
sécurité sociale concerne aussi les indigents à travers le Régime d’Assistance Médicale
(RAMED). Les associations de santé communautaire et les mutuelles de santé jouent un rôle
important au volet santé de la sécurité sociale.
Dans un pays où le principal motif de licenciement est la conjoncture économique néfaste, le
dialogue social joue un rôle important dans la gestion des conflits, litiges individuels et d’autres
aspects du travail décent.
Les maliens reconduits proviennent principalement des pays d’Afrique. En 2022, le nombre des
cartes d’identité consulaire et de passeports envoyés dans les missions diplomatiques et
consulaires a fortement baissé. Même le volume du transfert de fonds des migrants connait une
légère diminution.
 |
109 109 |
▲back to top |
96
2. Recommandations
Le Rapport d’Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail de 2022 a permis de
faire des constats. A travers ces constats nous pouvons faire des recommandations suivantes :
Pour à la fois améliorer l’employabilité des jeunes et réduire nombre d’années des
études supérieures, les autorités de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la formation professionnelle doivent mutualiser leurs efforts afin que plus la moitié
des élèves qui décrochent le diplôme d’études fondamentales puissent suivre une
formation professionnelle répondant au besoin réel du marché du travail ;
Avec une croissance rapide de la population et un marché du travail caractérisé par
l’informalité, la précarité et le bas salaire, les autorités en charge de la promotion de
l’investissement, de la création d’entreprise et de la promotion d’emploi doivent
multiplier la sensibilisation afin de promouvoir la création d’emploi en améliorant les
mécanismes existant de facilitation relatifs à la création d’entreprises, à la promotion
des investissements et la reconversion professionnelle.
Copyright @ 2024 | ONEF .