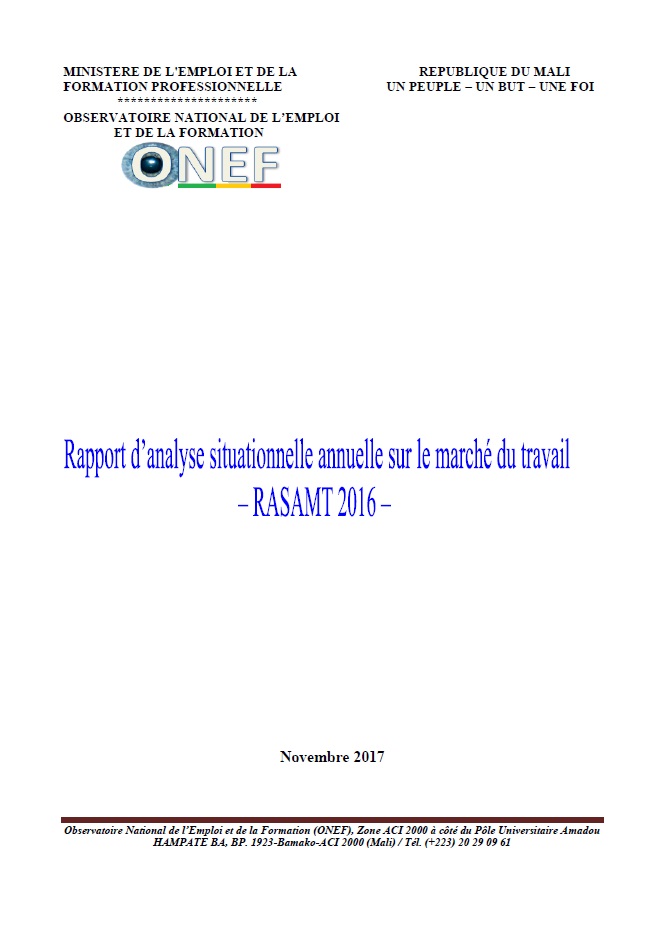MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA REPUBLIQUE DU MALI FORMATION PROFESSIONNELLE UN PEUPLE – UN...
 |
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA REPUBLIQUE DU MALI FORMATION PROFESSIONNELLE UN PEUPLE – UN... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA REPUBLIQUE DU MALI
FORMATION PROFESSIONNELLE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Novembre 2017
Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF), Zone ACI 2000 à côté du Pôle Universitaire Amadou
HAMPATE BA, BP. 1923-Bamako-ACI 2000 (Mali) / Tél. (+223) 20 29 09 61
 |
2 2 |
▲back to top |
i
Table des matières
Liste des tableaux ........................................................................................................................................... iii
Liste des graphiques ....................................................................................................................................... iv
Sigles et abréviations ....................................................................................................................................... v
Résumé ........................................................................................................................................................... vii
Introduction ..................................................................................................................................................... 1
1. Définitions des concepts .................................................................................................................. 3
1.1. Population en emploi ......................................................................................................................... 3
1.2. Travail................................................................................................................................................ 3
1.3. Population en âge de travailler .......................................................................................................... 3
1.4. Chômeur ............................................................................................................................................ 3
1.5. Chômeur découragé ........................................................................................................................... 3
1.6. Chômage combiné à la main-d'œuvre potentielle .............................................................................. 3
1.7. Main-d'œuvre ..................................................................................................................................... 4
1.8. Taux d'emploi .................................................................................................................................... 4
1.9. Taux d'emploi informel ..................................................................................................................... 4
2. Situation économique, financière, sociale et démographique ...................................................... 5
2.1. Situation économique ........................................................................................................................ 5
2.2. Situation financière ............................................................................................................................ 6
2.3. Situation sociale ................................................................................................................................. 6
2.3.1. Education ................................................................................................................................... 6
2.3.2. Santé .......................................................................................................................................... 8
2.4. Situation démographique ................................................................................................................... 9
3.1. Enseignement technique et professionnel ........................................................................................ 11
3.2. Enseignement supérieur ................................................................................................................... 12
3.2.1. Universités et instituts ............................................................................................................. 13
3.2.2. Grandes écoles ......................................................................................................................... 17
3.3. Ressources humaines formées à l’extérieur du Mali en 2016 ......................................................... 21
3.4. Formation professionnelle ............................................................................................................... 23
4. Marché du travail .......................................................................................................................... 28
4.1. Situation de l’emploi et du chômage ............................................................................................... 28
4.1.1. Population active et taux d’activités ........................................................................................ 28
4.1.2. Taux d'emploi informel ........................................................................................................... 30
4.1.3. Emploi selon le secteur institutionnel ...................................................................................... 31
4.1.4. Chômage .................................................................................................................................. 31
4.1.5. Sous-emploi lié à la durée du travail ...................................................................................... 31
4.1.6. Inactivité .................................................................................................................................. 32
4.2. Intermédiation .................................................................................................................................. 34
4.2.1. Demandes d’emplois ............................................................................................................... 34
4.2.2. Offres d’emplois ...................................................................................................................... 36
4.2.3. Placements ............................................................................................................................... 38
4.3. Créations d’emplois et employabilité .............................................................................................. 40
5. Sécurité sociale ............................................................................................................................... 46
5.1. Direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire .......................................... 46
5.2. Caisse Malienne de Sécurité Sociale ............................................................................................... 46
5.3. Institut national de prévoyance sociale ............................................................................................ 48
5.3.1. Les cotisations ......................................................................................................................... 48
5.3.2. Les prestations ......................................................................................................................... 48
5.3.3. Les prestations des structures socio-sanitaires ........................................................................ 50
5.3.4. Les conventions internationales de sécurité sociale ................................................................ 52
6. Dialogue social ............................................................................................................................... 54
6.1. Gestion des conflits collectifs .......................................................................................................... 54
 |
3 3 |
▲back to top |
ii
6.2. Contrôle de légalité des contrats de travail ...................................................................................... 55
6.3. Règlement des litiges individuels ................................................................................................... 56
6.4. Accidents de travail et maladies professionnelles ........................................................................... 56
6.5. Licenciements des travailleurs par branche d’activités et par motif des licenciements .................. 57
7. Migration internationale de retour .............................................................................................. 59
7.1. Pays de séjour des migrants de retour.............................................................................................. 59
7.2. Insertion socioprofessionnelle des migrants de retour en emploi .................................................... 60
Conclusion et recommandations .................................................................................................................. 63
Annexe ............................................................................................................................................................ 65
Annexe 1. Evolution de la balance des paiements de 2012 à 2016 (en milliards fcfa) ............................... 65
Annexe 2. Evolution du TOFE de 2012 à 2016 .......................................................................................... 66
 |
4 4 |
▲back to top |
iii
Liste des tableaux
Tableau 1. Croissance du PIB réel, de la consommation des ménages et de l'investissement (en %) ....................................... 5
Tableau 2. Evolution de la part des secteurs dans le PIB (en %) ............................................................................................... 6
Tableau 3. Evolution des indicateurs de la formation professionnelle (en %) ........................................................................... 7
Tableau 4. Etat nutritionnel en 2015 (en %) .............................................................................................................................. 8
Tableau 5. Couverture vaccinale des enfants de 12-23 mois en 2015 (en %) ............................................................................ 9
Tableau 6. Protection contre le paludisme/fièvre en 2015 (en %) ............................................................................................. 9
Tableau 7. Projection de la population en 2016 (en milliers d'habitants) ................................................................................ 10
Tableau 8. Résultat des examens de l'enseignement technique et professionnel par niveau de diplôme ................................. 11
Tableau 9. Répartition des étudiants du CERFITEX par type de diplôme .............................................................................. 11
Tableau 10. Résultats de fin de cycle des IFM ........................................................................................................................ 12
Tableau 11. Résultat du Bac par série ...................................................................................................................................... 12
Tableau 12. Répartition des étudiants des Universités du Mali ............................................................................................... 13
Tableau 13. Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par faculté et par filière ........................................................ 14
Tableau 14. Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par année d'étude et par filière ............................................. 14
Tableau 15. Répartition des étudiants de l'université de Ségou par statut et par année ........................................................... 15
Tableau 16. Répartition des étudiants de l'ULSHB par année et par sexe ............................................................................... 15
Tableau 17. Répartition des étudiants de l'USJPB par année et par sexe ................................................................................. 16
Tableau 18. Répartition des étudiants de l'USSGB par année d'étude et par sexe ................................................................... 16
Tableau 19. Répartition des étudiants de l'USTTB par année d'étude et par sexe ................................................................... 17
Tableau 20. Répartition des étudiants des grandes écoles par genre ....................................................................................... 17
Tableau 21. Répartition des étudiants finalistes de l'ENI par filière et genre .......................................................................... 17
Tableau 22. Répartition des étudiants de l'ENSUP par cycle et par filière 2015-2016 ............................................................ 19
Tableau 23. Situation des diplômés de l'IPR/ISFRA 2016 ...................................................................................................... 20
Tableau 24. Insertion des diplômés de l'IPR/ISFRA en 2016 .................................................................................................. 21
Tableau 25. Répartition des étudiants par type diplôme obtenu .............................................................................................. 22
Tableau 26. Indicateurs de la formation professionnelle ......................................................................................................... 24
Tableau 27. Evolution des effectifs dans les CFP .................................................................................................................... 24
Tableau 28. Effectifs d’apprenants passés par la certification ou la validation des acquis de l’expérience............................. 25
Tableau 29. Evolution des apprenants dans les dispositifs d’éducation non formelle ............................................................. 25
Tableau 30. Formation de la population active au 31 octobre 2016 (en millions fcfa et %) .................................................... 25
Tableau 31. Synthèse des projets soumis au PAPAM Koulikoro et Sikasso (en millions fcfa et %) ...................................... 26
Tableau 32. Répartition de la population en âge de travailler par statut vis-à-vis de la main-d'œuvre .................................... 28
Tableau 33. Répartition de la population active ou main d’œuvre .......................................................................................... 29
Tableau 34. Taux d’activités par caractéristique sociodémographique (en %) ........................................................................ 30
Tableau 35. Taux d’emploi informel selon le sexe (en %) ...................................................................................................... 30
Tableau 36. Répartition des actifs occupés par secteur institutionnel ...................................................................................... 31
Tableau 37. Evolution du taux de chômage de 2013 à 2016.................................................................................................... 31
Tableau 38. Taux de sous-emploi ............................................................................................................................................ 32
Tableau 39. Répartition des inactifs par raison d'inactivité ..................................................................................................... 33
Tableau 40. Répartition des inactifs selon les moyens utilisés pour survivre .......................................................................... 34
Tableau 41. Demandes d’emploi enregistrées par caractéristique sociodémographique ......................................................... 35
Tableau 42. Demandes d’emploi enregistrées par qualification et métier demandé ................................................................ 36
Tableau 43. Offres d’emploi enregistrées par Bureaux caractéristique sociodémographique ................................................. 36
Tableau 44. Offres d’emploi enregistrées par qualification et métier offert ............................................................................ 37
Tableau 45. Offres d’emploi enregistrées par branche d’activités de l’entreprise ................................................................... 38
Tableau 46. Placements effectués par caractéristique sociodémographique ............................................................................ 39
Tableau 47. Placements effectués selon la qualification et le métier ....................................................................................... 39
Tableau 48. Evolution des emplois créés de 2013 à 2016 ....................................................................................................... 40
Tableau 49. Répartition du nombre d’emplois créés par le secteur privé ................................................................................ 41
Tableau 50. Répartition du nombre d’emplois publics créés par département ministériel ...................................................... 41
Tableau 51. Dispositif de formation et de qualification 2016 .................................................................................................. 42
Tableau 52. Nombre de jeunes inscrits au programme de stage de formation professionnelle ............................................... 42
Tableau 53. Nombre de jeunes inscrits au programme de stage de formation professionnelle par diplôme et région ............ 43
Tableau 54. Répartition des demandes de formation enregistrées en CREE, GERME et autres modules .............................. 43
Tableau 55. Répartition des projets financés par l’APEJ en 2016 par région, par filière et par sexe ...................................... 44
 |
5 5 |
▲back to top |
iv
Tableau 56. Répartition des candidatures reçues pour les formations du PROCEJ (en entreprenariat simplifié) ................... 44
Tableau 57. Répartition des jeunes sélectionnés et formés en entreprenariat simplifié PROCEJ ............................................ 45
Tableau 58. Répartition des pensionnés de la CMSS par sexe ................................................................................................ 47
Tableau 59. Répartition des pensionnés de la CMSS par région ............................................................................................. 47
Tableau 60. Recettes de cotisation par nature (en millions fcfa) ............................................................................................ 48
Tableau 61. Situation des demandes de prestations des trois dernières années ....................................................................... 49
Tableau 62. Répartition du nombre des bénéficiaires par catégorie ........................................................................................ 49
Tableau 63. Répartition du nombre des bénéficiaires par branche et montant des prestations ................................................ 49
Tableau 64. Répartition des bénéficiaires de pensions par type de pension et par sexe .......................................................... 50
Tableau 65. Répartition des bénéficiaires d'allocations familiales et du nombre d’enfants par région.................................... 50
Tableau 66. Analyse des prestations en faveur des accidentés de travail ................................................................................ 51
Tableau 67. Activités de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles ..................................................... 51
Tableau 68. Activités médicales .............................................................................................................................................. 52
Tableau 69. Prestations en faveur des assurés AMO selon la convention INPS/CANAM ...................................................... 52
Tableau 70. Situation des prestations payées aux travailleurs maliens de l’extérieur .............................................................. 53
Tableau 71. Situation des pensions et rentes maliennes payées à l’extérieur .......................................................................... 53
Tableau 72. Répartition des conflits collectifs par caractéristique sociodémographique......................................................... 54
Tableau 73. Visa de contrats de travail (en %) ........................................................................................................................ 55
Tableau 74. Visa des contrats des travailleurs expatriés .......................................................................................................... 56
Tableau 75. Litiges individuels selon le règlement et par région (en %) ................................................................................. 56
Tableau 76. Accident de travail et maladies professionnelles par branche d’activités ............................................................ 57
Tableau 77. Licenciement des travailleurs par branche d’activités et motif ............................................................................ 58
Tableau 78. Répartition des migrants de retour par pays ......................................................................................................... 60
Tableau 79. Taux d'insertion socioprofessionnelle des migrants de retour en emploi (en %) ................................................ 61
Tableau 80. Répartition de la population de migrants de retour en emploi selon les branches d'activités ............................... 62
Liste des graphiques
Graphique 1: Pyramide des âges en 2016 ................................................................................................................................ 10
Graphique 2: Répartition des sortants (4ème année) PEF ......................................................................................................... 18
Graphique 3: Répartition des diplômes obtenus par domaine de formation ............................................................................ 22
Graphique 4: Répartition des étudiants par pays d'accueil....................................................................................................... 23
Graphique 5: Répartition des demandes d'immatriculation à l'AMO ...................................................................................... 47
Graphique 6: Répartition des montants de prestations accidents de travail et maladies professionnelles (en millions fcfa) ... 51
 |
6 6 |
▲back to top |
v
Sigles et abréviations
AE Académie d’enseignement
AMO Assurance maladie obligatoire
AMV Assurance maladie volontaire
ANAM Agence nationale de l’assistance médicale
ANPE Agence nationale pour l’emploi
APEJ Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes
BT Brevet de technicien
BTS Brevet de technicien supérieur
CANAM Caisse nationale d’assurance maladie
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée
CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CERFITEX Centre de recherche et de formation pour l’industrie textile
CMM Chambre des mines du Mali
CMSS Caisse malienne de sécurité sociale
CNECE Centre national des examens et de concours de l’éducation
CPS Cellule de planification et de statistique.
CREE Créer votre entreprise
CSCOM Centre de santé communautaire
CSCRP Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté
DNE Direction nationale de l’emploi
DNFP Direction nationale de la formation professionnelle
DNP Direction nationale de la Population
DNPD Direction nationale de la planification et du développement
DOEF Département Observatoire de l’emploi et de la formation
DPS Département planification statistique
EFEP Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires
EMOP Enquête modulaire permanente auprès des ménages
ENI-ABT Ecole nationale d’ingénieurs – Abderhamane Baba Touré
ENSUP Ecole normale supérieure
FAFPA Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage
FAMA Faculté d'agronomie et de médecine animale
FAPH Faculté de pharmacie
FASSO Faculté des sciences sociales de l'Université de Ségou
FAST Faculté des sciences et techniques
FBCF Formation brute de capital fixe
FDPRI Faculté de droit privé
FDPU Faculté de droit public
FHG Faculté d'histoire et de géographie
FIER Fonds d’insertion à l’entreprenariat des jeunes ruraux
FLLSL Faculté des lettres, des langues et des sciences du langage
FMOS Faculté de médecine et d'odontostomatologie
FNIHM Fédération nationale de l’industrie hôtelière du Mali
FSEG Faculté des sciences économiques et gestion
FSHSE Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation
GC Génie civil
GCO Gestion et commerce
GEL Génie électrotechnique
GELN Génie Electronique
GEN Génie Energétique
GERME Gérer mieux votre entreprise
GM Génie mécanique
GP Groupe pédagogique
IFM Institut de formation des maîtres
INIFORP Institut national d’ingénierie pour la formation professionnelle
INPS Institut national de prévoyance sociale
INSTAT Institut national de la statistique
IPP Incapacité partielle permanente
IPR/IFRA Institut polytechnique rural / Institut de formation et de recherche appliquée
 |
7 7 |
▲back to top |
vi
ISA Institut des sciences appliquées
ISFRA Institut supérieur de formation et de recherche appliquée
IUDT Institut universitaire de développement territorial
IUFP Institut universitaire de formation professionnelle
IUG Institut universitaire de gestion
IUT Institut universitaire des technologies
LL Langues littérature
LLT Langues littérature terminales
MEFP Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle
MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
OIT Organisation internationale du travail
ONEF Observatoire national de l’emploi et de la formation
ONG Organisation non gouvernementale
OPECOM Organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali
OPI Organisation patronale des industriels
PAP Population active potentielle
PEA Population économiquement active
PIB Produit intérieur brut
PNT Politique nationale du travail
PROCEJ Projet de développement des compétences et emploi des jeunes
PRODEFPE Programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l’emploi
RAMED Régime d’assistance médicale
RASAMT Rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail
RESC Ratio Elève/Salle de classe
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat
SB Sciences biologiques
SBT Sciences biologiques terminales
SCN Système de comptabilité nationale
SDC Salle de classe
SE Sciences exactes
SES Sciences économiques et sociales
SET Sciences exactes terminales
SH Sciences humaines
SHT Sciences humaines terminales
SIMTM Système d’information sur le marché du travail et la migration
STI Sciences et technologie industrielle
TA Taux d’activité
TAL Terminales arts lettres
TAO Taux d’actif occupé
TBA Taux brut d’admission
TCA Technique comptable
TCB Technique commerce et distribution
TE Technique économie
TGC Technique génie civil
TI Technique industrie
TLL Terminales langues lettres
TOFE Tableau des opérations financières de l'Etat
TSE Terminales sciences exactes
TSECO Terminales sciences économiques
TSEXP Terminales sciences expérimentales
TSS Terminales sciences sociales
UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine
ULSHB Université des lettres et sciences humaines de Bamako
USJPB Université des sciences juridique et politique de Bamako
USSGB Université des sciences sociales et de gestion de Bamako
USTTB Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako
 |
8 8 |
▲back to top |
vii
Résumé
Le Rapport annuel d'analyse situationnelle du marché du travail 2016 rappelle utilement une dizaine
de concepts clés pour faciliter sa compréhension. Cela va de la population en empli au taux
d'emploi informel en passant par le chômage combiné à la main-d'œuvre potentielle, etc. Il présente
le contexte national général en termes économique, financier, social et démographique à l'aide des
données statistiques des cinq dernières années. Les principaux indicateurs y afférents sont les taux
de croissance de l'économie et de ses principaux secteurs, la balance des paiements, l'accès à
l'éducation et à la santé, la structure de la population en 2016.
La situation économique est décrite à l'aide de l’évolution du taux de croissance du PIB et de ses
différents secteurs (primaire, secondaire et tertiaire), celle des dépenses des ménages et des
entreprises sur la période 2013-2017. La situation financière décrypte le solde global de la balance
des paiements et le TOFE (Tableau des opérations financières de l'Etat). Le contexte social rappelle
la dynamique de l’accès à l’éducation et l’évolution de l’état de santé de la population dans le pays.
Dans le domaine démographique, il est établi la pyramide des âges de la population projetée en
2016. Au regard de cette pyramide, les jeunes générations sont majoritaires ce qui donne à sa forme
un caractère de dynamisme, souplesse et réactivité. En relation avec le marché du travail, une telle
typologie est associée à une masse salariale peu élevée et des opportunités d'emploi peu abondantes.
Pour bien appréhender le marché du travail, il faut au préalable établir un tableau sommaire du
système éducatif et de la formation professionnelle qui participent de l'employabilité des individus.
Ce qui conduit à analyser, pour l'année 2016 essentiellement les statistiques de l'enseignement
technique et professionnel, celles de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle ainsi
que les ressources humaines formées à l'extérieur du Mali susceptibles d'arriver sur le marché
domestique du travail. L'analyse du marché du travail proprement dit s'opère à travers la situation
de l'emploi et du chômage, l'intermédiation entre offreurs et demandeurs de travail ainsi que la
création d'emploi et l'employabilité des arrivants sur le marché. Pour ce faire, on recense et on
analyse les données administratives auprès des divers producteurs de statistiques sectorielles, en
plus on traite les données d'enquête du module emploi de l'EMOP. Ainsi, en 2016, la population en
âge de travailler est estimée à près de 9 millions de personnes. Les personnes en emploi et les
chômeurs i.e. la main-d'œuvre ou population active représentent près de 76% de ce total pour 6% en
main-d'œuvre potentielle et 18% hors main-d'œuvre.
En rapport avec la population en emploi, les différents régimes de sécurité sociale sont analysés au
regard des statistiques collectées auprès des trois principaux prestataires que sont la protection
sociale, la sécurité sociale au sens strict et la prévoyance sociale). Toujours en relation avec le
monde du travail, plusieurs conflits collectifs et litiges individuels ont émaillé son fonctionnement
au cours de l'année que le Rapport analyse, à partir des données de la DNT et de ses
démembrements, données relatives à la gestion des confits collectifs, au contrôle de légalité des
contrats de travail, au règlement des litiges individuels, au traitement des accidents de travail et des
maladies professionnelles ainsi qu'à la gestion des licenciements de travailleurs.
Enfin, le Rapport analyse la situation particulière des migrants de retour sous les angles des pays de
retour desdits migrants, leur insertion socioprofessionnelle et leur répartition en emploi.
 |
9 9 |
▲back to top |
1
Introduction
Justification
L’information statistique qui s’est consolidée progressivement au Mali depuis bientôt quelques
décennies, est devenue, de nos jours, l’instrument privilégié d’éclairage de la politique économique
de l’Etat.
Héritier du patrimoine scientifique de l’ex-DOEF de l’ANPE, l’Observatoire national de l’emploi et
de la formation (ONEF) capitalise une riche expérience dans le domaine de la production
d’information statistique sur le marché du travail. Il mène des études et des recherches afin de
fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le
marché du travail, au niveau national et régional. Il contribue également à instaurer une meilleure
adéquation entre les besoins et les potentialités de l’économie, d’une part, et le système de
formation d’autre part.
En réponse à la demande de plus en plus croissante des utilisateurs d’information statistique sur le
marché du travail (Etat, secteur privé, structure de formation, etc.) et face à la problématique liée à
l’emploi des jeunes, l’ONEF est sans cesse appelé à améliorer la qualité des données qu’il collecte
et des produits qui en résultent.
Pour relever ces défis, l’ONEF met en place un dispositif permanent pour produire régulièrement
les statistiques fiables sur le marché du travail. En effet, les systèmes d’information sur le marché
du travail en Afrique francophone faisant défaut, les productions statistiques y sont loin d’être
fiables.
C’est dans ce contexte qu’est proposée la réalisation du présent Rapport d’analyse situationnelle
annuelle sur le marché du travail (RASAMT-2016). Le RASAMT est une compilation des données
administratives, produites par les autres structures productrices d’informations sur le marché du
travail dans le cadre de l’exercice de leurs activités. Il permet donc de renseigner certains
indicateurs qui ne peuvent pas être obtenus à partir des données d’enquêtes. Il s’agit aussi de mettre
à la disposition des acteurs concernés (décideurs politiques, les partenaires publics et privés, les
chercheurs et les particuliers etc.) des informations actualisées, pertinentes sur des indicateurs tels
que l’intermédiation, le dialogue social, le flux des diplômés qui arrivent chaque année sur le
marché du travail, etc.
Ce rapport renseigne donc un ensemble d’indicateurs essentiels à une bonne connaissance de l’état
et de l’évolution de la situation sur le marché du travail au Mali. Il peut permettre de déceler les
perturbations et de prendre des décisions d’orientation.
Ainsi, la prise en compte des données sur le marché du travail par les décideurs nécessite des
dispositifs statistiques de qualité. Conscient de ce fait, l’ONEF s’engage à faire le suivi de certains
indicateurs conjoncturels sur le marché du travail pour mieux orienter les programmes et les
politiques relatifs à la formation et à l’emploi au Mali.
Le présent rapport traite les données conjoncturelles et annuelles en rapport avec la situation socio-
économique du pays, portant sur l’année 2016.
 |
10 10 |
▲back to top |
2
Objectifs
L’objectif général de ce Rapport est d'établir la situation du marché du travail à partir des données
administratives de l’année 2016. D’une façon spécifique, cette étude vise à :
collecter les données administratives auprès des structures productrices d’informations sur le
marché du travail, au titre 2016 ;
analyser les principaux indicateurs macro-économiques de 2016 ;
analyser les principaux indicateurs relatifs aux données de l’enquête emploi ;
analyser les principaux indicateurs relatifs à l’éducation (enseignement secondaire général,
technique et professionnel, enseignement supérieur, formation professionnelle) ;
analyser les indicateurs sur le dialogue social et la sécurité sociale en 2016 ;
faire au besoin une analyse comparative des indicateurs de 2014, 2015 et 2016.
Méthodologie
L’ONEF a adressé une correspondance à tous les points focaux de toutes les structures productrices
de données sur le marché du travail. Ces points focaux ont transmis en retour à l'ONEF les données
et/ou les rapports d’activités de leurs structures respectives. Quelques difficultés demeurent par
rapport à la disponibilité dans certaines structures des données désagrégées par sexe ou par localité.
De même, certaines données sont souvent disponibles dans des formats inappropriés qui rendent
leur traitement difficile.
Afin d’atteindre les objectifs visés dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, les données ont été
traitées pour produire les tableaux ici présentés. La collecte des données a été complétée par la
revue documentaire qui nous a permis de mieux cerner les missions assignées aux structures
concernées.
Les informations ainsi collectées ont permis d’élaborer le présent rapport en six sections, précédées
d'un rappel de définitions et concepts clés portant sur le marché du travail :
Situation économique, financière, sociale et démographique ;
Enseignements et formation professionnelle ;
Marché du travail ;
Sécurité sociale ;
Dialogue social ;
Migration.
 |
11 11 |
▲back to top |
3
1. Définitions des concepts
Quelques concepts clés sont ici rappelés pour faciliter la compréhension du rapport. Ce sont les
principaux indicateurs du marché du travail se rapportant tantôt à la personne humaine ou à son
collectif tantôt à l'activité ou à la situation dans laquelle se trouve la personne ou son collectif.
1.1. Population en emploi
La population en emploi comprend toutes les personnes en âge de travailler qui, durant une courte
période de référence (7 derniers jours), étaient engagées dans toute activité visant à produire des
biens ou à fournir des services en échange d’une rémunération ou d’un profit.
1.2. Travail
Le travail comprend toutes les activités effectuées par des personnes de tout sexe et tout âge afin de
produire des biens ou fournir des services destinés à la consommation par des tiers ou à leur
consommation personnelle. Il exclut les activités qui n’impliquent pas la production de biens ou de
services (par exemple, la mendicité et le vol), le fait de prendre soin de soi (par exemple, la toilette
personnelle et l’hygiène) et les activités qui ne peuvent pas être réalisées par une autre personne que
soi-même (par exemple, dormir, apprendre et les activités de loisirs)1.
1.3. Population en âge de travailler
La population en âge de travailler comprend toutes les personnes des deux sexes ayant atteint l’âge
légal au travail. La limite inférieure suggérée par le BIT est de 15 ans, âge révolu, les pays ont
cependant la possibilité de l’adapter à leur propre contexte. Il ne doit en aucun cas être inférieur à
13 ans, âge révolu.
1.4. Chômeur
Le chômeur est défini comme toute personne en âge de travailler qui n’était pas en emploi, avait
effectué des activités de recherche d’emploi durant une période récente spécifiée, et était
actuellement disponible pour l’emploi si la possibilité d’occuper un poste de travail existait.
1.5. Chômeur découragé
Le chômeur découragé est une personne sans emploi, n’ayant pas travaillé (ne serait-ce qu’une
heure) lors de la semaine précédant le passage de l’agent enquêteur, n’ayant pas recherché un
emploi au cours du mois précédant le passage de l’agent enquêteur mais étant disponible pour
travailler immédiatement si l’on lui offrait un emploi.
1.6. Chômage combiné à la main-d'œuvre potentielle
Il comprend toutes les personnes sans emploi, n’ayant pas travaillé (ne serait-ce qu’une heure) lors
de la semaine précédant le passage de l’agent enquêteur, ayant recherché ou non un emploi au cours
du mois précédant le passage de l’agent enquêteur et disponibles pour travailler immédiatement si
l’on leur offrait un emploi.
1 Source : Résolution de la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail
 |
12 12 |
▲back to top |
4
1.7. Main-d'œuvre
La main d’œuvre fait référence à l’offre de travail du moment pour la production de biens et de
services en échange d’une rémunération ou d’un profit.
1.8. Taux d'emploi
C'est le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui est en emploi par rapport à la
population totale âgée de 15 ans et plus.
1.9. Taux d'emploi informel
Le taux d’emploi informel est défini comme étant le pourcentage des personnes en emploi informel
par rapport à la population totale en emploi.
 |
13 13 |
▲back to top |
5
2. Situation économique, financière, sociale et démographique
Cette section décrit brièvement les situations économique, financière, sociale et démographique du
pays sur les 5 dernières années. Les principaux indicateurs y afférents sont les taux de croissance de
l'économie et de ses principaux secteurs, les dépenses des ménages et des entreprises, la balance des
paiements, l'accès à l'éducation et à la santé, la structure de la population en 2016.
2.1. Situation économique
La situation économique est décrite à l'aide de l’évolution du taux de croissance du Produit intérieur
brut (PIB) et de ses différents secteurs (primaire, secondaire et tertiaire), celle des dépenses des
ménages et des entreprises sur la période 2013-2017. Durant cette période, la situation économique
du Mali a été marquée par un taux de croissance du PIB fluctuant entre 2,3% et 7,0%. C’est en 2014
que le pays a enregistré le taux le plus élevé, soit 7.0% pour ensuite passer à 6,0% en 2015 puis à
5,8% en 2016, ce qui montre un ralentissement de la vitalité de l'économie nationale. Les
projections pour 2017 n’indiquent pas une amélioration par rapport aux deux précédentes années.
En effet, elles prévoient un taux de croissance du PIB de 5,3% en 2017, ce qui serait inférieur à
celui des deux dernières années. En 2013, le taux de croissance du PIB bien que positif, était le plus
faible. Ce taux peut s’expliquer en partie par la crise sociopolitique inédite qu’a connue le pays en
2012. Cette crise avait installé un climat d’incertitude générale paralysant la quasi-totalité des
activités économiques.
Tableau 1. Croissance du PIB réel, de la consommation des ménages et de l'investissement (en %)
2013 2014 2015 2016 2017
PIB 2,3 7,0 6,0 5,8 5,3
Primaire -3,7 9,1 7,3 7,6 4,7
Secondaire 2,1 9,9 -0,3 0,4 5,8
Tertiaire 7,0 5,3 7,3 6,9 5,4
Consommation finale des ménages 2,6 7,5 5,8 5,0 4,0
FBCF 15,9 5,2 7,5 6,9 6,7
Source : INSTAT, Comptes nationaux, nouvelle série, 2017
La croissance du PIB de 2013 à 2017 est essentiellement attribuable à la dynamique des secteurs
primaire et tertiaire. Ces deux secteurs ont contribué chacun entre 35 et 40% au PIB du pays durant
toute la période. Le taux de croissance des deux secteurs a été au-dessus de 4,0% à l’exception de
celui du secteur primaire en 2013 qui était à -3,7%. Toutefois, le secteur secondaire a eu le taux de
croissance le plus élevé en 2014, soit environ 10%. Les secteurs primaire et secondaire ont le plus
contribué à la croissance du PIB durant l’année 2014. Ils ont contribué respectivement à hauteur de
37,5% et 36,2% au PIB. Le niveau élevé de croissance du PIB en 2014 résulterait de l’augmentation
de 7,5% des dépenses des ménages en 2014 et d’une augmentation de plus de 15% des
investissements des entreprises en 2013. Ces investissements ont été, semblent-ils, plus orientés
dans les secteurs secondaire et primaire qui ont connu respectivement des taux de croissance de 9,9
et 9,1% en 2014. En 2015, la croissance aurait pu rester au niveau élevé de 7% n'eut été le repli
dans le secteur secondaire (-0.3%) alors que les deux autres secteurs enregistraient chacun 7.3%.
D’après les projections pour l’année 2017, le secteur secondaire pourra enregistrer un taux de
croissance de 5,8%. Il sera suivi par le secteur tertiaire qui pourrait enregistrer un taux de croissance
de 5,4%. Le faible taux de croissance du PIB en 2013 est dû au secteur primaire qui a enregistré un
taux négatif, soit -3,7%.
 |
14 14 |
▲back to top |
6
Tableau 2. Evolution de la part des secteurs dans le PIB (en %)
2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne annuelle
Secteur primaire 38.0 36.2 37.5 37.8 38.1 37.5
Secteur secondaire 19.2 19.9 19.0 17.8 16.5 18.5
Secteur tertiaire 35.2 35.9 36.2 36.6 36.6 36.1
Taxes indirectes (moins subventions) 7.6 8.1 7.3 7.8 8.8 7.9
Total (PIB aux prix du marché) 100 100 100 100 100 100.0
Source : INSTAT, Comptes Nationaux nouvelle série, 2015
En moyenne annuelle, la contribution du secteur primaire à la création de richesse au Mali est au-
dessus de 37% contre 36% pour le secteur tertiaire, les deux secteurs moteurs de notre économie. Le
secteur secondaire contribue pour environ 18% en moyenne, essentiellement grâce au secteur
aurifère. Le niveau des taxes indirectes reste quasi constant, environ 8% du PIB.
2.2. Situation financière
Le solde global de la balance des paiements (Annexe 1) laisse entrevoir en 2016 un besoin de
financement de 180 milliards fcfa, soit une nette détérioration par rapport à 2013 où le solde global
était de +64 milliards fcfa. Sur toute la période 2012-2016, le solde des transactions courantes est
déficitaire avec une détérioration continue de la situation, le déficit étant passé de 139 milliards en
2012 à 464 en 2016. Dans le même temps, le solde de commerce de biens est passé d'un excédent
de 57 milliards fcfa en 2012 à un déficit prévisionnel de 305 milliards en 2016, soit une
détérioration continue sur la période, période sur laquelle le commerce des services est resté
constamment déficitaire.
Sur la période 2012-2016, le compte de capital est passé de 53 milliards fcfa à 154 milliards après
avoir dépassé les 200 milliards en 2015 essentiellement sous l'impulsion des investissements directs
étrangers. L'allègement de dette PPTE est la principale composante de financement exceptionnel
que reçoit le pays. De moins de 7 milliards fcfa en 2012, il a atteint les 60 milliards en 2015 pour
rechuter sous la barre des 18 milliards en 2016.
Le tableau des opérations financières de l'Etat (Annexe2) fait ressortir un solde budgétaire de base
de -188 milliards fcfa en 2016 contre moins de -47 milliards en 2012. Hors PPTE, le solde
budgétaire tombe à -170 milliards fcfa en 2016 contre -34 milliards en 2012. Il faut noter que le
solde budgétaire de base, hors PPTE ou PPTE inclus, est excédentaire en 2015, 38 milliards
respectivement 21 milliards fcfa. Les recettes fiscales représentent en moyenne 95% des recettes
budgétaires qui elles-mêmes constituent 90% des recettes totales de l'Etat. Le taux de pression
fiscale se situe autour de 15% du PIB.
2.3. Situation sociale
La situation sociale du Mali est décrite par la dynamique de l’accès à l’éducation et l’évolution de
l’état de santé de la population dans le pays.
2.3.1. Education
Durant les quatre dernières années, le taux d’alphabétisation au Mali a légèrement baissé en passant
de 35% en 2013 à 30% en 2016. De même, durant la même période, le taux de scolarisation est
passé de 74% à moins de 70%. La diminution du taux d’alphabétisation a été plus observée chez les
hommes et dans le milieu urbain. En effet, le taux d’alphabétisation des hommes est passé de 47,5%
en 2013 à 40,6% en 2016 et durant la même période, il est passé de 60,4% à 54,4% dans le milieu
urbain, soit des diminutions respectives de 7 et 6 points de pourcentage. Bien sûr, les taux
d'alphabétisation des femmes et du milieu rural restent très en deçà de celui des hommes
 |
15 15 |
▲back to top |
7
respectivement du milieu urbain. S'agissant de la scolarisation, on s’aperçoit que le taux des
hommes a faiblement fluctué, tandis que celui des femmes a fortement baissé en passant de 71% en
2013 à 64% en 2016, soit 7 points de pourcentage de perte contre seulement un point pour les
hommes.
Ces résultats impliquent deux constats pour lesquels il est recommandé d’en identifier les
déterminants. Le premier constat est que le taux d’alphabétisation est en baisse chez les hommes
tandis que le taux de scolarisation diminue chez les filles. Le second constat concerne la constance
du taux de scolarisation des garçons pendant quatre ans alors qu’il n’a pas atteint 100% et la
constance du taux d’alphabétisation des femmes qui dépasse à peine les 20%. Les filles iraient de
moins en moins à l'école et les hommes sont de moins en moins alphabétisés, il y a là le spectre d'un
pays d'illettrés, terreau favorable à tous les obscurantismes. Il y a lieu de s'atteler à inverser une telle
tendance si le pays veut compter parmi les nations qui œuvrent véritablement à l'atteinte des ODD à
l'horizon 2030.
Tableau 3. Evolution des indicateurs de la formation professionnelle (en %)
2013 2014 2015 2016
Taux d’alphabétisation de la population 35.2 30.4 32.6 30.1
Masculin 47.5 41.1 44.7 40.6
Féminin 24.1 20.8 21.8 20.9
Urbain 60.4 57.3 56.5 54.4
Rural 24.7 20.3 23.9 21.0
Taux de scolarisation brut EPT 74.0 70.1 69.0 69.6
Masculin 76.3 76.4 74.8 75.0
Féminin 71.4 64.0 63.4 64.3
Taux d’achèvement EPT 51.0 48.3 49.7 46.2
Masculin 49.9 52.7 53.8 49.4
Féminin 52.0 44.0 45.7 43.0
Taux de transition vers l’enseignement secondaire 33.2 31.8 39.9 39.2
Masculin 35.4 32.8 42.0 42.6
Féminin 30.0 30.5 37.1 34.9
Taux de transition vers l’enseignement supérieur 13.6 12.6 14.8 16.4
Masculin 14.0 12.8 15.8 17.2
Féminin 13.0 12.2 13.0 15.0
Taux de scolarisation EFTP 7.4 29.7 31.4
Masculin 8.4 32.1 30.0
Féminin 6.5 20.6 33.7
Source : CPS/Education, 2017
Lorsque l’on s’intéresse aux filles et garçons ayant achevé leur étude, on s’aperçoit que le taux
d’achèvement du primaire est en baisse de façon générale. Il est passé de 51% en 2013 à 46% en
2016. Néanmoins, ce taux est plus élevé chez les garçons que les filles durant toute la période à
l’exception de 2013 où 52% des filles ont terminé leur étude contre 50% des garçons. Pour les trois
années suivantes, plus de garçons que de filles ont terminé leur étude.
Parallèlement à la baisse du taux d’achèvement s'observe le faible taux de transition vers
l’enseignement secondaire, 33% en 2013 et 39% en 2016 année où le taux pour les garçons est de
43% contre 35% pour les filles, soit 8 points de pourcentage d'écart entre les deux sexes. Les filles
ont perdu 2 points de pourcentage entre 2015 et 2016 tandis que les garçons gagnaient un point. A
un taux de transition vers le secondaire de 39% est associé un taux de transition vers le supérieur de
seulement 16%, à raison de 17% pour les garçons et de 15% pour les filles. Concernant
l’enseignement technique et professionnel, le taux de scolarisation est à la hausse d’une façon
générale. Il est passé de 7% en 2013 à 31% en 2015, soit une augmentation moyenne annuelle de
106%, à raison de 89% pour les garçons et de 128% pour les filles. Ces dernières seraient-elles de
 |
16 16 |
▲back to top |
8
plus en plus dirigées vers l'enseignement technique et professionnel au détriment d'études longues
que viendraient contrarier les mariages précoces et les grossesses non désirées.
2.3.2. Santé
La situation de la santé est celle de 2015 et elle est décrite dans ce rapport à travers l’état
nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, l’état de vaccination des enfants de 12-23 mois contre
certaines maladies et la prévalence du paludisme ou de la fièvre au Mali. Pour 100 enfants, 25
enfants de moins de 5 ans souffrent en 2015 d’insuffisance pondérale modérée alors que plus de 8
enfants sont atteints d’insuffisance pondérale sévère. Concernant la prévalence du retard de
croissance, il ressort que 30 enfants pour 100 au Mali connaissent un retard de croissance modéré et
13 un retard de croissance sévère. Pour la prévalence de l’émaciation, les résultats révèlent que plus
de 13 enfants sur 100 étaient en dessous de 2 écart-types de la médiane poids-pour-taille du
standard de l’OMS. L’incidence de l’obésité est faible au Mali, elle concerne moins de 2 enfants sur
100.
Tableau 4. Etat nutritionnel en 2015 (en %)
Indicateur Description Valeur
Prévalence de l’insuffisance
pondérale
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent
(a) Modérée et sévère (-2 SD) (a) en dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) 25.0
(b) Sévère (-3 SD)
(b) en dessous de moins 3 écarts-type (sévère) de la médiane poids-
pour-âge du standard de l’OMS
8.3
Prévalence du retard de croissance Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent
(a) Modérée et sévère (-2 SD) (a) en dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) 30.4
(b) Sévère (-3 SD)
(b) en dessous de moins 3 écarts-type (sévère) de la médiane taille-pour-
âge du standard de l’OMS
13.2
Prévalence de l’émaciation Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent
(a) Modérée et Sévère (-2 SD) (a) en dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) 13.5
(b) Sévère (-3 SD)
(b) en dessous de moins 3 écarts-type (sévère) de la médiane poids-pour-
taille du standard de l’OMS
3.4
Prévalence de l’obésité
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus de 2
écarts-type par rapport à la médiane poids-pour-taille du standard de
l’OMS
1.9
Source : Instat, Enquête par grappes à indicateurs multiples 2015, Résultats clés, mars 2016
On peut retenir que chacune des quatre situations de malnutrition (insuffisance pondérale, retard de
croissance, émaciation et obésité) touchait au moins 2 enfant sur 100 au Mali en 2015. C’est le
retard de croissance modéré et sévère qui touche plus d’enfants que les autres formes de
malnutrition. À l’opposé, les enfants maliens soufraient très peu de l’obésité et même ceux qui
étaient concernés, ne semblaient pas être en situation d’obésité sévère. Toutefois, toutes ces quatre
formes de malnutrition méritent davantage l'attention des autorités afin de garantir aux enfants
maliens la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
L’état de vaccination des enfants de 12-23 mois indique la couverture vaccinale complète et celle
des pathologies prises de façon individuelle. Au total, une dizaine de molécules sont concernées. Il
s’agit de la Tuberculose, de la polio, de la DTCoq, de l’hépatite B et de l’haemophilus influenzae
type B, de la rougeole, de la pneumonie, de la diarrhée et de la fièvre jaune. Seulement 20% des
enfants concernés ont tous reçus ces molécules, soit une couverture vaccinale complète. La
couverture vaccinale de la tuberculose (environ 71%) est la plus élevée. Elle est suivie par celle de
la rougeole (environ 57%). Ensuite, il y a successivement la fièvre jaune (55%), la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche, l’hépatite B et l’haemophilus influenzae type B (54.5%), la
pneumonie (47%), la polio (39%) et la diarrhée (23%).
 |
17 17 |
▲back to top |
9
Tableau 5. Couverture vaccinale des enfants de 12-23 mois en 2015 (en %)
Indicateur Description Valeur
Couverture vaccinale
Tuberculose
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin du BCG avant leur
premier anniversaire
71.9
Couverture vaccinale Polio
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin
contre la Polio (Polio_3) avant leur premier anniversaire
39.2
Couverture vaccinale DTCoq,
Hépatite B et Hib
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin
contre le DTCoq, l’Hépatite B et l’Haemophilus Influenzae type B (Hib)
(Penta_3) avant leur premier anniversaire
54.5
Couverture vaccinale
Rougeole
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin contre la rougeole
avant leur premier anniversaire
56.9
Couverture vaccinale
Pneumonie ou Méningite à
pneumocoque
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin
contre la pneumonie ou la méningite à pneumocoque (PCV-13_3 avant leur
premier anniversaire
47.1
Couverture vaccinale Diarrhée
(ROTATEQ)
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin
contre la diarrhée (Rotateq_3) avant leur premier anniversaire
22.6
Couverture vaccinale Fièvre
jaune
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin contre la fièvre jaune
avant leur premier anniversaire
55.1
Couverture vaccinale
complète
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois qui ont reçu toutes les vaccinations
recommandées par le programme national de vaccination avant leur premier
anniversaire
20.2
Source : Instat, Enquête par grappes à indicateurs multiples 2015, Résultats clés, mars 2016
La situation de prévention des femmes de 15-49 ans contre le tétanos et le paludisme ou la fièvre
indique des taux de protection relativement faibles. Ainsi, à peine deux tiers (66%) des femmes
enceintes ont dormi sous moustiquaire imprégnée d'insecticides la nuit précédant l'enquête. La
protection contre le tétanos néonatal touche à peu près une femme sur deux (52.7%). Il s'agit du
pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont reçu au moins deux doses de vaccin
antitétanique dans l’intervalle de temps approprié avant la naissance la plus récente. Le traitement
préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse touche moins d'une femme sur cinq
(17.5%). Il s'agit du pourcentage de celles qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar.
Tableau 6. Protection contre le paludisme/fièvre en 2015 (en %)
Indicateur Description Valeur
Protection contre le tétanos néonatal
Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante
dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins deux doses de
vaccin antitétanique dans l’intervalle de temps approprié avant la
naissance la plus récente
52.7
Femmes enceintes dormant sous MII
Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit
précédente
66.2
Traitement préventif intermittent contre
le paludisme durant la grossesse
Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de
SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d’une visite
prénatale, durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance
vivante dans les 2 dernières années
17.5
Source : Instat, Enquête par grappes à indicateurs multiples 2015, Résultats clés, mars 2016
2.4. Situation démographique
La population totale du pays est projetée en 2016 à un peu plus de 18 millions d'habitants par
extrapolation de la population recensée en 2009 au taux d'accroissement moyen annuel de 3.6%.
Elle se répartit presque égalitairement entre les deux sexes et cela quelle que soit la tranche d'âge à
l'exception des 65-79 ans où l'on enregistre 51% de femmes contre 49% d'hommes. La pyramide
des âges est assez symétrique de type "poire écrasée" avec un âge moyen de 20 ans quel que soit le
sexe.
 |
18 18 |
▲back to top |
10
Graphique 1: Pyramide des âges en 2016
1 724
1 399
1 167
971
824
700
575
455
344
256
200
163
121
97
57
30
15
1 751
1 422
1 186
986
837
711
584
462
349
260
203
166
123
99
58
31
15
2 000 1 500 1 000 500 500 1 000 1 500 2 000
00-04 ans
05-09 ans
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80 ans et +
Femme Homme
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données de la population de la DNP/Projection démographique du Mali 2016
Compte tenu de la forme de la pyramide, les jeunes générations sont majoritaires ce qui donne à
cette typologie un caractère de dynamisme, souplesse et réactivité. En relation avec le marché du
travail, une telle typologie est associée à une masse salariale peu élevée et des opportunités d'emploi
peu abondantes. Plus du tiers (34%) de la population a moins de 10 ans et les moins de 15 ans
représentent 47% de la population, ce qui fait que la population en âge de travailler est de 53% du
total (DNP, projection RGPH). Les enfants de moins de 5 ans constituent 19% de la population,
près d'un malien sur cinq.
Tableau 7. Projection de la population en 2016 (en milliers d'habitants)
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif % % cumulé
00-04 ans 1 724 49,6 1 751 50,4 3 475 18,9 18,9
05-09 ans 1 399 49,6 1 422 50,4 2 821 15,4 34,3
10-14 ans 1 167 49,6 1 186 50,4 2 353 12,8 47,2
15-19 ans 971 49,6 986 50,4 1 957 10,7 57,8
20-24 ans 824 49,6 837 50,4 1 661 9,1 66,9
25-29 ans 700 49,6 711 50,4 1 411 7,7 74,6
30-34 ans 575 49,7 584 50,3 1 158 6,3 80,9
35-39 ans 455 49,6 462 50,4 917 5,0 85,9
40-44 ans 344 49,6 349 50,4 693 3,8 89,7
45-49 ans 256 49,6 260 50,4 516 2,8 92,5
50-54 ans 200 49,6 203 50,4 403 2,2 94,7
55-59 ans 163 49,7 166 50,3 328 1,8 96,5
60-64 ans 121 49,6 123 50,4 244 1,3 97,8
65-69 ans 97 49,2 99 50,8 197 1,1 98,9
70-74 ans 57 49,1 58 50,9 116 0,6 99,5
75-79 ans 30 49,2 31 50,8 61 0,3 99,8
80 ans et + 15 50,0 15 50,0 30 0,2 100,0
Total 9 097 49,6 9 244 50,4 18 341 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données de la population de la DNP/Projection démographique du Mali 2016
 |
19 19 |
▲back to top |
11
3. Enseignements et formation professionnelle
Pour bien appréhender le marché du travail, il faut avoir un œil sur le système éducatif et la
formation professionnelle qui participent de l'employabilité des individus. Aussi, analyse-t-on
successivement les données, pour l'année 2016 essentiellement, de l'enseignement technique et
professionnel, celles de l'enseignement supérieur, les statistiques de la formation professionnelle
ainsi que les ressources humaines formées à l'extérieur du Mali susceptibles d'arriver sur le marché
domestique du travail.
3.1. Enseignement technique et professionnel
Ce sont successivement les données des diplômés de 2016 de l'enseignement technique et
professionnel (CAP, BT1 et BT2), du CERFITEX, des IFM et du baccalauréat dont le bac
technique. Au niveau technique et professionnel global, ce sont plus de 7 mille admis au CAP, plus
de 5 mille au BT1 et plus de 4 mille au BT2. Les taux d'admission sont de 37% au CAP contre 27%
au BT1 et 48% au BT2. Les taux pour les filles vont de 22% au CAP à 39.5% au BT2 en passant
par 26% au BT1, chaque fois en deçà des taux des garçons.
Tableau 8. Résultat des examens de l'enseignement technique et professionnel par niveau de diplôme
Inscrits Présents Admis Taux d'admission
Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total
CAP 15 554 9 256 24 810 13 244 7 828 21 072 6 161 1 726 7 887 46,5 22,0 37,4
BT1 13 832 12 182 26 014 11 417 10 049 21 466 3 295 2 588 5 883 28,9 25,8 27,4
BT2 5 224 5 401 10 625 4 730 4 892 9 622 2 704 1 932 4 636 57,2 39,5 48,2
Source : CNECE, Résultats 2016
Au niveau du CERFITEX, ce sont au total 149 diplômés dont 23,5% sont des femmes. La formation
qualifiante seule fait près de 56% de cet effectif total contre 15% au CAP, 4% au BT, près de 21%
en licence et 5% en master. On notera qu'il n'y a aucune fille ni au BT ni au master dans cet
établissement. Les filles sont davantage représentées au niveau CAP (41% de l'ensemble des
qualifiés) qu'à tout autre niveau (28% en formation qualifiante et 10% en licence).
Tableau 9. Répartition des étudiants du CERFITEX par type de diplôme
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
CAP 13 59,1 9 40,9 22 14,8
BT 6 100,0 0,0 6 4,0
Formation qualifiante 60 72,3 23 27,7 83 55,7
Licence 28 90,3 3 9,7 31 20,8
Master 7 100,0 0,0 7 4,7
Total 114 76,5 35 23,5 149 100,0
Source : CERFITEX, rapport d’activités 2016
Au niveau de l’IFM, ce sont 3381 admis sur les 3479 inscrits, soit un taux d'admission de 98%, taux
qui varie de 96% pour le BAC général à 100% pour l'hégire, général comme spécialisé. Il est
dommage que ces statistiques en sont désagrégées par sexe, tout laisse croire que les filles sont
sous-représentées.
 |
20 20 |
▲back to top |
12
Tableau 10. Résultats de fin de cycle des IFM
Inscrits Présents Admis Taux d'admission
Préscolaire 148 148 143 96,6
DEF général 370 368 367 99,7
DEF spécialisé 723 722 717 99,3
BAC général 592 586 564 96,2
BAC spécialisé 1 567 1 534 1 511 98,5
Hégire général 42 42 42 100,0
Hégire spécialisé 37 37 37 100,0
Total général 3 479 3 437 3 381 98,4
Source : CNCE, résultats 2016
Au niveau de l'enseignement secondaire général et technique, les taux d'admission sont de l'ordre de
24% quel que soit le type d'enseignement. Pour le bac technique, les taux par série vont de 10%
(série GM) à 37% (série GEN), ceux des filles allant de 0 à 30% contre 10 à 40% pour les garçons.
Il y a déjà moins de filles que de garçons aussi bien dans les inscriptions que dans les présences aux
examens, en plus les taux d'admission des filles restent plus faibles. La situation est pareille pour le
bac général où les taux d'amission par série vont de 19% (TAL) à 37,5% (TSE). En TSE, les filles
font légèrement mieux que les garçons à un demi-point de pourcentage près. En 2016, le Mali
compte 617 bacheliers techniques contre 24 231 bacheliers généraux. Ce sont ainsi près de 25 mille
jeunes qui achèvent le niveau secondaire de l'enseignement sur lesquels un certain nombre
poursuivront leurs études dans le supérieur, d'autres dans l'enseignement professionnel pour aller
plus vite sur le marché du travail où sont aussitôt inscrits les sortants de l'enseignement supérieur et
les ressources diplômées de l'étranger qui retournent au pays.
Tableau 11. Résultat du Bac par série
Inscrits Présents Admis Taux d'admission
Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total
BAC général
TLL 21 701 14 646 36 347 18 698 12 940 31 638 4 566 2 808 7 374 24,4 21,7 23,3
TAL 1 744 1 030 2 774 1 566 942 2 508 316 150 466 20,2 15,9 18,6
TSS 22 089 13 037 35 126 20 263 10 277 30 540 4 452 1 765 6 217 22,0 17,2 20,4
TSECO 14 632 9 681 24 313 13 372 8 895 22 267 4 086 2 260 6 346 30,6 25,4 28,5
TSEXP 6 331 3 637 9 968 5 574 3 264 8 838 1 529 823 2 352 27,4 25,2 26,6
TSE 3 022 1 376 4 398 2 801 1 131 3 932 1 047 429 1 476 37,4 37,9 37,5
Total 69 519 43 407 112 926 62 274 37 449 99 723 15 996 8 235 24 231 25,7 22,0 24,3
BAC technique
GC 353 81 434 329 79 408 69 15 84 21,0 19,0 20,6
GM 43 9 52 39 9 48 4 1 5 10,3 11,1 10,4
GMI 128 54 182 122 54 176 37 14 51 30,3 25,9 29,0
GELN 42 7 49 38 7 45 10 1 11 26,3 14,3 24,4
GEL 38 3 41 34 3 37 8 0 8 23,5 0,0 21,6
GEN 21 11 32 20 10 30 8 3 11 40,0 30,0 36,7
CF 703 543 1 246 646 499 1 145 193 129 322 29,9 25,9 28,1
GCO 531 386 917 401 320 721 71 54 125 17,7 16,9 17,3
Total 1 859 1 094 2 953 1 629 981 2 610 400 217 617 24,6 22,1 23,6
Source : CNCE, résultats 2016
3.2. Enseignement supérieur
Les statistiques des universités et grandes écoles sont ici présentées et analysées. Elles sont
désagrégées par université puis par grande école. Plus bas, les données sont rattachées aux facultés,
instituts et enfin aux filières de formation. Il faut préciser que les données collectées n'intègrent pas
les universités et grandes écoles privées dont on sait que le nombre a augmenté ces dix dernières
années et que ce système privé universitaire déverse aussi sur le marché du travail une population
de ressources humaines formées de plus en plus appréciable.
 |
21 21 |
▲back to top |
13
3.2.1. Universités et instituts
En 2016, les 5 universités du pays (4 à Bamako et une à Ségou) totalisaient un effectif cumulé de
63 568 étudiants dont 29% de filles et 71% de garçons. La région de Ségou fait à peine 2,4% des
effectifs contre plus de 97,6% pour le district de Bamako. Le tiers des étudiants du Mali sont
inscrits à l'ULSHB, presque pour tiers en lettres et sciences humaines. Les filles sont davantage
représentées à l'USJPB surtout en droit privé (FDPRI). L'USTTB absorbe moins de 15% des
étudiants du pays dont 63% en médecine et pharmacie, ici l'on ne dénombre qu'une fille sur 5
étudiants, mais une fille sur trois en pharmacie. Les sciences sociales et de gestion hébergent 25,8%
des universitaires dont plus de la moitié dans la seule Faculté des sciences économiques et de
gestion dont 36% de filles.
Tableau 12. Répartition des étudiants des Universités du Mali
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Université de Ségou 1 095 71,5 437 28,5 1 532 2,4
FAMA 235 83,6 46 16,4 281 18,3
FASSO 625 68,2 291 31,8 916 59,8
IUFP 235 70,1 100 29,9 335 21,9
ULSHB 15 119 71,1 6 151 28,9 21 270 33,5
FLSL 8 666 75,4 2 822 24,6 11 488 54,1
FSHSE 6 364 66,1 3 260 33,9 9 624 45,2
IUT 89 56,3 69 43,7 158 0,7
USJPB 9 730 63,9 5 490 36,1 15 220 23,9
FDPRI 5 697 62 3 495 38 9 192 60,4
FDPU 4 033 66,9 1 995 33,1 6 028 39,6
USSGB 11 759 71,7 4 640 28,3 16 399 25,8
FSEG 5 315 64 2 994 36 8 309 50,7
FHG 5 444 85,8 904 14,2 6 348 38,7
IUG 934 56 733 44 1 667 10,2
IUDT 66 88 9 12 75 0,5
USTTB 7 287 79,7 1 860 20,3 9 147 14,4
ISA 233 80,3 57 19,7 290 3,2
FAST 2 659 85,8 440 14,2 3 099 33,9
FMOS 3 632 78,9 974 21,1 4 606 50,4
FAPH 763 66,2 389 33,8 1 152 12,6
Total Universités 44 990 70,8 18 578 29,2 63 568 100.0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les cinq universités (Ségou, ULSHB, USJPB, USSGB, USTTB)
Les cinq (5) universités du pays se répartissent en 11 facultés et 5 instituts universitaires. Ce sont
surtout celles dont les effectifs avoisinent ou dépassent les 10 mille étudiants (6 des 11 facultés).
L'Université de Ségou a moins d'étudiants que chacune des 9 facultés de Bamako à la seule
exception de la FAPH. Cette université forme dans les domaines agricoles, de l’aménagement du
territoire et de l’agrobusiness.
Ici, les filles représentent 28,5% des étudiants à raison de 32% à la FASSO, 16% à la FAMA et
30% à l'IUFP. Dans cet Institut, les filles semblent surreprésentées dans les formations d'assistant de
gestion (83 à 100% selon que la formation soit continue ou non). On s'étonne qu'il y ait des
formations avec moins de 5 auditeurs comme en génie informatique (1) ou en énergie renouvelable
(3). Mais cela s'explique par la répartition selon les cycles.
 |
22 22 |
▲back to top |
14
Tableau 13. Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par faculté et par filière
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FAMA 235 83,6 46 16,4 281 18,3
Agroéconomie 144 80,9 34 19,1 178 63,3
Hydraulique agricole 45 83,3 9 16,7 54 19,2
Production santé animale 12 100,0 0 0,0 12 4,3
Vulgarisation agricole 34 91,9 3 8,1 37 13,2
FASSO 625 68,2 291 31,8 916 59,8
Aménagement du territoire 169 83,7 33 16,3 202 22,1
Communication des organisations 234 52,9 208 47,1 442 48,3
Sociologie 222 81,6 50 18,4 272 29,7
IUFP 235 70,1 100 29,9 335 21,9
Agrobusiness 20 95,2 1 4,8 21 6,3
Agrobusiness - formation continue 2 100,0 0 0,0 2 0,6
Assistant de gestion 5 25,0 15 75,0 20 6,0
Assistant de gestion formation continue 0 0,0 4 100,0 4 1,2
Assistant de gestion 6 17,1 29 82,9 35 10,4
Comptabilité - finance - audit 78 71,6 31 28,4 109 32,5
Comptabilité- finance- audit 49 81,7 11 18,3 60 17,9
Comptabilité – finance - audit- formation continue 15 93,8 1 6,3 16 4,8
Eau environnement et énergie renouvelable 3 100,0 0 0,0 3 0,9
Génie informatique 50 86,2 8 13,8 58 17,3
Génie informatique - formation continue 1 100,0 0 0,0 1 0,3
Hôtellerie et tourisme 6 100,0 0 0,0 6 1,8
Total 1095 71,5 437 28,5 1532 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’Université des Ségou
En effet, les très faibles effectifs par filière sont dans les classes terminales avec un certain nombre
de filières sans inscription ni en L1 ni en L2 comme les filières hôtellerie, génie informatique,
comptabilité (formation continue) agrobusiness (formation continue) et assistant de gestion
(formation continue). Il y a quelques filières qui viennent d'ouvrir puisque les L1 n'ont pas d'effectif
ni en L2 ni en L3 à l'instar de la comptabilité et de l'assistance de gestion tout comme
l'environnement.
Tableau 14. Répartition des étudiants de l'Université de Ségou par année d'étude et par filière
L1 L2 L3 Total
FAMA 141 89 51 281
Agroéconomie 101 42 35 178
Hydraulique agricole 23 16 15 54
Production santé animale 5 6 1 12
Vulgarisation agricole 12 25 0 37
FASSO 430 322 164 916
Aménagement du territoire 73 87 42 202
Communication des organisations 191 151 100 442
Sociologie 166 84 22 272
IUFP 146 107 82 335
Agrobusiness 0 11 10 21
Agrobusiness - formation continue 0 0 2 2
Assistant de gestion 20 0 0 20
Assistant de gestion formation continue 0 0 4 4
Assistant de gestion 0 15 20 35
Comptabilité - finance - audit 109 0 0 109
Comptabilité- finance- audit 0 60 0 60
Comptabilité- finance - audit - formation continue 0 0 16 16
Eau environnement et énergie renouvelable 3 0 0 3
Génie informatique 14 21 23 58
Génie informatique - formation continue 0 0 1 1
Hôtellerie et tourisme 0 0 6 6
Total 717 518 297 1532
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’Université des Ségou
A Ségou toujours, 47% des étudiants sont en 1ère année (Licence 1) contre 34% en L2 et 19% en L3.
Les deux tiers environ des étudiants sont réguliers, le tiers restant étant constitué de professionnels
(21%) et de candidats libres (13%).
 |
23 23 |
▲back to top |
15
Tableau 15. Répartition des étudiants de l'université de Ségou par statut et par année
L1 L2 L3 Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Réguliers 459 64,0 332 64,1 219 73,7 1 010 65,9
Candidats libres 81 11,3 85 16,4 40 13,5 206 13,4
Professionnels 177 24,7 101 19,5 38 12,8 316 20,6
Total 717 46,8 518 33,8 297 19,4 1 532 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’Université des Ségou
L'Université des lettres et sciences humaines compte deux facultés et un institut, ce dernier compte
pour moins de 1% de l'effectif des étudiants de l'Université dont près de 44% de filles. La FLSL a la
particularité d'avoir moins d'étudiants en L2 qu'en L3 ou L4, aussi bien dans l'ensemble que par
sexe. Ici, les filles sont beaucoup proportionnellement moins présentes que dans l'autre faculté de
l'Université (la FSHSE).
Tableau 16. Répartition des étudiants de l'ULSHB par année et par sexe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FLSL dont 8 666 75,4 2 822 24,6 11 488 54,0
DEUG 213 75,5 69 24,5 282 2,5
L1 2 266 72,3 866 27,7 3132 27,3
L2 1 207 76,3 374 23,7 1581 13,8
L3 2 426 76,4 749 23,6 3175 27,6
L4 2505 76,9 754 23,1 3259 28,4
Master 49 83,1 10 16,9 59 0,5
FSHSE dont 6 364 66,1 3 260 33,9 9 624 45,2
DEUG 1 100,0 0 0,0 1 0,0
L1 2128 67,7 1015 32,3 3 143 32,7
L2 1683 69,5 738 30,5 2 421 25,2
L3 1477 63,6 845 36,4 2 322 24,1
L4 1075 61,9 662 38,1 1 737 18,0
IUT dont 89 56,3 69 43,7 158 0,7
DUT 62 55,9 49 44,1 111 70,3
L1 4 57,1 3 42,9 7 4,4
L2 3 50,0 3 50,0 6 3,8
L3 20 58,8 14 41,2 34 21,5
Total 15 119 71,1 6 151 28,9 21 270 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’USJPB
Les 15 mille étudiants de l'USJPB se répartissent pour 60% en faculté de droit privé (FDPRI) et
40% en faculté de droit public (FDPRI) où les filles représentent 33% contre 38 dans la première
faculté. Ici aussi, comme à l'ULSHB, les effectifs des L2 sont inférieurs à ceux des L3 et L4 pour la
FDPRI et seulement ceux de la L3 pour la FDPRI. Dans cette université, il n'y a pas d'institut
universitaire et l'on ne voit pas non plus la mention "sciences politiques" dans aucune des facultés
 |
24 24 |
▲back to top |
16
Tableau 17. Répartition des étudiants de l'USJPB par année et par sexe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FDPRI dont 5 697 62,0 3 495 38,0 9 192 60,4
L1 1 702 62,4 1 026 37,6 2 728 29,7
L2 1 189 62,9 702 37,1 1 891 20,6
L3 1 217 61,3 768 38,7 1 985 21,6
L4 1 589 61,4 999 38,6 2 588 28,2
FDPU dont 4 033 66,9 1 995 33,1 6 028 39,6
L1 1 182 69,4 521 30,6 1 703 23,9
L2 977 67,6 468 32,4 1 445 22,0
L3 1 171 68,8 531 31,2 1 702 22,1
L4 703 59,7 475 40,3 1 178 32,0
Total 9 730 63,9 5 490 36,1 15 220 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’USJPB
Les plus de 16 mille étudiants de l'USSGB se répartissent pour 51% à la FSEG, 39% à la FHG et le
reste dans les deux instituts universitaires dont moins de 1% à l'IUDT. Les filles sont mieux
représentées à l'IUG et beaucoup moins à l'IUDT (12%) et à la FHG (14%), la situation à la FSEG
est entre ces deux extrêmes. Les gros effectifs sont en L1 sauf à la FHG où il y a plus d'étudiants en
L4 que partout ailleurs. La FSEG a la particularité que plus de la moitié de ses effectifs sont en L1
(59%).
Tableau 18. Répartition des étudiants de l'USSGB par année d'étude et par sexe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
FSEG dont 5 315 64,0 2 994 36,0 8 309 50,7
L1 3 113 63,2 1 813 36,8 4 926 59,3
L2 897 63,4 517 36,6 1 414 17,0
L3 549 64,9 297 35,1 846 10,2
L4 756 67,3 367 32,7 1 123 13,5
FHG dont 5 444 85,8 904 14,2 6 348 38,7
L1 1 261 83,1 257 16,9 1 518 23,9
L2 1 216 87,2 178 12,8 1 394 22,0
L3 1 230 87,6 174 12,4 1 404 22,1
L4 1 737 85,5 295 14,5 2 032 32,0
IUG dont 934 56,0 733 44,0 1 667 10,2
L1 379 59,7 256 40,3 635 38,1
L2 322 55,8 255 44,2 577 34,6
L3 233 51,2 222 48,8 455 27,3
IUDT dont 66 88,0 9 12,0 75 0,5
Master DIDL 36 90,0 4 10,0 40 53,3
Master MFP 9 100,0 0 0,0 9 12,0
Licence DIDL 21 80,8 5 19,2 26 34,7
Total 11 759 71,7 4 640 28,3 16 399 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’USSGB
L'USTTB concentre près des deux tiers (64%) de ses étudiants en médecine (FMOS) et pharmacie
(FAPH). Un peu plus du tiers des étudiants en pharmacie sont des filles contre seulement 21% en
médecine et 14% en sciences et techniques (FAST). La FAST voit ses effectifs augmenter au fil des
années, de L1 à L3 sauf pour les filles où l'on enregistre moins de filles en L2 qu'en L1.
 |
25 25 |
▲back to top |
17
Tableau 19. Répartition des étudiants de l'USTTB par année d'étude et par sexe
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
ISA dont 233 80,3 57 19,7 290 3,2
L1 95 85,6 16 14,4 111 38,3
L2 90 80,4 22 19,6 112 38,6
L3 48 71,6 19 28,4 67 23,1
FAST dont 2 659 85,8 440 14,2 3 099 33,9
L1 761 82,9 157 17,1 918 29,6
L2 838 87,5 120 12,5 958 30,9
L3 1 060 86,7 163 13,3 1 223 39,5
FMOS 3 632 78,9 974 21,1 4 606 50,4
FAPH 763 66,2 389 33,8 1 152 12,6
Total 7 287 78,5 1 860 21,5 9 147 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’USTTB
3.2.2. Grandes écoles
Les trois grandes écoles publiques totalisent, en 2016, 1 727 étudiants dont moins de 14% de filles.
Cet effectif représente 4% de l'ensemble des universités du pays. La formation d'ingénieurs
représente 8% avec seulement 4% de filles soit à peine 6 filles à ce type de formation. Le gros
contingent (61%) est à l'ENSUP pour la formation des enseignants du fondamental, du secondaire et
du supérieur avec là encore une sous-représentation des filles (moins de 14%). L'institut de
formation agronomique (IPR/ISFRA) compte à peine 500 étudiants avec moins de 100 filles.
Tableau 20. Répartition des étudiants des grandes écoles par genre
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
ENI-ABT 137 95,8 6 4,2 143 8,3
ENSUP 914 86,1 147 13,9 1 061 61,4
IPR/ISFRA 436 83,4 87 16,6 523 30,3
Total 1 487 86,1 240 13,9 1 727 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENI, l’ENSUP et l’IPR/ISFRA
ENI-ABT
Les 143 auditeurs de l'ENI-ABT, en 2016, se répartissent en 105 en formation d'ingénieurs et 38 en
formation de techniciens supérieurs. Dans toute cette école, les filles représentent 4% des effectifs,
avec 3% des techniciens et 5% des ingénieurs. Dans le cycle ingénieur, il n'y a aucune fille dans 4
filières sur les 8 que compte ce cycle de formation, ce sont les BTP, l'hydrogéologie, la topographie
et la mécanique. Sur les 3 filières du cycle technicien supérieur, les filles sont concentrées dans le
seul génie civil, donc absentes des mines et télécommunications.
Tableau 21. Répartition des étudiants finalistes de l'ENI par filière et genre
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Technicien supérieur dont 37 97,4 1 2,6 38 26,6
Génie civil 21 95,5 1 4,5 22 57,9
Mines 15 100,0 0,0 15 39,5
Télécommunications 1 100,0 0,0 1 2,6
Ingénieur dont 100 95,2 5 4,8 105 73,4
BTP 29 100,0 0,0 29 27,6
Hydraulique 5 83,3 1 16,7 6 5,7
Hydrogéologie 5 100,0 0,0 5 4,8
Topographie 16 100,0 0,0 16 15,2
Métallogénie 13 92,9 1 7,1 14 13,3
Electricité 22 95,7 1 4,3 23 21,9
Mécanique 3 100,0 0,0 3 2,9
Energétique 7 77,8 2 22,2 9 8,6
Total 137 95,8 6 4,2 143 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENI
 |
26 26 |
▲back to top |
18
ENSUP
Au niveau licence de l'ENSUP, on observe la même absence de filles dans les filières anglais, arabe,
histoire-géographie et physique-chimie, soit 4 filières sur 9. C'est vrai que la licence ne représente
que 9% de plus de 1000 étudiants de cette école. A ce niveau, les filles sont un peu plus présentées
dans les filières mathématiques et philosophie (25% chacune) puis biologie (18%). Le niveau
master représente près de 79% des effectifs dont 15% de filles. Quatre langues sont au programme
de formation, allemand, anglais, arabe et russe. Les plus grands nombres d'étudiants sont dans trois
filières, psychopédagogie, histoire-géographie et lettres (55% de l'ensemble des effectifs des 12
filières de master). Le cycle "Professeurs d'enseignement fondamental" totalise 133 auditeurs dont
seulement 9 filles. Les filières correspondantes sont les sciences (41%), l'anglais (26%), les lettres
et histoire-géographie (24%) et l'arabe (9%). En 2016, sont sortis de ce cycle après 4 ans d'études 45
auditeurs dont 4 filles, 44% en sciences, 27% en anglais, 22% en lettres et histoire-géographie et
7% en arabe.
Graphique 2: Répartition des sortants (4ème année) PEF
0
20
40
60
80
100
17 9 12
3 41
3
1
4
20
10 12
3
45
Garçons Filles Total
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENSUP
 |
27 27 |
▲back to top |
19
Tableau 22. Répartition des étudiants de l'ENSUP par cycle et par filière 2015-2016
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Master 707 84,6 129 15,4 836 78,8
Allemand 19 86,4 3 13,6 22 2,6
Anglais 64 77,1 19 22,9 83 9,9
Arabe 45 88,2 6 11,8 51 6,1
Biologie 51 92,7 4 7,3 55 6,6
Histoire-géographie 140 84,8 25 15,2 165 19,7
Lettres 84 82,4 18 17,6 102 12,2
Mathématiques 27 90,0 3 10,0 30 3,6
Physique-chimie 50 90,9 5 9,1 55 6,6
Psychopédagogie 157 80,9 37 19,1 194 23,2
Philosophie 43 91,5 4 8,5 47 5,6
Sociologie 20 90,9 2 9,1 22 2,6
Russe 7 70,0 3 30,0 10 1,2
Professeurs d'enseignement fondamental 124 93,2 9 6,8 133 12,5
Sciences 52 94,5 3 5,5 55 41,4
Lettres, histoire-géographie 30 93,8 2 6,3 32 24,1
Anglais 31 91,2 3 8,8 34 25,6
Arabe 11 91,7 1 8,3 12 9,0
Licence 83 90,2 9 9,8 92 8,7
Anglais 11 100,0 0,0 11 12,0
Arabe 10 100,0 0,0 10 10,9
Biologie 9 81,8 2 18,2 11 12,0
Histoire-géographie 11 100,0 0,0 11 12,0
Lettres 11 91,7 1 8,3 12 13,0
Mathématiques 9 75,0 3 25,0 12 13,0
Physique-chimie 7 100,0 0,0 7 7,6
Psychopédagogie 9 90,0 1 10,0 10 10,9
Philosophie 6 75,0 2 25,0 8 8,7
Total 914 86,1 147 13,9 1 061 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’ENSUP
IPR/IFRA
En 2016, 523 diplômés sont sortis de l'IPR/ISFRA dont 45% de techniciens supérieurs, 34% de
licenciés, 14% d'ingénieurs et le reste en maîtrise ou master. Les premiers sont presque
équitablement répartis entre les 7 filières que compte ce cycle avec une légère dominance de
l'aménagement hydroagricole et de l'amélioration des plantes et production semencière. Les
ingénieuses sont majoritairement agronomes (53% des 74 ingénieurs).
 |
28 28 |
▲back to top |
20
Tableau 23. Situation des diplômés de l'IPR/ISFRA 2016
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Technicien supérieur 198 84,3 37 15,7 235 44,9
Amélioration des plantes et production des semences 35 87,5 5 12,5 40 17,0
Aménagement hydroagricole 50 96,2 2 3,8 52 22,1
Aménagement et gestion des ressources forestières et halieutiques 22 68,8 10 31,3 32 13,6
Production des cultures vivrières et industrielles 30 88,2 4 11,8 34 14,5
Production avicole 17 89,5 2 10,5 19 8,1
Production de viande 23 76,7 7 23,3 30 12,8
Production horticole 21 75,0 7 25,0 28 11,9
Ingénieur 60 81,1 14 18,9 74 14,1
Agronomie 33 84,6 6 15,4 39 52,7
Zootechnie 20 74,1 7 25,9 27 36,5
Eaux et forêts 7 87,5 1 12,5 8 10,8
Licence 147 83,5 29 16,5 176 33,7
Agrobusiness 19 90,5 2 9,5 21 11,9
Agroéconomie 23 69,7 10 30,3 33 18,8
Agriculture durable 20 80,0 5 20,0 25 14,2
Aménagement hydroagricole 32 88,9 4 11,1 36 20,5
Aménagement et gestion des ressources forestières fauniques 19 86,4 3 13,6 22 12,5
Halieutique et aquaculture 9 90,0 1 10,0 10 5,7
Machinisme agricole 9 81,8 2 18,2 11 6,3
Zootechnie 16 88,9 2 11,1 18 10,2
Maîtrise 23 82,1 5 17,9 28 5,4
Vulgarisation agricole 23 82,1 5 17,9 28 100,0
Master 8 80,0 2 20,0 10 1,9
Gestion intégrée de la fertilité des sols 8 80,0 2 20,0 10 100,0
Total 436 83,4 87 16,6 523 100,0
Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IPR/ISFRA
Sur le marché du travail, l'IPR/ISFRA enregistre 67 diplômés en emploi, ce qui est rapporté aux 523
diplômés donne un taux de placement de moins de 13%. Ce sont 42% en maîtrise, 24% de
techniciens supérieurs, 10% en master et seulement 3% en cycle ingénieur seulement dans la filière
halieutique et aquaculture.
 |
29 29 |
▲back to top |
21
Tableau 24. Insertion des diplômés de l'IPR/ISFRA en 2016
Diplômés en emploi
Garçon Fille Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Technicien supérieur 14 87,5 2 12,5 16 23,9
Amélioration des plantes et production des semences 2 100,0 0 0,0 2 12,5
Aménagement hydroagricole 5 100,0 0 0,0 5 31,25
Aménagement et gestion des ressources forestières et halieutiques 4 80,0 1 20,0 5 31,25
Production des cultures vivrières et industrielles 0 0 0 0
Production avicole 1 100,0 0 0,0 1 6,25
Production de viande 1 100,0 0 0,0 1 6,25
Production horticole 1 50,0 1 50,0 2 12,5
Ingénieur 13 92,9 1 7,1 14 20,9
Agronomie 7 100,0 0 0,0 7 50,0
Zootechnie 3 75,0 1 25,0 4 28,6
Eaux et forêts 3 100,0 0 0,0 3 21,4
Licence 2 100,0 0 0,0 2 3,0
Agrobusiness 0 0 0
Agroéconomie 0 0 0
Agriculture durable 0 0 0
Aménagement hydroagricole 0 0 0
Aménagement et gestion des ressources forestières fauniques 0 0 0
Halieutique et aquaculture 2 100,0 0 0,0 2 100
Machinisme agricole 0 0 0
Zootechnie 0 0 0
Maîtrise 23 82,1 5 17,9 28 41,8
Vulgarisation agricole 23 82,1 5 17,9 28 100,0
Master 6 85,7 1 14,3 7 10,4
Gestion intégrée de la fertilité des sols 6 85,7 1 14,3 7 100,0
Total 58 86,6 9 13,4 67 100,0
Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par l’IPR/ISFRA
3.3. Ressources humaines formées à l’extérieur du Mali en 2016
En 2016, le Mali comptait 945 personnes formées à l'extérieur dont 89% d'étudiants (soit 845
étudiants) et 11% de stagiaires. Au total, ce sont 106 filles et 839 hommes. On s'intéressera
davantage au profil des étudiants diplômés de l'extérieur, le financement de leur formation et le coût
y afférent.
Profil des ressources humaines formées à l’extérieur
Les 845 étudiants diplômés se répartissent à raison de 52% le diplôme postuniversitaire, 32% le
diplôme universitaire et 16% le diplôme secondaire. L'écrasante majorité des diplômés
postuniversitaires ont le master 2 (79%) ou son équivalent DEA ou DESS de l'ancien système
universitaire contre 9% d'ingénieurs et 12% de docteurs. Le niveau universitaire tout court est
dominé par la licence (65%) tandis que celui secondaire est dominé par le bac (62%).
 |
30 30 |
▲back to top |
22
Tableau 25. Répartition des étudiants par type diplôme obtenu
Effectif %
Diplôme postuniversitaire 440 52,1
Doctorat 54 12,3
Master 2/ DEA 348 79,1
Ingénieur 38 8,6
Diplôme universitaire 267 31,6
Maîtrise 15 5,6
Licence 174 65,2
DEUG 5 1,9
DES 23 8,6
DUT 50 18,7
Diplôme secondaire 138 16,3
BAC 86 62,3
DTSS 9 6,5
IFM/IPEG/Infirmier 5 3,6
CAP/BT 1/BT 2 13 9,4
Technicien de la santé 2 1,4
Total 845 100,0
Source : DNPD, rapport d’activités 2016
Sur les 15 domaines de formation répertoriés, les trois premiers en représentent plus de la moitié
(50.7%), ce sont l'économie, la médecine et les NTIC. Les 5 premiers domaines occupent 70% des
étudiants maliens diplômés à l'extérieur, les 7 les 80% et les 10 premiers 90%.
Graphique 3: Répartition des diplômes obtenus par domaine de formation
0 50 100 150 200 250
Economie, finances, commerce, douane
Santé, médecine
NTIC
Langues, lettres, art, culture, hôtellerie, tourisme
Droit, sécurité, paix, genre
Sciences Sociales
Sciences et techniques
Industrie, technologie, chimie
Ressources humaines
Ecologie, environnement, changements…
BTP, transport
Energie, électricité, eau
Agronomie, agroéconomie
Sport
Autres
224
102
102
97
69
50
39
29
26
25
22
16
5
1
38
Source : DNPD, rapport d’activités 2016
Evaluation du financement des formations à l’extérieur
Près des deux tiers du financement des étudiants à 'extérieur sont sur fonds propres (66%, soit 556
étudiants diplômés) et le tiers restant par des bourses de coopération, bilatérale ou multilatérale
(34%, soit 289 boursiers). Les principaux pays d'accueil sont le Maroc, l'Algérie, la France, le
Sénégal, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, 6 pays totalisant près des deux tiers des étudiants maliens à
l'extérieur et diplômés en 2016 (65%). Les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie totalisent
plus du premier tiers (36%) contre un dixième pour la France (11%). En y ajoutant le Burkina Faso,
le Niger, la Guinée et la Chine, on arrive à 78% des étudiants pour ces 10 pays les plus importants.
 |
31 31 |
▲back to top |
23
Les autres pays d'accueil comprennent les USA, le Canada, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud,
etc.
Graphique 4: Répartition des étudiants par pays d'accueil
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Maroc
Algérie
France
Sénégal
Tunisie
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
Niger
Guinée
Chine
Autres
119
109
94
80
76
69
36
27
26
23
186
Source : DNPD, rapport d’activités 2016
Par continent, ce sont 77% des formations qui ont eu lieu en Afrique contre 13% en Europe et les
10% restants en Amérique et en Afrique (5% chacun des deux continents). Les investissements
unitaires annuels de formation sont estimés à 5 millions fcfa en Amérique, 4 millions en Europe et
en Asie et 3 millions fcfa en Afrique. Le financement total annuel s'élève ainsi, pour les 845
étudiants, à 2768 millions fcfa, soit un investissent annuel de 3 275 740 fcfa par étudiant.
Evaluation des coûts de formation des diplômes étrangers non reconnus
En dehors des 845 étudiants répertoriés, 142 autres diplômés ont été recensés sans équivalence
nationale de leurs diplômes étrangers, à raison de 104 en provenance d'Afrique, 30 d'Europe, 7
d'Amérique et 1 d'Asie. En maintenant les mêmes frais unitaires annuels par continent, cela
équivalent à un coût total de 471 millions fcfa l'an, soit 3.3 millions fcfa par étudiant.
3.4. Formation professionnelle
La formation professionnelle est ici analysée à travers le coût de formation, ses principaux
indicateurs, les effectifs des apprenants, le financement de la formation et ses principales sources,
les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Elle a concerné 2691 apprenants pour un coût total de
403,65 millions fcfa, soit un coût unitaire de 150 000 fcfa. La répartition par apprenant et par coût
est de 63% pour la formation de type dual et 37% pour le type modulaire.
S'agissant des sortants des centres de formation professionnelle, à travers le pays, la Direction
nationale de ladite formation professionnelle a recensé plus de 11 milles sortants en 2016 contre un
peu moins de 11 mille en 2015, soit une progression de 4%. Les différents ratios rattachés à la
formation professionnelle indiquent une amélioration de la situation en ce qui concerne le taux de
couverture des localités, le taux d'accroissement des programmes et le taux de contribution des
promoteurs à l'équipement de leurs centres de formation professionnelle. Pour les autres indicateurs,
l'année 2016 marque un recul par rapport à 2015, qu'il s'agisse du taux de progression du nombre de
 |
32 32 |
▲back to top |
24
formés, du taux des centres équipés et du taux de recouvrement de la taxe de formation
professionnelle.
Tableau 26. Indicateurs de la formation professionnelle
2015 2016
Nombre de sortants des centres de formation professionnelle 10 914 11 356
Taux de progression du nombre de formés 42,0 11,6
Taux de centres équipés 64,0 57,1
Taux de progression de la taxe de formation professionnelle recouvrée 84,2 59,8
Taux de contributions des promoteurs à l’équipement des centres de formation professionnelle 20,0 68,9
Taux d’évolution des nouvelles localités couvertes 60,0 100,0
Taux d’accroissement des programmes de formation 60,0 78,0
Source : Rapport DNFP, 2016
La formation professionnelle dans les centres de formation professionnelle a concerné en 2105-
2016 922 apprenants contre 1024 en 2014-2015, soit un recul de 10%. Ce recul est provoqué
principalement par les CFP de Badougou Djoliba (-39%) et Yorosso (-37%) au moment où le CFP
de Tominian progressait de 35%. Les CFP publics et le CFP de Missabougou ont tous enregistré un
recul de 10% correspondant au taux global de recul des effectifs d'apprenants en 2016
comparativement à 2015.
Tableau 27. Evolution des effectifs dans les CFP
2014-15 2015-16 Taux annuel d'accroissement
CFP publics 512 461 -10,0
CFP Missabougou 315 282 -10,5
CFP de Badougou Djoliba 18 11 -38,9
CFP de Tominian 77 104 35,1
CFP de Yorosso 102 64 -37,3
Total 1 024 922 -10,0
Source : Rapport DNFP, 2016
En 2015-2016, les apprenants passés par la certification ou la validation des acquis de l'expérience
étaient au nombre de 1688 contre 1037 une année auparavant, soit une progression de 63%. Dans le
métier de couture, coiffure et esthétique, se concentrent 61% de ces apprenants et donc 39% dans
tous les autres métiers dont 14% en mécanique auto et engins à deux roues, 12% en construction
métallique. Les métiers les plus dynamiques, au regard des taux d'accroissement sont l'électronique,
la couture, coiffure et esthétique ainsi que l'électricité auto.
 |
33 33 |
▲back to top |
25
Tableau 28. Effectifs d’apprenants passés par la certification ou la validation des acquis de l’expérience
2014-15 2015-16 Taux annuel
d'accroissement Effectif % Effectif %
Mécanique auto ou engins à deux roues 145 14,0 233 13,8 60,7
Electricité auto 7 0,7 12 0,7 71,4
Froid climatisation 23 2,2 28 1,7 21,7
Electronique 11 1,1 44 2,6 300,0
Construction métallique 138 13,3 204 12,1 47,8
Menuiserie bois 106 10,2 116 6,9 9,4
Couture, coiffure, esthétique 595 57,4 1034 61,3 73,8
Bijouterie 12 1,2 17 1,0 41,7
Total 1 037 100,0 1 688 100,0 62,8
Source : Rapport DNFP, 2016
La formation professionnelle comprend aussi l'éducation non formelle, les CED (Centres
d'Education pour le Développement), CAF (Centres d'Alphabétisation Fonctionnelle) et CAFé
(Centres d'Apprentissage Féminin). En 2015-2016, on en dénombrait plus de 189 mille apprenants
dont 50% en éducation non formelle. Par rapport à 2014-2015, cela représentait une progression d'à
peu près 1%. Les centres d'apprentissage féminin (Café) marquent sur la période une progression
remarquable de 38%, les effectifs étant passés de 637 à 877 apprenantes. Les CED marquent un
léger repli de 1%, ce que gagnent les CAF en progression nette.
Tableau 29. Evolution des apprenants dans les dispositifs d’éducation non formelle
2014-15 2015-16 Croissance
annuelle (%)
Effectif % Effectif %
Education non formelle 93 708 50,0 94 531 50,0 0,9
Centres d'éducation pour le développement (CED) 19 226 10,3 18 998 10,0 -1,2
Centres d'alphabétisation fonctionnelle (CAF) 73 845 39,4 74 656 39,5 1,1
Centres d'apprentissage féminin (CAFé) 637 0,3 877 0,5 37,7
Total 187 416 100,0 189 062 100,0 0,9
Source : Rapport DNFP, 2016
FAFPA
Au 31 octobre 2016, le financement de la formation s'élevait à 5,3 milliards fcfa, à raison de 2.8
dans le secteur moderne et 2.5 dans le secteur dit non-structuré ou informel. La part du FAFPA
(Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage) dans ce total s'élevait à 73%, soit
84% pour le secteur formel et 63% pour l'informel. En termes de réalisation, cependant, les taux
effectifs de décaissement vont de 49% pour le secteur moderne à 60% pour le secteur informel, soit
un taux global de réalisation de 54%. Les taux de réalisation du FAFPA sont meilleurs à ces taux
d'ensemble, 78% respectivement 69% et 74%. Les principaux bénéficiaires sont le secteur des
services et l'apprentissage de type dual, dans l'ensemble comme pour la part du FAFPA.
Tableau 30. Formation de la population active au 31 octobre 2016 (en millions fcfa et %)
Total Part FAFPA
Prévision Réalisation Taux réalisation Prévision Prévision révisée Réalisation Taux réalisation
Secteur moderne dont 2 800 1 381 49,3 2 475 1 485 1 157 77,9
Sous secteur BTP mines 750 431 57,5 675 405 384 94,8
Sous secteur industries 750 379 50,5 675 405 327 80,8
Sous secteur services 1 300 571 43,9 1 125 675 446 66,0
Secteur non structuré dont 2 500 1 493 59,7 2 280 1 368 945 69,1
Monde rural 900 295 32,8 780 468 265 56,7
Artisanat 600 210 35,0 540 324 189 58,3
Apprentissage de type dual 700 926 132,3 700 420 420 100,0
Tertiaire 300 62 20,5 260 156 71 45,4
Total 5 300 2 874 54,2 4 755 2 853 2 102 73,7
Source : FAFPA, rapport d’activités 2016
 |
34 34 |
▲back to top |
26
FIER
Le Fonds d'insertion à l'entreprenariat des jeunes ruraux (FIER) exécute deux volets importants
d'insertion des jeunes sur le marché du travail que sont l'alphabétisation et la réalisation de travaux
HIMO (Haute intensité de main-d'œuvre). Le premier volet s'occupe de l’alphabétisation des jeunes
ruraux, en vue de renforcer les dispositifs d’alphabétisation fonctionnels et de les étendre, si besoin,
là où la couverture est insuffisante. Il est opérationnel dans les régions de Sikasso (cercles de
Kolondiéba, Kadiolo et Yorosso) et de Koulikoro (cercles de Banamba, Kangaba et Kolokani).
Ainsi, en 2016, 3191 jeunes ruraux ont été alphabétisés, à raison de 1461 dans la région de Sikasso
(40% de femmes) et 1730 à Koulikoro (dont 60% de femmes). La formation a lieu dans 77 centres
d'alphabétisation, à raison de 10 dans chacun des 3 cercles de Sikasso ainsi que dans le cercle de
Banamba, 17 à Kangaba et 20 à Kolokani, dans la région de Koulikoro.
En 2016, 194 projets ont été soumis à financement pour un montant total de 98,5 millions fcfa dont
48% pour la région de Koulikoro et 52% pour celle de Sikasso. Le financement devait se répartir
entre trois contributeurs que sont le PAPAM, les SFD et les jeunes eux-mêmes, à raison de 79%,
7% et 14%. A l'exécution, ce sont finalement, 54 projets jeunes qui auront été financés pour un
montant total de 25 millions fcfa, dont les deux tiers à Sikasso et le tiers restant à Koulikoro. Au
total, les jeunes eux-mêmes ont contribué pour 13% et le PAPAM pour 87%. Finalement les SFD
n'ont pas contribué et il serait intéressant de savoir pourquoi. Dans la région de Koulikoro, les
projets n'ont été exécutés que dans le seul cercle de Kolokani pour 8,5 millions fcfa avec 10% de
contribution des jeunes. Les plus faibles contributions des jeunes sont enregistrées à Kadiolo, moins
de 10% et Kolokani, 10%, partout ailleurs ces contributions dépassent les 14% et même les 15% à
Kolondiéba.
Tableau 31. Synthèse des projets soumis au PAPAM Koulikoro et Sikasso (en millions fcfa et %)
Nombre de projets Montant
Contribution (%)
Jeunes SFD PAPAM
Sikasso 35 16 896 480 14,6 85,4
Kadiolo 3 1 005 770 9,7 90,3
Kolondiéba 14 7 695 750 15,3 84,7
Yorosso 18 8 194 960 14,6 85,4
Koulikoro 19 8 471 764 10,3 89,7
Banamba
Kolokani 19 8 471 764 10,3 89,7
Kangaba
Total 54 25 368 244 13,2 86,8
Source : FIER, rapport d’activités 2016
Pour ce qui est des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, des pistes rurales ont été identifiées
par l'APEJ avec l’appui des collectivités locales. L'enveloppe budgétaire PTBA 2016 a permis
l'aménagement de 4 pistes dont deux dans chacune des deux régions. A Sikasso, les deux pistes
identifiées auront été, la piste Boura – Route principale (Commune de Boura, cercle de Yorosso) sur 1,5
Km pour 3,5 m de largeur, la piste Ménamba – Bema (Commune de Ménamba, cercle de Yorosso) sur 3 km
d'une largeur de 3,5 m. Pour la réalisation de ces deux pistes, 20 jeunes (dont 9 filles) ont été engagés sur la
piste de Boura et 30 (dont 10 filles) sur celle de Ménamba. Au total, les 50 jeunes (dont 19 filles) ont
bénéficié de deux jours de formation APEJ et les travaux d’aménagement ont été exécutés fin juillet
2016. Ainsi, la piste de Boura a été aménagée sur 400 m et celle de Ménamba sur 700 m mais sur
cette dernière piste les travaux auraient été interrompus suite à des pluies diluviennes qui ont
emporté une bonne partie des remblais. La reprise des travaux a été prise en charge par la CMDT.
Dans la région de Koulikoro, les deux pistes retenues sont la piste Naréna – Kéniéma (Commune de
Naréna, cercle de Kangaba) sur une longueur de 5 km large de 3m, et la piste Karan – Dangacene
(Commune de Karan, cercle de Kangaba) sur 7 km pour 3 m de large. Les travaux de la première
 |
35 35 |
▲back to top |
27
piste n'auraient commencé qu'en décembre 2016 engageant une trentaine de jeunes avec
l'accompagnement de l'APEJ. Les travaux HIMO ne semblent pas bénéficier de toute l'attention
nécessaire du FIER, ce sont pourtant de vrais réservoirs d'emploi surtout pour les jeunes ruraux et
participent au rapprochement des zones de production des marchés d'écoulement des produits
locaux.
 |
36 36 |
▲back to top |
28
4. Marché du travail
L'analyse du marché du travail s'opère ici à travers la situation de l'emploi et du chômage,
l'intermédiation entre offreurs et demandeurs de travail ainsi que la création d'emploi et
l'employabilité des arrivants sur le marché.
4.1. Situation de l’emploi et du chômage
En plus des données administratives sur l'emploi, des données d'enquête sont aussi disponibles au
sortir du module emploi de l'Enquête permanente modulaire auprès des ménages (EMOP) conduite
chaque année depuis 2013. Les données de l’emploi sont collectées au quatrième passage de ladite
enquête au cours du dernier trimestre de l'année. Ainsi, en 2016, la population en âge de travailler
(les 15 ans et plus) est estimée à près de 9 millions de personnes dont 53.5% de femmes. Les
personnes en emploi et les chômeurs représentent près de 76% de ce total pour 6% en main-d'œuvre
potentielle et 18% hors main-d'œuvre. Les deux premières catégories représentent la main-d'œuvre
ou population active. Les deux dernières sont dites hors main-d'œuvre répartie en main-d'œuvre
potentielle et autre hors main-d'œuvre.
Tableau 32. Répartition de la population en âge de travailler par statut vis-à-vis de la main-d'œuvre
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
En emploi 3 105 799 74,8 2 351 980 49,3 5 457 779 61,2
Chômeur 43 253 1,0 29 693 0,6 72 945 0,8
Main-d'œuvre potentielle 241 395 5,8 274 419 5,8 515 814 5,8
Autre hors main-d'œuvre 763 087 18,4 2 114 829 44,3 2 877 917 32,2
Total 4 153 534 46,5 4 770 921 53,5 8 924 455 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2016)
4.1.1. Population active et taux d’activités
En 2016, la population active ou main-d'œuvre est estimée à 5.5 millions de personnes dont 44% de
femmes et 56% d'hommes. Les trois quarts de cette main-d'œuvre sont en milieu rural et le quart
restant en milieu urbain dont un peu plus de la moitié à Bamako (13%). Les régions de forte
concentration de main-d'œuvre sont Sikasso (22%), Ségou (18%) et Mopti (16%). Deux tranches
d'âge concentrent 63% des actifs, ce sont les 41-64 (32%) et les 25-35 (31%). Par niveau
d'éducation, seulement 5% de cette population active ont le niveau secondaire et plus, 3% chez les
femmes et 7% chez les hommes, la population étant largement analphabète (75%, à raison de 81%
chez des femmes et 70% des hommes).
 |
37 37 |
▲back to top |
29
Tableau 33. Répartition de la population active ou main d’œuvre
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Zone de
résidence
Urbain 812 300 25,8 558 201 23,4 1 370 500 24,8
Bamako 423 454 13,4 310 322 13,0 733 776 13,3
Autre urbain 388 846 12,3 247 878 10,4 636 724 11,5
Rural 2 336 752 74,2 1 823 472 76,6 4 160 224 75,2
Région
Kayes 377 614 12,0 342 848 14,4 720 463 13,0
Koulikoro 466 437 14,8 159 591 6,7 626 028 11,3
Sikasso 586 729 18,6 644 406 27,1 1 231 135 22,3
Ségou 546 820 17,4 422 697 17,7 969 517 17,5
Mopti 508 281 16,1 361 242 15,2 869 523 15,7
Tombouctou 159 371 5,1 114 017 4,8 273 389 4,9
Gao 80 345 2,6 26 549 1,1 106 894 1,9
Bamako 423 454 13,4 310 322 13,0 733 776 13,3
Classe d'âge
15 - 24 ans 551 793 17,5 546 244 22,9 1 098 037 19,9
25 - 35 ans 876 668 27,8 840 628 35,3 1 717 297 31,1
36 - 40 ans 434 833 13,8 303 227 12,7 738 060 13,3
41 - 64 ans 1 125 580 35,7 655 256 27,5 1 780 836 32,2
Plus de 64 ans 160 177 5,1 36 317 1,5 196 494 3,6
Niveau
d'éducation
Aucun 2 209 994 70,2 1 940 589 81,5 4 150 583 75,0
Fondamental 721 654 22,9 361 017 15,2 1 082 671 19,6
Secondaire 129 055 4,1 57 256 2,4 186 311 3,4
Supérieur 88 348 2,8 22 810 1,0 111 159 2,0
Total 3 149 052 56,1 2 381 672 43,9 5 530 724 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2016)
En rapportant la main-d'œuvre à la population en âge de travailler, le taux d’activités obtenu est de
62% les deux sexes confondus, soit 76% des hommes et 50% des femmes. Le taux est plus élevé en
milieu rural qu'en milieu urbain. Il est très faible à Gao (33% avec 16% chez les femmes) et
Koulikoro (40%, 19% chez les femmes), plutôt très élevé à Sikasso (76%, 73% pour les femmes) et
Mopti (72%, 58% chez les femmes). Le taux d’activités augmente avec l'âge jusqu'à 40 ans, au-delà
il décroît pour devenir très faible à partir de 65 ans (31% avec 14% pour les femmes). Il est faible
pour le niveau fondamental d'éducation (50%) puis augmente de 66% à 80% en passant du niveau
secondaire au supérieur. Le taux d’activités des femmes est très faible à Gao (15,5%) et est le plus
élevé à Sikasso (73%). Ces deux extrêmes pour les hommes sont observés à Gao (51%) et Mopti
(84%). Les femmes les plus actives comme les hommes les plus actifs ont 36-40 ans.
 |
38 38 |
▲back to top |
30
Tableau 34. Taux d’activités par caractéristique sociodémographique (en %)
Taux d'activité
Homme Femme Total
Zone de
résidence
Urbain 71,3 43,3 56,5
Bamako 72,1 47,7 59,3
Autre urbain 70,5 38,9 53,5
Rural 77,5 52,4 64,0
Région
Kayes 74,4 53,2 62,5
Koulikoro 63,1 19,1 39,8
Sikasso 80,2 73,1 76,3
Ségou 84,1 55,6 68,7
Mopti 87,2 57,8 72,0
Tombouctou 80,0 56,3 68,1
Gao 51,4 15,5 32,6
Bamako 72,1 47,7 59,3
Classe d'âge de
travail
15 - 24 ans 50,5 39,0 44,0
25 - 35 ans 89,2 57,4 70,2
36 - 40 ans 95,5 59,8 76,7
41 - 64 ans 90,7 57,1 74,6
Plus de 64 ans 42,0 14,4 31,1
Niveau
d'éducation
Aucun 81,8 53,4 65,5
Fondamental 61,9 36,0 49,9
Secondaire 71,5 55,1 65,5
Supérieur 82,8 69,1 79,6
Total 75,8 49,9 62,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2016)
4.1.2. Taux d'emploi informel
Une des caractéristiques du marché malien du travail est la dominance de l'emploi informel qui
représente jusqu'à 96% de l'emploi total avec 98% pour les femmes. Ce type d'emploi est partout
dominant, dans toutes les régions et quel que soit le milieu. Son taux diminue significativement
avec le niveau d'éducation, de 96,5% pour le primaire à 37% pour le supérieur en passant par 47%
pour le secondaire. Ainsi, l'éducation serait un des remparts contre l'emploi informel surtout chez
les femmes.
Tableau 35. Taux d’emploi informel selon le sexe (en %)
Homme Femme Total
Zone de résidence
Urbain 86,5 92,5 88,9
Bamako 83,3 91,5 86,7
Autre urbain 89,8 93,8 91,4
Rural 98,3 99,4 98,8
Classe d’âge
15 - 24 ans 99,3 99,2 99,3
25 - 35 ans 94,4 97,2 95,8
36 - 40 ans 92,2 97,6 94,4
41 - 64 ans 94,9 97,5 95,9
Plus de 64 ans 99,0 100,0 99,2
Niveau d'éducation
Aucun niveau 99,4 99,8 99,6
Primaire 95,8 97,9 96,5
Secondaire 52,3 34,5 47,3
Supérieur 38,4 34,5 37,7
Total 95,4 97,9 96,4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2016)
 |
39 39 |
▲back to top |
31
4.1.3. Emploi selon le secteur institutionnel
La dominance de l'emploi informel se traduit par la part importante des entreprises privées
informelles dans la répartition institutionnelle de l'emploi. Celles-ci représentent 81% de l'emploi
total contre 3% pour le secteur public, moins de 1% pour les entreprises privées formelles ou les
organismes internationaux ou la société civile (ONG et associations). Le personnel de maison
représente 15% de l'emploi au Mali, 5% à Bamako mais 10% des femmes dans ce district contre
moins de 1% des hommes. Les entreprises privées formelles sont l'apanage du milieu urbain
principalement Bamako. Dans ce milieu le secteur public y est aussi le plus concentré, avec 10%
des emplois à Bamako, 8% dans les autres centres urbains et 1% en milieu rural.
Tableau 36. Répartition des actifs occupés par secteur institutionnel
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Secteur public 12,4 6,7 10,0 10,9 5,2 8,7 1,6 0,7 1,2 4,1 1,9 3,2
Entreprise privée formelle 4,2 0,5 2,6 2,0 0,2 1,3 0,3 0,0 0,2 1,0 0,1 0,6
Entreprise privée informelle 81,1 82,5 81,7 71,8 80,6 75,2 79,3 83,7 81,2 78,6 83,3 80,6
ONG, OI, association 1,6 0,2 1,0 1,5 1,4 1,5 1,1 0,5 0,8 1,2 0,6 0,9
Personnel de maison 0,7 10,2 4,7 13,8 12,6 13,4 17,8 15,0 16,6 15,1 14,2 14,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2016)
4.1.4. Chômage
En 2016, le taux de chômage est estimé à 9.7% contre 9.4 une année auparavant et 7.3% en 2013.
Le taux est plus élevé en milieu urbain que rural, plus élevé aussi pour les femmes que pour les
hommes. En 2016, les écarts sont assez significatifs, 3 points de pourcentage entre les hommes et
les femmes, 3 points également entre les urbains et les ruraux. L'écart genre s'était rétréci en 2014, 2
points de pourcentage alors qu'il était de plus de 4 points en 2013. Justement en 2014, le taux de
chômage des femmes diminuait par rapport à 2013 tandis que celui des hommes augmentait,
augmentation sans doute induite par le milieu urbain.
Tableau 37. Evolution du taux de chômage de 2013 à 2016
2013 2014 2015 2016
Homme 5,1 7,3 8,1 8,4
Femme 9,5 9,3 10,8 11,4
Urbain 8,9 11,9 11,7 12,1
Rural 6,8 7,1 8,7 9,0
Total 7,3 8,2 9,4 9,7
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2016)
4.1.5. Sous-emploi lié à la durée du travail
Mesuré par rapport à la durée normale de travail, le taux de sous-emploi de la main-d'œuvre est de
12%, à raison de 5% pour les hommes et de 21% pour les femmes. Il est plus important en milieu
urbain (16%) surtout à Bamako (18%), avec 27% respectivement 33% pour les femmes. En dehors
de Bamako, les taux restent également élevés voire très élevés à Gao (22% avec 31% pour les
femmes) et Kayes (18% respectivement 30%). A contrario, les taux sont relativement bas à
Koulikoro (3% pour 5% chez les femmes) et Ségou (6% et 11%). Le sous-emploi est presque
égalitairement réparti dans les différentes tranches d'âge à la seule exception des 36-40 ans où son
taux est de 10% contre une moyenne de 12%. Quel que soit l'âge, les taux sont plus faibles chez les
hommes que chez les femmes, 4-5% chez les hommes âgés de 15 à 64 ans contre 18-22% chez les
femmes. Au-delà de 64 ans, le taux des hommes est monté à 10,5% tandis que celui des femmes
monte à 25%. Dans l'ensemble, le taux est plus élevé chez les actifs ayant le niveau secondaire
d'éducation (17%) ainsi que chez les hommes, chez les femmes par contre le pic se situe chez les
 |
40 40 |
▲back to top |
32
actives du niveau fondamental (27%). Il est curieux que le sous-emploi des hommes de niveau
supérieur soit plus élevé que chez les analphabètes (10,5% contre 5%), c'est bien l'inverse chez les
femmes (16% contre 20%).
Tableau 38. Taux de sous-emploi
Source. Calcul de l’ONEF à partir des données EMOP 2016
4.1.6. Inactivité
Les principales raisons d'inactivité sont les activités ménagères (femmes au foyer) pour 43% des
raisons, la scolarité (23%), soit déjà près des deux tiers de l'inactivité. La retraite représente 15%.
La scolarité est le principal motif d'inactivité chez les hommes, en raison de la plus forte et plus
longue scolarisation des garçons comparativement aux filles. Il en est de même pour le milieu
urbain par rapport à celui rural. Ainsi donc la scolarisation reste au Mali un phénomène urbain et
masculin. Les femmes sont davantage au foyer à Mopti (64%) et Ségou (50%) et certainement
moins à Sikasso (23%) et Bamako (35%). A Sikasso, c'est davantage la retraite et la scolarité qui
peuvent rendre inactive une femme tandis qu'à Bamako c'est principalement la scolarité. La femme
au foyer est majoritairement analphabète.
Homme Femme Total
Zone de résidence
Urbain 7,9 27,4 15,8
Bamako 7,0 33,0 17,9
Autre urbain 9,0 20,6 13,5
Rural 4,4 18,6 10,7
Région
Kayes 7,3 30,0 18,1
Koulikoro 2,8 4,9 3,4
Sikasso 6,7 17,8 12,5
Ségou 2,2 11,4 6,2
Mopti 3,3 27,7 13,4
Tombouctou 9,3 7,5 8,6
Gao 18,9 31,4 22,0
Bamako 7,0 33,0 17,9
Classe d’âge
15 - 24 ans 5,2 19,7 12,4
25 - 35 ans 5,2 21,3 13,1
36 - 40 ans 4,2 17,7 9,8
41 - 64 ans 5,2 21,6 11,2
Plus de 64 ans 10,5 24,7 13,2
Niveau d'éducation
Aucun 4,1 19,6 11,4
Fondamental 6,4 26,9 13,2
Secondaire 16,9 18,1 17,2
Supérieur 12,5 15,6 13,0
Total 5,3 20,6 11,9
 |
41 41 |
▲back to top |
33
Tableau 39. Répartition des inactifs par raison d'inactivité
Invalide ou en
maladie de
longue durée
En cours de
scolarité,
étudiant
Retraité /
vieillard
Grossesse
Femme
au foyer
Rentier Autres Total
Sexe
Homme 9,7 46,4 25,3 0,0 0,0 0,0 18,6 100,0
Femme 4,8 14,1 10,9 0,6 58,4 0,0 11,2 100,0
Zone de
résidence
Urbain 4,2 39,8 13,1 0,4 36,7 0,1 5,8 100,0
Bamako 2,1 45,5 14,3 0,4 34,9 0,0 2,8 100,0
Autre urbain 6,3 34,4 11,9 0,5 38,4 0,1 8,6 100,0
Rural 7,0 14,5 15,5 0,5 45,9 0,0 16,7 100,0
Région
Kayes 6,9 14,2 15,3 0,1 48,8 0,0 14,7 100,0
Koulikoro 4,8 15,4 7,9 0,0 42,4 0,0 29,4 100,0
Sikasso 8,7 30,9 31,8 0,4 23,3 0,1 4,8 100,0
Ségou 10,2 18,2 17,5 0,2 50,3 0,0 3,5 100,0
Mopti 4,9 9,1 15,3 0,3 63,9 0,0 6,5 100,0
Tombouctou 6,3 27,2 6,8 6,5 44,7 0,2 8,3 100,0
Gao 7,5 27,2 11,1 0,2 36,6 0,0 17,4 100,0
Bamako 2,1 45,5 14,3 0,4 34,9 0,0 2,8 100,0
Classe
d'âge de
travail
15 - 24 ans 1,6 61,2 0,0 0,3 35,1 0,0 1,8 100,0
25 - 35 ans 2,3 6,0 0,0 1,0 69,8 0,0 20,9 100,0
36 - 40 ans 4,8 2,9 0,1 0,5 77,9 0,0 13,8 100,0
41 - 64 ans 11,8 3,0 21,8 0,3 41,5 0,0 21,6 100,0
Plus de 64 ans 14,4 1,7 67,3 0,0 2,6 0,1 13,9 100,0
Niveau
d'éducation
Aucun 7,9 4,0 19,7 0,5 51,2 0,0 16,7 100,0
Fondamental 2,6 60,7 2,7 0,3 27,3 0,0 6,4 100,0
Secondaire 2,2 55,1 16,6 0,4 21,5 0,0 4,3 100,0
Supérieur 0,7 27,5 49,6 0,0 16,7 0,0 5,6 100,0
Total 6,1 22,7 14,7 0,5 42,9 0,0 13,1 100,0
Source. Calcul de l’ONEF à partir des données EMOP 2016
Les inactifs subviennent à leurs besoins principalement par l'aide (96%), accessoirement par la
pension (2%) et marginalement la rente, l'épargne, la bourse ou la mendicité (2% pour ces 4 moyens
réunis). L'aide joue relativement moins chez les hommes que chez les femmes (90%) qui dépendent
un peu plus de pension, des revenus de propriété et d'épargne. Les inactifs de niveau supérieur en
ont également moins besoin (63% contre 96% en moyenne nationale), eux qui dépendent beaucoup
plus fortement de pension, surtout à Bamako, Sikasso et Koulikoro. La mendicité est tout aussi
relativement plus importante comme moyen de survie à Koulikoro, Bamako et Gao que partout
ailleurs. Peu importe qui mendie, mais la mendicité "nourrit" plus les 36-40 ans. La bourse est le
revenu des étudiants dont le niveau d'études achevé reste le secondaire.
 |
42 42 |
▲back to top |
34
Tableau 40. Répartition des inactifs selon les moyens utilisés pour survivre
Pension Aides Revenus propriétés / rentes Epargne Mendie Boursier Total
Sexe
Homme 5,3 89,6 1,6 2,8 0,1 0,6 100,0
Femme 1,2 98,1 0,2 0,4 0,1 0,0 100,0
Zone de
résidence
Urbain 4,4 94,0 0,5 0,5 0,1 0,5 100,0
Bamako 5,6 92,3 0,8 0,3 0,1 1,0 100,0
Autre urbain 3,4 95,6 0,2 0,8 0,0 0,0 100,0
Rural 1,3 96,8 0,6 1,2 0,1 0,0 100,0
Région
Kayes 0,6 92,9 0,2 6,3 0,0 0,0 100,0
Koulikoro 2,3 97,2 0,1 0,2 0,2 0,0 100,0
Sikasso 3,5 96,3 0,1 0,1 0,0 0,0 100,0
Ségou 0,7 96,7 2,4 0,2 0,0 0,0 100,0
Mopti 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Tombouctou 5,0 92,8 1,4 0,6 0,0 0,3 100,0
Gao 1,3 98,1 0,0 0,5 0,1 0,0 100,0
Bamako 5,6 92,3 0,8 0,3 0,1 1,0 100,0
Classe
d'âge de
travail
15 - 24 ans 0,3 99,2 0,0 0,3 0,0 0,3 100,0
25 - 35 ans 0,6 97,9 0,2 0,9 0,0 0,3 100,0
36 - 40 ans 0,9 97,4 0,0 1,4 0,4 0,0 100,0
41 - 64 ans 4,5 92,1 1,2 2,0 0,2 0,0 100,0
Plus de 64 ans 7,1 89,9 1,9 1,1 0,0 0,0 100,0
Niveau
d'éducation
Aucun 1,7 96,2 0,8 1,2 0,1 0,0 100,0
Fondamental 1,5 97,8 0,1 0,6 0,0 0,0 100,0
Secondaire 16,0 78,0 0,0 0,6 0,0 5,4 100,0
Supérieur 36,0 63,3 0,7 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 2,3 95,9 0,6 1,0 0,1 0,2 100,0
Source. Calcul de l’ONEF à partir des données EMOP 2016
4.2. Intermédiation
L’intermédiation est une des activités principales des agences et bureaux publics ou privés de
placement que sont l'ANPE et les bureaux privés de placement (BPP). Ces intermédiaires
enregistrent les demandes et offres d'emploi pour procéder au placement des demandeurs auprès des
offreurs. Les statistiques de ces activités d'enregistrement et de placement sont analysées ici.
4.2.1. Demandes d’emplois
Plus de 14 mille demandes d'emplois ont été enregistrées en 2016 par les agences et bureaux de
placement dont 25,5% de demandes féminines. L'ANPE en a enregistré 58% et les BPP 42%. Sur le
total, les chômeurs représentent 75% et les occupés 25%. De façon presque invariable, les femmes
comptent pour 25%, sensiblement plus à Mopti (36%) et Bamako (28%) et beaucoup moins à Gao
(10,5%). Le gros contingent des demandeurs est fourni par les 20-39 ans, 86% de l'effectif à raison
de 26% les 20-24, 36% les 25-29 et 23% les 30-39 ans. Les demandeurs d'emploi enregistrés sont
ceux qui ont pour la plupart le niveau d'éducation secondaire ou plus, 64%
 |
43 43 |
▲back to top |
35
Tableau 41. Demandes d’emploi enregistrées par caractéristique sociodémographique
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Structure de
placement
ANPE 6 079 75,3 1 999 24,7 8 078 57,7
BPP/ETT 4 359 73,5 1 575 26,5 5 934 42,3
Situation du
demandeur
Chômeur 7 843 74,6 2 670 25,4 10 513 75,0
Occupé 2 595 74,2 904 25,8 3 499 25,0
Région
Kayes 728 79,9 183 20,1 911 6,5
Koulikoro 816 82,2 177 17,8 993 7,1
Sikasso 587 78,3 163 21,7 750 5,4
Ségou 483 78,4 133 21,6 616 4,4
Mopti 353 64,3 196 35,7 549 3,9
Tombouctou 129 82,7 27 17,3 156 1,1
Gao 496 89,5 58 10,5 554 4,0
Kidal 191 80,9 45 19,1 236 1,7
Bamako 6 655 72,0 2 592 28,0 9 247 66,0
Classe d'âge
moins de 15 ans 21 72,4 8 27,6 29 0,2
15 – 19 ans 494 76,6 151 23,4 645 4,6
20 – 24 ans 2 627 71,6 1 044 28,4 3 671 26,2
25 – 29 ans 3 732 73,4 1 353 26,6 5 085 36,3
30 – 39 ans 2 453 75,1 814 24,9 3 267 23,3
40 – 59 ans 855 89,9 96 10,1 951 6,8
60 ans et plus 33 94,3 2 5,7 35 0,2
non déterminé 223 67,8 106 32,2 329 2,3
Niveau
d'éducation
Néant 1 220 87,8 170 12,2 1 390 9,9
Alphabétisé 447 73,9 158 26,1 605 4,3
1er Cycle fondamental 694 75,7 223 24,3 917 6,5
2ème Cycle fondamental 1 165 80,2 288 19,8 1 453 10,4
Secondaire général 597 80,5 145 19,5 742 5,3
Secondaire technique et professionnel 2 398 69,3 1063 30,7 3 461 24,7
Supérieur 1(DEUG/DUT/Licence) 1 607 68,9 724 31,1 2 331 16,6
Supérieur 2 (Maîtrise et plus) 2 310 74,2 803 25,8 3 113 22,2
Total 10 438 74,5 3 574 25,5 14 012 100,0
Source : DPS/ANPE, 2016
Par qualification professionnelle, les demandeurs d'emploi sont par ordre décroissant, les cadres
supérieurs (28%), les cadres moyens (27%) puis les manœuvres (20%), soit les trois quarts des
demandeurs. Les ouvriers et les employés ferment la marche (25% au total). Par métier ou emploi
recherché, les finances, BTP et services aux ménages absorbent la majorité des demandes, 51%.
Trois métiers de plus (justice, transport et commerce) que l'on totalise 76% des demandeurs
d'emploi. Trois métiers encore (agriculture, enseignement et santé) et le cumul est à 90%, pour 9
métiers sur les 15 recensés
 |
44 44 |
▲back to top |
36
Tableau 42. Demandes d’emplois enregistrées par qualification et métier demandé
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Qualification
Cadres supérieurs 2 858 72,7 1 075 27,3 3 933 28,1
Cadres moyens et agents de maîtrise 2 618 68,5 1 204 31,5 3 822 27,3
Ouvriers 1 752 86,6 271 13,4 2 023 14,4
Employés 1 029 71,4 412 28,6 1 441 10,3
Manœuvres et assimilés 2 181 78,1 612 21,9 2 793 19,9
Métier
recherché
Agriculture, hydrologie, pêche et sylviculture 642 89,8 73 10,2 715 5,1
BTP 1 763 91,3 168 8,7 1 931 13,8
Industrie 360 71,9 141 28,1 501 3,6
Maintenance et réparation 272 93,5 19 6,5 291 2,1
Transports et logistique 1 071 93,8 71 6,2 1142 8,2
Gestion administrative et financière 2 228 65,2 1 188 34,8 3 416 24,4
Justice 1 013 72,3 389 27,7 1 402 10,0
Commerce 683 69,5 300 30,5 983 7,0
Création artisanale 51 60,7 33 39,3 84 0,6
Boucher, hôtellerie et restauration 116 42,2 159 57,8 275 2,0
Education et enseignement 510 74,2 177 25,8 687 4,9
Culture et communication 153 62,4 92 37,6 245 1,7
Santé 292 50,3 289 49,7 581 4,1
Services aux ménages/personnes 1 283 73,0 475 27,0 1 758 12,5
Culte 1 100,0 0 0,0 1 0,0
Total 10 438 74,5 3 574 25,5 14 012 100,0
Source : DPS/ANPE, 2016
4.2.2. Offres d’emplois
Face aux 14 mille demandes d'emplois, les bureaux et agences de placement ont enregistré 6.5 mille
offres d'emploi dont 65% pour l'ANPE et 35% pour les bureaux privés de placement. Ce sont au
total, 87% d'offres de nouveaux postes contre 13% de remplacement de postes existants. La
majorité des offres est pour une durée d'un an au plus (62%) contre 42% pour plus d'un an dont 22%
pour plus de 2 ans. Par région, Bamako seule enregistre 2 offres sur 5, suivie de Gao, une offre sur
5, soit déjà trois offres sur cinq pour ces deux seules régions. Elles sont suivies de Kayes, 14%, les
autres régions se partageant les 25% d'offres restantes.
Tableau 43. Offres d’emplois enregistrées par Bureaux caractéristique sociodémographique
Effectif %
Structure de placement
Offres de l’ANPE 4 266 65,0
Offres des BPP et ETT 2 298 35,0
Type d'emploi offert
Nouveau poste 5 686 86,6
Remplacement 878 13,4
Durée de l'emploi offert
moins de 3 mois 1 572 23,9
3 à 6 mois 773 11,8
6 à 12 mois 1 720 26,2
12 à 24 mois 1 073 16,3
plus de 24 mois 1 426 21,7
Région
Kayes 931 14,2
Koulikoro 175 2,7
Sikasso 372 5,7
Ségou 398 6,1
Mopti 376 5,7
Tombouctou 252 3,8
Gao 1 342 20,4
Kidal 60 0,9
Bamako 2 658 40,5
Total 6 564 100,0
Source : DPS/ANPE, 2016
 |
45 45 |
▲back to top |
37
Par qualification, les offres s'adressent en premier aux cadres moyens (27.5%) puis aux ouvriers
(21.5%) et employés (20%). Il y a relativement peu d'offre pour les cadres supérieurs alors qu'ils
sont les premiers demandeurs d'emploi. Les quatre métiers les plus recherchés sont les BTP, la
gestion administrative et financière, l'industrie et la santé, soit 59% de l'offre totale pour les 15
métiers visés. Si on y ajoute le commerce et les services aux ménages, on arrive à 78,5% des offres
d'emplois de 2016. On voit bien qu'il y a un certain décalage dans les métiers entre offre et demande
d'emploi.
Tableau 44. Offres d’emplois enregistrées par qualification et métiers
Effectif %
Qualification
Cadre supérieur 826 12,6
Cadre moyen 1 806 27,5
Ouvriers 1 408 21,5
Employés 1 332 20,3
Manœuvres et assimilés 1 192 18,2
Métiers
Agriculture, de l'hydrologie, de la pêche et de la sylviculture 320 4,9
BTP 1 323 20,2
Industrie 860 13,1
Maintenance et réparation 310 4,7
Transports et logistique 258 3,9
Gestion administrative et financière 890 13,6
Justice 67 1,0
Commerce 645 9,8
Création artisanale 15 0,2
Hôtellerie et restauration 100 1,5
Enseignement 152 2,3
Culture et communication 189 2,9
Santé et action sociale 816 12,4
Services aux ménages/personnes 619 9,4
Culte 0 0,0
Total 6 564 100,0
Source : DPS/ANPE
Les principales branches d'activités des offreurs d'emplois sont la santé, l'industrie, la construction
et le commerce, soit 57% du volume total pour ces quatre branches sur les 21 branches répertoriées.
Les quatre banches suivantes sont par ordre décroissant les finances et assurances, la bureautique,
les activités des ménages et la communication, soit au total 79% des offres enregistrées en 2016.
 |
46 46 |
▲back to top |
38
Tableau 45. Offres d’emploi enregistrées par branche d’activités de l’entreprise
Effectif %
Agriculture, sylviculture et pêche 151 2,3
Extraction 16 0,2
Fabrication 917 14,0
Production et distribution d'électricité et de gaz 98 1,5
Production et distribution d'eau, assainissement, etc. 234 3,6
Construction 807 12,3
Commerce 624 9,5
Transport et entreposage 146 2,2
Hébergement et restauration 81 1,2
Information et communication 269 4,1
Finances et assurances 480 7,3
Immobilier 22 0,3
Science et technique 108 1,6
Services de soutien et de bureau 366 5,6
Administration publique 158 2,4
Enseignement 166 2,5
Santé humaine et action sociale 1391 21,2
Activités artistiques, sportives et récréatives 5 0,1
Autres activités de services N,C,A, 75 1,1
Activités spéciales des ménages 332 5,1
Activités des organisations extraterritoriales 118 1,8
Total 6 564 100,0
Source : DPS/ANPE, 2016
4.2.3. Placements
Les statistiques de placements de la main-d'œuvre indiquent un effectif total de 4 532 personnes
dont 18% de femmes. Ces placements sont effectués en majorité par les bureaux privés (53%) et
encore majoritairement à Bamako (58%). Les bureaux privés aussi placent plus de femmes que
l'ANPE. Par région, en dehors de Bamako, les placements ont surtout lieu à Kayes (15%) et Ségou
(8%), soit déjà quatre placements sur cinq, rien qu'à Bamako, Kayes et Ségou, sur les 9 régions du
pays. Par niveau d'éducation, le secondaire technique professionnel s'en sort relativement mieux que
les autres (21,5%), suivi du premier cycle fondamental (8%), soit 39% des deux niveaux. Il faut
noter que les analphabètes et les diplômés du supérieur 1 (DEUG/DUT/Licence) ont le même
pourcentage de placements dans le total, 14%. La différence entre ces deux niveaux se situe dans le
placement beaucoup plus important de femmes dans le supérieur que chez les analphabètes (38%
contre 5%)
 |
47 47 |
▲back to top |
39
Tableau 46. Placements effectués par caractéristique sociodémographique
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Structure de
placement
ANPE 1 815 85,7 303 14,3 2 118 46,7
BPP/ETT 1 896 78,5 518 21,5 2 414 53,3
Région
Kayes 542 78,1 152 21,9 694 15,3
Koulikoro 99 94,3 6 5,7 105 2,3
Sikasso 218 90,5 23 9,5 241 5,3
Ségou 320 91,2 31 8,8 351 7,7
Mopti 42 62,7 25 37,3 67 1,5
Tombouctou 100 87,0 15 13,0 115 2,5
Gao 251 93,0 19 7,0 270 6,0
Kidal 57 95,0 3 5,0 60 1,3
Bamako 2 082 79,2 547 20,8 2 629 58,0
Niveau
d'éducation
Néant 591 95,2 30 4,8 621 13,7
Permis de conduire 244 95,3 12 4,7 256 5,6
1er Cycle fondamental 663 82,8 138 17,2 801 17,7
2ème Cycle fondamental 517 89,1 63 10,9 580 12,8
Secondaire général 207 82,1 45 17,9 252 5,6
Secondaire technique professionnel 759 77,8 217 22,2 976 21,5
Supérieur 1 (DEUG/DUT/Licence) 393 63,3 228 36,7 621 13,7
Supérieur 2 (Maîtrise et plus) 337 79,3 88 20,7 425 9,4
Total 3 711 81,9 821 18,1 4 532 100,0
Source : DPS/ANPE, 2016
Les placements effectués se répartissent en 17% de femmes et 83% d'hommes. Près du tiers
(32,5%) est constitué de manœuvres et assimilés dont 13% de femmes, ensuite viennent les cadres
moyens et les ouvriers, pour 45% les deux qualifications. Les employés (12%) et les cadres
supérieurs (10%) ferment la marche. Par métier, ce sont les BTP et l'industrie qui se distancent des
autres avec 19% et 18% respectivement. Trois autres métiers suivent 15%, 13% et 12% de part
respective, ce sont la gestion administrative et financière, les services aux ménages et le commerce.
Tableau 47. Placements effectués selon la qualification et les métiers
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Qualification
Cadre Supérieur 374 79,4 97 20,6 471 10,4
Cadre Moyen 750 68,9 338 31,1 1 088 24,0
Ouvriers 928 95,6 43 4,4 971 21,4
Employés 381 72,2 147 27,8 528 11,7
Manœuvres et assimilés 1 278 86,7 196 13,3 1 474 32,5
Métiers
Agriculture, hydrologie, pêche et sylviculture 176 90,3 19 9,7 195 4,3
BTP 827 98,1 16 1,9 843 18,6
Industrie 713 87,0 107 13,0 820 18,1
Maintenance et réparation 150 98,0 3 2,0 153 3,4
Transport et logistique 168 94,9 9 5,1 177 3,9
Gestion administrative et financière 449 68,0 211 32,0 660 14,6
Justice 53 79,1 14 20,9 67 1,5
Commerce 357 65,7 186 34,3 543 12,0
Création artisanale 9 56,3 7 43,8 16 0,4
Hôtellerie et restauration 54 58,7 38 41,3 92 2,0
Education et enseignement 91 79,1 24 20,9 115 2,5
Culture et communication 78 78,0 22 22,0 100 2,2
Santé et action sociale 99 59,3 68 40,7 167 3,7
Services aux ménages/personnes 487 83,4 97 16,6 584 12,9
Total 3 711 83,3 821 16,7 4 532 100,0
Source : DPS/ANPE, 2016
Les femmes sont proportionnellement mieux représentées dans l'hôtellerie et la restauration (41%
des 2% de part de ce métier dans les placements totaux), dans la santé et l'action sociale (41% des
4%). De l'autre côté, elles sont quasi absentes des BTP et de la maintenance – réparation (2%
chacun) ainsi que des transports et logistiques (5%).
 |
48 48 |
▲back to top |
40
4.3. Créations d’emplois et employabilité
Sur la période 2013 – 2016, il a été créé 186 893 emplois nets soit 194 483 emplois créés pour
7 590 emplois détruits ou perdus. La création nette a été la plus forte en 2016, grâce à une plus
grande création d'emplois sinon les pertes d'emplois ont été beaucoup plus importantes
comparativement à 2014 et 2015 sinon presque de même niveau qu'en 2013. Pour les années 2013
et 2014, il a été créé plus d'emplois privés que publics et depuis 2015 c'est exactement l'inverse,
plus d'emplois publics que privés avec en 2016 un rapport de plus du simple au double, En 2015 et
2016, un certain nombre d'auto-emplois ont été générés, passant de 750 postes à 1087 postes. En
moyenne annuelle sur la période 2013 – 2016, on enregistre 46 723 emplois nets créés pour 48 621
emplois créés et 2 530 emplois perdus. Il y a presque autant d'emplois privés que d'emplois publics.
En moyenne, il y a un emploi perdu pour 19 créés, avec plutôt 22 en 2016 et 43 en 2015, emplois
créés par emploi perdu.
Tableau 48. Evolution des emplois créés de 2013 à 2016
2013 2014 2015 2016 Total Moyenne annuelle
Emploi privé 26 119 24 156 24 896 20 908 96 079 24 020
Emploi public 7 738 8 462 34 071 46 296 96 567 24 142
Auto-emplois générés 750 1 087 1 837 919
Total emplois créés 33 857 32 618 59 717 68 291 194 483 48 621
Pertes d’emplois 3 115 1 386 3 089 7 590 2 530
Total création nette d’emplois 30 742 32 618 58 331 65 202 186 893 46 723
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les points focaux emploi, 2016
Pour la seule année 2016, nous analysons successivement les créations d'emplois par le secteur
privé d'une part et d'autre part par le secteur public. Nous analysons ensuite l'employabilité de la
main-d'œuvre surtout des jeunes à l'aide des statistiques de l'APEJ. Les analyses portent sur des
données recalculées par l'ONEF à partir des informations fournies par ses points focaux auprès de la
DNT et des départements ministériels.
Les 20 908 emplois privés créés se décomposent en 11 882 CDD et 9 026 CDI. La part des femmes
dans ces deux types de contrats est de 18% pour les CDD et 17% les CDI, part statistiquement
identique dans les deux cas. Quel que soit le type de contrat, le plus de création se fait aux
deuxième et premier trimestres de l'année, 64% au total pour les CDI et 68% pour les CDD, les
parts des femmes étant de 86% respectivement 68%. Les secteurs d'activités les plus pourvoyeurs
d'emplois sont les services de soutien et de bureau, 64% des CDD et 53% des CDI. Ces services
sont suivis des finances – assurance et de l'extraction. Ces trois premiers employeurs pèsent pour
83% des CDI et 84% des CDD. Ils représentent 85% pour les femmes et 83% pour les hommes,
indépendamment du type de contrat.
 |
49 49 |
▲back to top |
41
Tableau 49. Répartition du nombre d’emplois créés par le secteur privé
CDD CDI
Homme Femme Total Homme Femme Total
Trimestre 1 27,6 29,6 27,9 8,4 68,7 30,7
Trimestre 2 40,3 39,6 40,2 42,1 17,2 32,9
Trimestre 3 16,8 16,7 16,8 25,1 7,2 18,5
Trimestre 4 15,3 14,1 15,1 24,3 6,9 17,9
Services de soutien et de bureau 63,0 69,9 64,2 51,6 60,0 53,0
Finances et assurances 14,7 13,6 14,5 14,8 19,0 15,5
Extraction 5,6 1,1 4,8 16,4 5,6 14,6
Transport et entreposage 2,4 2,2 2,4 2,8 0,7 2,5
Commerce 2,5 2,1 2,4 1,3 1,1 1,3
Agriculture, sylviculture et pêche 1,8 0,5 1,6 2,1 1,2 1,9
Fabrication 1,2 0,4 1,1 2,3 2,3 2,3
Santé humaine et action sociale 1,0 2,4 1,2 1,6 4,1 2,0
Construction 1,5 0,4 1,3 1,7 0,1 1,4
Autres activités de services N.C.A. 1,3 1,7 1,4 1,1 0,5 1,0
Enseignement 1,2 2,0 1,4 0,8 1,0 0,8
Production et distribution d'eau, assainissement 1,1 1,2 1,1 0,8 1,0 0,8
Administration publique 0,4 0,7 0,4 0,7 1,2 0,8
Activités des organisations extraterritoriales 0,7 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3
ND 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Information et communication 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3
Hébergement et restauration 0,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,2
Science et technique 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5
Production et distribution d'électricité et de gaz 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
Activités spéciales des ménages 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Immobilier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Activités artistiques, sportives et récréatives 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par la Direction nationale du travail (DNT), 2016
Dans le secteur public, deux départements ministériels sont à la base de la création de quatre
emplois sur cinq (80,6%), ce sont le Ministère de l'habitat et de l'urbanisme et celui de l'équipement,
des transports et du désenclavement. Dans le premier cas, l'emploi féminin compte pour 1‰ et dans
le second cas 3%, la part des femmes dans le total étant de 4% du fait qu'il y ait 22% de cas où le
sexe n'est pas spécifié. Si les femmes pourvoient à tous les emplois du département de la promotion
de la femme, de l'enfant et de la famille, les hommes le font autant dans le département de l'élevage
et de la pêche.
Tableau 50. Répartition du nombre d’emplois publics créés par département ministériel
Effectif % % Homme % Femme % ND
Habitat et urbanisme 20 734 44,8 72,4 0,1 27,5
Equipement, transports et désenclavement 17 020 36,8 74,5 2,9 22,7
Sécurité et la protection civile 2 700 5,8 87,9 12,1
Mines 1 192 2,6 98,6 1,4
Emploi, formation professionnelle 1 161 2,5 81,0 1,7 17,3
Travail, fonction Publique et réforme de l’Etat 734 1,6 64,4 35,6
Environnement 578 1,2 81,5 18,5
Promotion femme, enfant et famille 544 1,2 100,0
Elevage et pêche 500 1,1 100,0
Solidarité, action humanitaire et reconstruction du Nord 412 0,9 100,0
Jeunesse et construction citoyenne 193 0,4 74,6 25,4
Administration territoriale 164 0,4 75,0 25,0
Enseignement supérieur 160 0,3 100,0
Décentralisation et de la réforme de l'Etat 115 0,2 87,0 13,0
Energie et eau 81 0,2 56,8 6,2 37,0
Haut conseil des collectivités 8 0,0 87,5 12,5
Total 46 296 100,0 73,5 4,1 22,4
Source : Calcul de l’ONEF à partir des données fournies par les points focaux des départements ministériels
Un certain nombre de statistiques fournies par l'APEJ permettent de mesurer l'employabilité. Ce
sont les inscriptions de jeunes au programme de stage de formation professionnelle, le placement de
jeunes audit programme, les formatons en CREE et GERME, le financement de projets jeunes, les
 |
50 50 |
▲back to top |
42
formations PROCEJ en entreprenariat simplifié. Le dispositif de formation et de qualification
s'opérationnalise à travers plusieurs modules dont la formation en technique HIMO, de maraîchage
et de production de plants, formation en création d'entreprise (CREE et GERME), en gestion
simplifiée PROCEJ, etc. Plus de 11 mille participants ont suivi ce dispositif de formation et de
qualification dont la moitié des femmes. Il y a le plus grand nombre de participants en gestion
simplifiée et stage de formation dans les services publics, 83% des effectifs.
Tableau 51. Dispositif de formation et de qualification 2016
Nombre de participants % Femme
Stage de formation dans les services publics 5 017 50,8
Formation en technique HIMO 347 9,0
Formation en technique de maraîchage et production de plants 100 30,0
Formation en création d’entreprise (CREE) 640 38,0
Formation en gestion d’entreprise (GERME) 360 46,0
Formation en gestion simplifiée et formation/incubation PROCEJ 4 735 60,0
Formation en gestion simplifiée et formation/incubation OIM 500
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
Au programme de stage de formation professionnelle, ce sont plus de 22 mille jeunes dont 54% de
femmes. Plus de trois jeunes sur cinq (65%) se sont inscrits à Bamako, loin devant Koulikoro (10%)
ou encore Sikasso (8%) ses deux poursuivants immédiats. Les femmes semblent partout assez bien
représentées sauf à Kidal (26% des inscrits de la région) et Tombouctou (35%).
Tableau 52. Nombre de jeunes inscrits au programme de stage de formation professionnelle
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 351 48,4 374 51,6 725 3,2
Koulikoro 1 277 55,8 1011 44,2 2 288 10,2
Sikasso 956 52,2 877 47,8 1 833 8,2
Ségou 644 48,0 697 52,0 1 341 6,0
Mopti 572 55,6 456 44,4 1 028 4,6
Tombouctou 200 65,1 107 34,9 307 1,4
Gao 131 37,3 220 62,7 351 1,6
Kidal 20 74,1 7 25,9 27 0,1
District de Bamako 6 168 42,3 8 401 57,7 14 569 64,8
Total 10 319 45,9 12 150 54,1 22 469 100,0
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
Sur les 22 mille jeunes inscrits, 5 mille sont des diplômés, le diplôme allant du CAP au doctorat en
passant par le BT, le BTS et la licence. C'est ce dernier diplôme qui représente 51% des jeunes
inscrits au programme de stage de formation professionnelle avec 42% de femmes. La participation
proportionnelle des femmes au programme diminue avec le diplôme, de 64,5% au BT à seulement
38% au-delà de la licence. En effectif absolu, on enregistre le plus d'inscrits au niveau licence et le
moins au-delà, chez les hommes (51 inscrits) comme chez les femmes (31).
Par région, les diplômés inscrits au programme sont inscrits à 72% à Bamako, 8% à Koulikoro, 4%
à Sikasso et 3% à Kayes, soit 87% des diplômés dans ces 4 régions, ce qui ne laisse que 13% aux 5
autres régions du pays. La part des femmes est nettement en deçà de la parité à Kidal (21%), sinon
partout ailleurs elle s'en approche bien (49% au moins) et est bien au-delà à Sikasso, Kayes et
Ségou (plus de 61%)
 |
51 51 |
▲back to top |
43
Tableau 53. Nombre de jeunes inscrits au programme de stage de formation professionnelle par diplôme et région
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
CAP 235 43,3 308 56,7 543 10,6
BT 473 35,5 858 64,5 1 331 26,0
BTS-DUT-DUTS 259 46,0 304 54,0 563 11,0
Licence/maîtrise 1 499 57,7 1 099 42,3 2598 50,8
DEA/DESS/Doctorat 51 62,2 31 37,8 82 1,6
Kayes 57 38,5 91 61,5 148 2,9
Koulikoro 214 49,7 217 50,3 431 8,4
Sikasso 65 33,5 129 66,5 194 3,8
Ségou 80 38,8 126 61,2 206 4,0
Mopti 136 53,3 119 46,7 255 5,0
Tombouctou 42 50,6 41 49,4 83 1,6
Gao 50 51,0 48 49,0 98 1,9
Kidal 22 78,6 6 21,4 28 0,5
Bamako 1 851 50,4 1 823 49,6 3 674 71,8
Total 2 517 49,2 2 600 50,8 5 117 100,0
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
S'agissant des modules spécifiques de formation comme CREE (Créer votre entreprise), GERME
(Gérer mieux votre entreprise) et autres, 2 558 demandes ont été enregistrées dont 51% en CREE,
24% en GRERME et les 25% restants en autres modules de formation. Trois régions n'enregistrent
aucune demande de telles formations, Kayes, Sikasso et Ségou et d'autres modules hors de CREE et
GERME ne sont demandés qu'à Tombouctou, Gao et Bamako. La région de Tombouctou a un
engouement certain pour tous ces modules, 48% pour le total, loin devant toutes le régions, avec
34% CREE, toujours en tête, et 27% GERME, juste derrière Koulikoro (48%).
Tableau 54. Répartition des demandes de formation enregistrées en CREE, GERME et autres modules
CREE GERME Autres modules Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes
Koulikoro 200 15,4 300 47,8 500 19,5
Sikasso
Ségou
Mopti 80 6,2 40 6,4 120 4,7
Tombouctou 442 34,1 171 27,3 613 96,5 1226 47,9
Gao 113 8,7 65 10,4 10 1,6 188 7,3
Kidal 395 30,5 20 3,2 415 16,2
Bamako 66 5,1 31 4,9 12 1,9 109 4,3
Total 1 296 50,7 627 24,5 635 24,8 2 558 100,0
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
Toujours en 2016, 553 projets ont été financés par l'APEJ dont seulement 57 projets femmes. La
filière piscicole est de loin la plus financée, 511 projets sur les 553 dont 54 projets femmes et pour
l'essentiel ces projets piscicoles financés sont à Ségou (500 projets sur les 511) les 11 restants étant
dispersés à Bamako (3), Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti (2 projets chacune) avec seulement 2
femmes à Bamako et une à Kayes. Le garage moto et le service tracteur viennent en deuxième et
troisième place avec 15 et 14 projets financés. Les 9 projets d'embouche bovine (exclusivement
masculine) sont à Mopti, Sikasso, Bamako et Kayes. On dénombre trois régions pour les 3 projets
d'aviculture, Kayes, Ségou et Bamako. Bamako est la seule région où toutes les filières sont
représentées, y compris la bijouterie qu'elle a en monopole.
 |
52 52 |
▲back to top |
44
Tableau 55. Répartition des projets financés par l’APEJ en 2016 par région, par filière et par sexe
Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Gao Tombouctou Kidal Bamako Total
Embouche
bovine
Homme 1 0 4 0 3 0 0 0 1 9
Femme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 4 0 3 0 0 0 1 9
Aviculture
Homme 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Femme 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Pisciculture
Homme 1 2 2 449 2 0 0 0 1 457
Femme 1 0 0 51 0 0 0 0 2 54
Total 2 2 2 500 2 0 0 0 3 511
Renforcement de
garage moto
Homme 0 0 12 0 1 0 0 0 2 15
Femme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 12 0 1 0 0 0 2 15
Tracteur
Homme 3 2 2 2 2 0 0 0 2 13
Femme 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 3 2 2 2 3 0 0 0 2 14
Bijouterie
Homme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Femme 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total
Homme 6 4 20 452 8 0 0 0 7 496
Femme 1 0 0 51 1 0 0 0 3 57
Total 7 4 20 503 9 0 0 0 10 553
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
Pour la formation PPROCEJ en entreprenariat simplifié, 11 431 candidatures ont été reçues dont 42%
féminines. La répartition régionale semble relativement mieux équilibrée, avec 26% à Bamako, 15% à Kayes
et à Koulikoro 12% à Mopti et le reste dans les autres régions sans exclusive. Ségou qui a près de 10% du
total a 67% de femmes bien au-dessus de la moyenne nationale de 42%.
Tableau 56. Répartition des candidatures reçues pour les formations du PROCEJ (en entreprenariat simplifié)
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 1 041 60,9 669 39,1 1 710 15,0
Koulikoro 949 56,4 735 43,6 1 684 14,7
Sikasso 526 51,4 497 48,6 1 023 8,9
Ségou 358 32,8 732 67,2 1 090 9,5
Mopti 926 65,4 490 34,6 1 416 12,4
Tombouctou 245 60,3 161 39,7 406 3,6
Gao 592 62,2 360 37,8 952 8,3
Kidal 141 69,8 61 30,2 202 1,8
Bamako 1 868 63,4 1 080 36,6 2 948 25,8
Total 6 646 58,1 4 785 41,9 11 431 100,0
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
Sur les candidatures reçues, un certain nombre d'entre elles ont été sélectionnées et formées en
entreprenariat simplifié PROCEJ, soit au total 4 737 sur les 11 431 i.e. un taux de sélection de 41%
avec des taux plus bas à Bamako (23%), Kayes (26%), Koulikoro (27%) et beaucoup plus élevés à
Kidal (plus de 100%) et Tombouctou (100%). La formation s'est faite par cohorte à raison de 38%
la première et 62% la seconde. La première cohorte semble avoir privilégié Gao, Ségou et Bamako
tandis que la seconde avait une bien-meilleure représentativité de toutes les régions, avec 16% à
Ségou et Gao, 14% à Bamako, 11% à Kayes et Mopti et le reste assez équilibré entre les 4 régions
restantes, de 5% à 10%.
 |
53 53 |
▲back to top |
45
Tableau 57. Répartition des jeunes sélectionnés et formés en entreprenariat simplifié PROCEJ
1ère cohorte 2ème cohorte Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 131 7,3 315 10,7 446 9,4
Koulikoro 179 9,9 270 9,2 449 9,5
Sikasso 128 7,1 255 8,7 383 8,1
Ségou 322 17,9 465 15,8 787 16,6
Mopti 145 8,1 330 11,2 475 10,0
Tombouctou 123 6,8 285 9,7 408 8,6
Gao 390 21,7 478 16,3 868 18,3
Kidal 90 5,0 143 4,9 233 4,9
Bamako 292 16,2 396 13,5 688 14,5
Total 1 800 38,0 2 937 62,0 4 737 100,0
Source : APEJ, rapport d’activités 2016
 |
54 54 |
▲back to top |
46
5. Sécurité sociale
Les différents régimes de sécurité sociale sont analysés au regard des statistiques collectées auprès
des trois principaux prestataires que sont la DNPSES (Direction nationale de la protection sociale et
de l'économie solidaire), la CMSS (Caisse malienne de sécurité sociale) et l'INPS (Institut national
de prévoyance sociale).
5.1. Direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire
LA DNPSES centralise les données de sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie
(CANAM), de l'ANAM (Agence nationale de l'assistance maladie) et de l'Union technique de la
mutualité (UTM). Ces données sont relatives aux salariés des deux secteurs, public et privé, aux
parlementaires et aux retraités. Les risques couverts à cet effet sont ceux liés à la santé (maladie,
invalidité et accidents de travail et maladies professionnelles), à la maternité, à la vieillesse et à
l'indigénat.
Les statistiques relatives à l'assurance maladie sont celles produites par la CMSS pour les agents de
l'Etat et par l'INPS pour les autres travailleurs. Il existe pour les indigents une protection sociale
appelée Régime d'assistance médicale (RAMED) qui couvre près de 1% de la population, régime
financé à 85% par l'Etat et à 15% par les communes qui dans bien de cas ne parviennent pas à
s'acquitter de cette cote part. Il y a l'assurance maladie volontaire (AMV) qui couvrirait autres 2%
de la population malienne. Sachant que le salariat formel ne représente pas encore au Mali une
fraction importante de la population, moins de 10%, on peut estimer à plus de 85% la population
non couverte par un quelconque régime de protection sociale.
Sur les prestations sociales de l'INPS, 34,5 millions fcfa étaient en 2016 au compte de l'AMO, sur
une prévision de 80 millions fcfa. Les cotisations étaient de 19,8 millions fcfa pour une prévision de
15.6 millions. Les principales sources de dépenses sont les remboursements aux prestataires
conventionnés (6,7 milliards fcfa), les dotations techniques (8 milliards) et les feuilles de soins
reçues et traitées (1,1 milliards) dont le délai moyen de liquidation et de paiement serait inférieur à
10 jours. L'AMO enregistre 145 493 d'assurés directs dont 63% de travailleurs en activité, 37% de
retraités et une infime partie d'assurés volontaires (341 personnes). L'assurance volontaire de l’INPS
comptait en 2016, 2 652 adhérents.
5.2. Caisse Malienne de Sécurité Sociale
En 2016, le régime d'assurance maladie obligatoire (AMO) de la CMSS au compte des agents de
l'Etat a enregistré 7 613 demandes d'immatriculation dont 30,5% pour le seul district de Bamako
suivi de Ségou pour 16% et de Sikasso, 15%. Comme une anecdote, il y aurait eu une seule
demande d'immatriculation enregistrée à Kidal, région jusqu'alors inaccessible aux autorités
administratives et militaires établies de Bamako.
 |
55 55 |
▲back to top |
47
Graphique 5: Répartition des demandes d'immatriculation à l'AMO
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Bamako
Ségou
Sikasso
Kayes
Mopti
Koulikoro
Gao
Tombouctou
Kidal
2 321
1 248
1 159
771
703
492
490
429
1
Source : CMSS, rapport d’activités 2016
Les effectifs d'assurés de la CMSS s'élèvent à 51 433 pensionnés, aux deux tiers environ civils
(66%) et au tiers restant militaire. Les pensionnés sont majoritairement féminins, du fait sans doute,
que les femmes vivent plus longtemps au Mali que les hommes, indépendamment de l'état de santé.
Ainsi, 57% des pensionnés civils et 54% des pensionnés militaires sont des femmes.
Tableau 58. Répartition des pensionnés de la CMSS par sexe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Civil 14 435 42,7 19 381 57,3 33 816 65,7
Militaire 8 130 46,1 9 487 53,9 17 617 34,3
Total 22 565 43,9 28 868 56,1 51 433 100,0
Source : CMSS, rapport d’activités 2016
Par région, 54% des pensionnés résident à Bamako, avec 57% des civils et 48% des militaires. Au
total, les trois quarts des pensionnés sont dans les trois régions de Bamako, Ségou et Sikasso, soit
78% des civils et 70% des militaires. Kidal représente moins de 1% des pensionnés à raison de 1%
des militaires et 1‰ des civils, soit proportionnellement dix fois plus de militaires que de civils.
Koulikoro aussi a trois fois plus de pensionnés militaires que civils, 15% respectivement 5% des
pensionnés militaires et civils.
A l'intérieur de la région, les régions de Kidal et de Koulikoro ont plus de pensionnés militaires que
civils, 79% contre 21% à Kidal et 59% contre 41% à Koulikoro. Partout ailleurs, il y a plus de civils
que de militaires, beaucoup moins à Kayes (23% contre 77%) et Mopti (28% contre 72%)
Tableau 59. Répartition des pensionnés de la CMSS par région
Civil Militaire Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 2 424 76,8 734 23,2 3 158 6,1
Koulikoro 1 789 41,1 2 566 58,9 4 355 8,5
Sikasso 3 427 65,5 1 806 34,5 5 233 10,2
Ségou 3 652 63,9 2 064 36,1 5 716 11,1
Mopti 1 712 71,6 680 28,4 2 392 4,7
Tombouctou 654 56,9 496 43,1 1 150 2,2
Gao 760 53,0 675 47,0 1 435 2,8
Kidal 45 20,8 171 79,2 216 0,4
Bamako 19 361 69,7 8 417 30,3 27 778 54,0
Total 33 824 65,8 17 609 34,2 51 433 100,0
Source : CMSS, rapport d’activités 2016
 |
56 56 |
▲back to top |
48
5.3. Institut national de prévoyance sociale
Au chapitre des statistiques de l'INPS, l'on s'intéressera successivement aux cotisations, aux
prestations, aux prestations des structures socio-sanitaires, aux conventions internationales de
sécurité sociale signées par le Mali, aux activités de l'assurance volontaire et aux activités de
l'AMO.
5.3.1. Les cotisations
Les cotisations versées à l'INPS, en 2016, se sont élevées à la somme de 129 milliards fcfa, pour un
effectif total de 279 165 travailleurs assurés au régime général, soit une cotisation annuelle
moyenne de 462 292 fcfa ou encore 38 524 fcfa par mois et par travailleur assuré au régime général.
Comparativement à 2015, ces cotisations ont augmenté de 11,5%, avec 7,4% pour le régime général
INPS, 39,1% pour l'AMO et 12,3% pour l'ANPE. Sur les deux années, la part de l'ANPE n'a pas
changé, 4% des recettes totales, par contre l'AMO a gagné 3 points de pourcentage de part, passant
de 12% à 15%, les mêmes 3 points ayant été perdus par le régime général qui est passé de 83% à
80%. De la même manière les taux de réalisation par rapport aux prévisions restent plus importants
pour l'AMO que pour les deux autres régimes, 126% contre 102% à l'INPS et 108% à l'ANPE.
Tableau 60. Recettes de cotisation par nature (en millions fcfa)
2015 2016
Réalisation Prévision Réalisation Taux de réalisation Croissance annuelle
INPS 96 668 102 082 103 814 102% 7,4%
AMO 14 216 15 638 19 777 126% 39,1%
ANPE 4 867 5 073 5 464 108% 12,3%
Total 115 751 122 793 129 056 105% 11,5%
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Le rapport annuel de l'INPS indique que plus de 3 milliards de fcfa (3 201 460 034) d'arriérés de
cotisations ont été recouvrés sur les gros débiteurs dont l'Etat et certaines entreprises publiques et
parapubliques. De même, l'institut a généré par des placements et dépôts à terme des produits
financiers de plus de 3 milliards et obtenu autres 2 milliards fcfa de recettes de production de
prestation de ses structures socio-sanitaires et autres frais de gestion.
5.3.2. Les prestations
L'analyse porte sur l'état des demandes de prestations, la répartition des bénéficiaires desdites
prestations. Ensuite l'analyse porte sur les montants des prestations et leur structure en termes de
pensions, d'allocations familiales, d'assurance volontaire et d'accidents de travail et de maladies
professionnelles. En 2016, l'INPS a reçu 45 276 demandes de prestations contre 38 059 une année
auparavant, soit un accroissement de 19%, accroissement qui aura été de 10,6% en moyenne
annuelle sur la période 2014-2016. Les plus fortes augmentations en 2016 comparativement à 2015
auront été induites par l'assurance volontaire (104,8%), le régime général (878%) et l'AMO
(54,1%). Sur la période 2014-2016, les accroissements sont relativement plus modestes sauf pour
l'assurance volontaire qui aura littéralement explosé de 2014 à 2016.
,
 |
57 57 |
▲back to top |
49
Tableau 61. Situation des demandes de prestations des trois dernières années
2014 2015 2016 Croissance annuelle
moyenne
Nouveaux employeurs immatriculés 900 1 094 2 055 51,1%
Nouveaux assurés immatriculés au régime
général
18 294
20 152
20 570 6,0%
Nouveaux assurés volontaires immatriculés 103 581 1 190 239,9%
Nouveaux assurés AMO immatriculés 11 364 8 891 13 698 9,8%
Nouveaux bénéficiaires d'allocations
familiales
5 931
6 990
7 365 11,4%
Nouvelles victimes d’ATMP 391 351 398 0,9%
Total 36 983 38 059 45 276 10,6%
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Les prestations fournies ont bénéficié à 452 913 personnes dont 45% de femmes. Les ayants droits
représentent 73% des bénéficiaires contre 27% pour les assurés principaux. Les enfants constituent
les deux tiers des bénéficiaires de prestations sociales de l'INPS (67%) à raison de 52% de filles et
48% de garçons. Les ayants droits conjoints font 6% des bénéficiaires avec une nette prédominance
des veuves, 95% contre seulement 5% de veufs. Dans les rangs des assurés eux-mêmes, on constate
une nette dominance masculine, 85% contre seulement 15% de femmes.
Tableau 62. Répartition du nombre des bénéficiaires par catégorie
Hommes Femmes Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Assurés principaux 102 707 84,9 18 275 15,1 120 982 26,7
Ayants droits conjoints 1 277 4,8 25 454 95,2 26 731 5,9
Ayants droits enfants 146 353 48,0 158 847 52,0 305 200 67,4
Total 250 337 55,3 202 576 44,7 452 913 100,0
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Aux 452 913 bénéficiaires de prestations, a été versée la somme de 65.3 milliards fcfa, soit 144 159
fcfa par bénéficiaire, montant largement inférieur aux 462 292 fcfa perçus sur chaque cotisant, dans
un rapport de 3,2 contre 1,6 de rapport entre bénéficiaires et cotisants (452 913 contre 279 165). On
comprend mieux que l'INPS puisse encore rester longtemps en équilibre budgétaire voire en
excédent. Il faut surveiller le taux d'accroissement des cotisants et des bénéficiaires pour maintenir
leur rapport dans des limites compatibles avec le rapport cotisations sur prestations.
Les prestations sociales sont principalement faites sous forme de payement de pension, 81% des
prestations, pourcentage en légère baisse par rapport à 2015 (83%) au profit des allocations
familiales (2 points de pourcentage de plus entre 2015 et 2016) et de l'assurance volontaire dont la
part, certes marginale, a été multipliée par dix. L'augmentation de la part des allocations familiales
serait induite par l'augmentation des taux d'allocations obtenus par les syndicats en 2015, taux passé
de 1500 à 3500 fcfa par enfant bénéficiaire.
Tableau 63. Répartition du nombre des bénéficiaires par branche et montant des prestations
2015 2016 Croissance
annuelle Montants % Montants %
Allocations familiales 8 267 503 557 14,9 11 159 637 763 17,1 35,0
Pensions 46 077 193 652 83,1 52 851 611 138 80,9 14,7
Accidents du travail et maladies professionnelles 1 069 351 510 1,9 1 242 492 297 1,9 16,2
Assurance volontaire 7 708 500 0,01 37 568 841 0,1 387,4
Total 55 421 757 219 100,0 65 291 310 039 100,0 17,8
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Les près de 53 milliards fcfa de pension ont bénéficié à 59 931 pensionnaires dont 54% de femmes.
Les principales formes de pension sont la pension de réversion (46% des pensionnaires), la pension
normale (34%) et l'anticipation volontaire (19%), les autres formes (pour un total d'à peine 1%) sont
l'allocation de solidarité, la pension d'invalidité et le remboursement de cotisations. Les trois
principales formes absorbent 95% des montants alloués contre 5% pour 1% de formes restantes.
 |
58 58 |
▲back to top |
50
Bien que représentant 34% des pensionnaires, la pension normale absorbe 54,5% des montants
engagés. Cette pension bénéficie davantage aux hommes qu'aux femmes (82% contre 18%). Les
femmes sont proportionnellement plus nombreuses dans les remboursements de cotisations (95% de
ces bénéficiaires), remboursement qui absorbe 3% des dépenses pour à peine 2‰ des bénéficiaires,
soit un montant unitaire relativement élevé.
Tableau 64. Répartition des bénéficiaires de pensions par type de pension et par sexe
Hommes Femmes Total Montants
Effectif % Effectif % Effectif % fcfa %
Allocation de solidarité 389 93,5 27 6,5 416 0,7 181 021 210 0,3
Remboursement de
cotisations
7 4,9 135 95,1 142 0,2 1 752 894 452 3,3
Anticipation volontaire 8 830 78,5 2 415 21,5 11 245 18,8 13 240 496 477 25,1
Pension d'invalidité 221 76,5 68 23,5 289 0,5 591 953 646 1,1
Pension de réversion 1 529 5,6 25 897 94,4 27 426 45,8 8 263 790 477 15,6
Pension normale 16 784 82,2 3 629 17,8 20 413 34,1 28 821 454 876 54,5
Total 27 760 46,3 32 171 53,7 59 931 100,0 52 851 611 138 100,0
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Les allocations familiales de 2016 sont allées à 84 128 allocataires dont 18% de femmes. Les
allocataires sont majoritairement à Bamako (64%), Kayes et Sikasso (10% chacune). C'est à
Koulikoro que la part des femmes est la plus importante (58% contre une moyenne nationale de
18% avec 7,5% à Kayes et 11% à Sikasso). Les enfants bénéficiaires des prestations familiales sont
au nombre de 304 361 âmes dont 52% de filles contre 48% de garçons. Près des deux tiers de ces
enfants (65%) sont à Bamako, le tiers restant dispersé entre les 8 régions sans qu'aucune ne dépasse
les 7%. Partout les filles bénéficiaires sont majoritaires sauf à Bamako (49%) avec Kayes en pointe
(69%). Le nombre moyen d'enfants par allocataire est de 3,6 ; allant de 2,6 à Sikasso à 16,5 à
Koulikoro.
Tableau 65. Répartition des bénéficiaires d'allocations familiales et du nombre d’enfants par région
Allocataires Enfants Enfants par
allocataire Total dont % Homme % Femme Total dont % Garçons % Filles
Kayes 8 126 92,5 7,5 22 114 30,7 69,3 2,7
Koulikoro 1 007 42,2 57,8 16 622 48,9 51,1 16,5
Sikasso 8 188 88,9 11,1 21 116 44,8 55,2 2,6
Ségou 6 765 87,0 13,0 21 744 41,3 58,7 3,2
Mopti 2 998 84,7 15,3 12 156 49,6 50,4 4,1
Tombouctou 1 412 86,8 13,2 5 605 40,8 59,2 4,0
Gao 1 762 84,2 15,8 8 448 46,7 53,3 4,8
Kidal 59 88,1 11,9 192 41,1 58,9 3,3
Bamako 53 811 78,8 21,2 196 364 51,1 48,9 3,6
Total 84 128 81,8 18,2 304 361 48,0 52,0 3,6
Source : INPS, rapport d’activités 2016
5.3.3. Les prestations des structures socio-sanitaires
L'INPS dispose de 4 centres médicaux interentreprises (CMIE), 2 centres de protection maternelle
et infantile (PMI) et un centre dentaire infantile (CDI). Ce dispositif prend en charge des accidents
de travail et maladies professionnelles, des activités médicales curatives (consultation, analyses
biomédicales, examens d'imagerie médicale, etc.) et des activités de la convention spécifique avec
la CANAM. En 2016, il a été enregistré 397 accidents du travail dont 188 survenus sur le lieu du
travail, 202 survenus sur les trajets et 7 ayant occasionné le décès de la victime.
Les 397 accidents de travail ont occasionné 1809 prestations de services divers dont les
remboursements de frais médicaux, les contrôles médicaux des accidentés de travail. Ces
prestations sont en diminution de 17,6% par rapport à 2015, tous les services ayant diminué sauf les
 |
59 59 |
▲back to top |
51
avis sur évacuations des accidentés de travail qui ont progressé au contraire de 30%. Les
remboursements de frais médicaux des rentiers de France semblent le service le plus utilisé, 720 cas
en 2016 sur les 1 809 cas au total, ils connaissent néanmoins une baisse de 18% par rapport à 2015.
Tableau 66. Analyse des prestations en faveur des accidentés de travail
2015 2016 Taux de variation (%)
Remboursements frais médicaux des accidents de travail 333 300 -9,9
Remboursements frais médicaux des rentiers de France 877 720 -17,9
Avis sur les évacuations des accidentés de travail 20 26 30,0
Contrôles médicaux des accidentés de travail pour rentes 427 382 -10,5
Visites médicales de mise en invalidité 65 59 -9,2
Avis sur les taux d’incapacité permanente partielle 473 322 -31,9
Total 2 195 1 809 -17,6
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Les montants des services offerts aux accidentés de travail et aux malades professionnels s'élèvent
en 2016 à 1 242 millions fcfa dont près des deux tiers (66%) sous forme de rentes aux assurés.
Graphique 6: Répartition des montants de prestations accidents de travail et maladies professionnelles (en millions fcfa)
0 200 400 600 800
Rentes aux assurés
Rachats de rentes
Produits pharmaceutiques
Indemnisation des journées d'incapacité
Frais médicaux
Rentes aux conjoints
Journée africaine de prévention
Frais de transport
Rentes aux ascendants
Incapacité temporaire
Rentes aux orphelins
Autres charges techniques
Revalorisation
Incapacité permanente
Analyse, expertise et soins médicaux
819.0
140.9
77.1
58.7
54.0
53.1
14.2
10.5
8.9
4.0
0.9
0.7
0.5
0.1
0.0
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Les activités de préventions ont consisté en des visites médicales, d'embauche, d'entreprise et visites
périodiques. Seules les visites d'entreprise ont marqué une progression en nombre par rapport à
2016, les deux autres types de visites ayant plutôt diminué, de 17% pour les visites d'embauche et
de 27% pour celles périodiques. Aussi ces deux dernières visites ont été réalisées en deçà des
prévisions, 91% respectivement 83% de taux de réalisation.
Tableau 67. Activités de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles
2015 2016
Réalisation Prévision Réalisation Taux de réalisation Croissance annuelle
Visites médicales d’embauche 6 523 6 000 5 435 91% -16,7%
Visites médicales périodiques 19 328 17 000 14 111 83% -27,0%
Visites médicales d’entreprise 143 160 173 108% 21,0%
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Au titre des activités médicales curatives, l'INPS a réalisé en 2016plus de 97 mille consultations
médicales, près de 33 mille consultations médico-sociales, plus de 27 mille analyses biomédicales
 |
60 60 |
▲back to top |
52
et plus de 3 mille examens d'imagerie médicale. Tous ces chiffres sont en deçà des prévisions faites,
ils marquent même un recul par rapport en 2015 s'agissant des consultations médicales curatives et
des examens d'imagerie médicale.
Tableau 68. Activités médicales
2015 2016
Réalisation Prévision Réalisation Taux de réalisation Croissance annuelle
Consultations médicales curatives 114437 100 000 87 123 87% -23,9%
Consultations médico-sociales 30 738 40 000 32 787 82% 6,7%
Analyses biomédicales 26 529 30 000 27 294 91% 2,9%
Examen d’imagerie médicale 4 908 5 000 3 250 65% -33,8%
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Dans le cadre de la convention entre l'INPS et la CANAM, des prestations médicales sont réalisées
à des assurés AMO pour 59 606 feuilles de soins. Ces prestations coûtent près de 88 millions fcfa
dont 70% en part AMO (quelle que soit la prestation) et en ticket modérateur (30%). Les seules
consultations médicales représentent 92.5% des feuilles de soins pour 65% des montants alloués.
Les analyses biomédicales, pour 5% des feuilles de soins n'en absorbent pas moins 26% des
dépenses.
Tableau 69. Prestations en faveur des assurés AMO selon la convention INPS/CANAM
Feuilles de soins Montant
Nombre % fcfa %
Consultations médicales 55 128 92,5 57 402 000 65,3
Médicaments 609 1,0 3 935 451 4,5
Analyses biomédicales 3 233 5,4 22 909 670 26,0
Examens d'imagerie médicale 636 1,1 3 708 300 4,2
Total 59 606 100,0 87 955 421 100,0
Source : INPS, rapport d’activités 2016
Le rapport INPS indique que les ressources générées par les structures socio sanitaires dans le cadre
des prestations médico-sociales s’élevaient, en 2016, à 107.5 millions fcfa contre 105.9 en 2015. Le
jardin d’enfants de Bamako encaissait 1.86 millions fcfa de frais d’inscription pour un total de 97
inscrits.
5.3.4. Les conventions internationales de sécurité sociale
Ce régime de sécurité sociale comprend les prestations extérieures payées au Mali et celles de
l'INPS payées à l'extérieur. Les premières sont des paiements faits à des travailleurs maliens de
l'extérieur. Elles se font soit sous forme de pensions soit sous forme d'allocations familiales. En
2016, ces pensions s'élevaient à plus de 9 milliards fcfa pour 6788 pensionnaires répartis entre la
France (72%), la Côte d'Ivoire (26%), le Burkina et le Sénégal les 2% restants. Les 72% des
pensionnaires de France absorbent 94% des montants alloués. Ce pays enregistre également 2621
cas d'allocations familiales pour un montant total de 163 millions fcfa, soit 62305 fcfa par
allocataire familial.
 |
61 61 |
▲back to top |
53
Tableau 70. Situation des prestations payées aux travailleurs maliens de l’extérieur
Pensions Allocations familiales
Effectifs % Montants % Effectifs Montants
France 4 884 72,0 8 728 650 746 94,3 2 621 163 301 760
Côte d’ivoire 1 783 26,3 507 379 435 5,5 0 0
Burkina 119 1,8 16117518 0,2 0 0
Sénégal 2 0,03 1 926 802 0,02 0 0
Total 6 788 100,0 9 254 074 501 100,0 2 621 163 301 760
Source : INPS, rapport d’activités 2016
L'INPS ajoute, dans son rapport, qu'il a également été dépensé 32 millions fcfa en remboursement
de soins à 353 familles de travailleurs maliens de France. Les prestations payées à l'extérieur du
Mali vont à des bénéficiaires résidant hors du Mali qui sont 144 pensionnaires et 5 rentiers. Les
pensions ont coûté 239 millions en 2016 et les rentes 1.6 millions. Ces pensionnaires maliens
résident pour 75% en France, 17% au Burkina Faso, 4% au Sénégal, le reste au Togo au Bénin et au
Niger. Les montants vont pour 95% en France, pays qui reçoit 53% des 1.6 millions de rente contre
43% au Sénégal.
Tableau 71. Situation des pensions et rentes maliennes payées à l’extérieur
Pensions Rentes
Effectif % Montants % Effectif Montant
France 108 75,0 226 786 006 94,9 3 837 943
Burkina Faso 25 17,4 5 187 102 2,2
Sénégal 6 4,2 2 710 460 1,1 2 749 608
Togo 3 2,1 2 296 864 1,0
Bénin 1 0,7 2 015 044 0,8
Niger 1 0,7 98 928 0,04
Total 144 100,0 239 094 404 100,0 5 1 587 551
Source : INPS, rapport d’activités 2016
 |
62 62 |
▲back to top |
54
6. Dialogue social
En matière de dialogue social, quelques activités clés, relevant pour l'essentiel de la Direction
nationale du travail (DNT) et de ses démembrements dont les directions régionales du travail
(DRT), sont ici analysées. Ce sont la gestion des confits collectifs, le contrôle de légalité des
contrats de travail, le règlement des litiges individuels, le traitement des accidents de travail et des
maladies professionnelles ainsi que la gestion des licenciements de travailleurs.
6.1. Gestion des conflits collectifs
Au cours de l'année 2016, les autorités en charge de la question du travail ont intervenu dans le
règlement d'un certain nombre de conflits collectifs opposant employeurs et employés à travers
leurs représentations patronales et syndicales respectives. Sur 7 conflits collectifs réglés, 4 ont
concerné les mines et industries opposant les sociétés minières et la Section nationale des mines et
de l'industrie (SECNAMI), en mai, juin, juillet et octobre. Les trois autres conflits ont été portés par
le Syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique (SYNTEC), celui des
contrôleurs de visite technique (SYNCTEV), tous deux en février 2016, et la section syndicale de la
confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) des aéroports du Mali, en juillet de la
même année. Le rapport annuel de la DNT souligne que certains de ces conflits ont fait l’objet de
règlement amiable et d'autres, faute d’accord, ont fini par des grèves auquel cas les dossiers sont
transmis au Conseil d’arbitrage comme celui de la SECNAMI dont le dossier serait toujours en
instance devant ledit conseil.
Les sept conflits collectifs sont tirés des 43 conflits enregistrés au cours de l'année en tant qu'autant
de préavis de grèves. Ces conflits ont concerné les secteurs de l'industrie, du commerce, de
l'hôtellerie et de la restauration, des services à la collectivité ou services sociaux et personnels ainsi
que les BTP. Ils ont été enregistrés à Bamako (20 des 43 cas), Kayes (10), Sikasso et Gao (4
chacune), Ségou (3), Koulikoro et Tombouctou (1 cas chacune).
Tableau 72. Répartition des conflits collectifs par caractéristique sociodémographique
Branche d’activité Cercle
Nombre
de
conflits
Temps
perdu
Qualification professionnelle
Cadres
supérieurs
Cadres
moyens
Ouvriers Manœuvres Total
Kayes Total 10 48h 0 26 0 0 26
BTP Bafoulabé 1 00h
Commerce & hôtel Kayes 4 48h 26 0 0 26
Industrie Kéniéba 4 00h 0 0 0 0 0
Commerce & hôtel Kéniéba 1 00h
Koulikoro Services à la collectivité Koulikoro 1 72h 23 23
Sikasso Total 4 144h 488
Industrie Kadiolo 2 72h 488
Industrie Sikasso 1 Néant 0 0 0 0 0
Services à la collectivité Sikasso 1 Néant 0 0 0 0 0
Ségou Total 3 00h
Industrie Ségou 1 00h
Tous les conflits collectifs ont été réglés en conciliation Services à la collectivité Baraouéli 1 00h
Services à la collectivité Macina 1 00h
Tombouctou Services à la collectivité Tout cercle 1 72h
Gao Services à la collectivité Gao 4 0 Tous les conflits collectifs ont été réglés en conciliation
Bamako Total 20
Services à la collectivité Bamako 13
Industrie Bamako 7
Total 43 23 26 537
Source : DNT, rapport d’activités 2016
Dans la région de Kayes, les conflits ont touché trois des sept cercles que sont Bafoulabé, Kayes et
Kéniéba, ce dernier cercle étant la zone d'exploitation aurifère par excellence de la région. Trois des
 |
63 63 |
▲back to top |
55
sept cercles de Ségou ont été également touchés, à savoir Ségou, Baraouéli et Macina. A Sikasso, ce
sont les cercles de Sikasso et Kadiolo, soit deux des sept cercles de cette région. Les statistiques
montrent en outre une relative dominance des cadres, supérieurs et moyens, comparativement aux
autres catégories socioprofessionnelles tels que les manœuvres et ouvriers.
6.2. Contrôle de légalité des contrats de travail
En 2016, les DRT ont visé 354 618 contrats de travail dont 21 349 CDD (soit 60% du total) et
14 269 CDI (40%). Ces contrats sont pour trois quarts réservés aux hommes et pour un quart aux
femmes. Pour ce qui est des CDI, la part des femmes monte à 36% et celle des hommes diminue à
64%. L'inverse se produit pour ce qui est des CDD où les femmes ne comptent que pour 17% contre
83% aux hommes. Bamako enregistre la majorité des contrats, 58% loin devant Kayes qui vient en
deuxième position 14%, ces deux seules régions totalisent 72% des contrats de travail, c'est dire que
les 7 autres régions se partagent les 28% restants dont 7% pour Sikasso suivie de Ségou, 5%. Mopti,
Tombouctou et Gao enregistrent chacune 4%, Koulikoro et Kidal se partagent les 4% restants. Dans
le total des contrats, la part des femmes est la plus élevée à Bamako (33%) et la plus faible à Kidal
(7%) et Kayes (9%).
Dans toutes les régions, la part des contrats à durée déterminée est supérieure à celle des contrats à
durée indéterminée. Il n'y a que Koulikoro qui se rapproche de la parité 50,3% contre 49,7%. Dans
l'ensemble, la part des femmes dans les CDI est supérieure à leur part dans les CDD sauf à
Koulikoro, Sikasso, Gao et Kidal.
Tableau 73. Visa de contrats de travail (en %)
Total dont Contrats à durée déterminée Contrats à durée indéterminée
Total dont Hommes Femmes Total dont Hommes Femmes Total dont Hommes Femmes
Kayes 13,7 91,3 8,7 78,8 94,0 6,0 21,2 81,5 18,5
Koulikoro 3,4 83,0 17,0 50,3 80,4 19,6 49,7 85,7 14,3
Sikasso 7,1 88,7 11,3 63,6 88,0 12,0 36,4 90,0 10,0
Ségou 5,2 84,7 15,3 62,0 89,5 10,5 38,0 76,9 23,1
Mopti 4,1 79,7 20,3 75,3 80,1 19,9 24,7 78,5 21,5
Tombouctou 4,0 83,4 16,6 82,9 85,6 14,4 17,1 72,3 27,7
Gao 3,8 80,9 19,1 68,3 78,5 21,5 31,7 86,0 14,0
Kidal 0,2 93,2 6,8 79,5 91,4 8,6 20,5 100,0 0,0
Bamako 58,4 66,9 33,1 52,2 77,5 22,5 47,8 55,4 44,6
Total 100,0 75,1 24,9 59,9 82,7 17,3 40,1 63,8 36,2
Source : DNT, rapport d’activités 2016
La même année, il a été délivré 1 125 contrats de travail à des expatriés dont 40% sont des
ressortissants des Etats de la CEDEAO sur plus de 57% que représente toute l'Afrique dans cette
communauté de travailleurs immigrés du Mali. Les africains plus les asiatiques constituent les trois
quarts de la main-d'œuvre expatriée du Mali en 2016. Sur le quart restant, les européens
représentent près de 11%. Les femmes représentent 17% de l'emploi expatrié. Par continent, les
femmes constituent 13% des travailleurs expatriés d'origine africaine contre 45,5% des européens et
près de 28% des asiatiques contre seulement 1% des américains ou des australiens.
 |
64 64 |
▲back to top |
56
Tableau 74. Visa des contrats des travailleurs expatriés
Hommes Femmes Total
Effectif % Effectif % Effectif %
CEDEAO 394 88,1 53 11,9 447 39,7
Autres pays d’Afrique 170 85,4 29 14,6 199 17,7
Asie, Proche et Moyen-Orient 143 72,2 55 27,8 198 17,6
Europe 66 54,5 55 45,5 121 10,8
Amérique 68 98,6 1 1,4 69 6,1
Australie 72 98,6 1 1,4 73 6,5
Autres pays d'Océanie 17 94,4 1 5,6 18 1,6
Total : 930 82,7 195 17,3 1 125 100,0
Source : DNT, rapport d’activités 2016
6.3. Règlement des litiges individuels
Selon le rapport 2016 de la DNT, 1 289 litiges individuels ont été enregistrés en 2016 contre près du
triple en 2015, 3 194 exactement (Annexe 3). Sur l'ensemble des litiges de l'année 2016, 844 ont été
réglés en conciliation, 402 transmis au tribunal du travail et 43 classés sans suite ou en instance de
règlement. Les litiges individuels sont majoritairement enregistrés à Bamako (49%), Koulikoro
(12%) et Tombouctou (10%), Mopti et Gao enregistrent le moins de cas de litiges individuels, 2%
respectivement 2,7%. Selon le mode de règlement, 66% environ des litiges individuels sont réglés
en conciliation, beaucoup plus à Tombouctou et Gao (plus de 94% des cas dans chacune de ces
deux régions) et beaucoup moins à Sikasso (43,5%), région où 57% des litiges individuels
atterrissent sur la table du tribunal du travail. Des litiges classés sans suite s'observent uniquement à
Ségou (30% des litiges de la région), Kayes (près de 14%) et Koulikoro (3%).
Tableau 75. Litiges individuels selon le règlement et par région (en %)
Nombre de
litiges soumis
Nombres de litiges
réglés en conciliation
Nombres de litiges
transmis au tribunal
Litiges classés sans
suite ou en instance
Kayes 9,5 62,6 23,6 13,8
Koulikoro 11,8 90,8 5,9 3,3
Sikasso 9,0 43,1 56,9
Ségou 5,4 43,5 26,1 30,4
Mopti 2,0 76,9 23,1
Tombouctou 10,4 94,8 5,2
Gao 2,7 94,3 5,7
Bamako 49,2 58,2 41,8
Total 100,0 65,5 31,2 3,3
Source : DNT, rapport d’activités 2016
6.4. Accidents de travail et maladies professionnelles
En 2016, il a été recensé au niveau des DRT, 330 cas (contre 407 en 2015, soit une réduction de
19%) dont 279 cas ont fait l'objet d'enquêtes réglementaires (soit 84,5%) et 228 cas d'incapacités
(69% des accidents déclarés). Les incapacités vont du non arrêt de travail à l'incapacité partielle
(31% pour chacune de ces deux formes d'incapacités) aux divers types d'incapacité temporaire (IT),
de plus d'un mois (16%), de 5 jours à un mois (9%) et de moins de 5 jours (1%). Il faut ajouter que
deux cas mortels ont été enregistrés, tous à Bamako comme du reste tous les cas d'incapacité
partielle.
Plus de la moitié des accidents de travail (52%) se produit à Bamako et plus du quart (26%) à
Ségou, deux régions totalisant 78% des cas d'accidents de travail. C'est davantage dans l'industrie
manufacturière que dans toute branche d’activités que les accidents de travail se produisent,
nonobstant le fait que les cas d'accidents de Bamako n'ont pas été désagrégés par branche
d'activités.
 |
65 65 |
▲back to top |
57
Tableau 76. Accident de travail et maladies professionnelles par branche d’activités
Branche
d’activité
Nombre
de cas
déclarés
Enquêtes Cas mortels
Incapacités
IT
de 1 à 4 j
P/t 10 % de
5 j à 1 mois
P/ t 11 % de
plus d’un mois
IP 100
%
sans arrêt
de travail
Kayes
Total 31 31 9 10 12
Services 10 10 3 2 5
Transport 3 3 2 1
Extraction 6 6 3 3
Industrie 10 10 2 2 6
Agriculture 1 1 1
BTP 1 1 1
Koulikoro
Total 15 15 7 8
Industrie 8 8 4 4
Electricité 1 1 0 1
Services 5 5 2 3
BTP 1 1 1
Sikasso 13 13 5 2 1 5
Ségou
Total 86 48 4 9 35
Industrie 79 35 1 4
Finances 2 2 2
Services 5 11 3 3
Mopti 5 5
Tombouctou 4 4
Gao 3 3 1 2
Bamako 173 160 2 14 5 9 71 20
Total 330 279 2 20 28 37 71 72
Source : DNT, rapport d’activités 2016
6.5. Licenciements des travailleurs par branche d’activités et par motif des
licenciements
Au total, 3 124 demandes d'avis ou d'autorisation de licenciements ont été traitées par les directions
régionales du travail. Aucune demande d’avis n'a été rejetée ou encore aucun licenciement n'a été
refusé aux demandeurs. Six motifs de licenciement ont été retenus dont deux constituent les
principaux arguments en faveur, près des trois quarts des motifs (74%), ce sont les fins d'activités
(40%) et les motifs économiques (34%). Ensuite viennent à égalité les fautes professionnelles et la
démission ou l'abandon de poste (11% chacun). Les fautes lourdes ou le vol (3%) ainsi que les
maladies (1%) constituent des motifs marginaux.
Plus de quatre licenciements sur cinq (84%) ont lieu à Kayes (30%), Sikasso (29%) et Bamako
(25%). A Kayes, ce sont surtout les entreprises extractives qui licencient tandis qu'à Sikasso c'est
dans les exploitations agricoles (87% des licenciements de chaque région pour ces deux branches
respectives d’activités économiques). Le licenciement dans les entreprises manufacturières est plus
fréquent (dans 89% des cas) à Koulikoro, région qui totalise seulement 5% des licenciements du
pays en 2016. Tombouctou a le même poids que Koulikoro dans le licenciement total avec ici 83%
de la part des entreprises manufacturières aussi.
 |
66 66 |
▲back to top |
58
Tableau 77. Licenciement des travailleurs par branche d’activités et motif
Branches
d’activités
Motif
Compression/
Fin activité
Fautes
professionnelles
Abandon /
Démission
Motif
économique
Décès et
maladies
Fautes
lourdes
Licenciement
refusé
Total
Kayes
Total 42 53 73 731 14 26 939
Agriculture 1 1
Extraction 15 35 42 697 9 18 816
BTP 3 6 9 23 41
Commerce 5 4 4 1 1 15
Finances 2 1 5 4 12
Services 17 7 12 10 5 3 54
Koulikoro
Total 40 74 34 3 151
Industrie 40 60 34 1 135
Services 10 1 11
Autres NCA 4 1 5
Sikasso
Total 867 3 31 18 919
Agriculture 792 2 2 - 796
Extraction 61 10 2 73
BTP 7 7
Transport 11 7 18
Finances 2 1 8 11
Services 5 8 1 14
Ségou
Total 33 5 53 18 109
Industrie 18 4 9 31
Commerce 3 10 1 14
Finances 7 3 10
Services 5 1 43 4 53
Mopti Finances 7 52 7 66
Tombouctou
Total 126 5 15 146
Industrie 112 2 7 121
Services 14 3 8 25
Gao Services 12 4 2 6 24
Kidal 3 3
Bamako 168 177 217 189 7 9 767
Total 1 255 356 334 1 077 21 81 3 124
Source : DNT, rapport d’activités 2016
 |
67 67 |
▲back to top |
59
7. Migration internationale de retour
La migration internationale des maliens est analysée dans ce rapport sous trois angles que sont les
pays de séjour des migrants, l'insertion socioprofessionnelle des migrants de retour et enfin la
répartition d’emplois de cette population particulière.
7.1. Pays de séjour des migrants de retour
L'EMOP 2016 a dénombré 553 151 migrants de retour au Mali dont 21% de femmes. L'écrasante
majorité provenait de la Côte d'Ivoire voisine, 62% du total composés de 78% d'hommes et 22% de
femmes. Aucun autre des 36 pays répertoriés n'atteint à lui seul les 6%, moins du dixième de la
Côte d'Ivoire. Le retour massif de migrants maliens de ce pays a fait suite à la grave crise identitaire
et politique que ce pays a connue au début des années 2000 jusqu'en 2010. Le deuxième plus
important pays de retour des migrants est le Burkina sans doute suite au retour au pays des réfugiés
maliens dans ce pays suite à la crise sociopolitique que le Mali a connue en 2012 avec la rébellion,
des mouvements jihadistes, du coup d'Etat de mars 2012 et de banditisme à tout crin. Ces deux
premiers pays totalisent 67% soit deux migrants sur trois. Par ordre décroissant, il faut compter 9
pays avant d'arriver à un pays non africain et ces 9 Etats africains comptent pour 84% des migrants
de retour. La France est le dixième pays en importance numérique comptant pour moins de 2% des
migrants de retour. Dix pays comptent pour moins de 1000 migrants de retour chacun, totalisant
moins de 1% (0,9%) de l'effectif global. Ce sont 4 pays africains (Guinée équatoriale, Soudan,
Maroc et Erythrée), 4 européens (Russie, Belgique, Allemagne et Italie) auxquels s'ajoutent
l'Afghanistan et les USA.
Les femmes migrantes de retour proviennent de 16 pays nominatifs et du reste de l'Afrique et de
l'Europe. La Côte d'Ivoire seule représente 65% du total féminin, avec le Burkina ce total monte à
70%. Le Gabon et le Congo Brazzaville en ajoutent 8 autres points de pourcentage, soit 78% des
migrantes de retour pour seulement 4 pays, tous africains. La Mauritanie et le Niger en ajoutent 5
autres points pour porter le total à 83% pour 6 pays. Ces deux derniers Etats y figurent à la faveur
sans doute des réfugiées maliennes dans ces pays. Tous les pays pris nominalement de retour des
migrantes sont africains à la seule exception de la Chine qui compte pour 0,7%.
A la différence des femmes, les hommes proviennent de tous les pays nominatifs à la seule
exception de l'Erythrée qui n'enregistre que des migrantes de retour. La Côte d'Ivoire et le Burkina
absorbent les deux tiers des hommes émigrés de retour au pays. Après les 8 premiers Etats africains
en termes de nombre, la France occupe la 9ème place avec 2% de retours des migrants pour porter le
total à 83% pour les 9 premiers pays de provenance.
 |
68 68 |
▲back to top |
60
Tableau 78. Répartition des migrants de retour par pays
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif % %cumulé
Côte d'Ivoire 268 124 78,1 75 154 21,9 343 278 62,1 62,1
Burkina Faso 22 036 78,2 6 159 21,8 28 195 5,1 67,2
Sénégal 18 936 90,0 2 099 10,0 21 035 3,8 71,0
Mauritanie 11 690 78,4 3 217 21,6 14 907 2,7 73,7
Guinée 10 228 80,0 2 557 20,0 12 785 2,3 76,0
Algérie 11 904 100,0 0 0,0 11 904 2,2 78,1
Niger 8 374 73,3 3 056 26,7 11 430 2,1 80,2
Libye 10 452 96,8 350 3,2 10 802 2,0 82,1
Gabon 4 105 44,5 5 113 55,5 9 218 1,7 83,8
France 8 795 100,0 0 0,0 8 795 1,6 85,4
Congo Brazzaville 3 127 42,8 4 185 57,2 7 312 1,3 86,7
Nigeria 3 970 83,6 779 16,4 4 749 0,9 87,6
Ghana 3 176 76,7 964 23,3 4 140 0,7 88,3
Gambie 3 696 100,0 0 0,0 3 696 0,7 89,0
Cameroun 1 835 58,1 1 321 41,9 3 156 0,6 89,6
Angola 2 553 100,0 0 0,0 2 553 0,5 90,0
Chine 1 397 63,6 798 36,4 2 195 0,4 90,4
Arabie saoudite 2 096 100,0 0 0,0 2 096 0,4 90,8
Congo-Kinshasa (RDC) 916 48,0 992 52,0 1 908 0,3 91,1
Libéria 1 684 100,0 0 0,0 1 684 0,3 91,4
Togo 1 452 100,0 0 0,0 1 452 0,3 91,7
Espagne 1 214 100,0 0 0,0 1 214 0,2 91,9
Sierra Leone 1 178 100,0 0 0,0 1 178 0,2 92,1
Japon 564 50,0 564 50,0 1 128 0,2 92,3
Guinée-Bissau 1 085 100,0 0 0,0 1 085 0,2 92,5
Bénin 1 043 100,0 0 0,0 1 043 0,2 92,7
Guinée équatoriale 970 100,0 0 0,0 970 0,2 92,9
Soudan 898 100,0 0 0,0 898 0,2 93,1
Allemagne 865 100,0 0 0,0 865 0,2 93,2
Maroc 642 100,0 0 0,0 642 0,1 93,3
Afghanistan 406 100,0 0 0,0 406 0,1 93,4
Etats-Unis 308 100,0 0 0,0 308 0,1 93,5
Italie 242 100,0 0 0,0 242 0,0 93,5
Erythrée 0 0,0 116 100,0 116 0,0 93,5
Russie 107 100,0 0 0,0 107 0,0 93,6
Belgique 32 100,0 0 0,0 32 0,0 93,6
Reste Afrique 23 607 74,4 8 110 25,6 31 717 5,7 99,3
Reste Europe 3 112 79,6 798 20,4 3 910 0,7 100,0
Total 436 819 79,0 116 332 21,0 553 151 100,0
Source. ONEF, à partir des données EMOP 2016
7.2. Insertion socioprofessionnelle des migrants de retour en emploi
Le taux d'insertion socioprofessionnelle des migrants de retour en emploi est relativement élevé,
78.5% pour l'ensemble, avec 82% pour les hommes et 65% pour les femmes, soit 17 points de
pourcentage d'écart, c'est dire combien les femmes s'intègrent plus difficilement que les hommes sur
le marché du travail. Cela est vrai quel que soit le milieu, la classe d'âge ou le niveau d'éducation.
Par contre par région, la situation est assez contrastée. D'abord Ségou et Mopti ont des taux
d'insertion beaucoup plus élevés que partout ailleurs et dans ces deux régions, le taux des femmes
est de 100% contre 98% pour les hommes à Ségou et 89.5% pour les hommes toujours à Mopti. A
Tombouctou les taux d'insertion socioprofessionnelle sont particulièrement bas, 35% pour les deux
sexes avec 42% pour les femmes et moitié moins pour les hommes, 21%. Le taux d'insertion est
également faible à Gao, 47% avec seulement 33% pour les femmes et 55% pour les hommes. A
Bamako, le taux est faible aussi mais pas autant qu'à Gao, 55%.
Il faut noter que le taux d'insertion augmente avec l'âge jusqu'à 40 ans, au-delà il baisse pour être
très faible à partir de 65 ans. Après cet âge de la retraite, le taux est le plus bas chez les 15-24 ans,
l'âge du premier emploi. Par niveau d'éducation du migrant de retour l'insertion réussit mieux aux
 |
69 69 |
▲back to top |
61
analphabètes qu'aux lettrés, 80% contre 67% pour le niveau secondaire. Chez les lettrés, le
supérieur facilite plus que le secondaire l'insertion socioprofessionnelle sauf pour les femmes pour
qui le niveau secondaire a plus de chance que le supérieur et le fondamental, ce dernier niveau étant
le plus difficile pour les femmes.
Tableau 79. Taux d'insertion socioprofessionnelle des migrants de retour en emploi (en %)
Homme Femme Total
Zone de résidence
Urbain 74,3 58,1 68,6
Bamako 57,4 51,9 55,0
Autre urbain 84,5 65,5 79,0
Rural 84,0 69,5 81,4
Région
Kayes 86,5 71,7 83,8
Koulikoro 79,4 37,2 73,2
Sikasso 82,7 71,8 80,1
Ségou 98,1 100,0 98,3
Mopti 89,5 100,0 90,0
Tombouctou 20,7 41,7 35,0
Gao 54,6 32,8 47,0
Bamako 57,4 51,9 55,0
Classe d'âge
15 - 24 ans 68,7 43,9 55,7
25 - 35 ans 92,9 66,5 84,2
36 - 40 ans 96,4 82,2 92,5
41 - 64 ans 91,1 74,4 88,5
Plus de 64 ans 42,0 21,5 40,6
Niveau d'éducation
Aucun 81,3 73,1 79,7
Fondamental 86,4 46,9 75,5
Secondaire 70,8 54,5 66,7
Supérieur 80,1 52,0 74,8
Total 82,2 65,2 78,5
Source. ONEF, à partir des données EMOP 2016
L'insertion des 409 268 migrants de retour sur le marché du travail se fait dans toutes les branches
d'activités mais principalement dans l'agriculture (76%), le commerce et les activités de fabrication,
soit au total 89% des effectifs de migrants insérés. Ces trois branches sont celles de prédilection des
hommes, 90% des hommes insérés. Les femmes par contre substituent aux activités de fabrication
celles artistiques et récréatives pour 89% des femmes insérées en emploi au Mali.
Quand on regarde par zone de résidence, l'insertion à Bamako se fait principalement par le
commerce, les activités de fabrication et les services autres que le commerce, le transport, etc. Dans
cette ville, les femmes sont à 77% dans le commerce, les sciences et techniques puis dans les
activités de fabrication. En réalité, ici les hommes sont beaucoup plus dispersés entre branches
d'activités que les femmes qui sont concentrées dans 10 branches avec plus de 4 femmes sur 5 dans
les 4 premières branches, commerce, sciences et techniques, fabrication et services aux ménages.
Bamako représente seulement 7% des migrants de retour insérés sur le marché du travail, 5% des
hommes et 16% des femmes. Le reste urbain représente 13% avec 17% pour les femmes et 12%
pour les hommes. C'est dire que le gros des migrants de retour exerce en milieu rural d'où la
prédominance de l'agriculture comme branche d’activités principale. En milieu rural 91% des
hommes exercent dans l'agriculture contre 79% des femmes. En y ajoutant le commerce, les deux
branches absorbent 94% des hommes et 92% des femmes c'est dire que le commerce en rajoute
beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes.
 |
70 70 |
▲back to top |
62
Tableau 80. Répartition de la population de migrants de retour en emploi selon les branches d'activités
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Agriculture 2,5 0,0 1,4 38,3 22,8 34,6 91,1 79,1 89,3 80,2 56,5 75,9
Extraction 2,4 0,0 1,4 1,8 1,9 1,8 0,8 0,0 0,7 1,0 0,3 0,9
Activités de fabrication 13,7 7,5 11,1 7,7 0,9 6,1 2,8 0,7 2,5 3,9 1,8 3,6
Construction 6,8 0,0 4,0 8,5 3,1 7,2 0,5 0,0 0,4 1,8 0,5 1,6
Commerce 23,0 58,1 37,6 21,2 60,3 30,5 2,2 13,3 3,9 5,6 28,7 9,8
Transports et entreposage 5,5 0,0 3,2 7,7 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0
Hébergement et restauration 2,8 0,0 1,6 0,3 3,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,3
Information et communication 5,4 2,2 4,1 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3
Finances et assurance 2,1 0,0 1,2 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Sciences et techniques 6,9 11,1 8,6 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 0,7
Services de soutien et de bureau 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Administration publique 6,8 0,0 4,0 3,6 2,5 3,3 0,2 0,5 0,2 0,9 0,8 0,9
Enseignement 6,2 3,2 5,0 2,3 2,1 2,2 0,7 0,0 0,6 1,1 0,9 1,1
Santé et action sociale 2,7 4,4 3,4 0,7 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,4
Art et activités récréatives 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,1 5,6 0,9 0,1 3,7 0,8
Autres services NCA 12,5 6,1 9,8 4,8 2,0 4,1 1,6 0,0 1,4 2,6 1,3 2,3
Services aux ménages 0,0 7,4 3,1 1,4 0,0 1,0 0,0 0,8 0,1 0,2 1,7 0,4
Total 16 864 12 027 28 890 41 061 12 844 53 905 277 268 49 205 326
473
335 192 74 076 409
268
Source. ONEF, à partir des données EMOP 2016
 |
71 71 |
▲back to top |
63
Conclusion et recommandations
Il nous a paru utile de rappeler, pour faciliter la lecture et la compréhension du présent Rapport,
certains concepts et indicateurs relatifs au marché du travail surtout depuis la 19ème Conférence des
statisticiens du travail, tenue du 2 au 13 octobre 2013 à Genève. Ensuite il a fallu présenter, ne
serait-ce que très brièvement le contexte général du marché du travail en 2016. Ainsi, au plan
économique on retient que le Mali a une économie à deux moteurs que sont les secteurs primaire et
tertiaire, moteurs devant quasiment fonctionner simultanément pour maintenir la croissance, à
moins que le secteur secondaire ne vienne en rescousse dès qu'un des deux moteurs tombe en
panne. En moyenne annuelle, la contribution à la création de richesse des deux secteurs est de 37%
respectivement 36%. Le secteur secondaire contribue à environ 18% en moyenne, essentiellement
grâce au secteur aurifère.
Au cours des 5 dernières années, le solde des transactions courantes est resté déficitaire avec une
détérioration continue de la situation, le déficit étant passé de 139 milliards en 2012 à 464 en 2016.
Au plan social et particulièrement en matière d'éducation, parallèlement à la baisse du taux
d’achèvement s'observe le faible taux de transition vers l’enseignement secondaire, 39% en 2016
avec 8 points de pourcentage d'écart entre les garçons et les filles. Concernant l’enseignement
technique et professionnel, le taux de scolarisation est à la hausse d’une façon générale, 31% en
2015 contre 7% en 2013, surtout en faveur des filles. La situation sanitaire est marquée par l'état
préoccupant de la malnutrition des enfants qui mériteraient davantage l’attention des autorités afin
de garantir aux enfants maliens la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au plan démographique, la
pyramide des âges est assez symétrique de type "poire écrasée", typologie associée au fait que les
jeunes générations soient majoritaires mais aussi à une masse salariale peu élevée et des
opportunités d'emploi peu abondantes.
Le monde de l'enseignement et de la formation professionnelle déverse des milliers d'admis sur le
marché du travail. Ce sont, en 2016, 7 mille admis au CAP, plus de 5 mille au BT1 et plus de 4
mille au BT2, 149 diplômés du CERFITEX. Les 5 universités du pays (quatre à Bamako et une à
Ségou), réparties en 11 facultés et 5 instituts universitaires totalisaient un effectif cumulé de plus de
42 mille étudiants dont 29% de filles auxquelles il faut ajouter les plus de 900 personnes formées à
l'extérieur dont 89% d'étudiants et 11% de stagiaires. Au-delà du défi du financement de la
formation professionnelle comme d'ailleurs universitaire et secondaire, il y a celui de
l'employabilité des jeunes formés surtout leur insertion socioprofessionnelle. Il est dommage que les
HIMO occupent si peu de place dans le financement des actions alors qu'elles touchent les jeunes
ruraux, donc plus de pauvres pour des activités de très grande utilité sociale.
L'analyse des principaux indicateurs du marché du travail fait ressortir un taux d’activités de 62%,
taux plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain, très faible à Gao (33% avec 16% chez les
femmes) et Koulikoro (40% et 19% chez les femmes). L'emploi est à dominance informel, soit un
taux de 96% de l'emploi total avec 98% pour les femmes Ce taux diminue significativement avec le
niveau d'éducation, de 96.5% pour le primaire à 37% pour le supérieur en passant par 47% pour le
secondaire. Ainsi, l'éducation est un de ces remparts contre l'emploi informel surtout chez les
femmes. Le chômage touche, en 2016, 9.7% de la main-d'œuvre, taux plus élevé en milieu urbain
qu'en milieu rural, plus élevé aussi pour les femmes que pour les hommes, également plus élevé
dans les rangs des diplômés. Le taux de sous-emploi de la main-d'œuvre est de 12%, à raison de 5%
pour les hommes et de 21% pour les femmes. Il est plus important en milieu urbain (16%) surtout à
Bamako (18%), avec 27% respectivement 33% pour les femmes, plus élevé chez les actifs ayant le
niveau secondaire d'éducation (17%) et chez les hommes de niveau supérieur. Du côté de
l'inactivité, la scolarité en est le principal motif chez les hommes, en raison de la plus forte et plus
longue scolarisation des garçons comparativement aux filles. Ainsi donc la scolarisation reste au
Mali un phénomène urbain et masculin.
 |
72 72 |
▲back to top |
64
En matière d'intermédiation, on enregistre plus de 14 mille demandes d'emploi en 2016 dont 25,5%
de demandes féminines, 75% les chômeurs et 25% les occupés, 86% les 20-39 ans. Face à ces 14
mille demandes d'emploi, se présentent 6.5 mille offres d'emploi, 87% offrent de nouveaux postes
contre 13% de remplacement de postes existants, majoritairement pour une durée d'un an au plus
(62%). Les placements sont bien en deçà de l'offre, 4.5 mille personnes dont 18% de femmes, dont
près du tiers est constitué de manœuvres et assimilés (32,5%), suivis des cadres moyens et des
ouvriers, pour 45% les deux qualifications. Par métier, ce sont les BTP et l'industrie qui se
distancent des autres avec 19% et 18% respectivement.
Sur la période 2013 – 2016, il a été créé moins de 200 mille emplois compte tenu des pertes
d'emplois (un emploi perdu pour 19 créés en moyenne). Pour absorber le chômage, il faut bien plus
et veiller à réduire les pertes d'emplois, d'où le défi d'un secteur privé moderne qui crée aujourd'hui
moins d'emplois que le secteur public et celui d'inverser la dominance actuelle des CDD qui peut
conduire à la précarité de l'emploi. Au programme de stage de formation professionnelle, ce sont
plus de 22 mille jeunes dont 54% de femmes. Plus de trois jeunes sur cinq (65%) se sont inscrits à
Bamako, loin devant Koulikoro (10%) ou encore Sikasso (8%) ses deux poursuivants immédiats.
Les femmes semblent partout assez bien représentées sauf à Kidal (26% des inscrits de la région) et
Tombouctou (35%). En 2016, 553 projets ont été financés par l'APEJ dont seulement 57 projets
femmes. La filière piscicole est de loin la plus financée, 511 projets sur les 553 dont 54 projets
femmes et pour l'essentiel ces projets piscicoles financés sont à Ségou (500 projets sur les 511) les
11 restants étant dispersés à Bamako (3), Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti (2 projets chacune
avec seulement 2 femmes à Bamako et une à Kayes.
La sécurité sociale offerte aux travailleurs porte sur 51 mille agents civils et militaires du secteur
public et 129 mille cotisants du secteur privé inscrits à l'NPS. Sachant que le salariat formel ne
représente pas encore au Mali une fraction importante de la main-d'œuvre, moins de 10%, on peut
estimer à plus de 85% la population non couverte par un quelconque régime de protection sociale.
Sur le marché du travail, les conflits collectifs touchent particulièrement les secteurs de l'industrie,
du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que les BTP. De même, plus de mille litiges
individuels ont été enregistrés en 2016, majoritairement à Bamako (49%), Koulikoro (12%) et
Tombouctou (10%), Mopti et Gao enregistrant le moins de cas. Les deux tiers de ces litiges
individuels sont réglés en conciliation, beaucoup plus à Tombouctou et Gao (plus de 94% des cas
dans chacune de ces deux régions) et beaucoup moins à Sikasso (43,5%), région où 57% des litiges
individuels atterrissent sur la table du tribunal du travail. Parallèlement, plus de 3 mille demandes
d'avis ou d'autorisation de licenciements ont été enregistrées, aucune demande d’avis n'aura été
rejetée ou encore aucun licenciement n'aura été refusé aux demandeurs. Les demandes émanent
surtout des régions de Kayes (30%), Sikasso (29%) et Bamako (25%).
Enfin, le Rapport fait le point de l'insertion dans le marché du travail des migrants de retour au
Mali, en provenance majoritairement de Côte d'Ivoire (62% du total). Leur insertion
socioprofessionnelle en emploi est relativement élevée, 78.5% pour l'ensemble, avec 82% pour les
hommes et 65% pour les femmes, surtout dans l'agriculture (76%), le commerce et les activités de
fabrication, soit au total 89% des effectifs de migrants insérés. Ces trois branches sont celles de
prédilection des hommes, 90% des hommes insérés, et montrent qu'il n'y a probablement pas
beaucoup de transfert de technologie, vu le caractère traditionnel de ces secteurs.
 |
73 73 |
▲back to top |
65
Annexe
Annexe 1. Evolution de la balance des paiements de 2012 à 2016 (en milliards fcfa)
2012 2013 2014 2015 2016*
1 -COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES -139,205 -185,1 -334,1 -412,5 -463,9
1.1. BIENS 57,0 -122,8 -251,3 -281,3 -304,9
1.1.1. Marchandises générales -1 008,6 -1 087,3 -1 169,0 -1 285,4 -1 451,8
1.1.2. Exportations nettes de biens dans le cadre du négoce intern. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3. Or non monétaire 1 065,6 964,5 917,7 1 004,1 1 146,9
1.2. SERVICES -367,2 -854,1 -850,1 -923,6 -992,4
1.2.1. Transports -342,1 -362,0 -344,9 -384,7 -403,1
- dont fret -305,8 -319,7 -299,7 -342,7 -369,2
1.2.2. Voyages 20,3 30,0 33,6 21,3 14,3
1.2.3. Autres services -45,4 -522,2 -538,7 -560,3 -604,0
1.3. REVENU PRIMAIRE -234,8 -213,7 -190,0 -174,8 -226,5
1.3.1. Rémunération des salariés -1,5 1,1 2,6 1,3 2,0
1.3.2. Revenu des investissements -235,1 -213,4 -197,4 -173,5 -225,8
dont intérêts/dette publique -17,9 -18,4 -17,2 -23,7 -26,1
1.3.3. Autre revenu primaire 1,8 -1,4 4,8 -2,7 -2,7
1.4. REVENU SECONDAIRE 405,8 1 005,5 957,2 967,3 1 059,9
1.4.1. Administrations publiques 29,0 625,4 569,8 542,9 611,8
dont aide budgétaire 3,8 110,8 70,2 46,4 35,7
1.4.2. Autres secteurs 376,8 380,2 387,4 424,4 448,2
1.4.2.1 Transferts personnels 367,4 374,7 379,6 403,1 423,2
1.4.2.2 Autres transferts courants 9,4 5,5 7,8 21,4 24,9
2 - COMPTE DE CAPITAL 53,4 129,3 114,1 202,5 154,3
2.1. Actifs non financiers non produits -1,8 -0,8 -2,0 -3,9 0,0
2.2. Transferts de capital 55,1 130,1 116,1 206,4 154,3
2.2.1. Administration publique 15,7 105,3 96,7 178,7 129,1
- Remises de dette 6,6 25,5 14,9 59,9 17,7
- Autres transferts 9,2 79,8 81,8 118,8 111,4
2.2.2. Autres secteurs 39,4 24,8 19,4 27,7 25,2
Capacité (+) / besoin (-) de financement -85,8 -55,8 -220,1 -210,0 -309,7
3 - COMPTE FINANCIER -97,4 -137,9 -106,3 -161,9 -129,4
3.1. Investissements directs -195,0 -150,7 -70,9 -114,2 -120,2
3.1.1. Titres de participation -88,1 -45,4 -59,4 -5,6 -55,0
3.1.2. Instruments de dette -106,9 -105,3 -11,5 -108,6 -65,2
3.2. Investissements de portefeuille -5,2 -0,5 -88,9 -63,7 -68,8
3.2.1. Administrations publiques -7,5 -1,5 -90,4 -59,2 -70,0
3.2.2. Autres secteurs 2,3 1,0 1,5 -4,5 1,2
3.3. Dérivé financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. Autres Investissements 102,8 13,3 53,5 15,9 59,7
3.4.1. Administrations publiques -5,0 -77,8 -55,6 -127,7 -121,5
tirages budgétaires 0,0 -39,6 -16,4 -64,7 -10,7
tirages projets -22,9 -96,1 -103,1 -160,5 -169,2
amortissement -39,5 42,9 52,0 97,5 58,4
Variation des arriérés -21,6 15,0 11,9 0,0 0,0
3.4.2. Autres secteurs 107,8 91,1 109,1 143,6 181,2
4. FINANCEMENT EXCEPTIONNEL (PM) -15,0 40,5 26,8 59,9 17,7
4.1. Allégement de dette PPTE 6,6 25,5 14,9 59,9 17,7
4.2. Variation des arriérés -21,6 15,0 11,9 0,0 0,0
4.3. Financement à rechercher 0,0
5- ERREURS ET OMISSIONS NETTES -10,5 -18,0 -19,3 -38,5
6- SOLDE GLOBAL 1,1 64,1 -133,0 -86,6 -180,2
7- AVOIRS ET ENGAGEMENTS EXTERIEURS -1,1 -64,1 133,0 86,6
7.1 Banque Centrale 43,8 60,6 153,5 102,0
7.2 Autres institutions de dépôts -44,9 -124,7 -20,5 -15,5
* estimations de janvier 2017
Source : Service des études et de la statistique, BCEAO
 |
74 74 |
▲back to top |
66
Annexe 2. Evolution du TOFE de 2012 à 2016
RECETTES ET DONS 925,8 1 137,2 1 215,2 1 481,0 1 562,4
Recettes totales 912,8 951,2 1 057,6 1 273,3 1 395,3
Recettes budgétaires 813,3 842,7 940,8 1 134,1 1 290,3
Recettes fiscales 758,6 804,5 890,6 1 082,3 1 230,7
impôts directs 263,2 258,1 324,1 330,8 390,2
impôts indirects 495,4 546,4 566,5 751,5 840,6
TVA 286,5 325,7 335,0 411,3 445,4
TVA intérieur 115,0 122,1 136,4 166,1 175,4
TVA sur importation 171,5 203,6 198,6 245,2 270,1
Taxes intérieures sur produits pétroliers 25,3 22,3 27,8 93,1 97,9
Taxes sur les importations (DD et taxes) 100,5 111,8 115,5 141,8 155,1
Autres droits et taxes 140,6 146,9 149,9 189,3 213,6
Remboursement exonérations - 10,0 -1,5 -6,0 -3,4 -6,0
Remboursement crédit TVA - 47,5 -58,8 -55,7 -80,6 -65,4
Recettes non fiscales (Budget) 54,7 38,2 50,2 51,8 59,6
Recettes fds. spécial.et budget annuel 99,5 108,5 116,8 139,2 105,0
Dons 13,0 186,0 157,6 207,7 167,1
Projets 8,6 56,6 61,6 98,1 92,0
Budgétaires 3,8 110,8 70,2 88,9 55,7
Appui budgétaire sectoriel 0,6 9,3 25,8 20,7 19,4
Annulation dette monétaire France 42,5 0,0
fonds de concours - 9,3 0,0 0,0 0,0
Dépenses Totales, Prêts Nets (base engmt.) 995,3 1 292,4 1 419,9 1 622,3 1 919,6
Dépenses budgétaires 890,6 1 190,1 1 308,5 1 488,0 1 818,7
Dépenses courantes 720,2 800,5 848,1 922,0 1 045,9
Personnel 291,1 290,8 313,5 358,2 411,1
Fonctionnaires Etat 217,6 218,0 229,2 253,4 291,7
Fonctionnaires Collectivités 73,5 72,8 84,2 104,8 119,4
Biens et Services 208,3 239,6 240,5 260,9 295,1
Matériel 78,3 82,7 96,0 94,4 113,3
dont PPTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Communication - énergie 28,8 27,8 29,7 32,4 34,9
Déplacements et transports 29,5 30,2 37,5 42,1 54,2
Elections 3,3 38,8 9,5 17,0 9,2
Autres dépenses sur biens et services 68,4 60,1 67,9 75,0 83,5
Transferts et subventions 187,9 237,7 252,4 257,0 283,7
Bourses 14,6 15,1 14,4 13,5 17,8
Filet social 10,0 8,5 10,1 9,5 10,5
Subventions eau - électricité 26,0 57,5 42,0 30,0 25,0
Intrants agricoles 28,4 28,2 34,5 37,5 38,6
Subventions CRM (Caisse de Sécurité) 15,8 16,3 21,8 20,8 37,5
Plans sociaux (PASEP) 1,0 0,2 1,0 0,6 2,0
Dépenses PAGE
Autres transferts et subventions 92,1 111,9 128,5 145,1 152,3
dont PPTE 3,3
Intérêts dus 32,9 32,4 41,7 45,9 56,1
Dette intérieure 15,0 14,0 22,8 22,9 30,0
FMI 0,0 0,0 0,0 0,0
BCEAO (avance stat. et BDM) 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres intérieurs 0,0
Dette extérieure 17,9 18,4 18,9 23,0 26,1
dont: réduction dû à l'IADM
Dépenses en capital 170,4 389,6 460,4 566,0 772,8
Financement extérieur 32,0 161,0 190,5 281,1 280,5
Emprunts 32,0 95,1 103,1 160,5 169,1
Dons 0,0 56,6 61,6 98,1 92,0
Appui budgétaire sectoriel 0,0 9,3 25,8 22,5 19,4
Dont EDM_SA 15,0 12,0
Financement domestique (Equip - invest) 138,4 228,6 269,9 284,9 492,3
Financement intérieur BSI 125,1 129,8 232,5
Equipement investissement 129,9 155,1 259,8
SOTELMA 14,8 0,0
Dépenses fonds spéciaux et budgets annexes 99,5 108,5 116,8 139,2 105,0
Prêts Nets -2,8 -6,2 -5,4 -4,9 -4,1
Pour mémoire: Total PPTE 76,8 72,8 84,2 104,8 119,4
Déficit (base ordonnancement)
Avant moratoire de paiement
Dons exclus -82,5 -341,2 -362,3 -349,0 -524,3
 |
75 75 |
▲back to top |
67
Dons inclus -69,5 -155,2 -204,7 -141,3 -357,2
Après moratoire de paiement
Dons exclus -82,5 -341,2 -362,3 -349,0 -524,3
Dons inclus -69,5 -155,2 -204,7 -141,3 -357,2
Variation des arriérés 0,0 6,0 -50,4 -37,2 -15,2
Arriérés intérieurs 0,0 0,0 -50,4 -37,2 -15,2
Réduction -30,4 0,0 -16,6
Accumulation 0,0 0,0 16,4
Arriérés extrabudgétaires -20,0 -37,2 -15,0
Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Réduction 0,0 0,0 0,0
Accumulation 0,0 0,0
Avals et cautions -9,2 -9,2 -6,2
Ajustement base caisse 0,0 -8,1 85,0 -69,8 19,3
Mandats non payés (Trésor) 78,6 -68,1
Période complémentaire 0,0 -8,1 6,4 -1,7 19,3
Année N-1 -8,1 -54,8 -139,8 -70,0
Année N 61,2 138,1 89,3
Déficit (base Caisse)
Dons exclus -82,5 -343,3 -336,9 -465,2 -526,4
Dons inclus -69,5 -157,3 -170,1 -248,3 -359,3
Solde budgétaire de base -46,7 -69,4 -101,6 21,0 -188,1
Solde budgétaire de base hors PPTE -34,3 -43,8 -86,7 38,4 -170,4
 |
76 76 |
▲back to top |
68
Annexe 3. Ventilation des litiges individuels par région
Nature des litiges
Nombre de
litiges soumis
Litiges réglés
en conciliation
Litiges
transmis au
tribunal
Litiges classés
sans suite ou en
instance
Kayes
Salaires et accessoires 17 08 05 04
Préavis 15 09 02 04
Heures supplémentaires 05 04 01 00
Indemnités de licenciements 40 22 10 08
Congés payés 14 10 02 02
Maladies 01 00 01 00
Divers 31 22 06 03
Total 123 75 27 21
Koulikoro
Salaires et accessoires 13 13 00 00
Préavis 05 05 00 00
Bulletins de paie 05 00 00 05
Indemnités de licenciement 119 110 09 00
Certificats de Travail 10 10 00 00
Total 152 138 09 05
Sikasso
Salaires et accessoires 136 17 119 00
Préavis 29 19 10 00
Heures supplémentaires 11 06 05 00
Congés payés 30 19 11 00
Indemnité de préavis 01 01 00 00
Indemnités de licenciement 36 21 15 00
Divers 35 14 21 00
Total 278 97 181 00
Ségou
Salaires et accessoires de salaire 31 10 15 06
Préavis 24 08 04 12
Heures supplémentaires 08 08 00 00
Indemnité spéciale 08 05 02 01
Congés payés 32 15 05 12
Indemnité de licenciement 21 05 04 12
Certificat de Travail 24 08 04 12
Prime d’ancienneté 11 11 00 00
Indemnité pour inobservation de la
forme
03 02 01 00
Divers 40 21 14 05
Total 202 93 49 60
Mopti
Indemnité de licenciement 26 20 06 00
Total 26 20 06 00
Tombouctou
Salaires et accessoires de salaire 10 09 01 00
Préavis 12 12 00 00
Heures supplémentaires 12 12 00 00
Bulletins de paie 23 23 00 00
Indemnité de licenciement 18 17 01 00
Congés payés 11 11 00 00
Indemnité de précarité 12 08 04 00
Indemnité spéciale 21 21 00 00
Divers certificat de travail/INPS 15 14 01 00
Total 134 127 07 00
Gao
Salaires et accessoires 35 33 02 00
Préavis 35 33 02 00
Indemnité de licenciement 24 22 02 00
Bulletin de paie 15 15 00 00
Congés payés 35 33 02 00
Maladie 01 00 01 00
Dommages et intérêts 02 00 02 00
Certificat de Travail 35 33 02 00
Indemnité de précarité 11 11 00 00
Indemnité spéciale 09 09 00 00
Total 202 189 13 00
Kidal -
Bamako Salaires et accessoires 330 150 180 00
 |
77 77 |
▲back to top |
69
Nature des litiges
Nombre de
litiges soumis
Litiges réglés
en conciliation
Litiges
transmis au
tribunal
Litiges classés
sans suite ou en
instance
Préavis 390 230 160 00
Heures supplémentaires 193 115 78 00
Repos hebdomadaire 03 01 02 00
Congés payés 450 295 155 00
Indemnités de licenciement 340 195 145 00
Certificats de travail 300 170 130 00
Cotisations INPS 40 20 20 00
Dommages-intérêts 140 16 124 00
Indemnité de services rendus 03 01 02 00
Indemnités spéciale pour mot. éco 105 61 44 00
Départ négocié 08 08 00 00
Divers 75 60 15 00
Total 2 377 1 322 1 055 00
Total 3 494 2 061 1 347 86
Source : Direction Nationale du Travail (DNT), 2015
Copyright @ 2024 | ONEF .