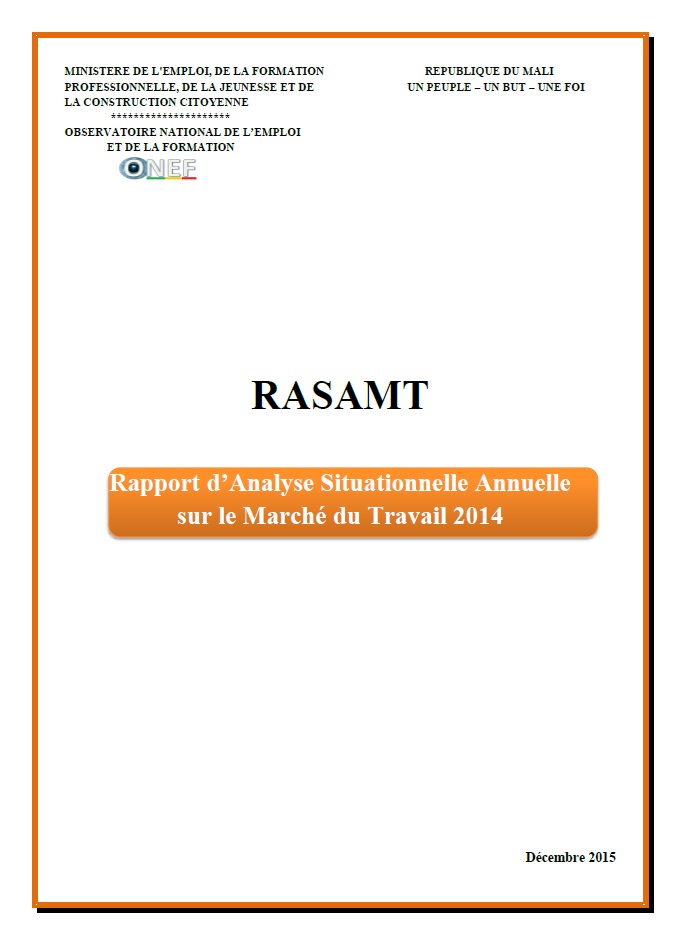MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN...
 |
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI
PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
LA CONSTRUCTION CITOYENNE
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
RASAMT
Rapport d’Analyse Situationnelle Annuelle
sur le Marché du Travail 2014
Décembre 2015
 |
2 2 |
▲back to top |
i
Table des matières
Liste des tableaux ................................................................................................................................................. iii
Liste des graphiques ............................................................................................................................................. iv
Sigles et abréviations ..............................................................................................................................................v
Résumé .................................................................................................................................................................. vi
Introduction ............................................................................................................................................................1
1. Environnement socio-économique et démographique ....................................................................................3
1.1. Caractéristiques socio-économiques et démographiques .........................................................................3
1.1.1. Caractéristiques socio-économiques .................................................................................................3
1.1.2. Caractéristiques démographiques .....................................................................................................4
1.2. Enseignements et formation professionnelle ............................................................................................7
1.2.1. L’enseignement technique et professionnel ......................................................................................7
1.2.2. L’enseignement supérieur .................................................................................................................8
1.2.3. La formation professionnelle ......................................................................................................... 10
2. Principales sources de données sur l’Emploi au Mali ...........................................................................13
2.1. Sources administratives ......................................................................................................................... 13
2.1.1. L'Agence Nationale Pour l'Emploi ................................................................................................ 13
2.1.2. L'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ......................................................................... 13
2.1.3. La Caisse Malienne de Sécurité Sociale ........................................................................................ 13
2.2. Enquêtes statistiques .............................................................................................................................. 14
2.2.1. Enquête auprès des ménages ......................................................................................................... 14
2.2.2. Autres enquêtes statistiques ........................................................................................................... 14
3. Marché du travail au Mali en 2014 .........................................................................................................15
3.1. La situation de l’Emploi et du Chômage ............................................................................................... 15
3.1.1. Population active et taux d'activité ................................................................................................ 15
3.1.2. Taux d'emploi informel ................................................................................................................. 17
3.1.3. L’emploi selon le secteur institutionnel ......................................................................................... 17
3.2. Le chômage ........................................................................................................................................... 18
3.3. L’intermédiation .................................................................................................................................... 20
3.3.1. Demandes d’emploi ....................................................................................................................... 20
3.3.2. Offres d’emploi.............................................................................................................................. 24
3.3.3. Placements ..................................................................................................................................... 26
3.4. Les créations d’emploi........................................................................................................................... 29
 |
3 3 |
▲back to top |
ii
3.5. Quelques programmes d’aide à l’emploi ............................................................................................... 30
3.5.1. Programme Emploi-Jeunes II (PEJ II) ........................................................................................... 30
3.5.1.1. Stage de qualification professionnelle ....................................................................................... 30
3.5.1.2. Programme de Stage de Formation Professionnelle dans les Services Publics ......................... 31
3.5.2. Projet Niéta .................................................................................................................................... 33
4. Sécurité sociale ..........................................................................................................................................36
4.1. Caisse Malienne de Sécurité Sociale ..................................................................................................... 36
4.2. Institut National de Prévoyance Sociale ................................................................................................ 39
5. Dialogue social ..........................................................................................................................................44
5.1. La gestion des conflits collectifs ........................................................................................................... 44
5.2. La relecture des conventions collectives et accords d’établissements ................................................... 45
5.3. L’évaluation du Pacte de Solidarité pour la Croissance et le Développement (PSCD) de 2001 ........... 45
5.4. La création d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS) ........................................................... 45
6. Migration internationale du travail au Mali ..........................................................................................48
 |
4 4 |
▲back to top |
iii
Liste des tableaux
Tableau 1. Estimation de la population en milliers par région et par sexe en 2014 4
Tableau 2. Répartition de la population selon le groupe d’âge et le sexe en milliers 5
Tableau 3. Répartition de la population par région, superficie et densité en 2014 6
Tableau 4. Répartition des diplômés en BT2 par filière et par sexe en 2014 7
Tableau 5. Répartition des diplômés en CAP par filière et par sexe en 2014 8
Tableau 6. Répartition des étudiants inscrits dans les différentes Universités de Bamako selon le genre en
2014
9
Tableau 7. Nombre d’apprenants en formation dans les champs/écoles par filière et par sexe 11
Tableau 8. Nombre d’apprenants en formation tutorat par filière et par sexe 11
Tableau 9. Nombre d’apprenants par type de formation par filière et par sexe 12
Tableau 10. Taux d'activité par région, sexe et quintile de consommation 16
Tableau 11. Répartition du taux d'emploi informel par sexe selon le secteur institutionnel 17
Tableau 12. Répartition (en %) des actifs occupés suivant le secteur institutionnel par sexe 17
Tableau 13. Taux de sous-emploi selon le groupe d’âge et le sexe 19
Tableau 14. Répartition (%) de la population de 15 - 64 ans inactive selon les raisons d'inactivité par sexe
et zone de résidence
19
Tableau 15. Demandes d’emploi enregistrées selon le niveau d’instruction par sexe 22
Tableau 16. Répartition (%) des demandes suivant le type de métiers 23
Tableau 17. Répartition des offres d'emploi suivant la catégorie socioprofessionnelle et le type de métiers 26
Tableau 18. Répartition des placements enregistrés par sexe, niveau d'instruction et catégorie
socioprofessionnelle
28
Tableau 19. Répartition des placements effectués en 2014 par sexe et type de métiers 28
Tableau 20. Nombre d’emplois créés en 2014 : 29
Tableau 21. Nombre d’emplois créés par le secteur privé selon le type de contrat et la branche d’activité 29
Tableau 22. Récapitulatif des inscriptions 30
Tableau 23. Nombre de jeunes placés en stage auprès des entreprises privées et des ONG par région et par
sexe.
31
Tableau 24. Situation des jeunes sélectionnés par diplôme 31
Tableau 25. Répartition des jeunes sélectionnés par région et par sexe 32
Tableau 26. Répartition des jeunes stagiaires pour le 7ème programme 33
Tableau 27. Nombre de jeunes ayant complété une formation professionnelle courte au cours de l'année
calendaire 2014 par filière, genre et région
34
Tableau 28. Répartition des bénéficiaires du volontariat du PAJENIETA 35
Tableau 29. Répartition des pensionnés par région selon le sexe 36
Tableau 30. Répartition des pensionnés par région selon le type de pensionné 37
Tableau 31. Répartition des pensionnés selon le type et le sexe 37
Tableau 32. Age moyen des pensionnés selon la région et le sexe 38
Tableau 33. Répartition des inscrits de l'AMO selon la région, le groupe d'âge et le sexe 38
Tableau 34. Prestations de l’INPS au cours de l’année 2014 40
Tableau 35. Répartition des bénéficiaires par sexe 41
Tableau 36. Répartition des bénéficiaires par région 42
Tableau 37. Répartition des bénéficiaires par âge 43
Tableau 38. Répartition des litiges individuels selon la région 45
Tableau 39. Répartitions des conflits collectifs par branche d’activité économique, le cercle, par nombre
de journées perdues et qualification professionnelle des travailleurs
46
 |
5 5 |
▲back to top |
iv
Tableau 40. Répartition des migrants de retour bénéficiaires de formation en 2014 par domaine 49
Tableau 41. Répartition des migrants de retour ayant bénéficié la formation et Kits d’installation en 2014
par domaine
49
Annexe 1 : Nombre de préavis de grèves par les syndicats en 2014 51
Annexe 2 : Ventilation des litiges individuels 52
Liste des graphiques
Graphique 1 : Répartition de la population de 15 - 64 ans suivant le statut dans l'activité 15
Graphique 2 : Taux de chômage par région, sexe et groupe d'âge 18
Graphique 3 : Répartition (en %) du nombre de demandes d'emploi enregistrées en 2014 par sexe 21
Graphique 4 : Répartition (%) des demandes d'emploi suivant le niveau d'instruction 21
Graphique 5 : Répartition (%) des demandes enregistrées suivant l'âge 23
Graphique 6 : Répartition (effectif) des offres d'emploi par région, type et durée du contrat
proposé en 2014
25
Graphique 7 : Répartition des placements effectués par région et sexe 27
 |
6 6 |
▲back to top |
v
Sigles et abréviations
ANPE Agence Nationale Pour l'Emploi
ANTIM Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale
APEJ Agence Pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
APCAM Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
APCMM Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali
BSIMT Bulletin Semestriel d'Informations sur le Marché du Travail
BIT Bureau International du Travail
BTP Bâtiment Travaux Publics
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
CCIM Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali
CMSS Caisse Malienne de Sécurité Sociale
CNDS Conseil National du Dialogue Social
CSCom Centre de Santé Communautaire
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CTOC Comité Technique d’Orientation et de Contrôle
DOEF Département Observatoire de l’Emploi et de la Formation
DNE Direction Nationale de l'Emploi
DNP Direction Nationale de la Population
DNT Direction Nationale du Travail
DOEF Département Observatoire de l'Emploi et de la Formation
EMOP Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages
FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
FARE Fonds Auto-Renouvelable pour l’Emploi
FDPRI Faculté des Droits Privés
FDPU Faculté de Droits Publics
FHG Faculté d’Histoire et Géographie
FLLSL Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage
FNAM Fédération Nationale des Artisans du Mali
FSEG Facultés des Sciences Economiques et de Gestion
FSHSE Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Education
ICCO Organisation inter-églises de coopération au développement
IGM Institut Géographique du Mali
INIFORP Institut National d’Ingénierie de la Formation Professionnelle
INPS Institut National de Prévoyance Sociale
INSTAT Institut National de la Statistique
IPEC-SIMPOC
International Programme on the Elimination of Child Labour - Statistical
Information and Monitoring Programme on Child Labour
IPR/IFRA Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée
IUG Institut Universitaire de Gestion
IUT Institut Universitaire de Technologie
MINUSMA Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
ONEF Observatoire National pour l'Emploi et la Formation
PAJE Projet d’Appui aux Jeunes Entrepreneurs
PEJ Projet Emploi Jeunes
PENF Projet d’appui à l’Education Non Formelle
PNT Politique Nationale du Travail
PSCD Pacte de Solidarité pour la Croissance et le Développement
RASAMT Rapport d’Analyse Situationnelle Annuel sur le Marché du Travail
SIMTM Système d’Information sur le Marché du Travail et la Migration
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
ULSHB Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako
USJPB Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako
USSGB Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
USTTB Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako
 |
7 7 |
▲back to top |
vi
Résumé
En 2014, plus de 8 000 individus travaillant dans le secteur informel ont bénéficié des formations
financées par le FAFPA, et plus de 5 200 agents évoluant dans les entreprises formelles ont été formés
grâce au financement de la même structure. Parallèlement, les organismes non gouvernementaux et les
Projets interviennent également dans la formation professionnelle des populations vivant surtout en zone
rurale. En 2014, plus 23 000 individus ont été formés.
Rien que pour la seule année de 2014, plus de 4 500 jeunes diplômés sont passés par le programme de
stage de formation professionnelle de l’APEJ, qui vise à donner une expérience professionnelle aux
jeunes après leur sortie du système éducatif. Ce programme vise ainsi à améliorer l’employabilité des
jeunes et augmenter ainsi leur chance de décrocher un premier emploi après leur passage dans le
programme.
Le système éducatif formel souffre de la pléthore d’effectifs dans certaines filières aussi bien au niveau
de l’enseignement supérieur qu’au niveau de l’enseignement technique et professionnel. En 2014,
l’Université des Sciences Juridiques et Politiques a enregistré 23 618 étudiants inscrits, soit 36% des
effectifs de l’enseignement supérieur et au niveau de l’enseignement secondaire technique et
professionnel, près de 81% des diplômés en Brevet de Technicien sont spécialisés dans des filières
tertiaires (principalement comptabilité et secrétariat de direction). Par contre au niveau du Certificat
d’Aptitude Professionnelle (CAP), près de 55% des sortants sont diplômés dans les filières techniques.
L’enquête nationale sur l’emploi 2014 réalisée à travers le dispositif de l’EMOP a estimé à 96,5% la part
de l’emploi informel dans l’emploi total. Le taux de chômage global du pays atteint 8,2%. Celui des
jeunes âgés de 15 à 24 est estimé à 11,1%.
Au cours de la même année, les demandes d'emploi enregistrées au niveau de l'ANPE et des bureaux
privés de placement étaient évaluées à 16 159 personnes. Par contre, les offres d’emplois enregistrées
par les mêmes structures se chiffrent à 6 400 pour seulement 3 400 placements effectués, soit 53% des
offres satisfaites.
L’Assurance Maladie Obligatoire a enregistré 44 715 individus inscrits en 2014 dont 19 368 hommes et
25 347 femmes.
L’INPS a réalisé 149 025 prestations pour un coût total de 48 706 013 746 FCFA réparti entre les
prestations familiales, accident du travail et maladies professionnelles, assurance vieillesse, invalidité et
survivants, assurance volontaire et assurance maladie obligatoire. L’assurance vieillesse, invalidité et
survivants occupe le premier rang avec 77,6% des prestations de l’année 2014 (soit 37 809 211 094 de
FCFA) avec un effectif de 55 482 personnes.
Dans le cadre du dialogue social, la Direction Nationale du Travail a enregistré 1384 litiges. Parmi ces
litiges, 895 ont été réglés en conciliation (soit 55,6%), 423 transmis au tribunal et enfin 66 sont classés
sans suite ou en instance.
 |
8 8 |
▲back to top |
1
Introduction
1. Justification
La compréhension des mécanismes à la base du disfonctionnement ou déséquilibre du marché du travail
est essentielle afin de développer des politiques efficaces pour promouvoir la création d’emploi.
L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF), de par les missions qui lui sont confiées
par les plus hautes autorités entend pleinement jouer sa partition tout en produisant et publiant des
statistiques fiables et régulières, indispensables à la bonne compréhension du fonctionnement du marché
du travail.
Les différentes informations publiées sur le marché du travail proviennent principalement de cinq
sources :
- le recensement général de la population et de l’habitat ;
- les enquêtes emploi auprès des ménages ;
- les enquêtes auprès des entreprises ;
- le dispositif de la formation professionnelle ;
- les données administratives ou base de données des organisations.
Rapport d’Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du Travail (RASAMT) est produit sur la base
des données administratives. En effet, l’exploitation de données disponibles dans les départements
ministériels et les organismes sous tutelle permet de fournir directement ou indirectement, certains
indicateurs sur la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. En plus donc de la réalisation des
enquêtes sur l’emploi auprès des ménages et des entreprises, l’ONEF publiera annuellement un rapport
qui compilera les statistiques afin de donner un aperçu général des activités réalisées par les structures
intervenant dans le Système d’Information sur le Marché du Travail et la Migration (SIMTM). L’un des
buts de la production de ce rapport est de suivre la mise en œuvre des politiques nationales de l’emploi
et de la formation professionnelle par les Agences chargées de leur opérationnalisation. Ces dernières,
dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques, doivent poser des actes concrets allant dans le sens
des objectifs visés.
2. L’objectif
L’objectif général de cette étude est de produire le rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché
du travail portant sur les données de 2014.
De façon spécifique, ce rapport vise à :
- faire le point des activités réalisées en 2014 par les structures intervenant dans le SIMTM ;
- produire des statistiques afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales
de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- assurer la régularité de la production d’informations pertinentes sur le marché du travail.
 |
9 9 |
▲back to top |
2
3. Méthodologie
Pendant près d’un mois, les agents de collecte de l’ONEF se sont rendus dans les différentes
structures productrices d’information sur le marché du travail pour collecter les données et les
rapports d’activités de 2014. Afin d’atteindre les objectifs visés dans le cadre de l’élaboration de ce
rapport, certaines données ont été traitées pour produire les tableaux croisés.
L’équipe a rencontré des difficultés relatives à l’inexistence dans certaines structures des données
désagrégées par sexe et souvent par localité. Les données souvent disponibles dans des formats
inappropriés ont rendu le traitement difficile.
La collecte des données a été complétée par la revue documentaire qui nous a permis de mieux cerner
les missions assignées aux structures concernées.
L’analyse est faite par une équipe technique multidisciplinaire composée des agents de l’ONEF et
des structures impliquées dans la production des données statistiques sur le marché du travail.
Les informations ainsi collectées ont permis d’élaborer le présent rapport en six sections :
- Environnement socio-économique et démographique ;
- Principales sources de données sur l’emploi au Mali ;
- Marché du travail en 2014 ;
- Sécurité sociale ;
- Dialogue social ;
- Migration.
 |
10 10 |
▲back to top |
3
1. Environnement socio-économique et démographique
1.1. Caractéristiques socio-économiques et démographiques
1.1.1. Caractéristiques socio-économiques
L’économie malienne reste dominée dans ces dernières années par un secteur secondaire tiré par les
mines et un secteur informel très important, tant au plan de sa contribution au PIB qu’en termes de
création d’emplois. Au Mali, l’année 2014 a été marquée par un renforcement de la stabilité socio -
politique et économique amorcée en 2013 après une situation difficile en 2012. L’économie malienne a
enregistré un taux de croissance du PIB de 7,2% en 2014 contre 1,7% en 2013 et 0,0% en 2012 (INSTAT,
2015)1. Cette croissance a été tirée par les secteurs secondaire et tertiaire qui ont enregistré
respectivement 9,1% et 4,2% en 2014. Selon les prévisions macroéconomiques, le taux de croissance du
PIB connaitra une relative baisse en 2015 pour s’établir à 4,9%. Cette baisse serait due à la diminution
des produits manufacturés. L’inflation mesurée par l’indicateur de convergence de l’UEMOA, qui est le
taux d’inflation moyen des douze (12) mois, a été de 1,1% en 2014 contre -0,6% en 2013 et 5,3% en
2012. Ce niveau est inférieur à la norme communautaire de l’UEMOA (3,0% maximum). La
consommation finale a connu une hausse de 2,5% en 2014 contre une baisse de 0,2% en 2013. La
formation brute de capital fixe est passée de -30,8% en 2012 à 23,3% en 2013, suite principalement à la
hausse des investissements publics (55,0%).
Compte tenu de toutes ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est ressorti à 61,5
milliards de FCFA en 2013 contre 1,1 milliard de FCFA en 2012. Les recettes totales cumulées en
réalisation à fin décembre 2014 sont ressorties à 1057,6 milliards de FCFA contre une réalisation de
951,2 milliards de FCFA à fin décembre 2013, soit une augmentation de 9,3%. Les recettes budgétaires
ont atteint 940,8 milliards de FCFA en 2014 contre 842,7 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de
5,5%, en lien avec l’amélioration des recettes fiscales qui sont passées de 804,5 milliards de FCFA en
2013 à 890,5 milliards de FCFA en 2014 soit une progression de 8,0%. Le niveau de la pression fiscale
s’est situé à 15% en 2014 contre 15,1% en 2013. Ce niveau reste toujours inférieur à la norme
communautaire de 17% minimum. Le solde budgétaire de base s’est détérioré en s’affichant à -86,7
milliards de FCFA en 2014 contre -43,7 milliards de FCFA en 2013. Cela représente -1,4% du PIB en
2014 contre - 0,7% du PIB en 2013. Les arriérés de paiements extérieurs sont ressortis à -1,5 milliards
de FCFA en 2013 mais l’Etat n’a enregistré aucun arriéré de paiement en 2014. Au 31 décembre 2014,
l’encours de la dette publique à moyen et long terme est estimé à 1930 milliards de FCFA comprenant la
dette intérieure pour 445,4 milliards de FCFA soit 23,1% du total et la dette extérieure pour un montant
de 1484,6 milliards de FCFA soit 76,9% de l’encours total. Dans le domaine de la santé, le taux de
consultation prénatale est passé de 68% en 2012 à 72% en 2013. Le taux d’accouchement assisté s’est
établi à 58,0% en 2013 contre 56,0% en 2012. Le nombre de CSCom fonctionnel s’est situé à 1151 en
2013 contre 1134 en 2012, soit une hausse de 1,5%.
1 INSTAT : Comptes nationaux révision septembre 2015
 |
11 11 |
▲back to top |
4
Le taux d’accès à l’électricité pour les ménages est de 20% en 2013 contre 19% en 2012 (INSTAT,
2014). S’agissant de l’eau potable, 78,9% des ménages ont accès à l’eau potable en 2013 contre 80,9%
en 2011. Le taux de chômage (au sens élargi), s’est situé à 7,3% en 2013 contre 8,2% en 2014.
Toutes ces performances ont été réalisées dans une situation sociale relativement apaisée. Les élections
présidentielle et législative ont été tenues dans un climat de paix en 2013 et 2014. Les nouvelles autorités
ont adopté la voie du dialogue et de la négociation dans la résolution de la crise au Nord du pays. Cette
démarche a abouti à la signature de l’accord de paix entre l’Etat malien et les groupes armés en 2015.
1.1.2. Caractéristiques démographiques
Le pays a connu quatre recensements généraux de la population dont le dernier remonte à 2009. Ce
recensement a permis de dénombrer 14 528 662 habitants (dont 50,4% de femme et 46,6% d’hommes).
La population résidente du Mali est estimée au 1er juillet 2014 à 17,308 millions d’habitants. En dépit
d’une forte émigration, la population du Mali a été multipliée par quatre depuis l’indépendance. De 3,5
millions d’habitants en 1960, elle a atteint 17,308 millions d’habitants en 2014 contre 14,5 millions
d’habitants (résultats définitifs du RGPH 2009), repartie entre 8, 655 millions d’hommes soit 50,01% et
8, 643 millions de femmes soit 49,99%. La population malienne continuera de s’accroître à près d’un
demi-million de personnes par an. Ceci montre que, la croissance de la population est beaucoup plus
forte que prévue avec un taux annuel moyen de 3,6% constaté sur la période de 1998 à 2009.
La distribution de la population totale est loin d’être uniforme. Les régions de Sikasso (18,2%), de
Koulikoro (16,7%) et de Ségou (16,1%), reçoivent à elles seules un peu plus de la moitié (51,0%) de la
population totale du pays. Par contre, les populations des régions de Tombouctou (4,6%), Gao (3,7%) et
Kidal (0,5%) n’atteignent pas 10% de l’effectif total du pays. Le District de Bamako compte plus d’un
Malien sur dix (12,5%) (Tableau 1).
Tableau 1. Estimation de la population en milliers par région et par sexe en 2014
Régions
Hommes Femmes Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 1 189 13,7 1 186 13,7 2 375 13,7
Koulikoro 1 445 16,7 1 441 16,7 2 885 16,7
Sikasso 1 576 18,2 1 572 18,2 3 149 18,2
Ségou 1 394 16,1 1 391 16,1 2 785 16,1
Mopti 1 214 14,0 1 211 14,0 2 426 14,0
Tombouctou 402 4,6 401 4,6 804 4,6
Gao 322 3,7 323 3,7 646 3,7
Kidal 41 0,5 40 0,5 81 0,5
Bamako 1 080 12,5 1 077 12,5 2 157 12,5
Ensemble 8 665 100,0 8 643 100,0 17 308 100,0
Source DNP : Pop. Info. Mali 2014
 |
12 12 |
▲back to top |
5
La répartition de la population par région met en évidence un phénomène marquant, à savoir
l’accélération de l’urbanisation au Mali. Plus de 91,16% de la population malienne vivent dans les 5
régions de la partie sud du pays. Si l’on enlève la région de Mopti, quatre régions du sud-ouest du pays
abritaient plus de 77,14% de la population totale du Mali.
La distribution de la population par groupe d’âge (tableau 2) fait ressortir que 46,9% de la population
totale en 2014 sont dans la tranche d’âge 0 -14 ans. Celle du groupe d’âge 15 à 44 ans représente 42,7%
de la population totale et le poids des personnes âgées de 45 ans et plus dans la population totale est de
10,4%. Aussi, la population âgée de 15 à 25 ans représente 19,7% de la population totale, la tranche d’âge
15-35 ans représente 33,5% de la population totale et les 15 à 40 ans représentent 38,7% de l’effectif
total de la population au Mali.
Tableau 2. Répartition de la population selon le groupe d’âge et le sexe en milliers
Groupe d'âge
Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
00-04 ans 1 625 18,8 1 558 18,0 3 183 18,4
05-09 ans 1 366 15,8 1 310 15,2 2 676 15,5
10-14 ans 1 150 13,3 1 104 12,8 2 254 13,0
15-19 ans 952 11,0 916 10,6 1 868 10,8
20-24 ans 780 9,0 757 8,7 1 537 8,9
25-29 ans 656 7,6 642 7,4 1 298 7,5
30-34 ans 551 6,4 546 6,3 1 097 6,3
35-39 ans 444 5,1 450 5,2 894 5,2
40-44 ans 341 3,9 358 4,1 699 4,0
45-49 ans 246 2,8 275 3,2 521 3,0
50-54 ans 175 2,0 210 2,4 385 2,2
55-59 ans 131 1,5 168 1,9 299 1,7
60-64 ans 99 1,1 134 1,6 233 1,3
65-69 ans 66 0,8 97 1,1 163 0,9
70-74 ans 47 0,5 69 0,8 116 0,7
75-79 ans 22 0,3 33 0,4 55 0,3
80 + 12 0,1 18 0,2 30 0,2
Total 8 663 100,0 8 645 100,0 17 308 100,0
Source : Perspectives de la population résidente du Mali 2010-2035, DNP
Par ailleurs, les femmes en âge de procréer (15 à 49) ans représentent 45,62% de la population féminine
totale. Enfin, la population d’âge actif (15-64 ans) représente 51,02% de la population totale en 2014.
La densité totale du pays est d’environ 122 habitants au km². Cette moyenne nationale cache des
disparités régionales non négligeables. Alors que dans la région de Kidal on compte 5 habitants sur 10
 |
13 13 |
▲back to top |
6
au km², dans le District de Bamako on observe une très forte concentration de la population avec 8 836
habitants au km² (tableau 3).
Tableau 3. Répartition de la population par région, superficie et densité en 2014
Régions Ensemble Superficie Densité
Kayes 2 375 000 124 153,85 19,13
Koulikoro 2 885 000 91 331,37 31,59
Sikasso 3 149 000 71 651,27 43,95
Ségou 2 785 000 61 399,83 45,37
Mopti 2 426 000 82 133,49 29,54
Tombouctou 804 000 502 358,98 1,60
Gao 646 000 172 311,23 3,75
Kidal 81 000 146 572,57 0,55
Bamako 2 157 000 244,11 8 836,32
Ensemble 17 308 000 1 241 238 13,82
Source : Perceptives DNP 2014 et IGM
L’urbanisation se poursuivra à un rythme soutenu. En effet, selon les résultats des recensements généraux
de la population, le taux d’urbanisation est passé de 16,8% en 1976 à 35% en 2009 pour atteindre 37,5%
en 2014. La population de la ville de Bamako a fortement augmenté. Elle est passée de 89 000 habitants
en 1950 à 1,8 million d’habitants en 2009 (RGPH 2009) et 2 157 000 habitants en 2014. Le District de
Bamako comptera près de 3 millions d’habitants en 2025 et 3,5 millions d’habitants à l’horizon 2035
(Perspectives de la population résidente du Mali 2010-2035, DNP).
Durant la même période, la population rurale, estimée à 63% de la population totale en 2012, est certes
passée à 62,2% et devrait rester majoritaire. Cependant, il convient de signaler que la population rurale
bien que supérieure à la population urbaine au Mali, le taux d’urbanisation augmente rapidement
essentiellement à cause de la forte migration interne.
Ainsi, cette situation aurait des répercussions importantes sur la distribution de la population et
nécessitera la mise en place de politiques et d’investissements adéquats, d’où la nécessité de maîtriser le
rythme de croissance rapide de la population. Le plus grand défi en milieu urbain sera donc d’assurer des
opportunités d’emplois surtout pour les milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du
travail.
 |
14 14 |
▲back to top |
7
1.2. Enseignements et formation professionnelle
L’analyse du marché du travail, nécessite aussi la connaissance des flux des diplômés qui arrivent chaque
année sur ce marché. L’analyse dans cette section concerne les diplômés de 2014 de l’enseignement
technique et professionnel, les inscrits au niveau des universités publiques et de la formation
professionnelle.
1.2.1. L’enseignement technique et professionnel
L’enseignement technique et professionnel relève du Ministère de l’Education Nationale. Il a pour objet
de développer les compétences requises pour l’exercice d’un métier. Après le DEF, il conduit à
l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) après deux ans d’études, du Brevet de
Technicien (BT) qui requière quatre années d’études et du Baccalauréat technique après trois années
d’études. L’enseignement technique et professionnel est dispensé dans les centres de formations publics
et privés, les lycées techniques, les instituts et dans les entreprises.
L’objectif général de ce type d’enseignement est de faire acquérir aux apprenants des capacités pratiques,
des aptitudes d’analyse se traduisant par l’étude et la résolution de problème d’ordre technologique,
économique et social. En 2014, le tableau ci-après donne la répartition des diplômés en Brevet de
Technicien de l’enseignement technique et professionnel (tableau 4).
Tableau 4. Répartition des diplômés en BT2 par filière et par sexe en 2013
Filière Sexe
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bâtiment 74 2,5 10 0,6 84 1,8
Chimie 6 0,2 10 0,6 16 0,3
Construction Métallique 19 0,7 3 0,2 22 0,5
Dessin Bâtiment 306 10,5 47 2,8 353 7,7
Douane 38 1,3 24 1,4 62 1,3
Electricité 9 0,3 3 0,2 12 0,3
Electromécanique 167 5,7 8 0,5 175 3,8
Electronique Audiovisuelle 8 0,3 7 0,4 15 0,3
Electronique Industrielle 24 0,8 3 0,2 27 0,6
Froide 3 0,1 0 0,0 3 0,1
Géologie 7 0,2 0 0,0 7 0,2
Géométrie 26 0,9 9 0,5 35 0,8
Hydraulique 22 0,8 7 0,4 29 0,6
Impôt 11 0,4 3 0,2 14 0,3
Maintenance 8 0,3 0 0,0 8 0,2
Mécanique 3 0,1 0 0,0 3 0,1
Mécanique Auto 26 0,9 0 0,0 26 0,6
Secrétariat de Direction 54 1,9 803 47,6 857 18,6
Technique Comptable 2064 70,7 746 44,2 2810 61,0
Travaux Publics 43 1,5 5 0,3 48 1,0
Total 2918 100,0 1688 100,0 4606 100,0
Source : Centre National des Examens et Concours
 |
15 15 |
▲back to top |
8
Les diplômés en Brevet de Technicien, spécialité technique comptable et secrétariat de direction sont
les plus nombreux (près de 80% des diplômés de 2013). Les femmes se spécialisent plus en secrétariat
de direction comparativement aux hommes (47,6% de femmes). Seulement, 18,71% des diplômés
proviennent des seize filières industrielles disponibles.
Tableau 5. Répartition des diplômés en CAP par filière et par sexe en 2014
Filière Sexe Total
Homme Femme
Effectif % Effectif % Effectif %
Aide Comptable 1316 31,7 584 40,6 1900 34,0
Banque 172 04,1 69 4,8 241 4,3
Boulangerie 4 0,1 0 0,0 4 0,1
Construction Métallique 91 02,2 7 0,5 98 1,8
Dessin Bâtiment 576 13,9 119 8,3 695 12,4
Electricité 554 13,3 41 2,9 595 10,6
Employé Commercial 1 0,0 12 0,8 13 0,2
Employé de Banque 218 05,2 113 7,9 331 5,9
Employé de Bureau 32 0,8 211 14,7 243 4,3
Employé de commerce 7 0,2 54 3,8 61 1,1
Machinisme Agricole 66 1,6 11 0,8 77 1,4
Maçonnerie 224 5,4 90 6,3 314 5,6
Mécanique 36 0,9 2 0,1 38 0,7
Mécanique Auto 90 2,2 8 0,6 98 1,8
Mécanique générale 10 0,2 0 0,0 10 0,2
Menuiserie 17 0,4 10 0,7 27 0,5
Monteur électricien 640 15,4 74 5,1 714 12,8
Pâtisserie 8 0,2 10 0,7 18 0,3
Plomberie Sanitaire 66 1,6 5 0,3 71 1,3
Technologie textile 13 0,3 7 0,5 20 0,4
Transmission 12 0,3 11 0,8 23 0,4
Total 4153 100,0 1438 100,0 5591 100,0
Source : Centre National des Examens et Concours
Contrairement aux diplômés en Brevet de Technicien, plus de 55% des diplômés en Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP) sont spécialisés dans les filières industrielles. Les filières qui ont enregistré plus
de diplômés sont la comptabilité, l’électricité et le dessin bâtiment. Une fois de plus les femmes ont
tendance à opter pour les filières tertiaires et les hommes s’orientent plus vers les filières industrielles.
1.2.2. L’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur prépare dans différentes branches des spécialistes hautement qualifiés et des
chercheurs capables de réaliser un travail créateur dans les domaines social, scientifique et technologique.
Il est composé des instituts de formation, des grandes écoles et des universités. Les données analysées
dans cette section concernent uniquement les instituts supérieurs de formation et les quatre universités
de Bamako.
Ces dernières années, l’enseignement supérieur souffre non seulement de la pléthore d’effectifs, mais
aussi des difficultés relatives à l’insertion professionnelle des diplômés. Face à ces difficultés majeures,
les autorités ont scindé l’Université de Bamako en quatre Universités en 2010. Le but de cette réforme
est de diversifier l’offre de formation au niveau des écoles publiques, mais également d’adapter les
produits de l’enseignement supérieur aux besoins du marché du travail. De même les grandes écoles ont
 |
16 16 |
▲back to top |
9
été dotées d’un nouveau statut leur mettant d’assurer la formation des cadres de haut niveau et de
dispenser la formation continue.
Malgré cette réforme, il existe un déséquilibre majeur entre les Universités accueillant les bacheliers des
séries littéraires et celles qui reçoivent les bacheliers en provenance des filières scientifiques. En 2013-
2014, l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) a enregistré 32% des
étudiants inscrits dans les quatre universités, suivi de l’Université des Langues et Sciences Humaines de
Bamako (ULSHB) avec 28% des inscrits. Ces deux universités totalisent 61% des inscrits contre 39%
des inscrits de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) et de
l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako.
La Faculté des Droits Privés (FDPRI) et celle des Lettres, Langues et des Sciences du Langage ont
enregistré le plus grand nombre d’étudiants inscrits avec respectivement 19,7% et 16,2% des inscrits en
2013-2014.
Tableau 6. Répartition des étudiants inscrits dans les différentes Universités de Bamako selon le genre en 2014
Facultés Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
ULSHB
FLLSL 9 156 17,3 2 875 13,6 12 031 16,2
FSHSE 5 654 10,7 3 444 16,3 9 098 12,3
IUT 82 0,2 48 0,2 130 0,2
USJPB
FDPRI 9 493 18,0 5 106 24,1 14 599 19,7
FDPU 6 383 12,1 2 636 12,4 9 019 12,2
ISFRA 284 0,5 48 0,2 332 0,4
USSGB
FSEG 5 473 10,4 2 834 13,4 8 307 11,2
FHG 6 560 12,4 1 159 5,5 7 719 10,4
IUG 970 1,8 835 3,9 1 805 2,4
USTTB
FST 3 854 7,3 620 2,9 4 474 6,0
FAPH 616 1,2 326 1,5 942 1,3
FMOS 2 930 5,5 973 4,6 3 903 5,3
ISA 251 0,5 65 0,3 316 0,4
IPR/IFRA 1 150 2,2 220 1,0 1 370 1,9
Total 52 856 100,0 21 189 100,0 74 045 100,0
Source : Application de Gestion de la Scolarité des universités de Bamako (ARTEMIS)
L’Institut Universitaire de Gestion (IUG), l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), l’IPR de
Katibougou et l’Institut des Sciences Appliquées (ISA) ont enregistré seulement 5% des étudiants inscrits
en 2013-2014.
Globalement, les femmes représentent près de 29% de l’ensemble des étudiants inscrits en 2014 dans les
différentes facultés et instituts. Elles sont surtout nombreuses à l’IUG, à la FSHSE et à l’IUT avec
respectivement 46,3%, 37,9% et 36,6% des étudiants inscrits dans ces instituts et facultés.
 |
17 17 |
▲back to top |
10
1.2.3. La formation professionnelle
La formation professionnelle est pratiquée au Mali depuis les temps anciens sous la forme traditionnelle.
Cette forme d’apprentissage est encore aujourd’hui le principal mode d’acquisition d’une première
qualification professionnelle pour la grande majorité de notre population, surtout dans le milieu rural.
Elle a toujours eu, en plus de son rôle de formation au métier, une fonction de socialisation importante.
La formation professionnelle est sous la tutelle du ministère de l’emploi de la formation professionnelle,
de la jeunesse et de la construction citoyenne. Les structures rattachées à ce ministère qui interviennent
directement dans la réalisation sont : la Direction Nationale de la Formation Professionnelle, le Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) et l’Institut National d’Ingénierie
de la Formation Professionnelle (INIFORP). En plus de l’intervention de ces structures publiques, les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les Projets interviennent également dans le cadre de la
formation professionnelle.
Le FAFPA a financé la réalisation de la formation de 42 associations dont les membres évoluent dans le
secteur informel. Au total, 8 045 adhérents ont bénéficié de ces formations pour un coût total d’environ
936 000 000 FCFA. Dans le cadre de la formation par apprentissage de type dual, 4 642 personnes ont
été formées dont 2 134 femmes. Le personnel des entreprises évoluant dans le secteur moderne a
également bénéficié de l’appui du FAFPA. Ainsi, la formation de 5 262 agents dont 532 femmes a été
financée par le FAFPA pour un coût global d’environ 1 876 000 000 FCFA.
La Direction Nationale de la formation Professionnelle a également réalisé en 2014 la formation de type
dual pour 4 470 bénéficiaires contre 1873 pour la formation modulaire et 1898 pour la formation tutorat.
Parallèlement aux structures publiques, les Projets et ONG interviennent beaucoup dans le financement
de la formation professionnelle. Au titre de 2014, Swisscontact a financé 461 projets de formation dans
le cadre de son projet PAFP et 320 dans le cadre du projet FIBANI. Au total 19 212 personnes ont
bénéficié de ces formations dont 11 285 femmes, soit 58,73% des bénéficiaires.
Dans le cadre du Projet d’appui à l’éducation non formelle à Sikasso, Mopti, Tombouctou (PENF),
HELVETAS Swiss Intercooperation a financé la formation modulaire pour 312 apprenants dont 109
femmes et la formation continue pour 346 bénéficiaires dont 221 femmes.
Les formations financées par le projet ICCO sont particulièrement relatives à la culture et la production
d’échalote, soit 42,8% des corps de métiers concernés par la formation (tableau 7).
 |
18 18 |
▲back to top |
11
Tableau 7. Nombre d’apprenants en formation dans les champs/écoles par filière et par sexe
Corps de métiers
concernés ou filière
Sexe
Total
Homme Femmes
Effectif % Effectif % Effectif %
Echalote 482 48,6 509 51,4 991 100,0
Karité 12 6,0 188 94,0 200 100,0
Echalote/Oignon 244 45,2 296 54,8 540 100,0
Sésame 415 71,6 165 28,4 580 100,0
Total 1 153 49,9 1 158 50,1 2 311 100,0
Source : ICCO (2014)
Les femmes sont particulièrement plus intéressées par la production d’échalote, d’oignon et de karité
comparativement aux hommes (42,9% contre 31,9%). Par contre, les hommes interviennent plus dans la
production de Sésame (71,6 d’hommes contre 28,4% de femmes).
La proportion d’hommes et de femmes ayant bénéficié de cette formation est presque identique (49,9%
d’hommes contre 50,1% de femmes).
Le projet a également financé des formations en tutorat dans six corps de métiers. Contrairement à la
formation modulaire, les bénéficiaires de la formation tutorat sont majoritairement constitués d’hommes
(58,8%).
Tableau 8. Nombre d’apprenants en formation tutorat par filière et par sexe
Corps de métiers concernés
ou filière
Sexe Total
Homme Femme
Effectif % Effectif % Effectif %
maraîchage 14 70,0 6 30 20 100,0
embouche et Aviculture 1 12,5 7 87,5 8 100,0
construction métallique 11 91,7 1 8,3 12 100,0
menuiserie bois 8 100,0 0 0,0 8 100,0
mécanique moto 12 100,0 0 0,0 12 100,0
coupe et couture 1 5,0 19 95,0 20 100,0
Total 47 58,8 33 41,3 80 100,0
Source : ICCO (2014)
Sur 20 apprenants en coupe et couture, 19 sont des femmes. Par contre, ce sont les hommes qui sont
nombreux à être formés en construction métallique, menuiserie bois et mécanique auto. Le poids de la
tradition fait que les femmes ont tendance à travailler principalement dans certains domaines.
 |
19 19 |
▲back to top |
12
Le projet BØRNEfoten évolue dans le domaine de la formation professionnelle. En 2014, le projet a
financé la formation de 1410 personnes dans différents types de formation dont 60,6% en tutorat. Les
femmes aussi bien que les hommes ont tendance à s’orienter vers certains métiers. Les femmes sont plus
nombreuses à faire la coupe couture stylisme et les hommes s’orientent plus vers la construction
métallique (tableau 9).
Tableau 9. Nombre d’apprenants par type de formation par filière et par sexe
Corps de métier Formation
modulaire
Formation
duale
Formation
continue
Formation
tutorat
H F Total H F Total H F Total H F Total
Coupe couture stylisme 31 35 66 34 94 128 8 84 92 73 213 286
Electricité 0 0 0 0 0 0 55 9 64 55 9 64
Froid climatisation 0 0 0 5 2 7 23 7 30 28 9 37
Electronique 0 0 0 11 4 15 17 4 21 28 8 36
Construction métallique 70 0 70 44 0 44 27 31 58 184 0 184
Agro-alimentaire 0 66 66 17 0 17 27 0 27 1 97 98
Total 101 101 202 111 100 211 157 135 292 369 336 705
Source : BØRNEfoten (2014)
 |
20 20 |
▲back to top |
13
2. Principales sources de données sur l’Emploi au Mali
Au Mali, les analyses faites sur le marché du travail utilisent des données provenant aussi bien des sources
administratives que des enquêtes statistiques.
2.1. Sources administratives
Plusieurs services des ministères en charge du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale produisent,
dans le cadre de leurs activités quotidiennes, une masse importante de données dites administratives qui
fournissent des informations pertinentes sur le marché du travail. Ces données sont généralement
compilées et souvent publiées sous forme de bulletin ou à travers des bases de données. Il s'agit, entre
autres, de : la Direction Nationale de l’Emploi ?, l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), la Direction
Nationale du Travail (DNT), l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), la Caisse Malienne de
Sécurité Sociale, etc.
2.1.1. L'Agence Nationale Pour l'Emploi
L'ANPE a été créée par l'ordonnance n°01-016/P-RM du 27 février 2001 en remplacement de l'Office
National de la Main d'Œuvre et de l'Emploi (ONMOE) afin de lui apporter une nouvelle dynamique pour
amoindrir le chômage. En plus de ses missions de prospection des offres d'emploi, d'accueil,
d'information et d'orientation des demandeurs d'emploi, elle est chargée de collecter les informations sur
les offres et les demandées d’emploi enregistrées auprès des Bureaux privés de placement.
2.1.2. L'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)
L'Institut National de Prévoyance Sociale est un établissement public national à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, créé en 1961 (loi 61-59/AN-RM du 15 mai
1961). Il fournit des informations importantes sur les différentes prestations qu'il réalise dans le cadre de
ses missions. Ainsi les données sur l'effectif des bénéficiaires et les montants versés y sont régulièrement
produites.
2.1.3. La Caisse Malienne de Sécurité Sociale
La Caisse Malienne de Sécurité Sociale est un Etablissement à caractère administratif doté de la
personnalité juridique et jouissant d’une autonomie financière. Elle est créée en juillet 2010 par la loi
N°10-029 en remplacement de la Caisse des Retraites du Mali. Elle a pour mission la gestion des régimes
de pensions des fonctionnaires, des militaires, des députés et de tout autre régime ou branche que l'Etat
lui confie. Dans ce cadre, elle fournit des statistiques sur les effectifs des bénéficiaires, leur répartition
spatiale et leurs caractéristiques sociodémographiques.
 |
21 21 |
▲back to top |
14
2.2. Enquêtes statistiques
Plusieurs enquêtes statistiques (certaines spécifiquement dédiées au sujet et d'autres non) permettent
d'obtenir des informations pertinentes sur le marché du travail malien.
2.2.1. Enquête auprès des ménages
Il s'agit, entre autres, de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages (EPAM). Cette enquête a été intégrée
dans l'Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP).
L’EMOP est un dispositif d'enquête permanent visant à fédérer l'ensemble des enquêtes auprès des
ménages. Elle a pour objectif de produire de façon régulière et permanente des indicateurs pertinents sur
la situation socio-économique des ménages, données nécessaires au suivi du CSCRP, des OMD et à la
formulation de différentes politiques sectorielles.
2.2.2. Autres enquêtes statistiques
Sans avoir un objectif spécifiquement dédié à l'analyse du marché du travail, d'autres enquêtes intègrent
des volets sur l'emploi. Il s'agit entre autres du Recensement général de la population et de l'habitat
(RGPH), le Recensement général de l’Agriculture, l'Enquête démographique et de santé (EDS), l'Enquête
agricole de conjoncture (EAC), l’Enquête malienne d'évaluation de la pauvreté (EMEP), l'Enquête légère
intégrée auprès des ménages (ELIM), etc.
 |
22 22 |
▲back to top |
15
3. Marché du travail au Mali en 2014
Le marché du travail peut être défini comme un lieu "théorique" de rencontre de l'offre (représentée par
la population active) et de la demande (représentée par l'administration, les entreprises publiques et
privées). Au Mali, cette rencontre régie et régulée par le droit du travail est faite à partir des textes
législatifs et réglementaires. Par exemple, le statut général des fonctionnaires définit les conditions de
recrutement dans la fonction publique ; le code du travail régit les relations de travail entre les travailleurs
et les employeurs en ce qui concerne le secteur privé. Cette partie traite de la situation de l'emploi et du
chômage, de l'intermédiation et des programmes d'aide à l'emploi.
3.1. La situation de l’Emploi et du Chômage
Comme signalé plus haut, l'Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages de 2014 a intégré dans
son troisième passage les questions détaillées sur l'emploi telles que collectées par l'Enquête Permanente
auprès des ménages (EPAM). Ce qui permet de disposer de toutes les informations nécessaires sur
l'emploi et le chômage. La collecte s'est déroulée du 1er octobre au 31 décembre 2014.
3.1.1. Population active et taux d'activité
On entend par population active, la fraction de la population en âge de travailler (15 - 64 ans) pourvue
d'un emploi ou en situation de chômage. En 2014, l'effectif de cette tranche de la population active était
estimé à près de 6 millions de personnes représentant 34,8 % de la population totale du pays (tout âge
confondu). Cette catégorie est majoritairement composée des personnes exerçant au moins un emploi.
Le nombre de chômeurs dans la sous-population des 15 -64 ans s'élevait à 492 310 personnes (graphique
1).
Graphique 1 : Répartition de la population de 15 - 64 ans suivant le statut dans l'activité
Source : INSTAT, EMOP 2014
Occupés: 5 494 274
Chômeurs: 492 310
Inactifs: 2 056 514
 |
23 23 |
▲back to top |
16
Le taux d'activité se définit comme le ratio de la population active (population économiquement active)
d'une catégorie à la population en âge de travailler de la même catégorie. En 2014, ce taux était estimé à
74,4 % des individus de 15 - 64 ans (tableau 10).
Majoritaires au sein de la population, les femmes sont moins présentes sur le marché du travail. Les
pesanteurs sociales qui font d'elles les principales gardiennes du foyer semblent être à l'origine de cette
absence. Le taux d'activité est nettement plus élevé chez les hommes, et ce quelle que soit la tranche
d'âge considérée. Alors que huit hommes sur dix âgés de 15 à 64 ans sont actifs, moins de deux femmes
sur trois sont présentes sur le marché du travail malien. Elles ne représentent que 46,7 % des actifs sur le
marché du travail.
Le taux d'activité est inversement proportionnel au degré de richesse. En d'autres termes, l'accès au
marché est plus élevé chez les individus ayant un niveau de vie relativement faible (très pauvre et pauvre).
Ces résultats suggèrent que plusieurs membres au sein des ménages moins nantis se présentent sur le
marché du travail afin de pouvoir contribuer au revenu du ménage. Pendant ce temps, dans les ménages
plus nantis, les membres surtout les plus jeunes restent plus longtemps à l'école c'est à dire en dehors du
marché du travail.
Tableau 10. Taux d'activité par région, sexe et quintile de consommation
Taux d'activité
15 - 64
ans
15 - 24
ans
Région
Kayes 81,7 68,7
Koulikoro 65,7 50,5
Sikasso 84,9 71,4
Ségou 76,7 75,4
Mopti 80,6 76,0
Tombouctou 70,2 53,5
Gao 50,8 37,5
Bamako 63,4 39,9
Sexe
Homme 85,6 67,9
Femme 64,8 55,9
Niveau de vie
Très pauvre 82,6 74,8
pauvre 76,4 68,6
Moyen pauvre 74,0 61,8
Riche 66,8 51,5
Très riche 64,3 39,0
Ensemble 74,4 61,6
Source : INSTAT, EMOP 2014
 |
24 24 |
▲back to top |
17
3.1.2. Taux d'emploi informel
Le taux d’emploi informel est défini comme le pourcentage des emplois informels par rapport à la
population totale occupée. Au plan national, ce taux est de 96,5% dont 97,8% pour les femmes.
Au regard du tableau 11, on constate que la population occupée est prédominée par les emplois informels.
Ainsi, plus de neuf individus sur dix occupent un emploi informel (soit 96,5%). Quel que soit le secteur
institutionnel, exception faite du secteur public, le taux d’emploi informel des hommes est toujours plus
élevé que celui des femmes. Par contre, au niveau national, on observe le contraire. En effet, le taux
d’emploi informel des femmes est 97,8% contre 95,4% pour les hommes.
Tableau 11. Répartition du taux d'emploi informel par sexe selon le secteur institutionnel
Secteur institutionnel Emploi informel
Homme Femme Total
Secteur public 20,6 21,0 20,7
Entreprise privée formelle 58,6 40,2 55,6
Entreprise privée informelle 99,5 99,2 99,3
ONG, Organisations internationales, association 90,5 85,3 89,4
Employés de maison 99,8 99,2 99,5
Total 95,4 97,8 96,5
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
3.1.3. L’emploi selon le secteur institutionnel
Le marché du travail malien demeure dominé par l'emploi dans le secteur informel. En effet, plus de sept
actifs occupés sur dix exercent son activité dans le secteur informel. Ce qui représente près de quatre
millions de personnes. Quel que soit le sexe, l'emploi dans le secteur informel est le principal secteur
d'exercice de la population malienne.
Tableau 12. Répartition (en %) des actifs occupés suivant le secteur institutionnel par sexe
Secteur institutionnel
Sexe de l'individu
Homme Femme Total
Secteur public 3,9 1,4 2,8
Entreprise privée formelle 2,1 0,5 1,3
Entreprise privée informelle 67,1 74,9 70,7
ONG, Organisations internationales, association 1,9 0,6 1,3
Employés de maison 25,0 22,6 23,9
Total 100,0 100,0 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
25 25 |
▲back to top |
18
3.2. Le chômage
Trois critères sont utilisés par le Bureau International du Travail (BIT) pour considérer un individu
comme chômeur :
être sans emploi pendant la période de référence ;
avoir entrepris des démarches pour chercher du travail pendant la période de référence ;
être prêt à travailler immédiatement s'il trouvait du travail (en général moins de 15 jours).
En ne tenant pas compte du deuxième critère, on se trouve dans la situation d'un chômage élargi. En
2014, le taux de chômage était estimé à 8,2 % de la population active. Ce taux a connu une légère hausse
par rapport à 2013 qui était de 6,9 % (INSTAT, EMOP 2013). Il reste cependant en deçà de celui de 2010
qui était de 8,8 % (ANPE/DOEF, EPAM 2010).
Les jeunes de 15 - 24 ans sont légèrement plus touchés par le chômage. Quel que soit le groupe d'âge, le
phénomène est plus accentué chez les femmes comparativement au groupe des hommes. La région de
Gao et le district de Bamako sont particulièrement touchés par le chômage des jeunes dont le taux atteint
respectivement 32,0 % et 23,4 % (graphique 9).
Graphique 2 : Taux de chômage par région, sexe et groupe d'âge
Source : INSTAT, EMOP 2014
3.2.1. Sous-emploi lié à la durée du travail
Selon l'Organisation Internationale du Travail, le sous-emploi existe « lorsque la durée ou la productivité
de l’emploi d’une personne sont inadéquates par rapport à un autre emploi possible que cette personne
est disposée à occuper et capable de faire. Par rapport au temps de travail, le sous-emploi touche un
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
K
ay
es
K
o
u
lik
o
ro
Si
ka
ss
o
Sé
go
u
M
o
p
ti
To
m
b
o
u
ct
o
u
G
ao
B
am
ak
o
H
o
m
m
e
Fe
m
m
e
Région Sexe Ensemble
7,0
9,6
11,6
4,4 3,9
5,7
19,4
11,5
7,3
9,3 8,2
13,0
9,2 8,4 7,6 7,0
12,3
32,0
23,4
10,3
12,1 11,1
15 - 64 ans 15 - 24 ans
 |
26 26 |
▲back to top |
19
dixième des actifs occupés. Cette incidence est particulièrement plus élevée chez les femmes où elle
atteint 17,9 % alors qu'elle n'est que de 3,4 % pour les hommes.
Tableau 13. Taux de sous-emploi selon le groupe d’âge et le sexe
Classe d'âge de travail Homme Femme Total
15 - 24 ans 3,9 16,7 9,9
25 - 35 ans 3,6 19,4 11,6
36 - 40 ans 3 17 9,5
41 - 64 ans 2,9 18,7 9,3
Total 3,4 18,2 10,2
Source : ONEF/INSTAT/EMOP_2014
3.2.2. L'Inactivité
Les inactives, c'est à dire les personnes qui ne participent pas au marché du travail pour une raison ou
une autre, sont estimées à plus de deux millions de personnes de 15 - 64 ans. Cette catégorie de la
population est essentiellement féminine et vivant majoritairement en milieu rural. En effet, près d’un
quart des inactives est une femme pendant que près de six sur dix résident en milieu rural.
En 2014, plus de deux millions de maliens âgés de 15 à 64 ans étaient inactifs c'est à dire sans emploi et
ne cherchant pas de travail. En d'autres termes, une personne sur quatre en âge de travailler était
considérée comme inactive. Il s'agit essentiellement des femmes au foyer (40,1%), les élèves/étudiants
(33,7%), les invalides ou les malades de longue durée (6,4%) et les retraités/vieillards (3,6%).
Tableau 14. Répartition (%) de la population de 15 - 64 ans inactive selon les raisons d'inactivité par sexe
et zone de résidence
Raisons d'inactivité
Invalide ou en
maladie de
longue durée
En cours de
scolarité,
étudiant
Retraité /
vieillard
Grossesse Femme au
foyer
Rentier Autres Total
Sexe
Homme 31,5 57,4 32,4 0,0 0,0 78,4 22,9 26,2
Femme 68,5 42,6 67,6 100,0 100,0 21,6 77,1 73,8
Zone de résidence
Bamako 6,8 32,9 21,4 24,2 14,6 0,0 14,6 20,6
Autre urbain 13,5 29,0 16,8 22,6 15,6 69,5 12,7 19,6
Rural 79,7 38,1 61,8 53,2 69,8 30,5 72,7 59,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : INSTAT, EMOP 2014
 |
27 27 |
▲back to top |
20
3.3. L’intermédiation
Deux types de marché caractérisent le marché de l'emploi : le marché "ouvert" constitué de l'ensemble
des annonces diffusées par les entreprises (publiques et privées) et le marché "fermé" qui recouvre
l'ensemble des emplois qui ne font pas l'objet d'annonces par les entreprises. L'intermédiation sur le
marché du travail, qui définit le point de rencontre des travailleurs et des emplois, est pratiquée sur le
premier type. Cette section présente les demandes et les offres d'emploi ainsi que les placements
enregistrés par les services spécialisés dans l'intermédiation.
3.3.1. Demandes d’emploi
En 2014, l'effectif des chômeurs, c'est-à-dire les individus sans emploi et disponibles pour travailler, était
estimé à 492 310 personnes, soit 8,2 % de la population active (INSTAT, EMOP 2014). Au cours de la
même année, les demandes d'emploi enregistrées au niveau de l'ANPE et les Bureaux privés de placement
étaient évaluées à 16 159 personnes, soit seulement 3,3 % des demandeurs d'emploi. Ces chiffres révèlent
l'importance du marché fermé au Mali.
Les demandes enregistrées proviennent essentiellement des hommes dans le district de Bamako comme
le montre le graphique 3. Environ huit demandes sur dix sont enregistrées dans la capitale malienne. En
dehors du district, l'enregistrement des demandes d'emploi est très faible dans toutes les régions. Elles ne
dépassent guère 3 % à l'exception de la région de Sikasso où elles atteignent 6,2 %. Si la crise dans le
septentrion permet de comprendre l'absence d'enregistrement à Kidal, la faiblesse des demandes
enregistrées (moins de 500) dans les régions comme Kayes, Sikasso et Ségou où l'activité économique
est relativement plus importante est révélateur de la fermeture du marché du travail au niveau régional.
Bien que majoritaire dans la population totale, les femmes sont moins présentent sur le marché du travail.
Elles ne représentent qu'un quart des demandes d'emploi enregistrées dans les différents services de
l'ANPE. La distribution régionale des demandes ne change pas fondamentalement suivant le sexe. Cette
sous représentativité de la gent féminine pourrait s'expliquer par le niveau d'instruction, généralement
élevé, des demandeurs d'emploi (voir graphique ci-dessous). Cet indicateur reste très faible au niveau
des femmes où seulement 2,5 % d'entre elles avaient atteint le niveau secondaire au moins en 2014
[INSTAT, EMOP 2014].
Par ailleurs, il faut noter que la plupart (84,4 %) des demandes sont enregistrées au nom des personnes
qui n'ont aucun emploi c'est-à-dire des chômeurs. La distribution des demandes suivant la situation dans
l'emploi ne varie pas significativement selon le sexe.
 |
28 28 |
▲back to top |
21
Graphique 3 : Répartition (en %) du nombre de demandes d'emploi enregistrées en 2014 par sexe
Source : ANPE(2014)
Note : aucun enregistrement réalisé dans la région de Kidal à cause de la situation sécuritaire
La distribution des demandes d'emploi enregistrées augmente en fonction du niveau d'instruction
(graphique 4). Près de la moitié des demandeurs ont atteint le niveau supérieur, environ un tiers à un
niveau secondaire pendant que moins d'un dixième est sans niveau d'instruction. Tout se passe comme si
le marché du travail ouvert est réservé aux personnes instruites. S'agit-il d'une insuffisance d'information
pour les personnes ? Ou celles-ci préfèrent-elles plutôt exercer dans le secteur informel ou passer par
d'autres voies (parent, ami, connaissance) pour accéder aux emplois qui n'exigent pas un niveau
d'instruction.
Graphique 4 : Répartition (%) des demandes d'emploi suivant le niveau d'instruction
Source : ANPE (2014)
Quel que soit le niveau d'instruction, les demandes enregistrées émanent essentiellement des hommes
(tableau 15). On note cependant, une présence remarquable des femmes au sein des groupes ayant atteint
le secondaire technique et professionnel, et le supérieur 1 qui concerne le niveau DEUG, DUT ou licence.
Pour ces deux groupes, un tiers des demandes est enregistré pour les femmes.
246
396
997
495
317
444
366
0
12898
11741
4418
16 159
13644
2515
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Kayes
Sikasso
Mopti
Gao
Bamako
Homme
Total
Chômeur
R
é
gi
o
n
Se
xe
St
a
tu
t
6,1 2,4 12,2
32,0
47,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Sans niveau Alphabétisé Fondamental Secondaire Supérieur
 |
29 29 |
▲back to top |
22
L'impact de l'instruction sur les demandes d'emploi est confirmé lorsque nous examinons les
qualifications des demandeurs. Deux tiers d'entre elles sont effectués par les cadres supérieurs, moyens
ou agents de maîtrise. Cette proportion est particulièrement plus élevée pour les femmes où sept
demandes sur dix concernent le groupe des cadres supérieurs, moyens ou agents de maîtrise.
Tableau 15. Demandes d’emploi enregistrées selon le niveau d’instruction par sexe
Homme Femme Ensemble %
Effectif % Effectif %
Niveau d'Instruction
Sans instruction 844 7,2 140 3,2 984 6,1
Alphabétisé 350 3,0 30 0,7 380 2,4
1er Cycle fondamental 556 4,7 114 2,6 670 4,1
2ème Cycle fondamental 975 8,3 320 7,2 1 295 8,0
Secondaire Général (Lycée) 733 6,2 239 5,4 972 6,0
Secondaire Technique et Professionnelle 2 816 24,0 1 388 31,4 4 204 26,0
Supérieur 1 (niveau DEUG/DUT/Licence) 1 815 15,5 947 21,4 2 762 17,1
Supérieur 2 (niveau maîtrise et plus) 3 652 31,1 1 240 28,1 4 892 30,3
Qualification
Cadres supérieurs 3936 33,5 1411 31,9 5347 33,1
Cadres moyens et agents de maîtrise 3462 29,5 1802 40,8 5264 32,6
Ouvriers 1204 10,3 308 7,0 1512 9,4
Employés 1398 11,9 479 10,8 1877 11,6
Manœuvres et assimilés 1741 14,8 418 9,5 2159 13,4
Total 11 741 100 4 418 100 16 159 100
Source : ANPE (2014)
Les jeunes sont les plus nombreux sur le marché du travail ouvert (graphique 5). En 2014, neuf demandes
sur dix enregistrées concernaient les jeunes de la tranche d'âge de 20 à 39 ans. Les jeunes de 25 à 29 ans
sont les plus nombreux avec plus d'un tiers des demandes enregistrées. La distribution des demandes
suivant l'âge ne varie pas significativement qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Il faut noter la
présence, certes négligeable, des adolescents sur le marché. Au cours de la même période, 334 demandes
enregistrées (soit 2,1 %) concernaient les jeunes de 15 à 19 ans dont trois quarts sont des garçons.
 |
30 30 |
▲back to top |
23
Graphique 5 : Répartition (%) des demandes enregistrées suivant l'âge
Source : ANPE (2014)
Le marché du travail malien se caractérise par une certaine diversité lorsqu'on regarde la typologie des
métiers demandés. On y trouve aussi bien des métiers hautement qualifiés que des métiers moins
exigeants en termes de qualification. Cependant, on note une prédominance des métiers de la gestion
administrative et financière qui occupent près d'un tiers des demandes enregistrées. Cette prépondérance
n'est guère surprenante lorsqu'on regarde la structure de l'enseignement au Mali marquée par une forte
affluence vers les filières de gestion administrative et financière.
Tableau 16. Répartition (%) des demandes suivant le type de métiers
Type de métier Homme Femme Ensemble %
Effectif % Effectif %
Métiers de l'agriculture, de l'hydrologie, de la pêche et
de la sylviculture
307 2,6 54 1,2 361 2,2
Métiers du bâtiment et des travaux publics 960 8,2 112 2,5 1072 6,6
Métiers de la production industrielle 752 6,4 103 2,3 855 5,3
Métiers de la maintenance et de la réparation 331 2,8 31 0,7 362 2,2
Métiers des transports et de la logistique 602 5,1 45 1,0 647 4,0
Métiers de la gestion administrative et financière 3339 28,4 1788 40,5 5127 31,7
Métiers juridiques 1163 9,9 449 10,2 1612 10,0
Métiers du commerce 808 6,9 416 9,4 1224 7,6
Métiers de la création artisanale 22 0,2 14 0,3 36 0,2
Métiers de l'hôtellerie et de la restauration 111 1,0 93 2,1 204 1,3
Métiers de l'éducation et de l'enseignement 644 5,5 212 4,8 856 5,3
Métiers de la culture et de la communication 664 5,7 126 2,9 790 4,9
Métiers de la santé et de l'action sociale 418 3,6 305 6,9 723 4,5
Métiers des services aux ménages et aux personnes 1620 13,8 670 15,2 2290 14,2
Total 11 741 100 4 418 100 16 159 100
Source : ANPE (2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Homme Femme Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans
30 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans et plus Non déterminés
 |
31 31 |
▲back to top |
24
En définitive, les données recueillies auprès de l'ANPE révèlent que les enregistrements des demandes
d'emploi proviennent essentiellement des jeunes hommes sans emploi ayant atteint un certain niveau
d'instruction et habitant dans la capitale. Ces demandes sont majoritairement orientées vers le secteur
tertiaire, en particulier la gestion administrative et financière, le service juridique et le commerce.
3.3.2. Offres d’emploi
On entend par offre d'emploi une annonce réalisée par une entreprise qui cherche à recruter du personnel.
En général, elle comprend les compétences attendues du candidat, la description du poste à pourvoir et
le type de contrat proposé. Dans le cadre d'un marché du travail ouvert, les offres d'emploi sont
enregistrées au niveau des structures spécialisées comme l'ANPE et d'autres bureaux privés au Mali.
En 2014, l'ensemble de ces structures a enregistré près de 6 400 offres d'emploi constituées
essentiellement de nouveaux postes (seulement 5,5 % des offres concernaient les remplacements). Dans
un pays marqué par un faible taux d'ouverture du marché du travail, ces chiffres suggèrent une certaine
vitalité du secteur privé formel qui arrive à créer plus de 6 000 emplois au cours d'une année.
Les durées de contrat proposé varient entre moins de trois mois à plus de deux ans. Environ deux contrats
sur trois ont une durée au moins égale à douze mois. Selon la région, la majorité des offres est enregistrée
à Bamako comme pour les demandes mais dans une moindre mesure. En effet, alors que trois quarts des
demandes sont enregistrées dans la capitale malienne, celle-ci n'a reçu que 56,4 % des offres. Ce qui
suggère une relative dispersion des créations d'emploi à travers tout le pays.
En dehors de Bamako, la région de Sikasso est la plus grande pourvoyeuse d'emplois. Elle est suivie de
celles de Gao et Ségou. Le niveau de l'activité économique à Sikasso et Ségou avec la présence d'unité
industrielle et l'importance de la production agricole, en particulier du coton, serait à l'origine des offres
d'emploi dans ces régions. Tel ne semble pas être le cas à Gao et Tombouctou qui se trouvent à l'épicentre
de la crise sécuritaire que traverse le pays avec comme corollaire le ralentissement de l'activité.
Cependant, la présence de la MINUSMA et le retour des humanitaires pourraient être les principales
sources de création dans ces régions dont le tissu économique se remet doucement des impacts de la
crise.
 |
32 32 |
▲back to top |
25
Graphique 6 : Répartition (effectif) des offres d'emploi par région, type et durée du contrat proposé en 2014
Source : ANPE (2014)
Alors que les demandes d'emploi proviennent essentiellement des personnes ayant un niveau d'instruction
élevé qui correspond aux cadres supérieurs, moyens ou agents de maîtrise, les offres concernent
majoritairement les ouvriers, employés et manœuvres. En 2014, ces trois catégories
socioprofessionnelles représentaient 60,0 % des offres enregistrées par l'ANPE et les différents bureaux
de placement privés au Mali. Ceci confirme le problème de l'inadéquation entre formation et emploi
toujours évoqué dans les discours politiques.
L'acuité de ce problème est davantage mise en exergue lorsque l'on s'intéresse aux métiers pour lesquels
les emplois sont offerts. Moins d'un tiers des offres concernent les métiers de la gestion administrative et
financière, du service juridique et du commerce qui représentent la moitié des demandes enregistrées au
cours de la même période. De façon générale, les offres sont très diversifiées et concernent l'ensemble
des branches de l'activité socioéconomique et culturelle. On note cependant une prédominance des
métiers comme les services aux ménages et aux personnes, la gestion administrative et financière, le
commerce et la production industrielle.
180
238
682
447
320
379
546
0
3604
6046
350
302
1025
973
1757
2339
6396
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
District de Bamako
Nouveau poste
Remplacement
Moins de 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
12 à 24
Plus de 24 mois
R
é
gi
o
n
Ty
p
e
D
u
ré
e
To ta
l
 |
33 33 |
▲back to top |
26
Tableau 17. Répartition des offres d'emploi suivant la catégorie socioprofessionnelle et le type de métiers
Effectifs %
Catégorie socioprofessionnelle
Cadre supérieur 868 13,6
Cadre moyen 1 692 26,5
Ouvriers 777 12,2
Employés 1 502 23,5
Manœuvres et assimilés 1 557 24,3
Type de métiers
Métiers de l'agriculture, de l’hydrologie, de la pêche et de la
sylviculture
115 1,8
Métiers du bâtiment et des travaux publics 405 6,3
Métiers de la production industrielle 743 11,6
Métiers de la maintenance et de la réparation 30 0,5
Métiers des transports et de la logistique 234 3,7
Métiers de la gestion administrative et financière 1 114 17,4
Métiers juridiques 47 0,7
Métiers du commerce 813 12,7
Métiers de la création artisanale 10 0,2
Métiers de boucher, de l'hôtellerie et de la restauration 71 1,1
Métiers de l'éducation et de l'enseignement 234 3,7
Métiers de la culture et de la communication 398 6,2
Métiers de la santé 590 9,2
Métiers des services aux ménages et aux personnes 1 592 24,9
Total 6 396 100
Source : ANPE (2014)
En définitive, on note que les offres d'emploi enregistrées au niveau de l'ANPE et des bureaux privés
sont loin d'être négligeables dans un pays où le marché du travail est plus fermé. Elles montrent une
vitalité du secteur privé à créer des emplois particulièrement pour les ouvriers, les employés et les
manœuvres dans toutes les branches de l'activité socioéconomique et culturelle du pays.
3.3.3. Placements
Il n’existe pas de remède unique au chômage. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, dont la
croissance économique et la bonne gouvernance. Mais, quoi qu’il en soit, il faut aussi une intermédiation
efficace sur le marché du travail, qui met les personnes en mesure de trouver les emplois disponibles et
fasse en sorte qu’elles aient bien les compétences requises pour ces emplois. Cette action qui consiste à
procurer un emploi à ceux qui en demandent, est appelé placement. Au Mali, ce rôle est joué par l'ANPE
et certains bureaux privés.
 |
34 34 |
▲back to top |
27
En 2014, ces structures ont pu placer plus de 3 400 personnes représentant 21,1 % des demandes
enregistrées. Ce chiffre représentant également 53,4 % des offres reçues montre l'acuité de l'inadéquation
entre formation et emploi dans le sens où près de la moitié des offres ne trouvent pas preneurs pendant
qu'au même moment quatre cinquièmes des demandes ne sont pas satisfaites sur le marché du travail.
Les placements ont essentiellement bénéficié aux hommes qui ont occupé plus de trois quarts des emplois
pourvus. Aussi, la proportion des demandes satisfaites est également plus élevée pour les hommes
(22,9 % pour les hommes contre 16,3 % pour les femmes).
Suivant les régions, sept placements sur dix sont effectués à Bamako. La capitale est suivie des régions
de Sikasso, Ségou et Koulikoro avec respectivement 7,7 %, 6,4 % et 6,1 % des placements enregistrés
en 2014.
Graphique 7 : Répartition des placements effectués par région et sexe
Source : ANPE (2014)
L'instruction semble influer positivement sur l'insertion sur le marché de l'emploi ouvert. En effet, six
placements sur dix ont concerné les personnes qui ont suivi une formation technique professionnelle ou
l'enseignement supérieur : un quart en faveur de ceux qui ont fréquenté l'enseignement technique
professionnel, un cinquième pour ceux qui ont le niveau supérieur 2 et 16,2 % pour ceux du premier
niveau du supérieur.
54
210
263
219
102
124
75
0
2367
2666
748
3414
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
District de Bamako
Homme
Femme
R
é
gi
o
n
Se
xe
En se m
b
le
 |
35 35 |
▲back to top |
28
Tableau 18. Répartition des placements enregistrés par sexe, niveau d'instruction et catégorie socioprofessionnelle
Homme Femme Ensemble %
Effectifs % Effectifs %
Niveau d'instruction
Néant 368 13,8 61 8,16 429 12,57
Alphabétisés 64 2,4 7 0,94 71 2,08
1er Cycle 197 7,39 19 2,54 216 6,33
Second Cycle 271 10,17 66 8,82 337 9,87
Secondaire général 229 8,59 49 6,55 278 8,14
Secondaire technique 589 22,09 263 35,16 852 24,96
Supérieur 1 385 14,44 162 21,66 547 16,02
Supérieur 2 563 21,12 121 16,18 684 20,04
CSP
Cadre supérieur 435 16,32 121 16,18 556 16,29
Cadre moyen et agent de maîtrise 592 22,21 265 35,43 857 25,1
Ouvrier 228 8,55 24 3,21 252 7,38
Employé 774 29,03 285 38,1 1059 31,02
Manœuvre et assimilé 637 23,89 53 7,09 690 20,21
Total 2666 100 748 100 3414 100
Source : ANPE (2014)
De façon générale, les placements suivent les offres d'emploi lorsqu'on s'intéresse aux types de métiers.
En d'autres termes, les placements sont relativement élevés en faveur des métiers où les offres étaient
plus nombreuses. Au moins un placement sur dix a concerné les métiers comme les services aux ménages
et aux personnes (19,5 %), la gestion administrative et financière (16,5 %), le commerce (13,0 %), la
production industrielle (12,5 %).
Tableau 19. Répartition des placements effectués en 2014 par sexe et type de métiers
Métiers Homme Femme Ensemble
Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Métiers de l'agriculture, de l’hydrologie, de la
pêche et de la sylviculture
142 5,3 13 1,7 155 4,5
Métiers du bâtiment et des travaux publics 248 9,3 3 0,4 251 7,4
Métiers de la production industrielle 393 14,7 33 4,4 426 12,5
Métiers de la maintenance et de la réparation 121 4,5 0 0,0 121 3,5
Métiers des transports et de la logistique 155 5,8 5 0,7 160 4,7
Métiers de la gestion administrative et financière 398 14,9 164 21,9 562 16,5
Métiers juridiques 37 1,4 26 3,5 63 1,9
Métiers du commerce 302 11,3 143 19,1 445 13,0
Métiers de la création artisanale 2 0,1 0 0,0 2 0,1
Métiers de l'hôtellerie et de la restauration 14 0,5 10 1,3 24 0,7
Métiers de l'éducation et de l'enseignement 62 2,3 30 4,0 92 2,7
Métiers de la culture et de la communication 127 4,8 73 9,8 200 5,9
Métiers de la santé 170 6,4 76 10,2 246 7,2
Métiers des services aux ménages et aux
personnes
494 18,5 171 22,9 665 19,5
Métiers des cultes 1 0,0 1 0,1 2 0,1
Total 2666 100 748 100 3414 100
Source : ANPE (2014)
 |
36 36 |
▲back to top |
29
3.4. Les créations d’emploi
Les statistiques sur les créations d’emploi sont produites trimestriellement par la Direction Nationale de
l’Emploi depuis 2013. L’objectif visé s’inscrit dans la Déclaration de Politique Générale du
Gouvernement de création des 200 000 emplois d’ici 2018.
Tableau 20. Nombre d’emplois créés en 2014 :
Secteur Sexe Total
Hommes Femmes Non précisé
Emplois publics 4080 1180 99 5359
Emplois privés 19826 4330 0 24156
Emplois générés par les projets et programmes 1122 842 1139 3103
Total 25028 6352 1238 32618
Source : DNE rapport d’activités 2014
Du 1er janvier au 31 décembre 2014, 32 618 emplois ont été créés. Ils se répartissent entre 24 156 emplois
privés (74,06%), 5359 emplois publics (16,43%) et 3103 emplois générés par certains projets et
programmes (9,51%). On constate qu’environ trois emplois sur quatre sont créés par le secteur privé.
La répartition suivant le sexe montre que ces emplois sont majoritairement occupés par des hommes. Ils
représentent 76,73% de l’ensemble contre seulement 19,47% de femmes.
Tableau 21. Nombre d’emplois créés par le secteur privé selon le type de contrat et la branche d’activité
Branche d'activités
Contrat à durée
déterminée
Contrat à durée
Indéterminée
Ensemble
Eff. % Eff. %
Agriculture-Pêche 186 51,81 173 48,19 359
Industrie Extractive; 183 17,72 850 82,28 1033
Industrie manufacturière 283 46,78 322 53,22 605
Electricité-Eau 80 33,06 162 66,94 242
BTP 142 29,65 337 70,35 479
Commerce restaurant hôtel 295 42,94 392 57,06 687
Transport-Entrepôt; Communication 434 44,56 540 55,44 974
Banque, Assurance affaires Immobilières., Services fournis aux
entreprises
2912 61,14 1851 38,86 4763
Services fournis aux Collectivités, Services sociaux, Services
Personnels
8693 62,48 5221 37,52 13914
Activités mal désignées 363 45,83 429 54,17 792
Non déterminées 105 34,09 203 65,91 308
Total 13676 56,62 10480 43,38 24156
Source : DNE rapport d’activités 2014
Les créations d’emplois ont concerné l’ensemble des branches d’activités. Plus de 50% des emplois ont
été créés dans le secteur des services fournis aux collectivités et services sociaux. Ce secteur est suivi par
celui des banques et assurances qui a enregistré 4763 créations d’emplois (19, 78%). La branche électricité-
eau a enregistré le plus bas nombre d’emplois, 242 (1% de l’ensemble).
 |
37 37 |
▲back to top |
30
3.5. Quelques programmes d’aide à l’emploi
3.5.1. Programme Emploi-Jeunes II (PEJ II)
L’APEJ a exécuté un premier Programme Emploi Jeunes (PEJ I), qui comprenait quatre composantes : (i) «
Renforcement de l’employabilité des jeunes » ; (ii) « Développement de l’entreprenariat des jeunes », (iii) « Emploi
rural et les travaux à haute intensité de main-d’œuvre », (iv) « Accès des jeunes au crédit ». Le PEJ I a fait l’objet
d’une évaluation.
Les activités de 2014 de l’APEJ s’inscrivent dans la réalisation des objectifs du PEJ II, dans la recherche de
nouveaux partenariats et dans la mobilisation de ressources intérieures et extérieures.
Dans ce rapport nous évoquerons uniquement deux des activités fars réalisées par l’APEJ dans le cadre de la mise
en œuvre de la composante 1 du Programme Emploi Jeune (PEJ II). Il s’agit du stage de qualification
professionnelle et du stage de formation professionnelle.
3.5.1.1. Stage de qualification professionnelle
Le stage de qualification professionnelle est une sous composante qui, à l’instar des autres produits de la
composante I du PEJ II, vise à renforcer l’employabilité des jeunes diplômés en leur offrant la possibilité d’avoir
une première expérience professionnelle et de se familiariser avec l’environnement du travail dans le secteur privé.
En 2014, l’APEJ a enregistré 59 demandes d’inscription en stage de qualification dont 31 hommes et 28 femmes
au cours de la période de référence. Au total, 28 entreprises privées et ONG ont été concernées suite à des
sollicitations de jeunes (tableau 22).
Tableau 22. Récapitulatif des inscriptions
Régions Femme Homme Total Structures
impliquées Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 2 7,1 3 9,7 5 8,5 5
Sikasso 10 35,7 2 6,5 12 20,3 7
Mopti 2 7,1 2 6,5 4 6,8 4
Bamako 14 50,0 24 77,4 38 64,4 12
Total 28 47,5 31 52,5 59 100,0 28
Source : APEJ rapport d’activités 2014
Suite à l’analyse des dossiers reçus, des jeunes ont été placés en stage de qualification dans les services privés et
les ONG. Cependant, en application de la décision du CTOC, les placements des jeunes en stage de qualification
ont connu par voie de conséquence, une diminution d’effectif au cours de l’année. Le tableau 23 donne le détail
de ces placements.
 |
38 38 |
▲back to top |
31
Tableau 23. Nombre de jeunes placés en stage auprès des entreprises privées et des ONG par région et par sexe.
Placements Nombre des jeunes placés
Régions Féminin Masculin Total
Kayes 1 1 2
Sikasso 0 2 2
Bamako 29 34 63
Total 30 37 67
Pourcentage 44,8% 55,2% 100%
Source : APEJ rapport d’activités 2014
Il ressort du tableau que 67 jeunes diplômés ont été placés en stage de qualification professionnelle dont
30 femmes (44,8%) et 37 hommes (55,2%).
Sur le plan géographique, la plupart de ces placements a été faite dans le District de Bamako, 63 jeunes diplômés
dont 29 femmes soit 43,06% et 34 hommes, soit 53,96%. On remarque également une parité entre homme et
femme dans la région de Kayes.
3.5.1.2. Programme de Stage de Formation Professionnelle dans les Services Publics
Le lancement du stage de formation professionnelle de la 7ème cohorte a été fait le 08 mai 2014 à l’IPR
de Katibougou sous la très haute présidence de son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA,
Président de la République, Chef de l’Etat. Ce programme (anciennement dénommé volontariat) a
concerné 4 547 jeunes repartis sur l’ensemble du territoire national.
Conformément aux besoins exprimés par les structures d’accueil, la situation de la sélection des jeunes
se présente comme suit :
Tableau 24. Situation des jeunes sélectionnés par diplôme
Niveau du Diplôme FEMME HOMME TOTAL
Effectif % Effectif % Effectif %
CAP 220 2,1 167 1,4 387 1,7
BT 1016 9,6 615 5,0 1631 7,1
BTS/DUT/DUTS 293 2,8 193 1,6 486 2,1
LICENCE/MAITRISE 802 7,6 1185 9,6 1987 8,7
DEA/DESS/DOCTORAT 23 0,2 33 0,3 56 0,2
TOTAL 2 354 51,8 2 193 48,2 4 547 100
Source : APEJ rapport d’activités 2014
Ce tableau nous révèle que l’effectif le plus élevé a été observé au niveau des diplômés en
License/Maîtrise avec 8,7%. Ensuite viennent les niveaux de diplômes BT, BTS/DUT/DUTS, CAP et
enfin DEA/DESS/DOCTORAT avec respectivement 7,1% ; 2,1% ; 1,7% et 0,2% de l’ensemble des
sélectionnés. Il est à noter que les femmes représentent 51,8% de l’effectif total sélectionné contre 48,2%
pour les hommes.
 |
39 39 |
▲back to top |
32
La configuration du nombre de jeunes sélectionnés par région (tableau 25) est faite au prorata des niveaux
d’inscription de chaque région.
Tableau 25. Répartition des jeunes sélectionnés par région et par sexe
Régions Femme Homme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 80 3,4 40 1,8 120 2,64
Koulikoro 144 6,1 110 5,0 254 5,59
Sikasso 143 6,1 123 5,6 266 5,85
Ségou 136 5,8 83 3,8 219 4,82
Mopti 78 3,3 51 2,3 129 2,84
Tombouctou 20 0,8 25 1,1 45 0,99
Gao 30 1,3 29 1,3 59 1,30
Kidal 0 0,0 9 0,4 9 0,20
Bamako 1 723 73,2 1 723 78,6 3 446 75,79
Total général 2 354 51,77 2 193 48,23 4 547 100
Source : APEJ rapport d’activités 2014
De l’analyse des informations de ce tableau, il ressort que les jeunes sélectionnés à Bamako sont de loin les plus
nombreux. En effet, il représente 75,8% de l’effectif total des sélectionnés. Cette situation est conforme à l’esprit
de la proportion, reflétant ainsi l’effectif retenu par région au prorata du nombre de candidatures recensées au
cours des inscriptions. Cependant, faudrait-il souligner que l’effectif total des dossiers de candidature de Kidal
n’est que de 9 dossiers. En raison du faible niveau de dépôt de candidature et à titre exceptionnel, toutes les
candidatures de la région de Kidal ont été retenues à travers un objectif de discrimination positive.
Sur les 22 897 dossiers déposés, 4547 ont été sélectionnés, soit un taux de réussite de 19,9%. La plus
part des sélectionnés (tableau 26) a été affecté aux différents départements ministériels. (54,21% de
l’effectif total des sélectionnés). Les structures publiques, para publiques et ONG régionales viennent en
deuxième position avec 23,97% ; suivies des collectifs d’ONG et des Organisations consulaires et
faîtières (APCAM, APCMM, CCIM, FNAM) avec respectivement 8,8% et 7,08%.
 |
40 40 |
▲back to top |
33
Tableau 26. Répartition des jeunes stagiaires pour le 7ème programme
Structure d’accueil Femme Homme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire
(FENASCOM)
82 3,48 35 1,60 117 2,57
Organisations consulaires et faîtières (APCAM, APCMM,
CCIM, FNAM)
176 7,48 146 6,66 322 7,08
Collectifs d’ONG (FECONG, FONGIM, CCA-ONG, SECO-
ONG, GP/SP, CAFO)
207 8,79 193 8,80 400 8,80
Départements Ministériels et assimilés 1208 51,32 1257 57,32 2465 54,21
Structures publiques, para publiques et ONG régionales 627 26,64 463 21,11 1090 23,97
Collectivités territoriales (du District de Bamako, des régions de
Koulikoro, de Ségou et de Mopti)
54 2,29 99 4,51 153 3,36
Total 2354 51,77 2193 48,23 4547 100
Source : APEJ rapport d’activités 2014
La Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire (FENASCom) occupe le bas du
tableau avec 2,57%.
3.5.2. Projet Niéta
Le Projet d’Appui aux Jeunes Entrepreneurs (PAJE-Niéta) est financé par l’USAID/Mali et mis en œuvre
par Education Development Center (EDC) en collaboration avec Catholic Relief Services, Swiss Contact
et l’Association Jeunesse Action.
Le projet Nièta a pour objectif de :
Renforcer les compétences des jeunes Maliens non scolarisés et déscolarisés :
Accroitre l’accès à l’éducation pour les jeunes.
Accroitre l’accès à la formation professionnelle pour les jeunes.
Favoriser un accompagnement vers la création d’entreprise pour les jeunes du projet.
Augmenter l’engagement civique chez les jeunes non scolarisés.
Le PAJE-Nièta a comme cible les jeunes garçons et filles, ruraux et périurbains qui sont âgés de 14 à 25
ans.
Comme stratégies d’intervention, le projet intervient dans les domaines suivants :
Programme de formation
Programme de formation de deux ans ;
Formation de base et formation professionnelle simultanées.
Les jeunes testent les concepts en dehors de la salle de classe en poursuivant leurs carrières et créent
une micro entreprise de leur choix.
 |
41 41 |
▲back to top |
34
Volontaire PAJE
Les volontaires résident dans les villages pour assurer la formation et l’accompagnement nécessaire à
l’atteinte des objectifs du projet.
Association de jeunes
Dynamisation des associations de jeunes dans les 120 villages PAJE (Sikasso, Koulikoro,
Kayes et Tombouctou) pour assurer le suivi et la continuité des actions de PAJE ;
Formation en gouvernance interne, gestion financière et gestion du leadership….
Tableau 27. Nombre de jeunes ayant complété une formation professionnelle courte au cours de l'année
calendaire 2014 par filière, genre et région
Filière KAYES SIKASSO TOMBOUCTOU Ensemble
F H T % F H T % F H T % F H T %
Agriculture 920 208 1128 62,9 369 438 807 49,3 61 145 206 35,3 1350 791 2141 53,3
Boulangerie 1 27 28 1,6 4 32 36 2,2 37 9 46 7,9 42 68 110 2,7
Photographie 1 11 12 0,7 1 11 12 0,3
REMA 30 30 1,83 117 117 20 147 147 3,7
Réparation
Téléphones
12 12 0,7 15 15 2,6 27 27 0,7
Restauration 155 11 166 9,3 201 2 203 12,4 25 1 26 4,5 381 14 395 9,8
Savonnerie 395 7 402 22,4 491 6 497 30,3 92 2 94 16,1 978 15 993 24,7
Transformation 42 3 45 2,5 59 6 65 4 77 3 80 13,7 178 12 190 4,7
TOTAL 1514 279 1793 44,7 1124 514 1638 40,8 292 292 584 14,5 2930 1085 4015 100
Source : PAJE, rapport d’activité 2014
En 2014, au plan national, 4015 jeunes ont complété une formation professionnelle courte dans 3 régions
du Mali. La région de Kayes a abrité 44,7% des bénéficiaires suivie de la région de Sikasso avec 40,8%
et de la région de Tombouctou avec 14,5% des formés.
Selon les filières de formation, l’agriculture et la savonnerie englobent à elles seules plus de 78% des
jeunes formés. L’agriculture est la filière la plus attractive avec 53,3% et 24,73% dans le domaine de la
savonnerie. La photographie est la moins attirante avec 12 jeunes soit 0,30%.
Aucune femme n’a suivi une formation en Réparation de Matériel Agricole (REMA) et en réparation
téléphonique. On n’observe pas la présence de formation en réparation téléphonique et en REMA dans
la région de Sikasso. L’absence de formation en REMA se fait sentir dans la région de Kayes. On
remarque également qu’il y a plus de jeunes formés dans le domaine de l’agriculture à Kayes qu’à
Sikasso, probablement pour diminuer l’exode rural dans la région de Kayes. Cette région a le plus grand
nombre de jeunes formés surtout en agriculture avec 1128 jeunes formés soit 62,9% sur les 1793 jeunes
formés de Kayes.
Selon le sexe, les jeunes femmes sont majoritaires avec 2930 formées sur l’ensemble des 4015 jeunes
formés, soit 73%. On constate que le nombre des jeunes femmes est plus que le double des jeunes
hommes.
 |
42 42 |
▲back to top |
35
Tableau 28. Répartition des bénéficiaires du volontariat du PAJENIETA
Localités Sexe Ensemble
Hommes % Femmes % Total %
Kayes 57 42,22 19 45,24 76 42,94
Sikasso 59 43,7 20 47,62 79 44,63
Tombouctou 19 14,07 3 7,14 22 12,43
Total 135 100 42 100 177 100
Source : PAJE, rapport d’activité 2014
Concernant les trois régions bénéficiant du volontariat du PAJE NIETA, Sikasso a le plus grand nombre
de bénéficiaires du volontariat avec 79 bénéficiaires soit 44,63% dans l’ensemble. Il est suivi de la
première région avec 42,94% et la région de Tombouctou occupe la dernière place avec 12,43% de
l’ensemble des volontaires bénéficiaires du projet Nièta.
Contrairement aux jeunes ayant complété une formation professionnelle courte, parmi les 177
bénéficiaires, le nombre des hommes est plus du triple de celui des femmes, soit 135 hommes contre 42
femmes.
 |
43 43 |
▲back to top |
36
4. Sécurité sociale
Le régime malien de sécurité sociale couvre les salariés des secteurs public et privé. Il assure aux
intéressés une protection contre les risques suivants :
maladie-maternité ;
accidents du travail et maladies professionnelles ;
vieillesse, invalidité, décès-survivants ;
prestations familiales.
Les travailleurs indépendants peuvent adhérer volontairement aux couvertures des différents risques.
4.1. Caisse Malienne de Sécurité Sociale
Tableau 29. Répartition des pensionnés par région selon le sexe
Région Sexe du pensionné
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 1247 5,8 1807 6,9 3054 6,4
Koulikoro 2005 9,4 2278 8,7 4283 9,0
Sikasso 2291 10,7 2588 9,9 4879 10,2
Ségou 2403 11,2 2888 11,0 5291 11,1
Mopti 1067 5,0 1143 4,4 2210 4,6
Tombouctou 447 2,1 586 2,2 1033 2,2
Gao 580 2,7 649 2,5 1229 2,6
Kidal 115 0,5 82 0,3 197 0,4
Bamako 11250 52,6 14177 54,1 25427 53,4
Total 21405 45,0 26198 55,0 47603 100
Source : CMSS (2014)
La répartition des pensionnés par sexe nous révèle que 55% des pensionnés sont de sexe féminin et 45%
de sexe masculin. Selon la région, on constate que le district de Bamako englobe 53,4% des pensionnés
dont 54,1% pour les femmes et 52,6% pour les hommes. Après Bamako, viennent les régions de Ségou,
de Sikasso avec respectivement 11,1% et 10,2%. La région de Kidal occupe le bas du tableau avec 0,4%
de l’ensemble des pensionnés, proportionnelle à la taille de sa population totale.
 |
44 44 |
▲back to top |
37
Tableau 30. Répartition des pensionnés par région selon le type de pensionné
Région Type de pensionné
Militaire Civil Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 824 27,0 2230 73,0 3054 6,4
Koulikoro 2736 63,9 1547 36,1 4283 9
Sikasso 1790 36,7 3089 63,3 4879 10,2
Ségou 2044 38,6 3247 61,4 5291 11,1
Mopti 662 30,0 1548 70,0 2210 4,6
Tombouctou 442 42,8 591 57,2 1033 2,2
Gao 606 49,3 623 50,7 1229 2,6
Kidal 162 82,2 35 17,8 197 0,4
Bamako 8476 33,3 16951 66,7 25427 53,4
Total 17742 37,3 29861 62,7 47603 100
Source : CMSS (2014)
Le même constat se dégage à la lecture du tableau 30. Parmi les pensionnés vivant dans le district de
Bamako 33,3% sont des militaires et 66,7% de civils. Dans la région de Kayes, 73% des pensionnés sont
des civils. Contrairement aux deux précédentes régions, le plus grand nombre des pensionnés des régions
de Koulikoro et de Kidal sont des militaires. Ainsi dans la région de Koulikoro, 63,9% des pensionnés
sont des militaires. De même dans la région de Kidal, 82,2% sont des militaires.
Tableau 31. Répartition des pensionnés selon le type et le sexe
Type de pensionné Sexe du pensionné
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Militaire 8913 41,6 8829 33,7 17742 37,3
Civil 12492 58,4 17369 66,3 29861 62,7
Total 21405 100,0 26198 100,0 47603 100,0
Source : CMSS (2014)
L’analyse de ce tableau nous montre que parmi les pensionnés de sexe masculin 41,6% sont des militaires
et 58,4% des civils. Quant aux femmes pensionnées, un peu plus d’un tiers sont des militaires (33,7%)
et le reste (66,3%) des civils.
 |
45 45 |
▲back to top |
38
Tableau 32. Age moyen des pensionnés selon la région et le sexe
Région Sexe du pensionné
Masculin Féminin Total
Kayes 65 65 65
Koulikoro 61 59 60
Sikasso 64 61 62
Ségou 64 63 64
Mopti 64 61 63
Tombouctou 67 60 63
Gao 65 57 61
Kidal 71 55 64
Bamako 64 62 63
Total 64 62 63
Source : CMSS (2014)
L’âge moyen des pensionnés du Mali est 63 ans dont 64 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes.
Les pensionnés de sexe masculin de Kidal ont plus de longévités avec une moyenne d’âge de 71 ans que
ceux des autres régions. Ils perçoivent donc plus longtemps leurs pensions que les autres. Par contre les
pensionnés de sexe féminin de Kidal ont moins de longévité avec un âge moyen de 55 ans que ceux des
autres régions.
On constate un équilibre d’âge moyen entre les pensionnés des deux sexes (masculin et féminin) de
Kayes, soit 65 ans en moyenne. Quel qu’en soit la région, l’âge moyen des hommes est toujours supérieur
à celui des femmes.
Tableau 33. Répartition des inscrits de l'AMO selon la région, le groupe d'âge et le sexe
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Région
Kayes 1157 6,0 1765 7,0 2922 6,5
Koulikoro 1678 8,7 2211 8,7 3889 8,7
Sikasso 2130 11,0 2521 9,9 4651 10,4
Ségou 2144 11,1 2760 10,9 4904 11,0
Mopti 1013 5,2 1110 4,4 2123 4,7
Tombouctou 427 2,2 557 2,2 984 2,2
Gao 543 2,8 622 2,5 1165 2,6
Kidal 101 0,5 77 0,3 178 0,4
Bamako 10175 52,5 13724 54,1 23899 53,4
Groupe d'âge
Au plus 40 ans 501 2,6 1621 6,4 2122 4,7
41 - 55 ans 1282 6,6 6041 23,8 7323 16,4
56 - 64 ans 8675 44,8 7128 28,1 15803 35,3
65 ans et plus 8910 46,0 10557 41,6 19467 43,5
Total 19 368 100,0 25 347 100,0 44715 100,0
Source : CMSS (2014)
 |
46 46 |
▲back to top |
39
Sur les 44 715 individus inscrits à l’AMO, 19 368 sont des hommes et 25 347 des femmes. Ils sont
repartis inégalement entre les régions et par groupe d’âge.
Sur le plan géographique, le district de Bamako a le plus grand nombre d’inscrits à l’AMO avec 23 899
inscrits surtout avec le plus grand nombre de femmes inscrites 54,1%. La région qui suit de loin Bamako
est Ségou avec 4 904 inscrits. Excepté la région de Kidal, le nombre de femme inscrit à l’AMO est
toujours supérieur à celui des hommes.
Selon le groupe d’âge, les plus âgés ont le plus grand nombre de personnes inscrites à l’AMO avec 35,3%
pour les 56-64 ans et 43,5% pour les 65 et plus. Par contre, le nombre d’inscrits des 40 ans est faible par
rapport aux tranches d’âge supérieures avec 4,7% de l’ensemble des inscrits. On constate qu’à
l’exception de la tranche d’âge 56 – 64 ans, le nombre de femmes inscrit à l’AMO est plus élevé que
celui des hommes.
4.2. Institut National de Prévoyance Sociale
Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l'INPS chaque embauche ou licenciement de
personnel dans les huit jours.
Les membres non-salariés des professions libérales, artisanales, commerciales et industrielles ainsi que
les travailleurs indépendants ont la possibilité d'adhérer volontairement à l'INPS. L'affiliation prend effet
à compter du premier jour du trimestre civil en cours à la date de réception de la demande.
Les cotisations sont payées sur la totalité du salaire. Le montant du salaire pris en considération pour la
base de calcul des cotisations ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du SMIG.
 |
47 47 |
▲back to top |
40
Tableau 34. Prestations de l’INPS au cours de l’année 2014
N° Désignation Nombre Montant %
1 Prestations familiales (PF) 79 226 6 529 868 410 13,4
- Allocations prénatales 9 594 923
- Allocations de maternité 39 816 987
- Allocations familiales 5 460 765 751
- Allocations familles extérieures 35 557 138
- Indemnités journalières de congés de maternités 960 120 164
- Allocations 1er établissement 10 750 941
- Congé de maternité 276 185
- Autres 12 978 321
2 Accident du travail et maladies Professionnelles
(ATMP) :
2 212 1 389 045 705 2,9
Indemnité journalière d’incapacité 63 457 449
Rentes aux assurés 573 113 472
Revalorisation 52 491
Rentes aux conjoints 64 033 450
Rentes aux orphelins 1 768 261
Rentes aux ascendants 24 553 990
Rachats des rentes 121 627 557
Frais médicaux 35 381 336
Frais d’hospitalisation 1 178 000
Produits pharmaceutiques 475 999 119
Frais de rééducation 783 490
Frais de transport 6 664 840
Autres 9 801 000
Prévention 10 631 250
3 Assurance vieillesse, Invalidité et survivants (A Vieil) 55 482 37 809 211 094 77,6
Pensions de vieillesse 20 393 949 607
Pensions anticipées 9 527 796 656
Allocations de solidarité 137 572 890
Pensions d’invalidité 379 668 267
Pensions de survivants 6 266 089 934
Remboursement de cotisations 1 104 133 740
4 Assurance volontaire (AV) 741 24 749 470 0,1
5 Assurance maladie obligatoire (AMO) 11 364 2 977 888 537 6,1
Soins médicaux 215 084 366
Produits pharmaceutiques 2 535 739 348
Analyses médicales 227 064 823
Total 149 025 48 706 013 746 100
Source : INPS (2014)
 |
48 48 |
▲back to top |
41
Les prestations de l’INPS accordées à 149 025 maliens en 2014 s’élèvent à 48 706 013 746 FCFA
réparties entre les Prestations familiales, Accident du travail et maladies Professionnelles, Assurance
vieillesse, Invalidité et survivants, Assurance volontaire et Assurance maladie obligatoire. L’assurance
vieillesse, Invalidité et survivants occupe le premier rang avec 77,6% des prestations de l’année 2014
(soit 37 809 211 094 de FCFA) avec un effectif de 55 482 personnes, donc elle plane sur toutes les autres
formes de prestations. Singulièrement, ce sont les pensions de vieillesse, les pensions anticipées et les
pensions de survivants qui la hissent au premier rang avec des montants respectifs de 20 393 949 607 ; 9
527 796 656 et 6 266 089 934 de francs CFA. En termes d’effectivité, elle vient au second rang derrière
les prestations familiales avec 79 226 individus.
L’effectif, aussi bien que le montant restreint revient à l’Assurance Volontaire avec seulement 741
individus et un montant de prestation de 24 749 470 FCFA.
Tableau 35. Répartition des bénéficiaires par sexe
Libellés Hommes Femmes Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Assurés Actifs 150 526 62,5 35 390 43,9 185 916 55,5
Prestations Familiales 65 468 27,2 13 758 17,1 79 226 23,6
Accident Travail et Mal. Prof – – – – 2 212 0,7
Assurance vieillesse 24 211 10 31 271 38,8 55 482 16,6
Assurance volontaire 737 0,3 161 0,2 898 0,3
Assurance Maladie Obligatoire – – – – 11 364 3,4
Total 240 942 100 80 580 100 335 098 100
Source : INPS (2014)
Parmi les 335 098 bénéficiaires de l’INPS, 13 576 n’ont pas pu être désagrégés par sexe dont 2 212 pour
les accidents de travail et maladie professionnelle et 11 364 pour l’assurance maladie obligatoire (AMO).
Les assurés actifs font le plus gros effectif avec 185 916 soit 55,5% (dont 150 526 pour les hommes et
35 390 pour les femmes). Les prestations familiales occupent la deuxième place avec 23,6%, ensuite
vient l’assurance vieillesse. L’effectif de l’Assurance Volontaire (AV) demeure toujours réduit, avec 737
pour les hommes et 161 pour les femmes, soit au total 898 (0,3% de l’effectif total des bénéficiaires).
En somme, sur les 321 522 bénéficiaires désagrégés selon le sexe, 75,1% sont des hommes et 24,9% des
femmes. Le nombre de bénéficiaires est 335 098 dont 240 942 pour les hommes et 80 580 pour les
femmes.
 |
49 49 |
▲back to top |
42
Tableau 36. Répartition des bénéficiaires par région
Localités Assurance Vieillesse Assurance volontaire Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 4504 8,1 2 0,2 4506 8,0
Koulikoro 3583 6,5 13 1,4 3596 6,4
Sikasso 4616 8,3 37 4,1 4653 8,3
Ségou 8892 16,0 83 9,2 8975 15,9
Mopti 2276 4,1 4 0,4 2280 4,0
Tombouctou 943 1,7 24 2,7 967 1,7
Gao/Kidal 1239 2,2 0 0,0 1239 2,2
Bamako 29424 53,0 735 81,8 30159 53,5
Total 55482 100 898 100 56380 100
Source : INPS (2014)
Malgré toutes les nouvelles mesures de la sécurité sociale qui est d’une assistance de l’Etat aux
populations qui n’ont pas assez de moyens pour se soigner, excepté les assurances vieillesse et volontaire,
les autres types d’assurances n’ont pas été désagrégés par zone géographique.
Dans ce tableau, sur les 55 482 bénéficiaires de l’assurance vieillesse 53% vivent à Bamako, 16% à
Ségou, 8,3 à Sikasso, 8,1% à Kayes ; 6,5% à Koulikoro et 4,1% à Mopti. Les 3 régions du nord se
répartissent les 3,9%.
En ce qui concerne l’assurance volontaire, parmi les bénéficiaires plus de 80% se trouvent à Bamako.
Les régions de Ségou et de Sikasso se suivent toujours avec respectivement 9,2% et 4,1%. Les régions
de Mopti et de Kayes n’ont que 0,6% de bénéficiaires de l’assurance volontaire (dont 0,4% à Mopti et
0,2% pour Kayes). On n’observe pas la présence de bénéficiaires de l’assurance volontaire dans les
régions de Gao et Kidal.
Pour bénéficier des avantages, l'assuré doit avoir versé des cotisations pendant au moins 6 mois
consécutifs. Souvent les gens ne sont pas informés sur les différents critères d’adhésion.
Les régions comme Kayes, Koulikoro, Sikasso, Tombouctou, Mopti, Kidal et Gao sont de plus en plus
désintéressées. Les raisons sont à la fois multiples. Elles sont parfois liées à l’aspect démographique,
politique, économique, social et même culturel. Beaucoup d’actifs occupés ignorent les formalités de
demande d’adhésion, le manque de formation adéquate des structures chargées des personnes assurées.
 |
50 50 |
▲back to top |
43
Tableau 37. Répartition des bénéficiaires par âge
Tranche d’Age Assurés Actifs Prestations
familiales
Assurances
Vieillesse
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Moins de 15 ans 18 0,01 0 0,00 28 0,05 46 0,01
15 - 24 ans 3732 2,01 219 0,28 45 0,08 3996 1,25
25 - 39 ans 75856 40,80 28039 35,39 916 1,65 104811 32,69
40 - 54 ans 76256 41,02 41444 52,31 5912 10,66 123612 38,55
55 - 64 ans 20934 11,26 8812 11,12 19124 34,47 48870 15,24
65 ans et plus 9120 4,91 712 0,90 29457 53,09 39289 12,25
Total 185916 100 79226 100 55482 100 320624 100
Source : INPS (2014)
A la lumière de ce tableau, la part des assurés actifs est plus importante par rapport aux autres
bénéficiaires. La répartition des assurés actifs nous montre que 41,02% ont un âge compris entre 40 et
54 ans, 40,80% se trouvent dans la tranche d’âge 25-39 ans et 11,26% dans la tranche 55-64 ans. Les
moins de 25 ans représentent un peu plus de 2% de l’effectif total des assurés actifs et les 65 ans et plus
représente 4,91% du même effectif.
Concernant les bénéficiaires des prestations familiales, le plus grand nombre a toujours été observé au
niveau de la tranche d’âge 40-54 ans, suivies de la tranche 25-39 ans avec 35,39% et de la tranche 55-64
ans.
Contrairement aux deux précédents, parmi les bénéficiaires de l’assurance vieillesse 53,09% ont un âge
d’au moins 65 ans et 34,47% ont l’âge compris entre 55-64 ans et 10,66% ont l’âge compris entre 40-54
ans. On constate également la présence timide des moins de 15 ans.
 |
51 51 |
▲back to top |
44
5. Dialogue social
Depuis janvier 2014, la mise en œuvre de la Politique Nationale du Travail (PNT) a été dominée par les
activités ci-après :
– l’élaboration de politiques et programmes, et de la législation et réglementation afférentes ;
– le renforcement du dialogue social ;
– la protection et l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs des secteurs
public, parapublic et privé ;
– l’amélioration des conditions de vie des agents contractuels de l’Etat ;
– le suivi de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants ;
– le retour de l’administration dans les trois (3) régions du nord ;
– la poursuite des activités régaliennes des services du travail.
La gestion des conflits collectifs du travail, l’actualisation des conventions collectives, l’évaluation du
Pacte de Solidarité pour la Croissance et le Développement de 2001 et la création d’un Conseil National
du Dialogue Social ont constitué les activités phares dans ce domaine.
5.1. La gestion des conflits collectifs
La Direction Nationale du Travail et ses services déconcentrés ont eu à connaitre, au cours de l’année
2014, plusieurs conflits collectifs de travail.
Les plus importants avaient été enclenchés par les organisations représentatives suivantes :
Section Nationale des Mines et des Industries (SECNAMI) UNTM du 24 janvier 2014 ;
Section Nationale des Mines et des Industries (SECNAMI) UNTM du 18 février 2014 ;
Section Syndicale des travailleurs permanents de PMU-Mali en mai 2014 ;
Préavis de grève déposés par le syndicat des travailleurs de SECURICOM, les 4 et 13 mars 2014 ;
Section Syndicale de Team Call Center en juillet 2014 ;
Section Syndicale de Ingelec en juillet 2014 ;
Section Syndicale de SUKALA S.A du 26 septembre 2014 ;
Syndicat des travailleurs de G4S en août et septembre 2014 ;
SECNAMI le 10 novembre 2014 ;
Comité syndical des travailleurs de China Road and Bridge Corporation (CRBC) en mai 2014 ;
La Direction Nationale du Travail a également contribué à la résolution de plusieurs conflits collectifs
dans le secteur public, par le biais des membres du comité du dialogue social. Les activités menées dans
ce cadre font l’objet d’un rapport spécifique au niveau du Ministère.
 |
52 52 |
▲back to top |
45
5.2. La relecture des conventions collectives et accords d’établissements
La DNT a poursuivi avec les partenaires sociaux l’exécution du programme de révision des conventions
collectives de travail avec la convention collective des chauffeurs et conducteurs, la convention collective
des banques, assurances et établissements financiers et a eu à faire des observations sur un certain nombre
d’accords d’établissements notamment ceux des structures suivantes :
- Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) ;
- Manutention Africaine Mali ;
- Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) ;
- ATOSS, Etablissement d’Enseignement « Liberté » ;
- Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ;
- Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale (ANTIM) ;
- Agence Nationale de la Météorologie (Mali-Météo) ;
- Office du Niger ;
- Fonds Auto-Renouvelable pour l’Emploi (FARE).
5.3. L’évaluation du Pacte de Solidarité pour la Croissance et le Développement
(PSCD) de 2001
Un consultant national a été commis pour évaluer le Pacte de Solidarité pour la Croissance et le
Développement conclu en 2001 avec les partenaires sociaux. Le consultant ayant déposé son rapport
provisoire, l’atelier de validation a eu lieu en septembre 2014.
5.4. La création d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS)
En vue de renforcer le dialogue social, la DNT a transmis au département en septembre 2014 le projet de
décret portant création du Conseil National du Dialogue Social (CNDS).
Tableau 38. Répartition des litiges individuels selon la région
Régions Nombre de
litiges soumis
Nombres de litiges
réglés en conciliation
Nombres de litiges
transmis au Tribunal
Litiges classés sans
suite ou en instance
Kayes 247 222 19 06
Koulikoro 152 134 09 09
Sikasso 61 19 41 01
Ségou 60 32 24 04
Mopti 41 31 06 04
Tombouctou 08 07 01 00
Gao 14 01 11 02
Kidal 02 02 - -
Bamako 799 447 312 40
Total 1 384 895 423 66
Source : DNT (2014)
Le litige étant un différend entre deux ou plusieurs personnes, les uns contestant aux autres d'être
titulaires d'un droit à l'exercice duquel ils prétendent. Les modalités sont diverses : le harcèlement, la
 |
53 53 |
▲back to top |
46
discrimination, le licenciement c’est-à-dire des litiges peuvent opposer un employeur et son salarié à
l'occasion des relations de travail : contestation autour d'heures supplémentaires à assurer, de congés.
A l’analyse de ce tableau, on constate qu’il y a eu 1384 litiges soumis dont 895 ont été réglés en
conciliation (soit 55,6%), 423 transmis au tribunal et enfin 66 sont classés sans suite ou en instance. A
Bamako, parmi les 799 litiges soumis, 447 réglés en conciliation et 312 litiges sont transmis au tribunal
et 40 autres classés sans suite ou en instance. Dans la première région, presque 90% des litiges soumis
sont réglés en conciliation, à Koulikoro 88,2% des litiges soumis sont réglés en conciliation, à
Tombouctou 87,5% et à Mopti 75,6% sont réglés en conciliation. Dans la région de Kidal, tous les litiges
ont été gérés par conciliation.
De façon générale, nous constatons une grande satisfaction en termes de litiges réglés en conciliation,
soit 64,5%. De même, le pourcentage des litiges classés sans suite ou en instance est pratiquement
faible dans toutes les régions.
Tableau 39. Répartitions des conflits collectifs par branche d’activité économique, le cercle, par nombre
de journées perdues et qualification professionnelle des travailleurs
Régions Branche d’activité
économique
Nombre
de
conflits
Temps
perdus
Qualification professionnelle
Cadres
supérieurs
Cadres
moyens
Ouvriers Manœuvres Total
Kayes (Sadiola
et Yatela)
Mines 1 3 224
heures
3 48 102 51 204
Koulikoro
(Dioila)
Bâtiments et
Travaux publics
1 720
heures
- - 10 20 30
Sikasso Néant
Ségou (Niono) Industrie
manufacturière
1 50 000
heures
27 121 643 2 334 3 125
Mopti Néant
Tombouctou Néant
Gao Néant
Kidal Néant
Bamako 13 752 h - 3 42 10 55
Industries 2 - - - 5 3 8
BTP 1 96h - 1 5 - 6
Commerces, Hôtels
et Restaurants
2 64h -
Banques et
Etablissements
financiers
3 - - - - - -
Transport, entrepôt
et communication
1 64h - - 4 4 8
Services fournis à la
collectivité, services
sociaux
4 528h - 2 28 3 33
Total General : 16 55448 30 172 797 2 415 3414
Source : DNT (2014)
Au regard de ce tableau, on constate qu’en 2014 il y a seize (16) conflits collectifs aux risques de 3414
individus et qui a coûteux en terme de temps de travail 55 448 heures. Parmi les seize (16) conflits,
Bamako à lui seul enregistre treize (13) conflits dont quatre (4) dans le domaine des services fournis,
trois (03) en banques et établissements financiers, deux (2) dans les commerces, hôtels et restaurants et
 |
54 54 |
▲back to top |
47
dans les industries et un (01) en BTP et en transport, entrepôt et communication. Les régions de Kayes,
Koulikoro et Ségou ont enregistré chacun un (1) conflit dans les branches d’activités économiques
respectives de mines, BTP et industrie manufacturière.
Concernant la qualification professionnelle des employés en conflits collectifs, on constate le plus grand
nombre de conflits au niveau des manœuvres avec 2415 individus (soit 70,7% de l’ensemble du personnel
en conflit), qui sont suivis des ouvriers (797) et les cadres moyens (172). Les cadres supérieurs ne
représentent que 0,9% de l’effectif total du personnel.
Dans la région de Koulikoro, on constate l’absence de cadres (supérieurs et moyens) en conflits collectifs
et surtout moins de temps perdu dans le BTP. Parmi les cadres en conflits collectifs, la quasi-totalité sont
de Ségou et seulement trois (03) à Kayes. C’est pourquoi, parmi les 55 448 heures de travail perdues,
50 000 heures ont été perdues dans la région de Ségou. En définitif, le plus grand nombre d’individus en
conflits collectifs a été observé au niveau de la région de Ségou.
Au total, 22 préavis de grève ont été déposés par les syndicats en 2014 dont 12 ont été observés, 6 levés
et 4 suspendus (annexe 2). La centrale syndicale, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali a déposé
2 préavis de grève dont 1 a été observé durant 48 heures et l’autre levé.
Comparativement aux syndicats des autres branches d’activités économiques, la plupart des préavis de
grèves a été déposée par les syndicats de l’Education Nationale. En général, la durée des grèves se situe
entre 48 et 72 heures aux niveaux des différents syndicats.
 |
55 55 |
▲back to top |
48
6. Migration internationale du travail au Mali
Dans son acception la plus élémentaire, la migration désigne le fait pour un individu de changer
volontairement2 de lieu de résidence habituelle. Ce déplacement se produit, généralement, à l'issue d'une
décision personnelle ou familiale pour un motif généralement économique. D'où le vocable migration du
travail.
Il est nécessaire d'élargir le concept en introduisant d'autres variables comme l'espace et le temps afin de
mieux étudier ce changement de résidence qu'est la migration. En considérant un espace géographique
donné, tout déplacement à l’intérieur de cet espace devient une migration interne. Lorsque le changement
de résidence s’effectue en dehors de cet espace, on parle alors de migration internationale3. Cependant,
la prise en compte de la seule variable spatiale paraît insuffisante pour bien étudier le phénomène. Il est
indispensable d’inclure le facteur temps en se fixant une date ou une période de référence. Une durée
d'au moins six mois est généralement utilisée comme période de référence dans la plupart des enquêtes
qui se sont intéressées au phénomène au Mali. Ainsi, la migration peut être définie comme un changement
d'un lieu de résidence habituelle pour une durée d'au moins six mois. L'individu qui effectue une
migration est appelé migrant. Par rapport à l'entité de départ ou de destination, il est nommé émigrant
ou immigrant.
En considérant les limites d'un pays, les migrants internes sont tous les individus dont le déplacement
s'effectue à l'intérieur du territoire national. Lorsque l'origine ou la destination est en dehors du territoire
national, on parle alors de migration internationale. Les individus qui effectuent ce déplacement sont
appelés immigrés si l'origine est à l'étranger ou émigrés quand la destination est l'extérieur du pays. Les
migrants de retour sont les personnes qui sont revenues à leur lieu de résidence habituelle après au
moins six mois de résidence ailleurs.
De par sa situation géographique au carrefour des routes marchandes entre le Maghreb et l'Afrique
Subsaharienne, le Mali est un pays de tradition migratoire. Les déplacements se font aussi bien à
l'intérieur du territoire national qu'à l'extérieur. En 2009, le Recensement Général de la Population et de
l'Habitat (RGPH) a dénombré 107 316 émigrés maliens des cinq années ayant précédé le recensement
[Cissé et Doumbia, 2011]. Au cours de la même période, le pays a enregistré le retour de plus de 126 000
migrants dont plus de 90 % en provenance d'un autre pays africain. L'importance de ce flux migratoire
pose le problème de l'insertion des migrants de retour. Pour ce faire, le Gouvernement du Mali, à travers
le CIGEM, a réalisé en 2014 un certain nombre d'activités en faveur de la réinsertion socioéconomique
des migrants de retour. Ainsi, 171 jeunes migrants de retour ont pu bénéficier d'une formation dans divers
domaines.
2 C'est à dire sans conflit ou crainte pour son intégrité physique, auquel cas on parle de réfugiés ou de déplacés.
3 On parle de migration internationale lorsque l’espace choisi coïncide avec un pays.
 |
56 56 |
▲back to top |
49
Aussi, 50 jeunes migrants ont obtenu des bourses d'études dans les écoles, instituts ou centre de formation
de référence en Afrique. Ils suivent des cours dans des domaines comme la géologie, les BTP,
Eaux/hygiène et assainissement, Hôtellerie, Automatisme, etc.
Tableau 40. Répartition des migrants de retour bénéficiaires de formation en 2014 par domaine
Domaine Effectif %
Hôtellerie/restauration 45 26,3
Carrelage/Maçonnerie 27 15,8
Santé 2 1,2
Transport urbain (avec tricycle) 8 4,7
Elevage bovine 30 17,5
Boucherie 12 7,0
Electricité 21 12,3
Mécanique auto 20 11,7
Teinture-batik-couture 3 1,8
Formations spécifiques (CREE, GERME) 3 1,8
Total Formation Professionnelle 171 100
Bourses d'études 50 -
Source : CIGEM (2014)
Dans le domaine de l'emploi, le CIGEM a pu insérer, à travers l'intermédiation, 20 jeunes migrants auprès
des employeurs et octroyer des Kits d'installation dans différents métiers de l'artisanat. Il s'agit, entre
autres, des emboucheurs (28,6 %), des mécaniciens moto et maçons (19,0 % chacun), etc. Dans le cadre
de la coopération avec le royaume d'Espagne, le CIGEM a également obtenu des contrats saisonniers
pour 29 jeunes. Afin de favoriser leur installation à leur propre compte, 2 500 jeunes ont bénéficié d'un
appui à la définition de projets.
Tableau 41. Répartition des migrants de retour ayant bénéficié la formation et Kits d’installation en 2014
par domaine
Effectif %
Octroi Kits d'installation
Carreleurs 15 14,3
Mécaniciens moto (montage et réparation) 20 19,0
Boucher 12 11,4
Emboucheurs 30 28,6
Conducteurs de tricycles 8 7,6
Maçons 20 19,0
Total 105 100
Intermédiation et Appui
Contrat de travail 20
Contrat saisonnier en Espagne 29
Appui à la définition de projets 2 500
Source : CIGEM (2014)
 |
57 57 |
▲back to top |
50
Conclusion et recommandations
1. Conclusion
Les données collectées dans le cadre de l’élaboration de ce rapport ont permis dans une certaine mesure
de constater les efforts fournis par les structures publiques et privées dans la réalisation des missions qui
leurs sont confiées. Ces données sont loin d’être exhaustives. Nous n’avons pas pu obtenir les données
de certaines structures et pour d’autres les données sont incomplètes ou souvent inexistantes.
L’enseignement supérieur aussi bien que l’enseignement technique et professionnel connaît des pléthores
d’effectifs surtout dans les filières tertiaires. Les filières techniques et scientifiques enregistrent peu
d’étudiants. Ce déséquilibre n’est pas sans conséquence sur le marché du travail. Malgré le nombre élevé
de demande d’emploi par rapport aux offres (16 159 demandes contre 6 396 offres), en 2014, seulement
53% des offres d’emplois enregistrées par l’ANPE et les bureaux privés ont été satisfaites. Les résultats
de l’enquête nationale sur l’emploi font ressortir également l’importance du chômage suivant le niveau
d’instruction (25,5% pour le niveau supérieur contre 17,1% pour le niveau secondaire).
Ces déséquilibres entre l’offre et la demande de travail persistent malgré les multiples initiatives prises
par les plus hautes autorités. Parmi ces mesures, nous pouvons citer le programme emploi jeune dont la
mise en œuvre de la 2ème phase a démarré en 2011, les politiques nationales mises en œuvre dans le
domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. En plus de ces mesures, la mise en œuvre des
recommandations ci-dessous pourrait réduire le niveau de déséquilibre.
2. Recommandations
Les quelques données collectées pour la réalisation de ce rapport ont permis de faire ces quelques constats
qui sont loin d’être exhaustifs. A la lumière de ces constats, les recommandations suivantes peuvent être
formulées :
- sensibiliser les jeunes à s’orienter vers les filières professionnelles techniques ;
- diversifier les filières de formation tertiaire en fonction des besoins du marché du travail ;
- réaliser régulièrement des études sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires des programmes
de formation professionnelle mise en œuvre par le FAFPA, la DNFP, les projets et les ONG.
 |
58 58 |
▲back to top |
51
ANNEXES
 |
59 59 |
▲back to top |
52
Annexe 1 : Nombre de préavis de grèves par les syndicats en 2014
N° Syndicats Date de la conciliation Durée de la
grève
Observations
1 CEN-SNESUP 08-janv-14 48 heures
72 heures Puis
illimitée.
Mot d’ordre levé
2 SNEC/SUPERIEUR 24-janv-14 48 heures puis
72 heures
Mot d’ordre levé
3 Institut National de formation en Sciences de
la Santé (INFSS)
Mardi 28 janvier 2014 48 heures Mot d’ordre suspendu
4 Bureaux Exécutifs Nationaux du SNS-AS-PF,
du SYNACAM et du SYMEMA
Lundi 17 février 2014 48 heures Mot d’ordre observé
5 Comité SNESUP/Faculté Histoire et
Géographie
Dimanche 16 mars 2014 48 heures Mot d’ordre observé
6 Institut National de formation en Sciences de
la Santé (INFSS)
06-mai-14 72 heures Mot d’ordre observé
7 Comité SNESUP de la Faculté des Sciences et
Techniques (FST) et de l’Institut des Sciences
Appliquées (ISA)
Mot d’ordre suspendu
8 Comité syndical Agence pour la Promotion
des Investissements au Mali (API –MALI).
Mot d’ordre observé
9 Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires
Etrangères (SYLTAE)
03-oct-14 48 heures Mot d’ordre suspendu
10 Comité syndical du Centre National d’Appui
à la Lutte contre la maladie (CNAM)
30-août-14 Illimitée Mot d’ordre observé
11 Comité SNESUP/IUG Initialement prévue pour
le 29 sept. n’a eu lieu
que le 16 octobre 2014
48 heures 72
heures
Mot d’ordre observé
12 Comité SNESUP/PMOS-FAPH 1er octobre 2014 48 heures Mot d’ordre suspendu
13 Coordination des Syndicats de
l’Enseignement Secondaire (COSES)
Prévue pour le vendredi
17 octobre mais reporté
au 22 octobre 2014
72 heures Mot d’ordre observé
14 Syndicat national de l’Education de Base
(SYNEB)
Lundi 03 octobre 2014 72 heures Mot d’ordre observé
15 Section Syndicale des Domaines et du
Cadastre
48 heures Mot d’ordre observé
16 Section Syndicale des Domaines et du
Cadastre
72 heures Mot d’ordre observé
17 Union Nationale des travailleurs du Mali
(UNTM)
Vendredi 15 août 2014 48 heures Mot d’ordre observé
18 Union Nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM)
Lundi 20 6 jours nég. 48 heures Mot d’ordre levé
19 Comité –SNESUP du Centre Régional de la
Recherche Agronomique (CRRA)
48 heures Mot d’ordre observé
20 ORTM Jeudi 04 déc. 2014 48 heures Mot d’ordre levé
21 Surveillants de Prison Mot d’ordre levé
22 CENOU Mot d’ordre levé
Source : Cabinet du Ministère de la Fonction Publique
 |
60 60 |
▲back to top |
53
Annexe 2 : Ventilation des litiges individuels
Régions Nature des litiges Nombre
de Litiges
soumis
Litiges réglés
en
conciliation
Litiges
transmis au
Tribunal
Litiges Classés
sans suite ou en
instance
Kayes Salaires et accessoires 20 19 02 -
Préavis 52 47 02 03
H. sup. 01 01 - -
Bulletins de paie 01 01 - -
Indemnités de licenciements 113 103 09 01
Congés payés 42 37 05 -
Maladies 03 03 - -
Divers 15 11 03 01
Total : 247 222 19 06
Koulikoro
Salaires et accessoires 36 29 02 05
Préavis 26 25 - 01
Certificat de travail 10 10 - -
Maladies 01 01 -
Congés payés 21 20 - 01
Bulletins de paie 10 10 - -
Licenciements et indemnités
de licenciement
43 36 05 02
Divers 05 03 02 -
Total : 152 134 09 09
Sikasso
Salaires et accessoires 40 07 33 -
Préavis 13 03 10 -
Heures supplémentaires 01 01 00 -
Congés payés 12 01 11 -
Licenciements et indemnités de
licenciement
16 02 14 -
Divers 25 14 11 -
Total : 107 28 79 -
Ségou
Salaires et accessoires de salaire 13 04 07 02
Préavis 07 04 03 00
Heures supplémentaires 04 00 04 00
Indemnités de précarité 06 05 01 00
Congés payés 08 06 02 00
Licenciements et indemnité de
licenciement
27 15 10 02
Divers 17 07 10 04
Total : 82 41 37 08
Mopti Non déterminé
Tombouctou Salaires et accessoires de salaire 03 02 01 00
Préavis 02 02 - -
Bulletins de paie 02 02 - -
Congés payés 01 01 - -
Total : 08 07 01 00
Gao
Salaires et accessoires 11 01 08 02
Préavis 11 01 08 02
Licenciement et indemnité de
licenciement
11 01 08 02
Total 33 03 24 06
Kidal Reprise des relations de travail 02 02 - -
Total : 02 02 - -
Bamako Salaires et accessoires 390 262 128 -
Préavis 376 176 200 -
Heures supplémentaires 11 03 08 -
 |
61 61 |
▲back to top |
54
Régions Nature des litiges Nombre
de Litiges
soumis
Litiges réglés
en
conciliation
Litiges
transmis au
Tribunal
Litiges Classés
sans suite ou en
instance
Repos hebdomadaire 01 00 01 -
Indemnités de déplacement 04 04 00 -
Congés payés 402 211 191 -
Licenciements et indemnités de
licenciement
375 224 151 -
Départ négocié 05 05 00 -
Certificats de travail 472 242 230 -
Cotisations INPS 36 19 17 -
Dommages-intérêts 232 00 232 -
Indemnités spécial 174 139 35 -
Divers 74 42 32 -
Total : 2 552 1 327 1 225 -
Total Général 3 183 1 764 1 433 29
Source : DNT
Copyright @ 2024 | ONEF .