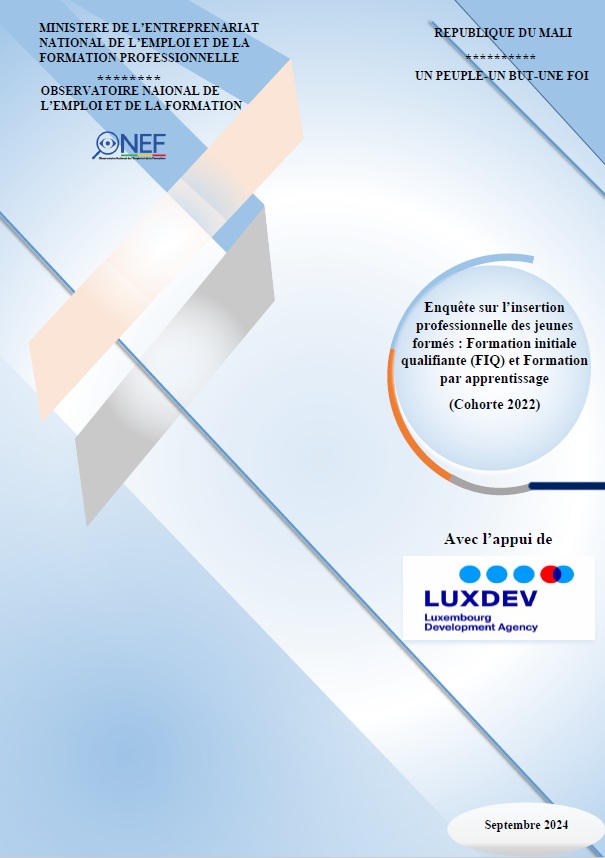Avec l’appui de MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA...
 |
Avec l’appui de MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA... |
 |
1 1 |
▲back to top |
Avec l’appui de
MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT
NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
OBSERVATOIRE NAIONAL DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
********
********
****
REPUBLIQUE DU MALI
**********
* UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
Enquête sur l’insertion
professionnelle des jeunes
formés : Formation initiale
qualifiante (FIQ) et Formation
par apprentissage
(Cohorte 2022)
Septembre 2024
 |
2 2 |
▲back to top |
i
Table des matières
LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................ii
LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................ iv
LISTE DES ANNEXES ........................................................................................................................ iv
LISTE DES SIGLES .............................................................................................................................. v
RESUME EXECUTIF ........................................................................................................................... 6
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 8
1. METHODOLOGIE ...................................................................................................................... 10
1.1. Bases de données ............................................................................................................ 10
1.2. Collecte des données ...................................................................................................... 10
1.3. Supervision de la collecte des données..................................................................... 11
1.4. Traitement, analyse et production du rapport provisoire d’enquête .................. 12
2. RESULTATS DE L’ENQUETE ................................................................................................ 13
2.1. Profils sociodémographiques des jeunes formés en 2022 ................................... 13
2.2. Formation des jeunes de la cohorte 2022 .................................................................. 16
2.3. Situation professionnelle actuelle des jeunes de la cohorte 2022 ...................... 51
CONCLUSION .................................................................................................................................. 121
RECOMMANDATIONS ................................................................................................................... 122
ANNEXES .......................................................................................................................................... 123
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................................ 124
 |
3 3 |
▲back to top |
ii
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Répartition de la cible prévue par localité et type de formation................................................................................. 10
Tableau 2: Tableau récapitulatif de la situation générale de la collecte ...................................................................................... 11
Tableau 3: Répartition des jeunes formés selon la localité de résidence actuelle et la tranche d’âge ........................................ 13
Tableau 4: Répartition des jeunes formés selon la localité de résidence actuelle et le sexe ...................................................... 13
Tableau 5: Répartition des jeunes formés selon le niveau d’instruction avant la formation et le sexe ........................................ 14
Tableau 6: Répartition des jeunes formés selon le niveau d’instruction avant la formation et la tranche d’âge .......................... 14
Tableau 7: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le statut matrimonial et le sexe .......................................................... 15
Tableau 8: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le statut matrimonial et la tranche d’âge ............................................ 15
Tableau 9: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et le sexe .......................................................... 16
Tableau 8: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et la tranche d’âge ............................................. 17
Tableau 9: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et la localité ....................................................... 17
Tableau 10: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et la filière ........................................................ 18
Tableau 11: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et le métier ...................................................... 18
Tableau 12: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et le niveau d’instruction avant la formation ..... 19
Tableau 13: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le choix de la formation et le sexe ................................................... 19
Tableau 14: Proportion des jeunes formés en 2022 selon le choix de la formation et le niveau d’éducation avant la formation . 20
Tableau 15: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et la localité ......................................................... 43
Tableau 16: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le niveau d’instruction avant la formation ......... 43
Tableau 17: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le type de formation ......................................... 44
Tableau 18: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et la filière ........................................................... 44
Tableau 19: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le métier .......................................................... 45
Tableau 20: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et la localité ...................................... 45
Tableau 21: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et le niveau d’instruction avant la
formation ................................................................................................................................................................................... 46
Tableau 22: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et la filière ......................................... 46
Tableau 23: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et le type de formation ...................... 47
Tableau 24: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et le métier ....................................... 47
Tableau 25: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan d’affaire selon le
sexe et la localité ....................................................................................................................................................................... 48
Tableau 26: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan d’affaires selon le
sexe et le niveau d’instruction avant la formation ....................................................................................................................... 49
Tableau 27: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan d’affaire selon le
sexe et la filière ......................................................................................................................................................................... 49
Tableau 28: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan d’affaire selon le
sexe et le type de formation ...................................................................................................................................................... 50
Tableau 29: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan d’affaire selon le
sexe et le métier ........................................................................................................................................................................ 50
Tableau 30: Taux d’insertion avec un revenu décent par localité et sexe................................................................................... 54
Tableau 31: Taux d’insertion avec un revenu décent par métier et sexe .................................................................................... 54
Tableau 32: Répartition des jeunes en emploi par localité et sexe ............................................................................................. 56
Tableau 33: Répartition des jeunes en emploi par localité et type de formation ......................................................................... 57
Tableau 34: Répartition des jeunes en emploi par localité et filière ............................................................................................ 58
Tableau 35: Proportion des jeunes en emploi par localité et métier ........................................................................................... 58
Tableau 36: Répartition des jeunes en emploi par localité et la tranche d’âge ........................................................................... 59
Tableau 37: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et le sexe .................................................................. 59
Tableau 38: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et la filière ................................................................. 60
Tableau 39: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et le type de formation .............................................. 61
Tableau 40: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et le sexe ........................................................... 61
Tableau 41: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et le type de formation ....................................... 62
Tableau 42: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et le métier ......................................................... 62
Tableau 43: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et la filière .......................................................... 63
Tableau 44: Répartition des jeunes en emploi selon la localité et le statut dans l’activité ........................................................... 63
Tableau 45: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et le statut dans l’activité ........................................... 64
Tableau 46: Répartition des jeunes en emploi selon le métier et le sexe ................................................................................... 64
Tableau 47: Répartition des jeunes en emploi selon le métier et la localité................................................................................ 65
Tableau 48: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et le sexe .................................................................................. 66
Tableau 49: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et le type de formation .............................................................. 66
Tableau 50: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et la filière ................................................................................. 67
Tableau 51: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et le statut dans l’activité........................................................... 67
Tableau 52: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le sexe ............................................. 68
Tableau 53: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le maillon.......................................... 69
Tableau 54: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et la filière ............................................ 69
Tableau 55: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le métier ........................................... 70
Tableau 56: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le statut dans l’activité ...................... 70
Tableau 57: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le sexe........................................................................ 71
Tableau 58: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et la tranche d’âge .......................................................... 71
Tableau 59: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le type de formation .................................................... 71
Tableau 60: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et la filière ....................................................................... 72
Tableau 61: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le maillon .................................................................... 72
 |
4 4 |
▲back to top |
iii
Tableau 62: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et la localité .................................................................... 73
Tableau 63: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le métier ..................................................................... 74
Tableau 64: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le statut dans l’activité ................................................ 74
Tableau 65: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et sexe ............................................................................... 75
Tableau 66: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et filière .............................................................................. 75
Tableau 67: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et métier ............................................................................ 76
Tableau 68: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et type de formation ........................................................... 76
Tableau 69: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et maillon ........................................................................... 77
Tableau 70: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et la tranche d’âge ............................................................. 77
Tableau 71: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et statut dans l’activité ....................................................... 78
Tableau 72: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le sexe ................................................................ 78
Tableau 73: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le type de formation ............................................ 79
Tableau 74: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et la filière ............................................................... 79
Tableau 75: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le métier ............................................................. 80
Tableau 76: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le maillon ............................................................ 81
Tableau 77: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et la tranche d’âge .................................................. 81
Tableau 78: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et sexe ................................................... 82
Tableau 79: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et type de formation ............................... 82
Tableau 80: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et filière de formation ............................. 83
Tableau 81: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et tranche d’âge ..................................... 85
Tableau 82: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et statut dans l’activité ............................ 86
Tableau 83: Répartition des jeunes en emploi par type d’entreprise et sexe .............................................................................. 86
Tableau 84: Proportion des jeunes en emploi par type d’entreprise et type de formation ........................................................... 87
Tableau 85: Répartition des jeunes en emploi par type d’entreprise et filière ............................................................................. 87
Tableau 86: Proportion des jeunes en emploi par type d’entreprise et métier ............................................................................ 88
Tableau 87: Répartition des jeunes en emploi par type d’entreprise et maillon .......................................................................... 88
Tableau 88: Proportion des jeunes en emploi par type d’entreprise et la tranche d’âge ............................................................. 89
Tableau 89: Répartition des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le sexe ............................................................... 89
Tableau 90: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le type de formation ............................................ 90
Tableau 91: Répartition des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et la filière .............................................................. 90
Tableau 92: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le métier ............................................................. 91
Tableau 93: Répartition des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le maillon ........................................................... 92
Tableau 94: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et la tranche d’âge.................................................. 92
Tableau 95: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le statut dans l’activité ........................................ 93
Tableau 96: Répartition des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le sexe ................................................... 93
Tableau 97: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le type de formation ................................ 94
Tableau 98: Répartition des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et la filière .................................................. 94
Tableau 99: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le métier (%) ........................................... 95
Tableau 100: Répartition des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le maillon ............................................. 95
Tableau 101: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et la tranche d’âge .................................... 95
Tableau 102: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le statut dans l’activité ........................... 96
Tableau 103: Durée moyenne d’accès au premier emploi par sexe et type de formation (mois) ................................................ 96
Tableau 104: Durée moyenne d’accès au premier emploi par filière et sexe (mois) ................................................................... 97
Tableau 105: Durée moyenne d’accès au premier emploi par métier et sexe (mois) ................................................................. 97
Tableau 106: Durée moyenne d’accès au premier emploi par maillon et sexe (mois) ................................................................ 98
Tableau 107: Durée moyenne d’accès au premier emploi par tranche d’âge et sexe (mois) ...................................................... 98
Tableau 108: Durée moyenne d’accès au premier emploi par statut dans l’activité et sexe (mois) ............................................ 99
Tableau 109: Répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et sexe .............................................................. 99
Tableau 110: Répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le type de formation ..................................... 100
Tableau 111: Répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et la filière ....................................................... 100
Tableau 112: Proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le maillon ..................................................... 102
Tableau 113: Proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et statut dans l’activité ...................................... 102
Tableau 114: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le sexe (%) ..................................................................... 103
Tableau 115: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon la localité (%) .................................................................. 104
Tableau 116: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le niveau d’instruction avant la formation (%) .................. 104
Tableau 117: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le type de formation (%) .................................................. 105
Tableau 118: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon la filière (%) .................................................................... 106
Tableau 119: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le métier (%) ................................................................... 106
Tableau 120: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le statut dans l’activité (%) .............................................. 107
Tableau 121: Répartition des jeunes au chômage par localité et sexe ..................................................................................... 108
Tableau 122: Répartition des jeunes au chômage par tranche d’âge et sexe .......................................................................... 109
Tableau 123: Répartition des jeunes au chômage par statut matrimonial et sexe .................................................................... 109
Tableau 124: Répartition des jeunes au chômage par type de formation et sexe .................................................................... 110
Tableau 125: Répartition des jeunes au chômage par filière de formation et sexe ................................................................... 110
Tableau 126: Répartition des jeunes au chômage par métier de formation et sexe ................................................................. 111
 |
5 5 |
▲back to top |
iv
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Proportion des jeunes formés en 2022 selon le choix de la formation et la localité ............................................................................. 20
Graphique 2 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation formés ayant acquis des compétences par sexe ........................ 21
Graphique 3 : Proportion des producteurs laitiers formés ayant acquis des compétences par sexe .......................................................................... 22
Graphique 4 : Proportion des producteurs de cultures fourragères formés ayant acquis des compétences par sexe ............................................... 23
Graphique 5 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence formés ayant acquis des compétences par sexe 24
Graphique 6 : Proportion des éleveurs laitiers formés ayant acquis des compétences par sexe ............................................................................... 25
Graphique 7 : Proportion des maintenanciers d’équipement agricole formés ayant acquis des compétences .......................................................... 26
Graphique 8 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation formés exploitant présentement des compétences acquises par
sexe ............................................................................................................................................................................................................................... 27
Graphique 9 : Proportion des producteurs laitiers formés exploitant présentement des compétences acquises ....................................................... 28
Graphique 10 : Proportion des producteurs de fourrage formés exploitant présentement des compétences acquises par sexe .............................. 29
Graphique 11 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence formés exploitant présentement des
compétences acquises par sexe ................................................................................................................................................................................... 30
Graphique 12 : Proportion des éleveurs laitiers formés exploitant présentement des compétences acquises par sexe ........................................... 31
Graphique 13 : Proportion des maintenanciers des équipements agricoles formés exploitant présentement des compétences acquises ............... 32
Graphique 14 : Proportion des producteurs de pommes de terre de consommation formés ayant acquis des compétences pour une exploitation
future par sexe .............................................................................................................................................................................................................. 33
Graphique 15 : Proportion des producteurs laitiers formés ayant acquis des compétences pour une exploitation future par sexe ........................... 34
Graphique 16 : Proportion des producteurs de fourrage formés ayant acquis des compétences pour une exploitation future par sexe .................. 35
Graphique 17 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence formés ayant acquis des compétences pour une
exploitation future par sexe ........................................................................................................................................................................................... 36
Graphique 18 : Proportion des éleveurs laitiers formés ayant acquis des compétences pour une exploitation future par sexe ................................ 37
Graphique 19 : Proportion des maintenanciers des équipements agricoles formés ayant acquis des compétences pour une exploitation future ... 38
Graphique 20 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par sexe ............................................................................................................ 39
Graphique 21 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par type de formation ........................................................................................ 40
Graphique 22 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par métiers de la filière agropastorale .............................................................. 41
Graphique 23 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par filière agropastorale .................................................................................... 42
Graphique 24 : Taux d’insertion avec un revenu décent par sexe et type de formation .............................................................................................. 52
Graphique 25 : Taux d’insertion avec un revenu décent par filière et sexe ................................................................................................................. 53
Graphique 26 : Taux d’insertion avec un revenu décent par tranche d’âge et sexe .................................................................................................... 53
Graphique 27 : Proportion des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et métier ............................................................................ 84
Graphique 28 : Proportion des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et maillon ........................................................................... 84
Graphique 29 : Proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le métier .................................................................................... 101
Graphique 30 : Proportion des jeunes au chômage selon leur moyen de recherche d’emploi et le sexe ................................................................. 111
Graphique 31 : Proportion des jeunes au chômage selon leur moyen de recherche d’emploi et la localité ............................................................. 112
Graphique 32 : Proportion des jeunes en recherche d’emploi par moyen de recherche d’emploi et type de formation ........................................... 113
Graphique 33 : Proportion des jeunes en recherche d’emploi par moyen de recherche d’emploi et filière de formation ......................................... 114
Graphique 34 : Proportion des jeunes en recherche d’emploi par moyen de recherche d’emploi et tranche d’âge ................................................. 115
Graphique 35 : Proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d’embauche selon le sexe et la localité .................................................. 115
Graphique 36 : Proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d’embauche selon le sexe, la filière et le type de formation ................... 116
Graphique 37 : Proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d’embauche selon le sexe et la tranche d’âge ....................................... 117
Graphique 38 : Taux de de chômage des jeunes par localité et sexe ....................................................................................................................... 118
Graphique 39 : Taux de chômage des jeunes par sexe et tranche d’âge ................................................................................................................. 119
Graphique 40 : Taux de chômage des jeunes par type de formation et sexe ........................................................................................................... 120
Graphique 41 : Taux de chômage des jeunes par filière de formation et sexe .......................................................................................................... 120
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Motifs de travailler plus de 48 heures ou moins de 35 heures................................................................................................................. 123
Annexe 2 : Durée moyenne passée sur le marché du travail ..................................................................................................................................... 123
 |
6 6 |
▲back to top |
v
LISTE DES SIGLES
ANPE Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
APEJ Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
BDD Base de données
CDFMO Convention de délégation de fonds et de mise en œuvre
CREDD Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable
ENS Ensemble
FPA Formation par apprentissage
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine
FIQ Formation initiale qualifiante
LuxDev Lux-Development
Lux-Development Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement
M.A Maitre d’Apprentissage
MEA Maintenance des équipements agricoles
ODD Objectifs pour le développement durable
ONEF Observatoire national de l'Emploi et de la Formation
PAFA II Programme d’appui aux filières agropastorales, phase 2
PNISA Plan national d’investissement dans le secteur agricole
SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SPSS Statistical Package for the Social Sciences
 |
7 7 |
▲back to top |
6
RESUME EXECUTIF
Le Programme d'appui aux filières agropastorales dans la région de Sikasso (PAFA II) qui s’étend sur une période
de quatre ans (janvier 2021 à décembre 2024) vise à augmenter les revenus des exploitations familiales agro-
pastorales au Mali. Cofinancé par la Coopération suisse et la Coopération luxembourgeoise, le programme cible
environ 14 000 exploitations familiales agricoles, avec un accent particulier sur l'insertion professionnelle de 700
jeunes formés dans les filières lait local et pomme de terre. Les principaux objectifs incluent l'amélioration de la
qualité des produits, la professionnalisation des acteurs des filières, et l'amélioration des performances grâce à la
collaboration entre le secteur privé, la société civile, les organisations professionnelles, et les institutions publiques.
Une attention particulière est accordée à l'insertion professionnelle des jeunes, mesurée par des indicateurs tels
que le taux d'insertion avec un revenu décent. Une enquête est menée pour évaluer l'efficacité du dispositif de
formation-insertion des jeunes, en examinant le taux d'insertion, les revenus obtenus, et la situation des jeunes
après leur sortie de formation. La méthodologie de l'enquête implique la collecte de données quantitatives et
qualitatives, sans échantillonnage, auprès de 312 jeunes formés dans les filières lait local et pomme de terre. La
collecte a eu lieu sur une période de quinze jours en novembre 2023, et les résultats sont présentés pour contribuer
à la prise de décisions et à la mise en œuvre de recommandations en vue de garantir la réussite du dispositif de
formation-insertion.
Le profil sociodémographique des jeunes formés en 2022 se caractérise par une diversité géographique, éducative
et matrimoniale. La majorité des jeunes se situe dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, bien que des disparités
significatives existent entre les localités, mettant en évidence des tendances démographiques spécifiques à chaque
localité. En termes de niveau d’éducation académique, le niveau secondaire est le plus répandu, avec des
variations subtiles entre les sexes. Le statut matrimonial montre une corrélation significative avec l'âge, indiquant
une tendance croissante au mariage avec l'avancement de celui-ci. Ces éléments offrent une base essentielle pour
analyser les programmes de formation et l'insertion professionnelle des jeunes de cette cohorte.
La satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par rapport à la formation indique un taux global élevé de 97,8%. Les
aspects les mieux évalués incluent la pertinence des modules, la technique d'animation, et la disponibilité des
formateurs. Les différences entre hommes et femmes sont minimes. Les types de formation, Apprentissage et
Qualifiante, affichent également des taux élevés, avec quelques variations subtiles. La satisfaction varie selon les
métiers de la filière agropastorale, avec des taux élevés pour les producteurs laitiers et de fourrage, mais des
opportunités d'amélioration pour la maintenance des équipements agricoles. Les résultats diffèrent également entre
les filières, avec une satisfaction légèrement plus élevée dans la filière lait local par rapport à la filière pomme de
terre. Globalement, les jeunes sont satisfaits de la formation, mais des ajustements spécifiques peuvent être
envisagés pour optimiser l'expérience de formation.
Le taux d'insertion professionnelle global avec un revenu décent est de 22,9%. Ce taux varie significativement entre
hommes (32,2%) et femmes (6,9%), montrant des disparités entre les sexes dans l'accès aux opportunités d'emploi.
La formation par apprentissage affiche un taux d'insertion plus élevé que la formation qualifiante, soulignant l'impact
significatif du type de formation. Les filières pomme de terre et lait local présentent des différences, avec la pomme
de terre offrant des perspectives d'emploi plus favorables. L'âge influence également le taux d'insertion, les plus
jeunes faisant face à des défis plus importants. Les localités telles que Sikasso montrent des taux plus élevés,
soulignant des disparités régionales. Les métiers de producteur de pomme de terre affichent des taux d'insertion
plus élevés (48,4%) que d’autres comme les métiers d’éleveur laitier (9,6%), suggérant une corrélation entre le
choix de carrière, le sexe et le succès professionnel. L'analyse souligne la nécessité d'approches différenciées pour
promouvoir l'égalité des chances sur le marché du travail.
L'analyse des revenus mensuels moyens des jeunes en emploi révèle des inégalités significatives entre hommes
et femmes, avec une proportion importante d'hommes (34,5%) percevant des revenus élevés par rapport aux
femmes (5,9%). Les disparités persistent également selon le type de formation, la filière de formation, le métier, le
maillon de l'activité agricole, la tranche d'âge, et le statut dans l'activité. Les résultats soulignent l'influence de ces
facteurs sur les opportunités économiques et appellent à des mesures visant à réduire les écarts de revenus et
promouvoir l'équité dans l'emploi.
Les données analysées mettent en évidence des disparités significatives entre les jeunes en emploi en fonction de
leur statut dans l'activité et de leur sexe. Les hommes (86,4% des salariés) sont plus prédominants dans le salariat,
tandis que l’effectif des femmes est important dans l'auto-emploi (17 sur les 52 jeunes en auto-emploi). Une
répartition équilibrée est observée dans les emplois salariés, mais des disparités émergent dans le choix de l'auto-
emploi en fonction du type de formation. Les tendances varient également selon le métier exercé et la filière de
formation. Les jeunes en emploi ont des modes d'insertion professionnelle différents, avec une influence
significative des relations personnelles et familiales. Ces résultats soulignent la nécessité de prendre en compte
ces facteurs dans les politiques d'emploi et de formation.
 |
8 8 |
▲back to top |
7
Globalement, 63,4% sont engagés dans des activités occasionnelles, avec des variations notables entre hommes
et femmes. La majorité des hommes privilégient les activités occasionnelles, tandis que la majorité des femmes
optent pour des activités permanentes. La répartition diffère également selon l'âge, la formation, la filière et la
localité. Les choix d'activité semblent être influencés par la maturité professionnelle, la formation, les opportunités
sur le marché du travail et les contraintes socioculturelles. De plus, l'analyse dévoile des corrélations entre le type
d'activité, le métier, le maillon de la chaîne d'activités, et la localité. Notamment, des tendances marquées sont
observées dans la prédominance d'emplois permanents dans le secteur laitier et la transformation commerciale.
Enfin, la distribution des statuts (salarié, indépendant, auto-emploi) varie selon le type d'activité, soulignant la
diversité des situations professionnelles parmi les jeunes en emploi.
Globalement, la durée moyenne d’accès au premier emploi est de 2 mois pour les hommes et 1 mois pour les
femmes, avec des variations selon la formation. Dans la filière pomme de terre, la durée est uniforme (2 mois) pour
les deux sexes, mais dans la filière lait local, elle est de 1 mois. Pour certains métiers, des variations existent, mais
dans l'ensemble, la durée d'accès au premier emploi semble relativement équivalente entre les sexes. Des nuances
apparaissent selon le statut, indépendamment du sexe, avec une durée de 2 mois pour les salariés, mais des
différences pour les indépendants/employeurs (2 mois pour les hommes, 1 mois pour les femmes) et l'auto-emploi
(1 mois pour les hommes, 2 mois pour les femmes).
Les résultats mettent en lumière des disparités significatives entre hommes et femmes dans la perception de
l'impact de la formation sur l'amélioration de compétences spécifiques, avec des variations selon le domaine
agricole. De plus, des tendances géographiques, des différences en fonction du niveau d'instruction académique
et du type de formation, ainsi que des variations significatives selon la filière, le métier et le statut professionnel
sont observées.
Sur un total de 147 chômeurs, il y a une répartition quasi-équilibrée entre hommes (69) et femmes (78). Les
disparités locales montrent que la majorité des chômeurs se trouvent à Koutiala (34,0%), suivie de Kadiolo (22,4%),
tandis qu'aucun chômeur n'est recensé à Yanfolila. Une analyse détaillée révèle des différences significatives entre
les localités, soulignant la nécessité de stratégies d'emploi différenciées. L'examen par tranche d'âge révèle une
prédominance des femmes chômeurs dans la catégorie de 15 à 24 ans (59,7%), soulignant les défis spécifiques
auxquels font face les jeunes femmes sur le marché du travail. Le statut matrimonial montre que les personnes
mariées représentent la majorité des chômeurs (58,5%), avec une répartition inégale entre hommes et femmes.
Les résultats suggèrent un lien potentiel entre le statut matrimonial et le chômage chez les jeunes. Concernant le
type de formation, la majorité des chômeurs ont suivi une formation qualifiante (79,6%), avec une forte présence
de femmes dans cette catégorie. La filière de la pomme de terre prédomine parmi les chômeurs (61,9%), avec des
variations entre les sexes. Les données indiquent également des disparités significatives entre les métiers de
formation et les sexes des chômeurs, soulignant l'importance de prendre en compte ces facteurs pour concevoir
des stratégies d'emploi ciblées.
En ce qui concerne les canaux de recherche d'emploi, les relations personnelles sont le moyen le plus courant
(74,7%), suivi des petites annonces/médias (32,7%) et de la recherche directe auprès de l'employeur (32,0%). Les
disparités entre les sexes et les localités sont notables, soulignant des variations significatives dans les préférences
des jeunes chômeurs.
L'analyse de la promesse d'emploi indique que 14,9% des jeunes sans emploi en ont une, avec des différences
notables entre les sexes, les localités, le type et la filière de formation. Les jeunes femmes de 15 à 24 ans ont une
proportion plus élevée de promesses d'embauche que les hommes dans la même tranche d'âge. La filière du lait
local présente la plus haute proportion de promesses d'embauche, tandis que la filière de la pomme de terre affiche
une proportion inférieure. Les résultats suggèrent des disparités importantes dans l'accès aux opportunités d'emploi
en fonction de divers facteurs.
Le taux de chômage dans la zone d’intervention du PAFA II, révèle un taux global de 46,7%, avec une disparité
entre les sexes. Les femmes affichent un taux de chômage plus élevé (67,2%) que les hommes (34,7%). Les
variations entre les localités sont notables, avec Sikasso présentant le taux le plus bas (20,2%) et Yorosso le plus
élevé (73,7%). Les tranches d'âge de 15 à 24 ans et 25 à 35 ans, ainsi que les catégories de formation qualifiante
et par apprentissage, montrent des taux de chômage distincts, soulignant l'importance de ces facteurs dans l'emploi
des jeunes. La durée moyenne sur le marché du travail et la répartition par filière de formation ajoutent des nuances
à la compréhension des défis d'emploi spécifiques.
L'évaluation du dispositif de formation-insertion du PAFA II au Mali met en lumière des efforts significatifs, mais des
disparités persistent dans l'insertion professionnelle, les revenus, et la diversité des secteurs. Malgré la satisfaction
des jeunes envers la formation, des ajustements spécifiques sont nécessaires, notamment pour promouvoir une
inclusion plus équitable entre les genres et les filières. Les recommandations ciblent la promotion de la diversité
des métiers, des partenariats industriels, et l'optimisation de la durée de la formation.
 |
9 9 |
▲back to top |
8
INTRODUCTION
D’une durée de quatre ans (janvier 2021 à décembre 2024), la deuxième phase du Programme d’appui
aux filières agropastorales dans la région de Sikasso (PAFA II) est cofinancée à parts égales par la
Coopération suisse et la Coopération luxembourgeoise et couvre les sept cercles de la région de
Sikasso. Son objectif général est de contribuer à l'augmentation du revenu des exploitations
familiales agropastorales, des entreprises et des personnes les plus vulnérables dans le sud du
Mali.
Le programme bénéficie directement d’une part à environ 14 000 exploitations familiales agricoles
(hommes, femmes et jeunes) et vise l’insertion avec des revenus décents pour au moins 700 jeunes
sortant des dispositifs de formation professionnelle initiale. Et d’autre part, il contribue à̀ l’atteinte par le
Mali des Objectifs pour le développement durable, par son alignement au Cadre stratégique pour la
relance économique et le développement durable (CREDD 2019 – 2023), en particulier son axe
stratégique 3 qui vise une croissance inclusive et une transformation structurelle de l’économie. Il
concourt également au Plan national d’investissement dans le secteur agricole (PNISA 2019 – 2023) et
prend en compte la Loi foncière agricole.
Les trois principaux résultats à atteindre dans le cadre du PAFA II se déclinent comme suit :
Résultat 1 : des produits de qualité́ des filières lait et pomme de terre arrivent sur les marchés
de façon compétitive ;
Résultat 2 : les différents maillons des deux filières sont professionnalisés, inclusifs et disposent
de compétences renouvelées ;
Résultat 3 : les performances des filières sont améliorées grâce au secteur privé, à la société
civile, aux organisations professionnelles et aux institutions publiques, chacun dans son rôle.
La grande innovation du programme tient à l’ambition affichée par le second résultat, dont l’atteinte
repose sur l’action conjointe entre les acteurs des filières et ceux de la formation professionnelle, initiale
et continue. L’insertion professionnelle des jeunes formés est également soutenue afin qu’ils puissent
obtenir des revenus décents et durables au sein des chaînes de valeurs du lait local et de la pomme de
terre.
Parmi les dispositifs déployés dans le cadre de ce « Résultat 2 », figure l’apprentissage rénové et la
formation initiale qualifiante. Dans l’optique d’atteindre les changements planifiés dans le cadre de de
ce « Résultat 2 », des ateliers d’identification des besoins de formation ont permis de choisir des
métiers, des maitres d’apprentissage (M.A) et des structures de formation pour l’apprentissage rénové
et la formation initiale qualifiante.
Pour la formation initiale qualifiante, il était prévu en 2022 de former 200 jeunes de 15 à 35 ans dont
50% de jeunes filles aux métiers liés aux filières pomme de terre et lait local. Le lancement des appels
d’offres de formation a permis de sélectionner neuf structures pour la formation de 200 jeunes de 15 à
35 ans dont 44% de jeunes filles. Il était prévu de débuter cette formation vers la fin du mois de
novembre 2022, dans les métiers d’éleveurs laitiers, de producteurs de pomme de terre de
consommation et de semence, et de maintenance des équipements agricoles.
Au niveau de la formation par apprentissage, il était prévu de former en 2022, 140 jeunes de 15 à 35
ans dont 50% de jeunes filles, mais seulement 11,43 % de jeunes filles ont été prises en compte dans
les métiers de producteurs de pomme de terre de consommation, de producteurs laitiers et de
producteurs de fourrage par 35 maîtres d’apprentissage. Il faut rappeler que des conventions de
formation ont été signées par les différentes parties pour ces actions de formation.
Par ailleurs, l’Observatoire national de l'Emploi et de la Formation (ONEF) a signé en août 2021, une
Convention de délégation de fonds et de mise en œuvre (CDFMO) avec LuxDev, l’Agence
 |
10 10 |
▲back to top |
9
luxembourgeoise pour la Coopération au développement, qui couvre les trois programmes mis en
œuvre par l’agence, à savoir le Programme Développement rural et Sécurité alimentaire (MLI/021
Extension) , le Programme Formation et Insertion professionnelle (MLI/022 Extension) et le Programme
d’appui aux filières agropastorales (MLI/026 ,PAFA, phase II). Cette convention de délégation de fonds
et de mise en œuvre confère à l’ONEF le mandat pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Appui
au dispositif national et régional de suivi-évaluation de l’emploi et de la formation
professionnelle ».
Dans le cadre de l’appui au dispositif national et régional de suivi-évaluation de l’emploi et de la
formation professionnelle, l’ONEF renseigne plusieurs indicateurs des trois programmes. La présente
enquête porte sur le renseignement de l’indicateur d’effet intermédiaire 2.1 Résultat 2 du PAFA II,
formulé comme suit : « taux d’insertion professionnelle avec un revenu décent, dans les filières lait local
et pomme de terre, des jeunes ayant suivi un parcours de formation-insertion dans le cadre du
programme, désagrégé par sexe ». Il s’agit à travers cet indicateur de mesurer le taux d’insertion
professionnelle des jeunes ayant suivi un parcours de formation-insertion appuyé par le programme et
qui arrivent à obtenir un revenu d’au moins 75000 FCFA par mois soit (900 000 FCFA par an).
L’indicateur s’intéresse donc à la suite du parcours des jeunes qui ont été formés afin de voir s’ils ont
pu trouver une occupation professionnelle dans les filières lait local et pomme de terre et s’ils arrivent à
obtenir un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins.
Cet indicateur permet de contribuer à l’ODD 8.6.1 Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non
scolarisés et sans emploi ni formation, ainsi que l’ODD 8.7.1 Proportion et nombre d’enfants âgés de 5
à 17 ans qui travaillent, par sexe et âge.
Il est important de souligner que les jeunes inscrits en formation par apprentissage ont achevé leur
formation en mars 2023 et sont donc en ce mois de septembre 2023 à six mois de leur sortie et ceux
en formation initiale qualifiante achèveront leur parcours de formation en fin septembre 2023. A cette
étape du parcours d’insertion, il est évident que tous les changements planifiés ne sont pas encore
atteints. Cependant, l’enquête permettra de mesurer les paramètres pouvant l’être et de disposer de
données susceptibles de mieux percevoir les points positifs et les aspects à améliorer en ce qui
concerne le dispositif d’insertion professionnelle mis en place.
L’objectif global est de contribuer à l’évaluation de l’efficacité du dispositif de formation-insertion des
jeunes mis en place dans le cadre du PAFA II.
De façon spécifique l’enquête vise à :
• mesurer le taux global d’insertion professionnelle des jeunes sortis du dispositif de formation
professionnelle initiale (qualifiante et par apprentissage) appuyés par le programme, désagrégé
par sexe, par filière et par métier ;
• évaluer le revenu mensuel et annuel obtenu par les jeunes (garçons et filles) insérés dans les
métiers des différents maillons des filières lait local et pomme de terre ainsi que dans les métiers
de services liés à ces filières ;
• déterminer la situation des jeunes (garçons et filles) sortants du dispositif de formation
professionnelle initiale (qualifiante et par apprentissage) appuyés par le programme 12 mois
après leur sortie de formation ;
• analyser l’efficacité du dispositif de formation et d’accompagnement à l’insertion professionnelle
des jeunes, mis en place dans le cadre du PAFA II et formuler des recommandations précises.
 |
11 11 |
▲back to top |
10
1. METHODOLOGIE
La méthodologie de réalisation de cette enquête a consisté à collecter les données quantitatives et
qualitatives auprès des jeunes (garçons et filles) sortis du dispositif de formation professionnelle initiale
(qualifiante et par apprentissage) appuyés par le programme d’une part et d’autre part de traiter,
d’analyser les données afin de rédiger un rapport d’enquête tout en proposant des recommandations
aux parties prenantes du dispositif de formation-insertion.
Il est décrit dans cette partie, les processus de réalisation de l’enquête, de la constitution de la base de
données à la collecte des données en passant par l’élaboration du support de collecte et d’analyse de
données ainsi que la production du rapport d’enquête.
1.1. Bases de données
La base de données contenant 312 jeunes issus de la formation initiale qualifiante (FIQ) et par
apprentissage (FPA), a été mise à la disposition de l’ONEF par le Conseil régional de Sikasso, à travers
l’équipe technique de LuxDev. Cette base de données contient des informations permettant de localiser
les jeunes (garçons et filles) sortis du dispositif de formation professionnelle initiale appuyés par le
programme. Ces jeunes ont été formés dans les différents cercle de la région de Sikasso (ancien
découpage territorial) par 35 maitres d’apprentissage dans le cadre de la formation par apprentissage
et 09 structures de formation dans le cadre des FIQ.
De plus, il convient de noter qu'aucun échantillonnage n'a été effectué pour cette enquête. Cette
décision est expliquée dans la fiche d'identité de l'indicateur (fiche n°10 du manuel de suivi-évaluation
du PAFA II), où il est spécifié qu'aucun échantillonnage ne sera réalisé afin d'inclure tous les jeunes
bénéficiaires du parcours de formation-insertion.
Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces jeunes par cercle et type de formation.
Tableau 1: Répartition de la cible prévue par localité et type de formation
Cercle Apprentissage FIQ Ensemble
Bougouni 10 16 26
Kadiolo 16 42 58
Kolondièba 3 20 23
Yanfolila 2 0 2
Koutiala 30 65 95
Yorosso 0 17 17
Sikasso 71 20 91
Total 132 180 312
Source : PAFA BDD Formation et Insertion Professionnelle, LuxDev 2023
1.2. Collecte des données
La collecte des données s’est déroulée dans tous les cercles de l’ancienne région de Sikasso sur une
période de quinze jours, du 16 au 30 novembre 2023. Les données ont été collectées auprès des jeunes
(garçons et filles) sortis du dispositif de formation professionnelle initiale appuyés par le programme.
Pour l’occasion, les enquêteurs formés pendant quatre jours aux techniques de collecte de données,
étaient munis d’un smartphone sur lequel, est déployée le questionnaire élaboré par l’ONEF. Ils avaient
la responsabilité directe du contrôle de la qualité des données saisies sur leur smartphone. L’avantage
principal de cette méthode est la simultanéité de la collecte et de la saisie des données.
 |
12 12 |
▲back to top |
11
1.3. Supervision de la collecte des données
Comme dans toute investigation statistique, du respect de la méthodologie de collecte des données
dépend la qualité et la validité des résultats obtenus. Les superviseurs avaient pour tâches, de faire
respecter des séries de contrôle suivantes :
✓ la présence à certaines interviews : il était nécessaire d'assister à certaines entrevues pour
vérifier que les procédures de collecte sont bien suivies et que les données recueillies sont
bonnes et complètes. Il s’agit de voir comment se déroule l'interview. Pour ce faire, les
superviseurs disposent d'une copie du questionnaire. Il prend note concernant par exemple les
questions qui présentent des difficultés pour l'enquêteur ou pour le répondant, la façon de poser
et de traduire les questions par l’enquêteur, le comportement de ce dernier vis-à-vis du
répondant, le rythme auquel se déroule l'entrevue, etc. Il fait part de ses observations à la fin
de l'entrevue et suggère à l’enquêteur des moyens de s’améliorer.
✓ Le contrôle du rythme de travail : il s’agissait de suivre constamment la progression des
travaux afin de s’assurer que la collecte sera terminée dans les délais prévus. Nous n’avons
pas eu besoin d’aménager le calendrier journalier d’aucun enquêteur pour être en phase avec
les délais. Le rythme de travail était parfaitement en adéquation avec le planning préétabli.
✓ Les contre-enquêtes (back-check) : en plus des vérifications sur le questionnaire les
superviseurs vérifiaient certains des renseignements recueillis par l'enquêteur. Ils se rendent
ou passent des appels téléphoniques à certaines personnes interrogées et repose certaines
des questions pour vérifier que les réponses ont été enregistrées correctement. De même, les
questionnaires renseignés et envoyés sur la plateforme Kobocollect par les enquêteurs ont fait
l’objet de vérification dans le fond et dans la forme par l’équipe de superviseurs afin de s’assurer
de l’exactitude des informations collectées.
Après la collecte de données, le tableau ci-dessous donne la répartition de ces jeunes par cercle et type
de formation.
Tableau 2: Tableau récapitulatif de la situation générale de la collecte
Localité
Nombre atteint Nombre non-enquêté Nombre ajouté
FPA FIQ ENS FPA FIQ ENS FPA FIQ ENS
Bougouni 9 20 29 1 0 1 0 4 4
Kadiolo 14 42 56 0 0 0 0 3 3
Kolondièba 3 20 23 0 0 0 0 0 0
Yanfolila 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Koutiala 31 57 88 0 1 1 1 0 1
Yorosso 0 19 19 0 0 0 0 0 0
Sikasso 69 25 94 4 1 5 2 0 2
Hors zone1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
Total 130 185 315 5 2 7 3 7 10
Source : Enquête insertion professionnelle jeunes formés cohorte 2022, ONEF 2023
1 Hors zone : comprend Ségou, Kidal et Abidjan.
 |
13 13 |
▲back to top |
12
1.4. Traitement, analyse et production du rapport provisoire d’enquête
À la suite de la collecte des données, une équipe a été mise en place pour apurer, analyser les données
afin de produire le rapport provisoire de l’enquête. En premier lieu, la mission de cette équipe a été
d'exporter les données collectées vers Excel et SPSS afin de rectifier les incohérences.
Après le traitement des données, les paramètres de l’indicateur ont été renseignés selon la définition et
les modalités de calcul consignées dans la fiche d’identité de l’indicateur du Programme. Cette phase
s'est déroulée sur une période de vingt jours et a impliquée la participation des cadres de l’ONEF.
Le rapport provisoire d’enquête a été par la suite rédigé selon le plan de rédaction validé avec
l’assistance technique suivi-évaluation du PAFA II, dans lequel les principaux indicateurs ont été
présentés et commentés.
Le rapport provisoire a été soumis à l’appréciation de l’assistance technique suivi-évaluation du PAFA
II, qui le partage également avec l’assistance technique du programme travaillant dans ce cadre afin
prendre en compte les contributions. Cette approche vise à minimiser les imperfections avant la
rencontre de validation du rapport par le comité scientifique de l’ONEF.
Le 25 septembre 2024, le rapport provisoire a été soumis à l'examen et à la validation des membres du
comité scientifique. Sous réserve de la prise en compte des observations et suggestions, le rapport a
été validé.
 |
14 14 |
▲back to top |
13
2. RESULTATS DE L’ENQUETE
2.1. Profils sociodémographiques des jeunes formés en 2022
Le profil sociodémographique des jeunes formés en 2022 se caractérise par une diversité
géographique, éducative, et matrimoniale. Ces éléments fournissent une base essentielle pour
concevoir des programmes de formation et d'insertion professionnelle adaptés à la variété de besoins
et de contextes individuels au sein de cette cohorte.
2.1.1. Localité de résidence actuelle
La majorité des jeunes formés se situent dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, représentant 54,9%,
suivi par la tranche d'âge des 15-24 ans, avec une proportion de 42,2%. La part de jeunes formés de
plus de 35 ans est relativement faible, ne représentant que 2,9% du total. Néanmoins, des disparités
significatives apparaissent d'une localité à l'autre.
En particulier, la localité de Koutiala se distingue par une forte proportion de jeunes de 15 à 24 ans. En
revanche, dans les autres localités, on observe une prédominance des jeunes de 25 à 35 ans.
Tableau 3: Répartition des jeunes formés selon la localité de résidence actuelle et la tranche d’âge
Localité
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 9 31,0 20 69,0 0 0,0 29 100,0
Kadiolo 21 37,5 33 58,9 2 3,6 56 100,0
Kolondièba 9 39,1 14 60,9 0 0,0 23 100,0
Koutiala 46 52,3 39 44,3 3 3,4 88 100,0
Sikasso 37 39,4 53 56,4 4 4,3 94 100,0
Yanfolila 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Yorosso 9 47,4 10 52,6 0 0,0 19 100,0
Hors zone 2 50,0 2 50,0 0 0,0 4 100,0
Total 133 42,2 173 54,9 9 2,9 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La distribution des jeunes formés semble suivre une répartition relativement équilibrée entre les
localités, bien que Sikasso et Koutiala se démarquent en termes de contribution globale. Cette
répartition offre un aperçu de la distribution relative des hommes et des femmes formés dans chaque
localité. On note une disparité significative entre les sexes à Sikasso, où les hommes prédominent de
manière notable. En revanche, Kadiolo se distingue par une forte représentation des femmes parmi les
jeunes formés. Yanfolila se caractérise par une proportion très faible, voire nulle, de femmes parmi les
jeunes formés.
Cette analyse offre une compréhension des tendances générales dans la répartition des jeunes formés
selon le sexe et la localité, soulignant des variations significatives entre les différentes localités du
programme.
Tableau 4: Répartition des jeunes formés selon la localité de résidence actuelle et le sexe
Localité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 17 8,5 12 10,3 29 9,2
Kadiolo 25 12,6 31 26,7 56 17,8
Kolondièba 12 6,0 11 9,5 23 7,3
Koutiala 54 27,1 34 29,3 88 27,9
Sikasso 75 37,7 19 16,4 94 29,8
Yanfolila 2 1,0 0 0,0 2 0,6
Yorosso 10 5,0 9 7,8 19 6,0
Hors zone 4 2,0 0 0,0 4 1,3
Total 199 100,0 116 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
15 15 |
▲back to top |
14
2.1.2. Niveau d’instruction avant la formation
Le niveau d'éducation le plus répandu parmi les jeunes formés est le niveau secondaire, constituant
48,3% de l'ensemble. En second lieu, on trouve le niveau fondamental, représentant 31,7%, suivi du
niveau supérieur avec une proportion de 8,3%. Le niveau Coranique/alphabétisé(e) est le moins
fréquent, comptabilisant seulement 3,5% de l'ensemble.
Indépendamment du sexe, les jeunes formés en 2022 dans le cadre de la formation initiale qualifiante
et par apprentissage présentent un niveau d’instruction relativement élevé. Notamment, 59,5% des
femmes ont atteint le niveau secondaire, tandis que 41,7% des hommes ont atteint le même niveau.
Les femmes sont peu représentées dans la catégorie « aucun », ne constituant que 6 femmes.
Tableau 5: Répartition des jeunes formés selon le niveau d’instruction avant la formation et le sexe
Niveau d'éducation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Aucun 20 10,1 6 5,2 26 8,3
Coranique/alphabétisé(e) 10 5,0 1 0,9 11 3,5
Fondamental 67 33,7 33 28,4 100 31,7
Secondaire 83 41,7 69 59,5 152 48,3
Supérieur 19 9,5 7 6,0 26 8,3
Total 199 100,0 116 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La tranche d'âge de 15 à 24 ans se caractérise principalement par un niveau d'éducation secondaire,
représentant 54,9% des individus, suivi du niveau fondamental à 33,1%. Les jeunes de 25 à 35 ans
affichent également une part significative avec un niveau d'éducation secondaire (45,7%), bien que le
niveau fondamental demeure notable à 28,9%. Dans la catégorie des plus de 35 ans, la majorité
présente un niveau d'éducation fondamental (66,7%), et un pourcentage élevé (22,2%) signale
l'absence de formation académique.
Peu importe la tranche d'âge, la plupart des jeunes ayant suivi une formation affichent un niveau
d'éducation situé entre le fondamental et le secondaire. Par ailleurs, il est remarquable qu'aucun jeune
formé âgé de plus de 35 ans n'a atteint un niveau d'éducation supérieur.
Tableau 6: Répartition des jeunes formés selon le niveau d’instruction avant la formation et la tranche d’âge
Niveau d'éducation
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Aucun 8 6,0 16 9,2 2 22,2 26 8,3
Coranique/alphabétisé(e) 2 1,5 8 4,6 1 11,1 11 3,5
Fondamental 44 33,1 50 28,9 6 66,7 100 31,7
Secondaire 73 54,9 79 45,7 0 0,0 152 48,3
Supérieur 6 4,5 20 11,6 0 0,0 26 8,3
Total 133 100,0 173 100,0 9 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
16 16 |
▲back to top |
15
2.1.3. Statut matrimonial des jeunes formés en 2022
Dans l'ensemble des jeunes formés de la cohorte 2022, le statut matrimonial prédominant est le
mariage, regroupant 58,4% de l'ensemble. Les célibataires représentent 41,3% du total. Les personnes
divorcées sont peu nombreuses, constituant seulement 0,3% de la cohorte 2022.
On observe une tendance où les femmes affichent un pourcentage plus élevé de mariage par rapport
aux hommes. Parallèlement, le pourcentage de célibataires est plus élevé chez les hommes que chez
les femmes. Ces différences reflètent des dynamiques sociales ou culturelles spécifiques à la population
malienne.
Tableau 7: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le statut matrimonial et le sexe
Statut
matrimonial
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Célibataire 91 45,7 39 33,6 130 41,3
Marié(e) 108 54,3 76 65,5 184 58,4
Divorcé(e) 0 0,0 1 0,9 1 0,3
Total 199 100,0 116 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans, une forte majorité de jeunes est célibataire, représentant 68,4%
des jeunes de 15- 24 ans, tandis que seulement 31,6% sont mariés, sans aucun cas répertorié de
divorce, ou de veuvage. Pour les jeunes de 25 à 35 ans, une écrasante majorité est mariée (76,9%),
avec une proportion moindre de célibataires, soit 22,5%. La catégorie des personnes divorcées est
représentée par une petite proportion de 0,6%. Dans la tranche d'âge de plus de 35 ans, tous les
participants sont mariés (100,0%), sans aucun cas de célibat, de divorce, ou de veuvage signalé.
Une tendance significative émerge avec l'âge, montrant une augmentation substantielle du pourcentage
de personnes mariées, passant de 31,6% chez les 15-24 ans à 100,0% chez les plus de 35 ans.
Parallèlement, la proportion de célibataires diminue considérablement avec l'âge.
Cette analyse suggère une corrélation marquée entre le statut matrimonial et l'âge des jeunes, illustrant
une tendance croissante au mariage à mesure que l'on avance en âge. L'absence de personnes veuves
dans les données peut refléter la jeunesse de la population étudiée ou d'autres facteurs particuliers à
cette cohorte.
Tableau 8: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le statut matrimonial et la tranche d’âge
Statut
matrimonial
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Célibataire 91 68,4 39 22,5 0 0,0 130 41,3
Marié(e) 42 31,6 133 76,9 9 100,0 184 58,4
Divorcé(e) 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,3
Total 133 100,0 173 100,0 9 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
17 17 |
▲back to top |
16
2.2. Formation des jeunes de la cohorte 2022
Pour atteindre le "résultat 2" de la deuxième phase du Programme d’appui aux filières agropastorales
(PAFA II, MLI/026), des jeunes préalablement sélectionnés ont participé à des formations dispensées
dans différentes filières, que ce soit au sein des centres de formation professionnelle pour la formation
initiale qualifiante ou auprès de maîtres d'apprentissage pour l'apprentissage rénové. Dans cette partie,
il sera analysé le type de formation suivi par les jeunes, le choix de cette formation par les jeunes, les
compétences majeures acquises par les jeunes, les compétences majeures présentement exploitées
par les jeunes, les compétences majeures à exploiter dans le futur par les jeunes, la satisfaction des
jeunes par rapport à la formation, la formation en entrepreneuriat suivi par certains jeunes après la
formation initiale, l’élaboration de plan d’affaire effectué par certains d’entre eux ainsi que la mobilisation
de financement pour le plan d’affaire.
L’analyse exhaustive de la formation des jeunes de la cohorte 2022 offre une perspective holistique sur
les différentes facettes de leur parcours, allant du choix de la formation à l'évaluation de son impact sur
l'insertion professionnelle, en passant par l'acquisition et l'utilisation de compétences, ainsi que la
satisfaction générale des participants.
2.2.1. Type de formation des jeunes formés en 2022
Globalement, 58,7% de jeunes formés en 2022 sont issus de la formation initiale qualifiante et 41,3%
de la formation par apprentissage. Quel que soit le type de formation, les jeunes de la cohorte 2022
sont majoritairement représentés dans la tranche d’âge des 15-35 ans.
Bien que la majorité des jeunes présente une prédominance vers la formation qualifiante (58,7%), il est
important de noter que cette tendance est largement influencée par le choix massif des femmes pour
ce type de formation.
La majorité des hommes (55,8%) ont choisi l'apprentissage, tandis qu'une proportion moindre (44,2%)
a opté pour la formation qualifiante. Cette tendance suggère que, parmi les hommes, il y a une
préférence relativement marquée pour l'apprentissage.
Les préférences de formation semblent être fortement liées au genre, avec des schémas clairs
émergents chez les hommes et les femmes. Les initiatives futures pourraient être orientées vers une
sensibilisation et une promotion différenciée des avantages de chaque type de formation en fonction du
sexe, afin de diversifier les choix et de favoriser une représentation équilibrée dans les différentes
filières.
Tableau 9: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et le sexe
Sexe
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Homme 111 55,8 88 44,2 199 100,0
Femme 19 16,4 97 83,6 116 100,0
Total 130 41,3 185 58,7 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données du Tableau 5, en se concentrant sur les comparaisons en ligne entre le type de
formation et la tranche d'âge, révèle plusieurs tendances intéressantes. La majorité des jeunes de la
tranche d'âge 15-24 ans ont opté pour la formation qualifiante, représentant 63,2% de leur ensemble.
Une proportion moindre, soit 36,8%, a choisi l'apprentissage. Cette tendance suggère une préférence
globale des jeunes de 15 à 24 ans pour les formations qualifiantes.
Dans la tranche d'âge 25-35 ans, la répartition entre l'apprentissage (43,9%) et la formation qualifiante
(56,1%) est plus équilibrée. Cependant, la formation qualifiante reste légèrement prédominante. Les
jeunes de 25 à 35 ans semblent donc présenter une diversité dans leurs choix de formation.
 |
18 18 |
▲back to top |
17
Les jeunes de plus de 35 ans ont manifesté une préférence marquée pour l'apprentissage, représentant
55,6% de cette tranche d'âge. La formation qualifiante, bien que moins prédominante, compte pour
44,4%. Cette tranche d'âge semble donc davantage encline vers l'apprentissage.
Cette analyse offre un aperçu significatif des préférences de formation en fonction de l'âge, permettant
ainsi d'orienter les efforts vers une personnalisation des programmes en tenant compte des besoins
spécifiques de chaque tranche d'âge.
Tableau 10: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et la tranche d’âge
Tranche d'âge
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
15 - 24 ans 49 36,8 84 63,2 133 100,0
25 - 35 ans 76 43,9 97 56,1 173 100,0
Plus de 35 ans 5 55,6 4 44,4 9 100,0
Total 130 41,3 185 58,7 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Avec une prédominance notable de 53,1% en faveur de l'apprentissage, Sikasso émerge comme la
localité où cette modalité de formation est la plus privilégiée. Koutiala suit avec une proportion
significative de 23,8% en apprentissage, tout en présentant également une forte participation en
formation qualifiante, atteignant 30,8%. Kadiolo se positionne également avec 22,7% des jeunes optant
pour la formation qualifiante.
En revanche, Yanfolila se distingue par les proportions les plus faibles en apprentissage, enregistrant
seulement 1,5%. À Yorosso, il n'y avait aucune participation à la formation par apprentissage, tandis
qu'à Yanfolila, aucune formation qualifiante n'a été suivie.
Cette analyse met en lumière des tendances marquées dans les préférences de formation à l'échelle
locale, offrant des indications pertinentes pour orienter les décisions stratégiques et personnaliser les
programmes de développement professionnel en fonction des besoins spécifiques de chaque localité.
Tableau 11: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et la localité
Localité
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 9 6,9 20 10,8 29 9,2
Kadiolo 14 10,8 42 22,7 56 17,8
Kolondièba 3 2,3 20 10,8 23 7,3
Koutiala 31 23,8 57 30,8 88 27,9
Sikasso 69 53,1 25 13,5 94 29,8
Yanfolila 2 1,5 0 0,0 2 0,6
Yorosso 0 0,0 19 10,3 19 6,0
Hors zone 2 1,5 2 1,1 4 1,3
Total 130 100,0 185 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans l'ensemble, les jeunes ont majoritairement opté pour une formation dans la filière de la pomme de
terre, représentant une proportion significative de 65,7%, tandis que seulement 34,3% ont choisi la
filière du lait local. Cette préférence marquée pour la formation dans la filière de la pomme de terre peut
s'expliquer par le fait que la zone d'intervention du projet est une région de production de pomme de
terre renommée au Mali.
Indépendamment du type de formation suivi par les jeunes de la cohorte 2022, la filière de la pomme
de terre se caractérise par une nette prédominance, enregistrant une proportion de 73,1% pour la
formation par apprentissage et de 60,5% pour la formation initiale qualifiante.
 |
19 19 |
▲back to top |
18
Tableau 12: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et la filière
Filière de formation
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Pomme de terre 95 73,1 112 60,5 207 65,7
Lait local 35 26,9 73 39,5 108 34,3
Total 130 100,0 185 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La majorité des jeunes sont des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence,
avec une proportion de 30,5%, suivis des producteurs de pomme de terre de consommation, avec
30,2%.
Dans la formation par apprentissage, les producteurs de pomme de terre de consommation ont été les
plus nombreux à être formés, représentant 73,1% des jeunes formés dans cette catégorie. Également
un nombre significatif de producteurs de fourrage et laitiers ont été formés, avec des pourcentages
respectifs de 10,0% et 16,9%.
Le producteur de pomme de terre de consommation et de semence est le métier avec la plus grande
proportion de formation qualifiante, atteignant 51,9%. Les éleveurs laitiers ont également une forte
proportion dans la formation qualifiante, avec une proportion de 39,5%.
Il est important de noter les préférences de chaque métier en matière de type de formation pour adapter
les programmes en conséquence. Les producteurs de pomme de terre de consommation sont
majoritairement issus de la formation par apprentissage, tandis que les éleveurs laitiers et les
producteurs de pomme de terre de consommation et de semence sont majoritairement issus de la
formation qualifiante.
Cette analyse offre des indications précieuses pour orienter les décisions stratégiques en matière de
conception de programmes de formation, afin de répondre de manière ciblée aux préférences et aux
besoins de chaque métier.
Tableau 13: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et le métier
Métier
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 95 73,1 0 0 95 30,2
Producteur laitier 22 16,9 0 0 22 7
Producteur de fourrage 13 10 0 0 13 4,1
Producteur de pomme de terre de consommation et
de semence
0 0 96 51,9 96 30,5
Éleveur laitier 0 0 73 39,5 73 23,2
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 0 0 16 8,6 16 5,1
Total 130 100 185 100 315 100
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les jeunes formés ayant un niveau d'éducation du fondamental sont les plus nombreux à opter pour
l'apprentissage, représentant 49,2% de cette catégorie. Le niveau secondaire est également marqué
par une préférence significative pour l'apprentissage, avec une proportion de 20,0%.
Le niveau d'éducation du secondaire est fortement associé à la formation qualifiante, représentant la
majorité avec 68,1% des jeunes dans cette catégorie. Le niveau du supérieur montre également une
préférence notable pour la formation qualifiante, atteignant 11,9%.
Le choix entre l'apprentissage et la formation qualifiante semble être influencé par le niveau d'éducation
académique. Les jeunes avec un niveau fondamental sont davantage enclins vers l'apprentissage,
tandis que ceux avec un niveau secondaire sont plus enclins vers la formation qualifiante.
 |
20 20 |
▲back to top |
19
Tableau 14: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le type de formation et le niveau d’instruction avant la
formation
Niveau d'éducation
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Aucun 25 19,2 1 0,5 26 8,3
Coranique/alphabétisé(e) 11 8,5 0 0,0 11 3,5
Fondamental 64 49,2 36 19,5 100 31,7
Secondaire 26 20,0 126 68,1 152 48,3
Supérieur 4 3,1 22 11,9 26 8,3
Total 130 100,0 185 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.2.2. Choix de la formation des jeunes de la cohorte 2022
La majorité des jeunes ont pris leur décision de formation en se basant principalement sur la suggestion
du maître d'apprentissage ou du centre de formation professionnelle (40,0%), suivi de près par la
suggestion d'un parent (31,1%). Une observation intéressante est la proportion significative de jeunes,
particulièrement des femmes, qui ont opté pour la formation en raison de la publicité et des réseaux
sociaux, montrant ainsi une influence croissante des canaux de communication numériques dans le
processus décisionnel. Cependant, on note une petite proportion de jeunes qui ont été orientés par des
institutions telles que le Conseil régional de Sikasso et l'Agence pour la Promotion de l'Emploi des
Jeunes (APEJ).
En ce qui concerne le sexe, les hommes sont majoritairement représentés dans la catégorie de choix
basé sur la suggestion du maître d'apprentissage ou du centre de formation professionnelle, constituant
50,3% de cette catégorie, tandis que les femmes sont plus présentes dans la catégorie de suggestion
d'un parent, représentant 39,7%.
La principale motivation derrière le choix de la formation semble être influencée par des facteurs
externes, notamment la suggestion des parents ou des structures de formation. Cette observation est
particulièrement évidente avec la prédominance des choix liés à la suggestion d'un parent et à la
suggestion du maître d'apprentissage ou de la structure de formation.
Tableau 15: Répartition des jeunes formés en 2022 selon le choix de la formation et le sexe
Choix de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Choix personnel 17 8,5 13 11,2 30 9,5
Suggestion d’un parent 52 26,1 46 39,7 98 31,1
Suggestion du M.A ou de la structure de formation 100 50,3 26 22,4 126 40,0
Inexistence d’autres options de formation à portée de
main
0 0,0 1 ,9 1 0,3
Publicité et réseau sociaux 22 11,1 24 20,7 46 14,6
Orientation par le Conseil régional de Sikasso 7 3,5 5 4,3 12 3,8
Orientation par l’APEJ 1 0,5 1 0,9 2 0,6
Autre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 199 100,0 116 100,0 315 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le choix de la formation présente des variations significatives d'une localité à une autre. Par exemple,
à Bougouni, la prédominance de la suggestion du M.A ou de la structure de formation atteint 48,3%,
tandis qu'à Yorosso, la suggestion d'un parent est la plus fréquente avec 31,6%.
La suggestion du M.A ou de la structure de formation demeure le choix le plus fréquent dans la plupart
des localités, témoignant d'une influence marquée des maîtres d'apprentissage ou des structures de
formation. Parallèlement, la suggestion d'un parent joue également un rôle majeur dans plusieurs
localités, soulignant l'influence parentale dans le processus de prise de décision.
 |
21 21 |
▲back to top |
20
La proportion de choix motivés par la publicité et les réseaux sociaux varie d'une localité à une autre,
avec une influence particulièrement notable à Kolondièba et à Yorosso.
Graphique 1 : Proportion des jeunes formés en 2022 selon le choix de la formation et la localité
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les choix de formation présentent des variations significatives en fonction du niveau d'éducation. La
suggestion du M.A ou de la structure de formation prédomine chez ceux ayant un niveau d'éducation
allant de "Aucun" à "Fondamental", mais elle diminue notablement chez les individus ayant un niveau
d'éducation secondaire ou supérieur. En revanche, la suggestion d'un parent est plus prédominante
chez les jeunes ayant atteint un niveau d'éducation secondaire et supérieur, avec des proportions
respectives de 38,2% et 38,5%.
Il est également observé que l'influence de la publicité et des réseaux sociaux est plus marquée chez
les individus ayant un niveau d'éducation plus élevé, et cette influence tend à diminuer à mesure que le
niveau d'éducation diminue. Ces résultats suggèrent une sensibilité accrue à la publicité et aux réseaux
sociaux parmi les personnes plus éduquées.
Tableau 16: Proportion des jeunes formés en 2022 selon le choix de la formation et le niveau d’éducation avant la
formation
Choix de formation Aucun
Coranique/
Alphabétisé(e)
Fondamental Secondaire Supérieur Total
Choix personnel 7,7 9,1 8,0 11,8 3,8 9,5
Suggestion d’un parent 30,8 18,2 20,0 38,2 38,5 31,1
Suggestion du M.A ou de la structure
de formation
61,5 72,7 61,0 24,3 15,4 40,0
Inexistence d’autres options de
formation à portée de main
0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 ,3
Publicité et réseau sociaux 0,0 0,0 10,0 18,4 30,8 14,6
Orientation par le Conseil régional de
Sikasso
0,0 0,0 0,0 6,6 7,7 3,8
Orientation par l’APEJ 0,0 0,0 1,0 0,0 3,8 ,6
Autre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
3,4%
14,3% 8,7% 5,7% 9,6%
21,1% 25,0%
9,5%
27,6%
37,5% 47,8%
42,0%
13,8%
31,6%
50,0%
31,1%
48,3%
19,6% 8,7%
36,4%
64,9%
100,0%
15,8%
25,0%
40,0%
13,8%
19,6% 30,4%
14,8% 6,4%
26,3%
14,6%
6,9% 5,4%
4,3% 0,0% 5,3% 5,3% 3,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Bougouni Kadiolo Kolondièba Koutiala Sikasso Yanfolila Yorosso Hors zone Total
Autre
Orientation par l’APEJ
Orientation par le Conseil régional de Sikasso
Publicité et réseau sociaux
Inexistence d’autres options de formation à portée de main
Suggestion du M.A ou de la structure de formation
Suggestion d’un parent
Choix personnel
 |
22 22 |
▲back to top |
21
2.2.3. Compétences majeures acquises
Les données indiquent des niveaux de compétence et de connaissances dans divers domaines liés à
la production de pomme de terre, différenciés par genre.
En ce qui concerne l'utilisation des équipements de production de pomme de terre de consommation,
les hommes semblent avoir une maîtrise légèrement supérieure à celle des femmes. Néanmoins, dans
l'ensemble, la maîtrise demeure élevée, dépassant les 97%.
En ce qui concerne les itinéraires techniques de production de pomme de terre de consommation, les
femmes affichent une maîtrise totale, surpassant même les hommes. La maîtrise globale est élevée,
atteignant 97,9%.
La maîtrise du ratio entre la quantité de semence de pomme de terre et la superficie à emblaver est
légèrement plus élevée chez les hommes. Cependant, la maîtrise d'ensemble reste élevée, atteignant
96,8%. Les connaissances sur les maladies liées à la production de pommes de terre sont légèrement
plus élevées chez les hommes, bien que l'ensemble démontre une compréhension relativement élevée,
à 78,9%. Pour les mesures à prendre en cas de maladies ou de mesures préventives, les hommes
affichent une connaissance légèrement supérieure. Dans l'ensemble, la compréhension demeure
élevée, à 81,1%. La maîtrise du système de conservation de pommes de terre est légèrement
supérieure chez les hommes, mais la différence est minime. Dans l'ensemble, la maîtrise est élevée, à
86,3%.
En ce qui concerne le circuit de commercialisation des pommes de terre de consommation, les hommes
démontrent une maîtrise significativement plus élevée que les femmes dans ce domaine. Dans
l'ensemble, la maîtrise atteint 80,0%.
Les données montrent une forte compétence et connaissance globale dans divers aspects de la
production de pomme de terre de consommation. Cependant, des disparités entre les genres sont
observées, avec les femmes présentant une maîtrise totale dans les itinéraires techniques de production
de pommes de terre de consommation. Par ailleurs, la commercialisation semble être un domaine où
les hommes surpassent les femmes.
Graphique 2 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation formés ayant acquis des
compétences par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données fournissent des indications sur les niveaux de compétence et de connaissance dans divers
domaines liés à la production de lait local. En ce qui concerne la maîtrise de l'utilisation des équipements
98,8% 97,6% 97,6%
79,3% 81,7%
86,6% 81,7%
92,3%
100,0%
92,3%
76,9% 76,9%
84,6%
69,2%
97,9% 97,9% 96,8% 78,9% 81,1% 86,3% 80,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence de
pomme de terre et
la superficie à
emblaver
Connaissances
des maladies liées
à la production de
pomme de terre
de consommation
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
pomme de terre
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de la pomme de
terre de
consommation
Autres
Homme Femme Ensemle
 |
23 23 |
▲back to top |
22
de production de lait local, les femmes démontrent une maîtrise totale, surpassant légèrement celle des
hommes. Dans l'ensemble, la maîtrise est élevée, atteignant 95,5%.
Pour la maîtrise des techniques de choix de race des vaches laitières et des techniques d’hygiène et
de traitement du lait local, les hommes et femmes présentent une maîtrise totale dans ces domaines.
La maîtrise globale est uniformément élevée, atteignant 100,0%.
En ce qui concerne les connaissances sur les maladies liées à la production de lait local (zoonoses),
les hommes affichent des connaissances légèrement supérieures aux femmes. Cependant, dans
l'ensemble, la compréhension demeure élevée, atteignant 81,8%.
Concernant les connaissances sur les mesures à prendre en cas de survenance de maladies ou de
mesures préventives, les femmes montrent une compréhension significativement inférieure.
Globalement, la connaissance est moins élevée, à 72,7%.
Pour la maîtrise du système de conservation du lait local, les femmes démontrent une maîtrise totale,
tandis que les hommes affichent une maîtrise légèrement inférieure. Dans l'ensemble, la maîtrise est
élevée, atteignant 81,8%.
Quant à la maîtrise du circuit de commercialisation du lait local, les hommes ont une maîtrise légèrement
supérieure, bien que la différence soit minime. Dans l'ensemble, la maîtrise atteint 77,3%.
En conclusion, ces données suggèrent une compétence et une connaissance globales élevées dans la
production de lait local. Les performances des femmes sont généralement supérieures, en particulier
dans les aspects techniques et d'hygiène. Les hommes semblent avoir une maîtrise légèrement
supérieure dans la gestion des maladies et la commercialisation. Un renforcement de la sensibilisation
et de la formation sur les mesures préventives, en particulier auprès des femmes, pourrait être envisagé.
Graphique 3 : Proportion des producteurs laitiers formés ayant acquis des compétences par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données sur la formation des producteurs de cultures fourragères en 2022, en fonction
du genre, révèle plusieurs tendances notables :
En ce qui concerne la maîtrise des types de semences selon les variétés de cultures existantes, tous
les producteurs, hommes et femmes, démontrent une compétence complète. Cela témoigne d'un haut
niveau d'expertise dans le choix des semences en fonction des variétés de cultures existantes.
94,4%
100,0% 100,0%
83,3%
77,8% 77,8% 77,8%
100,0% 100,0% 100,0%
75,0%
50,0%
100,0%
75,0%
95,5% 100,0% 100,0%
81,8%
72,7%
81,8% 77,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de lait
local
Maîtrise des
techniques de
choix de race des
vaches laitières
Maîtrise des
techniques
d’hygiène et de
traitement de lait
local
Connaissances
des maladies
liées à la
production de lait
local (zoonoses)
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
lait local
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
du lait local
Homme Femme Ensemle
 |
24 24 |
▲back to top |
23
En ce qui concerne la maîtrise du ratio entre la quantité de semence et la superficie à emblaver, une
disparité marquée entre les hommes et les femmes est observée. Les femmes affichent un taux de
maîtrise de 100%, tandis que chez les hommes, ce taux est légèrement inférieur à 91%. Ceci suggère
que les hommes pourraient avoir une performance légèrement moindre dans la gestion du ratio entre
la quantité de semence et la superficie à emblaver.
La maîtrise des itinéraires techniques est uniformément élevée, atteignant 100% pour l'ensemble des
producteurs. Cela indique une expertise homogène dans la mise en œuvre des itinéraires techniques
de production.
En ce qui concerne la maîtrise du système de stockage et de conservation de fourrage, une disparité
similaire à celle du ratio de semence est observée. Les femmes présentent un taux de maîtrise de
100%, tandis que chez les hommes, ce taux est de 90,9%. Cela suggère que les femmes pourraient
être plus compétentes dans la gestion du système de stockage et de conservation de fourrage.
En ce qui concerne la maîtrise du circuit de commercialisation de fourrage, une disparité significative
est constatée entre les sexes, avec un taux de maîtrise de 100% chez les femmes contre seulement
72,7% chez les hommes. Des initiatives visant à renforcer les compétences des hommes dans ce
domaine pourraient contribuer à équilibrer les performances globales.
En résumé, les producteurs de cultures fourragères démontrent une maîtrise robuste des compétences,
en particulier dans la maîtrise des types de semences, des itinéraires techniques, et du système de
stockage et de conservation de fourrage. Cependant, des disparités entre les sexes, notamment dans
la gestion du ratio de semence et dans le circuit de commercialisation, soulignent la nécessité d'efforts
ciblés pour renforcer les compétences spécifiques des hommes et promouvoir l'équité et l'efficacité
globale dans la production de cultures fourragères.
Graphique 4 : Proportion des producteurs de cultures fourragères formés ayant acquis des compétences par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des compétences entre hommes et femmes dans la production de pommes de terre et de
semences révèle des performances élevées dans l'utilisation des équipements et la compréhension des
itinéraires techniques. Les hommes affichent une maîtrise totale, tandis que les femmes démontrent
des compétences très proches, soulignant une compréhension approfondie de ces aspects.
Dans le domaine du ratio entre la quantité de semence et la superficie à emblaver, les hommes
présentent une maîtrise plus élevée, signalant une opportunité d'amélioration chez les femmes pour se
rapprocher du niveau de compétence des hommes.
Concernant la connaissance des maladies liées à la production de pommes de terre, les deux sexes
montrent une compréhension décente, mais des améliorations globales pourraient être envisagées.
100,0%
90,9%
100,0%
90,9%
72,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
92,3%
100,0%
92,3%
76,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise des types de
semences selon les
variétés de cultures
existantes
Maîtrise du ratio entre
la quantité de
semence et la
superficie à emblaver
Maîtrise des
itinéraires techniques
de production de
cultures fourragères
Maîtrise du système
de stockage et de
conservation de
fourrage
Maîtrise du circuit de
commercialisation de
fourrage
Homme Femme Total
 |
25 25 |
▲back to top |
24
Les hommes surpassent les femmes dans la compréhension des mesures à prendre en cas de maladies
ou de mesures préventives, soulignant un domaine où les femmes pourraient bénéficier d'un
renforcement des compétences.
En ce qui concerne le système de conservation de pommes de terre, les femmes affichent une maîtrise
légèrement supérieure par rapport aux hommes, indiquant des compétences acceptables dans ce
domaine pour les deux sexes.
Dans la maîtrise du circuit de commercialisation, les deux sexes démontrent des compétences
similaires, bien que légèrement inférieures à d'autres domaines évalués. Ces résultats mettent en
lumière des points forts et suggèrent des opportunités d'amélioration, avec une base de compétences
solide dans l'ensemble.
Graphique 5 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence formés ayant acquis
des compétences par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans l'ensemble, les compétences des deux sexes dans l'utilisation des équipements de production de
lait sont élevées, avec une légère avance pour les hommes, bien que la différence soit minime.
En ce qui concerne les techniques de choix de race, les hommes démontrent une maîtrise totale, tandis
que les femmes affichent une compétence légèrement inférieure. Il est possible d'envisager des
améliorations spécifiques dans ce domaine pour renforcer les compétences des femmes.
Les compétences élevées des deux sexes dans les techniques d'hygiène et de traitement du lait sont
notables, avec une légère avance pour les femmes, bien que la différence soit minime.
Une compréhension décente des maladies liées à la production de lait local est observée chez les deux
sexes, bien qu'il soit envisageable d'introduire des améliorations globales.
Les hommes montrent une meilleure compréhension des mesures à prendre en cas de maladies ou de
mesures préventives, tandis que les femmes présentent une compétence relativement plus faible dans
ce domaine spécifique.
Dans la maîtrise du système de conservation du lait, les compétences sont acceptables pour les deux
sexes, bien que les hommes affichent une maîtrise légèrement supérieure.
En ce qui concerne le circuit de commercialisation du lait, les hommes démontrent une maîtrise plus
élevée que les femmes, signalant une opportunité d'amélioration spécifique pour renforcer les
compétences des femmes dans ce domaine.
100,0% 100,0%
95,5%
81,8% 81,8%
75,0% 72,7%
96,2% 96,2%
88,5%
75,0% 73,1%
82,7%
75,0%
97,9% 97,9%
91,7%
78,1% 77,1% 79,2% 74,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de
pomme de terre
et de semence
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
pomme de terre
de consommation
et de semence
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence de
pomme de terre
et la superficie à
emblaver
Connaissances
des maladies
liées à la
production de
pomme de terre
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
pomme de terre
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de la pomme de
terre de
consommation et
de semences
Homme Femme Ensemble
 |
26 26 |
▲back to top |
25
En résumé, hommes et femmes présentent des compétences élevées dans divers aspects de la
production de lait local, chacun démontrant des points forts spécifiques. Néanmoins, des possibilités
d'amélioration, notamment dans les domaines du choix de race des vaches laitières et du circuit de
commercialisation, méritent une attention particulière pour renforcer les compétences globales de
l'ensemble de la population.
Graphique 6 : Proportion des éleveurs laitiers formés ayant acquis des compétences par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des compétences des hommes formés dans le domaine de la maintenance d'équipement
agricole (MEA) révèle des points forts et des domaines où des améliorations pourraient être bénéfiques.
En ce qui concerne la maîtrise des mesures de sécurisation d'atelier de travail (93,8%), il est évident
que les jeunes sont bien informés et compétents en matière de sécurité. Cette compétence élevée
suggère une conscience aiguë des protocoles de sécurité, essentielle pour prévenir les accidents.
La maîtrise totale des différents outils et équipements utilisés (100,0%) indique une expertise solide et
une capacité à utiliser efficacement les ressources disponibles. Cela démontre une connaissance
approfondie des équipements nécessaires à la maintenance d'équipement agricole.
En ce qui concerne les techniques d'entretien d'équipements agricoles (100,0%), les jeunes hommes
ont démontré une compétence élevée. C'est crucial pour assurer le bon fonctionnement des
équipements, prolonger leur durée de vie et éviter des pannes inutiles.
La maîtrise des techniques de réparation d'équipements agricoles (75,0%) montre une compétence
satisfaisante, bien qu'il reste de la place pour l'amélioration. Une expertise approfondie dans la
réparation pourrait réduire les temps d'arrêt des équipements, contribuant ainsi à une meilleure
efficacité.
En ce qui concerne la maîtrise des unités de mesure et de calcul (mètre, centimètre, litres, hectare, etc.)
(68,8%), bien que la compétence soit acceptable, il est indiqué qu'il y a une marge d'amélioration. Une
connaissance approfondie de ces aspects est cruciale dans le domaine agricole pour une gestion
précise des ressources.
Les jeunes hommes formés démontrent une base solide de compétences en MEA, avec une expertise
particulièrement notable en matière de sécurité, d'utilisation d'outils et d'équipements, ainsi que dans
les techniques d'entretien. Cependant, des efforts pour améliorer la maîtrise des techniques de
réparation et des unités de mesure pourraient encore renforcer leurs compétences globales dans ce
domaine.
92,9%
100,0%
96,4%
85,7% 85,7% 85,7%
92,9%
3,6%
88,9%
86,7%
97,8%
84,4%
80,0% 82,2%
75,6%
0,0%
90,4% 91,8%
97,3%
84,9%
82,2% 83,6% 82,2%
1,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de lait
local
Maîtrise des
techniques de
choix de race des
vaches laitières
Maîtrise des
techniques
d’hygiène et de
traitement de lait
local
Connaissances
des maladies liées
à la production de
lait local
(zoonoses)
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
lait local
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
du lait local
Autres
Homme Femme Ensemble
 |
27 27 |
▲back to top |
26
Graphique 7 : Proportion des maintenanciers d’équipement agricole formés ayant acquis des compétences
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.2.4. Compétences majeures présentement exploitées
L'analyse des données du graphique ci-dessous révèle des disparités significatives entre les sexes en
ce qui concerne les compétences acquises par les producteurs de pommes de terre de consommation.
Les femmes affichent une maîtrise totale (100,0%) de l'utilisation des équipements, surpassant les
hommes (73,8%). Dans l'ensemble, une majorité substantielle de producteurs (76,1%) a développé des
compétences dans ce domaine.
Par ailleurs, les femmes surpassent également les hommes en matière de maîtrise de la conservation
(66,7% contre 57,4%), avec une moyenne globale de 58,2%. Concernant la gestion des itinéraires
techniques, bien que les hommes affichent une proportion légèrement plus élevée (85,2%) par rapport
aux femmes (83,3%), l'ensemble demeure élevé à 85,1%. Les producteurs, dans leur grande majorité,
démontrent des compétences dans ce domaine.
En ce qui concerne la gestion du ratio semence/superficie, les hommes surpassent les femmes (72,1%
contre 66,7%), avec une moyenne globale de 71,6%. Ces résultats soulignent une compréhension
substantielle parmi les producteurs en ce qui concerne la gestion efficace des semences par rapport à
la superficie cultivée.
En revanche, les hommes ont une connaissance plus étendue des maladies liées à la production de
pommes de terre (50,8%) par rapport aux femmes (16,7%), avec une moyenne globale de 47,8%. Cela
suggère la nécessité de renforcer les connaissances des femmes dans ce domaine. De même, les
hommes surpassent les femmes dans la connaissance des mesures préventives (49,2% contre 16,7%),
avec une moyenne globale de 46,3%, indiquant une opportunité d'amélioration de la sensibilisation des
femmes à ces mesures.
En conclusion, les disparités entre les sexes dans certaines compétences soulignent l'importance de
formations ciblées pour renforcer les connaissances des femmes, en particulier en ce qui concerne les
maladies et les mesures préventives. Néanmoins, les résultats globaux indiquent une maîtrise
satisfaisante des compétences techniques liées à la production de pommes de terre de consommation
par la majorité des producteurs.
93,8%
100,0% 100,0%
75,0%
68,8%
6,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise des
mesures de
sécurisation
d’atelier de travail
Maîtrise des
différents outils et
équipements
utilisés
Maîtrise des
techniques
d’entretien
d’équipements
agricoles
Maîtrise des
techniques de
réparation
d’équipements
agricoles
Maîtrise des
unités de mesures
et de calcul
(mètre,
centimètre, litres,
hectare etc)
Autres
 |
28 28 |
▲back to top |
27
Graphique 8 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation formés exploitant présentement
des compétences acquises par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données sur la proportion des producteurs laitiers formés, avec une distinction selon le
sexe, révèle des tendances spécifiques dans ce métier. Les hommes, qui représentent l'ensemble des
exploitants, démontrent une maîtrise notoire de plusieurs compétences clés. Tout d'abord, leur expertise
dans l'utilisation des équipements de production de lait local est remarquable, indiquant une
compétence bien établie dans ce domaine. De manière homogène, ils maîtrisent également les
techniques de choix de race des vaches laitières.
Par ailleurs, la maîtrise totale des techniques d'hygiène et de traitement du lait local par l'ensemble des
producteurs masculins souligne l'importance accordée à la qualité du produit. Bien que plus de la moitié
d'entre eux possèdent une connaissance des maladies liées à la production de lait local, des
opportunités d'amélioration peuvent être explorées pour renforcer la santé du bétail et la sécurité
alimentaire.
Bien que la majorité des producteurs masculins ait une maîtrise du circuit de commercialisation, il
pourrait être avantageux d'explorer des stratégies pour améliorer cette compétence en vue d'optimiser
la rentabilité du métier. Néanmoins, leur solide connaissance des mesures à prendre en cas de
maladies ou des préventives renforce la gestion sanitaire du troupeau.
Enfin, la maîtrise par la majorité des producteurs masculins du système de conservation du lait est un
élément crucial pour assurer la durabilité du métier. En synthèse, bien que les hommes démontrent
globalement une forte maîtrise des compétences nécessaires à la production laitière locale, des
opportunités d'amélioration subsistent, particulièrement en renforçant les connaissances sur les
maladies et en optimisant les aspects liés à la commercialisation du lait local.
73,8%
85,2%
72,1%
50,8% 49,2%
57,4% 57,4%
100,0%
83,3%
66,7%
16,7% 16,7%
66,7%
50,0%
76,1%
85,1%
71,6%
47,8% 46,3%
58,2% 56,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence de
pomme de terre
et la superficie à
emblaver
Connaissances
des maladies
liées à la
production de
pomme de terre
de consommation
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de la pomme de
terre de
consommation
Homme Femme Ensemble
 |
29 29 |
▲back to top |
28
Graphique 9 : Proportion des producteurs laitiers formés exploitant présentement des compétences acquises
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données relatives à la proportion des producteurs de fourrage formés, différenciés par
sexe, met en lumière des tendances significatives qui soulignent une expertise généralisée dans la
filière.
Tant les hommes que les femmes démontrent une maîtrise totale des types de semences en fonction
des variétés de cultures existantes, illustrant ainsi une compréhension uniforme et approfondie de cette
compétence cruciale parmi l'ensemble des producteurs de fourrage. Cette homogénéité se poursuit
avec la maîtrise du ratio entre la quantité de semence et la superficie à emblaver, indiquant une solide
connaissance des pratiques agricoles efficaces liées à la culture du fourrage.
Parallèlement, hommes et femmes présentent une maîtrise totale des itinéraires techniques de
production de cultures fourragères, témoignant d'une expertise élevée dans la gestion complète du
processus de production de fourrage.
Cependant, des disparités entre les sexes émergent dans la maîtrise du système de stockage et de
conservation du fourrage, avec une maîtrise de 66,7% chez les hommes contre 100,0% chez les
femmes. De même, une disparité est observée dans la maîtrise du circuit de commercialisation du
fourrage, avec 66,7% pour les hommes et 100,0% pour les femmes. Ces différences suggèrent des
opportunités d'amélioration spécifiques pour les hommes dans ces domaines particuliers.
En résumé, bien que l'analyse révèle une compétence générale robuste parmi les producteurs de
fourrage, hommes et femmes confondus, elle souligne également des pistes d'amélioration ciblées pour
les hommes, notamment dans la maîtrise du système de stockage, de conservation et du circuit de
commercialisation du fourrage. Ces insights peuvent orienter des initiatives de renforcement des
compétences visant à équilibrer l'expertise au sein de la filière.
77,8%
77,8%
100,0%
55,6%
77,8%
77,8%
66,7%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Maîtrise de l’utilisation des équipements de
production de lait local
Maîtrise des techniques de choix de race des vaches
laitières
Maîtrise des techniques d’hygiène et de traitement
de lait local
Connaissances des maladies liées à la production
de lait local (zoonoses)
Connaissances des mesures à prendre en cas de
survenance de maladies ou de mesures préventives
Maîtrise du système de conservation de lait local
Maîtrise du circuit de commercialisation du lait local
 |
30 30 |
▲back to top |
29
Graphique 10 : Proportion des producteurs de fourrage formés exploitant présentement des compétences acquises
par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données sur la maîtrise des compétences par les producteurs de pommes de terre,
ventilée par sexe, révèle une compétence élevée dans l'ensemble. Une grande majorité des
producteurs (85,7%) démontrent une maîtrise de l'utilisation des équipements de production de pommes
de terre et de semence, avec une légère prédominance chez les hommes (87,5%) par rapport aux
femmes (83,3%). La maîtrise des itinéraires techniques de production de pommes de terre et de
semence est particulièrement élevée, atteignant 92,9%. Les hommes affichent une maîtrise totale
(100,0%), tandis que les femmes démontrent une solide compétence à hauteur de 83,3%.
Concernant le ratio entre la quantité de semence de pomme de terre et la superficie à emblaver, une
majorité des producteurs (71,4%) maîtrise cette compétence, avec une légère prédominance chez les
hommes (75,0%) par rapport aux femmes (66,7%). Les connaissances sur les maladies liées à la
production de pommes de terre sont élevées dans l'ensemble, atteignant 78,6%. Les femmes se
distinguent ici avec une légère supériorité (83,3%) par rapport aux hommes (75,0%).
Les compétences liées aux mesures préventives présentent une variabilité, avec 64,3% des
producteurs maîtrisant cette catégorie. Dans ce domaine, les femmes (83,3%) surpassent les hommes
(50,0%). La maîtrise du système de conservation de pommes de terre est démontrée par 64,3% des
producteurs, les femmes (83,3%) affichant un taux plus élevé que les hommes (50,0%). En ce qui
concerne le circuit de commercialisation de la pomme de terre, une compétence observée chez 71,4%
des producteurs, les femmes (83,3%) montrent une maîtrise plus élevée que les hommes (62,5%).
Cette analyse souligne une compétence globale élevée des producteurs de pommes de terre, tout en
mettant en évidence des distinctions spécifiques entre les sexes. Les femmes se démarquent
particulièrement dans les domaines des itinéraires techniques, des connaissances des maladies, des
mesures préventives, de la conservation et du circuit de commercialisation. Ces résultats suggèrent la
pertinence d'initiatives de renforcement des capacités différenciées pour maximiser l'efficacité des
formations.
100,0% 100,0%
66,7% 66,7%
100,0% 100,0% 100,0%
75,0% 75,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise des types de
semences selon les
variétés de cultures
existantes
Maîtrise du ratio entre
la quantité de
semence et la
superficie à emblaver
Maîtrise des
itinéraires techniques
de production de
cultures fourragères
Maîtrise du système
de stockage et de
conservation de
fourrage
Maîtrise du circuit de
commercialisation de
fourrage
Homme Femme Ensemble
 |
31 31 |
▲back to top |
30
Graphique 11 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence formés exploitant
présentement des compétences acquises par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données sur la proportion des éleveurs laitiers formés, en fonction du sexe, révèle des
tendances marquées.
Dans l'ensemble, 70,0% des éleveurs laitiers démontrent une maîtrise de l'utilisation des équipements
de production de lait local. Il est intéressant de noter que cette compétence est légèrement plus
prononcée chez les hommes (80,0%) que chez les femmes (60,0%).
De manière similaire, 70,0% des éleveurs laitiers maîtrisent les techniques de choix de race des vaches
laitières. Cependant, une prédominance est observée chez les hommes, avec un pourcentage de
80,0%, par rapport aux femmes, qui affichent un taux de maîtrise de 60,0%.
En ce qui concerne la maîtrise des techniques d'hygiène et de traitement du lait local, 50,0% des
éleveurs laitiers démontrent cette compétence. Les femmes se distinguent avec un pourcentage plus
élevé (60,0%) par rapport aux hommes (40,0%).
Les éleveurs laitiers présentent une connaissance des maladies liées à la production de lait local
(zoonoses) à hauteur de 40,0% dans l'ensemble. Cette compréhension est plus marquée chez les
femmes, avec un pourcentage de 60,0%, tandis que les hommes affichent un taux de 20,0%.
La maîtrise du système de conservation du lait local est observée chez 30,0% des éleveurs laitiers dans
l'ensemble. Les femmes présentent une légère prédominance avec un pourcentage de 40,0%,
comparativement à 20,0% chez les hommes.
En ce qui concerne les connaissances sur les mesures à prendre en cas de maladies ou de mesures
préventives, seulement 20,0% des éleveurs laitiers possèdent ces compétences, avec une légère
prédominance chez les femmes (40,0%).
De même, la maîtrise du circuit de commercialisation du lait local est démontrée par 20,0% des éleveurs
laitiers dans l'ensemble, avec une proportion plus élevée chez les femmes (40,0%) par rapport aux
hommes (0,0%).
87,5%
100,0%
75,0% 75,0%
50,0% 50,0%
62,5%
0,0%
83,3% 83,3%
66,7%
83,3% 83,3% 83,3% 83,3%
16,7%
85,7%
92,9%
71,4%
78,6%
64,3% 64,3%
71,4%
7,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de
pomme de terre
et de semence
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
pomme de terre
de consommation
et de semence
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence de
pomme de terre
et la superficie à
emblaver
Connaissances
des maladies
liées à la
production de
pomme de terre
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
pomme de terre
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de la pomme de
terre de
consommation et
de semences
Autres
Homme Femme Enssemble
 |
32 32 |
▲back to top |
31
L'analyse révèle des disparités notables dans la maîtrise des compétences entre les sexes parmi les
éleveurs laitiers formés. Les femmes excellent dans des domaines tels que l'hygiène, les maladies et la
conservation du lait, tandis que les hommes se distinguent davantage dans l'utilisation des équipements
et le choix de race des vaches laitières.
Graphique 12 : Proportion des éleveurs laitiers formés exploitant présentement des compétences acquises par
sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données révélant la proportion exclusivement masculine des maintenanciers des
équipements agricoles formés, compétents pour une exploitation présente, met en évidence plusieurs
aspects essentiels.
La totalité des maintenanciers masculins démontre une maîtrise complète des mesures de sécurisation
de l'atelier de travail, soulignant un engagement unanime envers la sécurité au sein de l'environnement
de travail. Cette uniformité constitue un pilier essentiel pour prévenir les accidents et maintenir un
environnement sûr, crucial pour des opérations agricoles efficaces.
Bien que 80,0% des maintenanciers masculins possèdent des compétences dans la maîtrise des
différents outils et équipements agricoles, cette proportion élevée indique la nécessité d'une formation
continue pour optimiser ces compétences. La quête d'amélioration dans ce domaine souligne
l'importance de rester à la pointe des évolutions technologiques et des nouvelles pratiques agricoles.
De manière cohérente, une maîtrise à hauteur de 80,0% est démontrée par les maintenanciers
masculins dans les techniques d'entretien des équipements agricoles. Cette compétence cruciale est
un facteur déterminant pour assurer la durabilité et la performance optimale des équipements,
contribuant ainsi à l'efficacité globale des opérations agricoles.
Les maintenanciers masculins affichent également une compétence à 80,0% dans les techniques de
réparation d'équipements agricoles. Cette aptitude est essentielle pour minimiser les temps d'arrêt,
maintenir la productivité et assurer la continuité des activités agricoles.
Cependant, dans le domaine des unités de mesures et de calcul, seulement 40,0% des maintenanciers
hommes démontrent une compétence. Cette lacune suggère une opportunité d'amélioration spécifique,
soulignant la pertinence d'une formation supplémentaire pour renforcer cette compétence cruciale pour
des opérations agricoles précises.
Bien que les maintenanciers des équipements agricoles, exclusivement masculins, aient acquis des
compétences solides dans la sécurisation de l'atelier, l'utilisation des outils, l'entretien et la réparation
80,0% 80,0%
40,0%
20,0%
0,0%
20,0%
0,0%
20,0%
60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
40,0% 40,0% 40,0%
0,0%
70,0% 70,0%
50,0%
40,0%
20,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de lait
local
Maîtrise des
techniques de
choix de race des
vaches laitières
Maîtrise des
techniques
d’hygiène et de
traitement de lait
local
Connaissances
des maladies liées
à la production de
lait local
(zoonoses)
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
lait local
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
du lait local
Autres
Homme Femme Enssemble
 |
33 33 |
▲back to top |
32
des équipements, des opportunités d'amélioration subsistent, particulièrement dans la maîtrise des
unités de mesures et de calcul. Cette analyse souligne l'importance d'un apprentissage continu et ciblé
pour maintenir et améliorer l'expertise technique dans ce domaine.
Graphique 13 : Proportion des maintenanciers des équipements agricoles formés exploitant présentement des
compétences acquises
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.2.5. Compétences majeures à exploiter dans le futur
Dans l'ensemble, une grande partie des producteurs de pommes de terre de consommation (72,6%)
démontre une maîtrise de l'utilisation des équipements de production. Les femmes affichent une légère
prédominance (76,9%) par rapport aux hommes (72,0%) dans cette compétence. La maîtrise des
itinéraires techniques de production de pommes de terre de consommation est élevée, atteignant
89,5%. Les hommes montrent une légère supériorité (90,2%) par rapport aux femmes (84,6%).
En ce qui concerne le ratio entre la quantité de semence de pomme de terre et la superficie à emblaver,
une proportion similaire de producteurs (72,6%) maîtrise cette compétence, avec une légère
prédominance chez les femmes (76,9%) par rapport aux hommes (72,0%). Les connaissances des
maladies liées à la production de pommes de terre de consommation sont présentes chez 40,0% des
producteurs dans l'ensemble. Les femmes (46,2%) démontrent une légère supériorité par rapport aux
hommes (39,0%).
En ce qui concerne les mesures préventives, 35,8% des producteurs ont acquis ces compétences, avec
une légère prédominance chez les femmes (46,2%) par rapport aux hommes (34,1%). La maîtrise du
système de conservation de pommes de terre de consommation est démontrée par 57,9% des
producteurs dans l'ensemble. Les femmes (76,9%) montrent une compétence plus élevée que les
hommes (54,9%). En ce qui concerne le circuit de commercialisation de la pomme de terre de
consommation, une majorité de producteurs (55,8%) maîtrise cette compétence, avec une légère
prédominance chez les hommes (56,1%) par rapport aux femmes (53,8%).
En résumé, l'analyse suggère une compétence globalement élevée parmi les producteurs de pommes
de terre de consommation formés, avec des variations spécifiques entre les sexes. Les femmes
montrent une supériorité dans la maîtrise des équipements, des itinéraires techniques, des
connaissances sur les maladies, les mesures préventives et la conservation, tandis que les hommes se
distinguent légèrement dans la maîtrise du circuit de commercialisation.
100,0%
80,0%
80,0%
80,0%
40,0%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Maîtrise des mesures de sécurisation d’atelier de
travail
Maîtrise des différents outils et équipements
utilisés
Maîtrise des techniques d’entretien d’équipements
agricoles
Maîtrise des techniques de réparation
d’équipements agricoles
Maîtrise des unités de mesures et de calcul
(mètre, centimètre, litres, hectare etc)
 |
34 34 |
▲back to top |
33
Graphique 14 : Proportion des producteurs de pommes de terre de consommation formés ayant acquis des
compétences pour une exploitation future par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données portant sur la proportion des producteurs laitiers formés ayant acquis des
compétences pour une exploitation future, révèle des tendances significatives, en mettant en évidence
des différences entre les sexes.
La maîtrise de l'utilisation des équipements de production de lait local est élevée dans l'ensemble,
atteignant 90,9%. Les hommes affichent une maîtrise plus élevée (94,4%) par rapport aux femmes
(75,0%), démontrant une compétence solide chez les deux sexes, bien que les hommes présentent une
légère supériorité.
Concernant les techniques de choix de race des vaches laitières, une majorité significative de
producteurs (86,4%) a acquis cette compétence. Les hommes démontrent une maîtrise plus élevée
(88,9%) par rapport aux femmes (75,0%), soulignant une compétence bien établie chez l'ensemble des
producteurs.
La maîtrise des techniques d'hygiène et de traitement du lait local est également élevée dans
l'ensemble, atteignant 86,4%. Les hommes montrent une compétence supérieure (88,9%) par rapport
aux femmes (75,0%), indiquant une préoccupation partagée pour la qualité sanitaire du lait.
En ce qui concerne les connaissances des maladies liées à la production de lait local (zoonoses), 54,5%
des producteurs ont acquis cette compétence. Les hommes (61,1%) démontrent une compréhension
plus élevée par rapport aux femmes (25,0%), suggérant des opportunités d'amélioration spécifiques
pour les femmes dans ce domaine.
Les connaissances des mesures à prendre en cas de survenance de maladies ou de mesures
préventives sont présentes chez 40,9% des producteurs dans l'ensemble. Les hommes (44,4%)
présentent une légère supériorité par rapport aux femmes (25,0%), indiquant un besoin potentiel de
renforcer cette compétence chez les deux groupes.
En ce qui concerne la maîtrise du système de conservation du lait local, 50,0% des producteurs ont
acquis cette compétence. Les hommes (55,6%) montrent une compétence supérieure par rapport aux
femmes (25,0%), soulignant une opportunité d'amélioration spécifique pour les femmes dans ce
domaine.
Enfin, la maîtrise du circuit de commercialisation du lait local est de 36,4% dans l'ensemble. Les
hommes (44,4%) présentent une compétence supérieure par rapport aux femmes (0,0%), soulignant
un besoin potentiel de renforcer cette compétence, en particulier chez les femmes.
72,0%
90,2%
72,0%
39,0%
34,1%
54,9% 56,1%
4,9%
76,9%
84,6%
76,9%
46,2% 46,2%
76,9%
53,8%
72,6%
89,5%
72,6%
40,0%
35,8%
57,9% 55,8%
4,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence de
pomme de terre et
la superficie à
emblaver
Connaissances
des maladies liées
à la production de
pomme de terre
de consommation
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
pomme de terre
de consommation
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de la pomme de
terre de
consommation
Autres
Homme Femme Ensemble
 |
35 35 |
▲back to top |
34
L'analyse indique une compétence généralement élevée parmi les producteurs laitiers formés, avec des
variations spécifiques entre les sexes. Les hommes montrent une supériorité dans plusieurs
compétences, mais des opportunités d'amélioration existent pour les femmes, notamment dans la
connaissance des maladies, les mesures préventives, la conservation et la commercialisation du lait
local.
Graphique 15 : Proportion des producteurs laitiers formés ayant acquis des compétences pour une exploitation
future par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'examen des données sur la proportion des producteurs de fourrage formés, démontrant l'acquisition
de compétences pour une exploitation future, met en lumière des tendances et des disparités
significatives entre les sexes.
Dans l'ensemble, 69,2% des producteurs de fourrage formés démontrent une maîtrise des types de
semences selon les variétés de cultures existantes. Il est notable que les hommes surpassent les
femmes dans cette compétence, avec une proportion de 72,7% contre 50,0%.
La maîtrise du ratio entre la quantité de semence et la superficie à emblaver reflète une tendance
similaire à la précédente, montrant une supériorité chez les hommes (72,7%) par rapport aux femmes
(50,0%).
En ce qui concerne la maîtrise des itinéraires techniques de production de cultures fourragères, une
compétence élevée est observée, avec une maîtrise totale chez les femmes (100,0%) et une proportion
de 63,6% chez les hommes. Cette distinction souligne particulièrement l'expertise des femmes dans
cette compétence spécifique.
La maîtrise du système de stockage et de conservation de fourrage présente une équité relative entre
les sexes, les hommes affichant une légère supériorité (54,5%) par rapport aux femmes (50,0%).
Cependant, une disparité significative apparaît dans la maîtrise du circuit de commercialisation de
fourrage. Les femmes démontrent une maîtrise totale (100,0%), tandis que les hommes atteignent
seulement 27,3%. Cette disparité souligne des opportunités d'amélioration pour les hommes dans la
compréhension du circuit de commercialisation.
En résumé, les femmes se distinguent particulièrement dans les itinéraires techniques et le circuit de
commercialisation, tandis que les hommes montrent une légère supériorité dans la maîtrise des types
de semences et du ratio de semence à la superficie à emblaver. Ces résultats soulignent la diversité
94,4%
88,9% 88,9%
61,1%
44,4%
55,6%
44,4%
75,0% 75,0% 75,0%
25,0% 25,0% 25,0%
90,9%
86,4% 86,4%
54,5%
40,9%
50,0%
36,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de lait
local
Maîtrise des
techniques de
choix de race des
vaches laitières
Maîtrise des
techniques
d’hygiène et de
traitement de lait
local
Connaissances
des maladies
liées à la
production de lait
local (zoonoses)
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
lait local
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
du lait local
Homme Femme Ensemble
 |
36 36 |
▲back to top |
35
des compétences entre les sexes et mettent en évidence des axes potentiels pour des stratégies
différenciées de renforcement des compétences.
Graphique 16 : Proportion des producteurs de fourrage formés ayant acquis des compétences pour une exploitation
future par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données sur la proportion des producteurs de pommes de terre de consommation et de
semence formés, ayant acquis des compétences pour une exploitation future et ventilées par sexe,
révèle des tendances significatives.
Dans l'ensemble, une majorité de producteurs (72,9%) dévoile une maîtrise de l'utilisation des
équipements de production de pommes de terre et de semence. Les hommes affichent une légère
prédominance avec un taux de maîtrise de 75,0%, comparé à celui des femmes qui est de 71,2%.
Concernant la maîtrise des itinéraires techniques de production de pommes de terre de consommation
et de semence, une compétence élevée est observée, atteignant 85,4%. Les niveaux de maîtrise entre
hommes (84,1%) et femmes (86,5%) sont similaires, soulignant une expertise équilibrée entre les sexes.
Dans le domaine du ratio entre la quantité de semence de pomme de terre et la superficie à emblaver,
on constate une disparité entre les sexes. Les hommes démontrent un taux de maîtrise plus élevé
(81,8%) par rapport aux femmes (55,8%), indiquant une opportunité d'amélioration pour ces dernières
dans ce domaine spécifique.
En ce qui concerne les connaissances des maladies liées à la production de pommes de terre, les
hommes (56,8%) surpassent légèrement les femmes (42,3%). De manière similaire, dans les
connaissances des mesures à prendre en cas de survenance de maladies ou de mesures préventives,
les hommes (56,8%) démontrent une légère supériorité par rapport aux femmes (40,4%).
La maîtrise du système de conservation de pommes de terre présente un équilibre relatif entre les
sexes, avec une prédominance chez les hommes (61,4%) par rapport aux femmes (51,9%).
En ce qui concerne la maîtrise du circuit de commercialisation de la pomme de terre de consommation
et de semences, les hommes (50,0%) ont une avance sur les femmes (44,2%).
72,7% 72,7%
63,6%
54,5%
27,3%
18,2%
50,0% 50,0%
100,0%
50,0%
100,0%
69,2% 69,2% 69,2%
53,8%
38,5%
15,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Maîtrise des types
de semences
selon les variétés
de cultures
existantes
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence et la
superficie à
emblaver
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
cultures
fourragères
Maîtrise du
système de
stockage et de
conservation de
fourrage
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de fourrage
Autres
Homme Femme Ensemble
 |
37 37 |
▲back to top |
36
Graphique 17 : Proportion des producteurs de pomme de terre de consommation et de semence formés ayant
acquis des compétences pour une exploitation future par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données concernant la proportion des éleveurs laitiers formés, ayant acquis des
compétences pour une exploitation future et ventilées par sexe, révèle plusieurs aspects saillants.
Dans l'ensemble, la maîtrise de l'utilisation des équipements de production de lait local est robuste,
atteignant 71,2%. Les hommes présentent une légère avance, affichant une proportion de maîtrise de
75,0%, comparativement à celle des femmes qui est de 68,9%.
En ce qui concerne les techniques de choix de race des vaches laitières, une expertise élevée est
observée, avec une proportion globale de 82,2%. Les hommes démontrent une maîtrise remarquable
de 92,9%, tandis que les femmes affichent une proportion respectable de 75,6%. Ainsi, cette
compétence semble plus prédominante chez les hommes.
La maîtrise des techniques d'hygiène et de traitement du lait local est également substantielle, atteignant
74,0% dans l'ensemble. Les femmes montrent une supériorité, affichant une proportion de 77,8%, par
rapport aux hommes qui ont un pourcentage de 67,9%.
En ce qui concerne les connaissances des maladies liées à la production de lait local (zoonoses), la
proportion globale est de 45,2%. Les femmes (48,9%) démontrent une compréhension supérieure par
rapport aux hommes (39,3%).
Les connaissances sur les mesures à prendre en cas de survenance de maladies ou de mesures
préventives sont relativement faibles dans l'ensemble, avec une proportion de 32,9%. Les hommes
(39,3%) semblent avoir une meilleure compréhension par rapport aux femmes (28,9%).
En ce qui concerne la maîtrise du système de conservation du lait local, la proportion est de 54,8%. Les
hommes (67,9%) surpassent les femmes (46,7%) dans cette compétence.
Enfin, la maîtrise du circuit de commercialisation du lait local est de 45,2% dans l'ensemble. Les
hommes (57,1%) présentent une compétence supérieure par rapport aux femmes (37,8%).
Bien que des compétences solides soient démontrées dans plusieurs domaines, des opportunités de
renforcement de capacités sont identifiées, en particulier en ce qui concerne les connaissances sur les
maladies liées à la production de lait local (zoonoses), les mesures préventives et la maîtrise du circuit
de commercialisation.
75,0%
84,1% 81,8%
56,8% 56,8%
61,4%
50,0%
71,2%
86,5%
55,8%
42,3% 40,4%
51,9%
44,2%
3,8%
72,9%
85,4%
67,7%
49,0% 47,9%
56,3%
46,9%
2,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de
pomme de terre et
de semence
Maîtrise des
itinéraires
techniques de
production de
pomme de terre
de consommation
et de semence
Maîtrise du ratio
entre la quantité
de semence de
pomme de terre et
la superficie à
emblaver
Connaissances
des maladies liées
à la production de
pomme de terre
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
pomme de terre
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
de la pomme de
terre de
consommation et
de semences
Autres
Homme Femme Ensemble
 |
38 38 |
▲back to top |
37
Graphique 18 : Proportion des éleveurs laitiers formés ayant acquis des compétences pour une exploitation future
par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données concernant la proportion des maintenanciers des équipements agricoles formés,
ayant acquis des compétences pour une exploitation future, met en lumière plusieurs points saillants.
Dans l'ensemble, une forte maîtrise des compétences est observée parmi les maintenanciers
d'équipements agricoles formés. La maîtrise des mesures de sécurisation de l'atelier de travail est
particulièrement élevée, atteignant 81,3%. Cela suggère une attention significative portée à la sécurité
des ateliers, contribuant à des conditions de travail sûres.
La maîtrise des différents outils et équipements utilisés est remarquable, avec une proportion de 87,5%.
Cette compétence essentielle garantit une utilisation efficace des équipements agricoles, ce qui peut
avoir un impact positif sur la productivité et la durabilité des opérations.
La maîtrise totale des techniques d'entretien des équipements agricoles est de 100,0%, soulignant
l'excellence des maintenanciers dans ce domaine. Cela indique une expertise complète dans le
maintien en bon état des équipements, ce qui est crucial pour prolonger leur durée de vie et assurer
leur fonctionnement optimal.
De même, la maîtrise des techniques de réparation d'équipements agricoles est élevée, atteignant
87,5%. Cette compétence est cruciale pour minimiser les temps d'arrêt des équipements et garantir une
continuité sans heurts des opérations agricoles.
Cependant, la maîtrise des unités de mesure et de calcul (mètre, centimètre, litres, hectare, etc.) est
légèrement moins élevée, atteignant 62,5%. Bien que solide, cela pourrait indiquer une opportunité
d'amélioration dans la compréhension des unités de mesure et de calcul, qui sont essentielles dans le
contexte agricole.
En fin, les maintenanciers d'équipements agricoles formés démontrent un niveau élevé de compétence
dans la plupart des domaines évalués. Cependant, des initiatives de renforcement des connaissances
en matière d'unités de mesure et de calcul pourraient être envisagées pour garantir une expertise
holistique et complète.
75,0%
92,9%
67,9%
39,3% 39,3%
67,9%
57,1%
3,6%
68,9%
75,6%
77,8%
48,9%
28,9%
46,7%
37,8%
71,2%
82,2%
74,0%
45,2%
32,9%
54,8%
45,2%
1,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Maîtrise de
l’utilisation des
équipements de
production de lait
local
Maîtrise des
techniques de
choix de race des
vaches laitières
Maîtrise des
techniques
d’hygiène et de
traitement de lait
local
Connaissances
des maladies liées
à la production de
lait local
(zoonoses)
Connaissances
des mesures à
prendre en cas de
survenance de
maladies ou de
mesures
préventives
Maîtrise du
système de
conservation de
lait local
Maîtrise du circuit
de
commercialisation
du lait local
Autres
Homme Femme Ensemble
 |
39 39 |
▲back to top |
38
Graphique 19 : Proportion des maintenanciers des équipements agricoles formés ayant acquis des compétences
pour une exploitation future
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.2.6. Taux de satisfaction des jeunes par rapport à la formation
Dans l'ensemble, les résultats indiquent une satisfaction élevée parmi les jeunes formés en 2022, avec
un taux global de satisfaction de 97,8%. La pertinence des modules de formation par rapport aux
besoins et aux exigences de la filière est particulièrement élevée, atteignant 97,8%. Hommes et femmes
expriment des niveaux de satisfaction équivalents, démontrant l'adéquation des modules avec les
attentes des jeunes.
La cohérence entre le volume horaire par module et la densité du contenu enseigné est bien évaluée,
avec un taux de satisfaction global de 92,7%. Les hommes et les femmes montrent des niveaux de
satisfaction similaires, indiquant une distribution équilibrée du temps de formation par rapport au
contenu.
La technique d'animation des modules de formation est très bien perçue, avec un taux de satisfaction
global de 97,5%. Les hommes et les femmes expriment des niveaux élevés de satisfaction, soulignant
l'efficacité de la méthodologie pédagogique utilisée.
La qualité du logigramme exploité dans les modules et lors des sessions de formation, y compris
l'utilisation d'images, de symboles, de formes, etc., est évaluée positivement avec un taux de
satisfaction global de 91,4%.
Le côté pratique de la formation, incluant le développement de contenu en adéquation avec la phase
théorique, l'application et l'expérimentation des connaissances apprises, obtient un taux de satisfaction
global de 89,2%. Bien que légèrement inférieur aux autres aspects, ce taux reste significativement
positif. En ce qui concerne les équipements utilisés lors de la formation, le taux de satisfaction global
est de 81,9%. Les femmes indiquent une satisfaction légèrement supérieure à celle des hommes dans
ce domaine. La durée de la formation est bien évaluée dans l'ensemble, avec un taux de satisfaction
global de 86,3%. Les femmes expriment une satisfaction plus élevée que les hommes concernant la
durée de la formation.
La disponibilité des formateurs pour le déroulement de la formation selon le chronogramme prévu et
pour répondre aux préoccupations est exceptionnelle, avec un taux de satisfaction global de 99,0%.
Les hommes et les femmes sont très satisfaits de cette dimension de la formation.
Les résultats reflètent une satisfaction élevée parmi les jeunes de la cohorte 2022, avec des différences
mineures entre les sexes. Les aspects les mieux évalués sont la pertinence des modules, la technique
81,3%
87,5%
100,0%
87,5%
62,5%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Maîtrise des mesures de sécurisation d’atelier de
travail
Maîtrise des différents outils et équipements utilisés
Maîtrise des techniques d’entretien d’équipements
agricoles
Maîtrise des techniques de réparation
d’équipements agricoles
Maîtrise des unités de mesures et de calcul (mètre,
centimètre, litres, hectare etc)
 |
40 40 |
▲back to top |
39
d'animation, la disponibilité des formateurs, et la qualité du logigramme. Ces points forts peuvent être
soulignés dans les futurs efforts de planification et d'amélioration des programmes de formation.
Graphique 20 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les résultats concernant la pertinence des modules indiquent une satisfaction élevée pour les deux
types de formation, Apprentissage et Qualifiante, avec un taux global de 97,8%. Cette constatation
suggère que l'adéquation des modules aux besoins et aux exigences de la filière est globalement
satisfaisante, indépendamment du type de formation choisi.
En ce qui concerne la cohérence entre le volume horaire et la densité du contenu, les deux types de
formation présentent des taux de satisfaction élevés. L'Apprentissage affiche un léger avantage avec
un taux de 93,1% par rapport à 92,4% pour la formation Qualifiante. Cependant, cette différence
demeure minime, soulignant une satisfaction générale élevée concernant cette dimension.
Pour la technique d’animation des modules, l'Apprentissage se distingue avec un taux exceptionnel de
99,2%, tandis que la formation Qualifiante maintient un niveau élevé à 96,2%. Ces résultats soulignent
une perception excellente de la méthodologie pédagogique, suggérant une qualité uniforme,
indépendamment du type de formation.
En ce qui concerne la qualité du logigramme, les deux types de formation obtiennent des taux de
satisfaction proches, avec une légère préférence pour la formation Qualifiante (91,9% contre 90,8%).
Dans l'ensemble, la qualité du logigramme est bien évaluée, indiquant une satisfaction globale.
Le côté pratique de la formation montre une satisfaction uniforme de 89,2% pour les deux types,
suggérant une équivalence dans le développement pratique et l'application des connaissances entre
l'Apprentissage et la formation Qualifiante.
En ce qui concerne les équipements utilisés lors de la formation, la formation Qualifiante affiche une
satisfaction légèrement supérieure à 83,2%, comparée à 80,0% pour l'Apprentissage. Cela peut
indiquer des opportunités d'amélioration dans l'adéquation des équipements pour la formation en
Apprentissage.
Concernant la durée de la formation, la formation Qualifiante obtient un taux de satisfaction plus élevé
(89,7%) par rapport à l'Apprentissage (81,5%). Ces résultats suggèrent que la durée de la formation
Qualifiante est mieux adaptée aux attentes des participants que celle de l'Apprentissage.
Enfin, la disponibilité exceptionnelle des formateurs est soulignée pour les deux types de formation,
avec une satisfaction totale de 99,0%. En conclusion, bien que les niveaux de satisfaction soient élevés
98,00%
92,50%
97,00%
91,00%
88,90%
80,40%
82,90%
99,50%
97,40%
93,10%
98,30%
92,20%
89,70%
84,50%
92,20%
98,30%
97,80%
92,70%
97,50%
91,40%
89,20%
81,90%
86,30%
99,00%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%
Pertinence des modules de formation
Cohérence entre le volume horaire par module et
la densité du contenu enseigné
Technique d’animation des modules de formation
Qualité du logigramme exploité dans les modules
et lors des sessions de formation
Côté pratique de la formation
Equipements utilisés lors de la formation
Durée de la formation
Disponibilité des formateurs
Ensemble Femme Homme
 |
41 41 |
▲back to top |
40
pour les deux types de formation, des variations subtiles peuvent être explorées pour optimiser
davantage l'expérience de formation.
Graphique 21 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par type de formation
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 varie selon les métiers au sein de la filière agropastorale.
Pour la pertinence des modules, les producteurs laitiers se démarquent avec un taux de satisfaction
maximal de 100,0%, suivis de près par les producteurs de fourrage et les producteurs de pommes de
terre de consommation et de semence, tous dépassant les 97,0%. Néanmoins, la maintenance des
équipements agricoles (MEA) présente le taux le plus bas à 93,8%, bien que globalement satisfaisant.
Cette diversité d'opinions se reflète également dans la perception de la cohérence entre le volume
horaire et la densité du contenu enseigné. Les producteurs de fourrage et les producteurs laitiers
expriment une satisfaction élevée de 100,0%, tandis que la MEA enregistre le taux le plus bas à 81,3%,
indiquant ainsi une variabilité dans la compréhension de cette cohérence.
En ce qui concerne la technique d’animation des modules, tous les métiers, y compris les producteurs
laitiers, les producteurs de fourrage et les producteurs de pommes de terre de consommation et de
semence, affichent des taux de satisfaction de 100,0%, soulignant une excellente perception de la
méthodologie pédagogique.
Pour la qualité du logigramme, la MEA se distingue avec un taux de satisfaction maximal de 100,0%,
bien que les producteurs de pommes de terre de consommation et les éleveurs laitiers présentent des
taux légèrement inférieurs. Dans l'ensemble, la qualité du logigramme est bien évaluée.
Les différences de satisfaction se manifestent également dans la dimension pratique de la formation,
où les producteurs laitiers et les producteurs de fourrage affichent une satisfaction élevée de 95,5%,
tandis que la MEA présente le taux le plus bas à 75,0%, suggérant des variations dans l'appréciation
de cette composante.
Concernant les équipements utilisés lors de la formation, les producteurs de fourrage se démarquent
avec un taux de satisfaction de 92,3%, tandis que les producteurs laitiers et les producteurs de pommes
de terre de consommation montrent des taux inférieurs, indiquant des opportunités d'amélioration,
notamment pour les producteurs laitiers et les équipements en général.
En ce qui concerne la durée de la formation, les producteurs laitiers et les producteurs de pommes de
terre de consommation enregistrent des taux de satisfaction plus élevés par rapport aux autres métiers,
alors que la MEA présente le taux le plus bas à 75,0%.
97,70%
93,10%
99,20%
90,80%
89,20%
80,00%
81,50%
100,00%
97,80%
92,40%
96,20%
91,90%
89,20%
83,20%
89,70%
98,40%
97,80%
92,70%
97,50%
91,40%
89,20%
81,90%
86,30%
99,00%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%
Pertinence des modules de formation
Cohérence entre le volume horaire par module…
Technique d’animation des modules de formation
Qualité du logigramme exploité dans les…
Côté pratique de la formation
Equipements utilisés lors de la formation
Durée de la formation
Disponibilité des formateurs
Ensemble Qualifiante Apprentissage
 |
42 42 |
▲back to top |
41
Cependant, un point positif commun est la disponibilité exceptionnelle des formateurs, soulignée par
des taux de satisfaction élevés, avec une satisfaction maximale de 100,0% pour plusieurs métiers,
indépendamment de leur spécificité. Ces résultats soulignent la nécessité d'adapter certaines
dimensions de la formation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque métier
professionnel.
Graphique 22 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par métiers de la filière agropastorale
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par filière agropastorale révèle des
tendances distinctes au sein des différentes filières.
Pour la pertinence des modules de formation, les jeunes formés dans la filière pomme de terre affichent
un taux de satisfaction de 97,1%, tandis que ceux de la filière lait local présentent un taux encore plus
élevé de 99,1%.
En ce qui concerne la cohérence entre le volume horaire et la densité du contenu enseigné, la filière lait
local se distingue avec un taux de satisfaction de 96,3%, dépassant celui de la filière pomme de terre
(90,8%). Malgré cette différence, le taux global reste positif à 92,7%, indiquant une perception générale
d'équilibre entre le temps de formation et le contenu enseigné.
Pour la technique d’animation des modules de formation, les deux filières, pomme de terre (98,1%) et
lait local (96,3%), affichent des taux élevés, contribuant à un taux global satisfaisant de 97,5%. Cela
témoigne de l'efficacité perçue de la méthodologie pédagogique utilisée dans l'ensemble des filières.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Pertinence
des modules
de formation
Cohérence
entre le
volume
horaire par
module et la
densité du
contenu
enseigné
Technique
d’animation
des modules
de formation
Qualité du
logigramme
exploité dans
les modules
et lors des
sessions de
formation
Côté pratique
de la
formation
Equipements
utilisés lors
de la
formation
Durée de la
formation
Disponibilité
des
formateurs
Producteur de pomme de terre de consommation
Producteur laitier
Producteur de fourrage
Producteur de pomme de terre de consommation et de semence
Éleveur laitier
Maintenance des équipements agricoles (MEA)
Ensemble
 |
43 43 |
▲back to top |
42
La qualité du logigramme utilisé dans les modules et les sessions de formation est bien évaluée dans
les deux filières, avec un léger avantage pour la filière pomme de terre (91,8%) par rapport à la filière
lait local (90,7%).
En ce qui concerne le côté pratique de la formation, les deux filières affichent des niveaux similaires de
satisfaction, avec un taux global de 89,2%. Cela suggère une équivalence dans le développement
pratique et l'application des connaissances apprises entre les filières pomme de terre et lait local.
Pour les équipements utilisés lors de la formation, la filière pomme de terre obtient un taux de
satisfaction de 84,5%, tandis que la filière lait local présente un taux inférieur de 76,9%. Cela souligne
des opportunités d'amélioration, en particulier dans la filière lait local.
En ce qui concerne la durée de la formation, la filière lait local affiche un taux de satisfaction plus élevé
(92,6%) par rapport à la filière pomme de terre (83,1%). Cela peut indiquer une meilleure adaptation de
la durée de formation aux attentes des jeunes dans la filière lait local.
La disponibilité des formateurs est élevée dans les deux filières, avec des taux de satisfaction de 99,0%
pour la pomme de terre et le lait local. Cela souligne une disponibilité exceptionnelle des formateurs,
renforçant la qualité globale de la formation.
En résumé, bien que les filières pomme de terre et lait local présentent des nuances dans les taux de
satisfaction, l'analyse globale suggère une satisfaction positive parmi les jeunes de la cohorte 2022,
avec des domaines spécifiques où des améliorations peuvent être envisagées pour optimiser
l'expérience de formation.
Graphique 23 : Taux de satisfaction des jeunes de la cohorte 2022 par filière agropastorale
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.2.7. Formation en entrepreneuriat après la formation initiale
L'examen de la répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et la localité révèle des
tendances saillantes. La localité de Sikasso se distingue en tant que leader avec le plus grand nombre
de jeunes formés (90), représentant 29,8% du total. Les localités de Koutiala (26,8%) et Kadiolo (18,2%)
suivent respectivement en termes d'effectif total. À l'inverse, Yanfolila et Hors zone affichent des effectifs
plus modestes.
En termes de répartition par sexe, les hommes constituent la majorité, représentant 62,3% du total des
jeunes formés en entrepreneuriat, tandis que les femmes représentent 37,7%. La localité de Sikasso
se démarque par une disparité significative entre hommes (37,8%) et femmes (16,7%), soulignant un
déséquilibre notable. Les localités de Koutiala et Kadiolo présentent également des disparités marquées
entre les sexes.
97,10%
90,80%
98,10%
91,80%
89,40%
84,50%
83,10%
99,00%
99,10%
96,30%
96,30%
90,70%
88,90%
76,90%
92,60%
99,10%
97,80%
92,70%
97,50%
91,40%
89,20%
81,90%
86,30%
99,00%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%
Pertinence des modules de formation
Cohérence entre le volume horaire par module et la densité du
contenu enseigné
Technique d’animation des modules de formation
Qualité du logigramme exploité dans les modules et lors des
sessions de formation
Côté pratique de la formation
Equipements utilisés lors de la formation
Durée de la formation
Disponibilité des formateurs
Ensemble Lait local Pomme de terre
 |
44 44 |
▲back to top |
43
En conclusion, l'analyse de la répartition des jeunes formés en entrepreneuriat met en lumière des
variations substantielles entre les localités, avec des différences significatives dans la participation des
hommes et des femmes. Ces observations soulignent l'importance d'une exploration approfondie pour
comprendre les facteurs sous-jacents à ces disparités et guider des initiatives visant à promouvoir une
participation plus équitable entre les sexes dans l'entrepreneuriat.
Tableau 17: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et la localité
Localité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 16 8,5 12 10,5 28 9,3
Kadiolo 24 12,8 31 27,2 55 18,2
Kolondièba 12 6,4 11 9,6 23 7,6
Koutiala 49 26,1 32 28,1 81 26,8
Sikasso 71 37,8 19 16,7 90 29,8
Yanfolila 2 1,1 0 0,0 2 0,7
Yorosso 10 5,3 9 7,9 19 6,3
Hors zone 4 2,1 0 0,0 4 1,3
Total 188 100,0 114 100,0 302 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le niveau d'instruction
avant la formation initiale met en évidence des tendances significatives. La majorité des jeunes
entrepreneurs ont un niveau d'éducation de secondaire, représentant 49,7% du total. Environ 30,8%
ont un niveau d’éducation fondamental, tandis que 8,6% ont un niveau d'éducation supérieur. Les
niveaux d'éducation les moins représentés sont ceux n'ayant aucun niveau d’éducation (7,9%) et ceux
ayant suivi une éducation coranique ou étant alphabétisés (3,0%). Cette distribution est similaire à celle
observée parmi les jeunes en formation initiale.
Concernant la répartition par sexe, les hommes ayant des niveaux d'éducation fondamental (31,9%
contre 28,9%) et secondaire (43,1% contre 60,5%) affichent des pourcentages plus élevés que les
femmes. Les hommes ayant des niveaux d'éducation plus élevés (supérieur) sont également plus
représentés que les femmes (10,1% contre 6,1%).
Tableau 18: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le niveau d’instruction avant la
formation
Niveau d'éducation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Aucun 19 10,1 5 4,4 24 7,9
Coranique/alphabétisé(e) 9 4,8 0 0,0 9 3,0
Fondamental 60 31,9 33 28,9 93 30,8
Secondaire 81 43,1 69 60,5 150 49,7
Supérieur 19 10,1 7 6,1 26 8,6
Total 188 100,0 114 100,0 302 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le type de formation
met en évidence des disparités significatives. La majorité des hommes formés en entrepreneuriat ont
suivi une formation qualifiante, représentant 46,3% du total des hommes, tandis que 53,7% ont suivi
une formation en apprentissage. En revanche, une proportion beaucoup plus élevée de femmes a suivi
une formation qualifiante (85,1%) par rapport à l'apprentissage (14,9%). Ces différences suggèrent des
préférences ou des orientations distinctes entre les sexes en ce qui concerne le type de formation en
entrepreneuriat.
Globalement, les femmes représentent une proportion plus importante de jeunes issus de la formation
qualifiante par rapport à l'apprentissage, avec un écart significatif entre les deux types de formation.
 |
45 45 |
▲back to top |
44
Tableau 19: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le type de formation
Type de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Apprentissage 101 53,7 17 14,9 118 39,1
Qualifiante 87 46,3 97 85,1 184 60,9
Total 188 100,0 114 100,0 302 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les hommes ayant suivi la formation sur la production de pomme de terre représentent 71,8% des
jeunes entrepreneurs, tandis que les femmes représentent 55,3%. Cette différence suggère un
déséquilibre marqué dans la participation des sexes, avec une prédominance des hommes dans la
filière de la pomme de terre.
En revanche, la filière du lait local présente une répartition plus équilibrée entre les sexes, bien que les
hommes y soient légèrement majoritaires avec 28,2%, par rapport aux femmes qui représentent 44,7%.
Cette filière semble donc attirer une participation relativement plus égale entre les hommes et les
femmes.
Tableau 20: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et la filière
Filière de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Pomme de terre 135 71,8 63 55,3 198 65,6
Lait local 53 28,2 51 44,7 104 34,4
Total 188 100,0 114 100,0 302 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse détaillée de la répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le métier met
en évidence des disparités significatives, révélant des tendances marquées dans la participation à la
formation entrepreneuriale.
Une forte prédominance masculine est observée parmi les producteurs de pomme de terre de
consommation, représentant 39,9% des hommes entrepreneurs, tandis que les femmes ne constituent
que 9,6% des femmes entrepreneures de cette catégorie. Cette disparité souligne l'impact significatif
du genre parmi les bénéficiaires de la formation en entrepreneuriat dans le domaine de la production
de pommes de terre de consommation.
La disparité persiste dans le domaine des producteurs de pomme de terre de consommation et de
semence, où 23,4% d'hommes entrepreneurs contrastent avec 45,6% de femmes entrepreneures.
Cette tendance indique clairement une forte représentation féminine parmi les entrepreneurs
spécialisés dans la production de pommes de terre.
En revanche, la participation des hommes entrepreneurs dans le métier de producteur laitier est limitée
à 8,5%, tandis que les femmes représentent seulement 3,5%. Il est notable que, quel que soit le sexe,
la participation des producteurs laitiers à la formation en entrepreneuriat est relativement faible.
De manière similaire, les producteurs de fourrage sont moins représentés parmi les bénéficiaires de la
formation en entrepreneuriat, soulignant des variations dans l'attrait de cette formation pour certains
métiers. Les hommes dominent exclusivement le domaine de la maintenance des équipements
agricoles (MEA), constituant 8,5% du total des hommes entrepreneurs, tandis qu'aucune femme n'a
suivi cette formation.
En contraste, la formation en entrepreneuriat semble particulièrement attractive pour les femmes parmi
les éleveurs laitiers, représentant 39,5% des femmes entrepreneures, tandis que les hommes ne
constituent que 14,4%.
 |
46 46 |
▲back to top |
45
Tableau 21: Répartition des jeunes formés en entrepreneuriat selon le sexe et le métier
Métier
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 75 39,9 11 9,6 86 28,5
Producteur laitier 16 8,5 4 3,5 20 6,6
Producteur de fourrage 10 5,3 2 1,8 12 4,0
Producteur de pomme de terre de consommation et de
semence
44 23,4 52 45,6 96 31,8
Éleveur laitier 27 14,4 45 39,5 72 23,8
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 16 8,5 0 0,0 16 5,3
Total 188 100,0 114 100,0 302 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.2.8. Elaboration de plan d’affaire
Parmi les jeunes ayant élaboré un plan d'affaires, une nette disparité entre les sexes est observée, avec
une prédominance masculine. En effet, 62,5% sont des hommes, tandis que les femmes représentent
37,5% de cette catégorie, indiquant une participation plus marquée des hommes dans le processus
d'élaboration de plans d'affaires.
L'analyse par localité révèle que les jeunes ayant élaboré un plan d'affaires sont principalement
concentrés dans les localités de Sikasso, Koutiala et Kadiolo, représentant respectivement 29,4%,
27,3% et 18,8% du total.
Plus précisément, les localités de Sikasso et Koutiala se distinguent par la plus forte concentration
d'hommes ayant élaboré leur plan d'affaires, totalisant 63,9% des hommes dans cette catégorie, dont
26,2% à Koutiala et 37,7% à Sikasso.
En ce qui concerne les femmes, la majorité, soit 57,3% de celles ayant élaboré leur plan d'affaires, se
trouvent à Kadiolo (28,2%) et Koutiala (29,1%).
Cette analyse souligne non seulement les disparités entre hommes et femmes dans l'élaboration de
plans d'affaires, mais met également en lumière la concentration géographique de cette activité
entrepreneuriale
Tableau 22: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et la localité
Localité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 15 8,2 12 10,9 27 9,2
Kadiolo 24 13,1 31 28,2 55 18,8
Kolondièba 12 6,6 10 9,1 22 7,5
Koutiala 48 26,2 32 29,1 80 27,3
Sikasso 69 37,7 17 15,5 86 29,4
Yanfolila 2 1,1 0 0,0 2 0,7
Yorosso 9 4,9 8 7,3 17 5,8
Hors zone 4 2,2 0 0,0 4 1,4
Total 183 100,0 110 100,0 293 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des jeunes ayant élaboré un plan d'affaires en fonction du niveau d'éducation avant la
formation révèle des tendances significatives, avec des variations entre hommes et femmes.
Parmi ceux qui ont élaboré un plan d'affaires, les hommes ayant suivi une formation jusqu’au niveau
secondaire sont majoritaires, représentant 43,7% de cette catégorie. Les femmes, quant à elles,
affichent une prévalence significative au niveau secondaire avec 60,9%. Cette disparité suggère que
l'élaboration de plans d'affaires est davantage associée à des niveaux d'éducation secondaires, bien
que la participation des femmes soit notablement plus élevée à ce niveau.
 |
47 47 |
▲back to top |
46
Une analyse plus approfondie révèle que les hommes ayant suivi une formation jusqu’au niveau
fondamental sont également bien représentés, constituant 31,1% de ceux ayant élaboré un plan
d'affaires. En revanche, les femmes ayant un niveau d'éducation fondamental sont légèrement moins
nombreuses, représentant 28,2%.
Ces résultats soulignent l'importance de l'éducation secondaire dans le processus d'élaboration de
plans d'affaires, tout en indiquant des variations intéressantes entre les sexes à différents niveaux
d'éducation.
Tableau 23: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et le niveau d’instruction
avant la formation
Niveau d'éducation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Aucun 19 10,4 5 4,5 24 8,2
Coranique/alphabétisé(e) 8 4,4 0 0,0 8 2,7
Fondamental 57 31,1 31 28,2 88 30,0
Secondaire 80 43,7 67 60,9 147 50,2
Supérieur 19 10,4 7 6,4 26 8,9
Total 183 100,0 110 100,0 293 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des jeunes ayant élaboré un plan d'affaires en fonction de la filière de formation révèle des
tendances distinctes entre hommes et femmes.
Dans l'ensemble, une majorité significative d'hommes, soit 71,0%, ont élaboré un plan d'affaires dans
la filière de formation liée à la pomme de terre, tandis que 53,6% des femmes de cette filière ont
également élaboré un plan d'affaires. Ces résultats suggèrent une participation active des deux sexes
dans l'élaboration de plans d'affaires, bien que la prédominance masculine demeure notable.
Pour la filière de formation liée au lait local, les hommes représentent 29,0%, tandis que les femmes
constituent une part plus importante, soit 46,4%, de ceux ayant élaboré un plan d'affaires. Cette
observation indique une participation plus équilibrée entre les sexes dans la filière du lait local en ce qui
concerne l'élaboration de plans d'affaires.
En combinant les deux filières, on constate que la filière de la pomme de terre enregistre une
prédominance masculine, tandis que la filière du lait local affiche une participation plus significative des
femmes dans l'élaboration de plans d'affaires.
Tableau 24: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et la filière
Filière de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Pomme de terre 130 71,0 59 53,6 189 64,5
Lait local 53 29,0 51 46,4 104 35,5
Total 183 100,0 110 100,0 293 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des jeunes ayant élaboré un plan d'affaires selon le type de formation souligne des disparités
significatives entre les hommes et les femmes.
Dans l'ensemble, une majorité d'hommes issue de la formation par apprentissage, soit 53,0%, ont
élaboré un plan d'affaires. Cependant, la proportion de femmes issue de la formation par apprentissage
est beaucoup plus faible, ne représentant que 15,5% des femmes ayant élaboré un plan d'affaires. Cette
différence souligne une prédominance marquée des hommes dans l'élaboration de plans d'affaires liés
à la formation par apprentissage.
En revanche, pour les formations qualifiantes, la situation s'inverse, avec 47,0% d'hommes et une
proportion plus élevée de femmes, soit 84,5%, ayant élaboré un plan d'affaires. Ces résultats indiquent
une participation plus importante des femmes dans l'élaboration de plans d'affaires associés à la
formation qualifiante.
 |
48 48 |
▲back to top |
47
En combinant les deux types de formation, on observe une dynamique où les hommes ont une forte
présence dans les formations en apprentissage, tandis que les femmes sont plus actives dans les
formations qualifiantes en termes d'élaboration de plans d'affaires.
Tableau 25: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et le type de formation
Type de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Apprentissage 97 53,0 17 15,5 114 38,9
Qualifiante 86 47,0 93 84,5 179 61,1
Total 183 100,0 110 100,0 293 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d'affaires selon le métier souligne
des disparités significatives entre les hommes et les femmes, mettant en évidence des tendances
distinctes dans l'entrepreneuriat agricole.
Les producteurs de pomme de terre de consommation se démarquent avec une forte participation
masculine, représentant 38,8% de ceux ayant élaboré un plan d'affaires, tandis que les femmes ne
constituent que 10,0% de cette catégorie. Cette asymétrie souligne une nette prédominance masculine
parmi les entrepreneurs dans la production de pommes de terre de consommation.
Les producteurs de pomme de terre de consommation et de semence présentent également une
disparité notable, avec 23,5% d'hommes ayant élaboré un plan d’affaires et 43,6% de femmes. Ces
résultats mettent en lumière une forte représentation des femmes productrices de pomme de terre de
consommation et de semence ayant élaboré un plan d’affaires.
De même, les éleveurs laitiers affichent une présence significative des femmes, représentant 40,9% de
celles ayant élaboré un plan d'affaires, tandis que les hommes constituent 14,8%. Cela suggère une
forte prédominance féminine parmi les entrepreneurs dans l'élevage laitier.
En revanche, la maintenance des équipements agricoles (MEA) se caractérise par une participation
exclusivement masculine, avec 8,7% d'hommes ayant élaboré un plan d’affaires et aucune femme
enregistrée dans cette catégorie.
Tableau 26: Répartition des jeunes formés ayant élaboré un plan d’affaire selon le sexe et le métier
Métier
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 71 38,8 11 10,0 82 28,0
Producteur laitier 16 8,7 4 3,6 20 6,8
Producteur de fourrage 10 5,5 2 1,8 12 4,1
Producteur de pomme de terre de consommation et de
semence
43 23,5 48 43,6 91 31,1
Éleveur laitier 27 14,8 45 40,9 72 24,6
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 16 8,7 0 0,0 16 5,5
Total 183 100,0 110 100,0 293 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
49 49 |
▲back to top |
48
2.2.9. Mobilisation de financement pour le plan d’affaire
L'analyse de la répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de
leur plan d'affaires selon le sexe et la localité met en lumière des tendances significatives, soulignant
des disparités entre hommes et femmes dans l'accès aux ressources financières.
En termes globaux, sur les 124 jeunes ayant mobilisé un financement, 65,3% sont des hommes, tandis
que les femmes représentent 34,7%. Cette différence suggère une participation plus élevée des
hommes dans la mobilisation de financements pour le développement de leurs plans d'affaires par
rapport aux femmes.
Au niveau des localités, Sikasso se distingue avec la plus grande proportion d'entrepreneurs ayant
mobilisé un financement, représentant 43,5% du total. Dans cette localité, les hommes et les femmes
ont une participation significativement plus élevée, avec respectivement 55,6% d’hommes et 20,9% de
femmes. Koutiala suit de près avec une représentation de 21,0% du total, marquée par une participation
équilibrée entre hommes (21,0%) et femmes (20,9%).
À Kadiolo, on observe une forte participation des femmes dans la mobilisation de financement,
représentant 32,6% du total des femmes ayant mobilisé un financement pour le développement de leur
plan d'affaires. Cette proportion est significativement plus élevée que celle des hommes (4,9%).
Tableau 27: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan
d’affaire selon le sexe et la localité
Localité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 8 9,9 3 7,0 11 8,9
Kadiolo 4 4,9 14 32,6 18 14,5
Kolondièba 2 2,5 4 9,3 6 4,8
Koutiala 17 21,0 9 20,9 26 21,0
Sikasso 45 55,6 9 20,9 54 43,5
Yanfolila 1 1,2 0 0,0 1 ,8
Yorosso 2 2,5 4 9,3 6 4,8
Hors zone 2 2,5 0 0,0 2 1,6
Total 81 100,0 43 100,0 124 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Globalement, parmi les 124 jeunes ayant mobilisé un financement, on observe une répartition variée en
fonction du niveau d'éducation. Les jeunes ayant un niveau d'éducation secondaire représentent la part
la plus importante, avec 48,4% du total, suivis par ceux ayant un niveau fondamental, qui constitue
32,3%. En revanche, les niveaux d'éducation supérieur, aucun, et coranique/alphabétisé(e) ont des
représentations relativement plus faibles.
En détaillant par sexe, les hommes se démarquent avec des participations significatives dans la
mobilisation de financement, notamment les hommes avec un niveau secondaire (43,2%) et
fondamental (33,3%). Les femmes, bien que présentes dans chaque catégorie, affichent une
participation plus notable pour celles avec un niveau d'éducation secondaire, représentant 58,1% des
femmes ayant mobilisé un financement pour le développement de leur activité.
Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte le niveau d'éducation dans les initiatives
visant à faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au financement. Ils suggèrent également la nécessité
de développer des approches différenciées en fonction du genre pour promouvoir l'égalité d'accès aux
ressources financières.
 |
50 50 |
▲back to top |
49
Tableau 28: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan
d’affaires selon le sexe et le niveau d’instruction avant la formation
Niveau d'éducation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Aucun 9 11,1 2 4,7 11 8,9
Coranique/alphabétisé(e) 4 4,9 0 0,0 4 3,2
Fondamental 27 33,3 13 30,2 40 32,3
Secondaire 35 43,2 25 58,1 60 48,4
Supérieur 6 7,4 3 7,0 9 7,3
Total 81 100,0 43 100,0 124 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan
d'affaires, selon le sexe et la filière, révèle des variations significatives dans l'accès aux ressources
financières entre les différentes filières de formation.
Globalement, parmi les 124 jeunes entrepreneurs ayant mobilisé un financement, les bénéficiaires de
la filière pomme de terre représentent la part prédominante avec 55,6% du total, suivie par la filière lait
local avec 44,4%. Cette répartition met en évidence une différence marquée dans la mobilisation de
financement entre ces deux filières.
En examinant la répartition par sexe, on constate que parmi les hommes ayant mobilisé un financement,
la filière pomme de terre est particulièrement prédominante, représentant 61,7% des hommes ayant
bénéficié de financements. En revanche, les femmes montrent une répartition plus équilibrée entre les
filières, avec une légère préférence pour la filière lait local qui constitue 55,8% des femmes ayant
mobilisé un financement.
Tableau 29: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan
d’affaire selon le sexe et la filière
Filière de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Pomme de terre 50 61,7 19 44,2 69 55,6
Lait local 31 38,3 24 55,8 55 44,4
Total 81 100,0 43 100,0 124 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La majorité des jeunes formés ayant réussi à mobiliser des financements pour le développement de
leur plan d’affaires ont suivi une formation par apprentissage, représentant 50,8% du total, tandis que
ceux ayant suivi une formation qualifiante constituent 49,2%. Cette répartition relativement équilibrée
suggère que les jeunes formés à travers ces deux types de formation ont réussi à obtenir des ressources
financières pour leurs projets entrepreneuriaux.
Lorsqu'on examine la répartition par sexe, des disparités significatives entre les hommes et les femmes
apparaissent. Les hommes ayant suivi une formation par apprentissage sont nettement plus nombreux,
représentant 67,9% de ceux ayant mobilisé un financement, tandis que les femmes dans cette catégorie
ne constituent que 18,6% de celles ayant réussi à mobiliser des fonds. En revanche, pour la formation
qualifiante, les femmes sont majoritaires, représentant 81,4% de celles ayant mobilisé un financement,
tandis que les hommes dans cette catégorie ne représentent que 32,1%.
Ces résultats soulignent l'importance de prendre en considération le type de formation suivi, avec des
implications spécifiques pour l'accès aux financements en fonction du genre. Ils mettent en évidence la
nécessité d'adopter des approches différenciées pour promouvoir l'équité dans l'accès aux ressources
financières, en tenant compte des différentes modalités de formation.
 |
51 51 |
▲back to top |
50
Tableau 30: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan
d’affaire selon le sexe et le type de formation
Type de formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Apprentissage 55 67,9 8 18,6 63 50,8
Qualifiante 26 32,1 35 81,4 61 49,2
Total 81 100,0 43 100,0 124 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de
leur plan d'affaires selon le sexe et le métier met en évidence des disparités significatives, reflétant des
dynamiques spécifiques dans l'accès aux ressources financières en fonction des secteurs d'activité.
Les producteurs de pomme de terre de consommation se démarquent avec une participation plus
importante des hommes (51,9%) par rapport aux femmes (7,0%). Cette différence souligne une
prédominance masculine marquée parmi les producteurs de pomme de terre de consommation ayant
réussi à mobiliser un financement.
Pour les producteurs de pomme de terre de consommation et de semence, une disparité significative
est observée, avec 9,9% d'hommes entrepreneurs par rapport à 37,2% de femmes entrepreneures. Les
femmes sont fortement représentées parmi celles ayant mobilisé un financement pour le développement
de leurs plans d'affaires dans cette catégorie.
Les éleveurs laitiers présentent également des disparités marquées entre les sexes, avec 22,2%
d'hommes entrepreneurs par rapport à 44,2% de femmes entrepreneures. Cela suggère une forte
participation des femmes parmi les éleveurs laitiers ayant réussi à mobiliser des financements.
Dans l'ensemble, l'absence de participants dans la maintenance des équipements agricoles (MEA)
indique une faible représentation de ce secteur dans la mobilisation de financement parmi les jeunes
formés.
Ces résultats soulignent la nécessité d'adopter des stratégies différenciées pour promouvoir l'équité
dans l'accès aux ressources financières, en tenant compte des particularités de chaque métier et de la
diversité des profils entrepreneurs.
Tableau 31: Répartition des jeunes formés ayant mobilisé un financement pour le développement de leur plan
d’affaire selon le sexe et le métier
Métier
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 42 51,9 3 7,0 45 36,3
Producteur laitier 10 12,3 3 7,0 13 10,5
Producteur de fourrage 3 3,7 2 4,7 5 4,0
Producteur de pomme de terre de consommation et de
semence
8 9,9 16 37,2 24 19,4
Éleveur laitier 18 22,2 19 44,2 37 29,8
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 81 100,0 43 100,0 124 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
52 52 |
▲back to top |
51
2.3. Situation professionnelle actuelle des jeunes de la cohorte 2022
La situation professionnelle des jeunes de la cohorte 2022 se caractérise par une variété d'expériences,
principalement réparties entre l'emploi et le chômage. Parmi ces jeunes, une proportion significative est
actuellement active sur le marché du travail, occupant divers postes en tant que salariés, travailleurs
indépendants ou personnes en auto-emploi.
En parallèle, une partie de cette cohorte fait face au chômage, soulignant leurs efforts actuels pour
trouver une opportunité professionnelle. Cette réalité peut refléter les défis inhérents au marché du
travail ou les changements dans les aspirations professionnelles des jeunes.
Il est important de noter qu'un seul jeune a été identifié comme ayant repris une nouvelle formation.
Bien que cette catégorie représente une proportion négligeable, elle a été exclue de l'analyse pour
maintenir la concentration sur les principales tendances observées.
Dans l'ensemble, cette analyse met en évidence la complexité des parcours professionnels au sein de
la cohorte 2022, avec des trajectoires variées entre l'emploi et le chômage. Une compréhension
approfondie de ces dynamiques serait bénéfique pour mieux orienter les actions du PAFAII et d'autres
initiatives visant à soutenir l'insertion professionnelle des jeunes dans le contexte évolutif du marché du
travail.
2.3.1. Emploi
L'analyse des données relatives à l'emploi des jeunes de la cohorte 2022 révèle une diversité de
paramètres influençant leur insertion professionnelle. Les tableaux et graphiques examinent différentes
dimensions telles que la localité de résidence, le type de formation, le statut dans l'activité, le métier, la
durée de travail, le type d'activité, le type de contrats, le revenu mensuel moyen, le type d'entreprise, la
taille de l'entreprise, le nombre d'emplois occupés depuis la fin de la formation, la durée d'accès au
premier emploi, les effets de la formation sur l’insertion, le lien formation-emploi, et enfin, le taux
d'insertion professionnelle avec un revenu décent.
Ces éléments mettent en lumière la complexité des parcours professionnels, illustrant la diversité des
contextes géographiques, des formations, des secteurs d'activité, et des caractéristiques individuelles
des jeunes. Les graphiques sur le taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent offrent une
perspective globale, permettant de mesurer l'impact des différentes variables sur l'atteinte d'une
insertion professionnelle satisfaisante.
2.3.1.1. Taux d’insertion professionnelle avec un revenu décent
L’indicateur mesure le taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant suivi un parcours de formation-
insertion appuyé par le programme et qui arrivent à obtenir un revenu d’au moins 75000 FCFA par mois
(900 000 F CFA par an).
Pour établir la valeur de l’indicateur, ces paramètres ont été collectés :
• Situation des sortants du dispositif de formation professionnelle initiale (qualifiante et par
apprentissage) appuyés par le programme 12 mois après leur sortie de formation ;
• Taux global d’insertion professionnelle des jeunes (garçons et filles) sortis du dispositif de
formation professionnelle initiale (qualifiante et par apprentissage) appuyés par le programme
12 mois après leur sortie de formation ;
• Montant du revenu mensuel et annuel obtenu par les jeunes (garçons et filles) insérés dans les
métiers des différents maillons filières lait local et pomme de terre ainsi que dans les métiers de
services liés à ces filières.
.
Le graphique ci-dessous présente le taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent, en
distinguant les résultats par sexe et type de formation. De manière globale, le taux d'insertion total est
 |
53 53 |
▲back to top |
52
de 32,2% pour les hommes, 6,9% pour les femmes, avec une moyenne générale de 22,9%. Cette
différence notable entre les sexes pourrait indiquer des disparités dans l'accès à des opportunités
d'emploi offrant un revenu décent.
En examinant les données, on observe que le taux d'insertion le plus élevé se trouve chez les jeunes
bénéficiaires de la formation par apprentissage, avec 45,9% pour les hommes et 10,5% pour les
femmes, aboutissant à une moyenne totale de 40,8%.
En revanche, les formations qualifiantes affichent des taux d'insertion inférieurs, avec 14,8% pour les
hommes, 6,2% pour les femmes et un taux global de 10,3%. Cette disparité entre les deux types de
formation suggère une corrélation significative entre le choix du type de formation et le taux d'insertion
professionnelle avec un revenu décent.
Ainsi, l'analyse de ces informations met en lumière l'impact significatif du type de formation sur le taux
d'insertion professionnelle, avec une attention particulière portée aux différences entre hommes et
femmes. Cette distinction pourrait être due à divers facteurs tels que des choix de carrière stéréotypés,
des disparités dans l'accès à certaines formations, ou des obstacles spécifiques rencontrés par chaque
sexe.
Graphique 24 : Taux d’insertion avec un revenu décent par sexe et type de formation
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le graphique ci-dessous présente le taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent, en
distinguant les données selon la filière de formation et le sexe. Globalement, la filière pomme de terre
affiche un taux d'insertion plus élevé que la filière lait local, avec des taux respectifs de 28,0% et 13,0%.
Lorsqu'on examine les résultats par sexe, on constate que le taux d'insertion pour les hommes est de
38,0% dans la filière pomme de terre par rapport à 17,5% dans la filière lait local, indiquant une
préférence nette pour la filière pomme de terre. En revanche, pour les femmes, la filière pomme de terre
présente un taux d'insertion de 6,2%, tandis que la filière lait local enregistre un taux légèrement
supérieur à 7,8%.
Ces disparités entre les filières laissent entrevoir une corrélation entre le choix de la filière de formation
et le taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent. Les chiffres suggèrent que la filière pomme
de terre offre des perspectives d'emploi plus favorables que la filière lait local.
En résumé, l'analyse de ces données souligne l'impact différencié des filières de formation sur le taux
d'insertion professionnelle, avec des implications spécifiques selon le sexe. Cette observation met en
lumière l'importance de comprendre les dynamiques propres à chaque filière, ce qui peut informer les
politiques et les programmes visant à promouvoir l'égalité des chances sur le marché du travail.
45,9%
10,5%
40,8%
14,8%
6,2%
10,3%
32,2%
6,9%
22,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Homme Femme Total
Apprentissage Qualifiante Total
 |
54 54 |
▲back to top |
53
Graphique 25 : Taux d’insertion avec un revenu décent par filière et sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le graphique ci-dessous présente le taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent en fonction
de la tranche d'âge et du sexe. En observant les résultats, on constate une tendance significative. Les
jeunes de 15 à 24 ans affichent un taux d'insertion de 21,6% pour les hommes et 5,1% pour les femmes,
aboutissant à une moyenne totale de 14,3%. Les jeunes de 25 à 35 ans présentent des taux d'insertion
plus élevés, avec 36,8% pour les hommes et 8,9% pour les femmes, donnant une moyenne globale de
27,7%. En revanche, les personnes de plus de 35 ans affichent un taux d'insertion remarquablement
élevé de 62,5% pour les hommes, mais aucun pour les femmes, conduisant à une moyenne totale de
55,6%.
Ces résultats suggèrent une corrélation entre l'âge, le sexe et le taux d'insertion professionnelle. Les
jeunes semblent faire face à des défis plus importants, avec des taux d'insertion plus bas, tandis que
les personnes de plus de 35 ans, en particulier les hommes, présentent des taux nettement plus élevés.
L'analyse de ces informations souligne l'impact différencié de l'âge sur le taux d'insertion
professionnelle, avec des variations notables entre les tranches d'âge et les sexes.
Graphique 26 : Taux d’insertion avec un revenu décent par tranche d’âge et sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'examen du taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent, segmenté par localités et sexe,
révèle des disparités significatives d'une localité à l'autre. Sikasso se distingue par un taux d'insertion
38,0%
6,2%
28,0%
17,5%
7,8%
13,0%
32,2%
6,9%
22,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Homme Femme Total
Pomme de terre Lait local Total
21,6%
36,8%
62,5%
32,2%
5,1%
8,9% 6,9%
14,3%
27,7%
55,6%
22,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Homme Femme Total
 |
55 55 |
▲back to top |
54
élevé, marqué par 61,3% pour les hommes et 15,8% pour les femmes, aboutissant à un taux global de
52,1%. De manière similaire, Bougouni affiche des taux relativement élevés, notamment pour les
femmes à 25,0%, entraînant un taux global de 17,2%.
En revanche, des défis spécifiques semblent exister dans certaines localités comme Yorosso, où les
taux d'insertion sont nuls. Cette situation pourrait être attribuée au fait que les jeunes formés dans cette
zone poursuivent leur perfectionnement dans le centre de formation professionnelle en attendant la
disponibilité des financements.
En résumé, l'analyse de ces données suggère une corrélation complexe entre la localité, le sexe et le
taux d'insertion professionnelle. Les variations constatées entre les localités pourraient découler de
facteurs socio-économiques spécifiques à chacune, mettant en évidence l'importance d'ajuster les
politiques d'emploi en fonction des réalités locales. Cela souligne la nécessité d'une approche
adaptative pour favoriser une insertion professionnelle équitable et efficace dans l'ensemble du
territoire.
Tableau 32: Taux d’insertion avec un revenu décent par localité et sexe
Localité Homme Femme Total
Bougouni 11,8 25,0 17,2
Kadiolo 24,0 0,0 10,7
Kolondièba 16,7 9,1 13,0
Koutiala 11,1 2,9 8,0
Sikasso 61,3 15,8 52,1
Yanfolila 50,0 0,0 50,0
Yorosso 0,0 0,0 0,0
Hors zone 25,0 0,0 25,0
Total 32,2 6,9 22,9
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse du taux d'insertion professionnelle avec un revenu décent, ventilé par métier et sexe révèle
des variations significatives entre les différents métiers, soulignant des tendances distinctes.
Certains métiers se démarquent par des taux d'insertion plus élevés. Le métier de producteur de pomme
de terre de consommation affiche un taux de 53,7% pour les hommes et 15,4% pour les femmes,
contribuant ainsi à un taux global de 48,4%. De même, le métier d’éleveur laitier présente un taux
d'insertion de 10,7% pour les hommes et 8,9% pour les femmes, avec un taux global de 9,6%.
En revanche, d'autres métiers montrent des taux d'insertion plus modestes, voire nuls, comme c'est le
cas pour le métier de producteur laitier, producteur de fourrage et maintenance des équipements
agricoles (MEA) pour les femmes.
La diversité des taux d'insertion entre les métiers suggère une corrélation entre le choix de carrière, le
sexe et le succès de l'insertion professionnelle. Ces résultats pourraient être influencés par des facteurs
tels que la demande du marché pour certains métiers, les compétences spécifiques requises, ou encore
des stéréotypes de genre.
En résumé, l'analyse de ces informations souligne l'importance de comprendre les dynamiques propres
à chaque métier pour informer des politiques et des programmes visant à améliorer l'égalité des chances
dans le domaine professionnel. Cela pourrait également orienter les efforts visant à promouvoir des
carrières plus inclusives et diversifiées.
Tableau 33: Taux d’insertion avec un revenu décent par métier et sexe
Métier Homme Femme Total
Producteur de pomme de terre de consommation 53,7 15,4 48,4
Producteur laitier 16,7 0,0 13,6
Producteur de fourrage 36,4 0,0 30,8
Producteur de pomme de terre de consommation et de semence 13,6 3,8 8,3
Éleveur laitier 10,7 8,9 9,6
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 25,0 0,0 25,0
Total 32,2 6,9 22,9
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
56 56 |
▲back to top |
55
Encadré : Taux d’insertion avec un revenu décent
Taux d’insertion professionnelle avec un revenu décent, dans les filières lait local et pomme de
terre, des jeunes ayant suivi un parcours de formation-insertion dans le cadre du programme,
désagrégé par sexe :
L’indicateur mesure le taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant suivi un parcours de
formation-insertion appuyé par le programme et qui arrivent à obtenir un revenu d’au moins
75000 FCFA par mois (900 000 F CFA par an).
32,2%
6,9%
22,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Homme Femme Taux Global
 |
57 57 |
▲back to top |
56
2.3.1.2. Localité de résidence des jeunes en emploi
En agrégeant les données, on observe que, sur un total de 153 jeunes en emploi, les hommes
représentent 119, soit 77,8%, tandis que les femmes comptent pour 34, soit 22,2%. Cette disparité
soulève des questions sur l'équité d'accès à l'emploi entre les sexes, suggérant des possibles obstacles
ou des tendances spécifiques dans la distribution des opportunités d'emploi.
En observant les pourcentages, on constate des disparités marquées entre hommes et femmes au sein
de chaque localité. À Bougouni, par exemple, les femmes représentent 17,6% des jeunes en emploi,
tandis que cette proportion est moindre dans d'autres localités comme Yanfolila (0,0%) et Hors zone
(0,0%). Ces différences soulignent des réalités spécifiques à chaque région en termes d'opportunités
d'emploi pour les jeunes.
En termes absolus, Sikasso se distingue avec le plus grand nombre de jeunes en emploi (72),
principalement composé d'hommes (52,1%). Koutiala suit avec 32 jeunes en emploi, dont 21,8% sont
des hommes. Ces chiffres reflètent potentiellement une dynamique économique plus développée dans
ces localités, influençant la disponibilité d'emplois pour les jeunes.
En somme, l'analyse de ces informations souligne l'importance de prendre en compte les spécificités
locales dans les initiatives visant à favoriser l'emploi des jeunes. L'identification des disparités entre les
sexes et les régions peut informer des stratégies ciblées pour promouvoir une distribution plus équitable
des opportunités professionnelles à travers les différentes localités.
Tableau 34: Répartition des jeunes en emploi par localité et sexe
Localité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 6 5,0 6 17,6 12 7,8
Kadiolo 14 11,8 8 23,5 22 14,4
Kolondièba 4 3,4 2 5,9 6 3,9
Koutiala 26 21,8 6 17,6 32 20,9
Sikasso 62 52,1 10 29,4 72 47,1
Yanfolila 2 1,7 0 0,0 2 1,3
Yorosso 3 2,5 2 5,9 5 3,3
Hors zone 2 1,7 0 0,0 2 1,3
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-dessous offre un aperçu de la distribution des jeunes en emploi en fonction de leur localité
de résidence et du type de formation qu'ils ont suivie. L'analyse de ces données révèle des tendances
significatives en matière de préférences de formation et de répartition des jeunes en emploi dans
différentes régions.
Globalement, sur les 153 jeunes en emploi, (92/153) 60,1% ont suivi une formation en apprentissage,
tandis que (61/135) 39,9% ont opté pour une formation qualifiante. Cette répartition soulève des
interrogations quant à l'adéquation entre les types de formation proposés et les besoins du marché du
travail dans ces localités.
Il est intéressant de noter que certaines localités, telles que Sikasso et Koutiala, affichent une
prédominance des jeunes en emploi ayant suivi une formation en apprentissage, représentant
respectivement 64,1% et 17,4%. Ces résultats suggèrent une corrélation marquée entre le type de
formation et le succès de l'insertion professionnelle, l'apprentissage étant privilégié dans ces régions.
Néanmoins, des nuances existent, notamment dans des localités telles que Kadiolo et Bougouni, où la
majorité des jeunes en emploi ont suivi une formation qualifiante. Cette diversité dans les parcours de
formation des jeunes en emploi indique une variabilité des choix de formation et des besoins du marché
du travail selon les localités.
En somme, cette analyse met en évidence la nécessité d'adapter les offres de formation aux spécificités
locales et aux tendances du marché du travail. Comprendre les préférences de formation des jeunes
 |
58 58 |
▲back to top |
57
dans chaque localité peut contribuer à élaborer des approches plus ciblées, favorisant ainsi une
meilleure adéquation entre les compétences acquises et les opportunités professionnelles disponibles.
Tableau 35: Répartition des jeunes en emploi par localité et type de formation
Localité
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 4 4,3 8 13,1 12 7,8
Kadiolo 7 7,6 15 24,6 22 14,4
Kolondièba 2 2,2 4 6,6 6 3,9
Koutiala 16 17,4 16 26,2 32 20,9
Sikasso 59 64,1 13 21,3 72 47,1
Yanfolila 2 2,2 0 0,0 2 1,3
Yorosso 0 0,0 5 8,2 5 3,3
Hors zone 2 2,2 0 0,0 2 1,3
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-dessous présente la répartition des jeunes en emploi selon leur localité de résidence et la
filière dans laquelle ils travaillent. L'analyse de ces données révèle des différences significatives dans
la distribution des emplois selon les filières agricoles et les localités.
Au niveau des filières, on observe que la filière pomme de terre prédomine, représentant 107 emplois
sur 153, soit 69,9% du total. Cette concentration peut être attribuée à la demande importante ou aux
opportunités d'emploi plus étendues dans cette filière.
En examinant les localités, Sikasso se démarque avec 64 emplois dans la filière pomme de terre, ce
qui représente la majorité des emplois dans cette filière (59,8%). La localité de Koutiala suit avec 19
emplois dans la filière pomme de terre et 13 emplois dans la filière lait local. Ces chiffres indiquent une
diversification des emplois agricoles dans cette localité.
Cependant, certaines localités comme Koutiala et Kadiolo présentent une distribution plus équilibrée
entre les filières pomme de terre et lait local. Koutiala compte 19 emplois dans la filière pomme de terre
et 13 emplois dans la filière lait local, tandis que Kadiolo enregistre 12 emplois dans la filière pomme de
terre et 10 emplois dans la filière lait local.
 |
59 59 |
▲back to top |
58
Tableau 36: Répartition des jeunes en emploi par localité et filière
Localité
Pomme de
terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 2 1,9 10 21,7 12 7,8
Kadiolo 12 11,2 10 21,7 22 14,4
Kolondièba 6 5,6 0 0,0 6 3,9
Koutiala 19 17,8 13 28,3 32 20,9
Sikasso 64 59,8 8 17,4 72 47,1
Yanfolila 0 0,0 2 4,3 2 1,3
Yorosso 4 3,7 1 2,2 5 3,3
Hors zone 0 0,0 2 4,3 2 1,3
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L’analyse de la proportion des jeunes en emploi par localité et métier, offre un aperçu détaillé des
diverses occupations au sein de chaque localité. Ces données révèlent des variations significatives
dans la répartition des métiers agricoles entre les différentes localités.
En agrégeant les données, on constate une diversité significative des métiers agricoles, avec chaque
localité ayant ses propres spécificités. Cette variabilité peut être influencée par les caractéristiques
économiques, les ressources naturelles disponibles, et les préférences locales.
En examinant les métiers spécifiques, on observe des différences notables. À Sikasso, par exemple, le
métier de producteur de pomme de terre de consommation est particulièrement prédominant,
représentant 75,0% de l’ensemble des emplois occupés par les producteurs de pomme de terre de
consommation. Koutiala se distingue par une diversification plus marquée, avec une répartition
relativement équilibrée entre plusieurs métiers, tels que les producteurs laitiers, les producteurs de
fourrage, les producteurs de pomme de terre de consommation et de semence, et les éleveurs laitiers.
En revanche, à Bougouni, le métier d'éleveur laitier est fortement représenté, constituant 30,8% des
emplois de ce métier. À Kadiolo, la maintenance des équipements agricoles (MEA) joue un rôle
prépondérant, représentant 88,9% des emplois de ce métier.
Tableau 37: Proportion des jeunes en emploi par localité et métier
Localité
Producteur de
pomme de
terre de
consommation
Producteur
laitier
Producteur
de
fourrage
Producteur de
pomme de
terre de
consommation
et de
semence
Éleveur
laitier
Maintenance
des
équipements
agricoles
(MEA)
Total
Bougouni 2,8 18,2 0,0 0,0 30,8 0,0 7,8
Kadiolo 5,6 9,1 22,2 0,0 26,9 88,9 14,4
Kolondièba 2,8 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 3,9
Koutiala 13,9 27,3 33,3 34,6 26,9 0,0 20,9
Sikasso 75,0 36,4 11,1 34,6 11,5 11,1 47,1
Yanfolila 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 1,3
Yorosso 0,0 0,0 0,0 15,4 3,8 0,0 3,3
Hors zone 0,0 9,1 11,1 0,0 0,0 0,0 1,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La répartition des jeunes en emploi par localité et tranche d'âge, fournissant des indications importantes
sur la démographie de la main-d'œuvre dans chaque localité. L'analyse de ces données révèle des
tendances spécifiques en termes de répartition des emplois selon les tranches d'âge et les localités.
En observant les tranches d'âge, on constate une prédominance significative des jeunes âgés de 15 à
24 ans dans la plupart des localités. Sikasso se distingue particulièrement, avec 50,9% des jeunes en
emploi appartenant à cette tranche d'âge. Cette concentration élevée de jeunes travailleurs peut être
liée à des opportunités d'emploi spécifiques dans cette localité.
 |
60 60 |
▲back to top |
59
Cependant, à Koutiala, on observe une distribution relativement équilibrée entre les tranches d'âge,
avec une représentation notable des jeunes âgés de 15 à 24 ans (23,6%) et de ceux âgés de 25 à 35
ans (18,3%). Cette diversification dans les groupes d'âge peut refléter une structure démographique
variée et des opportunités d'emploi pour différentes catégories de travailleurs. En revanche, certaines
localités, comme Yanfolila, présentent une faible participation des jeunes dans la main-d'œuvre, avec
seulement 2,2% des emplois occupés par des jeunes de 25 à 35 ans.
Tableau 38: Répartition des jeunes en emploi par localité et la tranche d’âge
Localité
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 2 3,6 10 10,8 0 0,0 12 7,8
Kadiolo 6 10,9 16 17,2 0 0,0 22 14,4
Kolondièba 2 3,6 4 4,3 0 0,0 6 3,9
Koutiala 13 23,6 17 18,3 2 40,0 32 20,9
Sikasso 28 50,9 41 44,1 3 60,0 72 47,1
Yanfolila 0 0,0 2 2,2 0 0,0 2 1,3
Yorosso 3 5,5 2 2,2 0 0,0 5 3,3
Hors zone 1 1,8 1 1,1 0 0,0 2 1,3
Total 55 100,0 93 100,0 5 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.3. Mode d’insertion
En observant les résultats, on constate que la plupart des emplois ont été obtenus via des relations
personnelles, représentant 52,3% du total. Cette méthode semble être prédominante tant pour les
hommes (49,6%) que pour les femmes (61,8%). Cela suggère l'importance des réseaux personnels
dans le processus d'insertion professionnelle, bien que les femmes semblent tirer davantage parti de
ces relations.
Par ailleurs, l'exploitation familiale se démarque comme une autre voie significative, représentant 34,6%
de l'ensemble des emplois. Cette méthode est particulièrement prévalente chez les hommes,
contribuant à 38,7% de leurs emplois, tandis qu'elle est moins fréquente chez les femmes avec une
contribution de 20,6%. Ces variations indiquent des différences de recours à l'exploitation familiale
comme mode d'insertion entre les genres.
La création d’entreprise est également un mode d'insertion notable, représentant 3,3% du total. Bien
que ce mode soit moins fréquent, il témoigne de l'entrepreneuriat parmi les jeunes en emploi.
Cependant, cette voie semble être un peu plus privilégiée par les femmes (5,9%) que par les hommes
(2,5%).
En résumé, cette analyse met en évidence la diversité des modes d'insertion professionnelle parmi les
jeunes en emploi, avec des influences variées des relations personnelles, de l'exploitation familiale et
de l'entrepreneuriat.
Tableau 39: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et le sexe
Mode d'insertion
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Relations personnelles 59 49,6 21 61,8 80 52,3
Directement auprès de l’employeur 11 9,2 3 8,8 14 9,2
Petites annonces, médias 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ANPE/APEJ 0 0,0 1 2,9 1 0,7
Bureau Privé de Placement 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Concours 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Créer une entreprise 3 2,5 2 5,9 5 3,3
Exploitation familiale 46 38,7 7 20,6 53 34,6
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la répartition des jeunes en emploi selon le mode d'obtention et la filière, mettant en
évidence les différentes approches d'insertion professionnelle dans les filières de la pomme de terre et
du lait local, révèle des tendances significatives influençant les choix d'insertion de ces filières.
 |
61 61 |
▲back to top |
60
Les résultats soulignent que les relations personnelles demeurent le mode d'insertion prédominant,
contribuant à 52,3% de l'ensemble des emplois. Bien que cette tendance soit présente dans les deux
filières, elle se manifeste de manière plus prononcée dans la filière du lait local (63,0%) par rapport à
celle de la pomme de terre (47,7%).
Le mode d'obtention d'emploi en s'adressant directement à l'employeur est également notable,
représentant 9,2% de l'ensemble des emplois. Il est pertinent de noter que, bien que ce mode soit
similaire entre les deux filières, il affiche une légère prévalence supérieure dans la filière du lait local,
avec un pourcentage de 10,9%.
La création d'une entreprise se distingue également avec une contribution de 3,3% au total des emplois.
Il est à noter que, dans la filière de la pomme de terre, ce mode est plus fréquent, représentant 4,7%
des emplois de cette filière, tandis qu'il est absent dans la filière du lait local.
L'exploitation familiale joue un rôle significatif dans les deux filières, contribuant à 34,6% de l'ensemble
des emplois. Cependant, son impact est plus marqué dans la filière de la pomme de terre (39,3%) que
dans celle du lait local (23,9%).
Cette analyse met en lumière la diversité des modes d'insertion professionnelle dans les filières de la
pomme de terre et du lait local, avec des nuances dans l'impact des relations personnelles, de la
création d'entreprise et de l'exploitation familiale. Ces informations peuvent orienter les stratégies
d'emploi et de formation propres à chaque filière pour optimiser les opportunités d'insertion
professionnelle.
Tableau 40: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et la filière
Mode d'insertion
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Relations personnelles 51 47,7 29 63,0 80 52,3
Directement auprès de l’employeur 9 8,4 5 10,9 14 9,2
Petites annonces, médias 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ANPE/APEJ 0 0,0 1 2,2 1 ,7
Bureau Privé de Placement 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Concours 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Créer une entreprise 5 4,7 0 0,0 5 3,3
Exploitation familiale 42 39,3 11 23,9 53 34,6
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données concernant le mode d'obtention d'emploi et le type de formation révèle que les
relations personnelles sont le principal mode d'insertion, contribuant à 52,3% de l'ensemble des
emplois. Cette prédominance est constatée dans les deux types de formation, mais elle est plus
marquée parmi les jeunes ayant suivi une formation qualifiante (63,9%) que parmi ceux ayant suivi une
formation en apprentissage (44,6%).
Par ailleurs, l'approche consistant à s'adresser directement à l’employeur est également notable,
représentant 9,2% de l'ensemble des emplois. Bien que cette méthode soit similaire entre les deux
types de formation, elle affiche une légère prévalence supérieure parmi les jeunes ayant suivi une
formation qualifiante (8,2%).
L'exploitation familiale joue un rôle significatif dans les deux types de formation, contribuant à 34,6% de
l'ensemble des emplois. Cependant, cette influence est plus prononcée parmi les jeunes ayant suivi
une formation en apprentissage (42,4%) que parmi ceux ayant suivi une formation qualifiante (23,0%).
Cette analyse souligne la diversité des approches d'insertion professionnelle en fonction du type de
formation, avec des nuances dans l'impact des relations personnelles, de la création d'entreprise et de
l'exploitation familiale. Ces informations peuvent orienter le développement de programmes de
formation et d'emploi adaptés à chaque type de formation, visant à maximiser les opportunités
d'insertion professionnelle.
 |
62 62 |
▲back to top |
61
Tableau 41: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et le type de formation
Mode d'insertion
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Relations personnelles 41 44,6 39 63,9 80 52,3
Directement auprès de l’employeur 9 9,8 5 8,2 14 9,2
Petites annonces, médias 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ANPE/APEJ 0 0,0 1 1,6 1 0,7
Bureau Privé de Placement 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Concours 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Créer une entreprise 3 3,3 2 3,3 5 3,3
Exploitation familiale 39 42,4 14 23,0 53 34,6
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.4. Statut dans l’activité
L'analyse des données met en lumière des disparités significatives entre les jeunes en emploi, en
considérant leur statut dans l'activité et leur sexe. En premier lieu, il est observé que 38,6% des jeunes
en emploi sont salariés, suivis de ceux en auto-emploi à hauteur de 34,0%, et enfin, les indépendants
représentant 27,5%. En se penchant sur la dimension du genre, on constate que la proportion d'hommes
salariés (42,9%) est plus élevée que celle des hommes indépendants et en auto-emploi. Cette
divergence suggère une potentielle inégalité d'accès à l'emploi salarié pour les hommes. À l'inverse, les
femmes en auto-emploi constituent la moitié de l'effectif total des femmes en emploi.
En synthèse, ces données révèlent une distribution inégale des jeunes en emploi en fonction de leur
statut dans l'activité et de leur sexe. Bien que les hommes soient prédominants dans le salariat, ils
demeurent également significatifs dans les catégories de l'emploi indépendant et de l'auto-emploi. En
revanche, les femmes sont plus nombreuses dans l'auto-emploi.
Tableau 42: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et le sexe
Statut dans l’activité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 51 42,9 8 23,5 59 38,6
Indépendant 33 27,7 9 26,5 42 27,5
Auto-emploi 35 29,4 17 50,0 52 34,0
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'examen des données présentées dans le tableau ci-après met en évidence des variations
significatives dans la répartition des jeunes en emploi en fonction de leur statut dans l'activité et du type
de formation qu'ils ont suivi. En premier lieu, en se concentrant sur le statut de salarié, on observe que
40,2% des jeunes en emploi ayant suivi un apprentissage occupent des postes salariés, tandis que
ceux ayant suivi une formation qualifiante représentent 36,1%. Cette répartition relativement équilibrée
suggère que les jeunes issus de formations différentes ont des chances similaires d'accéder à des
emplois salariés.
En ce qui concerne les indépendants, 28,3% de ceux ayant suivi un apprentissage ont adopté ce statut,
tandis que 26,2% de ceux avec une formation qualifiante ont fait de même. Les écarts entre ces deux
groupes ne sont pas aussi marqués, indiquant une certaine similitude dans la propension des jeunes
indépendants, quel que soit leur parcours de formation.
En revanche, pour le statut d'auto-emploi, une différence notable émerge. Parmi les jeunes en emploi
ayant suivi un apprentissage, 31,5% sont dans l'auto-emploi, tandis que ceux ayant suivi une formation
qualifiante affichent une proportion plus élevée de 37,7%. Cette disparité suggère que les jeunes ayant
suivi une formation qualifiante ont une propension plus marquée à s'engager dans des activités d'auto-
emploi par rapport à leurs homologues ayant suivi un apprentissage.
En résumé, ces données soulignent des tendances intéressantes dans la répartition des jeunes en
emploi en fonction de leur statut dans l'activité et du type de formation. Alors que l'accès aux emplois
salariés semble relativement équilibré, des disparités se manifestent dans le choix de l'auto-emploi, en
 |
63 63 |
▲back to top |
62
fonction du type de formation suivi par les jeunes. Cette observation met en lumière l'influence
potentielle du parcours de formation sur les choix d'activité professionnelle ultérieurs.
Tableau 43: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et le type de formation
Statut dans l’activité
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 37 40,2 22 36,1 59 38,6
Indépendant 26 28,3 16 26,2 42 27,5
Auto-emploi 29 31,5 23 37,7 52 34,0
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'examen des données met en évidence des différences significatives dans la répartition des jeunes en
emploi en fonction de leur statut dans l'activité et du métier exercé. Tout d'abord, en se penchant sur le
métier de producteur de pomme de terre de consommation, on constate que la majorité des individus
sont salariés (37,5%), suivis par les indépendants (29,2%) et ceux en auto-emploi (33,3%). Cette
diversité de statuts suggère une variabilité importante dans les choix professionnels au sein de ce métier
spécifique.
Dans le cas du producteur laitier, une prédominance écrasante de salariés est observée (63,6%),
indiquant une tendance claire vers l'emploi salarié dans ce domaine. Cependant, les indépendants et
les travailleurs en auto-emploi ne sont pas négligeables, représentant respectivement 18,2%.
Pour le métier de producteur de fourrage, les trois catégories de statut sont relativement équilibrées,
avec une répartition d'environ 33,3% pour chacune. Cela suggère une certaine équivalence dans les
choix professionnels au sein de ce métier.
Dans le cas de producteur de pomme de terre de consommation et de semence et éleveur laitier, on
observe une diversité dans la répartition des statuts. Les pourcentages varient, indiquant des
préférences professionnelles différentes au sein de ces métiers spécifiques.
Enfin, pour les maintenanciers des équipements agricoles (MEA), la prédominance des salariés est
également marquée (55,6%), mais les indépendants et les travailleurs en auto-emploi ne sont pas
absents, contribuant respectivement à 33,3% et 11,1%.
En résumé, ces données révèlent des nuances intéressantes dans la répartition des jeunes en emploi
en fonction de leur statut dans l'activité et du métier exercé. Les variations observées mettent en lumière
la complexité des choix professionnels dans le secteur agricole, soulignant l'importance de prendre en
compte cette diversité dans la formulation de politiques d'emploi et de formation.
Tableau 44: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et le métier
Métier
Salarié Indépendant Auto-emploi Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de
consommation
27 37,5 21 29,2 24 33,3 72 100,0
Producteur laitier 7 63,6 2 18,2 2 18,2 11 100,0
Producteur de fourrage 3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 100,0
Producteur de pomme de terre de
consommation et de semence
8 30,8 7 26,9 11 42,3 26 100,0
Éleveur laitier 9 34,6 6 23,1 11 42,3 26 100,0
Maintenance des équipements agricoles 5 55,6 3 33,3 1 11,1 9 100,0
Total 59 38,6 42 27,5 52 34,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse du tableau portant sur la répartition des jeunes en emploi en fonction de leur statut dans
l'activité et de la filière, révèle des tendances distinctes au sein de chaque type de formation. Tout
d'abord, en se concentrant sur la filière pomme de terre, la majorité des jeunes en emploi sont répartis
quasi-équitablement entre les statuts de salarié (37,4%) et d'auto-emploi (33,6%). Les indépendants
représentent également une part significative avec 29,0%. Cette répartition équilibrée suggère une
diversité dans les choix de statut professionnel au sein de la filière pomme de terre.
 |
64 64 |
▲back to top |
63
En revanche, pour la filière lait local, les jeunes en emploi semblent plus enclins à opter pour le salariat,
représentant 41,3% de la répartition totale. Les indépendants et ceux en auto-emploi constituent des
parts relativement plus faibles, avec 23,9% et 34,8% respectivement. Cette prédominance du salariat
dans la filière lait local indique une tendance marquée vers l'emploi salarié au sein de cette activité
spécifique.
Tableau 45: Répartition des jeunes en emploi selon leur statut dans l’activité et la filière
Statut dans l’activité
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 40 37,4 19 41,3 59 38,6
Indépendant 31 29,0 11 23,9 42 27,5
Auto-emploi 36 33,6 16 34,8 52 34,0
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la distribution des jeunes en emploi, en fonction de leur localité et de leur statut d'emploi,
révèle des disparités significatives. En observant le statut par localité, il est notable que Koutiala et
Sikasso concentrent plus de 70% des jeunes salariés, représentant 22,0% pour Koutiala et 49,2% pour
Sikasso. Cette tendance pourrait s'expliquer par le développement économique plus avancé de ces
deux localités, favorisé par la présence d'entreprises.
En ce qui concerne les jeunes indépendants ou employeurs, Sikasso et Kadiolo se distinguent avec des
pourcentages respectifs de 47,6% et 21,4% parmi cette catégorie. De manière similaire aux salariés,
les jeunes en auto-emploi sont prédominants à Sikasso et Koutiala, représentant respectivement 44,2%
et 25,0%.
Indépendamment du statut professionnel, les données suggèrent une proportion significative de jeunes
actifs dans la localité de Sikasso. Cela pourrait indiquer un environnement propice à l'insertion des
jeunes sur le marché du travail dans cette localité.
Tableau 46: Répartition des jeunes en emploi selon la localité et le statut dans l’activité
Localité
Salarié Indépendant Auto-emploi Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 1 1,7 4 9,5 7 13,5 12 7,8
Kadiolo 10 16,9 9 21,4 3 5,8 22 14,4
Kolondièba 2 3,4 2 4,8 2 3,8 6 3,9
Koutiala 13 22,0 6 14,3 13 25,0 32 20,9
Sikasso 29 49,2 20 47,6 23 44,2 72 47,1
Yanfolila 1 1,7 1 2,4 0 0,0 2 1,3
Yorosso 2 3,4 0 0,0 3 5,8 5 3,3
Hors zone 1 1,7 0 0,0 1 1,9 2 1,3
Total 59 100,0 42 100,0 52 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données mettent en évidence les divers modes d'insertion professionnelle des jeunes en fonction
de leur statut. En analysant le salariat, on observe que la majorité des salariés (39,0%) accèdent à leur
emploi grâce à des relations personnelles, suivies par l'exploitation familiale avec 45,8%. Ces résultats
soulignent l'influence cruciale des réseaux personnels et familiaux dans le processus d'insertion
professionnelle pour les salariés.
Pour les jeunes indépendants ou employeurs, l'exploitation familiale joue un rôle significatif,
représentant 61,9%, tandis que les relations personnelles viennent ensuite avec 35,7%. Ces
constatations mettent en lumière l'influence persistante des liens familiaux et personnels, même dans
la création d'emplois indépendants.
En revanche, les jeunes en auto-emploi semblent largement dépendre des relations personnelles,
constituant 80,8% des cas. La création d'une entreprise émerge comme un mode d'insertion
prédominant également, représentant 9,6%. Ces données suggèrent que les jeunes engagés dans
l'auto-emploi ont fréquemment recours à leurs réseaux personnels pour établir et développer leurs
activités.
 |
65 65 |
▲back to top |
64
Ces résultats révèlent une influence marquée des relations personnelles et familiales dans tous les
modes d'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit pour les salariés, les indépendants, ou ceux
engagés dans l'auto-emploi. Cette constatation souligne l'importance cruciale des réseaux sociaux dans
le processus d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes.
Tableau 47: Répartition des jeunes en emploi selon le mode d’obtention et le statut dans l’activité
Mode d'insertion
Salarié Indépendant Auto-emploi Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Relations personnelles 23 39,0 15 35,7 42 80,8 80 52,3
Directement auprès de l’employeur 8 13,6 1 2,4 5 9,6 14 9,2
Petites annonces, médias 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ANPE/APEJ 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 ,7
Bureau Privé de Placement 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Concours 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Créer une entreprise 0 0,0 0 0,0 5 9,6 5 3,3
Exploitation familiale 27 45,8 26 61,9 0 0,0 53 34,6
Total 59 100,0 42 100,0 52 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.5. Métier de la filière agropastorale
L'analyse des données révèle des disparités significatives entre les hommes et les femmes en emploi
dans divers métiers de la filière agropastorale. Tout d'abord, en se concentrant sur le métier de
producteur de pomme de terre de consommation, une nette prédominance masculine est observée,
avec 52,9% d'hommes par rapport à seulement 26,5% de femmes. Cette asymétrie souligne une
inégalité de genre spécifique à ce métier.
Pour le métier de producteur laitier, aucune femme n'est représentée, tandis que 9,2% des hommes
occupent des postes dans ce domaine. Cette absence de représentation féminine indique une forte
concentration des hommes dans le métier de producteur laitier.
Dans le métier de producteur de fourrage, bien que les pourcentages soient relativement faibles, une
disparité est observée avec 6,7% d'hommes et seulement 2,9% de femmes. Cela suggère une
prédominance masculine dans ce métier de la filière agropastorale.
En revanche, pour le métier de producteur de pomme de terre de consommation et de semence, une
répartition plus équilibrée entre les sexes est observée, avec 12,6% d'hommes et 32,4% de femmes.
Cette diversité indique une participation plus équilibrée des deux sexes dans ce métier particulier.
Pour le métier d'éleveur laitier, une forte prédominance féminine est remarquée, avec 38,2% de femmes
par rapport à 10,9% d'hommes. Cette disparité souligne une inversion du déséquilibre de genre par
rapport aux autres métiers, avec une représentation féminine dominante.
Enfin, dans le métier de maintenancier des équipements agricoles (MEA), aucun pourcentage n'est
attribué aux femmes, indiquant une absence de représentation féminine, tandis que 7,6% des hommes
exercent dans ce domaine. Cette spécificité souligne une concentration masculine importante dans ce
métier.
Tableau 48: Répartition des jeunes en emploi selon le métier et le sexe
Métier
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 63 52,9 9 26,5 72 47,1
Producteur laitier 11 9,2 0 0,0 11 7,2
Producteur de fourrage 8 6,7 1 2,9 9 5,9
Producteur de pomme de terre de consommation et
de semence
15 12,6 11 32,4 26 17,0
Éleveur laitier 13 10,9 13 38,2 26 17,0
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 9 7,6 0 0,0 9 5,9
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
66 66 |
▲back to top |
65
Tout d'abord, en observant le métier de "Producteur de pomme de terre de consommation", on constate
une forte présence dans les localités de Sikasso (75,0%), Kadiolo (18,2%), et Koutiala (31,3%). Cette
concentration suggère que la culture de pommes de terre est plus répandue dans ces zones
spécifiques.
Pour le métier de "Producteur laitier", la localité de Yanfolila se distingue avec une prédominance
marquée (50,0%), tandis que Bougouni (16,7%) et Kolondièba (0,0%) ont également leur propre niveau
d'activité. Ces variations soulignent des différences dans la distribution géographique de l'élevage laitier.
Dans le cas du métier de "Producteur de fourrage", une concentration importante est observée dans les
localités de Sikasso (100,0%) et Koutiala (50,0%). Cela indique une spécialisation géographique dans
la production de fourrage.
Pour le métier de "Producteur de pomme de terre de consommation et de semence", les localités de
Kolondièba (66,7%) et Sikasso (28,1%) montrent une forte implication dans cette activité spécifique.
L'élevage laitier, représenté par le métier d'"Éleveur laitier", est particulièrement prononcé dans les
localités de Bougouni (66,7%) et Kadiolo (31,8%). Ces différences géographiques reflètent les
variations dans la prévalence de l'élevage laitier dans différentes régions.
Enfin, pour le métier de "Maintenance des équipements agricoles (MEA)", la localité de Kadiolo se
démarque avec une proportion significative (36,4%), indiquant une concentration plus élevée de cette
activité dans cette zone.
Tableau 49: Répartition des jeunes en emploi selon le métier et la localité
Métier Bougouni Kadiolo Kolondièba Koutiala Sikasso Yanfolila Yorosso
Hors
zone
Total
Producteur de
pomme de terre de
consommation
16,7 18,2 33,3 31,3 75,0 0,0 0,0 0,0 47,1
Producteur laitier 16,7 4,5 0,0 9,4 5,6 0,0 0,0 50,0 7,2
Producteur de
fourrage
0,0 9,1 0,0 9,4 1,4 100,0 0,0 50,0 5,9
Producteur de
pomme de terre de
consommation et
de semence
0,0 0,0 66,7 28,1 12,5 0,0 80,0 0,0 17,0
Éleveur laitier 66,7 31,8 0,0 21,9 4,2 0,0 20,0 0,0 17,0
Maintenance des
équipements
agricoles (MEA)
0,0 36,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.6. Maillon du métier
Dans l'ensemble, le tableau révèle que la grande majorité des jeunes en emploi, soit 73,9%, sont
engagés dans le maillon de la production au sein de la filière agropastorale. Une proportion significative,
soit 19,0%, est attribuée à un autre maillon non spécifié, indiquant une diversité d'activités au sein de
cette catégorie. Les maillons de la transformation et de la commercialisation regroupent 5,9% des
jeunes en emploi, tandis que le maillon de stockage et conservation ne représente que 1,3%.
Indépendamment du sexe, la majorité des jeunes travaillant dans le maillon de la production sont des
hommes, représentant 78,2%. Cependant, il est important de noter que les femmes dans ce maillon ne
sont pas en reste, constituant tout de même 20,8% de la population féminine. Ces résultats suggèrent
une participation significative des femmes dans le processus de production agricole.
 |
67 67 |
▲back to top |
66
Quant au maillon "Autre", la répartition entre les genres est plus équilibrée, avec 15,1% d'hommes et
32,4% de femmes. Cette catégorie non spécifiée englobe probablement une diversité d'activités, et la
forte participation des femmes suggère une variabilité dans les rôles occupés au sein de cette
classification.
Ces données mettent en lumière une diversité de participation entre les hommes et les femmes au sein
des différents maillons de la filière agropastorale. Alors que les hommes prédominent dans la production
et le stockage, les femmes jouent un rôle important dans des activités non spécifiées.
Tableau 50: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et le sexe
Maillon
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Production 93 78,2 20 58,8 113 73,9
Stockage et conservation 2 1,7 0 0,0 2 1,3
Transformation et commercialisation 6 5,0 3 8,8 9 5,9
Autre 18 15,1 11 32,4 29 19,0
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Quelle que soit la modalité de formation, le maillon de la production se distingue avec les proportions
les plus importantes, représentant 84,8% pour la formation par apprentissage et 57,4% pour la formation
qualifiante. Cette prédominance suggère une forte incidence de l'apprentissage dans l'acquisition des
compétences liées à la production agropastorale, mais également une contribution significative de la
formation qualifiante.
En revanche, pour le maillon du stockage et de la conservation, les proportions de jeunes en emploi
issus de la formation par apprentissage et de la formation qualifiante sont relativement faibles, avec
1,1% et 1,6% respectivement. Ces résultats suggèrent une diversification des méthodes de formation
dans ce maillon, indiquant que les compétences nécessaires peuvent être acquises de différentes
manières.
Le maillon de la transformation et de la commercialisation présente une répartition plus équilibrée entre
l'apprentissage (3,3%) et la formation qualifiante (9,8%). Cela suggère que les jeunes impliqués dans
la transformation et la commercialisation ont acquis leurs compétences par différentes voies de
formation, démontrant une certaine flexibilité dans les approches éducatives.
Pour le maillon "Autre", une proportion notable d'individus ayant suivi une formation qualifiante est
observée, représentant 31,1%. Cela suggère que les activités non spécifiées regroupées dans ce
maillon peuvent nécessiter des compétences spécifiques acquises par le biais de formations
qualifiantes. En comparaison, 10,9% des jeunes ont suivi une formation en apprentissage, soulignant
une diversité dans les méthodes de préparation à ces activités non spécifiées.
En résumé, ces données soulignent des variations significatives dans la préférence de la modalité de
formation en fonction du maillon occupé. L'apprentissage prédomine dans la production, tandis que la
formation qualifiante est plus présente dans le maillon "Autre".
Tableau 51: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et le type de formation
Maillon
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Production 78 84,8 35 57,4 113 73,9
Stockage et conservation 1 1,1 1 1,6 2 1,3
Transformation et commercialisation 3 3,3 6 9,8 9 5,9
Autre 10 10,9 19 31,1 29 19,0
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le maillon de la production montre une prédominance marquée dans la filière de la pomme de terre,
avec une proportion élevée de 82,2%. En revanche, la filière du lait local, bien que représentée, affiche
une proportion relativement plus basse à 54,3%. Ces données suggèrent une spécialisation marquée
des activités de production, avec une focalisation significative sur la filière de la pomme de terre.
 |
68 68 |
▲back to top |
67
Concernant le maillon du stockage et conservation, les effectifs sont limités dans les deux filières,
indiquant une répartition relativement équilibrée entre la pomme de terre (0,9%) et le lait local (2,2%).
Ces résultats laissent entendre que les activités de stockage et conservation ne sont pas fortement liées
à une filière spécifique, mais plutôt distribuées de manière équitable entre les deux.
Le maillon "Autre" présente une dominante marquée de la filière du lait local, représentant 32,6%, tandis
que la pomme de terre constitue 13,1%. Cette asymétrie indique une prévalence plus marquée des
activités non spécifiées dans la filière du lait local.
En résumé, ces résultats soulignent une spécialisation distincte du maillon de la production dans la
filière de la pomme de terre, tandis que les autres maillons répartissent leurs activités de manière plus
équilibrée entre les filières.
Tableau 52: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et la filière
Maillon
Pomme de
terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Production 88 82,2 25 54,3 113 73,9
Stockage et conservation 1 ,9 1 2,2 2 1,3
Transformation et commercialisation 4 3,7 5 10,9 9 5,9
Autre 14 13,1 15 32,6 29 19,0
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant la répartition des jeunes en emploi par maillon et statut dans l’activité, la majorité se
trouve dans le maillon de la production avec 113 jeunes (73,9%). Parmi eux, 41 (36,3%) sont des
salariés, 35 (31,0%) sont des indépendants /employeurs, et 37 (32,7%) sont impliqués dans l'auto-
emploi.
Dans le maillon du stockage et de la conservation, deux jeunes sont employés, dont un en tant que
salarié et l'autre dans l'auto-emploi. Le maillon de la transformation et de la commercialisation compte
neuf jeunes, avec cinq en tant que salariés, trois en tant qu'indépendants, et un impliqué dans l'auto-
emploi.
Pour le maillon "Autre", 29 jeunes sont répartis avec 12 (41,4%) en tant que salariés, quatre (13,8%) en
tant qu'indépendants, et 13 (44,8%) dans l'auto-emploi.
En résumé, ces données mettent en évidence la diversité des rôles occupés par les jeunes dans
différents maillons de l'activité économique. Le maillon de la production attire le plus grand nombre de
jeunes, et la répartition entre salariés, indépendants et auto-emploi varie en fonction du maillon
spécifique. Cette analyse offre une perspective détaillée sur l'implication des jeunes dans différents
aspects de l'activité économique.
Tableau 53: Répartition des jeunes en emploi selon le maillon et le statut dans l’activité
Maillon Salarié Indépendant
Auto-
emploi Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 41 36,3 35 31,0 37 113 100,0
Stockage et conservation 1 50,0 0 0,0 1 2 100,0
Transformation et commercialisation 5 55,6 3 33,3 1 9 100,0
Autre 12 41,4 4 13,8 13 29 100,0
Total 59 38,6 42 27,5 52 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
69 69 |
▲back to top |
68
2.3.1.7. Temps de travail
Dans l'ensemble, l'analyse du tableau révèle une diversité significative dans les habitudes de travail des
jeunes de la cohorte 2022. Parmi eux, 19,0% travaillent moins de 35 heures, 33,3% entre 35 et 48
heures, et 47,7% plus de 48 heures par semaine. Cette répartition met en lumière la variabilité des
pratiques de travail, notamment une proportion importante de travailleurs dépassant les 48 heures
hebdomadaires.
En observant les différences entre les sexes, on constate que 15,1% des hommes travaillent moins de
35 heures, 31,1% entre 35 et 48 heures, et 53,8% plus de 48 heures. En revanche, parmi les femmes,
la majorité (41,2%) respecte l'horaire de travail standard défini par la législation malienne. Cependant,
32,4% des femmes travaillent moins de 35 heures et 26,5% plus de 48 heures. Un motif fréquent évoqué
par ces femmes pour travailler en dehors des heures normales est que leur employeur a fixé ces
horaires.
Notamment, la proportion d'hommes travaillant plus de 48 heures par semaine est significativement
plus élevée que celle des femmes dans cette catégorie (53,8% contre 26,5%), indiquant une disparité
notable dans les horaires de travail entre les genres. Les hommes qui dépassent plus de 48 heures
motivent souvent leur temps de travail par l'horaire fixé par l'employeur (43,8%) et la nécessité de
travailler davantage pour suivre le rythme (40,6%). 2
Tableau 54: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le sexe
Horaires hebdomadaire
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Moins de 35 heures 18 15,1 11 32,4 29 19,0
35-48 heures 37 31,1 14 41,2 51 33,3
Plus de 48 heures 64 53,8 9 26,5 73 47,7
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Premièrement, dans le maillon de Production, la majorité des jeunes (48,7%) travaillent plus de 48
heures par semaine, indiquant une forte implication et une charge de travail significative dans ce
secteur. En comparaison, 35,4% travaillent entre 35 et 48 heures, tandis que 15,9% travaillent moins
de 35 heures.
En ce qui concerne le maillon de Stockage et conservation, tous les travailleurs (100,0%) ont une durée
de travail entre 35 et 48 heures par semaine. Cette uniformité suggère une régularité dans les horaires
de travail au sein de ce maillon spécifique. Dans le maillon de Transformation et commercialisation, une
proportion significative de jeunes (51,7%) travaille plus de 48 heures par semaine, dénotant une charge
de travail importante. Cependant, on observe également une diversité, avec 44,4% travaillant moins de
35 heures et 22,2% travaillant entre 35 et 48 heures.
Enfin, dans le maillon Autre, la majorité des travailleurs (51,7%) travaillent plus de 48 heures par
semaine, avec une répartition relativement équilibrée entre ceux travaillant moins de 35 heures (24,1%)
et entre 35 et 48 heures (24,1%).
En résumé, l'analyse de ces informations met en évidence des variations significatives dans la durée
hebdomadaire de travail en fonction des maillons, reflétant la diversité des engagements horaires dans
différents secteurs d'activité.
2 Voir Annexe 1 : Motifs de travailler plus de 48 heures ou moins de 35 ans
 |
70 70 |
▲back to top |
69
Tableau 55: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le maillon
Maillon
Moins de 35
heures
35-48 heures Plus de 48
heures Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 18 15,9 40 35,4 55 48,7 113 100,0
Stockage et conservation 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Transformation et commercialisation 4 44,4 2 22,2 3 33,3 9 100,0
Autre 7 24,1 7 24,1 15 51,7 29 100,0
Total 29 19,0 51 33,3 73 47,7 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans la filière Pomme de terre, la majorité des jeunes (52,3%) travaille plus de 48 heures par semaine,
ce qui représente une part significative de l'effectif total dans cette filière. En comparaison, 30,8%
travaillent entre 35 et 48 heures, tandis que 16,8% travaillent moins de 35 heures. Cela indique une
prévalence notable de longues heures de travail dans cette filière spécifique.
En ce qui concerne la filière Lait local, une proportion importante de jeunes (39,1%) travaille entre 35 et
48 heures par semaine. On observe également que 37,0% travaillent plus de 48 heures, ce qui souligne
une charge de travail significative. En revanche, 23,9% travaillent moins de 35 heures. Ces résultats
indiquent une diversité d'engagements horaires dans la filière Lait local.
L'analyse de ces informations met en lumière des variations significatives dans la durée hebdomadaire
de travail en fonction des filières. La filière Pomme de terre se distingue par une forte prévalence de
longues heures de travail, tandis que la filière Lait local présente une diversité d'engagements horaires,
avec une proportion importante de jeunes travaillant entre 35 et 48 heures par semaine.
Tableau 56: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et la filière
Horaires hebdomadaire
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Moins de 35 heures 18 16,8 11 23,9 29 19,0
35-48 heures 33 30,8 18 39,1 51 33,3
Plus de 48 heures 56 52,3 17 37,0 73 47,7
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Parmi les Producteurs de pomme de terre de consommation, on constate que la majorité (61,1%)
travaille plus de 48 heures par semaine. En revanche, 30,6% travaillent entre 35 et 48 heures, et 8,3%
travaillent moins de 35 heures. Cela suggère une tendance significative vers des horaires de travail
prolongés dans cette catégorie de producteurs.
Pour les Producteurs laitiers, une proportion importante (45,5%) travaille entre 35 et 48 heures, suivie
de ceux travaillant moins de 35 heures (18,2%). Le pourcentage de ceux travaillant plus de 48 heures
est de 36,4%.
Les Producteurs de fourrage présentent une répartition relativement équilibrée entre les différentes
plages horaires, avec des pourcentages égaux (33,3%) pour moins de 35 heures, entre 35 et 48 heures,
et plus de 48 heures. Les Producteurs de pomme de terre de consommation et de semence, ainsi que
les Éleveurs laitiers, affichent des pourcentages similaires pour les trois catégories d'horaires de travail,
indiquant une certaine variabilité dans la durée hebdomadaire de travail au sein de ces métiers.
Enfin, pour les maintenanciers des équipements agricoles (MEA), la majorité (44,4%) travaille moins de
35 heures, tandis que 33,3% travaillent plus de 48 heures, soulignant une diversité importante dans
cette catégorie.
 |
71 71 |
▲back to top |
70
Tableau 57: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le métier
Métier
Moins de 35
heures
35-48 heures Plus de 48
heures Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de
consommation
6 8,3 22 30,6 44 61,1 72 100,0
Producteur laitier 2 18,2 5 45,5 4 36,4 11 100,0
Producteur de fourrage 3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 100,0
Producteur de pomme de terre de
consommation et de semence
8 30,8 9 34,6 9 34,6 26 100,0
Éleveur laitier 6 23,1 10 38,5 10 38,5 26 100,0
Maintenance des équipements agricoles 4 44,4 2 22,2 3 33,3 9 100,0
Total 29 19,0 51 33,3 73 47,7 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant les différentes plages horaires, on observe des variations significatives en fonction du
statut. Pour les jeunes en emploi travaillant moins de 35 heures par semaine, la majorité (41,4%) est
engagée dans l'auto-emploi, suivie de près par les salariés (37,9%). Les indépendants représentent
également une part notable à 20,7%. Cette répartition met en évidence la diversité des statuts dans
cette catégorie d'horaires.
Dans la plage horaire de 35 à 48 heures par semaine, indépendants (37,3%) constituent la plus grande
proportion suivis de près par les personnes en auto-emploi (33,3%) et les salariés (29,4%). Cela indique
une répartition relativement équilibrée des différents statuts dans cette plage horaire.
En ce qui concerne ceux travaillant plus de 48 heures par semaine, une majorité significative (45,2%)
est constituée de salariés, indiquant une propension plus élevée des salariés à travailler des heures
supplémentaires. Les indépendants représentent 23,3%, tandis que ceux en auto-emploi constituent
31,5% de cette catégorie.
Cette analyse met en lumière des associations intéressantes entre la durée hebdomadaire de travail et
les différents statuts dans l'activité, soulignant la diversité des conditions d'emploi parmi les jeunes de
la cohorte 2022.
Tableau 58: Répartition des jeunes en emploi selon la durée hebdomadaire de travail et le statut dans l’activité
Horaire hebdomadaire
Salarié Indépendant Auto-emploi Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Moins de 35 heures 11 37,9 6 20,7 12 41,4 29 100,0
35-48 heures 15 29,4 19 37,3 17 33,3 51 100,0
Plus de 48 heures 33 45,2 17 23,3 23 31,5 73 100,0
Total 59 38,6 42 27,5 52 34,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.8. Type d’activité
En termes globaux, le tableau ci-après illustre une différence notable dans la répartition des jeunes en
emploi selon le type d'activité. La majorité, soit 63,4%, est engagée dans des activités occasionnelles,
tandis que 36,6% sont impliqués dans des activités permanentes.
En décomposant ces données par genre, une disparité significative se manifeste. Parmi les hommes,
68,9% participent à des activités occasionnelles, tandis que 31,1% sont impliqués dans des activités
permanentes. À l'inverse, chez les femmes, la majorité (55,9%) est engagée dans des activités
permanentes, tandis que 44,1% sont impliquées dans des activités occasionnelles.
Cette distinction entre hommes et femmes dans le choix entre activités occasionnelles et permanentes
souligne une variation significative dans la nature de l'emploi occupé. Ces différences peuvent être
influencées par divers facteurs tels que les opportunités disponibles sur le marché du travail, et les
contraintes personnelles ou socioculturelles.
 |
72 72 |
▲back to top |
71
Tableau 59: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le sexe
Type d'activité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Occasionnelle 82 68,9 15 44,1 97 63,4
Permanente 37 31,1 19 55,9 56 36,6
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Pour la tranche d'âge de 15 à 24 ans, la majorité des jeunes en emploi (50,9%) s'engage dans des
activités occasionnelles, tandis que 49,1% optent pour des activités permanentes. Cette répartition
relativement équilibrée suggère une diversité dans les choix d'emploi parmi les jeunes de cette catégorie
d'âge.
Dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, une tendance plus marquée se dessine avec 68,8% des jeunes
participant à des activités occasionnelles et 31,2% à des activités permanentes. Cette prévalence des
activités occasionnelles pourrait refléter des caractéristiques spécifiques du marché du travail pour cette
catégorie d'âge, telles que des opportunités temporaires ou des emplois indépendants.
Notamment, pour la catégorie des plus de 35 ans, tous les jeunes en emploi (100,0%) sont engagés
dans des activités occasionnelles. Cela pourrait indiquer des choix professionnels spécifiques ou des
opportunités d'emploi limitées pour cette tranche d'âge.
L'analyse de la répartition des jeunes en emploi selon le type d'activité et la tranche d'âge révèle des
variations significatives, mettant en lumière l'influence potentielle de la maturité professionnelle et des
opportunités sur les choix d'emploi.
Tableau 60: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et la tranche d’âge
Tranche d'âge
Occasionnelle Permanente Total
Effectif % Effectif % Effectif %
15 - 24 ans 28 50,9 27 49,1 55 100,0
25 - 35 ans 64 68,8 29 31,2 93 100,0
Plus de 35 ans 5 100,0 0 0,0 5 100,0
Total 97 63,4 56 36,6 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Pour les activités occasionnelles, la majorité des jeunes (78,3%) ont suivi une formation en
apprentissage, tandis que 41,0% ont suivi une formation qualifiante. Cette prévalence de
l'apprentissage suggère que ces jeunes tendent à s'engager dans des activités occasionnelles qui
nécessitent des compétences spécifiques acquises par le biais de programmes d'apprentissage.
En revanche, pour les activités permanentes, une tendance inverse se dessine, avec 59,0% des jeunes
ayant suivi une formation qualifiante et 21,7% en apprentissage. Cela indique que les jeunes engagés
dans des activités permanentes ont tendance à détenir des qualifications formelles plus avancées, ce
qui peut être nécessaire dans des emplois plus stables et spécialisés.
En résumé, l'analyse de la répartition des jeunes en emploi selon le type d'activité et le type de formation
souligne une corrélation entre le choix d'activité (occasionnelle ou permanente) et le type de formation
suivie. Elle met en lumière l'impact potentiel du niveau de formation sur la nature des emplois occupés
par les jeunes.
Tableau 61: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le type de formation
Type d'activité
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Occasionnelle 72 78,3 25 41,0 97 63,4
Permanente 20 21,7 36 59,0 56 36,6
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En ce qui concerne la filière de la pomme de terre, la grande majorité des jeunes (83,2%) sont impliqués
dans des activités occasionnelles, ce qui suggère une prévalence d'emplois temporaires ou saisonniers.
 |
73 73 |
▲back to top |
72
En revanche, seulement 16,8% sont engagés dans des activités permanentes, soulignant la nature
souvent éphémère des emplois liés à la culture ou à la production de pommes de terre.
Pour la filière du lait local, la tendance est inverse, avec une majorité écrasante de jeunes (82,6%)
participant à des activités permanentes. Seulement 17,4% sont impliqués dans des activités
occasionnelles, indiquant que les opportunités d'emploi dans la filière du lait local sont plus souvent
liées à des engagements professionnels à long terme.
L'analyse de cette répartition souligne les disparités marquées entre les deux filières, mettant en lumière
la prédominance d'emplois occasionnels dans la pomme de terre et d'emplois permanents dans le lait
local. Ces données offrent des indications précieuses sur la nature et la stabilité des emplois dans ces
deux filières agropastorales.
Tableau 62: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et la filière
Filière
Occasionnelle Permanente Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Pomme de terre 89 83,2 18 16,8 107 100,0
Lait local 8 17,4 38 82,6 46 100,0
Total 97 63,4 56 36,6 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans le maillon le maillon de la production, la grande majorité des jeunes (76,1%) sont impliqués dans
des activités occasionnelles, indiquant une prévalence d'emplois temporaires ou liés à des saisons
spécifiques. En revanche, 23,9% des jeunes sont engagés dans des activités permanentes au sein du
maillon de la production, suggérant la présence d'emplois plus stables et à plus long terme.
Concernant le maillon du stockage et de la conservation, la répartition est équilibrée, avec 50% des
jeunes impliqués dans des activités occasionnelles et 50% dans des activités permanentes. Cela
suggère une certaine diversité dans la nature des emplois liés au stockage et à la conservation.
Pour le maillon de la transformation et de la commercialisation, une majorité significative de jeunes
(66,7%) est engagée dans des activités permanentes, mettant en évidence des opportunités d'emploi
plus stables dans ce secteur. Cependant, 33,3% des jeunes sont impliqués dans des activités
occasionnelles, soulignant la variabilité des emplois dans ce maillon.
Enfin, dans la catégorie "Autre", une majorité écrasante de jeunes (75,9%) est impliquée dans des
activités permanentes, montrant une stabilité accrue dans les emplois liés à ce maillon. Cependant,
24,1% des jeunes sont impliqués dans des activités occasionnelles, indiquant une diversité dans la
nature des emplois au sein de cette catégorie.
Cette analyse met en lumière les différences significatives entre les maillons de la chaîne d'activités,
avec une prédominance d'emplois occasionnels dans la production et une tendance vers des emplois
permanents dans d'autres maillons, notamment la transformation, la commercialisation, et les activités
classées comme "Autre".
Tableau 63: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le maillon
Maillon
Occasionnelle Permanente Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Production 86 76,1 27 23,9 113 100,0
Stockage et conservation 1 50,0 1 50,0 2 100,0
Transformation et commercialisation 3 33,3 6 66,7 9 100,0
Autre 7 24,1 22 75,9 29 100,0
Total 97 63,4 56 36,6 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Cette analyse met en lumière des disparités dans la nature des emplois selon les zones géographiques.
À Bougouni, une majorité de jeunes (58,3%) est impliquée dans des activités permanentes, soulignant
une stabilité dans l'offre d'emplois dans cette localité. De manière similaire, à Kadiolo, 68,2% des jeunes
 |
74 74 |
▲back to top |
73
participent à des activités permanentes, indiquant également une prédominance d'emplois plus stables
dans cette zone.
En revanche, Kolondièba présente une préférence marquée pour les activités occasionnelles, avec
83,3% des jeunes impliqués dans ce type d'emploi. Seuls 16,7% sont engagés dans des activités
permanentes. De même, Sikasso se distingue par une forte prévalence d'activités occasionnelles,
touchant 81,9% des jeunes, tandis que seulement 18,1% sont engagés dans des activités permanentes.
Malgré une majorité de jeunes impliqués dans des activités occasionnelles à Koutiala (53,1%), une
proportion notable (46,9%) participe à des activités permanentes. La localité de Yorosso présente
également une répartition relativement équilibrée, avec 60,0% des jeunes participant à des activités
permanentes et 40,0% à des activités occasionnelles, reflétant une diversité dans l'offre d'emplois.
La particularité de Yanfolila est que tous les jeunes (100,0%) sont impliqués dans des activités
occasionnelles, suggérant une prédominance d'emplois temporaires dans cette localité. Dans la
catégorie "Hors zone", tous les jeunes sont engagés dans des activités permanentes, suggérant une
certaine stabilité dans l'offre d'emplois en dehors des zones spécifiques mentionnées.
Tableau 64: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et la localité
Localité
Occasionnelle Permanente Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 5 41,7 7 58,3 12 100,0
Kadiolo 7 31,8 15 68,2 22 100,0
Kolondièba 5 83,3 1 16,7 6 100,0
Koutiala 17 53,1 15 46,9 32 100,0
Sikasso 59 81,9 13 18,1 72 100,0
Yanfolila 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Yorosso 2 40,0 3 60,0 5 100,0
Hors zone 0 0,0 2 100,0 2 100,0
Total 97 63,4 56 36,6 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse met en lumière des tendances significatives dans la répartition des jeunes en emploi selon le
type d'activité et le métier. Une majorité écrasante de Producteurs de pomme de terre de consommation
(95,8%) est engagée dans des activités occasionnelles, suggérant une prédominance d'emplois
temporaires dans cette catégorie. De même, les Producteurs de pomme de terre de consommation et
de semence montrent une inclination marquée vers les activités occasionnelles, avec 65,4% de jeunes
concernés, comparativement à 34,6% impliqués dans des activités permanentes.
En revanche, pour les Producteurs laitiers, une forte majorité (90,9%) participe à des activités
permanentes, soulignant la stabilité significative dans ce secteur. Cette tendance est également
observée chez les Éleveurs laitiers, où 80,8% sont engagés dans des activités permanentes,
témoignant d'une stabilité substantielle dans les emplois liés à l'élevage laitier.
Pour les Maintenanciers des équipements agricoles (MEA), une proportion notable (66,7%) est
impliquée dans des activités permanentes, tandis que 33,3% sont engagés dans des activités
occasionnelles, soulignant ainsi la diversité dans les modalités d'emploi au sein de cette catégorie de
métier.
En résumé, cette analyse révèle des disparités significatives dans la nature des emplois en fonction des
métiers, avec une prévalence marquée d'activités occasionnelles dans certains secteurs et une stabilité
dans d'autres.
 |
75 75 |
▲back to top |
74
Tableau 65: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le métier
Métier
Occasionnelle Permanente Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 69 95,8 3 4,2 72 100,0
Producteur laitier 1 9,1 10 90,9 11 100,0
Producteur de fourrage 2 22,2 7 77,8 9 100,0
Producteur de pomme de terre de consommation et
de semence
17 65,4 9 34,6 26 100,0
Éleveur laitier 5 19,2 21 80,8 26 100,0
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 3 33,3 6 66,7 9 100,0
Total 97 63,4 56 36,6 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant ces données, on constate que les jeunes en emploi sont engagés dans des activités
occasionnelles et permanentes, et leur statut varie en fonction de ces deux types d'activités. Parmi ceux
impliqués dans des activités occasionnelles, les salariés représentent la plus grande proportion avec
38,1%, suivis de près par les indépendants à 30,9%. Les personnes en auto-emploi constituent
également une part significative avec 30,9%. Cela suggère une diversité dans les types d'activités
occasionnelles, avec une distribution relativement équilibrée entre les différents statuts.
De même, pour les activités permanentes, les salariés restent majoritaires avec 39,3%, suivis de près
par ceux en auto-emploi à la même proportion. Les indépendants représentent une part plus faible avec
21,4%. Cette répartition souligne une prévalence plus élevée des salariés dans les activités
permanentes.
L'analyse de ces informations révèle des tendances intéressantes, montrant comment le type d'activité
influence le statut dans l'activité des jeunes en emploi. Les nuances entre les activités occasionnelles
et permanentes mettent en évidence la diversité des situations professionnelles au sein de cette
cohorte.
Tableau 66: Répartition des jeunes en emploi selon le type d’activité et le statut dans l’activité
Statut dans l'activité
Occasionnelle Permanente Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 37 38,1 22 39,3 59 38,6
Indépendant 30 30,9 12 21,4 42 27,5
Auto-emploi 30 30,9 22 39,3 52 34,0
Total 97 100,0 56 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.9. Type de contrats
L'analyse de ces données met en lumière des tendances intéressantes en termes de formalisation des
relations professionnelles. En examinant les hommes, on observe que 25,2% ont des accords verbaux,
3,4% ont des contrats écrits, et la majorité, soit 71,4%, n'ont aucun contrat formel. Pour les femmes, les
pourcentages correspondants sont de 26,5%, 0,0%, et 73,5%, respectivement. Ces chiffres suggèrent
que la majorité des jeunes, indépendamment du sexe, sont engagés dans des emplois sans contrat
formel, ce qui peut avoir des implications sur la stabilité et les droits des travailleurs.
Il est intéressant de noter l'absence totale de contrats écrits pour les femmes, ce qui soulève des
questions sur la sécurité et les conditions de travail auxquelles ces travailleuses peuvent être exposées.
Cette analyse révèle une prévalence notable d'accords verbaux et une fréquence élevée de l'absence
totale de contrats formels parmi les jeunes en emploi, indépendamment de leur sexe. Ces résultats
soulèvent des considérations importantes sur la formalisation des relations de travail dans cette cohorte.
 |
76 76 |
▲back to top |
75
Tableau 67: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et sexe
Type de contrat
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Contrat écrit 4 3,4 0 0,0 4 2,6
Accord verbal 30 25,2 9 26,5 39 25,5
Rien du tout 85 71,4 25 73,5 110 71,9
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de ces données met en évidence des variations dans la formalisation des relations
professionnelles en fonction des deux filières agropastorales. Pour la filière de la pomme de terre, on
constate que 19,6% des jeunes ont des accords verbaux, 2,8% ont des contrats écrits, et la grande
majorité, soit 77,6%, n'a aucun contrat formel. En revanche, pour la filière du lait local, 39,1% des jeunes
ont des accords verbaux, 2,2% ont des contrats écrits, et 58,7% n'ont aucun contrat formel. Ces chiffres
suggèrent des différences significatives dans la formalisation des relations de travail entre les filières.
Il est intéressant de noter que, dans la filière du lait local, la proportion de jeunes avec des accords
verbaux est plus élevée que dans la filière de la pomme de terre. Cela pourrait indiquer des pratiques
de travail plus formalisées ou des structures professionnelles distinctes dans la filière du lait local.
Tableau 68: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et filière
Type de contrat
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Contrat écrit 3 2,8 1 2,2 4 2,6
Accord verbal 21 19,6 18 39,1 39 25,5
Rien du tout 83 77,6 27 58,7 110 71,9
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de ces données révèle des tendances significatives dans la formalisation des relations
professionnelles selon les métiers spécifiques. Pour les producteurs de pomme de terre de
consommation, une écrasante majorité (80,6%) occupe des emplois informels, tandis que 15,3% ont
des accords verbaux et seulement 4,2% ont des contrats écrits. Cela indique une prédominance
marquée d'emplois non formels dans cette catégorie de métier.
Dans le cas des producteurs laitiers, la majorité (54,5%) a des accords verbaux, 45,5% n'ont aucun
contrat formel. De manière similaire, pour les éleveurs laitiers, une majorité (57,7%) a des accords
verbaux, et 42,3% n'ont aucun contrat formel. Aucun laitier ne détient de contrat écrit. Cette tendance
suggère une certaine formalisation des relations professionnelles dans ces métiers, principalement
basée sur des accords verbaux.
Les producteurs de fourrage présentent une répartition relativement équilibrée, avec 66,7% sans contrat
formel, 22,2% avec des accords verbaux, et 11,1% avec des contrats écrits. De même, pour les
maintenanciers des équipements agricoles (MEA), la grande majorité (77,8%) n'a aucun contrat formel,
22,2% ont des accords verbaux, et aucun n'a de contrat écrit. Cette répartition souligne une
prédominance d'emplois informels dans ces catégories de métiers.
 |
77 77 |
▲back to top |
76
Tableau 69: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et métier
Métier
Contrat écrit Accord verbal Rien du tout Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de
consommation
3 4,2 11 15,3 58 80,6 72 100,0
Producteur laitier 0 0,0 5 45,5 6 54,5 11 100,0
Producteur de fourrage 1 11,1 2 22,2 6 66,7 9 100,0
Producteur de pomme de terre de
consommation et de semence
0 0,0 8 30,8 18 69,2 26 100,0
Éleveur laitier 0 0,0 11 42,3 15 57,7 26 100,0
Maintenance des équipements agricoles 0 0,0 2 22,2 7 77,8 9 100,0
Total 4 2,6 39 25,5 110 71,9 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de ces données met en lumière des tendances significatives dans la formalisation des contrats
en fonction du type de formation des jeunes en emploi. Les résultats révèlent que pour les contrats
écrits, 4,3% des jeunes ayant suivi une formation en apprentissage détiennent un contrat, tandis que
ceux ayant une formation qualifiante n'ont aucun contrat écrit.
En ce qui concerne les accords verbaux, une proportion importante de jeunes ayant suivi une formation
en apprentissage (19,6%) a ce type d'accord, mais cette proportion augmente significativement à 34,4%
pour ceux ayant suivi une formation qualifiante. Cela suggère une préférence accrue pour les accords
verbaux parmi les jeunes ayant suivi des formations qualifiantes.
En revanche, pour ceux qui n'ont aucun contrat formel, la majorité est constituée de jeunes ayant suivi
une formation par apprentissage (76,1%), tandis que 65,6% de ceux ayant suivi une formation
qualifiante se trouvent dans la même situation. Ces résultats indiquent une tendance vers des emplois
informels, en particulier parmi les jeunes ayant suivi une formation qualifiante.
Les données soulignent des variations significatives dans la formalisation des contrats en fonction du
type de formation des jeunes en emploi, mettant en évidence l'importance de considérer ce facteur dans
l'analyse des modalités d'emploi.
Tableau 70: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et type de formation
Type de contrat
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Contrat écrit 4 4,3 0 0,0 4 2,6
Accord verbal 18 19,6 21 34,4 39 25,5
Rien du tout 70 76,1 40 65,6 110 71,9
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de ces données révèle des tendances significatives dans la formalisation des contrats en
fonction des maillons spécifiques de l'activité. Pour le maillon de production, on observe une faible
proportion de jeunes (2,7%) détenant des contrats écrits, tandis que 23,9% ont des accords verbaux,
et la grande majorité (73,5%) n'a aucun contrat formel. Cette répartition suggère une prédominance
d'emplois informels dans le maillon de production.
En ce qui concerne le maillon de stockage et conservation, aucun jeune n'a de contrat écrit ou verbal,
et tous sont sans contrat formel. Bien que le nombre d'individus soit limité dans cette catégorie, cela
indique une absence de formalisation contractuelle dans ce maillon.
Pour le maillon de transformation et commercialisation, une proportion marginale (3,4%) a des contrats
écrits, 22,2% ont des accords verbaux, et la majorité (77,8%) n'a aucun contrat formel. Cela suggère
une prévalence d'emplois informels dans ce maillon également.
Enfin, pour le maillon "Autre", 3,4% des jeunes ont des contrats écrits, 34,5% ont des accords verbaux,
et la majorité (62,1%) n'a aucun contrat formel. Ces résultats indiquent une diversité dans la
formalisation des contrats au sein de cette catégorie, avec une proportion significative d'emplois
informels.
 |
78 78 |
▲back to top |
77
Tableau 71: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et maillon
Maillon
Contrat écrit Accord verbal Rien du tout Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 3 2,7 27 23,9 83 73,5 113 100,0
Stockage et conservation 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0
Transformation et commercialisation 0 0,0 2 22,2 7 77,8 9 100,0
Autre 1 3,4 10 34,5 18 62,1 29 100,0
Total 4 2,6 39 25,5 110 71,9 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de ce tableau ci-dessous met en évidence des variations dans la formalisation des contrats
en fonction des tranches d'âge des jeunes en emploi. Pour la tranche d'âge de 15 à 24 ans, aucun jeune
n'a de contrat écrit, 32,7% ont des accords verbaux, et la majorité significative (67,3%) n'a aucun contrat
formel. Cela suggère une tendance vers des emplois informels plus fréquents dans cette tranche d'âge.
Dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, une petite proportion (4,3%) a des contrats écrits, 22,6% ont des
accords verbaux, et la majorité (73,1%) n'a aucun contrat formel. Bien que la formalisation des contrats
soit légèrement plus élevée dans cette tranche d'âge par rapport à la précédente, une grande partie des
jeunes continuent de travailler sans contrat formel.
Pour la tranche d'âge de plus de 35 ans, tous les jeunes (100,0%) n'ont aucun contrat formel. Cela peut
indiquer une tendance à l'informalité plus prononcée dans cette catégorie d'âge.
En résumé, l'analyse de ces données souligne des différences notables dans la formalisation des
contrats en fonction des tranches d'âge, avec une prédominance d'emplois informels, en particulier
parmi les jeunes de 15 à 24 ans.
Tableau 72: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et la tranche d’âge
Tranche d'âge
Contrat écrit Accord verbal Rien du tout Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
15 - 24 ans 0 0,0 18 32,7 37 67,3 55 100,0
25 - 35 ans 4 4,3 21 22,6 68 73,1 93 100,0
Plus de 35 ans 0 0,0 0 0,0 5 100,0 5 100,0
Total 4 2,6 39 25,5 110 71,9 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de ce tableau révèle des différences significatives dans la formalisation des contrats en
fonction du statut dans l'activité des jeunes en emploi. Pour les salariés, une proportion très faible (1,7%)
a des contrats écrits, 37,3% ont des accords verbaux, et la majorité (61,0%) n'a aucun contrat formel.
Cette distribution suggère une prévalence importante d'emplois informels parmi les salariés.
Pour les travailleurs indépendants, une proportion légèrement plus élevée (4,8%) a des contrats écrits,
33,3% ont des accords verbaux, et la majorité (61,9%) n'a aucun contrat formel. Bien que la
formalisation soit un peu plus élevée pour les indépendants par rapport aux salariés, la majorité continue
de travailler sans contrat formel.
En ce qui concerne les travailleurs en auto-emploi, une petite proportion (1,9%) a des contrats écrits,
5,8% ont des accords verbaux, et la grande majorité (92,3%) n'a aucun contrat formel. Cette répartition
souligne une prédominance marquée d'emplois informels parmi les travailleurs en auto-emploi.
En résumé, l'analyse de ces données indique une faible formalisation des contrats, en particulier parmi
les salariés et les travailleurs en auto-emploi, avec une majorité travaillant sans contrat formel.
 |
79 79 |
▲back to top |
78
Tableau 73: Répartition des jeunes en emploi par type de contrats et statut dans l’activité
Statut dans l'activité
Contrat
écrit
Accord
verbal
Rien du tout
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 1 1,7 22 37,3 36 61,0 59 100,0
Indépendant 2 4,8 14 33,3 26 61,9 42 100,0
Auto-emploi 1 1,9 3 5,8 48 92,3 52 100,0
Total 4 2,6 39 25,5 110 71,9 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.10. Mode de paiement des jeunes
En analysant la répartition par mode de paiement, on observe que la majorité des jeunes travailleurs,
indépendamment du sexe, reçoivent leur rémunération sous forme de bénéfices, totalisant 51,0% de
l'échantillon avec 78 individus. La rémunération à la tâche arrive en deuxième position, concernant
23,5% de l'échantillon avec 36 individus.
Notamment, la répartition par sexe confirme que, quel que soit le genre, la prédominance des bénéfices
comme mode de paiement demeure, suivie par la rémunération à la tâche. En revanche, la commission
est le mode de paiement le moins fréquent, affectant exclusivement un individu, représentant 0,7% de
l'échantillon total, et se limitant aux hommes.
Dans l'ensemble, ces données mettent en évidence des disparités de rémunération entre les sexes,
soulignant la préférence généralisée pour les bénéfices comme forme de rémunération principale parmi
les jeunes travailleurs.
Tableau 74: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le sexe
Mode de paiement
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salaire fixe 19 16,0 4 11,8 23 15,0
Au jour ou à l'heure de travail 1 ,8 2 5,9 3 2,0
A la tâche 30 25,2 6 17,6 36 23,5
Commission 1 ,8 0 0,0 1 ,7
Bénéfices 58 48,7 20 58,8 78 51,0
En nature 10 8,4 2 5,9 12 7,8
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant la proportion par mode de paiement, on observe que la majorité des jeunes travailleurs,
quel que soit leur type de formation, reçoivent leur rémunération principalement sous forme de
bénéfices, représentant 51,0% de l'échantillon total. La rémunération à la tâche vient en deuxième
position, touchant 23,5% des travailleurs, suivi par le salaire fixe à 15,0%.
En détaillant davantage la répartition par type de formation, les jeunes ayant suivi une formation
qualifiante sont plus nombreux à recevoir un salaire fixe (18,0%) par rapport à ceux ayant suivi un
apprentissage (13,0%). Cependant, la majorité des deux groupes préfèrent les bénéfices comme mode
de paiement principal.
Notons également que la rémunération en nature est plus fréquente parmi les jeunes ayant suivi un
apprentissage (10,9%) par rapport à ceux ayant une formation qualifiante (3,3%).
Les données suggèrent que, indépendamment du type de formation, les bénéfices demeurent la forme
de rémunération privilégiée parmi les jeunes travailleurs, tout en soulignant des variations dans les choix
de mode de paiement en fonction du type de formation suivi.
 |
80 80 |
▲back to top |
79
Tableau 75: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le type de formation
Mode de paiement
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salaire fixe 12 13,0 11 18,0 23 15,0
Au jour ou à l'heure de travail 1 1,1 2 3,3 3 2,0
A la tâche 21 22,8 15 24,6 36 23,5
Commission 1 1,1 0 0,0 1 ,7
Bénéfices 47 51,1 31 50,8 78 51,0
En nature 10 10,9 2 3,3 12 7,8
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans la filière pomme de terre, près de 39,1% des travailleurs optent pour un salaire fixe, soulignant
une préférence notable pour cette modalité. En revanche, dans la filière lait local, cette préférence est
encore plus marquée, atteignant 60,9%, suggérant une tendance claire en faveur du salaire fixe,
particulièrement dans ce secteur.
Le paiement au jour ou à l'heure de travail est une option exclusivement privilégiée dans la filière lait
local, avec 100,0% des travailleurs l'adoptant. À l'inverse, cette modalité est totalement absente dans
la filière pomme de terre, soulignant une nette préférence pour ce mode de rémunération dans la filière
laitière.
La rémunération à la tâche se démarque dans la filière pomme de terre, concernant 94,4% des
travailleurs, tandis qu'elle est significativement moins fréquente dans la filière lait local avec seulement
5,6%. Cette distinction suggère des choix de rémunération fortement influencés par la nature spécifique
des activités dans chaque filière.
Bien que la commission soit peu utilisée, elle est présente de manière exclusive dans la filière lait local
pour 100,0% des cas, indiquant une spécificité de ce mode de paiement dans cette filière particulière.
Les bénéfices sont le mode de rémunération privilégié dans la filière pomme de terre, représentant
71,8% des travailleurs, tandis que dans la filière lait local, cette préférence est moins marquée, s'élevant
à 28,2%. Cette distinction souligne clairement une inclination plus forte pour les bénéfices dans la filière
pomme de terre.
La rémunération en nature est plus fréquente dans la filière pomme de terre (66,7%) que dans la filière
lait local (33,3%), ce qui peut être attribué à la nature spécifique des activités agricoles dans la filière
pomme de terre.
En résumé, les différences significatives dans les choix de mode de paiement entre les deux filières
reflètent des préférences distinctes parmi les jeunes travailleurs, suggérant une adaptation des modes
de rémunération en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque filière.
Tableau 76: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et la filière
Mode de paiement
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Salaire fixe 9 39,1 14 60,9 23 100,0
Au jour ou à l'heure de travail 0 0,0 3 100,0 3 100,0
A la tâche 34 94,4 2 5,6 36 100,0
Commission 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Bénéfices 56 71,8 22 28,2 78 100,0
En nature 8 66,7 4 33,3 12 100,0
Total 107 69,9 46 30,1 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La répartition des jeunes en emploi dans le secteur agricole est présentée selon le mode de paiement
et le métier. Les métiers inclus dans l'analyse sont le producteur de pommes de terre de consommation,
le producteur laitier, le producteur de fourrage, le producteur de pommes de terre de consommation et
de semence, l'éleveur laitier et la maintenance des équipements agricoles (MEA).
 |
81 81 |
▲back to top |
80
En examinant le mode de paiement, on observe que la majorité des producteurs de pommes de terre
de consommation et de semence ainsi que des éleveurs laitiers reçoivent des bénéfices comme mode
de rémunération, avec des pourcentages respectifs de 58,3% et 65,4%. En revanche, les producteurs
de fourrage ont une répartition significative de leur rémunération à la tâche, représentant 55,6% de leur
mode de paiement.
Concernant le producteur laitier, le salaire fixe est le mode de paiement prédominant, atteignant 54,5%.
Pour la maintenance des équipements agricoles, la majorité des jeunes en emploi sont rémunérés à la
tâche, constituant 55,6% de leur répartition. Il est également notable que certains métiers, tels que la
maintenance des équipements agricoles, n'ont pas de pourcentage attribué au paiement à l'heure de
travail. De plus, les commissions ne sont utilisées que par les producteurs laitiers, représentant 9,1%
de leur mode de paiement.
Cette analyse met en lumière les différences significatives dans les modes de paiement entre les
métiers du secteur agricole, soulignant l'importance de comprendre ces variations pour élaborer des
politiques et des stratégies adaptées à chaque catégorie d'emploi.
Tableau 77: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le métier
Mode de
paiement
Producteur de
pomme de
terre de
consommation
Producteur
laitier
Producteur
de
fourrage
Producteur de
pomme de
terre de
consommation
et de
semence
Éleveur
laitier
Maintenance
des
équipements
agricoles
(MEA)
Total
Salaire fixe 5,6 54,5 22,2 15,4 23,1 11,1 15,0
Au jour ou à
l'heure de
travail
0,0 0,0 11,1 0,0 7,7 0,0 2,0
A la tâche 27,8 0,0 11,1 34,6 3,8 55,6 23,5
Commission 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ,7
Bénéfices 58,3 0,0 55,6 46,2 65,4 22,2 51,0
En nature 8,3 36,4 0,0 3,8 0,0 11,1 7,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En scrutant les mécanismes de rétribution, il apparaît que la majorité des jeunes œuvrant dans la
production, ainsi que dans la transformation et la commercialisation, perçoivent principalement des
bénéfices, représentant respectivement 56,6% et 55,6%. Ces données révèlent une nette prévalence
de ce mode de rémunération au sein de ces secteurs de la chaîne de valeur.
Dans le maillon de la production, le salaire fixe se distingue également, atteignant 10,6%, tandis que le
travail à la tâche est plébiscité par 22,1% des jeunes. En revanche, dans le maillon du stockage et de
la conservation, le salaire fixe prédomine de manière marquée, représentant 50% de la répartition. Pour
ce qui est de la transformation et de la commercialisation, le travail salarié se démarque comme un
mode de paiement significatif, touchant 33,3% des jeunes employés dans ce maillon.
Cette analyse met en relief la diversité des méthodes de rémunération selon les différents maillons de
la chaîne de valeur, mettant en évidence les préférences distinctes des jeunes travailleurs en fonction
de leurs rôles spécifiques au sein de l'industrie.
 |
82 82 |
▲back to top |
81
Tableau 78: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et le maillon
Mode de
paiement
Production
Stockage et
conservation
Transformation et
commercialisation
Autre Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Salaire fixe 12 10,6 1 50,0 3 33,3 7 24,1 23 15,0
Au jour ou à
l'heure de
travail
0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 6,9 3 2,0
A la tâche 25 22,1 0 0,0 0 0,0 11 37,9 36 23,5
Commission 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 ,7
Bénéfices 64 56,6 1 50,0 5 55,6 8 27,6 78 51,0
En nature 12 10,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 7,8
Total 113 100,0 2 100,0 9 100,0 29 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Lorsqu'on examine les modalités de paiement, on remarque que la majorité des jeunes, quelle que soit
leur tranche d'âge, préfèrent être rémunérés en bénéfices. Ces pourcentages s'élèvent à 43,6% pour
les 15-24 ans, 54,8% pour les 25-35 ans et 60,0% pour les plus de 35 ans. Cette préférence pour les
bénéfices semble être une constante, indépendamment de l'âge des travailleurs.
En ce qui concerne les salaires fixes, ils sont plus courants chez les jeunes de 15-24 ans, représentant
21,8%, comparé à la tranche d'âge de 25-35 ans avec 11,8%. Il est intéressant de noter que les
personnes de plus de 35 ans ne sont pas représentées dans cette catégorie de paiement, soulignant
une divergence d'utilisation entre les groupes d'âge.
Le travail à la tâche semble être une option prisée parmi les jeunes de toutes les tranches d'âge,
représentant respectivement 21,8%, 23,7% et 40,0%. Il est particulièrement remarquable que la
proportion de jeunes de plus de 35 ans optant pour ce mode de paiement soit la plus élevée, signalant
une tendance marquée dans cette catégorie d'âge.
En ce qui concerne les commissions, elles sont peu utilisées comme mode de rémunération, avec une
faible présence dans toutes les tranches d'âge, soulignant une préférence générale pour d'autres
formes de compensation.
Cette analyse met en lumière des tendances significatives dans les choix de modes de paiement en
fonction de l'âge des jeunes travailleurs, avec une prédominance des bénéfices. Les variations notables
dans l'adoption du salaire fixe et du travail à la tâche soulignent l'importance d'adapter les politiques de
rémunération en fonction des préférences démographiques.
Tableau 79: Répartition des jeunes en emploi selon le mode de paiement et la tranche d’âge
Mode de paiement
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Salaire fixe 12 21,8 11 11,8 0 0,0 23 15,0
Au jour ou à l'heure de travail 2 3,6 1 1,1 0 0,0 3 2,0
A la tâche 12 21,8 22 23,7 2 40,0 36 23,5
Commission 1 1,8 0 0,0 0 0,0 1 ,7
Bénéfices 24 43,6 51 54,8 3 60,0 78 51,0
En nature 4 7,3 8 8,6 0 0,0 12 7,8
Total 55 100,0 93 100,0 5 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
83 83 |
▲back to top |
82
2.3.1.11. Revenu mensuel moyen
D’après le tableau ci-après, 153 jeunes en emploi ont été répartis en fonction de leur revenu mensuel
moyen et de leur sexe. Les résultats montrent que 28,8% des jeunes gagnent moins du Salaire
Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), tandis que 24,2% gagnent entre 40 000 et moins de 75
000 FCFA. En outre, 10,5% des jeunes gagnent entre 75 001 et 100 000 FCFA, tandis
que 28,1% gagnent plus de 100 000 FCFA.
En ce qui concerne la répartition par sexe, 52,9% des femmes gagnent moins du SMIG, tandis
que 34,5% des hommes gagnent plus de 100 000 FCFA. Il est intéressant de noter que seulement 2
femmes gagnent plus de 100 000 FCFA .
Cette analyse révèle une inégalité marquée dans la distribution des revenus entre les femmes et les
hommes. Une proportion importante d'hommes bénéficie de revenus considérables, tandis qu'une part
significative de femmes se contente d’un revenu inférieur au SMIG malien, démontrant ainsi des
disparités importantes dans les opportunités économiques entre les deux sexes.
Tableau 80: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et sexe
Revenu moyen mensuel
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Moins du SMIG 26 21,8 18 52,9 44 28,8
40 000 à moins de 75000 FCFA 29 24,4 8 23,5 37 24,2
75 000 FCFA 10 8,4 3 8,8 13 8,5
75 001-100 000FCFA 13 10,9 3 8,8 16 10,5
Plus de 100 000 FCFA 41 34,5 2 5,9 43 28,1
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les résultats de l'étude mettent en lumière des disparités dans la distribution des revenus en fonction
des types de formations suivies. En effet, 37,7% des jeunes ayant suivi une formation qualifiante
gagnent moins que le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), tandis que 43,5% de ceux
ayant opté pour une formation par apprentissage affichent des revenus dépassant les 100 000 FCFA.
Ces résultats suggèrent que les individus ayant suivi une formation en apprentissage ont davantage de
probabilités de percevoir des revenus plus élevés par rapport à ceux ayant suivi une formation
qualifiante.
De plus, il est à noter que seulement 3 jeunes ayant suivi une formation qualifiante gagnent plus de 100
000 FCFA. Cette observation laisse entendre que les jeunes issus de la formation qualifiante ont une
probabilité moindre de percevoir des revenus élevés par rapport à leurs pairs ayant choisi la formation
par apprentissage. Une explication plausible de cet écart de revenus entre les deux types de formation
pourrait résider dans le temps passé sur le marché du travail3, car les individus issus de la formation
par apprentissage ont accumulé une expérience professionnelle plus étendue que leurs homologues
ayant suivi une formation qualifiante.
Tableau 81: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et type de formation
Revenu moyen mensuel
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Moins du SMIG 21 22,8 23 37,7 44 28,8
40 000 à moins de 75000 FCFA 18 19,6 19 31,1 37 24,2
75 000 FCFA 5 5,4 8 13,1 13 8,5
75 001-100 000FCFA 8 8,7 8 13,1 16 10,5
Plus de 100 000 FCFA 40 43,5 3 4,9 43 28,1
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les résultats de l'étude révèlent des disparités dans la distribution des revenus selon les filières de
formation. En effet, 37,0% des jeunes ayant suivi une formation dans la filière du lait local gagnent moins
que le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), tandis que 35,5% de ceux ayant suivi une
3 Temps moyen passé sur le marché de travail : sept mois pour la formation par apprentissage et quatre pour la formation qualifiante (voir Annexe 2)
 |
84 84 |
▲back to top |
83
formation dans la filière de la pomme de terre affichent des revenus dépassant les 100 000 FCFA. Ces
constats suggèrent que les jeunes formés dans la filière de la pomme de terre ont davantage de chances
de percevoir des revenus élevés que leurs pairs formés dans la filière du lait local.
De plus, il est à noter que seulement 3 jeunes ayant suivi une formation dans la filière du lait local
gagnent plus de 100 000 FCFA. Cela implique que les jeunes formés dans la filière du lait local ont une
probabilité moindre de percevoir des revenus élevés par rapport à ceux issus de la filière de la pomme
de terre. Il convient toutefois de rappeler que les jeunes formés dans la filière de la pomme de terre ont,
en moyenne, passé plus de temps sur le marché du travail que leurs homologues de la filière du lait
local, avec une durée moyenne de six mois pour la pomme de terre et de quatre mois pour le lait local.
Tableau 82: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et filière de formation
Revenu moyen mensuel
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Moins du SMIG 27 25,2 17 37,0 44 28,8
40 000 à moins de 75000 FCFA 22 20,6 15 32,6 37 24,2
75 000 FCFA 7 6,5 6 13,0 13 8,5
75 001-100 000FCFA 13 12,1 3 6,5 16 10,5
Plus de 100 000 FCFA 38 35,5 5 10,9 43 28,1
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
On remarque plusieurs tendances intéressantes en ce qui concerne la répartition des jeunes en emploi
dans le secteur agricole en fonction de leur niveau de revenu mensuel moyen et de leur métier. Les
producteurs de pommes de terre de consommation affichent une diversité de revenus, avec une
proportion significative gagnant plus de 100 000 FCFA (48,6%), mais également une proportion notable
percevant moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) (15,3%).
Pour les producteurs laitiers, on observe une tendance à gagner moins que le SMIG, avec 54,5% se
situant dans cette catégorie de revenus. Cependant, une proportion notable de 27,3% gagne plus de
100 000 FCFA. Les producteurs de fourrage présentent une répartition des revenus moins équilibrée,
avec une proportion notable dans la catégorie inférieure au SMIG (44,4%) et plus de 100 000 FCFA
(22,2%).
Les éleveurs laitiers affichent une répartition des revenus plus équilibrée, avec une proportion notable
dans la tranche de 40 000 à moins de 75 000 FCFA (46,2%) et en dessous du SMIG (26,9%). Les
jeunes travaillant dans la maintenance des équipements agricoles (MEA) présentent une répartition des
revenus assez équilibrée, bien que la proportion soit relativement faible dans toutes les catégories de
revenus.
Ces constatations suggèrent que le type de métier exerce une influence significative sur le niveau de
revenu des jeunes e emploi dans le secteur agricole. Il serait intéressant d'approfondir l'exploration des
facteurs contribuant à ces disparités. Par exemple, ces différences pourraient découler de variations
dans les compétences requises, la demande du marché, l'expérience sur le marché du travail ou
d'autres facteurs socio-économiques.
 |
85 85 |
▲back to top |
84
Graphique 27 : Proportion des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et métier
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans le maillon de la production, une proportion considérable de jeunes gagne au-delà de 100 000
FCFA (34,5%), mais une part notable perçoit également des revenus inférieurs au salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG) (20,4%). Concernant le maillon du stockage et de la conservation, la
moitié des jeunes gagne moins que le SMIG (50,0%), tandis que l'autre moitié se situe dans la tranche
de revenus entre 75 001 et 100 000 FCFA (50,0%).
Dans le maillon de la transformation et de la commercialisation, les revenus sont relativement équilibrés
entre ceux qui gagnent moins que le SMIG (33,3%), ceux percevant 75 000 FCFA (11,1%), et ceux
gagnant plus de 100 000 FCFA (33,3%). Pour les autres maillons, une grande majorité des jeunes
affiche des revenus inférieurs au SMIG (58,6%), tandis qu'une faible proportion perçoit plus de 100 000
FCFA (3,4%).
Ces observations suggèrent que le type de maillon exerce une influence significative sur le niveau de
revenu des jeunes en emploi. Il serait opportun d'approfondir l'exploration des facteurs contribuant à
ces disparités. Par exemple, ces différences pourraient découler de variations dans les compétences
requises, la demande du marché, l’expérience sur le marché du travail ou d'autres facteurs socio-
économiques.
Graphique 28 : Proportion des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et maillon
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
15,3%
54,5%
44,4%
46,2%
26,9%
44,4%
28,8%
20,8%
18,2%
11,1%
23,1%
46,2%
11,1%
24,2%
4,2%
0,0%
22,2%
7,7%
15,4%
22,2%
8,5%
11,1%
15,4%
11,5%
11,1%
10,5%
48,6%
27,3%
22,2%
7,7%
11,1%
28,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Producteur de pomme de terre de consommation
Producteur laitier
Producteur de fourrage
Producteur de pomme de terre de consommation et de
semence
Éleveur laitier
Maintenance des équipements agricoles (MEA)
Total
Moins du SMIG 40 000 à moins de 75000 FCFA 75 000 FCFA
75 001-100 000FCFA Plus de 100 000 FCFA
20,4%
50,0%
33,3%
58,6%
28,8%
26,5%
22,2%
17,2%
24,2%
7,1%
11,1%
13,8%
8,5%
11,5%
50,0%
6,9%
10,5%
34,5%
33,3%
3,4%
28,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Production
Stockage et conservation
Transformation et commercialisation
Autre maillon
Total
Moins du SMIG 40 000 à moins de 75000 FCFA 75 000 FCFA
75 001-100 000FCFA Plus de 100 000 FCFA
 |
86 86 |
▲back to top |
85
L’analyse porte sur la répartition des jeunes en emploi selon le niveau de revenu mensuel moyen et la
tranche d'âge. On observe que parmi les jeunes de 15 à 24 ans, la majorité (45,5%) gagne moins que
le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), tandis que 20,0% se situent dans la tranche de
40 000 à moins de 75 000 FCFA. Cela suggère une prévalence de revenus modestes dans cette
catégorie d'âge.
En comparaison, pour les jeunes de 25 à 35 ans, bien que la proportion gagnant moins que le SMIG
diminue (20,4%), on constate une augmentation significative dans la tranche de 40 000 à moins de 75
000 FCFA (28,0%). Cela pourrait indiquer une transition vers des revenus légèrement plus élevés dans
cette tranche d'âge.
Quant aux jeunes de plus de 35 ans, le tableau montre une diversité de revenus, avec une proportion
notable (40,0%) gagnant entre 75 000 FCFA et 100 000 FCFA. Cette tranche d'âge semble avoir une
répartition plus équilibrée des revenus, avec une proportion significative gagnant plus de 100 000 FCFA
(40,0%).
En analysant l'ensemble des données, on constate que la tranche d'âge de 25 à 35 ans présente une
variabilité intéressante, avec une répartition significative dans la catégorie de revenus de 40 000 à moins
de 75 000 FCFA. Cela pourrait indiquer une période de transition économique pour cette cohorte de
jeunes travailleurs. En outre, la tranche d'âge de plus de 35 ans se démarque par une diversité de
revenus, avec une proportion notable dans la catégorie de 75 000 FCFA à 100 000 FCFA. Cette analyse
suggère des dynamiques différentes en fonction de l'âge, mettant en lumière des aspects importants
liés aux revenus des jeunes en emploi.
Tableau 83: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et tranche d’âge
Revenu moyen mensuel
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Moins du SMIG 25 45,5 19 20,4 0 0,0 44 28,8
40 000 à moins de 75000 FCFA 11 20,0 26 28,0 0 0,0 37 24,2
75 000 FCFA 1 1,8 10 10,8 2 40,0 13 8,5
75 001-100 000FCFA 6 10,9 9 9,7 1 20,0 16 10,5
Plus de 100 000 FCFA 12 21,8 29 31,2 2 40,0 43 28,1
Total 55 100,0 93 100,0 5 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
On observe que parmi les salariés, la majorité (37,3%) gagne moins que le salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG), tandis que 22,0% se situent dans la tranche de 40 000 à moins de
75 000 FCFA. Cela suggère que malgré le statut salarié, une proportion significative de jeunes
travailleurs perçoit des revenus modestes.
D'autre part, parmi les travailleurs indépendants, une proportion notable (50,0%) gagne plus de 100 000
FCFA, ce qui indique une certaine prospérité dans cette catégorie. En revanche, la tranche de 40 000
à moins de 75 000 FCFA représente 21,4%, montrant une diversité de revenus parmi les indépendants.
Pour les jeunes en auto-emploi, la situation est nuancée, avec 32,7% gagnant moins que le SMIG, mais
15,4% percevant plus de 100 000 FCFA. Cela souligne une variabilité significative dans les revenus
des jeunes actifs engagés dans l'auto-emploi.
En consolidant l'ensemble des données, on peut noter que le statut dans l'activité a un impact significatif
sur le niveau de revenu des jeunes en emploi. Les salariés tendent à être plus concentrés dans les
tranches de revenus modestes, tandis que les indépendants, en particulier, ont une proportion
importante gagnant plus de 100 000 FCFA. Cette analyse suggère l'importance de prendre en compte
le statut dans l'activité lors de l'évaluation des disparités de revenus parmi les jeunes travailleurs.
 |
87 87 |
▲back to top |
86
Tableau 84: Répartition des jeunes en emploi par niveau de revenu mensuel moyen et statut dans l’activité
Revenu moyen mensuel
Salarié Indépendant Auto-emploi Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Moins du SMIG 22 37,3 5 11,9 17 32,7 44 28,8
40 000 à moins de 75000
FCFA
13 22,0 9 21,4 15 28,8 37 24,2
75 000 FCFA 4 6,8 2 4,8 7 13,5 13 8,5
75 001-100 000FCFA 6 10,2 5 11,9 5 9,6 16 10,5
Plus de 100 000 FCFA 14 23,7 21 50,0 8 15,4 43 28,1
Total 59 100,0 42 100,0 52 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.12. Type d’entreprise
Dans l'ensemble, les exploitations familiales représentent la majorité des entreprises où les jeunes en
emploi travaillent, totalisant 54,5%, suivies par les entreprises privées avec une part de 44,6%. En
revanche, la présence des jeunes dans les entreprises publiques ou parapubliques est limitée, ne
représentant que 1,0% du total.
Lorsque l'on examine la répartition par sexe, on observe que 56,0% des hommes travaillent dans des
exploitations familiales, tandis que 52,9% des femmes sont employées par des entreprises privées. Ces
deux secteurs présentent ainsi les proportions les plus importantes pour les jeunes hommes et femmes,
respectivement. Cette distinction souligne les différences marquées dans les choix d'emploi en fonction
du sexe, mettant en évidence des tendances spécifiques au sein de chaque sexe.
Tableau 85: Répartition des jeunes en emploi par type d’entreprise et sexe
Type d'entreprise
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Publique ou parapublique 1 1,2 0 0,0 1 1,0
Privée 36 42,9 9 52,9 45 44,6
Exploitation familiale 47 56,0 8 47,1 55 54,5
Total 84 100,0 17 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données présentées dans le tableau 76 portent sur la proportion des jeunes en emploi, en fonction
du type d'entreprise et du type de formation. Pour chaque type d'entreprise (publique ou parapublique,
privée, et exploitation familiale), l'effectif total ainsi que la répartition en pourcentage selon le type de
formation (apprentissage et qualifiante) sont fournis.
En examinant les chiffres, on constate que dans les entreprises publiques ou parapubliques, tous les
jeunes en emploi ont suivi une formation en apprentissage, représentant ainsi 100% de cette catégorie.
En revanche, aucune formation qualifiante n'est répertoriée pour ce type d'entreprise.
Pour les entreprises privées, la répartition entre les formations en apprentissage et les formations
qualifiantes est relativement équilibrée. Environ 48,9% des jeunes en emploi ont suivi une formation en
apprentissage, tandis que 51,1% ont opté pour une formation qualifiante. En ce qui concerne les
entreprises d'exploitation familiale, une grande majorité des jeunes en emploi (72,7%) ont suivi une
formation en apprentissage, tandis que 27,3% ont opté pour une formation qualifiante.
En synthèse, le tableau ci-après démontre que la répartition entre les types de formation varie
significativement selon le type d'entreprise. Les entreprises publiques ou parapubliques privilégient
l'apprentissage, tandis que les entreprises privées et d'exploitation familiale présentent une répartition
plus équilibrée entre les deux types de formation.
 |
88 88 |
▲back to top |
87
Tableau 86: Proportion des jeunes en emploi par type d’entreprise et type de formation
Type d'entreprise
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Publique ou parapublique 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Privée 22 48,9 23 51,1 45 100,0
Exploitation familiale 40 72,7 15 27,3 55 100,0
Total 63 62,4 38 37,6 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les entreprises publiques ou parapubliques se caractérisent par une concentration exclusive de tous
les jeunes en emploi dans la filière Lait local, représentant ainsi 100% de cette catégorie. En revanche,
aucune personne travaillant dans ces entreprises ne semble être affectée à la filière Pomme de terre.
Les entreprises privées présentent une répartition plus équilibrée, avec 60,0% des jeunes en emploi
œuvrant dans la filière Pomme de terre et 40,0% dans la filière Lait local. Cette répartition suggère une
diversification des activités au sein de ces entreprises, marquant une différence notable par rapport aux
entreprises publiques ou parapubliques.
Pour les exploitations familiales, une écrasante majorité de 80,0% des jeunes en emploi se concentre
dans la filière Pomme de terre, tandis que seulement 20,0% sont orientés vers la filière Lait local. Cette
prédominance dans la filière Pomme de terre souligne une inclination marquée dans cette catégorie
d'activité au sein des exploitations familiales.
En analysant l'ensemble des données, il est clair que la filière Pomme de terre domine globalement,
représentant 70,3% de tous les jeunes en emploi. Cette tendance est également perceptible dans les
entreprises privées et d'exploitation familiale. En revanche, les entreprises publiques se distinguent par
leur spécialisation exclusive dans la filière Lait local, néanmoins l’effectif dans ces entreprises est
insignifiant.
Tableau 87: Répartition des jeunes en emploi par type d’entreprise et filière
Type d'entreprise
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Publique ou parapublique 0 0,0 1 3,3 1 1,0
Privée 27 38,0 18 60,0 45 44,6
Exploitation familiale 44 62,0 11 36,7 55 54,5
Total 71 100,0 30 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Globalement, le métier de Producteur de pomme de terre de consommation ressort comme le plus
fréquent parmi les jeunes en emploi, totalisant 47,5% de l'ensemble. Les métiers liés à la production
laitière, tels qu’éleveur laitier et Producteur laitier, représentent également une part significative,
contribuant à 8,9% et 14,9%, respectivement, du total des jeunes en emploi. L'analyse met en lumière
la diversité des métiers exercés dans le secteur agricole, avec des tendances spécifiques à chaque
type d'entreprise.
En examinant les données, on observe que dans les entreprises publiques ou parapubliques, le métier
de Producteur de fourrage est le seul répertorié, avec un effectif de 1, représentant 100,0% de cette
catégorie. Aucun jeune de cette typologie d'entreprise n'est employé dans les autres métiers énumérés.
Pour les entreprises privées, la répartition des jeunes en emploi est diversifiée entre plusieurs métiers.
Le métier le plus représenté est celui de Producteur de pomme de terre de consommation, avec 33,3%,
suivi de près par Éleveur laitier avec 24,4%.
Dans le cas des exploitations familiales, le métier dominant est celui de Producteur de pomme de terre
de consommation, représentant 60,0%. Les autres métiers tels qu’éleveur laitier et Producteur de
pomme de terre de consommation et de semence sont également présents, mais avec des proportions
inférieures.
 |
89 89 |
▲back to top |
88
Tableau 88: Proportion des jeunes en emploi par type d’entreprise et métier
Métier
Publique ou
parapublique
Privée
Exploitation
familiale
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de
consommation
0 0,0 15 33,3 33 60,0 48 47,5
Producteur laitier 0 0,0 3 6,7 6 10,9 9 8,9
Producteur de fourrage 1 100,0 4 8,9 1 1,8 6 5,9
Producteur de pomme de terre de
consommation et de semence
0 0,0 6 13,3 9 16,4 15 14,9
Éleveur laitier 0 0,0 11 24,4 4 7,3 15 14,9
Maintenance des équipements agricoles 0 0,0 6 13,3 2 3,6 8 7,9
Total 1 100,0 45 100,0 55 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L’analyse de ces données offre une perspective sur la répartition des jeunes en emploi en fonction du
type d'entreprise et du maillon de la chaîne d'activités agricoles, à savoir la production, du stockage et
conservation, la transformation et commercialisation, ainsi qu'une catégorie dénommée "Autre". En
observant les données, il est notable que dans les entreprises publiques ou parapubliques, un seul
jeune est attribué à la catégorie "Autre", représentant ainsi 100,0% de cette catégorie spécifique. Aucun
jeune n'est répertorié dans les maillons de Production, Stockage et conservation, ou Transformation et
commercialisation.
Pour les entreprises privées, le maillon de Production est prédominant, accaparant 60,0% des jeunes
en emploi. Cela suggère une concentration significative dans les activités de production au sein de ce
type d'entreprises. Le maillon "Autre" est également notable, représentant 31,1% des jeunes en emploi
dans ce maillon.
Dans les exploitations familiales, le maillon de Production est encore plus prééminent, englobant 89,1%
des jeunes en emploi. Les autres maillons, tels que Stockage et conservation, et Transformation et
commercialisation, ont des proportions relativement faibles.
Le maillon de Production émerge comme le principal maillon d'activité pour les jeunes en emploi, avec
une prédominance significative à la fois au niveau global (75,2%) et spécifiquement dans les entreprises
privées (60,0%) et d'exploitation familiale (89,1%). Le maillon "Autre" est également notable, surtout
dans les entreprises privées.
Tableau 89: Répartition des jeunes en emploi par type d’entreprise et maillon
Maillon
Publique ou
parapublique
Privée
Exploitation
familiale
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 0 0,0 27 60,0 49 89,1 76 75,2
Stockage et conservation 0 0,0 1 2,2 0 0,0 1 1,0
Transformation et commercialisation 0 0,0 3 6,7 5 9,1 8 7,9
Autre 1 100,0 14 31,1 1 1,8 16 15,8
Total 1 100,0 45 100,0 55 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des données révèle des tendances distinctes en fonction du type d'entreprise et de la tranche
d'âge des jeunes en emploi. Dans les entreprises publiques ou parapubliques, la présence est limitée
à un jeune, âgé de 25 à 35 ans, représentant ainsi l'intégralité de cette catégorie. Aucun jeune n'est
répertorié dans les tranches d'âge de 15 à 24 ans ou plus de 35 ans au sein de ce type d'entreprise.
Pour les entreprises privées, la distribution des tranches d'âge est relativement équilibrée, avec 48,9%
des jeunes en emploi appartenant à la tranche d'âge de 15 à 24 ans et 51,1% à la tranche d'âge de 25
à 35 ans. Aucun jeune de cette catégorie d'entreprise n'est classé dans la tranche d'âge plus de 35 ans.
Dans les exploitations familiales, la tranche d'âge de 25 à 35 ans prédomine, regroupant 63,6% des
jeunes en emploi, suivie de la tranche d'âge de 15 à 24 ans à 34,5%. Une seule personne (1,8%) de
cette catégorie d'entreprise est répertoriée dans la tranche d'âge plus de 35 ans.
 |
90 90 |
▲back to top |
89
Les profils d'âge des jeunes en emploi varient considérablement selon le type d'entreprise, soulignant
une distribution sélective au sein de chaque secteur. Les entreprises publiques ou parapubliques se
caractérisent par une présence exclusive dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, tandis que les
entreprises privées et les exploitations familiales présentent une répartition plus diversifiée entre les
tranches d'âge de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans.
Tableau 90: Proportion des jeunes en emploi par type d’entreprise et la tranche d’âge
Type d'entreprise
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Publique ou parapublique 0 0,0 1 1,7 0 0,0 1 1,0
Privée 22 53,7 23 39,0 0 0,0 45 44,6
Exploitation familiale 19 46,3 35 59,3 1 100,0 55 54,5
Total 41 100,0 59 100,0 1 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.13. Taille de l’entreprise
Les données présentées dans le tableau ci-dessous montrent la répartition des jeunes en emploi en
fonction de la taille de l'entreprise et du sexe. En examinant les effectifs, on observe que la majorité des
jeunes en emploi se trouvent dans des micro-entreprises, représentant 77,2% du total. Plus
spécifiquement, parmi les hommes, 77,4% travaillent dans des micro-entreprises, tandis que chez les
femmes, ce pourcentage est légèrement inférieur à 76,5%.
En ce qui concerne les petites entreprises, elles emploient 16,8% des jeunes en général. Il est
intéressant de noter une disparité entre les sexes, avec 17,9% d'hommes travaillant dans de petites
entreprises par rapport à seulement 11,8% de femmes.
Les moyennes entreprises ont un impact moins significatif, employant 4,0% des jeunes en emploi.
Cependant, il est notable que la répartition entre hommes et femmes est équivalente dans ce cas,
chacun représentant 2,4% du total.
Enfin, les grandes entreprises ont la plus faible contribution, employant seulement 2,0% des jeunes en
emploi, tous étant des hommes.
Les données mettent en lumière une concentration importante de jeunes en emploi dans les micro-
entreprises, avec des variations notables entre les sexes dans les petites entreprises. Les moyennes et
grandes entreprises ont une influence moindre sur l'emploi des jeunes, avec une prédominance
masculine dans les grandes entreprises.
Tableau 91: Répartition des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le sexe
Taille de l'entreprise
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Micro-entreprise 65 77,4 13 76,5 78 77,2
Petite entreprise 15 17,9 2 11,8 17 16,8
Moyenne entreprise 2 2,4 2 11,8 4 4,0
Grande entreprise 2 2,4 0 0,0 2 2,0
Total 84 100,0 17 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant les effectifs, on constate que la majorité des jeunes en emploi dans les micro-entreprises
ont suivi une formation en apprentissage, représentant 62,8% de l'effectif total, tandis que 37,2% ont
suivi une formation qualifiante. Cette tendance se maintient également dans les petites entreprises, où
70,6% des jeunes en emploi ont bénéficié d'une formation en apprentissage, comparativement à 29,4%
ayant suivi une formation qualifiante.
Cependant, la situation diffère dans les moyennes entreprises, où l'on observe une inversion. Ici, 75,0%
des jeunes en emploi ont suivi une formation qualifiante, tandis que seulement 25,0% ont opté pour
l'apprentissage. Les grandes entreprises présentent une répartition plus équilibrée entre les deux types
 |
91 91 |
▲back to top |
90
de formation, avec 50,0% des jeunes en emploi ayant suivi une formation en apprentissage et 50,0%
une formation qualifiante.
Les micro-entreprises et les petites entreprises privilégient majoritairement les jeunes ayant suivi une
formation en apprentissage, tandis que les moyennes entreprises favorisent ceux ayant suivi une
formation qualifiante. Les grandes entreprises, quant à elles, maintiennent une équité entre les deux
types de formation. Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte la taille de l'entreprise
lors de l'analyse des choix de formation des jeunes en emploi.
Tableau 92: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le type de formation
Taille de l'entreprise
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Micro-entreprise 49 62,8 29 37,2 78 100,0
Petite entreprise 12 70,6 5 29,4 17 100,0
Moyenne entreprise 1 25,0 3 75,0 4 100,0
Grande entreprise 1 50,0 1 50,0 2 100,0
Total 63 62,4 38 37,6 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant les données, il ressort clairement que la filière pomme de terre prédomine au sein des
micro-entreprises, représentant 71,8% de l'effectif total, tandis que la filière lait local constitue les 28,2%
restants. Cette tendance se maintient également dans les petites entreprises, où 70,6% des jeunes en
emploi se dirigent vers la filière pomme de terre, tandis que 29,4% optent pour la filière lait local.
Concernant les moyennes entreprises, bien que la filière pomme de terre reste majoritaire, l'écart entre
les deux filières s'accentue, atteignant 75% pour la pomme de terre et 25% pour la filière lait local. Dans
le cas des grandes entreprises, la filière lait local prévaut, rassemblant la totalité des jeunes en emploi
de cette catégorie, alors que la filière pomme de terre ne contribue pas.
Une corrélation évidente émerge entre la taille de l'entreprise, la filière et l'emploi des jeunes. Les micro-
entreprises et les petites entreprises semblent être favorables à la filière pomme de terre, tandis que
les moyennes entreprises maintiennent cette tendance avec une légère diversification en faveur de la
filière lait local. Les grandes entreprises, quant à elles, concentrent leurs jeunes employés dans la filière
lait local.
Tableau 93: Répartition des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et la filière
Taille de l'entreprise
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Micro-entreprise 56 71,8 22 28,2 78 100,0
Petite entreprise 12 70,6 5 29,4 17 100,0
Moyenne entreprise 3 75,0 1 25,0 4 100,0
Grande entreprise 0 0,0 2 100,0 2 100,0
Total 71 70,3 30 29,7 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant les proportions, il est manifeste que le métier de producteur de pomme de terre de
consommation occupe une place prépondérante au sein des micro-entreprises, représentant 50,0% de
l'ensemble de cette catégorie. Cette tendance persiste également dans les petites entreprises, avec
une proportion de 47,1%. Cependant, dans les moyennes entreprises, bien que ce métier conserve sa
position dominante avec 25,0%, la proportion connaît une diminution significative. Dans les grandes
entreprises, ce métier est totalement absent.
Le métier de producteur de fourrage est principalement associé aux micro-entreprises (6,4%) et, de
manière remarquable, aux grandes entreprises (50,0%), étant totalement absent des petites et
moyennes entreprises. Les maintenanciers des équipements agricoles (MEA) présentent une répartition
relativement équilibrée, avec une présence notable dans les micro-entreprises (7,7%) et les petites
entreprises (11,8%).
 |
92 92 |
▲back to top |
91
Le métier de producteur de pomme de terre de consommation et de semence affiche une diversité plus
marquée, étant réparti dans toutes les tailles d'entreprises, mais avec une prévalence significative dans
les micro-entreprises (14,1%) et les moyennes entreprises (50,0%). Quant aux éleveurs laitiers, leur
distribution est plus équilibrée, couvrant les micro-entreprises (15,4%), les petites entreprises (5,9%),
les moyennes entreprises (25,0%) et les grandes entreprises (50,0%).
Tableau 94: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le métier
Métier
Micro-entreprise
Petite
entreprise
Moyenne
entreprise
Grande
entreprise
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de
pomme de terre de
consommation
39 50,0 8 47,1 1 25,0 0 0,0 48 47,5
Producteur laitier 5 6,4 4 23,5 0 0,0 0 0,0 9 8,9
Producteur de
fourrage
5 6,4 0 0,0 0 0,0 1 50,0 6 5,9
Producteur de
pomme de terre de
consommation et de
semence
11 14,1 2 11,8 2 50,0 0 0,0 15 14,9
Éleveur laitier 12 15,4 1 5,9 1 25,0 1 50,0 15 14,9
Maintenance des
équipements
agricoles (MEA)
6 7,7 2 11,8 0 0,0 0 0,0 8 7,9
Total 78 100,0 17 100,0 4 100,0 2 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-dessous offre une analyse approfondie de la distribution des jeunes employés en fonction
de la taille de l'entreprise et du maillon de la chaîne agricole. Il est manifeste que le maillon de la
production occupe une position de grande importance dans toutes les catégories d'entreprises,
représentant une part significative de l'effectif, soit 76,9% dans les micro-entreprises, 76,5% dans les
petites entreprises, et de manière notable, 50,0% dans les moyennes et grandes entreprises. Dans
l'ensemble, le maillon de la production contribue substantiellement à hauteur de 75,2% du total des
jeunes en emploi.
Le maillon du stockage et conservation se caractérise par une présence plus limitée, ne représentant
que 1,3% des effectifs dans les micro-entreprises et contribuant modestement à 1,0% de l'ensemble
des jeunes employés. En ce qui concerne le maillon de la transformation et commercialisation, il se
démarque davantage dans les micro-entreprises (9,0%) et les moyennes entreprises (25,0%), cumulant
ainsi une contribution totale de 7,9%.
Le maillon dénommé "Autre" se distingue par sa présence significative dans toutes les catégories
d'entreprises, représentant 12,8% dans les micro-entreprises, 23,5% dans les petites entreprises,
25,0% dans les moyennes entreprises, pour un total de 15,8%.
Ces résultats soulignent l'importance prépondérante du maillon de la production dans l'emploi des
jeunes, indépendamment de la taille de l'entreprise. Cependant, des variations notables apparaissent
dans d'autres maillons en fonction de la taille de l'entreprise, mettant en exergue des opportunités et
des spécificités potentielles.
 |
93 93 |
▲back to top |
92
Tableau 95: Répartition des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le maillon
Maillon
Micro-entreprise
Petite
entreprise
Moyenne
entreprise
Grande
entreprise
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 60 76,9 13 76,5 2 50,0 1 50,0 76 75,2
Stockage et
conservation
1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0
Transformation et
commercialisation
7 9,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 8 7,9
Autre 10 12,8 4 23,5 1 25,0 1 50,0 16 15,8
Total 78 100,0 17 100,0 4 100,0 2 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-dessous détaille la répartition des jeunes en emploi selon la tranche d'âge et la taille de
l'entreprise. En analysant les effectifs, il est évident que la tranche d'âge de "15 - 24 ans" compte un
nombre significatif de jeunes employés, représentant 41,0% dans les micro-entreprises, 35,3% dans
les petites entreprises, et de manière notable, 50,0% dans les moyennes et grandes entreprises. Au
total, cette tranche d'âge contribue à 40,6% de l'ensemble des jeunes en emploi.
La tranche d'âge "25 - 35 ans" représente une part majoritaire dans toutes les catégories d'entreprises,
avec 59,0% dans les micro-entreprises, 58,8% dans les petites entreprises, et 50,0% dans les
moyennes et grandes entreprises. Globalement, cette tranche d'âge contribue à 58,4% de l'ensemble
des jeunes employés.
En ce qui concerne la tranche d'âge "Plus de 35 ans", elle est moins représentée, n'étant présente que
dans les petites entreprises avec une proportion de 5,9%, contribuant ainsi à 1,0% de l'ensemble des
jeunes en emploi.
Ces données mettent en évidence une concentration significative de jeunes employés dans les tranches
d'âge "15 - 24 ans" et "25 - 35 ans", avec des variations subtiles en fonction de la taille de l'entreprise.
La présence de la tranche "Plus de 35 ans" est plus modeste, principalement observée dans les petites
entreprises.
Tableau 96: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et la tranche d’âge
Tranche d'âge
Micro-
entreprise
Petite
entreprise
Moyenne
entreprise
Grande
entreprise
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
15 - 24 ans 32 41,0 6 35,3 2 50,0 1 50,0 41 40,6
25 - 35 ans 46 59,0 10 58,8 2 50,0 1 50,0 59 58,4
Plus de 35 ans 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 1,0
Total 78 100,0 17 100,0 4 100,0 2 100,0 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Globalement, le tableau révèle que la majorité des jeunes en emploi travaillent en tant que salariés,
avec 58,4% de l'effectif total, tandis que les indépendants représentent 41,6%. Ces données mettent
en lumière des disparités significatives en termes de type d'emploi en fonction de la taille de l'entreprise.
Cette analyse offre des indications précieuses pour comprendre la dynamique de l'emploi des jeunes.
En examinant les pourcentages, on constate que dans les micro-entreprises, la majorité des jeunes en
emploi sont des salariés, représentant 52,6% de l'effectif total, tandis que les indépendants représentent
47,4%. Cette répartition équilibrée souligne la diversité des statuts d'emploi au sein de ces entreprises
de petite taille.
Pour les petites entreprises, la tendance change avec une forte prédominance de salariés, constituant
76,5% de l'effectif total, comparativement à 23,5% pour les indépendants. Les moyennes entreprises
affichent également une nette majorité de jeunes salariés, représentant 75,0%, avec seulement 25,0%
d'indépendants. Dans les grandes entreprises, tous les jeunes en emploi sont salariés, représentant
100,0%.
 |
94 94 |
▲back to top |
93
Tableau 97: Proportion des jeunes en emploi selon la taille de l’entreprise et le statut dans l’activité
Taille de l'entreprise
Salarié Indépendant Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Micro-entreprise 41 52,6 37 47,4 78 100,0
Petite entreprise 13 76,5 4 23,5 17 100,0
Moyenne entreprise 3 75,0 1 25,0 4 100,0
Grande entreprise 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Total 59 58,4 42 41,6 101 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.14. Nombre d’emplois occupés depuis la fin de la formation
L'analyse de la répartition des jeunes en emploi, en fonction du nombre d'emplois occupés et en
distinguant les hommes des femmes, met en évidence plusieurs tendances. La prédominance majeure
se situe parmi ceux qui occupent un seul emploi, représentant 74,5% de l'ensemble. Cette stabilité
professionnelle est observée chez la plupart des jeunes, avec des proportions de 70,6% pour les
hommes et 88,2% pour les femmes.
En revanche, une proportion notable, soit 23,5% de l'ensemble des jeunes en emploi, occupe leur
deuxième emploi depuis la fin de leur formation. Cette catégorie présente une répartition plus
déséquilibrée entre les sexes, avec 26,9% pour les hommes et 11,8% pour les femmes. Cette
diversification dans l'occupation d'un deuxième emploi suggère une flexibilité accrue et une volonté
d'explorer des opportunités multiples sur le marché du travail.
La catégorie occupant un troisième emploi est moins fréquente, représentant seulement 2,0% de
l'ensemble. Cette option est principalement choisie par des hommes, avec une proportion de 2,5%,
alors qu'aucune femme n'est répertoriée dans cette catégorie.
En résumé, l'analyse indique que la majorité des jeunes ont occupé depuis la fin de la formation un seul
emploi, tandis qu'une proportion significative est à leur deuxième emploi. Ces résultats offrent des
perspectives importantes sur les choix d'emploi des jeunes, soulignant la diversité des trajectoires
professionnelles après la formation.
Tableau 98: Répartition des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le sexe
Nombre d'emploi occupé
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Un emploi 84 70,6 30 88,2 114 74,5
Deux emplois 32 26,9 4 11,8 36 23,5
Trois emplois 3 2,5 0 0,0 3 2,0
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la distribution des jeunes en emploi selon le nombre d'emplois occupés, en tenant compte
du type de formation (apprentissage ou qualifiante), révèle des tendances intéressantes. Dans la
catégorie occupant un seul emploi depuis la fin de la formation initiale, une majorité de jeunes ont suivi
une formation en apprentissage, représentant 58,8% de l'ensemble, tandis que ceux ayant suivi une
formation qualifiante représentent 41,2%. Ces données suggèrent une corrélation entre le type de
formation et la propension à occuper un seul emploi, montrant une légère prédominance pour les jeunes
formés en apprentissage.
Concernant la catégorie occupant un deuxième emploi, on observe une proportion significative de ceux
formés en apprentissage, représentant 69,4%, par rapport à 30,6% pour ceux ayant suivi une formation
qualifiante. Cette dominance dans la catégorie suggère une flexibilité et la capacité des jeunes formés
en apprentissage à changer d'emplois ou à explorer d'autres opportunités professionnelles.
La catégorie des jeunes en emploi occupant un troisième emploi est exclusivement composée de ceux
ayant suivi une formation qualifiante, représentant 100,0%. Bien que cette catégorie soit moins
fréquente, elle indique que la formation qualifiante peut influencer la propension à explorer d'autres
 |
95 95 |
▲back to top |
94
opportunités d'emplois. Ces résultats soulignent ainsi l'impact potentiel du type de formation sur les
possibilités professionnelles des jeunes.
Tableau 99: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le type de formation
Nombre d'emploi occupé
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Un emploi 67 58,8 47 41,2 114 100,0
Deux emplois 25 69,4 11 30,6 36 100,0
Trois emplois 0 0,0 3 100,0 3 100,0
Total 92 60,1 61 39,9 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la répartition des jeunes en emploi selon le nombre d'emplois occupés et la filière (pomme
de terre ou lait local) dévoile des tendances significatives. Pour ceux occupant un seul emploi depuis la
fin de la formation initiale, la filière de la pomme de terre prédomine avec 67,5%, tandis que la filière du
lait local représente 32,5%. Cette répartition suggère une corrélation entre la filière spécifique et la
propension à occuper un seul emploi, montrant une nette prédominance pour la filière de la pomme de
terre.
Quant aux jeunes occupant leur deuxième emploi, les jeunes de la filière de la pomme de terre maintient
une forte représentation avec 80,6%, comparativement à 19,4% pour la filière du lait local. Cette
différence indique une préférence marquée des jeunes en emploi dans la filière de la pomme de terre
pour diversifier leurs opportunités professionnelles.
La catégorie des jeunes en emploi qui sont à leur troisième emploi présente une répartition notable,
avec une prédominance de la filière du lait local (66,7%) par rapport à la filière de la pomme de terre
(33,3%). Bien que cette catégorie soit moins fréquente, elle souligne une tendance des jeunes à
explorer des opportunités d'emploi multiples dans la filière du lait local.
Cette analyse met en lumière des différences significatives en fonction de la filière et du nombre
d'emplois occupés. La filière de la pomme de terre semble influencer davantage les catégories des un
et deux emplois, tandis que la filière du lait local montre une diversification des opportunités
professionnelles, surtout dans la catégorie des deux emplois.
Tableau 100: Répartition des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et la filière
Nombre d'emploi occupé
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Un emploi 77 67,5 37 32,5 114 100,0
Deux emplois 29 80,6 7 19,4 36 100,0
Trois emplois 1 33,3 2 66,7 3 100,0
Total 107 69,9 46 30,1 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données fournies permettent d'explorer le nombre d'emploi occupé par les jeunes dans divers
métiers agricoles après la fin de leur formation. La stabilité dans le premier emploi est particulièrement
marquée chez les producteurs de pommes de terre de consommation, où 69,4% d'entre eux se trouvent
dans leur premier emploi, tandis que 30,6% ont déjà intégré un deuxième emploi. Une tendance
similaire est observée parmi les professionnels de la maintenance des équipements agricoles, où la
majorité (55,6%) a choisi de se concentrer sur un seul emploi.
Dans le métier de la production laitière, la stabilité professionnelle est soulignée, avec 81,8% des
producteurs laitiers qui ont maintenu un seul emploi. Cependant, bien que moins fréquent, 18,2% ont
effectué une transition vers un nouveau poste. L'analyse révèle également que la plupart des
producteurs de fourrage (88,9%) et des producteurs de pommes de terre de consommation et de
semence (84,6%) ont occupé un seul emploi après la fin de leur formation.
Dans le métier de l'élevage laitier, la majorité (76,9%) des jeunes ont choisi de travailler dans un seul
emploi, mais 15,4% sont à leur deuxième emploi, et 7,7% ont même changé deux fois de poste. En
somme, la majorité des jeunes dans chaque métier agricole ont occupé un seul emploi. Cependant, des
variations se manifestent, notamment avec des jeunes embrassant un deuxième emploi, et dans des
 |
96 96 |
▲back to top |
95
secteurs spécifiques comme l'élevage laitier, certains optent même pour un troisième poste, démontrant
ainsi une diversité dans les choix de carrière après la formation.
Tableau 101: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le métier (%)
Métier
Un
emploi
Deux
emplois
Trois
emplois
Total
Producteur de pomme de terre de consommation 69,4 30,6 0,0 100,0
Producteur laitier 81,8 18,2 0,0 100,0
Producteur de fourrage 88,9 11,1 0,0 100,0
Producteur de pomme de terre de consommation et de semence 84,6 15,4 0,0 100,0
Éleveur laitier 76,9 15,4 7,7 100,0
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 55,6 33,3 11,1 100,0
Total 74,5 23,5 2,0 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-après présente la répartition des jeunes en emploi selon le nombre d'emplois occupés et
le maillon de la chaîne agricole. Le maillon de la production se distingue avec 69,9% des jeunes
occupant un seul emploi. En parallèle, 28,3% de ces jeunes sont à leur deuxième emploi et 1,8% sont
engagés dans leur troisième emploi.
Le maillon du stockage et conservation se caractérise par la totalité des jeunes travaillant dans leur
premier emploi. De manière similaire, dans le maillon de la transformation et commercialisation, tous
les jeunes sont toujours dans leur premier poste.
Globalement, la majorité des jeunes dans chaque maillon de la chaîne agricole se trouve toujours dans
leur premier emploi depuis la fin de la formation.
Tableau 102: Répartition des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le maillon
Maillon
Un emploi Deux emplois Trois emplois Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 79 69,9 32 28,3 2 1,8 113 100,0
Stockage et conservation 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Transformation et commercialisation 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 100,0
Autre 24 82,8 4 13,8 1 3,4 29 100,0
Total 114 74,5 36 23,5 3 2,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-dessous expose la proportion des jeunes en emploi selon le nombre d'emplois occupés
et leur tranche d'âge. Les données révèlent des tendances intéressantes. Dans la tranche d'âge de 15
à 24 ans, la grande majorité (85,5%) des jeunes occupent un seul emploi, tandis que 12,7% sont leur
deuxième emploi depuis la fin de la formation et 1,8% exercent actuellement leur troisième emploi.
Pour la tranche d'âge de 25 à 35 ans, la majorité (67,7%) n’a occupé un seul emploi, tandis que 30,1%
ont changé leur premier emploi au profit d’un autre emploi, et 2,2% sont engagés dans leur troisième
emploi. Quant aux plus de 35 ans, 80% des jeunes travaillent présentement dans leur premier emploi
après la formation, 20% sont à leur deuxième emploi.
La tendance indique que, quel que soit l'âge, la majorité des jeunes en emploi ont occupé un seul poste
depuis la fin de la formation. Cependant, une diversification apparaît avec l'âge, où la proportion de
jeunes occupant leur deuxième emploi augmente dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans. Les données
suggèrent ainsi que les choix d'emploi peuvent évoluer en fonction de l'expérience et de la maturité
professionnelle des jeunes au fil du temps.
Tableau 103: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et la tranche d’âge
Tranche d'âge
Un emploi Deux emplois Trois emplois Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
15 - 24 ans 47 85,5 7 12,7 1 1,8 55 100,0
25 - 35 ans 63 67,7 28 30,1 2 2,2 93 100,0
Plus de 35 ans 4 80,0 1 20,0 0 0,0 5 100,0
Total 114 74,5 36 23,5 3 2,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
97 97 |
▲back to top |
96
L’analyse offre un aperçu de la répartition des jeunes en emploi en fonction du nombre d'emplois
occupés et de leur statut dans l'activité. Ces données révèlent des nuances intéressantes liées au mode
d'emploi et au nombre d'engagements professionnels.
Pour les salariés, la majorité (66,1%) n’a connu qu’un seul emploi, tandis que 32,2% exercent
actuellement leur second emploi et 1,7% sont dans leur troisième poste. Pour les indépendants, une
grande proportion (76,2%) préfère se concentrer sur un seul emploi. Cependant, 19,0% d'entre eux ont
occupé également un deuxième emploi (8 individus), et 4,8% sont à leur troisième emploi. Le total pour
cette catégorie est de 42 individus.
Les jeunes engagés dans l'auto-emploi ont également occupé un seul emploi depuis la fin de la
formation, représentant 82,7%. Cependant, 17,3% d'entre eux ont occupé un deuxième emploi, et
aucun dans un troisième emploi.
Globalement, la majorité des jeunes, qu'ils soient salariés, indépendants ou engagés dans l'auto-emploi,
ont peu changé de poste depuis la fin de la formation initiale. Cependant, des variations apparaissent
en fonction du statut, où les indépendants semblent être plus enclins à occuper un deuxième emploi
par rapport aux salariés et aux travailleurs en auto-emploi. Ces données mettent en lumière les choix
d'emploi diversifiés en fonction du statut professionnel des jeunes dans le secteur.
Tableau 104: Proportion des jeunes en emploi selon le nombre d’emplois occupés et le statut dans l’activité
Statut dans l'activité
Un emploi
Deux
emplois
Trois
emplois
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 39 66,1 19 32,2 1 1,7 59 100,0
Indépendant 32 76,2 8 19,0 2 4,8 42 100,0
Auto-emploi 43 82,7 9 17,3 0 0,0 52 100,0
Total 114 74,5 36 23,5 3 2,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.15. Durée moyenne d’accès au premier emploi
La durée moyenne d'accès au premier emploi en fonction du sexe et du type de formation est présente
dans le tableau ci-dessous. Les données révèlent des variations intéressantes dans les délais d'entrée
sur le marché du travail en fonction du genre et de la nature de la formation.
Globalement, en combinant les deux types de formation, la durée moyenne d'accès au premier emploi
est de 2 mois pour les hommes et de 1 mois pour les femmes.
Pour les individus ayant suivi un apprentissage, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 2
mois pour les hommes, tandis qu'elle est réduite à 1 mois pour les femmes. Ces résultats suggèrent
une entrée plus rapide des femmes sur le marché du travail par rapport aux hommes après avoir suivi
une formation par apprentissage.
En ce qui concerne la formation qualifiante, la tendance s'inverse, avec une durée moyenne d'accès au
premier emploi de 1 mois pour les hommes et de 2 mois pour les femmes. Cette disparité pourrait
refléter des différences dans les opportunités d'emploi ou les exigences du marché du travail pour les
jeunes ayant suivi une formation qualifiante en fonction de leur genre.
Ces chiffres synthétisent les tendances observées dans les deux types de formation, mettant en
évidence des disparités potentielles dans le temps nécessaire pour accéder au marché du travail en
fonction du genre et du type de formation.
Tableau 105: Durée moyenne d’accès au premier emploi par sexe et type de formation (mois)
Type de formation Homme Femme Total
Apprentissage 2 1 2
Qualifiante 1 2 1
Total 2 1 2
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
98 98 |
▲back to top |
97
Les données indiquent des tendances homogènes dans la durée d'accès au premier emploi entre
hommes et femmes, indépendamment de la filière de formation. Pour la filière de formation pomme de
terre, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 2 mois aussi bien pour les hommes que pour
les femmes. Cela suggère une uniformité dans le temps nécessaire pour les individus des deux sexes
pour entrer sur le marché du travail après avoir suivi cette formation spécifique.
De manière similaire, dans la filière lait local, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 1 mois
tant pour les hommes que pour les femmes. Cette cohérence souligne une équivalence dans les délais
d'insertion professionnelle pour les deux genres dans cette filière particulière.
Ces chiffres agrégés montrent une stabilité dans les délais d'insertion professionnelle entre les sexes,
indépendamment de la filière de formation suivie. Ces constatations suggèrent une relative égalité
d'accès au marché du travail pour les hommes et les femmes, du moins en termes de durée moyenne
pour obtenir leur premier emploi.
Tableau 106: Durée moyenne d’accès au premier emploi par filière et sexe (mois)
Filière de formation Homme Femme Total
Pomme de terre 2 2 2
Lait local 1 1 1
Total 2 1 2
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données indiquent une cohérence générale dans la durée d'accès au premier emploi entre hommes
et femmes, bien que des variations puissent être observées en fonction des métiers.
Pour le métier de producteur de pomme de terre de consommation, la durée moyenne d'accès au
premier emploi est de 2 mois pour les hommes et de 1 mois pour les femmes. De même, dans les
métiers de producteur laitier et de maintenanciers des équipements agricoles (MEA), les durées
moyennes sont respectivement de 1 mois et 2 mois, bien que les durées pour les femmes ne soient pas
spécifiées. Pour ces deux métiers, aucune femme en emploi n’a été identifiée.
Le métier de producteur de fourrage affiche une durée moyenne d'accès au premier emploi de 1 mois,
indépendamment du sexe. Dans le métier de producteur de pomme de terre de consommation et de
semence, la durée moyenne est de 2 mois pour les deux sexes. Quel que soit le sexe, la durée moyenne
d'accès au premier emploi est de 1 mois pour les métiers d’éleveur laitier.
Ces données suggèrent une relative uniformité dans les délais d'insertion professionnelle entre les
sexes, bien que des variations puissent être observées en fonction des métiers spécifiques.
Tableau 107: Durée moyenne d’accès au premier emploi par métier et sexe (mois)
Métier Homme Femme Total
Producteur de pomme de terre de consommation 2 1 2
Producteur laitier 1 - 1
Producteur de fourrage 1 1 1
Producteur de pomme de terre de consommation et de semence 2 2 2
Éleveur laitier 1 1 1
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 2 - 2
Total 2 1 2
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L’analyse de la durée moyenne d'accès au premier emploi par maillon de la chaîne et par sexe indique
une certaine homogénéité dans la durée d'accès au premier emploi entre hommes et femmes, avec
quelques variations notables.
Cependant, dans le maillon de la production, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 2
mois pour les hommes et les femmes, suggérant une similitude dans les délais d'insertion
professionnelle entre les sexes dans ce métier spécifique.
 |
99 99 |
▲back to top |
98
Le maillon du stockage et conservation affiche une durée moyenne d'accès au premier emploi de 1
mois, bien que la durée pour les femmes ne soit pas mentionnée car aucune femme de ce maillon est
en emploi. De même, dans le maillon de la transformation et commercialisation, la durée moyenne est
de 1 mois pour les deux sexes, soulignant une concordance dans les délais d'accès au premier emploi
dans ce secteur.
Pour le maillon "Autre", la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 1 mois pour les hommes
et les femmes, reflétant une similarité dans les délais d'insertion professionnelle.
Ces résultats suggèrent une cohérence générale dans les délais d'insertion professionnelle entre les
sexes, bien que des variations puissent exister en fonction des maillons spécifiques de la chaîne.
Tableau 108: Durée moyenne d’accès au premier emploi par maillon et sexe (mois)
Maillon Homme Femme Total
Production 2 2 2
Stockage et conservation 1 - 1
Transformation et commercialisation 1 1 1
Autre 1 1 1
Total 2 1 2
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L’analyse de la durée moyenne d'accès au premier emploi par tranche d'âge et par sexe en mois
suggère une tendance générale à une uniformité des délais d'insertion professionnelle entre hommes
et femmes, bien que des nuances puissent apparaître en fonction des tranches d'âge. Pour la tranche
d'âge de 15 à 24 ans, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 1 mois pour les hommes et
les femmes, indiquant une similitude dans les délais d'insertion professionnelle pour les jeunes.
Dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans, la durée moyenne est de 2 mois pour les hommes et les femmes,
reflétant une concordance dans les délais d'accès au premier emploi au sein de cette catégorie d'âge.
Quant aux plus de 35 ans, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 1 mois pour les hommes,
bien que la durée pour les femmes ne soit pas mentionnée car aucune femme de plus de 35 ans n’était
en emploi.
Ces données suggèrent une relative homogénéité dans les délais d'insertion professionnelle entre les
sexes, avec des variations potentielles en fonction des groupes d'âge spécifiques.
Tableau 109: Durée moyenne d’accès au premier emploi par tranche d’âge et sexe (mois)
Tranche d'âge Homme Femme Total
15 - 24 ans 1 1 1
25 - 35 ans 2 2 2
Plus de 35 ans 1 - 1
Total 2 1 2
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse de la durée moyenne d'accès au premier emploi selon le statut dans l'activité et le sexe en
mois met en lumière des disparités dans les délais d'insertion professionnelle des jeunes. Pour les
salariés, on observe une uniformité avec une durée moyenne de 2 mois, aussi bien pour les hommes
que pour les femmes.
En revanche, pour les indépendants/employeurs, la durée moyenne est de 2 mois pour les hommes et
de 1 mois pour les femmes, soulignant une différence notable dans les délais d'accès au premier emploi
en fonction du genre chez les jeunes optant pour un statut indépendant. En ce qui concerne l'auto-
emploi, la durée moyenne d'accès au premier emploi est de 1 mois pour les hommes et de 2 mois pour
les femmes, mettant en évidence une variation significative dans les délais d'insertion professionnelle
entre les sexes pour ceux qui choisissent cette voie.
Ces observations synthétisent les tendances spécifiques à chaque statut, mettant en évidence des
distinctions potentielles dans les délais d'insertion professionnelle en fonction du statut et du genre.
 |
100 100 |
▲back to top |
99
Tableau 110: Durée moyenne d’accès au premier emploi par statut dans l’activité et sexe (mois)
Statut dans l'activité Homme Femme Total
Salarié 2 2 2
Indépendant 2 1 2
Auto-emploi 1 2 1
Total 2 1 2
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.16. Lien formation-emploi
L’examen de la répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le sexe met en
évidence des variations significatives entre hommes et femmes en termes de perception du lien entre
leur formation et leur emploi actuel.
Pour les hommes, la majorité (77,3%) estime que leur emploi actuel est en parfait accord avec leur
formation, affirmant un lien étroit entre les deux. En revanche, 8,4% pensent que le lien est plutôt mitigé,
tandis que 14,3% estiment qu'il n'y a aucun lien entre leur formation et leur emploi actuel.
Pour les femmes, la dynamique est différente. Seulement 52,9% considèrent que leur emploi est en
totale adéquation avec leur formation, indiquant une perception moins affirmative par rapport aux
hommes. Une proportion plus élevée (11,8%) pense que le lien est partiellement présent, et 35,3%
estiment qu'il n'y a pas du tout de lien entre leur formation et leur emploi actuel.
Les données montrent que la majorité des jeunes, indépendamment du sexe, perçoit un certain lien
entre leur formation et leur emploi actuel. Cependant, cette perception varie significativement entre les
genres, soulignant des différences dans la manière dont les hommes et les femmes évaluent la
pertinence de leur formation par rapport à leur emploi actuel.
Tableau 111: Répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et sexe
Lien formation-emploi
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Oui, tout à fait 92 77,3 18 52,9 110 71,9
Oui, plus ou moins 10 8,4 4 11,8 14 9,2
Non, pas du tout 17 14,3 12 35,3 29 19,0
Total 119 100,0 34 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le type de formation révèle des
variations significatives dans la perception du lien entre la formation et l'emploi en fonction du type de
formation.
Pour les jeunes ayant suivi un apprentissage, une grande majorité (87,0%) estime que leur emploi actuel
est en totale adéquation avec leur formation, soulignant une forte correspondance entre les
compétences acquises pendant l'apprentissage et les exigences de leur emploi actuel. En revanche,
une proportion très faible (3,3%) considère que le lien est partiellement présent, et 9,8% estiment qu'il
n'y a aucun lien entre leur formation en apprentissage et leur emploi actuel.
En ce qui concerne les jeunes ayant suivi une formation qualifiante, la dynamique est différente. Bien
que la majorité (49,2%) estime que le lien entre leur formation et leur emploi est tout à fait présent, une
proportion significative (18,0%) pense que le lien est plus ou moins présent, et 32,8% estiment qu'il n'y
a pas du tout de lien.
Globalement, les jeunes ayant suivi un apprentissage ont tendance à percevoir un lien plus fort entre
leur formation et leur emploi actuel par rapport à ceux ayant suivi une formation qualifiante. Ces résultats
soulignent l'influence du type de formation sur la perception du lien entre la formation et l'emploi.
 |
101 101 |
▲back to top |
100
Tableau 112: Répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le type de formation
Lien formation-emploi
Apprentissage Qualifiante Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Oui, tout à fait 80 87,0 30 49,2 110 71,9
Oui, plus ou moins 3 3,3 11 18,0 14 9,2
Non, pas du tout 9 9,8 20 32,8 29 19,0
Total 92 100,0 61 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le tableau ci-dessous expose la répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et la
filière dans laquelle ils ont été formés. Ces données mettent en lumière des disparités significatives
dans la perception du lien entre la formation et l'emploi en fonction de la filière.
Pour la filière pomme de terre, une grande majorité (81,3%) des jeunes estime que leur emploi actuel
est en totale adéquation avec leur formation. En revanche, une proportion plus modeste (7,5%)
considère que le lien est plus ou moins présent, et 11,2% estiment qu'il n'y a aucun lien entre leur
formation dans la filière pomme de terre et leur emploi actuel.
En ce qui concerne la filière lait local, la dynamique est différente. Seulement la moitié (50,0%) des
jeunes estime que le lien entre leur formation et leur emploi est tout à fait présent, indiquant une
perception moins affirmée par rapport à la filière pomme de terre. Une proportion plus élevée (37,0%)
estime qu'il n'y a pas du tout de lien entre leur formation dans la filière lait local et leur emploi actuel et
13,0% pense que le lien est plus ou moins présent.
Les jeunes formés dans la filière pomme de terre ont tendance à percevoir un lien plus fort entre leur
formation et leur emploi actuel par rapport à ceux formés dans la filière lait local. Ces résultats soulignent
l'influence de la filière de formation sur la perception du lien entre la formation et l'emploi.
Tableau 113: Répartition des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et la filière
Lien formation-emploi
Pomme de terre Lait local Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Oui, tout à fait 87 81,3 23 50,0 110 71,9
Oui, plus ou moins 8 7,5 6 13,0 14 9,2
Non, pas du tout 12 11,2 17 37,0 29 19,0
Total 107 100,0 46 100,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La majorité des producteurs de pommes de terre de consommation (93,1%) estime que leur emploi est
en totale adéquation avec leur formation, indiquant une forte correspondance entre les compétences
acquises lors de leur formation et les exigences de leur emploi actuel. Seuls 1,4% estiment que le lien
est plus ou moins présent, tandis que 5,6% pensent qu'il n'y a aucun lien.
Pour les producteurs laitiers, la plupart (81,8%) considèrent que le lien est tout à fait présent. Cependant,
18,2% estiment qu'il n'y a aucun lien avec leur formation.
Dans le métier de producteur de fourrage, une proportion moins significative (44,4%) estime que le lien
est tout à fait présent, mais une part importante (33,3%) estime qu'il n'y a pas du tout de lien avec leur
formation.
Les producteurs de pommes de terre de consommation et de semence affichent une diversité
d'opinions, avec 57,7% estimant que le lien est tout à fait présent, 19,2% considérant qu'il est plus ou
moins présent, et 23,1% estimant qu'il n'y a aucun lien.
En ce qui concerne les éleveurs laitiers, une proportion faible (38,5%) estime que le lien est tout à fait
présent, tandis que 46,2% pensent qu'il n'y a aucun lien avec leur formation.
Pour le métier de maintenance des équipements agricoles (MEA), une majorité (55,6%) estime que le
lien est tout à fait présent, tandis que 22,2% considèrent qu'il est plus ou moins présent, et 22,2%
estiment qu'il n'y a aucun lien.
L’analyse souligne des variations significatives dans la perception du lien formation-emploi selon les
métiers. Certains métiers, comme les producteurs de pommes de terre de consommation, montrent une
 |
102 102 |
▲back to top |
101
forte corrélation, tandis que d'autres, comme les éleveurs laitiers, présentent des opinions plus
divergentes sur la pertinence de leur formation par rapport à leur emploi actuel. Ces résultats mettent
en évidence la complexité de la relation entre la formation et l'emploi, avec des nuances propres à
chaque métier.
Graphique 29 : Proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le métier
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le maillon de la chaîne agricole met
en évidence des variations significatives dans la perception du lien entre la formation et l'emploi en
fonction du maillon au sein duquel les jeunes travaillent.
Dans le maillon de la production, une grande majorité (85,0%) estime que le lien entre leur formation et
leur emploi est tout à fait présent, indiquant une forte correspondance entre les compétences acquises
pendant la formation et les exigences de leur emploi actuel. Une proportion moindre (9,7%) considère
que le lien est plus ou moins présent, tandis que 5,3% estiment qu'il n'y a aucun lien.
Pour le maillon du stockage et conservation, la totalité des jeunes (100,0%) estime que le lien est tout
à fait présent, indiquant une perception unanime de la correspondance entre la formation et l'emploi
dans ce maillon spécifique. Dans le maillon de la transformation et commercialisation, une majorité
(77,8%) estime que le lien est tout à fait présent, tandis que 22,2% considèrent qu'il n'y a aucun lien
avec leur formation.
Pour le maillon "Autre", les résultats sont plus nuancés. Seulement 17,2% estiment que le lien est tout
à fait présent, 10,3% considèrent qu'il est plus ou moins présent, et une grande majorité (72,4%) estime
qu'il n'y a aucun lien entre leur formation et leur emploi actuel dans ce maillon spécifique.
Cette analyse met en lumière des variations notables dans la perception du lien formation-emploi en
fonction du maillon de la chaîne agricole. Certains maillons, comme la production, présentent une forte
corrélation, tandis que d'autres, comme "Autre maillon", montrent des opinions plus divergentes sur la
pertinence de la formation par rapport à l'emploi actuel. Ces résultats soulignent l'influence du contexte
professionnel spécifique sur la perception du lien entre la formation et l'emploi.
93,1%
81,8%
44,4%
57,7%
38,5%
55,6%
71,9%
1,4%
22,2%
19,2%
15,4%
22,2%
9,2%
5,6%
18,2%
33,3%
23,1%
46,2%
22,2%
19,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Producteur de pomme de terre de consommation
Producteur laitier
Producteur de fourrage
Producteur de pomme de terre de consommation
et de semence
Éleveur laitier
Maintenance des équipements agricoles (MEA)
Total
Non, pas du tout Oui, plus ou moins Oui, tout à fait
 |
103 103 |
▲back to top |
102
Tableau 114: Proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et le maillon
Maillon
Oui, tout à fait
Oui, plus ou
moins
Non, pas du
tout
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Production 96 85,0 11 9,7 6 5,3 113 100,0
Stockage et conservation 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Transformation et commercialisation 7 77,8 0 0,0 2 22,2 9 100,0
Autre 5 17,2 3 10,3 21 72,4 29 100,0
Total 110 71,9 14 9,2 29 19,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données relatives à la proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et leur statut
dans l'activité révèlent des variations significatives dans la perception du lien entre la formation et
l'emploi en fonction du statut professionnel des jeunes.
Pour les salariés, une majorité (76,3%) estime que le lien entre leur formation et leur emploi est tout à
fait présent, soulignant une forte corrélation entre leurs compétences acquises pendant la formation et
les exigences de leur emploi actuel. Une proportion plus réduite (6,8%) considère que le lien est plus
ou moins présent, tandis que 16,9% estiment qu'il n'y a aucun lien.
Dans le cas des indépendants/employeurs, une proportion plus élevée (88,1%) estime que le lien est
tout à fait présent, suggérant une perception positive de la correspondance entre la formation et l'emploi.
Une faible proportion (4,8%) pense que le lien est plus ou moins présent, et 7,1% estiment qu'il n'y a
aucun lien.
En revanche, pour les jeunes en auto-emploi, la dynamique est différente. Seulement 53,8% estiment
que le lien est tout à fait présent, indiquant une perception moins affirmée par rapport aux salariés et
aux indépendants/employeurs. Une proportion significative (15,4%) considère que le lien est plus ou
moins présent, et 30,8% estiment qu'il n'y a aucun lien entre leur formation et leur emploi actuel.
Cette analyse souligne des variations importantes dans la perception du lien formation-emploi en
fonction du statut dans l'activité. Les salariés et les indépendants semblent avoir une perception plus
positive de la correspondance entre leur formation et leur emploi, tandis que les personnes en auto-
emploi présentent des opinions plus mitigées. Ces résultats mettent en évidence l'impact du statut
professionnel sur la manière dont les individus évaluent la pertinence de leur formation par rapport à
leur emploi actuel.
Tableau 115: Proportion des jeunes en emploi selon le lien formation-emploi et statut dans l’activité
Statut dans l'activité
Oui, tout à
fait
Oui, plus ou
moins
Non, pas du
tout
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Salarié 45 76,3 4 6,8 10 16,9 59 100,0
Indépendant 37 88,1 2 4,8 3 7,1 42 100,0
Auto-emploi 28 53,8 8 15,4 16 30,8 52 100,0
Total 110 71,9 14 9,2 29 19,0 153 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.1.17. Effets de la formation sur l’insertion
Les résultats révèlent des disparités significatives dans la manière dont les hommes et les femmes
évaluent l'impact de leur formation sur l'amélioration de compétences spécifiques. En ce qui concerne
les compétences liées aux techniques d’entretien et réparation d’équipements agricoles, les hommes
(30,8%) ont noté une amélioration plus marquée par rapport aux femmes (5,6%), suggérant que ces
compétences ont eu un impact plus significatif sur les hommes après leur formation.
Pour le domaine du système d’approvisionnement, une proportion plus élevée d'hommes (29,7%)
rapporte une amélioration par rapport aux femmes (11,1%), bien que la différence soit moins prononcée
que dans le domaine de la réparation d'équipements agricoles. De même, dans le système de
commercialisation, les hommes (27,5%) signalent une amélioration plus fréquente que les femmes
(16,7%), bien que la disparité soit moins importante.
 |
104 104 |
▲back to top |
103
Concernant les compétences en techniques de stockage et de conservation, les hommes (20,9%)
indiquent une amélioration plus fréquente par rapport aux femmes (11,1%). En ce qui concerne les
techniques de production, les hommes (47,3%) présentent une proportion significativement plus élevée
signalant une amélioration, tandis que les femmes (38,9%) affichent également une augmentation
notable de leurs compétences dans ce domaine.
Pour les compétences regroupées sous "Autres", les femmes (33,3%) ont noté une amélioration plus
prononcée que les hommes (19,8%).
Ces résultats soulignent clairement que les hommes et les femmes ont des perceptions divergentes
quant à l'impact de leur formation sur le renforcement de compétences spécifiques. Cette observation
met en évidence l'importance de considérer les nuances de genre lors de l'évaluation des effets de la
formation sur l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur agricole.
Tableau 116: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le sexe (%)
Amélioration constatée Homme Femme Total
Techniques d’entretien et réparation d’équipements agricoles 30,8 5,6 26,6
Système d’approvisionnement 29,7 11,1 26,6
Système de commercialisation 27,5 16,7 25,7
Techniques de production 47,3 38,9 45,9
Techniques de stockage et de conservation 20,9 11,1 19,3
Autres 19,8 33,3 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Les données relatives aux effets de la formation sur l'insertion des jeunes en se focalisant sur différentes
compétences, dévoilent des tendances variables dans la manière dont les jeunes perçoivent
l'amélioration de leurs compétences selon la localité géographique.
Dans la localité de Bougouni, aucune amélioration constatée n'est rapportée pour les techniques
d'entretien et réparation d’équipements agricoles, suggérant un impact limité de la formation dans cette
compétence spécifique dans cette zone. Cependant, des améliorations sont notées dans d'autres
compétences telles que le système d’approvisionnement (14,3%) et la commercialisation (14,3%).
Kadiolo présente des résultats contrastés avec une amélioration significative dans les techniques
d'entretien et réparation d’équipements agricoles (33,3%), tandis que le système d’approvisionnement
(16,7%) et la commercialisation (8,3%) montrent des améliorations plus modestes.
Dans la localité de Kolondièba, les résultats suggèrent des améliorations notables dans la
commercialisation (33,3%), indiquant une réponse positive des jeunes de cette localité à la formation
dans ce domaine.
À Koutiala, des améliorations significatives sont signalées dans les techniques d'entretien et réparation
d’équipements agricoles (5,3%) et le système d’approvisionnement (15,8%). Cependant, la
commercialisation (26,3%) montre également une amélioration notable.
Sikasso présente des résultats équilibrés avec des améliorations signalées dans plusieurs
compétences, notamment les techniques d'entretien et réparation d’équipements agricoles (36,4%), le
système d’approvisionnement (34,8%), la commercialisation (30,3%), et les techniques de production
(47,0%).
Yanfolila, Yorosso, et les zones hors zone présentent des résultats où certaines compétences montrent
des améliorations, mais d'autres affichent des pourcentages nuls ou faibles. Par exemple, Yanfolila
montre une amélioration significative à 100% dans les techniques de production.
Les résultats révèlent des variations géographiques importantes dans la manière dont les jeunes
perçoivent l'impact de leur formation sur différentes compétences agricoles. Ces disparités soulignent
l'influence du contexte local sur l'efficacité perçue de la formation dans le renforcement des
compétences des jeunes dans le secteur agricole.
 |
105 105 |
▲back to top |
104
Tableau 117: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon la localité (%)
Amélioration constatée Bougouni Kadiolo Kolondièba Koutiala Sikasso Yanfolila Yorosso
Hors
zone
Total
Techniques d’entretien et
réparation d’équipements
agricoles
0,0 33,3 0,0 5,3 36,4 0,0 0,0 0,0 26,6
Système
d’approvisionnement
14,3 16,7 0,0 15,8 34,8 0,0 0,0 0,0 26,6
Système de
commercialisation
14,3 8,3 33,3 26,3 30,3 0,0 0,0 0,0 25,7
Techniques de production 57,1 33,3 0,0 47,4 47,0 100,0 0,0 0,0 45,9
Techniques de stockage et
de conservation
14,3 16,7 0,0 26,3 19,7 0,0 0,0 0,0 19,3
Autres 28,6 16,7 66,7 36,8 16,7 0,0 0,0 0,0 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des effets de la formation sur l'insertion des jeunes, en fonction de leur niveau d'instruction
antérieur, révèle des disparités significatives dans la manière dont ils perçoivent l'amélioration de leurs
compétences agricoles.
Pour les techniques d’entretien et réparation d’équipements agricoles, une amélioration notable est
observée chez les jeunes sans instruction préalable (21,4%) et ceux ayant suivi un enseignement
coranique ou étant alphabétisés (11,1%). Les pourcentages augmentent avec le niveau d'instruction,
atteignant 34,6% pour le niveau secondaire, mais déclinent pour le niveau supérieur, aboutissant à une
moyenne de 26,6%. En ce qui concerne le système d’approvisionnement, les jeunes sans instruction
préalable (21,4%) et ceux ayant suivi un enseignement coranique ou étant alphabétisés (22,2%)
rapportent des améliorations notables. Les pourcentages varient en fonction du niveau d'instruction,
atteignant 35,3% pour le niveau fondamental, mais diminuant ensuite pour le niveau supérieur, avec
une moyenne globale de 26,6%.
Pour le système de commercialisation, les jeunes sans instruction préalable (35,7%) affichent la plus
grande amélioration, suivis de ceux ayant suivi un enseignement coranique ou étant alphabétisés
(22,2%). Les pourcentages diminuent avec le niveau d'éducation, aboutissant à une moyenne de
25,7%. De même, pour les techniques de production, les jeunes sans instruction préalable (64,3%) et
ceux ayant suivi un enseignement coranique ou étant alphabétisés (88,9%) présentent des
pourcentages élevés. Cependant, le pourcentage diminue significativement pour le niveau supérieur,
conduisant à une moyenne globale de 45,9%.
Concernant les techniques de stockage et de conservation et "Autres", les tendances varient également
en fonction du niveau d'instruction préalable. Ces résultats soulignent l'impact différencié de la formation
selon le niveau d'éducation préalable des jeunes, mettant en évidence l'importance de concevoir des
programmes de formation adaptés à différents niveaux d'instruction pour maximiser les avantages pour
les participants.
Tableau 118: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le niveau d’instruction avant la formation (%)
Amélioration constatée Aucun Coranique/alphabétisé(e) Fondamental Secondaire Supérieur Total
Techniques d’entretien et
réparation d’équipements
agricoles
21,4 11,1 27,5 34,6 22,2 26,6
Système d’approvisionnement 21,4 22,2 35,3 15,4 22,2 26,6
Système de
commercialisation
35,7 22,2 31,4 11,5 22,2 25,7
Techniques de production 64,3 88,9 49,0 30,8 0,0 45,9
Techniques de stockage et de
conservation
7,1 33,3 21,6 15,4 22,2 19,3
Autres 21,4 11,1 13,7 34,6 44,4 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des effets de la formation sur l'insertion des jeunes, en fonction du type de formation, révèle
des différences marquées dans la manière dont les participants perçoivent l'amélioration de leurs
compétences agricoles.
 |
106 106 |
▲back to top |
105
En ce qui concerne les techniques d'entretien et de réparation d'équipements agricoles, les jeunes
formés par apprentissage (27,5%) montrent des pourcentages plus élevés d'amélioration par rapport à
ceux ayant suivi une formation qualifiante (24,1%), aboutissant à une moyenne globale de 26,6%.
Une tendance similaire se manifeste dans le domaine du système d'approvisionnement, où les
participants à l'apprentissage (30,0%) présentent des pourcentages plus élevés d'amélioration que ceux
de la formation qualifiante (17,2%), conduisant à une moyenne globale de 26,6%. De même, pour le
système de commercialisation, les jeunes ayant suivi une formation par apprentissage (30,0%) affichent
des pourcentages d'amélioration plus élevés que ceux de la formation qualifiante (13,8%), contribuant
à une moyenne de 25,7%.
Dans le domaine des techniques de production, une nette préférence se dégage en faveur de
l'apprentissage, avec un pourcentage d'amélioration de 55,0%, tandis que la formation qualifiante
présente un pourcentage de 20,7%. La moyenne globale pour cette catégorie atteint 45,9%. Pour les
techniques de stockage et de conservation, ainsi que pour les "Autres compétences", des variations
significatives sont également observées, soulignant l'impact différencié de l'apprentissage par rapport
à la formation qualifiante dans ces domaines spécifiques.
Ces résultats soulignent l'influence significative du type de formation sur la perception de l'amélioration
des compétences agricoles, soulignant ainsi l'importance de concevoir des programmes de formation
adaptés pour maximiser les avantages pour les participants.
Tableau 119: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le type de formation (%)
Amélioration constatée Apprentissage Qualifiante Total
Techniques d’entretien et réparation d’équipements agricoles 27,5 24,1 26,6
Système d’approvisionnement 30,0 17,2 26,6
Système de commercialisation 30,0 13,8 25,7
Techniques de production 55,0 20,7 45,9
Techniques de stockage et de conservation 18,8 20,7 19,3
Autres 16,3 37,9 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'examen des effets de la formation sur l'insertion des jeunes, selon la filière, met en lumière des
variations significatives dans la perception de l'amélioration des compétences agricoles.
Pour les techniques d'entretien et de réparation d'équipements agricoles, les jeunes issus de la filière
pomme de terre présentent un pourcentage d'amélioration plus élevé (30,2%) par rapport à ceux de la
filière lait local (13,0%), aboutissant à une moyenne globale de 26,6%. Concernant le système
d'approvisionnement, une tendance similaire se manifeste, avec des pourcentages d'amélioration plus
élevés pour la filière pomme de terre (32,6%) par rapport à la filière lait local (4,3%), contribuant à une
moyenne globale de 26,6%. Pour le système de commercialisation, les participants de la filière pomme
de terre affichent également un pourcentage d'amélioration plus élevé (27,9%) que ceux de la filière lait
local (17,4%), contribuant à une moyenne de 25,7%.
En ce qui concerne les techniques de production, une nette préférence se dégage en faveur de la filière
pomme de terre, avec un pourcentage d'amélioration de 47,7%, tandis que la filière "Lait local" présente
un pourcentage de 39,1%. La moyenne globale pour cette catégorie atteint 45,9%. Pour les techniques
de stockage et de conservation, ainsi que pour les "Autres compétences", des variations sont également
observées entre les deux filières, soulignant l'impact différencié de la formation selon la spécialisation
de la filière.
Ces résultats soulignent l'influence significative de la filière sur la perception de l'amélioration des
compétences agricoles, mettant en évidence l'importance de concevoir des programmes de formation
adaptés à chaque spécialisation pour maximiser les avantages pour les participants.
 |
107 107 |
▲back to top |
106
Tableau 120: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon la filière (%)
Amélioration constatée
Pomme de
terre
Lait local Total
Techniques d’entretien et réparation d’équipements agricoles 30,2 13,0 26,6
Système d’approvisionnement 32,6 4,3 26,6
Système de commercialisation 27,9 17,4 25,7
Techniques de production 47,7 39,1 45,9
Techniques de stockage et de conservation 20,9 13,0 19,3
Autres 18,6 34,8 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'analyse des effets de la formation sur l'insertion des jeunes, selon le métier, met en évidence des
tendances significatives dans la perception de l'amélioration des compétences agricoles. Pour les
techniques d'entretien et de réparation d'équipements agricoles, les maintenanciers des équipements
agricoles (MEA) affichent le pourcentage d'amélioration le plus élevé (80,0%), suivi des producteurs
laitiers (33,3%).
Pour le système d'approvisionnement, les producteurs de pomme de terre de consommation obtiennent
le pourcentage d'amélioration le plus élevé (35,8%), suivi de près par les producteurs de pomme de
terre de consommation et de semence (28,6%). Les systèmes de commercialisation présentent une
variabilité significative, avec les producteurs laitiers affichant le pourcentage le plus élevé (33,3%). Les
producteurs de pomme de terre de consommation et les producteurs de pomme de terre de
consommation et de semence obtenant des pourcentages de 31,3% et 21,4%, respectivement. La
moyenne globale pour cette catégorie atteint 25,7%. En ce qui concerne les techniques de production,
une nette préférence se dégage pour les producteurs de pomme de terre de consommation (56,7%),
suivis des producteurs de fourrage (50,0%).
Les autres métiers présentent également des pourcentages significatifs, soulignant l'impact positif de la
formation. Pour les techniques de stockage et de conservation, les producteurs de pomme de terre de
consommation et de semence affichent le pourcentage d'amélioration le plus élevé (35,7%), suivi des
producteurs laitiers (22,2%). Enfin, pour les "Autres compétences", les producteurs de fourrage et les
éleveurs laitiers obtiennent des pourcentages significatifs de 50,0%. Ces résultats soulignent l'influence
différenciée de la formation en fonction du métier exercé, mettant en évidence l'importance de concevoir
des programmes adaptés à chaque secteur pour maximiser les avantages pour les participants.
Tableau 121: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le métier (%)
Amélioration
constatée
Producteur de
pomme de
terre de
consommation
Producteur
laitier
Producteur
de
fourrage
Producteur de
pomme de
terre de
consommation
et de
semence
Éleveur
laitier
Maintenance
des
équipements
agricoles
(MEA)
Total
Techniques
d’entretien et
réparation
d’équipements
agricoles
28,4 33,3 0,0 21,4 0,0 80,0 26,6
Système
d’approvisionnement
35,8 0,0 0,0 28,6 10,0 0,0 26,6
Système de
commercialisation
31,3 33,3 0,0 21,4 10,0 0,0 25,7
Techniques de
production
56,7 44,4 50,0 21,4 30,0 0,0 45,9
Techniques de
stockage et de
conservation
19,4 22,2 0,0 35,7 10,0 0,0 19,3
Autres 14,9 11,1 50,0 35,7 50,0 20,0 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
L'examen des effets de la formation sur l'insertion des jeunes, selon le statut dans l'activité, révèle des
variations significatives dans la perception de l'amélioration des compétences agricoles. Pour les
 |
108 108 |
▲back to top |
107
techniques d'entretien et de réparation d'équipements agricoles, les salariés affichent le pourcentage
d'amélioration le plus élevé (35,6%), suivi des indépendants (27,8%). Les personnes en auto-emploi
présentent un pourcentage plus bas de 10,7%, conduisant à une moyenne globale de 26,6%.
En ce qui concerne le système d'approvisionnement, les indépendants obtiennent le pourcentage
d'amélioration le plus élevé (38,9%), suivi des jeunes en auto-emploi (25,0%), contribuant à une
moyenne globale de 26,6%. Pour le système de commercialisation, une tendance similaire se
manifeste, avec les indépendants obtenant le pourcentage d'amélioration le plus élevé (36,1%), suivi
des jeunes en auto-emploi (28,6%). En ce qui concerne les techniques de production, une nette
préférence se dégage pour les personnes en auto-emploi (53,6%), suivies des indépendants (47,2%)
et des salariés (40,0%). La moyenne globale pour cette catégorie atteint 45,9%.
Pour les techniques de stockage et de conservation, les indépendants présentent le pourcentage
d'amélioration le plus élevé (25,0%), suivis des personnes en auto-emploi (25,0%) et des salariés
(11,1%). Enfin, pour les "Autres compétences", les indépendants (27,8%) affichent le pourcentage
d'amélioration le plus élevé, suivi des salariés (20,0%) et des personnes en auto-emploi (17,9%).
Tableau 122: Effets de la formation sur l’insertion des jeunes selon le statut dans l’activité (%)
Amélioration constatée Salarié Indépendant Auto-
emploi
Total
Techniques d’entretien et réparation d’équipements agricoles 35,6 27,8 10,7 26,6
Système d’approvisionnement 17,8 38,9 25,0 26,6
Système de commercialisation 15,6 36,1 28,6 25,7
Techniques de production 40,0 47,2 53,6 45,9
Techniques de stockage et de conservation 11,1 25,0 25,0 19,3
Autres 20,0 27,8 17,9 22,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
109 109 |
▲back to top |
108
2.3.2. Chômage
Les jeunes de la cohorte 2022 font face à des réalités variées en matière de chômage, comme illustré
par les différentes caractéristiques analysées. La répartition des jeunes au chômage selon la localité,
le sexe, la tranche d’âge, le statut matrimonial, le type de formation, la filière, et le métier offre un
panorama détaillé de certains aspects liés au chômage.
Les canaux de recherche d'emploi dévoilent les divers moyens utilisés par les jeunes chômeurs pour
trouver des opportunités professionnelles, avec des variations significatives selon la filière, la tranche
d’âge, et la localité. La notion de promesse d'embauche, apporte des éclaircissements sur la confiance
des jeunes chômeurs quant à leur futur emploi, avec des variations notables en fonction du type de
formation, de la tranche d’âge, de la localité, et de la filière.
Enfin, les taux de chômage offrent une vision synthétique de la situation, mettant en avant les variations
du taux de chômage en fonction du sexe, de la tranche d'âge, de la localité, du type de formation, et de
la filière.
2.3.2.1. Caractéristiques des jeunes chômeurs
L'examen approfondi de la distribution des jeunes chômeurs par localité et sexe offre un panorama
détaillé des caractéristiques spécifiques des jeunes au chômage dans la zone de mise en œuvre du
programme MLI026. Parmi les 147 jeunes chômeurs recensés, on observe une parité presque égale
entre les sexes, avec 69 hommes et 78 femmes.
Les disparités régionales sont clairement visibles, mettant en lumière que 34,0% des jeunes chômeurs
se trouvent à Koutiala, suivi de Kadiolo avec 22,4% et Sikasso avec 12,9%. Notablement, aucun jeune
au chômage n'a été recensé dans la localité de Yanfolila.
Une analyse plus approfondie des données révèle des différences significatives entre les localités.
Concernant les hommes chômeurs, Koutiala et Sikasso se démarquent, représentant respectivement
33,3% et 17,4%. En ce qui concerne les femmes chômeuses, Koutiala et Kadiolo se distinguent avec
des proportions de 34,6% et 29,5%.
Cette analyse souligne la diversité des situations locales et la nécessité de concevoir des stratégies
d'emploi différenciées, tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque localité. L'absence de
chômeurs recensés à Yanfolila souligne également l'importance de comprendre les réalités locales pour
une mise en œuvre efficace du programme MLI026.
Tableau 123: Répartition des jeunes au chômage par localité et sexe
Localité
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bougouni 9 13,0 6 7,7 15 10,2
Kadiolo 10 14,5 23 29,5 33 22,4
Kolondièba 6 8,7 8 10,3 14 9,5
Koutiala 23 33,3 27 34,6 50 34,0
Sikasso 12 17,4 7 9,0 19 12,9
Yanfolila 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Yorosso 7 10,1 7 9,0 14 9,5
Hors zone 2 2,9 0 0,0 2 1,4
Total 69 100,0 78 100,0 147 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Globalement, parmi les 147 jeunes chômeurs recensés, on observe une légère prédominance des
femmes, constituant 53,1% du total. En analysant par tranche d'âge, les jeunes de 15 à 24 ans
représentent une part significative, avec 67 individus au total. La tranche d'âge de 15 à 24 ans révèle
une nette majorité de femmes chômeurs, représentant 59,7%, par rapport à 40,3% d'hommes. Cette
observation souligne les défis spécifiques auxquels sont confrontées les jeunes femmes sur le marché
du travail.
 |
110 110 |
▲back to top |
109
Pour la tranche d'âge de 25 à 35 ans, le taux de chômage total est de 51,7%, avec une répartition
relativement équilibrée entre hommes (51,3%) et femmes (48,7%). Cela suggère une situation où les
deux sexes partagent de manière similaire les difficultés d'emploi dans cette catégorie d'âge.
La tranche d'âge de plus de 35 ans présente un taux de chômage plus faible, avec seulement 4 individus
au total. Cependant, cette tranche d'âge révèle une nette prédominance d'hommes chômeurs,
constituant 75%, comparé à 25% de femmes.
Cette analyse détaillée met en évidence les variations dans la répartition des jeunes chômeurs selon
l'âge et le sexe. La prédominance des femmes chômeurs, en particulier dans la tranche d'âge de 15 à
24 ans, souligne la nécessité d'approches différenciées pour aborder les disparités d'emploi entre les
genres et les groupes d'âge spécifiques.
Tableau 124: Répartition des jeunes au chômage par tranche d’âge et sexe
Tranche d’âge
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
15 - 24 ans 27 39,1 40 51,3 67 45,6
25 - 35 ans 39 56,5 37 47,4 76 51,7
Plus de 35 ans 3 4,3 1 1,3 4 2,7
Total 69 100,0 78 100,0 147 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Globalement, parmi les 147 jeunes chômeurs recensés, les personnes mariées représentent la majorité,
constituant 58,5% du total. Cette catégorie inclut 52,2% d'hommes et 64,1% de femmes chômeurs. En
comparaison, les célibataires représentent 41,5% du total, avec 47,8% d'hommes et 35,9% de femmes
chômeurs. Il est notable qu'aucun chômeur n'est répertorié comme divorcé ou veuf dans ce tableau ci-
dessous, indiquant une absence de cette catégorie spécifique parmi les jeunes chômeurs.
L'analyse de la répartition des jeunes au chômage par statut matrimonial et sexe suggère que le statut
matrimonial peut jouer un rôle dans les tendances du chômage. Les personnes mariées semblent être
plus touchées par le chômage, et cette observation peut être explorée davantage pour comprendre les
dynamiques socio-économiques qui influent sur cette corrélation.
En fin, ces données mettent en lumière des liens potentiels entre le statut matrimonial et le chômage
parmi les jeunes dans la région étudiée. L'exploration de ces relations peut contribuer à la conception
de stratégies d'emploi plus ciblées, tenant compte des caractéristiques spécifiques des jeunes.
Tableau 125: Répartition des jeunes au chômage par statut matrimonial et sexe
Statut
matrimonial
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Célibataire 33 47,8 28 35,9 61 41,5
Marié(e) 36 52,2 50 64,1 86 58,5
Divorcé(e) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Veuf(ve) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 69 100,0 78 100,0 147 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Parmi les 147 jeunes chômeurs recensés, une nette majorité a suivi une formation qualifiante,
représentant 79,6% du total. Cette catégorie comprend 65,2% d'hommes et une proportion plus élevée
de femmes, soit 92,3%. En revanche, ceux ayant suivi une formation en apprentissage représentent
20,4% du total, avec 34,8% d'hommes et 7,7% de femmes.
L'analyse détaillée révèle que les femmes ayant suivi une formation qualifiante sont significativement
plus présentes parmi les chômeuses. Ces résultats soulèvent des questions sur l'efficacité respective
de ce type de formation en termes d'employabilité des jeunes, en particulier pour les femmes. Les
données indiquent que le type de formation peut jouer un rôle significatif dans les tendances du
chômage parmi les jeunes.
 |
111 111 |
▲back to top |
110
Tableau 126: Répartition des jeunes au chômage par type de formation et sexe
Type de
formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Apprentissage 24 34,8 6 7,7 30 20,4
Qualifiante 45 65,2 72 92,3 117 79,6
Total 69 100,0 78 100,0 147 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
La filière de formation prédominante parmi les chômeurs est celle de la pomme de terre, regroupant
61,9% de l'ensemble des jeunes chômeurs. Les jeunes hommes issus de cette filière représentent une
majorité significative, constituant 71,0%, tandis que les femmes de cette même filière représentent
53,8% des femmes chômeuses. La filière du lait local, bien que moins représentée, englobe 38,1% du
total, avec 29,0% d'hommes et 46,2% de femmes.
L'analyse approfondie de ces données met en évidence des disparités notables entre les sexes au sein
des deux filières. Peu importe le sexe, les proportions de chômeurs sont plus élevées dans la filière de
la pomme de terre par rapport à la filière du lait local. Ces résultats soulignent l'importance de prendre
en compte la filière de formation dans le but de favoriser une participation équilibrée entre les sexes. Il
est crucial de noter que les jeunes n'ont pas passé suffisamment de temps sur le marché du travail, un
élément qui pourrait influencer ces chiffres.
Les données suggèrent que la filière de formation peut exercer une influence significative sur les
tendances du chômage parmi les jeunes. Cependant, il est également pertinent de considérer que le
nombre élevé de chômeurs dans la filière de la pomme de terre pourrait être expliqué par le peu de
temps que les jeunes ont consacré sur le marché de travail pour obtenir un emploi.
Tableau 127: Répartition des jeunes au chômage par filière de formation et sexe
Type de
formation
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Pomme de terre 49 71,0 42 53,8 91 61,9
Lait local 20 29,0 36 46,2 56 38,1
Total 69 100,0 78 100,0 147 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Globalement, parmi les 147 jeunes chômeurs recensés, le métier de producteur de pomme de terre de
consommation et de semence est le plus représenté, regroupant 45,6% du total. Les hommes de ce
métier représentent une part importante des jeunes chômeurs, soit 39,1%, tandis que les femmes sont
plus prédominantes, constituant 51,3% des femmes chômeuses. Le métier d'éleveur laitier est
également significatif, rassemblant 29,9% du total, avec une forte représentation de femmes
chômeuses, soit 41,0%.
En analysant les autres métiers, on observe des variations dans les proportions entre les sexes. Par
exemple, le métier de producteur de pomme de terre de consommation montre une forte présence
d'hommes (23,2%) par rapport aux femmes (2,6%). De même, le métier de maintenance des
équipements agricoles (MEA) est principalement représenté par des hommes (8,7%) sans présence
féminine.
Ces données soulignent des disparités significatives dans la répartition des jeunes chômeurs en
fonction de leur métier de formation et de leur sexe. Il est nécessaire de prendre en compte dans cette
analyse le faible temps que ces jeunes ont mis pour la recherche d’emploi.
 |
112 112 |
▲back to top |
111
Tableau 128: Répartition des jeunes au chômage par métier de formation et sexe
Métier
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Producteur de pomme de terre de consommation 16 23,2% 2 2,6% 18 12,2%
Producteur laitier 5 7,2% 3 3,8% 8 5,4%
Producteur de fourrage 3 4,3% 1 1,3% 4 2,7%
Producteur de pomme de terre de consommation et de
semence
27 39,1% 40 51,3% 67 45,6%
Éleveur laitier 12 17,4% 32 41,0% 44 29,9%
Maintenance des équipements agricoles (MEA) 6 8,7% 0 0,0% 6 4,1%
Total 69 100,0% 78 100,0% 147 100,0%
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.2.2. Canaux de recherche d'emploi
Les données présentées dans le graphique ci-après montrent la répartition des jeunes au chômage
selon leur moyen de recherche d'emploi et leur sexe. Globalement, le tableau indique que 74,7% des
jeunes au chômage utilisent des relations personnelles comme moyen de recherche d'emploi.
En détaillant par sexe, on observe que 73,6% des hommes et 75,6% des femmes ont recours aux
relations personnelles. Cela suggère que, bien que la différence ne soit pas significative, les femmes
ont légèrement plus tendance à utiliser ce moyen par rapport aux hommes.
D'autre part, la recherche d'emploi directement auprès de l'employeur est choisie par 32,0% de
l'ensemble des jeunes au chômage. En analysant par sexe, 34,7% des hommes et 29,5% des femmes
préfèrent cette approche. Les hommes sont ainsi plus enclins à solliciter directement les employeurs
que les femmes.
Les petites annonces et les médias sont également des canaux importants, représentant 32,7% du total.
Cependant, il est intéressant de noter une disparité significative entre les sexes, avec 27,8% d'hommes
utilisant ce moyen par rapport à 37,2% de femmes. Cela suggère que les femmes ont davantage recours
aux annonces et aux médias dans leur recherche d'emploi.
L'utilisation des services de l'ANPE ou APEJ est observée chez 35,3% des jeunes au chômage. En
examinant par sexe, 40,3% des hommes et 30,8% des femmes ont recours à ces organismes publics.
Cette différence indique que les hommes dépendent plus fréquemment de l'ANPE ou APEJ que les
femmes dans leur quête d'emploi.
Les jeunes chômeurs montrent une moindre préférence pour d'autres canaux tels que les bureaux
privés de placement, les concours, et divers autres moyens dans leur quête d'emploi. Ces résultats
offrent une analyse approfondie des choix de canaux de recherche d'emploi des jeunes au chômage,
soulignant des disparités significatives entre les sexes dans certaines méthodes privilégiées.
Graphique 30 : Proportion des jeunes au chômage selon leur moyen de recherche d’emploi et le sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
73,6% 75,6% 74,7%
34,7%
29,5% 32,0%
27,8% 37,2% 32,7%
40,3%
30,8%
35,3%
2,8% 3,8% 3,3%
15,3% 17,9% 16,7%
5,6% 5,1% 5,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Homme Femme Ensemble
Relations personnelles Directement auprès de l’employeur Petites annonces, médias
ANPE ou APEJ Bureau Privé de Placement Concours
Autre moyen
 |
113 113 |
▲back to top |
112
L’analyse porte sur la proportion des jeunes au chômage en fonction de leur moyen de recherche
d'emploi et de leur localité. Globalement, il offre un aperçu diversifié des choix de canaux de
recherche d'emploi dans différentes zones géographiques.
En examinant les relations personnelles comme moyen de recherche d'emploi, on constate des
variations significatives entre les localités. Bougouni affiche la plus grande préférence avec 86,7%,
tandis que Yanfolila ne montre aucune utilisation de ce moyen. Ces disparités soulignent l'influence de
la localité sur l'importance des relations personnelles dans la recherche d'emploi.
La recherche d'emploi directement auprès de l'employeur varie également considérablement selon la
localité, allant de 14,3% à Kadiolo à 53,3% à Bougouni. Ces différences mettent en évidence des
variations significatives dans l'approche de la recherche d'emploi directe en fonction de la zone
géographique.
Les petites annonces et les médias comme moyen de recherche d'emploi montrent une diversité
similaire. Les pourcentages varient de 28,3% à Koutiala à 60,0% à Bougouni. Ces résultats révèlent
une préférence régionale marquée pour l'utilisation des médias dans la recherche d'emploi.
En ce qui concerne l'utilisation des services de l'ANPE ou APEJ, on observe des différences notables
entre les localités, avec une préférence plus marquée à Yorosso (64,3%) par rapport à d'autres endroits.
Ces variations soulignent l'impact de la localité sur le recours aux services publics d'emploi.
Les autres canaux tels que les bureaux privés de placement, les concours, et d'autres moyens
présentent également des disparités significatives entre les localités, illustrant une diversité d'approches
dans la recherche d'emploi au niveau local. En résumé, ce graphique offre des indications claires sur la
manière dont la localité influence les choix de canaux de recherche d'emploi des jeunes au chômage.
Graphique 31 : Proportion des jeunes au chômage selon leur moyen de recherche d’emploi et la localité
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Le Graphique ci-dessous offre un aperçu de la proportion des jeunes en recherche d'emploi selon leur
moyen de recherche d'emploi, en les distinguant par type de formation. Les données révèlent des
tendances intéressantes qui mettent en lumière des variations significatives dans les choix de canaux
de recherche d'emploi en fonction du type de formation.
Globalement, les relations personnelles demeurent le moyen de recherche d'emploi le plus utilisé. En
examinant par type de formation, on constate que cette méthode est largement préférée dans les deux
types de formation, avec 75,8% pour l'apprentissage et 74,4% pour la formation qualifiante. Cela
suggère que, quel que soit le type de formation, les jeunes accordent une importance similaire aux
relations personnelles dans leur recherche d'emploi.
86,7%
72,7% 71,4%
77,4%
68,4%
64,3%
100,0%
74,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Bougouni Kadiolo Kolondièba Koutiala Sikasso Yanfolila Yorosso Hors zone Ensemble
Relations personnelles Directement auprès de l’employeur Petites annonces, médias
ANPE ou APEJ Bureau Privé de Placement Concours
Autre moyen
 |
114 114 |
▲back to top |
113
La recherche d'emploi directement auprès de l'employeur représente 32,0% du total. Les différences
entre les deux types de formation sont relativement modestes, avec une préférence légèrement plus
marquée dans la formation par apprentissage (33,3%) par rapport à la formation qualifiante (31,6%).
En ce qui concerne les petites annonces et les médias, une disparité plus prononcée est observée.
Cette méthode est plus couramment utilisée dans la formation qualifiante, avec 35,0%, par rapport à
l'apprentissage, où elle atteint 24,2%. Ces résultats suggèrent une préférence accrue pour les annonces
et les médias parmi les jeunes de la formation qualifiante.
L'utilisation des services de l'ANPE ou APEJ montre également des variations entre les deux types de
formation, avec une préférence plus marquée dans la formation par apprentissage (39,4%) par rapport
à la formation qualifiante (34,2%).
Les bureaux privés de placement sont peu sollicités, mais la formation qualifiante montre une utilisation
légèrement supérieure (4,3%) par rapport à l'apprentissage (0,0%). En ce qui concerne les concours,
ils sont davantage privilégiés dans la formation qualifiante (19,7%) par rapport à l'apprentissage (6,1%).
Graphique 32 : Proportion des jeunes en recherche d’emploi par moyen de recherche d’emploi et type de formation
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Il s’agit d’analyser la répartition des jeunes au chômage en fonction de leur moyen de recherche
d'emploi et de la filière de formation. Ces données offrent des variations significatives sur les
préférences des jeunes chômeurs en termes de canaux de recherche d'emploi, tout en tenant compte
de leur filière de formation.
Dans l'ensemble, les relations personnelles restent un moyen de recherche d'emploi privilégié.
Cependant, il est intéressant de noter des différences subtiles entre les filières, avec une préférence
légèrement plus élevée pour les relations personnelles dans la filière du lait local (77,2%) par rapport à
la filière de la pomme de terre (73,1%).
La recherche d'emploi directement auprès de l'employeur est également un canal important, avec une
proportion de 32,0% dans l'ensemble. Les jeunes issus de la filière de la pomme de terre montrent une
préférence légèrement supérieure (33,3%) par rapport à ceux de la filière du lait local (29,8%).
Les petites annonces et les médias présentent une disparité significative, avec une utilisation plus
fréquente dans la filière du lait local (42,1%) par rapport à la filière de la pomme de terre (26,9%). Ces
résultats indiquent une tendance marquée des jeunes de la filière du lait local à recourir aux médias
dans leur recherche d'emploi.
L'utilisation des services de l'ANPE ou APEJ montre également des variations, avec une préférence
plus élevée dans la filière de la pomme de terre (38,7%) par rapport à la filière du lait local (29,8%).
75,8% 74,4% 74,7%
33,3% 31,6% 32,0%
24,2%
35,0% 32,7%
39,4%
34,2% 35,3%
0,0%
4,3% 3,3%
6,1%
19,7%
16,7%
9,1% 4,3% 5,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Apprentissage Qualifiante Ensemble
Relations personnelles Directement auprès de l’employeur
Petites annonces, médias ANPE ou APEJ
Bureau Privé de Placement Concours
Autre moyen
 |
115 115 |
▲back to top |
114
Les bureaux privés de placement sont peu sollicités, mais la filière du lait local montre une utilisation
légèrement supérieure (5,3%) par rapport à la filière de la pomme de terre (2,2%).
En ce qui concerne les concours, une proportion plus élevée de jeunes de la filière du lait local (19,3%)
les utilise par rapport à la filière de la pomme de terre (15,1%).
L’analyse met en évidence des nuances dans les choix de canaux de recherche d'emploi entre les
filières de formation, soulignant l'importance de prendre en compte la nature spécifique de la formation
dans l'élaboration de stratégies d'emploi ciblées pour les jeunes chômeurs.
Graphique 33 : Proportion des jeunes en recherche d’emploi par moyen de recherche d’emploi et filière de formation
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Dans l'ensemble, les relations personnelles sont le moyen de recherche d'emploi prédominant.
Cependant, en analysant par tranche d'âge, on observe une nette préférence chez les jeunes de 15 à
24 ans, avec une proportion élevée de 82,4%. À mesure que l'âge augmente, la dépendance aux
relations personnelles diminue, atteignant 69,2% chez les 25-35 ans et chutant à 50,0% pour ceux de
plus de 35 ans. Cette évolution suggère que les jeunes plus âgés ont tendance à explorer d'autres
avenues en plus des relations personnelles dans leur recherche d'emploi.
Les jeunes de 15 à 24 ans sont plus enclins à adopter la recherche d'emploi directement auprès de
l'employeur approche (29,4%), tandis que les personnes de plus de 35 ans privilégient massivement
cette méthode (100,0%). Cette disparité peut refléter une plus grande confiance ou expérience chez les
chercheurs d'emploi plus âgés dans leur capacité à solliciter directement les employeurs.
Les petites annonces et les médias montrent une utilisation relativement uniforme entre les différentes
tranches d'âge, avec une proportion de 32,7% dans l'ensemble. Cependant, il est intéressant de noter
que la recherche d'emploi via ce canal est plus fréquente chez les jeunes de 15 à 24 ans (33,8%).
L'utilisation des services de l'ANPE ou APEJ est assez stable entre les tranches d'âge, bien que
légèrement plus élevée chez les 15-24 ans (33,8%) et les plus de 35 ans (75,0%). Cela suggère que
les jeunes de 15 à 24 ans et les personnes plus âgées ont davantage recours à ces services publics
dans leur recherche d'emploi.
Les concours sont plus populaires parmi les jeunes de 15 à 24 ans (23,5%) par rapport aux autres
groupes d'âge. Cette préférence peut être attribuée à une volonté accrue de décrocher un premier.
73,1%
77,2% 74,7%
33,3%
29,8%
32,0%
26,9%
42,1%
32,7%
38,7%
29,8%
35,3%
2,2%
5,3% 3,3%
15,1%
19,3%
16,7%
5,4% 5,3% 5,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Pomme de terre Lait local Ensemble
Relations personnelles Directement auprès de l’employeur Petites annonces, médias
ANPE ou APEJ Bureau Privé de Placement Concours
Autre moyen
 |
116 116 |
▲back to top |
115
Graphique 34 : Proportion des jeunes en recherche d’emploi par moyen de recherche d’emploi et tranche d’âge
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
2.3.2.3. Promesse d’emploi
Dans l'ensemble, 14,9% des jeunes sans emploi ont une promesse d'embauche, avec une répartition
de 15,9% pour les femmes et 13,9% pour les hommes. L'analyse de cette promesse d'embauche en
fonction des localités révèle que Bougouni affiche la proportion la plus élevée de jeunes sans emploi
bénéficiant d'une promesse d'embauche, soit 18,8%. Cependant, il est notable qu'aucune femme dans
cette localité n'a une promesse d'embauche, tandis que 30,0% des jeunes hommes sans emploi
bénéficient de cette opportunité, constituant le pourcentage le plus élevé, indépendamment du sexe.
Sikasso se positionne en deuxième place avec 18,2% des jeunes sans emploi ayant une promesse
d'embauche, dont 23,1% sont des hommes. En revanche, Kadiolo se démarque par l'absence de
promesses d'embauche pour les hommes sans emploi, tandis que 21,7% des femmes de cette localité
en bénéficient. Kolondièba affiche la deuxième proportion la plus élevée pour les femmes sans emploi
avec une promesse d'embauche, soit 22,2%.
À l'inverse, aucune femme sans emploi à Yorosso n'a une promesse d'embauche, tandis que 14,3%
des hommes dans cette localité en bénéficient. Yanfolila et la zone hors zone ne présentent aucune
promesse d'embauche pour les jeunes sans emploi.
Graphique 35 : Proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d’embauche selon le sexe et la localité
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
82,4%
29,4%
33,8%
33,8%
5,9%
23,5%
5,9%
69,2%
30,8%
34,6%
11,5%
5,1%
50,0%
100,0%
75,0%
74,7%
32,0%
32,7%
35,3%
3,3%
16,7%
5,3%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Relations personnelles
Directement auprès de l’employeur
Petites annonces, médias
ANPE ou APEJ
Bureau Privé de Placement
Concours
Autre moyen
Ensemble Plus de 35 ans 25 - 35 ans 15 - 24 ans
30,0%
12,5%
10,7%
23,1%
14,3%
13,9%
21,7%
22,2%
17,9%
11,1%
15,9%
18,8%
14,7%
17,6%
14,3%
18,2%
7,1%
14,9%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Bougouni
Kadiolo
Kolondièba
Koutiala
Sikasso
Yanfolila
Yorosso
Hors zone
Ensemble
Ensemble Femme Homme
 |
117 117 |
▲back to top |
116
L’analyse de la proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d'embauche en fonction du
sexe, du type de formation et de la filière de formation, offre un aperçu des disparités dans l'obtention
de promesses d'embauche parmi les jeunes sans emploi.
En analysant par type de formation, les résultats indiquent que les jeunes issus de la formation
qualifiante présentent une proportion plus élevée de promesses d'embauche (15,4%) par rapport à ceux
de l’apprentissage (13,2%). Cette différence peut refléter une demande accrue sur le marché du travail
pour les compétences spécifiques acquises par le biais d'une formation qualifiante.
En se focalisant sur la filière de formation, on observe des variations marquées. Les jeunes de la filière
du lait local affichent la plus haute proportion de promesses d'embauche (21,3%), dépassant
significativement ceux de la filière de la pomme de terre (11,0%). Ces résultats mettent en évidence
l'impact significatif de la filière de formation sur les opportunités d'emploi.
Graphique 36 : Proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d’embauche selon le sexe, la filière et le
type de formation
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En examinant la proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d'embauche en fonction du
sexe et de la tranche, des tendances intéressantes émergent. Les jeunes de 15 à 24 ans affichent une
proportion relativement plus basse de promesses d'embauche, avec 14,3% dans l'ensemble.
Cependant, cette tendance diffère considérablement entre les sexes, avec seulement 8,6% d'hommes
dans cette tranche d'âge ayant une promesse d'embauche, tandis que 19,0% des femmes bénéficient
de cette opportunité. Cette disparité souligne un écart significatif dans l'accès aux promesses
d'embauche entre les jeunes hommes et femmes de cette tranche d'âge.
Pour les individus de 25 à 35 ans, la proportion globale de promesses d'embauche est plus élevée,
atteignant 16,3%. Cependant, cette fois-ci, la tendance s'inverse, avec 19,5% des hommes dans cette
tranche d'âge ayant une promesse d'embauche, comparativement à 12,8% des femmes. Il est important
de noter que la tranche d'âge "Plus de 35 ans" affiche des proportions nulles pour les hommes et les
femmes, indiquant l'absence de promesses d'embauche dans cette catégorie.
13,8% 14,0%
10,9%
20,8%
13,9%
11,1%
16,4%
11,1%
21,6%
15,9%
13,2%
15,4%
11,0%
21,3%
14,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Apprentissage Qualifiante Pomme de terre Lait local
Type de formation Filière de formation Ensemble
Homme Femme Ensemble
 |
118 118 |
▲back to top |
117
Graphique 37 : Proportion des jeunes sans emploi ayant une promesse d’embauche selon le sexe et la tranche
d’âge
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
8,6%
19,5%
13,9%
19,0%
12,8%
15,9%
14,3%
16,3%
14,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Ensemble
Homme Femme Ensemble
 |
119 119 |
▲back to top |
118
2.3.2.4. Taux de chômage
Dans l'ensemble, le taux de chômage dans la zone d'application du programme MLI026 s'élève à 46,7%,
avec une forte disparité entre les sexes. Les femmes affichent un taux de chômage notablement plus
élevé, atteignant 67,2%, tandis que celui des hommes est de 34,7%. Ces chiffres mettent en lumière
des variations significatives dans les taux de chômage selon les différentes localités.
Il est important de noter que, en moyenne, les jeunes ont passé cinq mois sur le marché du travail avant
le début de la collecte des données. 4À Bougouni et Kadiolo, les jeunes ont passé en moyenne quatre
mois sur le marché du travail. Cependant, cette durée relativement courte, ces localités présentent des
taux de chômage élevés, avec 58,9% à Kadiolo et 51,7% à Bougouni. À Kadiolo, les femmes sont
particulièrement touchées, affichant un taux de chômage de 74,2%.
Kolondièba se distingue par le fait que les jeunes y ont passé en moyenne six mois sur le marché du
travail avant la collecte des données, et le taux de chômage atteint 60,9%, dont 72,7% pour les femmes.
Les jeunes de Yorosso sont les plus durement touchés par le chômage, malgré une durée moyenne de
six mois sur le marché du travail. Le taux de chômage global est de 73,7%, avec 77,8% pour les femmes
et 70,0% pour les hommes.
En revanche, Sikasso se distingue par le plus faible taux de chômage, soit 20,2%, même si les jeunes
ont passé en moyenne six mois sur le marché du travail. Peu importe le sexe, les jeunes hommes de
Sikasso présentent le taux de chômage le plus bas parmi toutes les localités étudiées.
Graphique 38 : Taux de de chômage des jeunes par localité et sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En observant les différentes tranches d'âge, on constate que les jeunes de 15 à 24 ans affichent un
taux de chômage global de 50,4%, avec des taux élevés pour les femmes (67,8%) que pour les hommes
(36,5%). Cette tranche d'âge semble être particulièrement touchée par le chômage, avec une disparité
significative entre les genres.
La tranche d'âge de 25 à 35 ans présente également des taux de chômage élevés, avec un taux global
de 43,9%. Les femmes de cette tranche d'âge affichent un taux de chômage plus élevé (66,1%) que les
hommes (33,3%). Cette observation suggère que, même au-delà de la jeunesse, les femmes continuent
de faire face à des défis importants sur le marché du travail.
La catégorie des plus de 35 ans montre des taux de chômage élevés, avec un taux global de 44,4%.
Notamment, le taux de chômage des femmes dans cette catégorie est de 100%, ce qui indique une
situation particulièrement préoccupante.
4 Annexe 2 : Durée moyenne passée sur le marché de travail
52,9% 40,0%
50,0%
42,6%
16,0%
70,0%
50,0%
34,7%
50,0%
74,2% 72,7%
79,4%
36,8%
77,8%
67,2%
51,7%
58,9%
60,9%
56,8%
20,2%
73,7%
50,0%
46,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Bougouni Kadiolo Kolondièba Koutiala Sikasso Yanfolila Yorosso Hors zone Ensemble
Homme Femme Ensemble
 |
120 120 |
▲back to top |
119
Les données révèlent que le chômage des jeunes est plus prononcé parmi les femmes, en particulier
dans les tranches d'âge plus élevées. Ces résultats soulignent la nécessité de mettre en place des
programmes spécifiques pour favoriser l'emploi des jeunes, en particulier des femmes, à toutes les
étapes de leur vie active.
Graphique 39 : Taux de chômage des jeunes par sexe et tranche d’âge
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En analysant les types de formation, des disparités significatives dans les taux de chômage des jeunes
se dégagent. Pour ceux ayant suivi une formation par apprentissage, le taux de chômage se situe à
23,1%, avec des variations notables entre les hommes (21,6%) et les femmes (31,6%). Ces données
suggèrent que l'apprentissage peut jouer un rôle positif dans la réduction du chômage des jeunes,
même si des écarts subsistent entre les genres. Il est essentiel de noter que ces jeunes formés par
apprentissage ont en moyenne passé sept mois sur le marché du travail avant la collecte de ces
informations5.
En revanche, les jeunes formés de manière qualifiante présentent un taux de chômage plus élevé,
atteignant 63,2%. La disparité entre les sexes est également marquée, avec un taux de chômage de
74,2% pour les femmes et de 51,1% pour les hommes. Ces résultats soulèvent des interrogations quant
à l'efficacité des formations qualifiantes actuelles en termes d'employabilité des jeunes, surtout pour les
femmes. Il est important de noter que ces jeunes issus de formations qualifiantes sont récemment
arrivés sur le marché du travail, en moyenne seulement quatre mois avant la collecte de ces
informations.
Dans l'ensemble, ces données mettent en évidence l'influence significative du type de formation sur le
taux de chômage des jeunes. Elles soulignent également la nécessité d'ajuster les programmes de
formation afin de mieux répondre aux exigences du marché du travail et de réduire les disparités entre
les sexes dans l'accès à l'emploi.
5 Annexe 2 : Durée moyenne passée sur le marché de travail
36,5%
33,3%
37,5% 34,7%
67,8% 66,1%
100,0%
67,2%
50,4%
43,9% 44,4% 46,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
15 - 24 ans 25 - 35 ans Plus de 35 ans Ensemble
Homme Femme Enemble
 |
121 121 |
▲back to top |
120
Graphique 40 : Taux de chômage des jeunes par type de formation et sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
En analysant les différentes filières de formation, des disparités significatives dans les taux de chômage
se révèlent. Pour les jeunes ayant suivi la formation dans la filière de la pomme de terre, le taux de
chômage s'établit à 44,0%, montrant des écarts marqués entre les hommes (34,5%) et les femmes
(64,6%). Ces chiffres laissent entrevoir des opportunités d'emploi dans la filière de la pomme de terre,
bien que les femmes soient confrontées à un taux de chômage plus élevé.
En revanche, dans la filière du lait local, le taux de chômage des jeunes atteint 51,9%. Les femmes de
cette filière présentent un taux de chômage particulièrement élevé de 70,6%, comparativement à celui
des hommes, qui est de 35,1%. Ces résultats suscitent des interrogations sur les facteurs contribuant
à la disparité de chômage entre les sexes dans cette filière spécifique.
Les données soulignent l'impact significatif de la filière de formation sur le taux de chômage des jeunes,
avec des implications spécifiques en termes de disparités entre les hommes et les femmes. Il semble
que le temps passé sur le marché du travail soit un facteur crucial dans ces taux élevés de chômage,
notamment dans les filières agropastorales. Les jeunes formés dans ces deux filières ont passé
relativement peu de temps sur le marché du travail, avec une moyenne de quatre mois pour la filière
lait local et six mois pour la filière pomme de terre. Cette temporalité pourrait jouer un rôle dans la
compréhension des défis d'emploi spécifiques rencontrés par les jeunes dans ces domaines de
formation.
Graphique 41 : Taux de chômage des jeunes par filière de formation et sexe
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
21,6%
31,6%
23,1%
51,1%
74,2%
63,2%
34,7%
67,2%
46,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Homme Femme Total
Apprentissage Qualifiante Total
34,5%
64,6%
44,0%
35,1%
70,6%
51,9%
34,7%
67,2%
46,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Homme Femme Total
Pomme de terre Lait local Total
 |
122 122 |
▲back to top |
121
CONCLUSION
L'objectif de l'enquête est d'évaluer l'efficacité du dispositif de formation-insertion du PAFA II au Mali.
Elle se concentre sur la mesure du taux d'insertion professionnelle des jeunes formés, l'évaluation de
leurs revenus dans les filières lait et pomme de terre, l'examen de leur situation post-formation, et
l'analyse globale de l'efficacité du dispositif. Les résultats de cette évaluation visent à formuler des
recommandations en vue d'éventuelles améliorations du programme.
Le Programme d'appui aux filières agropastorales dans la région de Sikasso (PAFA II) au Mali montre
des efforts significatifs pour améliorer les revenus des exploitations familiales et favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes dans les filières lait et pomme de terre. Cependant, des disparités
importantes persistent, notamment entre les sexes, les localités, les types de formation et les filières.
Les résultats de l'enquête révèlent une diversité sociodémographique parmi les jeunes formés en 2022,
soulignant l'importance de personnaliser les programmes de formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque localité. La satisfaction élevée des jeunes par rapport à la formation témoigne
de l'efficacité du programme, mais des ajustements spécifiques pourraient encore être envisagés pour
optimiser l'expérience de formation, en particulier dans certains métiers.
En sus des défis liés au faible taux d’insertion professionnelle et aux revenus modestes des jeunes, des
disparités entre les genres persistent. Les écarts salariaux importants soulignent la nécessité de mettre
en place des mesures visant à favoriser l'égalité des opportunités sur le marché du travail. La diversité
des secteurs d'activité, des statuts professionnels et des modes d'intégration souligne également
l'importance de politiques plus individualisées afin de répondre aux besoins variés des jeunes.
La corrélation entre la recherche d'emploi, les promesses d'embauche et le taux de chômage met en
évidence la complexité du marché du travail pour les jeunes de la cohorte 2022. Les résultats suggèrent
également la nécessité de stratégies d'emploi différenciées en fonction des localités, de l'âge, du type
de formation et de la filière.
En fin, bien que le PAFA II ait réussi à atteindre certains de ses objectifs, des ajustements spécifiques
sont nécessaires pour promouvoir une inclusion plus équitable et efficace des jeunes dans les filières
lait local et pomme de terre. Les recommandations pourraient inclure des mesures ciblées pour réduire
les écarts de revenus entre les sexes, des programmes de formation adaptés à la diversité des cohortes,
et des stratégies d'emploi différenciées en fonction des caractéristiques locales et individuelles.
 |
123 123 |
▲back to top |
122
RECOMMANDATIONS
En tenant compte des conclusions tirées du rapport sur l’insertion professionnelle des jeunes formés :
Formation initiale qualifiante (FIQ) et Formation par apprentissage (cohorte 2022), voici des
recommandations spécifiques pour certains acteurs impliqués :
Conseil regional de Sikasso
• Promotion de la diversité des métiers agricoles : sensibiliser davantage les jeunes à la
diversité des métiers au sein de la filière agropastorale, mettant en valeur chaque métier et
soulignant l'importance de chacun dans le secteur.
• Partenariats avec les industries (public-privé) : établir des partenariats avec des entreprises
et des experts de l'industrie pour garantir que les modules de formation restent alignés sur les
évolutions du secteur et répondent aux exigences du marché du travail.
• Optimisation de la durée de la formation : réévaluer la durée de la formation pour chaque
filière afin de mieux répondre aux attentes des jeunes. Adapter la durée pour maximiser
l'efficacité de l'apprentissage tout en évitant la surcharge d'informations.
• Renforcement des équipements utilisés lors de la formation : investir dans l'amélioration
des équipements utilisés lors de la formation, en particulier dans la filière lait local, afin de
garantir une expérience pratique optimale pour les jeunes participants.
Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes (APEJ)
• Adaptation des programmes de formation en entreprenariat : adapter les programmes de
formation en entrepreneuriat pour tenir compte des différents niveaux d'éducation des
participants, en veillant à ce que des programmes adaptés soient disponibles pour ceux qui
n'ont pas suivi d'éducation formelle.
• Suivi et mise à jour de la base : initier des séances périodiques de travail avec la Chambre
régional d’agriculture (CRA).
Institut national d’ingénierie de formation professionnelle (INIFORP)
• Renforcement des compétences pratiques des formateurs et maîtres d’apprentissages :
Organiser des formations sur les besoins spécifiques des formateurs des structures de
formation et des maitres d’apprentissage.
• Contrôle pédagogique des formateurs et maîtres d’apprentissages : Initier des missions
de contrôle et de suivi pédagogique des formateurs et maîtres d’apprentissage.
Ces recommandations visent à créer une synergie entre les différents acteurs impliqués dans le
processus d'insertion professionnelle des jeunes formés : Formation initiale qualifiante (FIQ) et
Formation par apprentissage (cohorte 2022), contribuant ainsi à une meilleure adaptation des
programmes de formation aux réalités du marché du travail.
 |
124 124 |
▲back to top |
123
ANNEXES
Annexe 1 : Motifs de travailler plus de 48 heures ou moins de 35 heures
Motif de travailler
Homme Femme
Effectif % Effectif %
Plus de
48
heures
Horaire normal 28 43,8 7 77,8
Excès de travail dû à la bonne conjoncture 10 15,6 1 11,1
Excès de travail pour pourvoir suivre 26 40,6 1 11,1
Autre 0 0,0 0 0,0
Total 64 100,0 9 100,0
Moins de
35
heures
Ne veut pas travailler plus 3 16,7 3 27,3
Horaire fixé par la loi ou l'employeur 10 55,6 5 45,5
Moins de travail dû à la mauvaise conjoncture 4 22,2 3 27,3
Problème personnel (santé, etc.) 1 5,6 0 0,0
Autre 0 0,0 0 0,0
Total 18 100,0 11 100,0
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
Annexe 2 : Durée moyenne passée sur le marché du travail
Variables
Nombre de mois sur le
marché de travail après la
formation
Bougouni 4
Kadiolo 4
Kolondièba 6
Koutiala 5
Sikasso 6
Yanfolila 7
Yorosso 6
Hors zone 5
Apprentissage 7
Qualifiante 4
Pomme de terre 6
Lait local 4
Total 5
Source : Enquête insertion professionnelle des jeunes formés de la cohorte 2022, ONEF 2023
 |
125 125 |
▲back to top |
124
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Insertion des diplômés de l’enseignement technique et professionnel au Mali-promotion 2013.
• Etude élargie sur l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés des institutions
publiques d’enseignement supérieur du Mali (Cohorte 2015-2018).
• Enquête annuelle de suivi de l’insertion professionnelle des apprenants sortis des centres de
formation professionnelle appuyés par le programme MLI/022, 2020.
Copyright @ 2024 | ONEF .