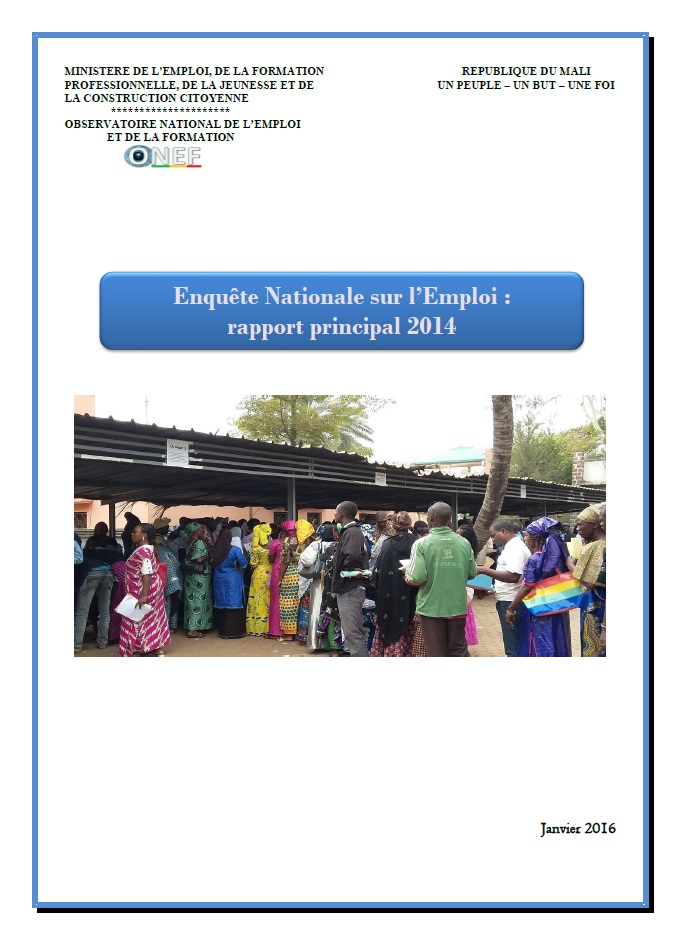MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN...
 |
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI
PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
LA CONSTRUCTION CITOYENNE
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Janvier 2016
Enquête Nationale sur l’Emploi :
rapport principal 2014
 |
2 2 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
i
Enquête Nationale sur l’Emploi :
rapport principal 2014
 |
3 3 |
▲back to top |
ii
Table des matières
Liste des tableaux ................................................................................................................................ iv
Liste des graphiques ............................................................................................................................. v
Équipe d’élaboration du rapport ......................................................................................................... vi
Préface ................................................................................................................................................ vii
Sigles et abréviations ........................................................................................................................ viii
Résumé ................................................................................................................................................ ix
Introduction ........................................................................................................................................ 1
1. De l'enquête de terrain ............................................................................................................. 2
1.1. Méthodologie d'enquête ................................................................................................. 2
1.2. Organisation de l'enquête ............................................................................................... 2
1.3. Communication .............................................................................................................. 3
1.4. Structure du questionnaire d'enquête ............................................................................. 3
1.5. Traitement des données et analyse ................................................................................. 3
2. Caractéristiques sociodémographiques .................................................................................. 4
2.1. Caractéristiques des ménages ................................................................................................ 4
2.1.1. Taille du ménage ........................................................................................................ 4
2.1.2. Caractéristiques du chef de ménage ........................................................................... 5
2.2. Caractéristiques de la population .......................................................................................... 6
2.2.1 Structure par sexe et par âge .......................................................................................... 6
2.2.2 Statut migratoire de la population .................................................................................. 8
2.3. Niveau d’instruction et formation continue ........................................................................... 9
2.3.1. Niveau d’éducation..................................................................................................... 9
2.3.2. Formation continue des actifs occupés ..................................................................... 10
2.3.2. Durée de la formation continue ................................................................................ 11
3. Population active potentielle ou en âge de travailler ........................................................... 13
3.1. Poids de la population active potentielle dans la population totale ..................................... 14
3.2. Population active ................................................................................................................. 15
3.2.1. Composition de la population active ........................................................................ 16
3.2.2. Taux d'activité .......................................................................................................... 16
3.3. Population inactive .............................................................................................................. 18
3.3.1. Composition de la population inactive ..................................................................... 18
3.3.2. Taux d'inactivité ....................................................................................................... 19
4. Profil et structure de l'emploi ................................................................................................ 21
4.1. Profil du taux d’emploi........................................................................................................... 21
4.2. Structure de l'emploi ............................................................................................................... 22
4.3. Taux de salarisation selon les caractéristiques sociodémographiques. .................................. 23
4.4. Nature de l'emploi .................................................................................................................. 25
5. La pluriactivité ........................................................................................................................ 26
5.1. Principaux déterminants de la pluriactivité ......................................................................... 26
5.2. Durée hebdomadaire comparée des activités principale et secondaire ............................... 31
5.3. Activité principale et pluriactivité ....................................................................................... 33
5.4. Caractéristiques de l'activité secondaire .............................................................................. 35
6. La mobilité sociale .................................................................................................................. 42
6.1. Importance et mesure .......................................................................................................... 42
6.2. Mobilité générationnelle...................................................................................................... 43
6.3. Mobilité professionnelle ...................................................................................................... 47
6.4. Mobilité spatiale ................................................................................................................ 49
6.4.1. Taux de mobilité spatiale ......................................................................................... 49
 |
4 4 |
▲back to top |
iii
6.4.2. Origines de la mobilité spatiale ................................................................................ 50
6.4.3. Raisons de mobilité spatiale ..................................................................................... 51
6.5. Mobilité sociale et genre .................................................................................................... 52
6.5.1. Mobilité générationnelle et genre ............................................................................. 52
6.5.2. Mobilité professionnelle et genre ............................................................................. 54
7. Le revenu d'emploi ................................................................................................................. 56
7.1. Revenu moyen d'emploi ...................................................................................................... 56
7.2. Revenu moyen d'activité ..................................................................................................... 60
7.3. Revenu moyen d'activité principale .................................................................................... 62
7.4. Revenu moyen d'activité secondaire ................................................................................... 65
8. Le sous-emploi ......................................................................................................................... 68
8.1. Structure de la durée hebdomadaire de travail .................................................................... 68
8.2. Profil du taux de sous-emploi .............................................................................................. 69
9. Le chômage .............................................................................................................................. 72
9.1. Profil du taux de chômage ...................................................................................................... 72
9.2. Caractéristiques des chômeurs ............................................................................................... 75
9.3. Stratégie de recherche d'emploi et prétentions salariales des chômeurs.. .............................. 77
Conclusion et recommandations ..................................................................................................... 80
Références bibliographiques ........................................................................................................... 82
Annexe : Quelques indicateurs du marché du travail ................................................................. 83
 |
5 5 |
▲back to top |
iv
Liste des tableaux
Tableau 1 : Répartition des ménages selon la taille du ménage et la zone de résidence..........................................…... 4
Tableau 2 : Caractéristiques du chef de ménage selon le sexe, la zone de résidence, le statut matrimonial, la région… 5
Tableau 3 : Caractéristiques du chef de ménage selon la zone de résidence, le statut matrimonial, la région et le sexe.. 6
Tableau 4 : Répartition (en %) de la population selon le groupe d’âge, la zone de résidence, le sexe et la région…….. 7
Tableau 5 : Principaux pays de migration pour les migrants de retour…………………………………………………. 8
Tableau 6 : Répartition (en %) des migrants de retour selon les principales causes de retour………………………...... 8
Tableau 7 : Catégorie socioprofessionnelle dans l'activité exercée dans le pays d'immigration (en %)......……………. 9
Tableau 8 : Situation financière dans le pays d'immigration selon la zone de résidence et le sexe (en %)......………… 9
Tableau 9 : Répartition (en %) de la population de 6 ans et plus selon le niveau d’instruction et le diplôme…………. 10
Tableau 10 : Répartition (en %) des agents formés selon les caractéristiques sociodémographiques…………………… 11
Tableau 11 : Durée moyenne (en jour) de la formation des actifs occupés………………………………………………. 12
Tableau 12 : Population en âge de travailler selon la zone de résidence et le sexe………………………………………. 14
Tableau 13 : Poids de la population en âge de travailler par rapport à la Population totale…………………………….. 14
Tableau 14 : Population active de 15 – 64 ans selon la zone de résidence et le sexe……………………………………. 16
Tableau 15 : Taux brut et taux net d’activité selon la zone de résidence et le sexe (en %) ……………………………… 16
Tableau 16 : Taux d’activité selon les caractéristiques sociodémographiques (en %) …………………………………... 17
Tableau 17 : Répartition de la population inactive selon les raisons d’inactivité et le sexe……………………………… 18
Tableau 18 : Population inactive selon le sexe, le milieu de résidence et les raisons d'inactivités (en %) ………………. 19
Tableau 19 : Taux d’inactivité selon les caractéristiques sociodémographiques (en %) ………………………………… 20
Tableau 20 :
Répartition (en %) du taux d'emploi par zone de résidence, région, groupe d'âge, niveau d'éducation et
sexe.................................................................................................................................................................
21
Tableau 21 : Répartition des emplois suivant le sexe de l'occupant et la zone de résidence……………………………... 23
Tableau 22 : Taux de salarisation selon les caractéristiques sociodémographiques……………………………………… 24
Tableau 23 :
Répartition du taux d’emploi suivant la nature du travail d'activité principale, le sexe, la zone de
résidence, la région, la classe d’âge et le niveau d’éducation……………………………………………….
25
Tableau 24 : Taux d'activité secondaire (en %)…………………………………………………………………………... 27
Tableau 25 : Répartition activités secondaires versus répartition de la population (en %)………………………………. 28
Tableau 26 : Nombre d'activités secondaires (en %)…………………………………………………………………….. 30
Tableau 27 : Durée hebdomadaire moyenne avec ou sans activité secondaire (heures/semaine)………………………... 32
Tableau 28 : Taux d'activité secondaire selon les caractéristiques de l'activité principale (en %)……………………….. 34
Tableau 29 : Répartition activités secondaires versus répartition de la population selon l'activité principale (en %)…… 35
Tableau 30 : Taux des catégories d'activité secondaire selon l'âge (en % et effectif)....................................................…. 36
Tableau 31 : Taux des catégories d'activité secondaire selon les catégories (en % et effectif)…………………………... 37
Tableau 32 : Origine de l'activité secondaire ou destinée de l'activité principale (en %)………………………………… 38
Tableau 33 : Destination de l'activité principale ou recrutement de l'activité secondaire (en %)………………………. 40
Tableau 34 : Taux de transition entre activités principale et secondaire (en %) ……………………………………… 41
Tableau 35 : Répartition des actifs occupés selon leurs CSP et celles de leurs pères…………………………………… 42
Tableau 36 : Destinée de la CSP du père – que deviennent les enfants de … (en %)…………………………………… 43
Tableau 37 : Recrutement de la CSP de l'enfant – d'où proviennent les enfants de … (en %)…………………………. 44
Tableau 38 : Calcul de la mobilité sociale des 15 ans et plus (en %)……………………………………………………. 45
Tableau 39 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon la CSP (en %)…………………………………. 45
Tableau 40 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le statut salarial (en %)…………………………. 45
Tableau 41 : Taux de mobilité ascendante versus descendante selon le statut salarial (en %)…………………………… 46
Tableau 42 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le type d'entreprise (en %)……………………… 46
Tableau 43 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le secteur d'activité (en %)……………………... 46
Tableau 44 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le niveau d'éducation (en %)…………………… 47
Tableau 45 : Taux de mobilité ascendante versus descendante selon le niveau d'éducation (en %)…………………….. 47
Tableau 46 : Destinée de la CSP antérieure – que devient la CSP antérieure (en %)……………………………………. 48
Tableau 47 : Recrutement de la CSP actuelle – de quelle CSP provient la CSP actuelle (en %)………………………… 48
Tableau 48 : Taux de mobilité professionnelle par groupe d'âge selon la CSP (en %)…………………………………... 48
Tableau 49 : Taux de mobilité professionnelle par groupe d'âge selon le statut salarial (en %)…………………………. 48
Tableau 50 : Taux de mobilité professionnelle par groupe d'âge selon le type d'entreprise (en %)……………………… 49
Tableau 51 : Taux de mobilité professionnelle ascendante/descendante par statut salarial (en %)………………………. 49
Tableau 52 : Taux de mobilité spatiale par groupe d'âge (en %)…………………………………………………………. 50
Tableau 53 : Origines de la mobilité spatiale (en %)…………………………………………………………………….. 51
Tableau 54 : Raisons de la mobilité spatiale (en %)……………………………………………………………………… 52
Tableau 55 : Taux de mobilité générationnelle par sexe et âge selon le statut salarial (en %)…………………………… 53
Tableau 56 : Taux de mobilité ascendante/descendante par sexe et âge selon le statut salarial (en %)………………….. 53
Tableau 57 : Taux de mobilité générationnelle par sexe et âge selon le secteur d'activité (en %)……………………….. 53
Tableau 58 : Taux de mobilité générationnelle par sexe et âge selon le niveau d'éducation (en %)……………………... 54
Tableau 59 : Taux de mobilité ascendante/descendante par sexe et âge selon le niveau d'éducation (en %)……………. 54
Tableau 60 : Taux de mobilité professionnelle par sexe et âge selon la CSP (en %)……………………………………. 54
Tableau 61 : Taux de mobilité professionnelle par sexe et âge selon le type d'entreprise (en %)……………………….. 55
Tableau 62 : Taux de mobilité professionnelle par sexe et âge selon le statut salarial (en %)…………………………… 55
Tableau 63 : Taux de mobilité professionnelle ascendante/descendante par sexe et âge selon le statut salarial (en %)…. 55
 |
6 6 |
▲back to top |
v
Tableau 64 : Revenu mensuel total (en millions FCFA et %)……………………………………………………………. 57
Tableau 65 : Revenu mensuel moyen par tranche d'âge (en FCFA)……………………………………………………… 58
Tableau 66 : Revenu mensuel moyen (en FCFA)………………………………………………………………………… 59
Tableau 67 : Revenu mensuel moyen d'activité ………………………………………………………………………….. 61
Tableau 68 : Revenu mensuel moyen de l'activité principale (en FCFA)………………………………………………... 63
Tableau 69 : Revenu mensuel moyen de l'activité secondaire (en FCFA)……………………………………………….. 66
Tableau 70 : Répartition des heures de travail selon les caractéristiques sociodémographiques………………………… 69
Tableau 71 : Taux de sous-emploi selon le groupe d’âge par zone de résidence et par sexe…………………………….. 69
Tableau 72 : Taux de sous-emploi selon la CSP, la zone de résidence et le sexe………………………………………... 70
Tableau 73 :
Taux de sous-emploi selon la situation dans la profession, le secteur d'activité et le secteur institutionnel
par zone de résidence………………………………………………………………………………………..
71
Tableau 74 : Taux de chômage selon le niveau d'éducation, la zone de résidence et par sexe…………………………... 74
Tableau 75 : Taux de chômage selon la région et le sexe………………………………………………………………… 74
Tableau 76 : Proportion de chômeurs selon l’âge, le niveau d’instruction le milieu et le sexe………………………….. 75
Tableau 77 : Type de chômage selon l'âge, le niveau d'éducation, le milieu de résidence et le sexe……………………. 76
Tableau 78 : Stratégie de recherche d'emploi par le chômeur……………………………………………………………. 77
Tableau 79 : Salaire ou revenu minimum moyen accepté le chômeur…………………………………………………… 78
Tableau A1 : Répartition de la population en âge de travailler selon le sexe 83
Tableau A2 : Répartition de la population occupée par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation
selon le sexe…………………………………………………………………………………………………
83
Tableau A3 :
Répartition de la population au chômage par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon
le sexe……………………………………………………………………………………………………….
84
Tableau A4 :
Répartition de la population active par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le
sexe………………………………………………………………………………………………………….
84
Tableau A5 :
Taux d’emploi vulnérable par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation
selon le sexe…………………………………………………………………………………………………
85
Tableau A6 : Taux de pluriactivité par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe…………… 85
Tableau A7 : Ratio Emploi/ Population par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe………. 86
Tableau A8 : Ratio Emploi/ Population par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe………. 86
Tableau A9 : Taux de chômage élargi par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe………... 87
Tableau A10 : Taux de chômage BIT par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe………….. 87
Tableau A11 : Taux de chômage des jeunes 15-24 ans par milieu de résidence, niveau d’éducation selon le sexe……….. 88
Tableau A12 :
Taux de chômage des jeunes 15-35 ans par milieu de résidence, niveau d’éducation selon le sexe
d’âge, niveau d’éducation selon le sexe……………………………………………………………………
88
Tableau A13 : Proportion de chômeurs découragés par milieu de résidence, groupe…………………………………….. 89
Tableau A14 : Proportion des Jeunes de (15-24 ans) « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation» par milieu……. 89
Tableau A15 :
Proportion des Jeunes de (15-35 ans) « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation » par milieu de
résidence, niveau d’éducation selon le sexe…………………………………………………………………
90
Tableau A16 : Taux d’emplois informel par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe………. 90
Tableau A17 : Proportion de l’emploi salarié par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe….. 91
Tableau A18 : Taux de salarisation par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe……………. 91
Tableau A19 : Taux d’activité par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe…………………. 92
Tableau A20 : Taux de sous-emploi par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe…………… 92
Tableau A21 : Taux de syndicalisation par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe………... 93
Tableau A22 : Durée moyenne du chômage par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe…… 93
Liste des graphiques
Graphique 1 : Pyramide des âges de la population...................................................................................................................... 07
Graphique 2 : Taux de chômage élargi par groupe d'âge et par sexe………………………………………………………….. 73
Graphique 3 : Durée moyenne en année du temps de chômage par région et par sexe………………………………………... 76
Graphique 4 : Durée moyenne en année du temps de chômage par niveau d'instruction et par sexe......................................... 77
 |
7 7 |
▲back to top |
vi
Équipe d’élaboration du rapport
Coordination technique
Marie DEMBELE Conseillère technique MEFPJCC
Boubacar DIALLO Directeur Général ONEF
Aoua dite Saran DEMBELE Directrice Générale Adjointe ONEF
Comité de rédaction
Boubacar DIALLO Directeur Général, ONEF
Aoua dite Saran DEMBELE Directrice Générale Adjointe, ONEF
Fatoumata ABDOURHAMANE Directrice Nationale de l’Emploi
Assekou AHMADOU Directeur CPS/SICAEPIP
Massa COULIBALY Université des Sciences Sociales et de Gestion
Sidy Boly Statisticien, Institut National de la Statistique (INSTAT)
Moussa CISSE Direction Nationale de la Formation Professionnelle
Kadia Bagayoko Chargée d’études, ONEF
Adama André TOGO Chargé d’études, ONEF
Lassana DOUMBIA Chargé d’études, ONEF
N’Faly SIAMA Chargé d’études, ONEF
Djimé TRAORE Chargé d’études ONEF
Idrissa Yacouba TOURE Informaticien, ONEF
Administration et Gestion
Ibrahima Yala DIALLO Agent Comptable
Sohayata Attacher MAIGA Chef Département Administration et Gestion des Ressources
Humaines
Bandiougou KEITA Chef Département Communication et Documentation
Siaka KONATE Chef Département Finance Approvisionnement
Oumar OUOLOGUEM Chef Cellule Contrôle et Gestion Interne
Adam DEMBELE Assistante Chef Cellule Contrôle et Gestion Interne
Oumou KEITA Chargée de Comptabilité
Sétou DOUMBIA Secrétaire de Direction
Comité Scientifique
Président
Mahamadou Zibo MAIGA Coordinateur de la Cellule Technique du CSLP
Membres
Moussa KANTE Directeur Général, CNRST
Samba DIALLO Recteur, USSGB
Dénis DOUGNON Directeur Général, ISFRA
Boubacar MAKALOU Directeur Général, CERCAP
Mahamadou Soukalo TRAORE Directeur Général, INRSP
Issa BOUARE Chef de Division INSTAT
Bourama DEMBELE Directeur Général, IER
Sidiki TRAORE Directeur National, DNPD
Comité de lecture
Mme KY Annita PARE CT-MEFPJCC
Bourama Fassery BALLO ODHD
Maïmouna TRAORE CT-CSLP
Mme Dicko Fatoumata ABDOURHAMANE DNE
 |
8 8 |
▲back to top |
vii
Préface
a jeunesse d’une population est facteur d’enrichissement d’un pays. Au Mali, elle représente
environ 38,7% (source : Direction Nationale de la Population, estimation 2014) de la
population avec son corolaire de besoins de formation et d’emploi. C’est pourquoi les
politiques publiques en la matière doivent être analysées sous le prisme de la relation entre croissance
économique et marché du travail en vue de garantir à tous une promotion sociale se fondant sur un
accès à l’emploi.
Les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics pour garantir l’accès à l’emploi et assurer la
promotion sociale se fondent tout d’abord sur une connaissance des différents indicateurs du
chômage, du sous-emploi, du taux d’emploi en vue de bâtir des perspectives pour le futur.
L’approche par les politiques actives de l’emploi conditionne la vision de ce qui est requis pour
rétablir les opportunités économiques et pour assurer le bien-être de la population dans son ensemble.
Ceci implique que les priorités et la planification des interventions doivent prendre en considération
les caractéristiques socio-professionnelles des demandeurs d’emploi et les besoins des entreprises à
court, long et moyen terme.
Pour répondre à ces besoins le Gouvernement a créé en décembre 2013 un organisme personnalisé
dénommé Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF). Dans ses missions et
attributions, l’ONEF doit fournir aux décideurs des outils d’aide à la décision à travers des statistiques
sur le marché de l’emploi. C’est dans ce cadre qu’a été élaboré le présent rapport dénommé « Enquête
Nationale sur l’Emploi 2014 ».
Ce rapport contient un grand nombre d’informations utiles sur les différents indicateurs de l’emploi
et du chômage. La présentation de l’évolution du paysage de l’emploi apporte d’utiles conseils pour
concevoir les meilleures stratégies.
Par la richesse des informations, la variété des thèmes abordés et la qualité des conseils apportés, il
constitue un atout exceptionnel pour accroître les connaissances sur le marché de l’emploi.
Bamako, le ________________
Le Ministre de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle,
de la Jeunesse et de la
Construction Citoyenne
M. Mahamane BABY
L
 |
9 9 |
▲back to top |
viii
Sigles et abréviations
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
BIT Bureau International du Travail
BPP Bureau Privé de Placement
BTS Brevet de Technicien Supérieur
CD-ROM Compact Disc –Read Only Memory
CERCAP Centre d’Etudes et de Renforcement des Capacités d’Analyse et de Plaidoyer
CMDT Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles
CNRST Centre National de Recherche Scientifique et Technologique
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CSP Catégorie Socioprofessionnelle
CT Conseiller (ère) Technique
DEF Diplôme d’Etudes Fondamentales
DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement
DOEF Département Observatoire de l’Emploi et de la Formation
DRPSIAP Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de
l’Aménagement du Territoire et de la Population
EMOP Enquête Modulaire Permanente auprès des ménages
ENE Enquête Nationale Emploi
EPAM Enquête Permanente Auprès des Ménages
FCFA Francs de la Communauté Financière Africaine
IER Institut d’Economie Rurale
INSTAT Institut National de la Statistique
INRSP Institut National de Recherche en Santé Publique
ISFRA Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée
MEFPJCC Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la
Construction Citoyenne
ODHD Observatoire du Développement Humain Durable
OIT Organisation Internationale du Travail
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
ONEQ Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications
ONG Organisation Non Gouvernementale
ORTM Office de Radio Diffusion et Télévision du Mali
RDC République Démocratique de Congo
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SICAEPIP Secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et Promotion de l'Investissement Privé
SPSS Statistical Package for the Social Sciences
USSGB Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
TBA Taux Brut d’Activités
TNA Taux Net d’Activités
 |
10 10 |
▲back to top |
ix
Résumé
La population du Mali est estimée à 17,2 millions d’habitants en 2014 avec 50,4% de femmes. Cette
population est répartie entre 2 163 290 ménages. Elle comprend 75% de ruraux et 25% de populations
urbaines. Parmi cette population, 8 043 098 sont en âge de travailler c’est-à-dire ceux dont l’âge est
compris entre 15 et 64 ans. De plus, la main-d’œuvre (actifs occupés et chômeurs) occupe 74,4% de
cette population (soit 5 986 584 personnes) et 25,6% d’entre elles sont économiquement inactives.
La main-d’œuvre est constituée d’hommes (53,3%) contre 46,7% pour les femmes.
Le taux d’activité défini comme le rapport entre la population active (chômeurs et occupés) et la
population en âge de travailler est estimé à 74,4%. Il est de 85,6% chez les hommes et 64,8% chez
les femmes. Le monde rural a le plus fort taux d’activité (78,8%), suivi de Bamako avec 63,4%. Les
autres zones urbaines arrivent en 3ème position avec 62,6%. En outre, c’est dans la tranche d’âge 36-
40 ans où se trouve le taux le plus élevé (84,4%) contre 61,6% pour les jeunes (15-24 ans).
L’un des aspects les plus frappants que révèle l’étude est le fort taux d’emploi. En effet, parmi la
population en âge de travailler, 68,3% sont employés. Ce taux est de 79,3% chez les hommes et
58,8% chez les femmes. Le milieu rural enregistre le taux le plus élevé (73,2%) contre 56,1% à
Bamako et 55,0% pour les autres zones urbaines.
Le secteur le plus pourvoyeur d’emploi est le primaire qui occupe près de deux actifs sur trois
(66,7%). Les autres se composent de l’industrie, le commerce et les services. Il est à noter que c’est
le milieu rural qui concentre l’essentiel de ces emplois dans le secteur primaire.
Une répartition institutionnelle de l’emploi révèle que plus de la moitié des employés (54,6%) sont
des patrons ou travailleurs indépendants, 36,7% constitués des apprentis ou des aides familiaux et 9%
des employés seulement sont salariés.
Quant au sous-emploi, mesuré à travers la durée de travail hebdomadaire, son taux est estimé à 17,4%
des actifs occupés. Environ une femme sur quatre (29,6%) est sous-employée contre seulement 6,9%
pour les hommes.
Le revenu mensuel moyen d’activité est estimé à 27 554 FCFA. Le gain des hommes est nettement
supérieur à celui des femmes (39 198 FCFA contre 12 966 FCFA). C’est Bamako qui enregistre le
revenu moyen le plus élevé (60 569 FCFA) contre 20 973 FCFA en milieu rural.
En 2014, le taux de chômage est estimé à 8,2%, ce qui correspond à un effectif de 492 310 chômeurs
dont 52,6% de femmes contre 47,4% pour les hommes. Les femmes sont les plus exposées au
chômage quel que soit le niveau d’instruction. C’est surtout à Bamako et autres zones urbaines que
la différence entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes de même niveau d’instruction
est plus marquée, surtout à partir du secondaire. En outre, le chômage est et demeure un phénomène
urbain. En effet, le taux est de 11,5% à Bamako, 11,1% pour les autres urbaines contre 7,3% en milieu
rural. Il faut aussi noter que près de 3/4 des chômeurs sont dans la tranche 15-35 ans au niveau des
autres zones urbaines. A Bamako, cette proportion atteint les 85%.
 |
11 11 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
1
Introduction
L’enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages de 2014 dont les données ont servi à la
rédaction de ce rapport est la troisième édition d’une série d’enquêtes ayant pour objectifs de fournir
les informations nécessaires au suivi et à l’évaluation du Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP). Elle a été réalisée sur un échantillon de 6 360 ménages répartis
entre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le District de
Bamako. La région de Kidal n’a pas été enquêtée pour des raisons sécuritaires.
Le présent rapport qui est une initiative de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
(ONEF) est basé sur le module emploi de ladite enquête. Il vise à fournir des indicateurs clés pour
une meilleure évaluation du marché du travail au Mali. Plus spécifiquement, il donne une visibilité
concernant :
l’emploi ;
le chômage ;
le sous-emploi ;
la disparité en termes de gain entre les hommes et les femmes ;
le secteur informel.
 |
12 12 |
▲back to top |
2
1. De l'enquête de terrain
1.1. Méthodologie d'enquête
L’EMOP est une enquête par sondage stratifié à deux degrés réalisée auprès des ménages. Ces
résultats sont significatifs au niveau national, par région administrative excepté celle de Kidal, dans
le district de Bamako et par milieu de résidence (urbain et rural). L’opération est exécutée
annuellement en quatre (4) passages et chaque passage couvre trois mois de collecte.
Tous les indicateurs de plus de 10 %, sont estimés avec une précision relative au plus égale à 0,10 et
à 0,15 respectivement pour les niveaux national et régional.
Dans cette étude, on s’intéresse particulièrement au module "Emploi" du 3ème passage de l’EMOP.
La section "Emploi" s’articule autour des modules suivants :
Emploi actuel des membres du ménage âgés de 06 ans et plus ;
Emploi principal des membres du ménage âgés de 06 ans et plus ;
Emploi secondaire des membres du ménage âgés de 06 ans et plus ;
Revenus hors activités ;
Recherche d’emploi des membres du ménage âgés de 06 ans et plus ;
Module chômage des membres du ménage âgés de 06 ans et plus ;
Module trajectoire et perspectives pour les personnes de 15 ans et plus. Il s’agit de l’activité
du père, l’emploi antérieur de l’individu et les perspectives.
Module Migrant de retour concerne également les personnes de 15 ans et plus ayant fait au
moins une migration.
1.2. Organisation de l'enquête
Pour un suivi régulier et un contrôle efficace des travaux de terrain, trois (3) agents enquêteurs sont
placés sous la responsabilité directe d’un (1) contrôleur. Ils forment une équipe. Tous les membres
de l'équipe évoluent ensemble dans toutes les grappes qui leur sont préalablement affectées. Chaque
agent de l'équipe est muni d'un ordinateur "Tablette" pour accomplir la mission qui leur est confiée.
Une application de l'enquêteur et une application du contrôleur sont conçues à cet effet. Le contrôleur,
dont le rôle est principalement de dénombrer les ménages d'une grappe, affecter les ménages à ses
enquêteurs, contrôler les données, les rassembler et envoyer au superviseur les données de la grappe,
pourra faire toutes ces opérations depuis sa tablette. La mission des enquêteurs est d'administrer le
questionnaire aux enquêtés.
Au niveau régional, la coordination de l’opération est confiée au Directeur Régional de la
Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population
(DRPSIAP). Il est secondé par un superviseur régional chargé de suivre l’évolution des travaux de
collecte sur le terrain. La gestion et la supervision de l’opération au niveau national sont assurées par
la Direction Générale de l’INSTAT qui veille au respect du calendrier prévisionnel et au bon
 |
13 13 |
▲back to top |
3
déroulement des activités. L’EMOP 2014 a été réalisée par 22 contrôleurs, 66 enquêteurs, 8
superviseurs régionaux, 3 éditeurs.
1.3. Communication
La sensibilisation est un élément important dans la réalisation des opérations d’enquête. Elle permet
d’informer la population sur l’objet et l’importance de l’enquête afin d’avoir leur adhésion. Dans le
cadre de la mise en œuvre de l’EMOP, les microprogrammes ont été conçus et sont diffusés
régulièrement par l’ORTM et les radios de proximité. Au démarrage de l’opération, des lettres de
sensibilisation ont été adressées aux Gouverneurs de région et aux DRPSIAP.
1.4. Structure du questionnaire d'enquête
Le questionnaire de l’EMOP comporte un module de base et un ou plusieurs modules supplémentaires
qui sont insérés à la demande des utilisateurs de données statistiques. Le module de base est conçu
pour prendre en compte prioritairement les préoccupations du cadre stratégique de croissance et de
réduction de la pauvreté (CSCRP) et des OMD ainsi que d’autres programmes sectoriels.
Le questionnaire du module "Emploi" du 3ème passage de l’EMOP dont il est question dans cette
étude est structuré comme suit :
La section I s’intéresse aux identifiants du ménage
la section M se rapporte aux caractéristiques des membres du ménage (âge, sexe), leur lien
avec le chef de ménage, l'état matrimonial le statut de résidence et le statut migratoire ;
la section S renseigne sur la santé des membres du ménage ; des questions y sont posées sur
la prévalence de certaines maladies ;
la section EA est relative à l'emploi ; elle permet de calculer les indicateurs tels que les taux
de chômage, d’activité et d’inactivité, etc. ;
la section AP renseigne sur les caractéristiques de l’activité principale des membres du
ménage âgés de 6 ans et plus ;
la section AS donne des informations sur l’activité secondaire des membres du ménage âgés
de 6 ans et plus ;
la section RHA renseigne sur les revenus hors-activité ;
la section R donne des informations sur la recherche d’emploi.
La section C se rapporte au chômage ;
La section TP se réfère à la trajectoire et perspectives pour les personnes âgées de 15 ans et
plus ;
La section MR aborde des aspects portant sur les migrants de retour ;
La dernière section, comme pour tous les passages, est consacrée à la consommation des
ménages.
1.5. Traitement des données et analyse
 |
14 14 |
▲back to top |
4
Les informations collectées transmises par les agents sont récupérées au niveau central par une équipe
d’édition installée dans une salle de traitement équipée d’ordinateurs. Ces agents d’édition procèdent
au contrôle, à la vérification et à la consolidation des données reçues. Les erreurs ou incohérences
décelées sont notifiées aux agents concernés pour correction sur le terrain. Après chaque trimestre de
collecte, les fichiers de données sont consolidés puis exportés sur SPSS pour des fins d’apurement
complémentaires et d’analyse des résultats.
En ce qui concerne l’analyse des résultats, une équipe a été mise en place. L’analyse consiste à décrire
les résultats obtenus selon un plan préalablement conçu et à rédiger un rapport dans lequel les
principaux résultats de l’enquête sont présentés. Cette approche vise à pouvoir présenter les résultats
dans le plus court délai possible, après la collecte des informations sur le terrain.
2. Caractéristiques sociodémographiques
Ce chapitre fait une description des ménages et de la population. Il aborde les aspects liés à la
migration, la scolarisation et la formation continue (formation des actifs exerçant un emploi).
2.1. Caractéristiques des ménages
2.1.1. Taille du ménage
La plus faible taille du ménage compte de 1 à 2 personnes. Au Mali, ce genre de ménage est minime
(4,2%). Elle se rencontre beaucoup dans les centres urbains et à Bamako, la capitale (5,7% et 5,6%).
Elle est très faible dans les campagnes (3,7%). De même, les ménages composés de 3 à 4 individus,
sont encore plus nombreux dans les villes que dans les centres ruraux (20,4% contre 13,7% de
ménages). Ce type de ménage, bien que plus nombreux que celui de 1 à 2 individus, demeure très
timide à l’échelle nationale (15,6%). Le même constat se dégage pour les ménages regroupant 5 à 6
personnes (23,9% à Bamako, contre 22,5% en milieu rural). Cette catégorie de ménage, certes plus
élevée que les deux premières tranches, n’atteint pas la moitié des effectifs sélectionnés, dans le cadre
de cette étude. Elle se chiffre seulement à 23,3%. La tendance change complètement pour les ménages
composés de 7 personnes et plus. Ils représentent plus de la moitié (56,8%) de l’ensemble des
ménages. En terme clair, les ménages de plus de 7 personnes se rencontrent en grand nombre dans
les campagnes que les centres urbains, y compris la capitale.
Tableau 1 : Répartition des ménages selon la taille du ménage et la zone de résidence
Taille du ménage Bamako Autre urbain Rural Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
1 - 2 personnes 15561 5,6 16034 5,7 52898 3,7 84493 4,2
3 - 4 personnes 57249 20,5 57479 20,4 196908 13,7 311635 15,6
5 - 6 personnes 66972 23,9 75232 26,7 322703 22,5 464907 23,3
7 personnes et plus 140101 50,1 133513 47,3 860173 60,0 1133787 56,8
Total 279883 100 282257 100 1432682 100 1994823 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
En Afrique, plus particulièrement au Mali, le petit ménage (de 1 à 6 personnes) ou famille nucléaire,
s’implante de façon graduelle. Le grand ménage se disloque aussi bien dans les villes que dans les
 |
15 15 |
▲back to top |
5
zones rurales. Ce facteur soulève du coût la problématique de la dégradation de nos valeurs
habituelles. L’individualisme a tendance à émerger dans nos mœurs, au détriment du grand groupe.
2.1.2. Caractéristiques du chef de ménage
La majeure partie des chefs de ménage, au Mali sont des hommes (92,1 %). Seulement, 7,9% des
chefs de ménages sont des femmes. Elles sont plus nombreuses dans les villes que les campagnes
(11,2% à Bamako et 13,8% pour les autres zones urbaines contre 6,3%). En général, la femme
n’assure la chefferie dans le ménage que lorsqu’elle perd son mari ou si elle est divorcée. De ce fait,
la proportion de femme chef de ménage atteint les 66% pour les divorcées et 80% pour les veuves.
C’est dans les régions de Gao, Tombouctou et dans le district de Bamako où la proportion de femmes
chef de ménage est élevée comparativement aux autres régions. A Gao, elle atteint le pic (22%). Cette
situation pourrait s’expliquer par le déplacement des hommes, occasionné par la crise de 2012.
La région de Ségou enregistre la plus faible proportion de femmes chef de ménage (4,9%) suivie de
la région de Mopti (5,2%). L’autonomisation et l’augmentation du taux de scolarisation des femmes
pourraient dans les années à venir réduire cet écart entre les hommes et les femmes.
Tableau 2 : Caractéristiques du chef de ménage selon le sexe, la zone de résidence, le statut matrimonial, la région (en %)
Sexe du chef de ménage
Homme Femme Total
Zone de résidence Bamako 88,8 11,2 100,0
Autre urbain 87,0 13,0 100,0
Rural 93,7 6,3 100,0
Groupe d’âge 15 - 34 ans 92,4 7,6 100,0
35 - 64 ans 91,8 8,2 100,0
65 ans et plus 92,9 7,1 100,0
Statut matrimonial du chef
de ménage
Marié monogame 97,9 2,1 100,0
Marié polygame 97,1 2,9 100,0
Célibataire 83,0 17,0 100,0
Divorcé/séparé 33,9 66,1 100,0
Veuf 19,1 80,9 100,0
Région Kayes 92,4 7,6 100,0
Koulikoro 92,9 7,1 100,0
Sikasso 94,5 5,5 100,0
Ségou 95,1 4,9 100,0
Mopti 94,8 5,2 100,0
Tombouctou 87,3 12,7 100,0
Gao 78,0 22,0 100,0
Bamako 88,8 11,2 100,0
Total 92,1 7,9 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
16 16 |
▲back to top |
6
Les chefs de ménage de façon générale, n’ont aucun niveau d’instruction pour la plupart (74,5%).
C’est surtout en milieu rural que la proportion est très élevée. La proportion de chef ménage est
inversement proportionnelle au niveau d’instruction. Comparativement aux autres régions, le niveau
d’études des chefs de ménage à Bamako est relativement élevé, (10,2% ont le niveau supérieur).
La proportion de célibataires chefs de ménage ayant le niveau d’études supérieur (7,4%) est élevée
comparativement aux autres (tableau 3).
Tableau 3 : Caractéristiques du chef de ménage selon la zone de résidence, le statut matrimonial, la région et le sexe (en %)
Education
Aucun
niveau Fondamental 1 Fondamental 2 Secondaire Supérieur Total
Zone de
résidence
Bamako 50,0 14,7 15,6 9,5 10,2 100,0
Autre urbain 57,5 14,7 10,7 11,3 5,8 100,0
Rural 82,6 10,9 3,3 2,5 0,7 100,0
15 - 34 ans 65,2 15,8 8,1 8,1 2,9 100,0
35 - 64 ans 72,5 13,1 7,0 4,5 2,9 100,0
65 ans et plus 89,7 4,6 1,0 2,9 1,8 100,0
Statut
matrimonial
du chef de
ménage
Marié monogame 74,2 11,1 6,2 5,5 2,9 100,0
Marié polygame 76,2 12,8 5,0 3,6 2,4 100,0
Union libre 43,9 38,1 6,0 8,5 3,5 100,0
Célibataire 37,9 22,2 21,1 11,4 7,4 100,0
Divorcé/séparé 64,1 18,3 12,8 1,8 3,0 100,0
Veuf 82,6 9,4 5,5 1,2 1,3 100,0
Kayes 71,6 16,4 6,8 3,8 1,3 100,0
Koulikoro 76,8 11,4 5,1 4,5 2,2 100,0
Sikasso 72,2 13,3 6,3 6,0 2,1 100,0
Région Ségou 81,2 11,5 2,8 3,1 1,3 100,0
Mopti 89,4 6,2 2,0 1,9 0,5 100,0
Tombouctou 86,5 5,9 4,0 2,8 0,9 100,0
Gao 67,2 19,1 4,8 6,6 2,3 100,0
Bamako 50,0 14,7 15,6 9,5 10,2 100,0
Total 74,5 12,0 6,0 4,7 2,7 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
2.2. Caractéristiques de la population
2.2.1 Structure par sexe et par âge
La structure de la population par sexe montre que les hommes représentent 48,0% et les femmes
52,1%. Cette population est constituée de 28% de personnes de moins de 7 ans, 21,6% de 7-14 ans,
46,7% de 15-64 ans et 3,6% de 65 ans ou plus.
Cette répartition de la population révèle que près d’une personne sur deux est en âge de travailler au
sens du BIT (15-64 ans). Cette proportion des personnes en âge de travailler est plus élevée chez les
femmes (49,5%) que chez les hommes (43,8%), en autre milieu urbain (51,0%) qu’en milieu rural
(48,3%), à Bamako (53,6%) que dans les autres régions du pays.
La proportion des personnes âgées de 15 ans et plus dépasse légèrement la moitié de la population
totale. Selon la nouvelle résolution du BIT, elle représente la main d’œuvre du pays.
 |
17 17 |
▲back to top |
7
Tableau 4 : Répartition (en %) de la population selon le groupe d’âge, la zone de résidence, le sexe et la région
Classe d'âge de travail
moins de
7 ans 7 - 14 ans 15 - 64 ans
65 ans plus
de Total
Proportion
des 15 ans et
plus
Zone de
résidence
Bamako 23,1 20,5 53,6 2,8 100,0 56,4
Autre urbain 24,2 21,7 51,0 3,1 100,0 54,1
Rural 29,5 21,8 44,8 3,8 100,0 48,7
Sexe
Homme 29,3 22,8 43,8 4,2 100,0 48,0
Femme 26,9 20,6 49,5 3,1 100,0 52,6
Région
Kayes 29,4 22,4 44,6 3,6 100,0 48,3
Koulikoro 28,0 22,4 45,9 3,7 100,0 49,6
Sikasso 28,1 22,3 45,9 3,6 100,0 49,6
Ségou 27,1 21,4 47,2 4,3 100,0 51,5
Mopti 30,1 21,3 44,7 3,9 100,0 48,6
Tombouctou 30,8 19,5 46,6 3,0 100,0 49,7
Gao 32,5 21,4 43,4 2,7 100,0 46,1
Bamako 23,1 20,5 53,6 2,8 100,0 56,4
Total 28,0 21,6 46,7 3,6 100,0 50,3
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La pyramide des âges ci-dessous présente la forme générale des pyramides des populations des pays
en développement. Elle est caractérisée généralement par une base très élargie, puis un rétrécissement
progressif et régulier au fur et à mesure que l’on avance en âge. Ainsi, on constate qu’aux âges élevés,
cette pyramide s’effile très vite. L’allure de cette pyramide des âges fait ressortir le caractère jeune
de la population du Mali en 2014.
2000000 1500000 1000000 500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
90+
Graphique 1: pyramide des âges de la population
Femme Homme
 |
18 18 |
▲back to top |
8
2.2.2 Statut migratoire de la population
Cette partie concerne uniquement les migrants de retour au Mali. Ce pays est un peuple de voyageurs.
Les maliens parcourent plusieurs contrées à travers le monde. Les populations rurales maliennes se
vident pour la recherche de mieux vivre et vont à l’intérieur du pays, dans la sous-région africaine,
en Europe, aux Amériques et en Asie. Les migrants de retour au Mali en 2014 sont venus en majorité
de la Côte d’Ivoire (67,5%) contre seulement 2,7% venus de la France. Ils viennent également des
pays Africains et surtout les pays frontaliers avec le Mali.
Tableau 5 : Principaux pays de migration pour les migrants de retour (en %)
Pays de migration
de retour
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Côte d'Ivoire 55 54,4 54,8 62,8 64,9 63,4 70,3 65,9 69,4 68,4 64,5 67,5
Sénégal 2,7 3,8 3,1 6,3 0 4,4 9,2 3,6 8,1 8,5 2,9 7,2
Burkina Faso 3,6 1,1 2,6 3,7 8,5 5,2 6,7 9 7,1 6,1 8,1 6,5
Niger 0 0 0 5,4 5 5,3 3,8 10,3 5,2 3,8 8,1 4,8
Gabon 3,3 17,2 8,6 7,9 10,3 8,6 2,5 0,7 2,1 3,3 4,4 3,5
Mauritanie 2,2 0 1,3 1,6 1,1 1,4 4,1 0 3,2 3,6 0,2 2,8
France 8,1 1,7 5,7 2,3 1,1 2 3,1 1 2,6 3,2 1,1 2,7
Guinée 3,1 0 1,9 2,4 1,3 2,1 2,2 3,2 2,4 2,3 2,5 2,3
Congo-Brazzaville 2,3 0 1,4 1 2,3 1,4 2,2 0 1,8 2,1 0,5 1,7
Ghana 0,6 0 0,4 2,4 3,1 2,6 1,2 2,5 1,4 1,3 2,4 1,6
Effectif migrants 22 560 13 858 36 418 58 534 25 942 84 476 346 139 89 818 435 957 427 233 129 618 556 851
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
L’accélération du processus de la décentralisation est une bonne opportunité pour une mise en niveau
des campagnes et des villes. La création des activités génératrices de revenus est une stratégie de lutte
contre l’émigration.
La contrainte familiale est la principale cause de retour des migrants au pays (tableau 6). Elle
représente plus de la moitié (54,7%) des circonstances de retour au pays. Une part importante (1/4)
des migrants retournés en 2014 au pays n’ont pas voulu se prononcer sur les circonstances de leur
retour. Probablement, ces personnes ont eu des difficultés d’insertion dans les pays d’accueil.
Tableau 6 : Répartition (en %) des migrants de retour selon les principales causes de retour
Principales circonstances de retour au pays %
Permis de séjour non renouvelé 0,6
Travail perdu 2,3
Etudes interrompus 0,2
expulsé 0,7
Rapatrié 2,4
Problèmes administratifs/fiscaux 1,4
Contraintes familiales 54,7
Demande d’asile rejetée 0,3
Ne Souhaite pas répondre 24,9
Autre (précisez) 22,5
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
19 19 |
▲back to top |
9
Parmi les migrants rentrés au pays en 2014 (tableau 7), plus de 36,1% ont travaillé comme
indépendant dans le pays d’accueil, plus de 27,7% comme manœuvre employé et 23,8% comme
employé/ouvrier. De par les emplois occupés à l’extérieur, ces migrants étaient certainement dans la
précarité qui pourrait être une des raisons de leur retour au pays. Les migrants de retour en milieu
rural ont surtout travaillé comme aide familial dans le pays d’accueil. Aucun d’entre eux n’occupait
le poste de cadre.
Tableau 7 : Catégorie socioprofessionnelle dans l'activité exercée dans le pays d'immigration (en %)
Catégorie
socioprofessionnelle
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Cadre supérieur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cadre moyen 7,7 0,0 6,4 ,4 0,0 ,3 ,2 0,0 ,2 ,5 0,0 ,5
Employé / ouvrier 18,0 0,0 14,9 26,3 4,3 23,1 25,0 17,4 24,3 24,9 13,7 23,8
Manœuvre 17,3 0,0 14,3 23,2 0,0 19,8 31,5 11,4 29,7 29,9 8,4 27,7
Employeur 1,7 0,0 1,4 1,6 0,0 1,3 ,9 0,0 ,8 1,0 0,0 ,9
Indépendant 44,4 85,5 51,4 30,3 60,8 34,8 35,9 31,1 35,5 35,6 40,8 36,1
Apprenti 5,5 0,0 4,6 9,4 1,8 8,3 2,6 0,0 2,3 3,5 ,3 3,2
Aide familial 5,4 14,5 7,0 8,9 33,0 12,4 4,0 40,0 7,2 4,6 36,8 7,9
Total (effectif) 22 560 13 858 36 418 58 534 25 942 84 476 346 139 89 818 435 957 427 233 129 618 556 851
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Les migrants rentrés au pays en 2014 estiment en majorité (62,2%) que leur situation financière s’est
améliorée contre 25,7% qui trouvent qu’elle est restée inchangée. Plus de 70% des hommes pensent
que l’émigration a permis d’améliorer leur situation financière. Par contre ce sont les femmes qui
estiment en majorité (40,9%) que leur situation financière n’a pas changé pendant leur séjour en
dehors du pays.
Tableau 8 : Situation financière dans le pays d'immigration selon la zone de résidence et le sexe (en %).
Situation
financière
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Améliorée 52,2 46,6 50,0 64,8 41,0 57,5 72,8 30,8 64,1 70,6 34,5 62,2
Inchangée 30,1 30,7 30,3 19,7 31,5 23,3 20,7 45,1 25,7 21,1 40,9 25,7
Détériorée 1,8 6,9 3,7 3,2 3,5 3,3 1,7 4,7 2,4 1,9 4,7 2,6
ND 16,0 15,8 15,9 12,4 24,0 16,0 4,8 19,4 7,8 6,4 19,9 9,6
Effectif migrant 22 560 13 858 36 418 58 534 25 942 84 476 346 139 89 818 435 957 427 233 129 618 556 851
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
2.3. Niveau d’instruction et formation continue
2.3.1. Niveau d’éducation
Plus des 2/3 de la population malienne sont sans aucun niveau d’instruction. Les femmes sont au
premier rang, plus de 70% d’entre elles n’ont aucun niveau d’instruction. Les personnes n’ayant
aucun niveau d’instruction vivent majoritairement en milieu rural (77%). La population vivant dans
les villes, notamment à Bamako à un niveau relativement élevé (4,6% de la population à Bamako ont
atteint le niveau d’étude supérieur).
 |
20 20 |
▲back to top |
10
Tableau 9 : Répartition (en %) de la population de 6 ans et plus selon le niveau d’instruction et le diplôme
Niveau
d’instruction
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Aucun niveau 38,6 47,9 43,4 47,1 54,8 51,0 73,2 81,4 77,3 65,7 73,8 69,8
Maternelle 3,8 3,4 3,6 3,9 2,8 3,4 2,1 2,1 2,1 2,6 2,3 2,4
Fondamental 1 25,7 26,3 26,0 25,9 25,7 25,8 18,8 14,0 16,4 20,5 17,0 18,7
Fondamental 2 18,0 15,4 16,7 14,6 12,1 13,3 4,5 2,2 3,3 7,4 5,1 6,2
Secondaire 7,5 4,6 6,0 6,1 4,1 5,1 1,0 0,4 0,7 2,4 1,4 1,9
Supérieur 6,5 2,3 4,3 2,4 0,5 1,4 0,4 0,0 0,2 1,4 0,4 0,9
Diplôme obtenu
N'a pas été à l'école 38,6 47,8 43,3 47,0 54,8 51,0 73,1 81,3 77,2 65,6 73,8 69,8
Aucun diplôme 40,2 39,9 40,1 38,8 36,7 37,7 24,6 17,9 21,2 28,2 23,0 25,6
DEF 7,3 5,4 6,3 5,5 3,9 4,7 1,0 0,4 0,7 2,3 1,5 1,9
CAP 2,9 1,9 2,4 2,3 2,0 2,1 0,3 0,2 0,3 0,9 0,7 0,8
BT 2,6 1,9 2,2 3,0 1,5 2,3 0,5 0,1 0,3 1,1 0,5 0,8
BAC 2,1 0,7 1,4 0,9 0,7 0,8 0,2 0,0 0,1 0,5 0,2 0,4
BTS/DEUG 2,5 1,1 1,8 0,7 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,3
Master 1 3,4 1,1 2,2 1,5 0,3 0,9 0,2 0,0 0,1 0,8 0,2 0,5
Master 2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Doctorat 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Du DEF au Doctorat, l’effectif des diplômés décroit sensiblement. Les détenteurs de gros diplômes
sont rares et même souvent par traces.
De manière générale, au Mali, les filles sont moins scolarisées et cela, malgré les efforts fournis par
les plus hautes autorités ces dernières années pour rehausser le taux de scolarisation des filles. Au
niveau du fondamental I, elles sont plus nombreuses dans le District de Bamako et dans les centres
villes qu’en milieu rural. Au fondamental II, Secondaire et Supérieur, les femmes ne sont représentées
que par trace comparativement aux hommes. Cette situation de faible scolarisation des femmes,
s’explique en grande partie par le poids culturel. Il faut élargir les campagnes de sensibilisations en
faveur de la scolarisation des filles jusqu’au niveau des collectivités de base. La disparité, dans
l’acquisition des diplômes, continue entre les sexes, les villes. D’une façon pyramidale, l’effectif des
filles diminue nettement du fondamental au supérieur. Le District de Bamako et les capitales
régionales abritent plus de diplômés que les zones rurales.
2.3.2. Formation continue des actifs occupés
Près des 3/4 des salariés ont bénéficié de la formation dans le cadre de l’exercice de leur activité. Les
agents ayant bénéficié de la formation continue évoluent pour la plus part dans le secteur moderne
(75,5% pour les services, 10,1% pour l’industrie). Ces formations permettent de développer les
compétences des employés pour exercer avec plus d’efficacité les tâches qui leur sont confiées. Plus
de la moitié des employés formés travaillent dans le secteur public qui emploie moins de 3% des
actifs occupés. Seulement, 7,1% des employés formés travaillent dans le secteur privé formel qui
emploi seulement 1,31% des actifs occupés.
 |
21 21 |
▲back to top |
11
Le secteur informel demeure le principal secteur pourvoyeur d’emplois. En 2014, il a employé 71%
des actifs occupés et parmi les actifs formés, 31,6% travaillent dans ce secteur.
Tableau 10 : Répartition (en %) des agents formés selon les caractéristiques sociodémographiques
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Situation dans la profession
Salarié 87,8 95,8 90,0 76,8 82,9 78,3 59,6 69,2 61,0 69,9 80,8 72,2
Patron, travailleurs
indépendants
10,7 0,0 7,9 18,0 12,4 16,6 38,1 20,7 35,5 26,8 12,9 23,9
Associés 0,0 0,0 0,0 2,0 ,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 0,6
Apprenti, aide familial 1,5 4,2 2,2 3,2 4,5 3,5 2,3 10,2 3,5 2,5 6,3 3,3
Secteur d'activité économique
Agriculture, élevage, forêt,
pêche
2,7 0,0 1,9 5,4 2,6 4,7 22,6 9,8 20,7 13,3 4,4 11,5
Industrie 7,3 0,0 5,3 14,6 6,4 12,6 10,0 5,6 9,3 11,5 5,0 10,1
Commerce 1,5 0,0 1,1 5,0 3,8 4,7 1,9 0,0 1,6 3,1 1,9 2,8
Services 88,6 100 91,6 74,9 87,3 78,0 65,5 84,6 68,4 72,1 88,7 75,5
Secteur institutionnel
Secteur public 61,1 76,4 65,2 54,9 59,3 56,0 41,4 42,3 41,6 49,2 56,9 50,8
Entreprise privée formelle 9,0 0,0 6,6 9,1 8,7 9,0 6,5 0,0 5,5 7,9 4,4 7,1
Entreprise privée informelle 18,7 0,0 13,7 29,1 24,0 27,9 38,8 50,6 40,5 32,5 28,3 31,6
ONG, Organisations
internationales, association
11,1 0,0 8,2 3,8 5,3 4,2 3,8 0,0 3,2 4,7 2,7 4,3
Employés de maison 0,0 23,6 6,3 2,9 2,7 2,9 9,5 7,1 9,1 5,7 7,8 6,1
Nombre d’employés formés 13 325 4 873 18 198 41 861 13 691 55 552 50 874 8 831 59 706 106 060 27 396 133 456
% d'employés formés 3,6 1,7 2,8 12,0 5,6 9,3 2,3 0,4 1,4 3,6 1,1 2,4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Globalement, la proportion des actifs occupés ayant bénéficié de la formation demeure très faible
(2,4%). A tous les niveaux, la proportion des femmes employées formées est très faible
comparativement aux hommes ayant bénéficié de la formation au cours de l’année 2014.
2.3.2. Durée de la formation continue
La durée moyenne des salariés formés est nettement supérieure à celle des autres catégories
d’employés (85 jours contre 68 pour les patrons, travailleurs indépendants). Les actifs occupés dans
le secteur industriel ont une durée moyenne de formation qui dépasse les 100 jours. Cette durée est
relativement longue par rapport aux travailleurs formés dans les autres secteurs d’activités
économiques. La formation continue des agents des entreprises évoluant surtout dans le secteur
industriel est indispensable pour produire des produits de bonne qualité afin de gagner le pari de la
concurrence.
Les employés des entreprises privées formelles ont en moyenne plus duré en formation que les actifs
occupés des autres secteurs institutionnels. En 2014, ils ont totalisé en moyenne 154 jours de
formation contre 80 pour les agents du secteur public. Même si ce secteur emploie peu d’actifs, les
employés qui y évoluent durent plus longtemps en formation que ceux des autres secteurs.
 |
22 22 |
▲back to top |
12
Tableau 11 : Durée moyenne (en jour) de la formation des actifs occupés
Situation dans
la profession
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Apprenti, aide familial 74 7 40 81 3 56 23 23 23 55 14 39
Associés 0 0 0 65 7 64 0 0 0 65 7 64
Patron, travailleurs indépendants 32 0 32 131 30 113 53 23 51 73 26 68
Salarié 49 28 43 128 60 110 75 62 73 94 54 85
Total 48 27 42 126 54 108 66 50 63 87 48 79
Secteur d'activité économique
Agriculture, élevage, forêt,
pêche
50 50 57 50 56 32 21 32 37 30 36
Commerce 60 60 100 52 90 114 114 102 52 95
Industrie 14 14 139 11 123 105 52 100 115 26 106
Services 50 27 43 130 57 110 70 53 67 91 50 81
Total 48 27 42 126 54 108 66 50 63 87 48 79
Secteur institutionnel
Employés de maison 0 2 2 43 33 40 24 7 22 28 9 23
Entreprise privée formelle 18 0 18 225 60 186 155 0 155 167 60 154
Entreprise privée informelle 65 0 65 120 19 98 63 56 62 83 40 76
ONG, Organisations
internationales, association
64 0 64 73 38 62 43 0 43 59 38 56
Secteur public 44 35 41 121 69 107 65 51 63 86 56 80
Total 48 27 42 126 54 108 66 50 63 87 48 79
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Pour que ces formations puissent atteindre les résultats escomptés, les entreprises doivent faire une
analyse objective des besoins de formation avant d’entreprendre des actions de formations du
personnel. Dans un environnement dominé par la concurrence, le perfectionnement des ressources
humaines devient indispensable pour les entreprises afin de pérenniser leurs activités.
 |
23 23 |
▲back to top |
13
3. Population active potentielle ou en âge de travailler
La population de 15 à 64 ans peut être définie comme la population en âge de travailler et donc
potentiellement active. Il s’agit avant tout d’un cadre de référence, en principe d’un maximum, qui
représente la composante démographique de la population active.
La population en âge de travailler correspond à l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans. Cette
fourchette n’est pas totalement pertinente pour tous les pays compte tenue de certaines obligations.
On retient cependant cette définition pour faciliter les comparaisons internationales ou sous
régionales.
Le diagramme ci-dessous, permet d’identifier clairement les principales composantes de la population
en âge de travailler, définie dans ce rapport par les personnes de 15 à 64 ans.
Diagramme 1 : répartition (en million) de la population en âge de travailler en 2014
Population totale
(17,22)
Population en âge de
travailler 15-64 ans
(8,04)
Population inactive
(2,06)
Actifs occupés
(5,5)
Chômeurs
(0,49)
Population active
(5,99)
Chômeurs BIT
(0,38)
Chômeurs
découragés
(0,11)
Agriculture,
élevage, forêt,
pêche (3,67)
Industrie
(0,44)
Commerce
(0,81)
Service
(0,58)
 |
24 24 |
▲back to top |
14
Tableau 12 : Population en âge de travailler selon la zone de résidence et le sexe
Situation
dans l'emploi
Homme Femme Bamako Autre urbain Rural Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Actif occupé 2957495 79,3 2536780 58,8 647836 56,1 594453 55,0 4251985 73,2 5494274 68,3
Chômeur 233502 6,3 258808 6,0 84490 7,3 82722 7,7 325098 5,6 492310 6,1
Inactifs 538657 14,4 1517857 35,2 423152 36,6 403851 37,4 1229510 21,2 2056514 25,6
Total 3729653 46,4 4313445 53,6 1155478 14,4 1081027 13,4 5806593 72,2 8043098 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La population en âge de travailler est composée d’actif occupé, de chômeur et d’inactif. Sur
l’ensemble de la main d’œuvre potentielle du Mali, la part des actifs occupés représente environ
68,3% ; la population au chômage est d’environ 6,1% de la population totale (actifs + inactifs) et la
population inactive représente presque 25,6%.
La population en âge de travailler est essentiellement en zone rurale (72,2), contre 14,4% à Bamako
et 13,4% dans les autres villes urbaines.
3.1. Poids de la population active potentielle dans la population totale
Le poids ou taux de population en âge de travailler mesure la part de la population potentiellement
active au sein de la population.
Tableau 13 : Poids de la population en âge de travailler par rapport à la Population totale
Poids de la population en âge
de travailler (en %)
Population en âge de travailler Population totale
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Zone de résidence
Bamako 53,0 54,2 53,6 555 931 599 547 1 155 478 1 049 504 1 106 913 2 156 417
Autre urbain 49,5 52,5 51,0 515 317 565 710 1 081 027 1 042 007 1 076 559 2 118 567
Rural 41,4 48,2 44,8 2 658 405 3 148 188 5 806 593 6 423 527 6 528 517 12 952 044
Région
Kayes 40,6 48,4 44,6 466 928 593 170 1 060 098 1 150 106 1 224 887 2 374 994
Koulikoro 42,5 49,2 45,9 610 149 714 603 1 324 752 1 434 395 1 451 063 2 885 458
Sikasso 42,5 49,2 45,9 660 661 785 187 1 445 847 1 553 805 1 595 014 3 148 819
Ségou 45,0 49,6 47,2 636 896 679 183 1 316 079 1 416 170 1 369 506 2 785 676
Mopti 41,9 47,6 44,7 507 150 578 332 1 085 482 1 209 878 1 215 857 2 425 736
Tombouctou 44,3 48,9 46,6 174 004 201 001 375 005 392 798 411 083 803 881
Gao 38,2 48,1 43,4 117 935 162 421 280 356 308 382 337 664 646 047
Bamako 53,0 54,2 53,6 555 931 599 547 1 155 478 1 049 504 1 106 913 2 156 417
Niveau d'éducation
Aucun niveau 38,7 49,0 44,2 2 252 687 3 253 222 5 505 909 5 814 348 6 635 543 12 449 891
Primaire 49,3 47,3 48,4 1 170 667 909 712 2 080 380 2 376 686 1 924 880 4 301 566
Secondaire 94,5 99,3 96,3 196 925 118 857 315 781 208 288 119 708 327 996
Supérieur 94,5 99,4 95,6 109 374 31 654 141 028 115 717 31 859 147 576
Total 43,8 49,5 46,7 3 729 653 4 313 445 8 043 098 8 515 039 8 711 989 17 227 028
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La population en âge de travailler représente 46,7% de la population totale malienne en 2014 dont
49,5% sont des femmes et 43,8% des hommes.
 |
25 25 |
▲back to top |
15
Quand on analyse le poids de la population en âge de travailler par rapport à la population totale selon
la zone de résidence, on constate que la population en âge de travailler est urbaine. En effet, le district
de Bamako occupe la première place avec 53,6%. Il est suivi d’autre urbain avec 51,0% et le milieu
rural occupe la dernière place avec 44,8%, même si la population en milieu rural représente plus de
75% de la population malienne. Par région, le poids de la population en âge de travailler est
prédominant dans la région de Ségou (47,2%), ensuite vient la région de Tombouctou avec 46,6%.
Les régions de Koulikoro et de Sikasso occupent le même rang (3ex) avec un poids de 45,9%.
Du point de vue genre, à l’exception du niveau d’étude primaire (49,3% pour les hommes et 47,3%
pour les femmes), on constate que le poids des femmes dépasse toujours celui des hommes selon les
différentes caractéristiques.
3.2. Population active
La population active est l’une des composantes de la population en âge de travailler. Elle se définit
comme l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail,
qu'elles aient un emploi (population active occupée) ou qu'elles soient au chômage (population active
inoccupée) à l'exclusion de celles ne cherchant pas d'emploi, comme les personnes au foyer, étudiants,
personnes en incapacité de travailler, rentiers. Selon les définitions, l'âge est fixé entre 15 et 64 ans,
ou porte sur toute personne de plus de 15 ans. Une lecture logique de la notion peut être proposée
comme dans le diagramme ci-dessous. Au sens du BIT, la population active regroupe la population
active occupée et les chômeurs.
Diagramme 2 :
Population
totale
En âge de
travailler
Population
active
Population
active
occupée
Salariés Non salariés
Chômeurs
Population
inactive
Autres
Moins de 15
ans
65 ans et plus
 |
26 26 |
▲back to top |
16
3.2.1. Composition de la population active
Les actifs sont ceux qui exercent ou cherchent à exercer une activité professionnelle. Parmi les actifs
se trouvent donc les travailleurs, salariés à temps plein ou à temps partiel, les travailleurs indépendants
et les chômeurs. Autrement, la population active est composée d’actifs occupés et de chômeurs.
La population active de 15 à 64 ans est le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans qui sont soit
actives, soit chômeurs.
Tableau 14 : Population active de 15 – 64 ans selon la zone de résidence et le sexe
Situation
dans l'emploi
Bamako Autres Urbains Rural Ensemble
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Total
Actif occupé 365209 282627 349747 244706 2242538 2009447 2957495 2536780 5494274
Chômeur 42885 41604 36575 46148 154042 171056 233502 258808 492310
Total 408094 324231 386322 290854 2396580 2180503 3190996 2795588 5986584
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
En 2014, la population active est estimée à 5 986 584 individus dont 5 494 274 sont occupés et le
reste (492 310 personnes) des chômeurs. Selon la zone de résidence, 76,5% des actifs vivent dans la
zone rurale, 12,2% à Bamako et 11,3% dans les autres villes urbaines. Par sexe, 53,3% de la
population active sont des hommes et 46,7% des femmes.
3.2.2. Taux d'activité
Le taux d’activité est le rapport entre la population de chômeurs et d’occupés et la population en âge
de travailler. Le taux d'activité indique dans un pays donné, le niveau général de participation au
monde du travail de la population en âge de travailler et l'importance relative de la main d’œuvre
disponible pour la production de biens et de services dans l'économie. Le taux brut d’activité (TBA)
est la population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans ou plus. Un taux d'activité
élevé signifie qu’une proportion importante de la population en âge de travailler est en emploi ou
activement à la recherche d'un emploi.
Tableau 15 : Taux brut et taux net d’activité selon la zone de résidence et le sexe (en %)
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
TNA 73,4 54,1 63,4 75,0 51,4 62,6 90,2 69,3 78,8 85,6 64,8 74,4
TBA 71,4 53,3 62,0 73,0 49,7 60,8 86,2 66,7 75,9 82,3 62,6 71,9
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Les taux brut et net d’activité de l’ensemble de la population du Mali s’établissent respectivement à
74,4% et 71,9% ; en moyenne plus de 7 individus sur dix âgés de 15 à 64 ans sont sur le marché du
travail.
 |
27 27 |
▲back to top |
17
Tableau 16 : Taux d’activité selon les caractéristiques sociodémographiques (en %)
Taux d'activité
Homme Femme Total
Zone de résidence
Urbain 74,2 52,8 63,0
Bamako 73,4 54,1 63,4
Autre urbain 75,0 51,4 62,6
Rural 90,2 69,3 78,8
Région
Kayes 86,7 77,8 81,7
Koulikoro 81,5 52,2 65,7
Sikasso 87,0 83,1 84,9
Ségou 90,7 63,6 76,7
Mopti 94,6 68,3 80,6
Tombouctou 87,9 54,9 70,2
Gao 81,1 28,8 50,8
Bamako 73,4 54,1 63,4
Classe d'âge de travail
15 - 24 ans 67,9 55,9 61,6
25 - 35 ans 95,4 70,5 80,7
36 - 40 ans 98,5 72,6 84,4
41 - 64 ans 93,7 66,2 80,1
Total 85,6 64,8 74,4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Les actifs sont répartis inégalement dans l’espace. Le monde rural a le plus fort taux d’activité
(78,8%), suivi de Bamako avec 63,4%. Les autres zones urbaines arrivent en 3ème position avec
62,6%.
Par rapport aux régions, le taux d’activité varie d’une région à une autre. Ainsi, dans les régions de
Sikasso, Kayes et Mopti, le taux d’activité respectivement 84,9%, 81,7% et 80,6% est supérieur à la
moyenne nationale (74,4%). La région de Gao (50,8%) enregistre le taux le plus bas tandis que la
région de Tombouctou enregistre un taux de 70,2%. Dans le district de Bamako, le taux d’activité
est de 63,4% inférieure à la moyenne nationale. Ce niveau faible du taux d’activité dans la capitale,
s’explique entre autres par la forte densité, la présence de la quasi-totalité des universités et grandes
écoles, etc.
Selon les groupes d’âges, la tranche d’âge 36 - 40 ans occupe la première place avec un taux d’activité
de 84,4%, ensuite viennent les tranches d’âges 25 – 35 ans et 41 – 64 ans avec les taux respectifs de
80,7% et 80,1%. La tranche d’âges 15 – 24 ans occupe le bas du tableau avec un taux d’activité de
61,6% inférieur à la moyenne nationale.
 |
28 28 |
▲back to top |
18
3.3. Population inactive
Sont considérés comme population inactive, les individus âgés de 15 à 64 ans qui, pour une raison ou
une autre, ne se présentent pas sur le marché du travail. On définit conventionnellement les inactifs
comme les personnes qui ne sont ni en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans,
étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler, etc.
On considère comme inactives : les personnes retraitées, les personnes qui ne sont pas disposées à
travailler et les personnes qui ne sont pas activement à la recherche d'un emploi. Ce groupe comprend
aussi les « travailleuses et travailleurs découragés », soit ceux qui ont déclaré vouloir travailler, mais
qui n'ont pas cherché de travail parce qu'ils estimaient n'avoir aucune chance de trouver un emploi
convenable. Dans le cas de la présente étude, cette dernière est ajoutée à la population active
inoccupée.
3.3.1. Composition de la population inactive
La population inactive est composée de plusieurs catégories de personnes qui sont :
Femmes au foyer : ce sont des femmes qui s'occupent exclusivement des travaux ménagers
sans percevoir de salaire ;
Etudiants/Elèves : ce sont toutes les personnes qui fréquentent régulièrement un
établissement scolaire ;
Rentiers : ce sont les personnes qui ne travaillent pas et qui vivent exclusivement des
revenus de leur propriété ou de leur capital ;
Retraités : ce sont des personnes qui se sont définitivement retirées de la vie active et qui
vivent exclusivement d'une pension ;
Vieillards : ce sont les personnes âgées qui ne travaillent pas et qui vivent exclusivement des
aides financières d'autres personnes ;
Invalides : ce sont des personnes frappées d'une incapacité physique ou mentale, les
empêchant d'exercer une activité d'ordre économique ;
Autres inactifs : ce sont les personnes qui n'exercent aucune activité économique non
classées ailleurs.
Tableau 17 : Répartition de la population inactive selon les raisons d’inactivité et le sexe
Raisons d'inactivité Homme Femme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Invalide ou en maladie de longue durée 41384 7,7 90047 5,9 131432 6,4
En cours de scolarité, étudiant 398602 74,0 295431 19,5 694033 33,7
Retraité / vieillard 23972 4,5 50059 3,3 74032 3,6
Grossesse 0 0,0 9604 0,6 9604 0,5
Femme au foyer 0 0,0 824202 54,3 824202 40,1
Rentier 787 0,1 217 0,0 1004 0,0
Autres 73911 13,7 248297 16,4 322207 15,7
Total 538657 26,2 1517857 73,8 2056514 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
29 29 |
▲back to top |
19
En 2014, au total 2 056 514 personnes sont inactives, soit 25,6% de la population en âge de travailler.
La proportion d'inactifs a tendance à augmenter fortement entre 2013 et 2014. Elle a passé de 1
459 685 en 2013 à 2 056 514 en 2014 soit une augmentation de 40,9% par rapport à l’année 2013.
Les principales raisons de l’inactivité (tableau 17) sont respectivement la présence des femmes au
foyer (40,1%) et la durée des études (33,7%). L’écart important dans l’inactivité entre les hommes et
les femmes est de l’ordre de 47,6 points de pourcentage (73,8% pour les femmes contre 26,2% pour
les hommes). Cet écart serait principalement dû à la durée dans des études, donc moins de filles sont
scolarisées et cela se répercute sur les autres ordres d’enseignement (secondaire et supérieur).
Tableau 18 : Population inactive selon le sexe, le milieu de résidence et les raisons d'inactivités (en %).
Raisons d'inactivité Bamako Autre urbain Rural
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Invalide ou en maladie de longue
durée
2,9 1,7 2,1 3,6 4,8 4,4 12,4 7,5 8,5
En cours de scolarité, étudiant 88,1 35,7 54 83,8 33,9 49,9 61,2 10,7 21,5
Retraité / vieillard 3,7 3,8 3,7 5,8 1,8 3,1 4,2 3,6 3,7
Grossesse 0 0,8 0,5 0 0,8 0,5 0 0,5 0,4
Femme au foyer 0 43,8 28,5 0 46,7 31,8 0 59,4 46,8
Rentier 0 0 0 0,4 0,1 0,2 0,1 0 0
Autres 5,3 14,2 11,1 6,5 11,9 10,2 22 18,2 19,1
Total 147836 275316 423152 128996 274856 403851 261825 967685 1229510
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Contrairement au niveau national, les mêmes tendances ne sont pas observées selon le milieu de
résidence. Si dans les zones rurales les femmes au foyer sont les plus inactives avec 46,8%, ce sont
les études qui prédominent l’inactivité dans le district de Bamako et dans les autres villes urbaines
avec respectivement 54,0% (dont 88,1% chez les hommes et 35,7% pour les femmes) et 49,9%
(83,8% pour les hommes et 33,9% pour les femmes).
3.3.2. Taux d'inactivité
Le taux d'inactivité désigne la proportion des personnes inactives dans l'ensemble de la population. Il
est en général calculé pour la seule population d'âge actif, soit 25 à 54 ans. Le taux d’inactivité est le
rapport entre le nombre d’inactifs âgés de 25 à 54 ans et le nombre total d’individus appartenant à ce
groupe. Ce taux concerne donc le groupe d’âge 25-54 ans où l’activité est la plus élevée étant donné
que les individus de ce groupe ont normalement achevé leurs études et n’ont pas encore atteint l’âge
de la retraite.
 |
30 30 |
▲back to top |
20
Tableau 19 : Taux d’inactivité selon les caractéristiques sociodémographiques (en %)
Taux d'inactivité
Homme Femme Total
Zone de résidence
Bamako 5,8 34,8 20,3
Autre urbain 4,3 38,0 21,9
Rural 2,7 26,6 16,3
Région
Kayes 2,0 14,9 9,4
Koulikoro 5,4 41,2 25,3
Sikasso 2,1 10,2 6,7
Ségou 3,2 33,7 20,5
Mopti 1,2 28,0 16,4
Tombouctou 2,9 42,8 24,1
Gao 5,7 63,8 39,3
Bamako 5,8 34,8 20,3
Groupe d'âge
25 - 29 ans 7,0 31,5 22,3
30 - 34 ans 2,7 27,0 16,0
35 - 39 ans 2,5 26,4 15,9
40 - 44 ans 1,5 28,2 15,5
45 - 49 ans 2,2 25,8 14,1
50 - 54 ans 4,0 35,1 20,1
Total 3,4 29,0 17,6
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Les résultats de l’enquête révèlent que le taux d’inactivité est de 17,6%. Cette inactivité est plus
accentuée dans les autres villes urbaines avec un taux d’inactivité de 21,9% contre 20,3% pour
Bamako et 16,3% pour les zones rurales. Le taux d’inactivité le plus élevé a été observé dans la région
de Gao avec 39,3%, suivi de Koulikoro (25,3%), de Tombouctou (24,1%). La région de Sikasso
occupe le bas du tableau avec 6,7% du taux d’inactivité.
L’inactivité touche surtout les tranches d’âge de 25-29 ans et de 50-54 ans. En effet, les taux
d’inactivité représentent respectivement 22,3% et 20,1%. La tranche d’âge 45-49 ans est la moins
touchée avec 14,1%.
Du point de vue genre, le taux d’inactivité des femmes est de 29,0% contre 3,4% pour les hommes.
Ceci montre que l’inactivité est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.
 |
31 31 |
▲back to top |
21
4. Profil et structure de l'emploi
Après avoir analysé la population active composée de chômeurs et actifs occupés, âgés de 15 à 64
ans, le présent chapitre analyse la structure des actifs occupés. Il fait ressortir le profil du taux
d’emploi et la structure de l’emploi suivant la zone géographique, le secteur d’activité économique,
le secteur institutionnel.
4.1. Profil du taux d’emploi
Le taux d'emploi désigne le rapport entre la population pourvue d'un emploi (actifs occupés) et la
population en âge de travailler (15 – 64 ans). Le taux d'emploi permet de savoir dans quelle mesure
la population participe à des activités productives sur le marché du travail. Plus le rapport est élevé,
plus la participation est forte.
Tableau 20 : Répartition (en %) du taux d'emploi par zone de résidence, région, groupe d'âge, niveau d'éducation et sexe.
Homme Femme Total
Zone de résidence
Bamako 65,7 47,1 56,1
Autre urbain 67,9 43,3 55,0
Rural 84,4 63,8 73,2
Région
Kayes 81,2 71,9 76,0
Koulikoro 72,4 48,3 59,4
Sikasso 79,8 71,0 75,0
Ségou 86,1 61,4 73,4
Mopti 90,3 66,1 77,4
Tombouctou 86,2 48,9 66,2
Gao 74,5 16,6 41,0
Bamako 65,7 47,1 56,1
Groupe d'âge
25 - 29 ans 84,6 60,3 69,5
30 - 34 ans 91,4 66,1 77,6
35 - 39 ans 93,1 68,0 79,1
40 - 44 ans 92,9 67,5 79,6
45 - 49 ans 90,0 70,0 79,9
50 - 54 ans 91,9 61,3 76,1
Niveau d'éducation
Aucun niveau 89,2 63,4 73,9
Maternelle 91,9 72,2 83,6
Fondamental 1 80,4 56,8 69,6
Fondamental 2 48,1 29,8 40,6
Secondaire 63,6 43,5 56,0
Supérieur 58,5 42,3 54,9
Total 79,3 58,8 68,3
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
L’intérêt de l’analyse de la répartition des taux d’emploi par sexe, par âge et par niveau d’éducation
dans le tableau ci-dessus réside dans le fait que ces trois caractéristiques jouent un rôle
 |
32 32 |
▲back to top |
22
particulièrement important dans le fonctionnement de l’économie, car l’âge, le niveau d’éducation et
le sexe sont les principaux arguments qui influent sur la division du travail. Avec l’avancement en
âge, les caractéristiques et les aptitudes à travailler de l’individu selon le sexe et le niveau d’éducation
se modifient. C’est important, pour une bonne élaboration d’outils de promotion de l’emploi,
d’identifier les groupes d’âge et par sexe, les lieux de résidence, les régions, les groupes par niveau
d’éducation, les groupes par catégories socioprofessionnelles.
D’après l’enquête EMOP 2014, le taux d’emploi au niveau national est d’environ 68,3%. Ce taux est
inférieur à celui de 2013 qui était de 73,9%1. Le taux d’emploi des hommes est de 79,3% et de 58,8%
pour les femmes.
Dans les zones urbaines autres que Bamako, le taux d’emploi est le plus faible, soit 55%. Le milieu
rural enregistre le taux le plus élevé (73,2%), mais qui est inférieur à celui de 2013 qui était de 80,1%2.
On observe aussi de fortes inégalités entre les taux d’emploi au niveau des régions. La région de Gao
enregistre le plus faible taux, soit 41%. Les autres régions ont un taux d’emploi plus élevé que
Bamako.
Le taux d’emploi est reparti suivant 6 groupes d’âges. Les deux groupes d’âges extrêmes, les jeunes
de 25 à 29 ans et les actifs de 50 à 54 ans, ont des taux d’emploi relativement faibles par rapport aux
autres groupes. Parmi ces deux groupes extrêmes, le groupe des jeunes a le plus faible taux d’emploi,
soit 69,5%.
Le taux d’emploi varie en fonction du niveau d’éducation. En effet, plus le niveau est élevé plus le
taux d’emploi est faible. Une relation négative se dégage entre le taux d’emploi et le niveau
d’éducation. On constate aussi que ceux qui ont le niveau du fondamental 2, pour les hommes aussi
bien que pour les femmes, ont le taux d’emploi le plus faible de la population. Le taux d’emploi des
hommes (48,1%) reste toujours plus élevé que celui des femmes (29,8%).
4.2. Structure de l'emploi
Le milieu rural renferme la plus grande part des emplois, soit 77,4% (tableau 9). La proportion
d’emploi à Bamako qui est de 11,8%, est supérieure à celle enregistrée dans les autres villes urbaines.
La répartition des 5 494 274 actifs occupés montre que 44% sont des femmes et 56% des hommes.
L’écart entre la proportion d’emploi des hommes et celle des femmes au niveau des régions et du
District de Bamako est faible sauf à Gao (53 points de pourcentage) et Tombouctou (21 points de
Pourcentage). On constate aussi que les régions du nord ont les plus faibles proportions d’emplois
dans l’emploi total.
1 EMOP2013
2 EPAM 2013/DOEF/ANPE
 |
33 33 |
▲back to top |
23
Le secteur primaire qui regroupe les activités comme l’agriculture, l’élevage, la foresterie et la pêche
emploie 66,7% des actifs occupés. C’est le principal secteur pourvoyeur d’emplois, suivi du
Commerce avec 14% des emplois. Le service et l’industrie offrent peu d’opportunités d’emploi au
Mali. Au niveau du secteur institutionnel, c’est le secteur privé informel qui vient en tête avec plus
70% de part dans l’emploi total. Le nombre d’emplois de ces entreprises et celui des employés de
maison dans les zones rurales sont largement supérieurs aux nombres d’emplois des mêmes secteurs
institutionnels à Bamako et dans les autres villes urbaines.
Tableau 21 : Répartition des emplois suivant le sexe de l'occupant et la zone de résidence
Homme Femme Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Zone de
résidence
Bamako 365 209 12,3 282 627 11,1 647 836 11,8
Autre urbain 349 747 11,8 244 706 9,6 594 453 10,8
Rural 2 242 538 75,8 2 009 447 79,2 4 251 985 77,4
REGION
Kayes 379 046 12,8 426 328 16,8 805 374 14,7
Koulikoro 441 657 14,9 345 391 13,6 787 049 14,3
Sikasso 527 305 17,8 557 573 22,0 1 084 877 19,7
Ségou 548 586 18,5 417 088 16,4 965 674 17,6
Mopti 457 846 15,5 382 465 15,1 840 311 15,3
Tombouctou 149 960 5,1 98 370 3,9 248 331 4,5
Gao 87 885 3,0 26 937 1,1 114 822 2,1
Bamako 365 209 12,3 282 627 11,1 647 836 11,8
secteur d'activité
économique
Agriculture, élevage, forêt,
pêche
1 976 293 66,8 1 690 948 66,7 3 667 241 66,7
Industrie 271 198 9,2 165 716 6,5 436 913 8,0
Commerce 312 434 10,6 494 599 19,5 807 034 14,7
Services 397 570 13,4 185 516 7,3 583 086 10,6
Secteur
institutionnel
Secteur public 116 207 3,9 35 593 1,4 151 800 2,8
Entreprise privée formelle 60 790 2,1 11 696 0,5 72 486 1,3
Entreprise privée informelle 1 985 196 67,1 1 900 841 74,9 3 886 037 70,7
ONG, Organisations
internationales, association
56 228 1,9 14 354 0,6 70 582 1,3
Employés de maison 739 074 25,0 574 294 22,6 1 313 369 23,9
Total 2 957 495 100,0 2 536 780 100,0 5 494 274 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
L’écart entre la proportion d’emplois des femmes et celle des hommes au niveau du secteur
institutionnel est très faible. Cependant, le nombre d’emploi des hommes dans ces secteurs reste
toujours supérieur à celui des femmes.
4.3. Taux de salarisation selon les caractéristiques sociodémographiques.
La répartition du taux de salarisation selon les caractéristiques sociodémographiques montre de fortes
inégalités en fonction du lieu de résidence, du sexe, de l’âge, du niveau d’éducation.
Globalement, le taux de salarisation est très faible au Mali (9,0% en 2014). Autrement dit, moins de
1/10 de la population active est salarié. C’est dans la zone rurale que ce taux est très faible, soit 3,2%.
La capitale Bamako enregistre le taux le plus élevé (34,8%).
Quelle que soit la zone de résidence, on enregistre un taux de salarisation plus important chez les
hommes que chez les femmes et particulièrement dans les villes urbaines et la capitale Bamako.
 |
34 34 |
▲back to top |
24
Tableau 22 : Taux de salarisation selon les caractéristiques sociodémographiques (en %).
Taux de salarisation %
Homme Femme Total
Zone de résidence
Bamako 43,6 23,4 34,8
Autre urbain 29,5 10,6 21,7
Rural 4,9 1,4 3,2
Région
Kayes 10,8 1,5 5,9
Koulikoro 11,3 3,7 8,0
Sikasso 9,2 2,9 5,9
Ségou 5,3 2,1 3,9
Mopti 2,5 0,6 1,6
Tombouctou 7,0 1,2 4,7
Gao 26,4 21,9 25,4
Bamako 43,6 23,4 34,8
Classe d'âge de travail
15 - 24 ans 7,9 6,8 7,4
25 - 35 ans 15,5 4,5 9,9
36 - 40 ans 17,4 2,5 10,5
41 - 64 ans 12,2 3,8 8,8
Niveau d'éducation
Aucun niveau 4,8 1,9 3,3
Maternelle 5,3 8,1 6,3
Fondamental 1 12,2 4,4 9,3
Fondamental 2 26,6 18,1 24,0
Secondaire 74,3 71,2 73,4
Supérieur 80,3 73,2 79,1
Total 12,6 4,7 9,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
L’écart du taux de salarisation entre hommes et femmes est faible dans les zones rurales. Dans la
région de Mopti, le taux de salarisation des femmes est de 0,6% ; bien qu’elle fait partie des régions
où le taux d’emploi est très élevés.
Le taux de salarisation étant reparti en 4 groupes d’âges, les deux groupes d’âges extrêmes, les jeunes
de 15 à 24 ans et les actifs de 41 à 64 ans, ont des taux de salarisation relativement faibles par rapport
aux autres groupes. Parmi ces deux extrêmes, le groupe des jeunes est le moins salarié avec 7,4%. Le
groupe d’âge de 36 à 40 ans est le plus salarié avec 10,5%.
On constate que le taux de salarisation augmente en fonction du niveau d’éducation. En effet, plus le
niveau d’éducation est élevé plus le taux de salarisation est fort. Cette tendance est contraire à celle
du taux d’emploi.
 |
35 35 |
▲back to top |
25
Ce qui montre une forte corrélation entre le taux de salarisation et le niveau d’éducation et cela est
valable aussi pour les hommes que pour les femmes, mais le taux de salarisation des hommes est
supérieur à celui des femmes sauf pour le niveau maternel.
4.4. Nature de l'emploi
Suivant la nature du travail d’activité principale, le « Travail à la journée » (3,8%) et le « Travail à la
tâche » (5,2%) ont les plus faibles taux d’emploi.
Tableau 23 : Répartition du taux d’emploi suivant la nature du travail d'activité principale, le sexe, la zone de résidence, la région, la
classe d’âge et le niveau d’éducation.
Nature du travail d'activité principale
Travail régulier
%
Travail à la
journée %
Travail à la
tâche %
Travail
saisonnier %
Total %
Sexe de l'individu
Homme 59,0 45,9 61,8 48,9 53,8
Femme 41,0 54,1 38,2 51,1 46,2
Zone de résidence
Bamako 19,0 40,6 30,4 1,1 11,8
Autre urbain 16,6 17,1 17,2 4,4 10,8
Rural 64,4 42,3 52,4 94,5 77,4
Classe d'âge de travail
15 - 24 ans 24,8 25,7 24,8 29,8 27,2
25 - 35 ans 31,0 36,3 31,1 30,4 30,9
36 - 40 ans 12,3 11,3 13,9 11,3 11,9
41 - 64 ans 31,9 26,7 30,2 28,5 30,0
Niveau d'éducation
Aucun niveau 65,8 66,7 68,1 82,5 74,0
Maternelle 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1
Fondamental 1 15,4 16,7 15,7 12,8 14,2
Fondamental 2 9,5 12,9 12,6 3,8 7,1
Secondaire 6,3 3,1 2,2 0,6 3,2
Supérieur 2,9 0,5 1,2 0,2 1,4
Total 2 362 602 207 247 285 906 2 638 519 5 494 274
43,0 3,8 5,2 48,0 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Par contre, 43% des actifs occupés exercent régulièrement leur travail et 48% travail comme
saisonnier. Les deux types de travail occupent 91% des actifs occupés. Le travail régulier est plus
fréquent dans les régions de Ségou, Mopti et dans le district de Bamako comparativement aux régions
de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti où le travail saisonnier est plus fréquent.
La capitale Bamako enregistre plus de travailleurs à la journée et à la tâche qu’ailleurs. La zone rurale
enregistre 94% des travailleurs saisonniers. Ce type de travail est presque inexistant à Bamako et dans
les autres zones urbaines.
 |
36 36 |
▲back to top |
26
5. La pluriactivité
Au Mali, les 6 ans et plus représentent 75% de la population totale, soit 12,97 millions sur les 17,23
millions d’habitants. Sur ces 12,97 millions, 1,52 millions de personnes exercent au moins une
activité secondaire, soit 12% des travailleurs.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la multiplicité des activités professionnelles. Pour certains, il
s'agit de compenser la faiblesse du revenu d'activités principales (sur le plan conjoncturel), de
diminuer les inégalités de revenu global qui restent moins fortes que les inégalités de revenu d'activité
principale et pour d'autres de contribuer directement ou indirectement au financement de
l'exploitation et par conséquent à son développement ou à sa survie. Aussi, permet-elle de réduire la
dispersion des revenus globaux entre les ménages, permettant aux foyers pluriactifs de disposer de
revenus globaux plus élevés. Il s'agit pour les hyperactifs, soit de contourner les "imperfections du
marché du travail, soit d'une préférence plus forte de certains pour le travail indépendant agricole
relativement au travail hors de l'exploitation, souvent effectué à titre salarié" (Butault et al. 1999). En
tout cas, elle agit sur la situation financière des travailleurs, surtout des exploitants agricoles, par
l'accroissement de leur capacité d'épargne et d'autofinancement et par la facilitation de l'accès au
marché du crédit.
5.1. Principaux déterminants de la pluriactivité
Au Mali, près de 12% de la population des 6 ans et plus exercent au moins une activité secondaire
avec respectivement 11% pour ceux qui exercent une seule activité et seulement 1% pour ceux
exerçant plus d'une activité secondaire (Tableau 24). De même, les chefs de ménage exerçant
plusieurs activités représentent 23% de l'ensemble des chefs de ménage, avec une plus forte
proportion pour ceux de la classe d'âge 36-40 ans et des 41-64 ans pour près d'un quart des chefs de
ménages. Au total, le conjoint et autre membre du ménage se retrouvent respectivement à 18% de
l'ensemble de leur catégorie.
La pluriactivité semble l'apanage du milieu rural comparativement à Bamako. Ainsi, les travailleurs
pluriactifs ruraux représentent 15% de l'ensemble des travailleurs contre 1% seulement pour Bamako.
Que ce soit les hommes ou les femmes, la pluriactivité représente un peu plus de 10% de leur
catégorie. Elle se rencontre plus facilement dans les classes de pauvre et de la classe moyenne
(inférieure ou supérieure). Très peu de riches exercent une autre activité en dehors de l'activité
principale, seulement 5%.
Enfin, il est loisible de constater que la pluriactivité se retrouve prioritairement chez les non éduqués,
la pluriactivité étant inversement corrélée au niveau d'éducation. Autrement dit, plus l'on est éduqué,
moins l'on a recours à la pluriactivité. On serait tenté d'inférer que les personnes de haut niveau
d'éducation disposeraient de suffisamment de revenus pour ne pas recourir à la pluriactivité pour
compenser la faiblesse du revenu d'activités principales.
 |
37 37 |
▲back to top |
27
Tableau 24 : Taux d'activité secondaire (en %)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Chef de ménage - 21 24 25 26 10 23
Conjoint(e) 0 11 17 22 20 8 18
Enfant 2 8 17 22 26 0 6
Autre parent 2 11 19 26 15 3 9
Autre membre 1 14 42 49 27 0 18
Bamako 0 0 2 1 2 0 1
Autre urbain 0 4 8 9 12 3 5
Rural 3 13 24 30 27 9 15
Homme 2 8 20 25 26 10 12
Femme 2 11 18 23 18 4 11
D1 2 6 11 16 10 1 6
D2 4 11 20 33 24 5 14
D3 2 9 26 32 31 6 14
D4 2 14 27 31 26 10 15
D5 1 15 21 31 32 7 15
D6 2 12 26 34 29 10 15
D7 2 13 26 23 28 9 15
D8 1 10 18 23 24 14 12
D9 1 6 13 11 15 8 8
D10 1 4 7 6 9 7 5
Aucun niveau 3 13 22 25 24 8 16
Maternelle 0 12 0 43 26 0 1
Fondamental 1 1 11 18 25 23 8 7
Fondamental 2 2 4 9 13 10 0 5
Secondaire 0 2 3 7 10 0 4
Supérieur 0 4 2 5 4 3
Total 2 10 19 24 22 8 12
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Au regard de la répartition des travailleurs pluriactifs comparativement à la population totale des 6
ans et plus, les "aucun niveau d'éducation" semblent surreprésentés dans la cohorte des travailleurs
pluriactifs avec une proportion de 81% contre 61%, soit une différence de 20 points de pourcentage.
Cette catégorie est suivie des ruraux, des chefs de ménage et de leurs conjoint(e)s. Ainsi, les ruraux
représentent effectivement 94% des travailleurs avec une activité secondaire contre 74% des
travailleurs ruraux et cela est constaté dans toutes les classes d'âge. Dans la même lancée, quoique
avec une différence relativement faible, les proportions de chefs de ménage et de conjoints
représentent le double de la proportion des travailleurs des 6 ans et plus (30% contre 15% pour la
première catégorie, 28% contre 18% pour la seconde). Pour le premier cas, la différence s'expliquerait
par une plus grande propension des chefs de ménage de 41 ans et plus à exercer des activités
secondaires. Pour le second cas, la différence quoique faible est observée dans toutes les classes d'âge
à commencer par celle des 15-24 ans. A l'opposé, les enfants pluriactifs représentent la moitié des
enfants de la population des 6 ans et plus, avec 38% contre 19%. Cela résulterait essentiellement des
différences constatées au niveau des jeunes de 15 à 35 ans. Cette catégorie est suivie respectivement
par la ville de Bamako, les travailleurs du fondamental 1 et autres urbains avec 1% contre 13% pour
la première, 14% contre 25% pour la deuxième et 6% contre 13% pour la troisième. Quelle que soit
la catégorie, l'on constate que peu de bamakois s'adonnent à la pluriactivité. A l'inverse, la situation
des travailleurs trouve son explication dans la surreprésentation des enfants de 6-14 ans
comparativement aux enfants exerçant des activités secondaires, avec 48% contre 30%. Enfin, les
travailleurs de "autre urbain" suivent la même tendance que Bamako (Tableau 25).
 |
38 38 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
28
Tableau 25 : Répartition activités secondaires versus répartition de la population (en %)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
%pop %second %pop %second %pop %second %pop %second %pop %second %pop %second %pop %second
Chef de ménage 0 0 1 2 14 18 31 33 48 55 58 77 15 30
Conjoint(e) 0 0 12 14 36 33 43 40 35 32 12 12 18 28
Enfant 69 74 49 42 20 18 10 9 3 4 0 0 38 19
Autre parent 30 26 35 38 28 28 15 17 14 9 31 11 27 22
Autre membre 1 0 3 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 2
Bamako 11 0 16 1 15 1 13 1 12 1 10 1 13 1
Autre urbain 12 1 15 6 13 5 12 5 12 7 11 5 13 6
Rural 77 99 69 93 72 93 75 95 76 92 80 95 74 94
Homme 52 49 48 41 41 43 45 47 50 59 57 78 49 50
Femme 48 51 52 59 59 57 55 53 50 41 43 22 51 50
D1 11 9 9 5 9 5 9 6 9 4 12 2 10 5
D2 10 22 9 10 9 10 10 13 9 10 12 7 10 11
D3 10 11 8 7 9 12 10 14 9 12 9 7 9 11
D4 11 12 9 12 10 13 10 13 10 12 11 14 10 13
D5 11 8 10 15 9 10 9 11 10 14 9 8 10 12
D6 10 10 10 11 11 15 10 14 9 12 9 13 10 13
D7 10 12 10 14 10 13 10 10 10 13 10 13 10 13
D8 10 7 11 12 10 10 10 10 10 11 9 17 10 10
D9 9 5 11 7 11 7 12 5 11 7 10 10 10 7
D10 8 5 14 6 13 5 10 3 13 5 11 10 11 5
Aucun niveau 42 66 50 67 74 84 80 85 81 86 93 95 61 81
Maternelle 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Fondamental 1 48 30 20 22 12 11 11 11 10 11 4 4 25 14
Fondamental 2 3 3 25 10 6 3 4 2 5 2 1 0 8 4
Secondaire 0 0 4 1 5 1 3 1 3 1 2 0 3 1
Supérieur 0 0 1 0 3 1 1 0 2 0 1 1 1 0
Total 4 304 958 84 551 2 729 047 265 748 2 304 665 438 231 827 059 195 725 2 182 327 488 520 622 940 46 740 12 970 996 1 519 515
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
39 39 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
29
Au Mali, la tendance dominante du marché du travail demeure l'exercice d'une seule activité
professionnelle. Les plus nombreux pluriactifs se rencontrent parmi les chefs de ménage, les
conjoints, les «autres membres", dans le milieu rural, dans les déciles 3 à 7 (à savoir une bonne
partie des pauvres – déciles 3 et ', et la couche inférieure de la classe moyenne – déciles 5 à 7)
et dans la catégorie des analphabètes. Pour les chefs de ménage, plus d'un cinquième de cette
catégorie exerce au moins une activité secondaire, soit 22% avec 21% de personnes faisant une
seule activité et 1% travaillant sur plus de 2 activités. Avec 18% de travailleurs pluriactifs, les
conjoints viennent en deuxième position loin derrière les chefs de ménage. Ici, l'on constate une
plus grande propension des conjoints de 36-40 ans à exercer plusieurs activités, avec un taux
de 24% de pluriactivité. Par milieu de résidence, le plus grand nombre de pluriactifs se retrouve
dans le milieu rural avec 15%. Cela pourrait s'expliquer par le caractère saisonnier de
l'agriculture qui n'occupe les exploitants agricoles que quelques mois de l'année. Ici, les jeunes
de 15-24 ans sont les plus nombreux. Enfin, les sans niveau instruction comparativement aux
autres sont plus enclins à la pluriactivité et la classe d'âge 36-40 ans détient la palme de la
catégorie (Tableau 26).
 |
40 40 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
30
Tableau 26 : Nombre d'activités secondaires par tranche d’âge (en %)
Tranche d’âge 6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Nombre
d’activités
0 1 2-3 0 1 2-3 0 1 2-3 0 1 2-3 0 1 2-3 0 1 2-3 0 1 2-3
Chef de ménage 79 21 0 76 23 1 75 23 2 74 24 1 90 10 0 77 21 1
Conjoint(e) 100 0 0 89 11 0 83 16 1 78 20 2 80 19 2 92 8 0 82 17 1
Enfant 98 2 0 92 8 0 83 16 1 78 22 0 74 25 1 100 0 0 94 6 0
Autre parent 98 2 0 89 10 0 81 18 1 74 26 0 85 14 1 97 3 0 91 9 0
Autre membre 99 1 0 86 13 2 58 34 8 51 29 20 73 21 6 100 0 0 82 15 3
Bamako 100 0 0 100 0 0 98 2 0 99 1 0 98 2 0 100 0 0 99 1 0
Autre urbain 100 0 0 96 4 0 92 8 0 91 9 1 88 12 1 97 3 0 95 5 0
Rural 97 2 0 87 13 0 76 23 1 70 28 2 73 26 2 91 9 0 85 14 1
Homme 98 2 0 92 8 0 80 19 1 75 24 1 74 25 1 90 10 0 88 12 0
Femme 98 2 0 89 10 1 82 17 1 77 21 2 82 17 1 96 4 0 89 11 1
D1 98 2 0 94 5 0 89 11 0 84 14 1 90 10 0 99 1 0 94 6 0
D2 96 4 0 89 11 0 80 20 0 67 31 2 76 22 2 95 5 0 86 13 1
D3 98 2 0 91 8 1 74 24 3 68 29 3 69 31 1 94 6 0 86 14 1
D4 98 2 0 86 13 0 73 25 2 69 27 5 74 24 2 90 10 0 85 14 1
D5 99 1 0 85 14 1 79 19 2 69 30 1 68 29 3 93 7 0 85 14 1
D6 98 2 0 88 11 0 74 25 1 66 32 2 71 27 1 90 10 0 85 14 1
D7 98 2 0 87 13 0 74 25 1 77 21 2 72 25 3 91 9 0 85 14 1
D8 99 1 0 90 10 1 82 17 2 77 22 1 76 23 1 86 14 0 88 11 1
D9 99 1 0 94 6 0 87 12 0 89 11 0 85 15 0 92 8 0 92 8 0
D10 99 1 0 96 4 0 93 7 0 94 6 0 91 9 0 93 7 0 95 5 0
Aucun niveau 97 3 0 87 13 0 78 20 1 75 23 2 76 22 1 92 8 0 84 15 1
Maternelle 100 0 0 88 12 0 100 0 0 57 43 0 74 26 0 100 0 0 99 1 0
Fondamental 1 99 1 0 89 10 0 82 17 1 75 23 2 77 21 2 92 8 0 93 6 0
Fondamental 2 98 2 0 96 4 0 91 9 0 87 12 1 90 10 0 100 0 0 95 5 0
Secondaire 100 0 0 98 2 0 97 3 0 93 7 0 90 9 0 100 0 0 96 4 0
Supérieur 100 0 0 96 4 0 98 2 0 95 5 0 96 4 0 97 3 0
Total 98 2 0 90 10 0 81 18 1 76 22 2 78 21 1 92 8 0 88 11 1
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
41 41 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
31
5.2. Durée hebdomadaire comparée des activités principale et secondaire
La durée hebdomadaire moyenne de travail concerne une semaine de travail "normale" sans
évènement exceptionnel (jour férié, congé, etc.). Elle inclut de ce fait toutes les heures
habituellement effectuées y compris les heures supplémentaires régulières, rémunérées ou non.
Au Mali, le Code du travail fixe la durée légale du temps de travail à 40 heures par semaine
dans les entreprises (article L.131) et à 48 heures par semaine au maximum dans les
exploitations agricoles (article L.138). Dans la réalité, les actifs occupés travaillent en moyenne
42 heures hebdomadaires pour les "mono-actifs" et 62 heures hebdomadaires pour les
pluriactifs dont 41 heures pour l'activité principale et 21 heures pour les activités secondaires
(Tableau 27).
Les volumes horaires hebdomadaires au Mali pour l'activité principale varient entre 48 heures
(maximum enregistré à Bamako) et 36 heures (minimum chez les femmes). Pour les pluriactifs,
ce volume horaire hebdomadaire varie entre 52 heures toujours pour la ville de Bamako et 31
heures pour la catégorie des cadres supérieurs. Enfin, il faut noter que la durée de travail
secondaire va de 19 heures hebdomadaires pour les pauvres à 24 heures hebdomadaires chez
les cadres de niveau secondaire, les "autre urbain" et la classe moyenne supérieure (déciles 8 et
9). La ville de Bamako est caractérisée par une plus grande propension des jeunes à exercer
plusieurs activités et au-delà des heures légales de travail, surtout les jeunes (15-24 ans et 25-
35 ans). Il faut noter que les hommes travaillent en moyenne plus d'heures que les femmes, 47
heures contre 36 heures pour les "mono-actifs" et 70 heures contre 55 heures pour les pluriactifs.
Evidemment, cette comparaison ne prend pas en compte les activités domestiques qui, comme
on le sait, sont principalement exercées par les femmes.
L'analyse par décile montre que les riches et la classe moyenne supérieure travaillent plus de
temps que les autres classes sociales et ce quel que soit le type de travail. Par niveau d'éducation,
les cadres supérieurs travailleraient plus que les autres catégories quel que soit le type d'activité
exercée. Ainsi, les "mono-actifs" feraient 44 heures hebdomadaires en moyenne contre plus de
51 heures hebdomadaires pour les pluriactifs. Dans cette catégorie, les personnes âgées (64 ans
et plus) font plus de temps de travail que les autres. Cette tranche d'âge est suivie par les jeunes
de 15-40 ans.
.
 |
42 42 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
32
Tableau 27 : Durée hebdomadaire moyenne avec ou sans activité secondaire (heures/semaine)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
sans avec sans avec sans avec sans avec sans avec sans avec
Princ. Princ. Sec. Princ. Princ. Sec. Princ. Princ. Sec. Princ. Princ. Sec. Princ. Princ. Sec. Princ. Princ. Sec.
Bamako 51 62 15 45 57 9 47 55 13 48 41 27 41 42 20 48 52 16
Autre urbain 40 39 26 43 42 25 45 39 22 44 43 23 41 44 20 42 42 24
Rural 43 39 21 43 41 22 44 41 21 44 43 21 40 43 19 41 41 21
Homme 48 45 24 50 48 25 52 48 22 50 48 21 44 45 19 47 47 23
Femme 38 35 19 36 36 19 36 35 20 37 36 20 32 36 18 36 36 20
D1 43 40 17 41 36 19 44 43 17 44 43 22 42 40 20 42 40 19
D2 41 41 18 41 40 18 40 43 21 41 42 21 38 37 24 40 41 20
D3 42 38 20 42 39 19 44 41 18 44 43 19 39 38 16 40 41 19
D4 42 41 20 41 39 19 43 39 24 44 44 20 31 42 14 41 41 20
D5 41 39 21 42 41 22 44 38 24 44 43 19 38 39 17 41 41 21
D6 42 37 20 45 42 24 44 43 21 44 42 23 38 45 19 41 41 23
D7 42 36 23 42 40 22 45 41 20 46 43 20 43 48 15 42 41 21
D8 47 40 26 43 44 23 46 42 22 47 43 22 44 51 24 44 43 23
D9 45 41 25 44 46 26 46 42 27 46 44 23 46 38 20 45 43 24
D10 49 44 21 46 45 28 49 38 22 45 45 21 44 41 18 46 44 22
Aucun niveau 44 39 21 43 41 22 45 41 21 44 43 21 40 43 19 43 41 21
Maternelle 44 39 35 43 . 46 24 3 49 31 18 . . 32 32 25
Fondamental 1 43 40 23 43 41 23 46 44 24 46 46 22 41 42 24 41 42 22
Fondamental 2 41 39 20 45 40 22 45 39 24 46 44 23 36 . 44 39 22
Secondaire 41 48 20 41 37 29 40 36 21 43 41 24 42 . 42 40 24
Supérieur 40 72 26 43 24 19 45 35 20 44 35 24 66 40 5 44 31 20
Total 43 39 21 43 41 22 45 41 21 45 43 21 40 43 19 42 41 21
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
43 43 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
33
5.3. Activité principale et pluriactivité
Les résultats de l'EMOP (2014) permettent d'estimer le taux de pluriactivité et la proportion
d'actif avec contrat. Pour ce faire, l'on a procédé au croisement de l'exercice d'une activité
secondaire avec certaines caractéristiques de l'emploi telles que la catégorie
socioprofessionnelle, le statut salarial (indépendant ou salarié, avec les différents degrés
associés), le type d'entreprise et le secteur d'activité. Ainsi, au Mali, près d'un travailleur sur
quatre, 23% exactement, exerce une activité secondaire.
L'analyse par CSP principale montre que les travailleurs indépendants et les aides familiaux ont
plus recours aux activités secondaires comparativement aux autres CSP. Pour la première
catégorie, l'on remarque que les indépendants âgés de 36 à 40 ans sont plus d'un tiers à s'adonner
à des activités secondaires et les plus faibles taux étant observés auprès des enfants de 6-14 ans,
heureusement serait-on tenté de dire car à cet âge c'est déjà du travail des enfants et si en plus
ces enfants travailleurs devaient être astreints à des activités secondaires, cela serait un fait
aggravant. Au niveau des aides familiaux, l'on constate une forte propension des classes d'âge
25-35 ans et 36-40 ans à se consacrer à des activités secondaires, respectivement 36% et 43%.
Ces deux catégories sont suivies par ordre d'importance par les employeurs, les manœuvres et
les cadres moyens, soit 15% pour les premiers, 13% pour les seconds et 10% pour les troisièmes.
Aussi, les employeurs jeunes (15-24 ans et 25-35 ans) connaissent des taux de pluriactivité
respectifs de 23% et 28%. De l'autre côté, on observe que seulement 2% des cadres supérieurs
s'adonnent à des activités secondaires.
Par statut salarial, les indépendants agricoles consacrent plus du tiers de leur temps aux activités
secondaires, surtout les adultes de 25 à 40 ans. Bien que peu nombreux, les personnes âgées
(plus de 64 ans) consacrent un quart de leur temps de travail aux activités secondaires. L'analyse
du taux d'activité par entreprise montre que les personnels de maison, les entreprises privées
ont le plus recours au travail secondaire avec respectivement 24% et 23%. Loin derrière, ces
deux catégories, l'on retrouve des travailleurs des entreprises publiques avec un taux d'activité
secondaire de 12%. Les travailleurs du secteur agricole, au vu des résultats d'enquête, semblent
les plus enclins à exercer des activités secondaires avec un taux de 29%. Ici aussi, les adultes
jouent un grand rôle dans cet état de fait (36% pour la classe 25-35 ans et 43% pour la classe
36-40 ans). Les travailleurs de l'industrie et du secteur non marchand viennent compléter ce trio
de tête en matière de recours aux activités secondaires (Tableau 28).
 |
44 44 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
34
Tableau 28 : Taux d'activité secondaire selon les caractéristiques de l'activité principale (en %)
6 - 14 ans 15 - 24
ans
25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64
ans
Total
Cadre supérieur 0 0 0 4 0 2
Cadre moyen 7 8 10 11 26 10
Employé / ouvrier 1 5 2 5 6 24 4
Manœuvre 0 4 26 19 15 64 13
Employeur 23 28 11 11 0 15
Indépendant 4 15 22 29 30 19 25
Apprenti 0 0 7 0 0 1
Aide familial 9 21 36 43 42 32 24
Indépendant agricole 9 22 36 43 41 25 29
Indépendant non agricole 3 7 8 9 11 9 9
Salarié privé 1 4 8 7 7 26 6
Salarié public 10 7 12 11 58 10
Administration publique 9 7 13 9 41 9
Entreprise publique 6 8 16 16 12
Entreprise privée 8 16 24 29 29 20 23
Entreprise associative/ONG 0 2 6 8 15 32 7
Organisme international 0 0 0 0
Personnel de maison 9 21 35 37 37 15 24
Agriculture 9 22 36 43 40 25 29
Industrie 3 8 11 10 13 15 10
Service marchand 2 6 6 8 9 7 7
Service non marchand 5 5 9 10 13 15 9
Total 8 18 26 30 30 20 23
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Le tableau 29 permet de comparer le poids de chaque catégorie de travailleurs aussi bien en
activités principales qu'en activités secondaires. Ainsi, les indépendants agricoles représentent
64% des actifs principaux et 89% des actifs secondaires, soit une surreprésentation de cette
catégorie de travailleurs dans la pluriactivité. Il en est de même pour l'ensemble des travailleurs
du secteur agricole (dans les mêmes proportions de 64% et 89%). A l'opposé, les indépendant
non agricoles, les salariés (privés comme publics) ont chacun un poids moindre dans la
pluriactivité comparativement à leurs poids respectifs dans les activités principales. Par type
d'entreprise, il ne se dégage aucune catégorie franchement plus pluriactive que son poids dans
la répartition de l'activité principale, si ce n'est pour le personnel de maison en ce qui concerne
les 15-24 ans. A cause de la prépondérance du secteur agricole dans la pluriactivité, les services
marchands qui absorbent pourtant 20% des actifs principaux ne constituent que 5% des
pluriactifs.
 |
45 45 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
35
Tableau 29 : Répartition activités secondaires versus répartition de la population selon l'activité principale (en %)
15 - 24 ans 36 - 40 ans plus de 64 ans Total
%princ %second %princ %second %princ %second %princ %second
Cadre supérieur 0 0 1 0 0 0 0 0
Cadre moyen 0 0 3 1 1 1 2 1
Employé / ouvrier 5 1 8 1 2 3 5 1
Manœuvre 3 1 2 1 0 1 2 1
Employeur 0 0 1 0 1 0 1 0
Indépendant 29 24 64 60 90 85 47 52
Apprenti 2 0 0 0 0 0 1 0
Aide familial 60 74 21 36 6 11 43 45
Indépendant agricole 70 91 49 88 62 81 64 89
Indépendant non agricole 22 7 37 9 35 14 27 9
Salarié privé 8 2 9 1 3 4 7 2
Salarié public 1 0 5 1 0 1 3 1
Administration publique 0 0 4 1 0 1 2 1
Entreprise publique 0 0 1 0 0 0 1 0
Entreprise privée 63 56 76 74 84 87 69 70
Entreprise associative/ONG 2 0 1 0 1 2 2 0
Organisme international 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel de maison 35 43 18 24 15 10 27 29
Agriculture 71 91 50 89 62 82 64 89
Industrie 8 3 12 3 10 7 8 3
Service marchand 14 4 29 6 22 6 20 5
Service non marchand 7 1 9 2 7 5 8 3
Total (effectif) 1 228 955 265 748 457 102 195 725 188 493 46 740 5 209 595 1 519 515
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
5.4. Caractéristiques de l'activité secondaire
Les caractéristiques de l'activité secondaire peuvent être analysées par CSP, par type d'emploi,
par type d'entreprise et par secteur d'activité. Au Mali, la majorité des travailleurs se retrouve
dans la classe d'âge 41-64 ans avec 32%, les 25-35 ans avec 29% et les 15-24 ans avec 17%
(Tableau 30). Parmi les 41-64 ans, l'on observe que 90% sont des indépendants, les autres CSP
se partageant les 10% restants avec un plus grand score pour les aides familiaux avec 7%. Par
statut salarial, la domination des indépendants est effective avec 97% au total, pour 63%
d'indépendants agricoles et 34% d'indépendant non agricoles. Ce qui fait que les salariés ne
représenteraient au Mali que 3% de la population active, à raison de 6% des 15-24 ans et 4%
des 25-35 ans. Le salariat est numériquement dominé par le secteur privé. Aussi, les entreprises
privées absorbent 85% des actifs occupés au Mali, avec près de 90% des 25-64 ans (Tableau
30).
Le travail des enfants (6-14 ans) est prépondérant dans le secteur agricole (86%) et donc parmi
les indépendants agricoles comme statut salarial, dans la catégorie professionnelle des aides
familiaux. Par type d'entreprise, ce phénomène demeure courant dans les sociétés privées et
parmi le personnel de maison.
 |
46 46 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
36
Tableau 30 : Taux des catégories d'activité secondaire selon l'âge (en % et effectif)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Cadre supérieur 0 0 0 0 0 0 0
Cadre moyen 0 0 0 0 0 0 0
Employé / ouvrier 1 2 1 2 1 0 1
Manœuvre 0 4 3 1 1 0 2
Employeur 0 0 0 0 0 1 0
Indépendant 6 56 80 84 90 96 76
Apprenti 0 1 0 0 0 0 0
Aide familial 92 36 16 13 7 3 20
Indépendant agricole 86 64 61 59 61 68 63
Indépendant non agricole 13 30 36 38 37 32 34
Salarié privé 1 6 4 3 2 0 3
Salarié public 0 0 0 0 0 0 0
Administration publique 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise publique 0 0 0 0 0 0 0
Entreprise privée 55 73 87 93 91 83 85
Entreprise associative/ONG 0 2 2 1 1 1 2
Organisme international 0 0 0 0 0 0 0
Personnel de maison 45 25 11 5 7 16 13
Agriculture 86 65 61 60 62 68 63
Industrie 6 17 18 16 17 9 16
Service marchand 7 15 18 21 17 16 17
Service non marchand 0 4 3 3 4 6 3
Total (effectif) 84 551 265 748 438 231 195 725 488 520 46 740 1 519 515
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Il est possible, selon les données disponibles, de répartir les 1.5 millions de travailleurs
secondaires par CSP. Ce faisant, l'on constate que les indépendants sont au nombre de 1,15
millions, soit 76% de l'effectif total. Sur ce total, les classes d'âge 41-64 ans, et 25-35 ans
arrivent en tête avec respectivement 38% et 30%. Les classes d'âge 36-40 ans et 15-24 ans sont
presque à égalité à 14%. Les aides familiaux avec un effectif de 304 000 personnes occupent la
deuxième place après les indépendants. La majorité des aides familiaux se rencontrent dans les
classes d'âge jeunes des 15-24 ans et 6-14 ans.
A la suite des CSP, le statut salarial est également dominé par les indépendants agricoles avec
63%, les indépendants non agricoles avec 34%. Les entreprises privées et le personnel de
maison sont presque les seuls pourvoyeurs de travailleurs secondaires avec 85% pour le premier
et 20% pour le second. Il est possible de scinder les travailleurs secondaires entre les secteurs
d'activité. En le faisant, l'on observe que 63% viennent du secteur agricole, qui lui aussi est
dominé par les classes d'âge 41-64 ans et 25-35 ans avec 31% et 28%. La plus faible proportion
est observée auprès du service non marchand avec seulement 3%. Plus globalement, les classes
dominantes en matière de pluriactivité demeurent les 41-64 ans suivies des 25-35 ans. Les
exceptions notables à cette tendance générale est la dominance des 15-24 ans parmi les
manœuvres, les aides familiaux et le personnel de maison, ainsi que celle des 15-35 ans parmi
les salariés privés (Tableau 31)
 |
47 47 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
37
Tableau 31 : Taux des catégories d'activité secondaire selon les catégories (en % et effectif)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
(effectif)
Cadre supérieur 0 0 0 0 100 0 163
Cadre moyen 0 15 38 0 47 0 1 822
Employé / ouvrier 3 26 25 17 29 0 19 798
Manœuvre 1 38 37 8 16 0 30 466
Employeur 0 0 24 3 56 17 3 807
Indépendant 0 13 30 14 38 4 1 153 960
Apprenti 6 70 16 0 8 0 5 126
Aide familial 26 32 22 8 12 0 304 374
Indépendant agricole 8 18 28 12 31 3 952 768
Indépendant non agricole 2 15 30 15 35 3 514 498
Salarié privé 2 33 33 11 20 0 50 537
Salarié public 0 16 2 0 82 0 1 712
Administration publique 8 7 28 13 45 0 4 056
Entreprise publique 0 0 4 0 96 0 975
Entreprise privée 4 15 30 14 35 3 1 286 754
Entreprise associative/ONG 0 25 40 11 22 2 26 047
Organisme international 0 0 100 0 0 0 114
Personnel de maison 19 32 23 5 17 4 201 569
Agriculture 8 18 28 12 31 3 963 484
Industrie 2 18 31 13 34 2 247 851
Service marchand 2 15 30 16 33 3 256 858
Service non marchand 1 18 29 12 34 6 51 323
Total 6 17 29 13 32 3 1 519 515
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Quand on analyse la répartition des travailleurs secondaires par origine de l'activité secondaire
par CSP et par statut salarial, on s'aperçoit que la principale destination de toutes les catégories
demeure la catégorie des indépendants, 76% dans l'ensemble, avec 100% pour les apprentis (ce
qui se comprend aisément puisqu'ils apprennent un métier afin de l'exercer en tant
qu'indépendant non agricole) et 90% pour les employeurs. Par contre, cette destination prisée
ne séduirait que 63% des ouvriers même devant les cadres supérieurs (69%). Aussi, la classe
ouvrière ne se serait-elle pas la classe la plus détachée de l'auto-emploi.
Par statut salarial, à l'exception des cadres supérieurs, des employeurs et des apprentis, le statut
d'indépendant agricole est la première destination de la pluriactivité de toutes les CSP. Les trois
exceptions dégagées privilégient plutôt le statut d'indépendant non agricole (Tableau 32).
 |
48 48 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
38
Tableau 32 : Origine de l'activité secondaire ou destinée de l'activité principale (en %)
CSP secondaire Statut salarial secondaire Total
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Indépendant
agricole
Indépendant
non agricole
Salarié privé Salarié public
Cadre supérieur 31 0 0 0 0 69 0 0 20 49 31 0 522
Cadre moyen 0 9 2 0 3 65 0 21 75 14 8 3 12 321
Employé / ouvrier 0 0 8 2 1 63 0 26 75 16 6 4 12 196
Manœuvre 0 0 0 14 0 67 0 19 69 17 14 0 13 169
Employeur 0 0 5 0 5 90 0 0 44 51 5 0 5 317
Indépendant 0 0 1 1 0 85 0 12 64 33 3 0 788 376
Apprenti 0 0 0 0 0 100 0 0 44 56 0 0 474
Aide familial 0 0 1 2 0 66 1 30 61 35 3 0 687 140
Indépendant agricole 0 0 1 2 0 78 0 18 61 36 3 0 1 348 369
Indépendant non agricole 0 0 1 1 0 58 0 39 79 18 3 0 132 939
Salarié privé 0 4 4 8 1 60 0 23 64 20 13 3 23 500
Salarié public 1 1 1 1 2 74 0 20 86 10 4 0 14 708
Total 0 0 1 2 0 76 0 20 63 34 3 0 1 519 515
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
49 49 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
39
Par origine, la totalité des cadres supérieurs en pluriactivité proviennent de cette même
catégorie contrairement aux cadres moyens dont 61% proviennent de cette catégorie en activité
principale et 39% des indépendants. Les ouvriers et les manœuvres pluriactifs proviennent des
indépendants pour 59% respectivement 38% et des aides familiaux pour 33% respectivement
55%.
Dans la pluriactivité toujours, tous les statuts salariaux recrutent majoritairement parmi les
indépendants agricoles, y compris les salariés privés pluriactifs (qui recrutent 85% de leur
effectif parmi ces indépendants agricoles). Il est utile de noter que même le salariat public
secondaire recrute parmi les indépendants agricoles (52%) et parmi les salariés privés (48%). Il
est également intéressant de noter que l'apprentissage secondaire s'opère essentiellement dans
le cadre familial, en qualité d'aide familial, pour 85% contre seulement 15% dans le cadre d'un
atelier d'indépendant autre que la famille (Tableau 33).
 |
50 50 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
40
Tableau 33 : Destination de l'activité principale ou recrutement de l'activité secondaire (en %)
CSP secondaire Statut salarial secondaire Total
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé /
ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Indépendant
agricole
Indépendant
non agricole
Salarié
privé
Salarié
public
CSP
principale
Cadre supérieur 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadre moyen 0 61 1 0 9 1 0 1 1 0 2 18 1
Employé / ouvrier 0 0 5 1 4 1 0 1 1 0 1 30 1
Manœuvre 0 0 0 6 0 1 0 1 1 0 4 0 1
Employeur 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
Indépendant 0 39 59 38 72 58 15 30 53 51 46 50 52
Apprenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aide familial 0 0 33 55 8 39 85 67 44 47 46 2 45
Statut
salarial
principal
Indépendant agricole 0 39 86 87 71 91 100 80 86 94 85 52 89
Indépendant non
agricole
0 0 8 6 16 7 0 17 11 5 7 0 9
Salarié privé 0 55 5 6 4 1 0 2 2 1 6 48 2
Salarié public 100 7 1 0 9 1 0 1 1 0 1 1 1
Total 163 1 822 19 798 30 466 3 807 1 153 960 5 126 304 374 952 768 514 498 50 537 1 712 1 519 515
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
51 51 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
41
Le tableau précédent permet de calculer des taux de transition entre activités principales et activités
secondaires au regard d'une part de la catégorie socioprofessionnelle et d'autre part du statut salarial des
actifs. Pour se faire, on établit la proportion de pluriactifs qui ne changent pas de statut (soit reste dans la
même CSP soit dans le même statut salarial), ensuite la proportion de ceux qui changent de position dans
l'emploi, soit la CSP soit le statut. Le premier taux est calculé à l'aide des éléments de la diagonale de la
matrice qui croise la CSP principale avec la secondaire ou le statut salarial principal avec le secondaire. Le
taux obtenu est un taux d'immobilité, l'activité secondaire préservant le même statut d'actif que l'activité
principale. Le second taux est celui de la transition d'un statut principal à un autre statut secondaire différent,
que ce dernier soit en ascendance ou en descendance par rapport au premier. Ce taux de transition traduisant
une certaine mobilité dans l'emploi, en passant de l'emploi principal à l'emploi secondaire, est ensuite scindé
en taux structurel et en taux net, le premier étant dicté par les caractéristiques limitées du marché du travail
et le second en tant que simple résidu entre transition totale et transition structurelle.
Appliqués aux données du tableau précédent, les calculs établissent respectivement à 58% et 56% le taux
d'immobilité dans l'emploi selon la CSP et le statut salarial. Du coup, les taux de transition ou de mobilité
sont de 42% respectivement 44%. Dans chacun des deux cas, les taux sont à prédominance structurelle
(Tableau 34). Si l'on pense que ces taux de transition sont relativement faibles, alors il apparaît que la
pluriactivité ne s'accompagne pas nécessairement d'une diversification importante ni dans la catégorie
professionnelle ni dans le statut salarial, le marché du travail étant dominé par le statut d'indépendance
quelle que soit l'une de ces deux caractéristiques de l'emploi au Mali.
Tableau 34 : Taux de transition entre activités principale et secondaire (en %)
Taux d'immobilité Taux de transition/mobilité
Totale Structurelle Nette
CSP 58 42 26 16
Statut salarial 56 44 27 17
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
52 52 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
42
6. La mobilité sociale
On estime que la notion de mobilité sociale peut s'appliquer à beaucoup (voire tout) de domaine social
permettant une stratification des individus en groupes différents comme ceux plus ou moins liés à l'emploi
tels que la catégorie socioprofessionnelle, le statut salarial, le secteur d'activité, le type d'entreprise, etc.
Toute stratification associe aux individus des attributs sociaux plus ou moins durables, entre d'une part
l'immobilité sociale et les divers degrés de mobilité jusqu'à l'égalité parfaite des chances marquant une
indépendance totale des statuts sociaux des origines d'autre part. Dans le premier cas, le statut social est
prédéterminé et figé le long de la vie comme dans les sociétés précapitalistes dominées par l'existence des
castes. Dans la société moderne, le statut social est plus ou moins indépendant de l'origine des individus, il
n'est pas prédéterminé mais plutôt acquis par compétition plus ou moins ouverte. A cette compétition sont
associées les notions d'ascension sociale, de trajectoire professionnelle et d'égalité des chances à l'instar du
rêve américain. Aussi importe-t-il d'en mesurer l'importance et d'évaluer la mobilité sociale au triple plan
des générations, de la profession et de l'espace géographique dans lequel se déplacent les individus pour
élire résidence.
6.1. Importance et mesure
A l'origine, on peut inférer que la mobilité sociale est née de l'abolition du statut social héréditaire des
sociétés de caste à laquelle a succédé l'égalité des hommes en droits tant dans les domaines juridique,
politique qu'économique. Elle reflète le changement de position sociale des individus, d'une part par rapport
à leur origine sociale et d'autre part par rapport à leurs propres situations successives dans l'emploi et dans
l'espace. On parlera successivement de mobilité générationnelle, de mobilité professionnelle et de mobilité
géographique ou spatiale. Quelle que soit la mesure retenue, la mobilité sociale suppose la stratification et
l'égalité des chances comme enjeu majeur. Pour l'évaluer, il est fait recours aux tables de mobilité qui
croisent la position de l'individu avec celle de ses parents ou avec sa propre position antérieure (au double
plan professionnel et spatial). Les différents élements considérés peuvent être la catégorie
socioprofessionnelle, le statut dans l'emploi, le quintile de revenu ou de bien-être (avec pour groupes, les
pauvres, la classe moyenne et les riches), le niveau d'éducation et toute autre segmentation sociale.
A titre illustratif, les 4,8 millions d'actifs occupés, âgés de 15 ans et plus, se répartissent selon leurs propres
catégories socioprofessionnelles et celles de leurs pères (Tableau 35).
Tableau 35 : Répartition des actifs occupés selon leurs CSP et celles de leurs pères
Catégorie socioprofessionnelle du père
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti
Aide
familial
Total
C
S
P
d
e
l'
en
fa
n
t
Cadre supérieur 2 643 2 604 1 709 522 0 8 845 0 0 16 322
Cadre moyen 3 857 22 807 10 113 1 641 796 56 707 0 366 96 287
Employé / ouvrier 2 518 16 616 29 547 5 594 3 528 133 997 517 524 192 840
Manœuvre 0 698 3 947 5 440 3 181 47 696 0 3 474 64 437
Employeur 933 2 313 484 717 2 186 22 608 0 369 29 610
Indépendant 5 648 36 923 75 749 21 144 12 659 2 390 792 2 332 29 758 2 575 004
Apprenti 555 1 073 1 992 332 1 676 23 462 0 152 29 242
Aide familial 1 460 4 239 8 835 1 204 1 904 1 736 878 524 41 282 1 796 327
Total 17 613 87 273 132 376 36 595 25 930 4 420 985 3 374 75 924 4 800 068
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
53 53 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
43
A l'aide de tels tableaux, on établit des matrices de transition entre position des enfants et celle des parents
ou entre périodes successives dans la position des individus eux-mêmes sans comparaison avec d'autres
individus. La diagonale principale de ces matrices traduit l'immobilité sociale avec reproduction de la
position antérieure dans le présent, c'est l'effet "lignée" ou de reproduction sociale. Les éléments hors de
cette diagonale traduisent le degré de mobilité des individus. Ce degré dépend de la segmentation sociale
utilisée et selon la valorisation ou l'accessibilité des différents segments de la société tels que construits
pour les besoins de l'analyse. Un des indicateurs de statut social souvent utilisé dans la littérature est la
catégorie socioprofessionnelle ou le statut salarial de l'actif, nonobstant ses limites par exemple pour rendre
compte de la mobilité sociale des femmes (Merllié, 2015).
6.2. Mobilité générationnelle
L'on s'intéresse ici non pas au changement social des individus dans le temps mais à la comparaison entre
leur statut social et celui de leurs parents (l'enquête EMOP a privilégié le statut social des pères, sans
référence à celui des mères). La mesure de la mobilité intergénérationnelle se fait à l'aide de tables de
mobilité. Elle est ensuite décomposée en mobilité structurelle et mobilité nette au regard des
caractéristiques intrinsèques du marché du travail. Pour des stratifications sociales spécifiques (celles
laissant apparaître une nette inégale valorisation sociale), elle peut également être décomposée en ascension
ou descendance sociale. Pour un certain nombre de caractéristiques de l'emploi et pour le niveau
d'éducation, le degré de mobilité sociale associé est calculé et décomposé selon le cas.
La table de mobilité (Tableau 35) permet de distinguer la CSP des enfants comme destinée de celle de leurs
pères de la CSP des pères comme source de recrutement de celle des enfants. Dans le premier cas, il s'agit
de savoir ce que deviennent les enfants des pères de telle ou telle CSP tandis que dans le second, il s'agit
de savoir d'où proviennent les CSP des enfants au regard de celles de leurs pères3. Deux autres tableaux
sont construits à cet effet, pour rendre compte de la mobilité. Le premier (Tableau 36) renseigne sur la
destination des CSP des pères tandis que le second (Tableau 37) est relatif à l'origine CSP des enfants.
Tableau 36 : Destinée de la CSP du père – que deviennent les enfants de … (en %)
CSP du père
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Total
C
S
P
d
e
l'
en
fa
n
t
Cadre supérieur 15 3 1 1 0 0 0 0 0
Cadre moyen 22 26 8 4 3 1 0 0 2
Employé / ouvrier 14 19 22 15 14 3 15 1 4
Manœuvre 0 1 3 15 12 1 0 5 1
Employeur 5 3 0 2 8 1 0 0 1
Indépendant 32 42 57 58 49 54 69 39 54
Apprenti 3 1 2 1 6 1 0 0 1
Aide familial 8 5 7 3 7 39 16 54 37
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
3 Il n'est pas ici question de savoir si l'individu progresse ou régresse dans la hiérarchie sociale mais simplement comment il
évolue.
 |
54 54 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
44
Tableau 37 : Recrutement de la CSP de l'enfant – d'où proviennent les enfants de … (en %)
CSP du père
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Total
C
S
P
d
e
l'
en
fa
n
t
Cadre supérieur 16 16 10 3 0 54 0 0 100
Cadre moyen 4 24 11 2 1 59 0 0 100
Employé / ouvrier 1 9 15 3 2 69 0 0 100
Manœuvre 0 1 6 8 5 74 0 5 100
Employeur 3 8 2 2 7 76 0 1 100
Indépendant 0 1 3 1 0 93 0 1 100
Apprenti 2 4 7 1 6 80 0 1 100
Aide familial 0 0 0 0 0 97 0 2 100
Total 0 2 3 1 1 92 0 2 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Par comparaison des deux tableaux (Tableaux 36 et 37), on constate qu'il y a, à la génération des enfants :
moins d’indépendants (54% des enfants contre 92% de leurs pères), à raison de moins d'indépendants
agricoles (72% contre 86%) avec cependant plus d'indépendants non agricoles (21% contre 12%)
plus d'aides familiaux (37% contre 2%) et surtout plus de salariés en particulier privés (6% contre
2%).
On peut en déduire que la société s'est quelque peu ouverte par le haut, avec moins d'actifs agricoles et
davantage d'actifs indépendants non agricoles et de salariés (privés comme publics, informels comme
formels). Cela traduit un relatif élargissement de l'artisanat de production et du salariat y compris cependant,
le salariat informel. Ce changement traduit une mobilité sociale induite par les modifications de la structure
des emplois. Elle est dite mobilité structurelle imposée par les changements de la structure
socioprofessionnelle du pays, traduisant une certaine évolution de la structure du marché du travail. C'est
la composante minimale de la mobilité sociale, l'autre composante étant la mobilité nette avec pour
déterminants la modification de la population et les mouvements migratoires. C'est ce qui reste du brassage
des catégories sociales en dehors de l'évolution structurelle du marché du travail.
Dans une table de mobilité (Tableau 35), la mobilité structurelle est calculée à partir des sous-totaux
marginaux des enfants (en lignes) et des pères (en colonnes) en faisant la somme soit des écarts positifs soit
des écarts négatifs, les deux écarts étant égaux en valeur absolue. Le taux de mobilité structurelle est égal
au rapport de cette somme à l'effectif total de la population active considérée. La mobilité nette est obtenue
par soustraction de la mobilité structurelle de la mobilité sociale totale. L'effectif de la mobilité est égal à
l'effectif total de la population active diminué de celui de l'immobilité. Il faut rappeler que l'effectif de
l'immobilité sociale est la somme des éléments de la diagonale principale de la table de mobilité (Tableau
35).
Au regard de la catégorie socioprofessionnelle, la table de mobilité permet d'établir la mobilité totale à 48%
avec 38% de mobilité structurelle et 10% de mobilité nette (Tableau 38), ce qui traduit une mobilité
beaucoup plus liée à l'évolution du marché du travail qu'à autre chose, la mobilité s'effectuant certainement
plus entre catégories proches. Certes, la mobilité totale est plus importante pour les 15-35 ans mais elle
reste à dominance structurelle (Tableau 39). Elle est certes moins importante pour les plus de 35 ans, mais
la part nette devient beaucoup plus importante, ce qui traduit une plus forte mobilité sociale d'autant plus
que les taux de mobilité des jeunes (40 ans et moins) sont jugés moins fiables puisque au-delà de 40 ans, la
mobilité est normalement moindre, l'enfant et son père ayant atteint des statuts sociaux plus ou moins figés.
 |
55 55 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
45
Tableau 38 : Calcul de la mobilité sociale des 15 ans et plus (en %)
Père Enfant Ecart
Cadre supérieur 17 613 16 322 1 291
Cadre moyen 87 273 96 287
Employé / ouvrier 132 376 192 840
Manœuvre 36 595 64 437
Employeur 25 930 29 610
Indépendant 4 420 985 2 575 004 1 845 981
Apprenti 3 374 29 242
Aide familial 75 924 1 796 327
Total 4 800 068 4 800 068 1 847 272
effectif taux
Immobilité 2 494 697 52%
Mobilité 2 305 372 48%
o Structurelle 1 847 272 38%
o Nette 458 100 10%
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 39 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon la CSP (en %)
15-24 ans 25-35 ans 36-40 ans 41-64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 26% 48% 61% 72% 88% 52%
Mobilité 74% 52% 39% 28% 12% 48%
o Structurelle 68% 41% 28% 18% 9% 38%
o Nette 6% 11% 11% 10% 3% 10%
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La mobilité sociale suivant cette caractéristique de l'emploi est plus structurelle que nette, les individus
changeant certes de catégorie socioprofessionnelle mais sans que leur position dans la hiérarchie sociale ne
change beaucoup. Aussi, l'égalité des chances d'accéder aux différentes catégories reste-t-elle limitée.
Lorsqu'on s'intéresse au statut salarial (avec comme modalités : indépendant agricole, indépendant non
agricole, salarié privé et salarié public), la mobilité totale est de 23% dont 9% de nette, avec 26% pour les
36-64 ans (Tableau 40).
Tableau 40 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le statut salarial (en %)
15-24 ans 25-35 ans 36-40 ans 41-64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 81 76 74 74 73 77
Mobilité 19 24 26 26 27 23
o Structurelle 10 14 18 17 23 14
o Nette 9 10 8 9 4 9
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Pour savoir si la mobilité sociale ci-dessus observée signifie ascension sociale ou descendance sociale, on
calcule deux autres taux de mobilité dits respectivement mobilité ascendante et mobilité descendante. La
première est obtenue en rapportant à la population active totale la somme des effectifs en bas de la diagonale
principale, et la seconde en rapportant toujours à la population active la somme des effectifs en haut de la
diagonale. La mobilité sociale est la somme de ces deux mobilités. Le taux d'immobilité est ici encore
appelé taux de reproduction sociale. Appliqué au statut salarial des actifs, le taux de mobilité sociale est à
dominance ascendante, quelle que soit la classe d'âge, si l'on admet que la progression sociale va
d'indépendant agricole à salarié public en passant par indépendant non agricole puis salarié privé (Tableau
41). Cela n'est pas forcément lié à l'appréciation subjective de chaque privé pris isolément.
 |
56 56 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
46
Tableau 41 : Taux de mobilité ascendante versus descendante selon le statut salarial (en %)
4
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Reproduction sociale 82 77 75 74 73 77
Mobilité sociale 18 23 25 26 27 23
Ascendante 13 19 21 22 25 19
Descendante 5 4 4 4 2 4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La fluidité sociale reste relativement faible, autour du quart de la population active, peut-être qu'elle a pu
être plus élevée aux périodes antérieures aux réformes structurelles entreprises au début des années 1990
ayant entraîné un recul de l'emploi public formel au profit de l'emploi privé et de l'auto-emploi.
Il est curieux de constater que le taux de mobilité sociale selon le type d'entreprise (administration publique,
entreprise publique, entreprise privée, entreprise associative/ONG, organisme international, personnel de
maison) et selon le secteur d'activité (agriculture, industrie, service marchand, service non marchand) soit
le même, 26% avec toutefois une part nette plus importante par secteur d'activité que par entreprise (13%
contre 10%). Par tranche d'âge, la mobilité sociale est plus élevée pour les plus de 35 ans selon le secteur
d'activité que le type d'entreprise. Toutefois, la part nette n'en est pas plus grande et d'ailleurs bien au
contraire pour les plus de 40 ans (Tableaux 42 et 43)
Tableau 42 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le type d'entreprise (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Reproduction sociale 67 72 76 79 87 74
Mobilité sociale 33 28 24 21 13 26
Structurelle 27 17 12 8 7 16
Nette 6 11 12 13 6 10
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 43 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le secteur d'activité (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 79 73 70 71 71 74
Mobilité sociale 21 27 30 29 29 26
Structurelle 8 14 17 17 22 14
Nette 13 14 13 12 6 13
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
4
totaleffectif
principalediagonaleladeeffectifs
socialeonreproductidetaux
totaleffectif
principalediagonaleladebaseneffectifs
ascendantemobilitédetaux
totaleffectif
principalediagonaleladehauteneffectifs
edescendantmobilitédetaux
edescendantmobilitédetauxascendantemobilitédetauxsocialemobilitédetaux
 |
57 57 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
47
Les différents niveaux d'éducation (aucun niveau, fondamental 1, fondamental 2, secondaire, supérieur)
peuvent ici être utilisés pour calculer la mobilité sociale avec ses deux décompositions, structurelle et nette,
respectivement ascendante et descendante. Dans le premier cas, la mobilité structurelle est dominante et
dans le second, la mobilité est ascendante. La mobilité diminue, comme on pouvait s'y attendre, avec l'âge,
celle des plus de 35 ans est moins importante que pour les 35 ans et moins (Tableaux 44 et 45). Ces résultats
traduisent un élargissement du système éducatif sans pour autant qu'on puisse parler d'égalité des chances
puisque la part nette de la mobilité éducative reste faible. Le statut scolaire reste donc attribué au mérite
personnel et non à une quelconque égalité des conditions sociales des individus.
Tableau 44 : Taux de mobilité générationnelle par groupe d'âge selon le niveau d'éducation (en %)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 49 53 74 81 80 92 64
Mobilité sociale 51 47 26 19 20 8 36
Structurelle 51 37 18 13 15 6 31
Nette 0 10 8 6 5 2 5
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 45 : Taux de mobilité ascendante versus descendante selon le niveau d'éducation (en %)
6 – 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Reproduction sociale 49 53 74 81 80 92 64
Mobilité sociale 51 47 26 19 20 8 36
Ascendante 51 42 22 16 17 7 34
Descendante 0 5 4 2 2 1 2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
6.3. Mobilité professionnelle
A la différence de la sous-section précédente, ici l'on s'intéresse non pas aux différences de statut social
entre enfants et pères mais bien aux mutations sociales que les individus auront connu dans le temps,
lesquelles mutations sont supposées induire chez les individus concernés des valorisations sociales inégales.
Il s'agit donc d'un changement dans le temps et dans le statut social de l'individu, la catégorie
socioprofessionnelle, le statut salarial ou le type d'entreprise. Cela n'induit pas nécessairement un
changement de niveau de bien-être mais constitue un des canaux essentiels de mobilité sociale.
La mobilité professionnelle traite des changements de situations dans l'emploi entre deux périodes de vie
des mêmes individus. Elle peut intervenir sans pour autant que les individus concernés ne changent de statut
professionnel, comme par exemple par simple changement d'entreprise ou encore le passage du statut de
chômeur à celui d'employé et vice versa. Sur la base des CSP, une table de mobilité professionnelle permet
de distinguer l'évolution de CSP de l'individu avec d'un côté la destinée de la CSP antérieure et de l'autre la
source de la CSP actuelle. En d'autres termes, l'on saura ce que deviennent les CSP antérieures et d'où
proviennent les CSP actuelles. Les deux tableaux associés (Tableaux 46 et 47) renseignent sur la destinée
des CSP antérieures respectivement l'origine des CSP actuelles.
 |
58 58 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
48
Tableau 46 : Destinée de la CSP antérieure – que devient la CSP antérieure (en %)
CSP antérieure
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Total
C
S
P
a
ct
u
el
le
Cadre supérieur 63 2 0 0 0 0 0 0 0
Cadre moyen 0 56 3 1 0 2 0 1 2
Employé / ouvrier 0 10 18 11 41 3 16 2 4
Manœuvre 0 8 2 17 0 1 0 1 1
Employeur 18 4 3 0 59 1 0 0 1
Indépendant 11 20 45 50 0 76 36 46 54
Apprenti 9 0 0 0 0 0 15 1 1
Aide familial 0 0 29 22 0 17 33 51 37
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 47 : Recrutement de la CSP actuelle – de quelle CSP provient la CSP actuelle (en %)
CSP antérieure
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Total
C
S
P
a
ct
u
el
le
Cadre supérieur 77 11 5 0 0 0 0 7 100
Cadre moyen 0 46 8 1 0 30 0 16 100
Employé / ouvrier 0 5 32 7 1 27 6 22 100
Manœuvre 0 11 9 32 0 17 0 31 100
Employeur 10 11 25 0 7 26 0 22 100
Indépendant 0 1 6 2 0 42 1 48 100
Apprenti 6 0 0 0 0 0 34 60 100
Aide familial 0 0 5 1 0 14 1 78 100
Total 0 2 7 2 0 30 1 57 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Par comparaison des deux tableaux, on constate qu'il y a, par rapport à la CSP antérieure :
moins d’ouvriers (4% contre 7%) et moins d’aides familiaux (37% contre 57%)
plus d'indépendants (54% contre 30%), mais en réalité plus d'indépendants non agricoles (26% contre
20%) avec toutefois légèrement moins d'indépendants agricoles (66% contre 69%).
Aussi, la structure sociale de l'emploi s'ouvre-t-elle vers les indépendants non agricoles au détriment des
employés/ouvriers. Néanmoins, la mobilité professionnelle qui en résulte reste à dominance structurelle
sauf pour les 35 ans et moins. Le taux de mobilité par CSP est le plus élevé des taux de mobilité
professionnelle, que celle-ci soit par statut salarial ou par entreprise. Il est de 45% contre respectivement
40% et seulement 18% (Tableaux 48, 49 et 50).
Tableau 48 : Taux de mobilité professionnelle par groupe d'âge selon la CSP (en %)
15-24 ans 25-35 ans 36-40 ans 41-64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 68 56 58 48 54 55
Mobilité 32 44 42 52 46 45
o Structurelle 2 17 23 39 39 25
o Nette 30 27 19 13 7 20
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 49 : Taux de mobilité professionnelle par groupe d'âge selon le statut salarial (en %)
15-24 ans 25-35 ans 36-40 ans 41-64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 74 66 61 51 43 60
Mobilité 26 34 39 49 57 40
o Structurelle 4 5 5 11 40 7
o Nette 22 28 34 38 17 33
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
59 59 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
49
Tableau 50 : Taux de mobilité professionnelle par groupe d'âge selon le type d'entreprise (en %)
15-24 ans 25-35 ans 36-40 ans 41-64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité 86 82 82 81 84 82
Mobilité 14 18 18 19 16 18
o Structurelle 11 11 11 12 13 11
o Nette 3 7 7 7 3 7
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
En approfondissant l'analyse de la mobilité selon le statut salarial, on s'aperçoit que cette mobilité
professionnelle légèrement plus descendante qu'ascendante chez les 40 ans et moins et légèrement plus
ascendante que descendante chez les 41-64 ans et encore nettement plus ascendante chez les plus de 64 ans
(Tableau 51). Les modalités salariales considérées demeurent :
indépendant agricole ;
indépendant non agricole ;
salarié privé informel ;
salarié privé informel ;
salarié privé formel ;
salarié public, avec informel dans l'emploi actuel mais pas l'emploi antérieur.
Tableau 51 : Taux de mobilité professionnelle ascendante/descendante par statut salarial (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Reproduction sociale 74 66 61 52 43 60
Mobilité sociale 26 34 39 48 57 40
Ascendante 12 16 19 25 43 21
Descendante 14 18 20 23 14 19
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
6.4. Mobilité spatiale
A l'instar de la mobilité professionnelle, la mobilité spatiale ou géographique n'induit pas nécessairement
un changement de niveau de bien-être mais constitue un des canaux essentiels de mobilité sociale. On peut
même dire que la mobilité spatiale, à travers les migrations intérieures et internationales, peut être à la fois
cause et conséquence de la mobilité sociale. Elle peut être cause en ce sens qu'elle va induire un changement
de statut social du migrant tant par l'emploi que par les études et autres. Elle sera conséquence dès lors que
la migration est motivée par un changement de statut dans l'emploi voire dans le bien-être comme un ancien
locataire qui déménage dans sa nouvelle construction propre ou un enfant qui quitte la demeure familiale
pour la nouvelle demeure (en location ou en propre – peu importe) de son propre nouveau ménage.
6.4.1. Taux de mobilité spatiale
Globalement, le taux de mobilité spatiale est estimé à 14% de la population de 2014, soit 2.4 millions
d'individus, avec presque autant d'hommes que de femmes. Cette quasi parité est le résultat de deux
mouvements contraires avec d'un côté plus de mouvements féminins chez les moins de 25 ans et davantage
de mouvements masculins au-delà de cet âge. Le taux de mobilité augmente sensiblement avec l'âge, 18%
pour les 15-24 ans contre 26% les 36-64 ans et 25% les 25-35 ans. Il est également fortement dépendant de
l'éducation, du simple au double entre l'analphabétisme et le niveau fondamental 2 de l'enseignement
formel, du simple au double entre ce dernier et le supérieur, cette dépendance étant perceptible dans toutes
 |
60 60 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
50
les classes d'âge avec des écarts différents entre les niveaux. Le décile de revenu est un autre déterminant
principal de la mobilité spatiale. Le taux est de 7 à 9% chez les pauvres (déciles 1 à 4), de 13 à 15% dans
la couche inférieure de la classe moyenne (déciles 5 à 7), de 20% dans la couche supérieure de cette classe
moyenne (déciles 8 et 9) et de 24% chez les riches (dernier décile de revenu). Au-delà de 24 ans, cette
hiérarchie n'est plus strictement respectée (Tableau 52).
Tableau 52 : Taux de mobilité spatiale par groupe d’âge (en %)
moins de 6 ans 6 – 14 ans 15 – 24 ans 25 – 35 ans 36 – 40 ans 41 – 64 ans plus de 64 ans Total
M
il
ie
u
d
e
ré
si
d
en
ce
Bamako 6 22 42 47 46 52 50 33
Autre urbain 4 11 23 32 33 37 33 20
Rural 2 5 12 19 21 20 19 10
S
ex
e Homme 2 7 16 27 31 28 26 14
Femme 2 8 20 23 21 24 21 14
D
éc
il
e
d
e
re
v
en
u
D1 1 4 8 11 16 16 13 7
D2 2 5 12 16 23 21 10 9
D3 2 3 12 17 16 18 20 9
D4 2 5 13 16 19 20 18 9
D5 2 7 15 26 25 26 21 13
D6 2 5 16 27 25 29 28 14
D7 2 10 20 23 35 23 29 15
D8 3 10 26 36 35 33 34 20
D9 4 11 24 33 34 35 36 20
D10 4 17 28 34 27 35 33 24
E
d
u
ca
ti
o
n
Aucun niveau 2 5 15 21 24 23 23 12
Fondamental 1 2 9 16 30 26 32 30 14
Fondamental 2 21 23 29 45 36 12 25
Secondaire 0 36 45 38 53 40 43
Supérieur 51 54 59 48 58 53
Total 2 7 18 25 26 26 24 14
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Un autre facteur important de la mobilité spatiale est l'urbanisation. Aussi, le taux passe de 10% en milieu
rural à 20% en milieu urbain avec 33% dans le cas spécifique de Bamako. Pour chacune de ces trois milieux
de résidences, la mobilité augmente avec l'âge pour légèrement s'estomper au-delà de 64 ans. Le plus fort
taux s'observe dans la tranche d'âge 41-64 ans en milieu urbain tandis qu'en milieu rural, il s'observe entre
36 et 40 ans.
6.4.2. Origines de la mobilité spatiale
Les zones de départ des migrants (intérieurs comme internationaux) sont, par ordre d'importance, le milieu
rural (6% des 14% de migrants) et Bamako (4%), soit 71% des origines de la migration. Le reste urbain et
l'étranger se partagent égalitairement les 29% restants. Pour tous les déterminants considérés, le milieu rural
demeure la principale origine de la mobilité géographique, soit donc l'exode rural, de la campagne vers la
ville d'autant plus que les ruraux se dirigent prioritairement vers Bamako ensuite vers d'autre urbain et pour
moitié moins vers d'autres régions rurales sans doute les zones d'agriculture intensive comme l'Office du
Niger ou les régions CMDT ainsi que les zones minières (industrielles comme d'orpaillage). L'exode rural
est légèrement plus important chez les femmes que chez les hommes et cet état de fait est compensé par la
prédominance des hommes parmi les migrants de retour de l'étranger comparativement aux femmes. Il faut
ajouter que la mobilité à destination de Bamako est d'abord interne à Bamako (13% des 33% de mobilité),
ensuite rurale (11%) puis en provenance d'autres zones urbaines (7%) et seulement 2% des migrants de
retour de l'étranger (Tableau 53).
 |
61 61 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
51
Tableau 53 : Origines de la mobilité spatiale (en %)
Aucune mobilité Bamako Autre urbain Rural Hors Mali
M
il
ie
u
d
e
ré
si
d
en
ce
Bamako 67 13 7 11 2
Autre urbain 80 3 2 12 3
Rural 90 2 1 5 2
S
ex
e Homme 86 4 2 6 3
Femme 86 4 2 7 2
D
éc
il
e
d
e
re
v
en
u
D1 93 1 0 4 1
D2 91 2 1 4 3
D3 91 2 1 4 2
D4 91 2 1 5 2
D5 87 3 2 5 3
D6 86 4 1 6 3
D7 85 6 1 6 2
D8 80 5 3 10 3
D9 80 6 3 9 3
D10 76 6 5 12 2
E
d
u
ca
ti
o
n
Aucun niveau 88 2 1 6 2
Fondamental 1 86 4 2 6 2
Fondamental 2 75 7 4 12 2
Secondaire 57 14 6 21 2
Supérieur 47 24 9 17 2
Total 86 4 2 6 2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Il est intéressant de noter que la mobilité spatiale est prioritairement d'origine rurale quel que soit le décile
de revenu. Par contre, par niveau d'éducation, cela reste vrai jusqu'au niveau secondaire puisque dans le
supérieur, la mobilité provient en premier de Bamako et seulement après le milieu rural, avec 7 points de
pourcentage de différence. Les migrants de retour de l'étranger sont plus que proportionnellement dans la
classe moyenne, surtout dans sa couche supérieure.
6.4.3. Raisons de mobilité spatiale
Le mobile de la mobilité spatiale peut être résidentiel, de travail ou autres. Dans tous les cas, la mobilité
géographique est associée à une mobilité sociale même lorsqu'elle s'opère à l'intérieur d'une même localité
comme à l'intérieur de Bamako (impliquant le déplacement d'un quartier à l'autre, d'une commune à l'autre
mais aussi simplement d'une demeure à l'autre à l'intérieur du même découpage territorial avec le moins de
distance possible entre l'origine et la destination). La principale raison demeure la famille, quel que soit le
niveau d'éducation, le sexe, le milieu de résidence ou le décile de revenu. La deuxième raison de mobilité
géographique est la recherche d'emploi ou l'apprentissage. Les études viennent en troisième position. Au
titre de l'emploi la mobilité concerne moins de 1% de la population soit seulement 14 248 individus dont
plus de la moitié pour la seule ville de Bamako ou encore près de 40% pour le seul décile des riches (décile
10). Les femmes sont proportionnellement plus entrain de rejoindre la famille et les hommes
proportionnellement plus à la recherche d'emploi ou en apprentissage (Tableau 54).
 |
62 62 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
52
Tableau 54 : Raisons de la mobilité spatiale (en %)
Aucune mobilité Famille Etudes Apprentissage/recherche emploi Emploi Autres
M
il
ie
u
d
e
ré
si
d
en
ce
Bamako 67 20 3 6 0.3 4
Autre urbain 80 15 1 4 0.2 0
Rural 90 9 0 1 0.0 0
S
ex
e Homme 86 9 1 3 0.1 1
Femme 86 13 0 1 0.1 1
D
éc
il
e
d
e
re
v
en
u
D1 93 6 0 0 0.0 0
D2 91 8 0 1 0.1 0
D3 91 8 0 1 0.2 0
D4 91 8 0 1 0.0 0
D5 87 11 0 1 0.0 0
D6 86 11 0 2 0.0 0
D7 85 12 1 2 0.0 1
D8 80 15 1 3 0.1 1
D9 80 15 1 3 0.1 1
D10 76 14 2 5 0.3 2
E
d
u
ca
ti
o
n
Aucun niveau 88 10 0 2 0.1 0
Fondamental 1 86 12 0 1 0.1 0
Fondamental 2 75 18 3 2 0.2 1
Secondaire 57 24 6 10 0.0 2
Supérieur 47 27 10 9 0.2 6
Total 86 11 1 2 0.1 0.1
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
6.5. Mobilité sociale et genre
Dans la littérature, l'analyse de la mobilité intergénérationnelle porte principalement sur fils et non sur les
filles. Dans bien de cas, la mobilité féminine est analysée non pas en référence à la profession du père mais
bien à celle du conjoint voire à celle du père de ce dernier (c'est-à-dire celle du beau-père). Les tables de
mobilité sont ainsi remplacées par des tables matrimoniales dans lesquelles, le concept d'hétérogamie est
substitué à celui de mobilité et l'homogamie à celui d'immobilité sociale. Nonobstant ces difficultés
théoriques, l'on a procédé à l'établissement des taux de mobilité générationnelle et professionnelle selon le
genre.
6.5.1. Mobilité générationnelle et genre
Les résultats obtenus montrent qu'il n'y a pas d'effet genre au regard du type d'entreprise ni des catégories
socioprofessionnelles. Aussi, les différences de genre s'observent quand la mobilité générationnelle est
analysée selon le statut salarial, le secteur d'activité et selon le niveau d'éducation du père et de l'enfant
(garçon et fille, séparément). Vis-à-vis du statut salarial, les taux de mobilité sont quasiment identiques, à
cette importante différence près que les hommes ont une plus grande mobilité nette comparativement aux
femmes, 11% contre 7% avec des écarts encore plus importants dans les tranches d'âge de plus de 24 ans.
A mobilité descendante identique, les femmes ont un taux de mobilité ascendante plus élevée que les
hommes du point de vue du statut salarial, surtout chez les plus de 40 ans (Tableaux 55 et 56).
 |
63 63 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
53
Tableau 55 : Taux de mobilité générationnelle par sexe et âge selon le statut salarial (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 84 75 71 75 78 77
Femme 78 77 77 72 62 76
Mobilité
Homme 16 25 29 25 22 23
Femme 22 23 23 28 38 24
Structurelle
Homme 6 12 19 14 17 11
Femme 14 16 17 22 36 18
Nette
Homme 10 13 10 11 5 11
Femme 8 7 5 6 2 7
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 56 : Taux de mobilité ascendante/descendante par sexe et âge selon le statut salarial (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 84 75 71 75 78 77
Femme 78 77 77 72 62 76
Mobilité
Homme 16 25 29 25 22 23
Femme 22 23 23 28 38 24
Ascendante
Homme 10 19 24 20 20 18
Femme 17 18 19 24 37 20
Descendante
Homme 6 5 5 4 2 5
Femme 5 5 4 4 1 4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Par secteur d'activité, on observe un taux de mobilité sociale légèrement plus élevé chez les femmes (28%)
que chez les hommes (25%), surtout chez les plus de 40 ans et les moins de 25 ans. Par contre, la mobilité
nette des hommes est supérieure à celle des femmes, sauf chez les moins de 25 ans (Tableau 57).
Tableau 57 : Taux de mobilité générationnelle par sexe et âge selon le secteur d'activité (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 83 73 67 72 76 75
Femme 74 73 74 69 60 72
Mobilité
Homme 17 27 33 28 24 25
Femme 26 27 26 31 40 28
Structurelle
Homme 6 12 18 14 17 12
Femme 12 16 16 22 37 17
Nette
Homme 11 16 15 14 8 14
Femme 14 12 9 8 3 11
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
L'analyse par niveau d'éducation laisse apparaître une certaine discrimination en défaveur des femmes. En
effet, le taux de mobilité des femmes par rapport à ce déterminant est de 11 points de pourcentage inférieur
à celui des hommes, 31% contre 42%. Sans doute qu'il aurait été intéressant ici de voir l'effet non pas de
l'éducation du père mais bien de celui de la mère sur la fille, données malheureusement non disponibles. Si
le taux de mobilité nette ne souffre d'aucun effet genre, celui de la mobilité structurelle est beaucoup plus
élevé chez les hommes que chez les femmes, particulièrement plus chez les 25-64 ans. Du point de vue de
l'ascension sociale, les hommes dominent encore les femmes, quel que soit le groupe d'âge. En d'autres
termes, l'éducation du père promeut peu à la fille par rapport au garçon et cela au regard de la stratification
sociale (Tableaux 58 et 59).
 |
64 64 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
54
Tableau 58 : Taux de mobilité générationnelle par sexe et âge selon le niveau d'éducation (en %)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 47 46 67 73 74 89 58
Femme 51 60 79 88 87 96 69
Mobilité
Homme 53 54 33 27 26 11 42
Femme 49 40 21 12 13 4 31
Structurelle
Homme 53 44 25 20 21 8 37
Femme 49 31 13 7 8 2 26
Nette
Homme 0 11 8 7 4 2 5
Femme 0 9 8 5 6 2 5
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 59 : Taux de mobilité ascendante/descendante par sexe et âge selon le niveau d'éducation (en %)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 47 46 67 73 74 89 58
Femme 51 60 79 88 87 96 69
Mobilité
Homme 53 54 33 27 26 11 42
Femme 49 40 21 12 13 4 31
Ascendante
Homme 53 48 30 25 24 10 39
Femme 49 35 17 10 10 3 29
descendante
Homme 0 6 3 2 2 1 2
Femme 0 5 4 3 3 1 3
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
6.5.2. Mobilité professionnelle et genre
Par rapport à la mobilité professionnelle, trois caractéristiques de l'emploi restent déterminantes dans
l'inégalité genre. Ce sont la catégorie socioprofessionnelle, le type d'entreprise et le statut salarial. Par
rapports aux CSP, la mobilité professionnelle masculine est supérieure de 19 points de pourcentage à la
mobilité féminine. Et puisque les taux de mobilité nette sont quasiment les mêmes, c'est la structure
intrinsèque du marché du travail qui crée cette différenciation, presque du simple au double entre femmes
et hommes, les écarts les plus importants étant observés chez les 25-40 ans (Tableau 60).
Tableau 60 : Taux de mobilité professionnelle par sexe et âge selon la CSP (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 64 41 44 45 52 47
Femme 70 71 78 53 57 66
Mobilité
Homme 36 59 56 55 48 53
Femme 30 29 22 47 43 34
Structurelle
Homme 3 29 39 45 43 34
Femme 6 7 2 30 31 14
Nette
Homme 33 31 17 11 5 20
Femme 24 22 20 17 11 21
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Selon le type d'entreprise, les taux de mobilité professionnelle, masculin et féminin, sont assez proches
(20% respectivement 16%), des taux tous faibles démontrant le peu de possibilité pour les actifs de changer
de nature d'entreprise tellement le marché du travail serait étroit. La mobilité structurelle féminine est
supérieure à celle masculine sauf chez les 36-40 ans. En contrepartie, la mobilité nette masculine est de loin
supérieure à celle féminine, les créations d'entreprises profitant certainement plus aux hommes qu'aux
femmes (Tableau 61).
 |
65 65 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
55
Tableau 61 : Taux de mobilité professionnelle par sexe et âge selon le type d'entreprise (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 91 76 78 80 84 80
Femme 82 87 88 82 83 84
Mobilité
Homme 9 24 22 20 16 20
Femme 18 13 12 18 17 16
Structurelle
Homme 7 11 15 10 11 9
Femme 15 13 6 18 17 14
Nette
Homme 2 13 7 11 5 11
Femme 3 0 6 0 0 2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Du point de vue du statut salarial, les femmes ont une position beaucoup plus figée que les hommes (70%
d'immobilité professionnelle contre 52%). A mobilité structurelle bien comparable, la mobilité nette
masculine est deux fois plus importante que la mobilité nette féminine, pour l'ensemble des actifs comme
pour tout groupe d'âge pris individuellement. Curieusement, la mobilité professionnelle des hommes est
plus descendante que celle des femmes alors même que la mobilité féminine n'est plus ascendante que la
masculine que chez les plus de 40 ans (Tableau 62 et 63).
Tableau 62 : Taux de mobilité professionnelle par sexe et âge selon le statut salarial (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 74 55 47 46 46 52
Femme 74 77 82 61 35 70
Mobilité
Homme 26 45 53 54 54 48
Femme 26 23 18 39 65 30
Structurelle
Homme 2 5 8 9 34 6
Femme 7 7 5 23 54 9
Nette
Homme 23 40 45 45 20 42
Femme 19 15 13 16 11 22
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Tableau 63 : Taux de mobilité professionnelle ascendante/descendante par sexe et âge selon le statut salarial (en %)
15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Immobilité
Homme 74 55 47 46 46 52
Femme 74 77 82 61 35 70
Mobilité
Homme 26 45 53 54 54 48
Femme 26 23 18 39 65 30
Ascendante
Homme 15 25 26 23 36 24
Femme 9 7 8 28 60 17
descendante
Homme 11 20 28 30 18 24
Femme 17 15 10 11 6 13
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
66 66 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
56
7. Le revenu d'emploi
Il y a 2 séries de directives internationales en matière de mesure de revenu (OIT, 1998). L'une porte sur la
mesure des gains des salariés et l'autre sur la mesure du revenu des ménages à partir des enquêtes sur le
revenu et les dépenses des ménages. Les enquêtes sur l'emploi permettent de renseigner, directement ou
indirectement, des indicateurs tels que la durée hebdomadaire de travail, la rémunération mensuelle
moyenne et la rémunération horaire moyenne. Les 2 unités d'observation statistique possibles sont l'emploi
ou la personne et les sources de revenus des ménages sont alors constituées des apporteurs de revenus. Dans
les enquêtes EMOP 2014, on privilégie la personne car elle est l'unité de base de l'enquête et elle ne pose
pas de problème dès lors qu'on peut clairement identifier les activités économiques des différents membres
du ménage et ainsi répartir entre eux les revenus générés par ces activités.
7.1. Revenu moyen d'emploi
Les statistiques sur le revenu de l'emploi sont très importantes à des fins de politiques publiques. Elles sont
par exemple utilisées dans la formulation des politiques fiscales mais il y a une distinction à faire entre le
revenu de l'emploi et le revenu du ménage, ce dernier étant réparti en 5 postes à savoir (i) les salaires et
traitements, (ii) le revenu d'entreprise, (iii) le revenu de propriété, (iv) le revenu de transferts et (v) le revenu
d'autres sources. Les données sur le revenu de l'emploi permettent non seulement de renseigner sur le revenu
tiré des activités économiques mais aussi de procurer une mesure du bien-être lié à l'emploi des individus,
deux aspects tout aussi intéressants pour les politiques publiques.
La source du revenu d'emploi est avant tout l'exercice d'un emploi salarié ou d'une activité indépendante et
ses formes sont au nombre de 3, en espèces, en nature ou sous forme de services, de prestation ou même de
droits à des prestations différées. Le revenu de l'emploi est (i) le revenu obtenu par la population pourvue
d'un emploi au titre de cet emploi y compris les sous-employés et (ii) le revenu des chômeurs ou inactifs au
titre de leur statut précédent de salarié ou de travailleur indépendant. Aussi, dans notre cas, le revenu de
l'emploi se limite ici au revenu dérivé d'une participation à un emploi rémunéré ou à un emploi indépendant,
en excluant tout revenu perçu d'autres sources telles que propriété, assistance sociale, transferts, etc., formes
de rémunération qui ne sont pas très développées, du reste, au Mali.
Les éléments constitutifs du revenu de l'emploi sont la rémunération totale en espèces (argent), la
rémunération en nature et en services, la rémunération liée aux bénéficies et les prestations de sécurité
sociale. La rémunération totale en espèces comprend les salaires et traitements directs, les congés annuels
et autres congés payés, les primes et gratifications en espèces. Dans les rémunérations en nature et en
services, il y a la nourriture, le logement, le transport, etc. Quant aux prestations de sécurité sociale, on y
inclut les allocations familiales, les primes de départ, les versements en relation avec les absences pour
cause de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations chômage
et les pensions professionnelles et pensions de retraite.
Les indépendants peuvent être scindés en indépendants agricoles et indépendants non agricoles, soit des
artisans. La rémunération des indépendants provient des bénéfices sur la production des biens ou services.
Le revenu de l'emploi indépendant est ainsi égal au revenu des propriétaires uniques ou copropriétaires des
entreprises familiales non constituées en sociétés. C'est un revenu mixte qui mesure l'excédent provenant
 |
67 67 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
57
de la production, nette de toute consommation de capital immobilisé. Les indépendants ne perçoivent pas
de sécurité sociale vu l'absence d'employeurs pour partager les charges, du coup ils ne peuvent adhérer qu'à
des régimes financés par leurs propres cotisations.
Le revenu mensuel total des maliens est ici estimé à 225 milliards de francs CFA répartis entre le revenu
d'emploi (86%), le revenu de chômeur (8%) et le revenu d'inactif (6%). Plus de la moitié de ce revenu (134
milliards de FCFA) va aux ruraux, à cause de leur grand nombre, et le reste au district de Bamako (51
milliards FCFA) et aux autres milieux urbains (39 milliards FCFA). Les hommes reçoivent les 3/4 du
revenu (168 milliards FCFA) alors qu'ils ne comptent que pour moitié dans l'ensemble de la population. Il
y a ainsi des inégalités de revenu aussi bien selon le milieu de résidence et selon le genre.
La structure du revenu total ne change pas beaucoup d'un milieu à l'autre mais on peut noter que, par rapport
à la structure nationale, il y a une augmentation de la part du revenu d'inactif (10%) au détriment du revenu
de chômeur (5%) à Bamako, une diminution de la part du revenu d'inactif (4%) au profit du revenu de
chômeur (9%) en milieu rural. Le revenu des hommes a une part de revenu d'emploi (91%) plus importante
que la moyenne nationale, contrairement aux femmes (73%) qui ont en revanche des parts de revenu de
chômeur (15%) et de revenu d'inactif (11%) plus importantes que pour l'ensemble du pays (Tableau 64).
Tableau 64 : Revenu mensuel total (en millions FCFA et %)
Revenu total Revenu d'emploi Revenu de chômeur Revenu d'inactif
Bamako 51 302 85% 5% 10%
Autre urbain 38 826 85% 7% 8%
Rural 134 870 87% 9% 4%
Homme 168 323 91% 5% 4%
Femme 56 675 73% 15% 11%
D1 2 954 82% 12% 6%
D2 7 099 87% 9% 3%
D3 9 368 88% 8% 3%
D4 13 005 88% 8% 3%
D5 15 441 85% 11% 4%
D6 18 392 86% 10% 4%
D7 22 029 86% 10% 4%
D8 27 729 86% 8% 5%
D9 37 366 85% 8% 8%
D10 71 615 87% 5% 8%
Aucun niveau 137 406 87% 8% 5%
Maternelle 360 38% 16% 46%
Fondamental 1 32 175 86% 9% 5%
Fondamental 2 20 415 84% 7% 9%
Secondaire 19 638 85% 6% 9%
Supérieur 15 005 87% 4% 8%
Total 224 998 86% 8% 6%
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La répartition du revenu total par niveau de vie est également très inégalitaire en faveur des riches (D10)
qui gagnent près du tiers de ce revenu (32% soit 72 milliards FCFA) pour 10% de la population. Les pauvres
(D1 à D4), au contraire, gagnent 14% soit 32 milliards FCFA, beaucoup moins que leur poids dans la
population (40%). C'est au niveau de la classe moyenne (D5 à D9) que la part de revenu (54% soit 121
milliards FCFA) est comparable à leur poids dans la population (50%).
 |
68 68 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
58
La part des ménages dans le revenu total diminue avec le niveau d'éducation du chef de ménage, 137
milliards FCFA pour aucun niveau, 32 milliards FCFA pour le fondamental 1, 20 milliards FCFA pour le
fondamental 2, 20 milliards pour le secondaire et 15 milliards FCFA pour le supérieur. Cette tendance à la
hausse s'explique en partie par les parts de population de ces groupes de ménages. Les ménages dirigés par
un chef sans aucun niveau étant beaucoup plus nombreux que les autres, ils pèsent plus de la moitié (61%)
du revenu total et représentent d'ailleurs, dans le revenu total, moins que ce qu'ils représentent (76%) dans
la population totale. Le niveau supérieur, quant à lui, compte pour 7% du revenu total pour 3% de la
population. La structure du revenu n'est pas bouleversée le long des niveaux d'éducation des chefs de
ménage avec des parts de chaque composante (revenu d'emploi, revenu de chômage et revenu d'inactif)
chaque fois comparables à celles du pays dans son ensemble.
Le revenu moyen généré par tête (d'inactif, d'employé et de chômeur), croisé par les groupes d'âge de travail
selon les principaux déterminants, est obtenu en faisant la somme des revenus et en divisant ensuite cette
somme par le nombre d'individus des 3 catégories (inactif - employé - chômeur). Le revenu total moyen
pour l'ensemble du pays est de 17 346 FCFA par personne et par mois. Le revenu moyen d'activité (228
880 FCFA) et de chômage (29 680 FCFA) sont plus élevés que le revenu total moyen en raison de la prise
en compte, dans le calcul de ce dernier, de tous les individus même ceux qui n'ont aucun revenu. Le revenu
mensuel moyen d'inactif (2 361 FCFA) est néanmoins inférieur à la moyenne nationale du revenu total.
Par tranche d'âge, le revenu total moyen augmente progressivement de 1 215 FCFA pour les 6-14 ans, à 8
995 FCFA pour les 15-24 ans, 24 230 FCFA pour les 25-35 ans, 34 915 FCFA pour les 36-40 ans pour
atteindre son maximum, 43 027 FCFA mensuels pour les 41-64 ans. Il baisse ensuite à 26 651 pour les plus
de 64 ans. Le revenu d'emploi moyen suit la même trajectoire que le revenu total moyen avec la plus petite
valeur (1 420 FCFA) pour les plus jeunes (6-14 ans) et la plus grande valeur (53 128 FCFA) pour les 41-
64 ans. Le revenu d'inactif croit aussi avec l'âge mais avec un maximum situé dans la tranche d'âge des
retraités, les plus de 64 ans. Le revenu moyen de chômage ne varie quasiment pas selon le groupe d'âge,
autour de 30 000 FCFA mensuels (Tableau 65).
Tableau 65 : Revenu mensuel moyen par tranche d'âge (en FCFA)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans Plus de 64 ans Total
Revenu total 1 215 8 995 24 230 34 915 43 027 26 651 17 346
Revenu d'emploi 1 420 11 487 29 082 41 495 53 128 49 649 28 880
Revenu de chômeur 30 000 29 066 29 777 29 920 30 290 30 000 29 680
Revenu d'inactif 445 1 843 3 698 3 445 7 633 12 174 2 361
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Dans l'analyse des revenus moyens selon leurs déterminants, il faut noter que le revenu de chômeur reste
quasiment au même niveau, autour de 30 000 FCFA, quel que soit le déterminant Du coup, on s'intéressera
davantage au revenu total et à ses autres composantes. Le revenu total moyen varie selon le milieu de
résidence, les bamakois ayant la plus forte moyenne (29 991 FCFA), suivi des autres urbains (23 3003
FCFA) et des ruraux qui gagnent moins de la moitié (14 057 FCFA) de ce que gagnent les Bamakois. Nous
avons le même classement en matière de revenu d'emploi moyen mais avec des écarts plus importants entre
milieux de résidence, 63 638 FCFA pour Bamako, 50 150 FCFA pour autre urbain et 21 866 FCFA pour
le rural. De même, le revenu d'inactif est le plus élevé à Bamako (5 424 FCFA), suivi des autres milieux
urbains (3 394 FCFA) et du milieu rural (1 359 FCFA).
 |
69 69 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
59
Le revenu moyen des hommes vaut 3 fois celui des femmes, aussi bien en revenu total qu'en revenu
d'emploi. En effet, les hommes gagnent en moyenne 26 614 FCFA en revenu total et 40 807 FCFA en
revenu d'emploi quand les femmes en moyenne gagnent 8 527 FCFA en revenu total et 13 938 FCFA en
revenu d'emploi. La même inégalité genre, en défaveur des femmes, persiste quant au revenu d'inactif, 3
087 FCFA pour les hommes contre 1 864 FCFA pour les femmes.
La moyenne du revenu total comme celle de ses composantes, revenu d'emploi et revenu d'inactif, s'accroît
continuellement le long des déciles ce qui génère de grandes inégalités. Les 10% les plus riches gagnent,
en revenu total et en revenu d'emploi, 21 fois ce que gagnent les 10% les plus pauvres et la situation s'empire
quant au revenu d'inactif avec un rapport de 37 contre 1 dans le même sens.
Entre pauvres (D1-D4), classe moyenne inférieure (D5-D7), classe moyenne supérieure (D8-D9) et riches
(D10), les inégalités ne s'amenuisent pas. La moyenne de revenu total est à peu près doublée chaque fois
qu'on passe d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Le retenu total moyen passe ainsi de 6 507
FCFA pour les pauvres à 14 389 FCFA pour la classe moyenne inférieure, 24 376 FCFA pour la classe
moyenne supérieure et 49 437 pour les riches. Pour le revenu d'emploi moyen, les écarts sont un peu plus
importants entre les classes successives avec 10 444 FCFA pour les pauvres, 22 841 FCFA pour la classe
moyenne inférieure, 24 376 FCFA pour la classe moyenne supérieure et 92 257 FCFA pour les riches. Le
revenu moyen de chômeur est d'à peu près 30 000 FCFA pour toutes les classes à l'exception des pauvres
pour lesquels il est de 29 161 FCFA. Le revenu moyen d'inactif fait plus que doubler d'une classe à la
suivante, allant de 526 FCFA pour les pauvres à 1 338 FCFA pour la classe moyenne inférieure, 3 605
FCFA pour la classe moyenne supérieure et 8 904 FCFA pour les riches (Tableau 66).
Tableau 66 : Revenu mensuel moyen (en FCFA)
Revenu total Revenu d'emploi Revenu de chômeur Revenu d'inactif
Bamako 29 991 63 638 29 708 5 424
Autre urbain 23 303 50 150 29 791 3 394
Rural 14 057 21 866 29 649 1 359
Homme 26 614 40 807 29 998 3 087
Femme 8 527 13 938 29 377 1 864
D1 2 349 4 427 26 776 238
D2 5 738 9 216 29 802 445
D3 7 909 12 121 29 908 651
D4 10 030 15 997 30 157 768
D5 12 068 18 374 29 512 1 181
D6 14 335 22 868 29 539 1 308
D7 16 763 27 282 29 698 1 526
D8 20 805 35 021 29 566 2 514
D9 27 946 49 389 29 720 4 695
D10 49 437 92 257 29 986 8 904
Aucun niveau 17 464 24 105 29 805 2 666
Maternelle 1 068 6 444 30 000 527
Fondamental 1 10 003 25 343 29 589 852
Fondamental 2 19 005 42 732 30 220 2 789
Secondaire 59 872 93 314 31 203 15 324
Supérieur 101 675 166 843 25 180 29 329
Total 17 346 28 880 29 680 2 361
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
A partir du niveau fondamental 1, les revenus moyens croissent avec le niveau d'éducation du chef de
ménage. Dans le cas du revenu total, le revenu moyen quitte 10 003 FCFA, son plus bas niveau, au
 |
70 70 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
60
fondamental 1 pour atteindre son plus haut niveau (101 675 FCFA) dans les ménages dirigés par un chef
de niveau supérieur. Entre le niveau sans instruction (17 464 FCFA) et le niveau fondamental 1, il y a, au
contraire, une baisse de revenu total moyen en ne tenant pas compte du niveau maternel qui ne représente
qu'une infime partie des ménages. Le niveau fondamental 1 est le seul à avoir un revenu total moyen
inférieur à la moyenne nationale de 17 346 FCFA mensuels par personne.
Dans le cas du revenu d'emploi moyen, la croissance commence au niveau "aucun" (24 105 FCFA) jusqu'au
niveau supérieur (166 843 FCFA), faisant fi, une fois encore, du niveau maternel. A la seule exception du
niveau "aucun", tous les autres niveaux d'éducation dépassent la moyenne nationale en la matière, 28 880
francs FCFA de revenu d'emploi par mois et par personne. Il faut cependant noter que les niveaux
secondaire (93 314 FCFA) et supérieur (166 843 FCFA) se détachent nettement des autres niveaux. Le
revenu moyen d'inactif baisse entre le niveau "aucun" (2 666 FCFA) et le niveau fondamental 1 (852
FCFA), il augmente ensuite progressivement à 2 789 FCFA pour le fondamental 2, 15 324 FCFA pour le
secondaire et 29 329 FCFA pour le supérieur. Ici aussi c'est le niveau fondamental 1 qui est le seul à ne pas
atteindre la moyenne nationale.
7.2. Revenu moyen d'activité
Les rémunérations annuelles ont été divisées par 12 pour les avoir mensuellement, plus courte période
correspondant mieux, non pas à la mesure des flux de revenu dans le temps, mais à celle des flux du revenu
d'activité. Ces rémunérations correspondent aux salaires et avantages non inclus dans le salaire pour les
salariés et aux revenus d'activité pour les indépendants. Les avantages non salariaux des salariés
comprennent les congés annuels, les congés maladie, les régimes de retraite, l'assurance santé et assurance
vie et l'intéressement aux bénéfices. Les données chiffrées pourraient montrer l'importance et le nombre de
bénéficiaires de tels avantages mais elles ne sont pas encore disponibles.
Le revenu moyen d'activité généré par tête d'employé est, pour tout groupe d'âge confondu, le plus élevé à
Bamako (60 569 FCFA), suivi des autres milieux urbains (47 090 FCFA) avec le niveau le plus bas (20 973
FCFA) en milieu rural. Ce classement est le même dans toutes les tranches d'âge prises isolément à
l'exception des 36-40 ans pour lesquels les autres milieux urbains (76 269 FCFA) passent devant Bamako
(68 745 FCFA) même si le milieu rural (29 554 FCFA) garde sa dernière place. On peut noter aussi que les
écarts, entre milieux, sont réduits chez les 64 ans et plus. Comme pour le pays dans son ensemble, à
Bamako, le revenu moyen d'activité croit continuellement en fonction de l'âge, de 11 445 FCFA pour les
6-14 ans pour atteindre son maximum (93 180 FCFA) dans la tranche d'âge 41-64 ans. Sa trajectoire est
comparable mais quelque peu différente dans les autres milieux urbains où il croit entre la tranche d'âge 6-
14 ans (5 0116 FCFA) et celle des 36-40 ans où on observe son niveau le plus élevé (76 269 FCFA) et
décroît ensuite progressivement de ce niveau pour se situer à 65 988 FCFA chez les 41-64 ans puis à 47
000 FCFA chez les plus de 64 ans. L'évolution du revenu moyen d'activité est tout autre le long de la vie
avec une croissance continue depuis le bas âge (6-14 ans) jusqu'aux âges les plus avancés (plus de 64 ans),
passant ainsi de 1 020 FCFA à 43 160 FCFA.
Dans tous les ménages, qu'ils soient dirigés par des hommes ou par des femmes, le revenu moyen d'activité
augmente en fonction de l'âge et atteint son niveau maximal (71 000 FCFA pour les hommes et 19 806
FCFA pour les femmes) dans la tranche d'âge 41-64 ans à partir de laquelle il baisse jusqu'à 56 794 FCFA
dans les ménages des hommes et 15 230 FCFA dans les ménages des femmes. Son niveau est toujours plus
 |
71 71 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
61
élevé, quelle que soit la tranche d'âge considérée, dans les ménages dirigés par un homme que dans les
ménages dirigés par une femme. Par ailleurs, l'écart entre les 2 sexes semble se creuser en fonction de l'âge
avec les plus grandes différences durant les âges de fin de vie active (41-64 ans) et durant la retraite (plus
de 64 ans).
Le revenu d'activité moyen par tranche d'âge et par décile laisse entrevoir d'importantes inégalités entre les
plus pauvres et les plus riches. Par exemple les 10 % les plus riches gagnent, en moyenne, 11 à 46 fois ce
que gagnent en moyenne les 10% les plus pauvres (D1). Le rapport est inversement proportionnel à l'âge,
11 pour les plus de 64 ans et 46 pour les 6-14 ans. Les 41-64 ans, la dernière tranche d'âge officiel d'activité,
ont des revenus moyens d'activité 3 à 9 fois plus élevés que ceux des 15-24 ans, tranche d'âge officielle
d'activité la plus jeune (Tableau 67).
Tableau 67 : Revenu mensuel moyen d'activité
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Bamako 11 445 24 996 53 080 68 745 93 180 55 997 60 569
Autre urbain 5 016 18 249 46 751 76 269 65 988 47 000 47 090
Rural 1 020 8 983 21 258 29 554 40 553 43 160 20 973
Homme 1 416 13 979 41 600 60 852 71 000 56 794 39 198
Femme 1 279 8 168 15 227 16 537 19 806 15 230 12 966
D1 239 1 425 3 168 7 739 9 857 8 129 4 091
D2 837 2 613 7 939 14 077 18 666 24 471 8 657
D3 583 3 545 10 714 17 309 26 384 25 892 11 680
D4 462 4 074 13 708 23 544 34 701 32 983 15 499
D5 555 6 822 15 138 28 621 37 378 25 374 17 770
D6 498 6 303 20 536 31 997 41 299 53 145 21 632
D7 1 881 10 814 27 393 38 855 45 194 46 864 26 431
D8 2 084 17 122 34 433 47 562 57 389 47 106 34 188
D9 4 696 19 950 45 657 66 441 69 263 68 278 47 154
D10 10 999 45 824 81 530 120 003 119 807 85 671 86 603
Aucun niveau 1 438 8 613 21 595 30 776 40 398 43 072 23 091
Maternelle 876 17 476 10 789 15 413 20 169 5 883
Fondamental 1 1 085 13 149 33 492 49 250 55 920 54 898 24 045
Fondamental 2 4 174 17 928 43 814 78 643 78 138 75 827 40 817
Secondaire 41 860 72 556 118 064 117 626 76 117 87 443
Supérieur 44 970 102 873 154 996 226 204 137 708 158 588
Total 1 364 11 263 28 259 40 266 50 009 44 591 27 554
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
L'analyse par classes sociales, en distinguant les pauvres (D1-D4), de la classe moyenne inférieure (D5-
D7), de la classe moyenne supérieure (D9-D10) et des riches, montre la persistance des inégalités. Les
pauvres gagnent entre 530 et 22 869 FCFA par mois et par personne, la classe moyenne inférieure entre
978 et 41 794 FCFA 390, la classe moyenne supérieure entre 3 390 et 63 326 FCFA et les riches entre 10
999 et 120 003 FCFA. Le revenu moyen d'activité augmente non seulement suivant l'âge mais aussi suivant
la classe sociale, les plus jeunes (6-14 ans) et les pauvres ayant les plus faibles revenus contrairement aux
plus âgés (41-64 ans et plus de 64 ans) et aux riches qui ont les revenus les plus élevés. On peut remarquer
que le revenu moyen d'activité est maximal à 36-40 ans pour les riches et à 41-64 ans pour la classe moyenne
supérieure. Pour les pauvres et la classe moyenne inférieure, c'est à plus de 64 ans que le revenu moyen
d'activité atteint son plus haut niveau.
Dans l'ensemble, le revenu d'activité moyen est le plus élevé dans les ménages dirigés par des chefs de
niveau supérieur, 158 588 FCFA, suivi du secondaire (87 443 FCFA) et du fondamental 2 (40 817 FCFA).
 |
72 72 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
62
La plus petite valeur est pour les ménages dont le chef est sans aucune instruction (23 091 FCFA), derrière
les ménages dont le chef a le niveau fondamental 1 (24 045 FCFA). Sans tenir compte du niveau maternel,
le niveau d'éducation du chef de ménage semble avoir un lien positif avec le revenu moyen d'activité et cela
aussi bien pour l'ensemble que pour chaque tranche d'âge. Ainsi, le revenu moyen d'activité va de 40 398 à
226 204 FCFA avec une moyenne de 50 009 FCFA pour les 41-64 ans et de 43 072 à 137 708 FCFA avec
une moyenne de 44 591 FCFA pour les plus de 64 ans, deux tranches d'âge renfermant le plus de chefs de
ménages.
7.3. Revenu moyen d'activité principale
Dans l'ensemble, l'activité principale rapporte en moyenne 24 221 FCFA par mois et par personne mais
cette moyenne diffère selon les tranches d'âge et le milieu de résidence. Ce sont les 41-64 ans qui en tirent
le plus de revenu (44 775 FCFA) juste devant les plus de 64 ans (40 379 FCFA) et les 36-40 ans (35 836
FCFA). Les plus jeunes en tirent le moins de revenu avec 9 309 FCFA pour 15-24 ans et 24 226 FCFA
pour les 25-35 ans. L'activité principale rapporte plus à Bamako (59 829 FCFA) que dans les autres milieux
urbains (44 455 FCFA) et dans le milieu rural (17 226 FCFA). Il en est ainsi à tous les âges sauf à 36-40
ans où les autres milieux urbains (72 988 FCFA) passent devant Bamako (68 417 FCFA) comme dans le
cas du revenu d'activité d'ensemble. Les écarts entre milieux sont les plus importants à 41-64 ans. A
Bamako, le revenu moyen d'activité principale augmente avec l'âge pour atteindre son plus haut niveau (91
867 FCFA) à 41-64 ans. Par contre, dans les autres milieux urbains sa croissance s'arrête à 36-40 ans (72
988 FCFA), âge à partir duquel il décroît jusqu'à plus de 64 ans (44 022 FCFA). En milieu rural, il croit
sans interruption de 6-14 ans (900 FCFA) à plus de 64 ans (38 398 FCFA).
L'activité principale rapporte en moyenne beaucoup plus aux hommes (34 703 FCFA) qu'aux femmes (11
089 FCFA). Cet ordre de grandeur ne change pas en fonction de l'âge même si les 2 sexes ont des revenus
moyens d'activité principale comparable à 6-14 ans, 1 282 FCFA pour les hommes et 1 200 FCFA pour les
femmes. Tout âge confondu, le revenu moyen d'activité montre une grande variabilité entre les déciles de
revenu. Les 10% les plus riches tirent (82 164 FCFA) de l'activité principale plus de 23 fois que ce qu'en
tirent les 10% les plus pauvres (3 504 FCFA). Les 7 premiers déciles (comprenant les pauvres et la couche
inférieure de la classe moyenne) ont chacun moins de la moyenne nationale de 24 221 FCFA par mois et
par personne contrairement aux 3 derniers qui dépassent largement cette moyenne.
La classification en pauvres (D1-D4), classe moyenne inférieure (D5-D7), classe moyenne supérieure (D8-
D9) et riches (D10) montre que le revenu moyen d'activité est à peu près multiplié par 2 à chaque fois qu'on
quitte une classe pour la classe immédiatement supérieure. On passe de 8 129 FCFA pour les pauvres à 18
046 FCFA pour la classe moyenne inférieure puis à 36 014 FCFA pour la classe moyenne supérieure puis
à 82 165 FCFA pour les riches. L'ordre est le même quel que soit le groupe d'âge. Le revenu moyen des
pauvres augmente suivant l'âge, de 492 FCFA à 6-14 ans à 20 659 FCFA pour les plus de 64 ans. Celui de
la classe moyenne inférieure à la même trajectoire suivant l'âge, partant de 861 FCFA à 6-14 ans à 38 074
FCFA à plus de 64 ans. La croissance du revenu moyen d'activité principale s'arrête plus tôt pour les 2
autres classes sociales. Pour la classe moyenne supérieure, il y a une croissance de 2 866 FCFA à 6-14 ans
à 57 128 FCFA à 41-64 ans, suivie d'une décroissance à plus de 64 ans. Pour les riches, la croissance s'arrête
une classe d'âge plus tôt de 6-14 ans (10 999 FCFA) à 36-40 ans (117 580 FCFA), suivie d'une décroissance
jusqu'à plus de 64 ans, 79 527 FCFA (Tableau 68).
 |
73 73 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
63
Tableau 68 : Revenu mensuel moyen de l'activité principale (en FCFA)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Bamako 11 445 24 751 52 280 68 417 91 867 55 897 59 829
Autre urbain 5 004 17 288 44 040 72 988 61 940 44 022 44 455
Rural 900 6 732 16 475 24 194 34 475 38 398 17 226
Homme 1 282 11 592 35 852 54 768 63 841 51 235 34 703
Femme 1 200 6 708 12 870 14 013 17 293 14 259 11 089
D1 227 1 256 2 571 6 131 8 656 7 933 3 504
D2 812 1 954 6 006 10 862 15 601 22 171 7 021
D3 488 2 694 7 677 13 296 21 723 23 813 9 270
D4 441 2 502 10 710 18 805 29 752 28 719 12 719
D5 465 4 435 11 789 24 674 31 608 24 827 14 641
D6 249 4 779 14 849 25 682 35 543 47 101 17 590
D7 1 868 8 140 21 621 33 923 37 841 42 295 21 908
D8 2 031 14 081 29 349 40 696 50 285 41 326 29 465
D9 3 701 16 854 40 276 61 232 63 971 61 108 42 562
D10 10 999 41 990 76 569 117 580 114 417 79 527 82 165
Aucun niveau 1 309 6 538 17 325 26 428 34 988 38 756 19 513
Maternelle 876 15 752 10 789 8 623 19 545 5 490
Fondamental 1 1 006 11 307 28 607 42 904 50 167 51 241 21 091
Fondamental 2 3 985 16 481 41 469 75 614 75 807 75 827 38 901
Secondaire 39 545 71 425 114 443 113 961 76 117 85 141
Supérieur 43 237 101 522 154 266 219 752 134 089 155 111
Cadre supérieur 0 118 543 196 418 241 028 350 000 198 621
Cadre moyen 83 785 90 264 108 605 145 695 109 488 114 796
Employé / ouvrier 7 979 32 366 64 057 88 021 91 052 38 701 64 016
Manœuvre 6 110 21 708 33 548 43 597 45 331 28 796 29 683
Employeur 29 185 94 566 83 687 133 429 108 954 108 120
Indépendant 9 397 18 570 30 339 39 862 43 260 41 848 35 443
Apprenti 6 187 16 648 25 292 36 568 38 644 17 647
Aide familial 648 2 410 2 291 2 009 3 093 2 339 1 861
Indépendant agricole 719 3 951 11 356 18 964 30 031 39 173 13 409
Indépendant non agricole 4 370 21 594 38 684 52 325 54 975 41 446 39 559
Salarié privé 7 393 28 204 58 373 67 609 110 515 45 013 59 873
Salarié public 72 887 92 968 128 228 131 716 142 854 114 559
Administration publique 76 703 96 276 110 471 141 172 105 718 116 648
Entreprise publique 43 635 74 898 200 832 100 650 97 811
Entreprise privée 1 418 12 077 26 161 37 140 43 580 39 512 27 354
Entreprise associative 0 23 380 36 558 43 159 66 643 68 605 34 537
Organisme international 161 667 53 618 117 171 105 640
Personnel de maison 1 111 3 108 8 413 12 446 26 984 40 927 8 295
Agriculture 745 4 063 11 505 18 946 30 383 39 393 13 563
Industrie 2 019 26 873 41 584 56 463 65 796 33 183 43 487
Service marchand 3 100 24 805 42 151 59 814 61 592 38 658 45 719
Service non marchand 8 337 21 004 66 013 79 116 104 014 65 710 62 301
Total 1 251 9 309 24 226 35 836 44 755 40 379 24 221
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Le revenu d'activité principale moyen augmente avec le niveau d'instruction du chef de ménage dans
l'ensemble, 19 513 FCFA pour les ménages des chefs sans instruction, 21 091 FCFA dans les ménages des
chefs de niveau fondamental 1, 38 901 FCFA pour le fondamental 2, 85 141 FCFA pour le secondaire et
155 111 FCFA pour le supérieur. Le lien positif avec le niveau d'éducation du chef de ménage persiste à
l'intérieur des tranches d'âge. Entre le niveau aucun et le niveau supérieur du chef de ménage, le revenu
moyen va de 34 988 FCFA à 219 752 FCFA pour les 41-64 ans et de 38 756 FCFA à 134 089 FCFA pour
les plus de 64 ans. Le revenu moyen augmente avec l'âge, atteint un niveau maximum puis décroît si ce
 |
74 74 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
64
maximum est atteint avant plus de 64 ans. Le maximum est atteint à 36-40 ans pour le niveau secondaire,
à 41-64 ans pour le niveau supérieur et à plus de 64 ans pour les autres niveaux.
De l'activité principale, le cadre supérieur tire le maximum de revenu possible (198 621 FCFA), juste devant
le cadre moyen (114 796 FCFA) et l'employeur (108 120 FCFA). Les autres catégories
socioprofessionnelles arrivent, dans un ordre décroissant du revenu d'activité principale moyen,
l'employé/ouvrier (64 016 FCFA), l'indépendant (35 443 FCFA), le manœuvre (29 683 FCFA), l'apprenti
(17 647 FCFA) et l'aide familial (861 FCFA). Seuls l'apprenti et l'aide familial n'atteignent pas la moyenne
nationale de 24 221 FCFA.
Le salarié public est le mieux rémunéré, et de loin, dans l'activité principale, 114 559 FCFA en moyenne,
suivi du salarié privé qui ne gagne que la moitié de ce montant (59 873) et de l'indépendant non agricole
(39 559 FCFA). L'indépendant agricole est le moins bien rémunéré par son activité principale avec
seulement 13 409 FCFA, bien en deçà de la moyenne nationale de 24 221 FCFA. Ce classement est
absolument le même à l'intérieur des classes d'âge. La rémunération d'activité principale de chaque statut
salarial croit continuellement suivant l'âge pour atteindre son niveau le plus élevé à 41-64 ans pour
l'indépendant non agricole et le salarié privé et à plus de 64 ans pour l'indépendant agricole et le salarié
public.
Conformément à l'analyse par statut salarial, l'administration publique paye mieux que n'importe quel autre
employeur, en moyenne 116 648 FCFA, suivie de l'organisme international (105 640 FCFA) et de
l'entreprise publique (97 811 FCFA). Autrement dit, ce sont les employés du secteur public et parapublic
national et les fonctionnaires internationaux qui sont les mieux payés dans leur activité principale. Les
employés des organismes associatifs ou ONG (34 537 FCFA), des entreprises privées (27 354 FCFA) et le
personnel de maison (8 295 FCFA) sont beaucoup moins bien payés. Le revenu d'activité principale croit
jusqu'à l'âge de 41-64 ans (414 172 FCFA) dans l'administration publique, jusqu'à 36-40 ans (200 832
FCFA) dans les entreprises publiques, jusqu'à 41-64 ans (43 580 FCFA) dans les entreprises privées, jusqu'à
plus de 64 ans dans les associations/ONG (68 605 FCFA) et pour le personnel de maison (40 927 FCFA).
La trajectoire du revenu d'activité principale moyen dans les organismes internationaux est particulière en
ce sens qu'elle commence par une décroissance entre 15-24 ans et 25-35 ans, suivie d'une croissance à 41-
64 ans. Il faut noter par ailleurs que cet employeur ainsi que l'administration publique et l'entreprise
publique n'emploient pas des 6-14 ans, cela étant du travail des enfants.
Le secteur non marchand (essentiellement sécurité, éducation et santé) rémunère le plus l'activité principale
avec 62 301 FCFA en moyenne. Le secteur marchand vient en deuxième position (45 719 FCFA), juste
devant le secteur industriel (43 487 FCFA). Le secteur agricole (13 563 FCFA) est encore une fois celui
qui paye le moins bien l'activité principale. Dans tous les secteurs d'activité, le revenu moyen d'activité
principale augmente progressivement du plus jeune âge jusqu'à 41-64 ans, âge auquel il atteint son plus
haut niveau sauf pour le secteur agricole. Dans le secteur agricole, la croissance du revenu continue jusqu'à
plus de 64 ans, tranche d'âge qui a la plus forte moyenne de revenu d'activité principale.
 |
75 75 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
65
7.4. Revenu moyen d'activité secondaire
Pour compenser la faiblesse du revenu d'activités principales, les actifs mènent souvent une ou plusieurs
activités secondaires. Les revenus tirés de ces activités secondaires contribuent ainsi à diminuer les
inégalités de revenu global (qui restent ainsi moins fortes que les inégalités de revenu d'activité principale).
Dans le secteur agricole, "la pluriactivité permet, en définitive de réduire la dispersion des revenus globaux
entre foyers d'agriculteurs. Les foyers pluriactifs ont des revenus globaux plus élevés, soit compte tenu des
imperfections du marché du travail, soit compte tenu d'une préférence plus forte de certains pour le travail
indépendant agricole relativement au travail hors de l'exploitation, souvent effectué à titre salarié" (Jean-
Pierre Butault et al. 1999). Cette contribution à l'inégalité est interprétée comme étant "la baisse de
l'inégalité de revenu global qu'on constaterait si la source de revenu considérée était égalitairement répartie
ou nulle pour tous les individus". C'est une décomposition par source et non par classe.
L'activité secondaire rapporte en moyenne 14 759 FCFA par type de pluriactif, 10 989 FCFA aux 15-24
ans, 15 625 FCFA aux 25-35 ans, 14 775 FCFA aux 36-40 ans, 17 735 FCFA aux 41-64 ans et 21 199
FCFA aux plus de 64 ans. Comme l'activité principale, l'activité secondaire rapporte plus à Bamako (37 793
FCFA) que dans le reste urbain (20 407 FCFA) et en milieu rural (14 204 FCFA). Contrairement au revenu
d'activité principale moyen, le revenu moyen d'activité secondaire semble évoluer en dents de scie en
alternant des hausses et des baisses dans tous les milieux à mesure que l'âge avance. Le maximum est atteint
dans la tranche 41-64 ans à Bamako, dans la tranche 36-40 ans dans autre urbain et dans la tranche plus de
64 ans en milieu rural.
Les hommes (22 167 FCFA) tirent de l'activité secondaire plus de revenu que les femmes (7 370 FCFA)
qui ont moins que la moyenne au niveau national. En moyenne, ce revenu augmente progressivement le
long des déciles de revenu. Les déciles 1 à 6 ont des revenus d'activité secondaires moyens inférieurs à la
moyenne, respectivement 4 181 FCFA, 6 588 FCFA, 9 657 FCFA, 10 481 FCFA, 11 892 FCFA, et 14 495
FCFA contrairement aux déciles 7 à 10 qui sont au-dessus de la moyenne avec respectivement 16 328
FCFA, 20 278 FCFA, 27 761 FCFA et 39 944 FCFA. Cela génère de grandes inégalités entre les pauvres
(D1-D4), la classe moyenne inférieure (D5-D7), la classe moyenne supérieure (D8-D9) et les riches (D10).
Le revenu moyen est à peu près doublé à chaque fois qu'on passe d'une classe sociale à la classe
immédiatement supérieure, de 7 731 FCFA pour les pauvres à 14 238 FCFA pour la classe moyenne
inférieure, 24 020 FCFA pour la classe moyenne supérieure et 39 944 FCFA pour les riches. Les pauvres
et la classe moyenne inférieure ont moins que la moyenne nationale (14 759 FCFA).
L'évolution du revenu d'activité secondaire moyen en fonction du niveau d'éducation du chef de ménage
n'est pas monotone, avec une augmentation entre aucun niveau (14 382 FCFA) et le fondamental 1 (15 306
FCFA), une baisse entre le fondamental 1 et le fondamental 2 (13 839 FCFA) et une hausse de ce niveau
jusqu'au supérieur (56 163 FCFA) en passant par le secondaire (31 362 FCFA). Dans les tranches d'âge
officiel d'activité, de 15-24 ans à 41-64 ans, les niveaux secondaire et supérieur ont les 2 plus grandes
moyennes de revenu d'activité secondaire (Tableau 69).
En moyenne, un cadre supérieur gagne en activité secondaire 60 000 FCFA par mois, un peu plus que ce
que gagne un cadre moyen (55 314 FCFA) dans la même activité secondaire. Viennent ensuite le manœuvre
(26 877 FCFA), l'employeur (24 404 FCFA), l'employé/ouvrier (24 070 FCFA), l'indépendant (17 825
FCFA), l'apprenti (2 340 FCFA) et l'aide familial (1138 FCFA).
 |
76 76 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
66
Tableau 69 : Revenu mensuel moyen de l'activité secondaire (en FCFA)
6 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 40 ans 41 - 64 ans plus de 64 ans Total
Bamako 24 883 28 184 20 563 64 823 7 500 37 793
Autre urbain 435 8 045 21 906 26 665 24 010 25 475 20 407
Rural 1 349 11 104 15 069 14 145 16 850 21 076 14 204
Homme 2 012 17 386 25 491 23 010 23 979 25 419 22 167
Femme 695 6 522 8 129 7 408 8 579 6 450 7 370
D1 158 1 733 3 552 7 080 6 283 3 712 4 181
D2 161 4 076 7 225 7 599 8 795 14 312 6 588
D3 1 543 5 951 9 516 10 059 12 006 10 834 9 675
D4 281 7 719 8 516 12 255 14 526 15 074 10 481
D5 1 725 10 016 12 047 10 779 14 545 3 607 11 892
D6 3 273 7 464 15 950 15 515 16 187 29 314 14 495
D7 124 11 273 17 066 17 247 20 471 21 944 16 328
D8 768 14 778 21 170 24 042 23 678 20 041 20 278
D9 11 346 21 380 29 749 37 659 27 590 34 362 27 761
D10 0 33 246 49 719 29 671 45 564 36 281 39 944
Aucun niveau 1 553 11 392 14 729 13 395 16 731 21 247 14 382
Maternelle 0 14 500 9 853 2 229 4 782
Fondamental 1 900 9 687 20 996 20 798 20 787 20 910 15 306
Fondamental 2 1 157 9 811 17 392 21 917 19 341 13 839
Secondaire 25 895 24 813 49 402 31 346 31 362
Supérieur 39 500 17 439 28 000 122 473 15 000 56 163
Cadre supérieur 60 000 60 000
Cadre moyen 25 000 54 871 65 631 55 314
Employé / ouvrier 6 490 17 659 24 539 30 285 27 682 24 070
Manœuvre 5 000 23 877 31 632 21 370 27 601 26 877
Employeur 20 779 39 500 27 059 18 002 24 404
Indépendant 14 733 16 083 17 772 16 259 18 676 21 822 17 825
Apprenti 0 865 8 577 5 000 2 340
Aide familial 362 1 533 851 2 536 1 242 2 799 1 138
Indépendant agricole 541 5 744 9 711 11 755 15 547 22 178 10 795
Indépendant non agricole 6 220 19 810 24 124 18 504 20 530 19 127 20 867
Salarié privé 5 936 21 995 30 510 26 594 27 409 26 113
Salarié public 25 000 21 000 56 182 50 368
Administration publique 0 25 000 19 797 14 669 55 655 34 089
Entreprise publique 21 000 38 212 37 573
Entreprise privée 1 874 11 349 14 932 14 507 18 093 21 458 15 153
Entreprise associative 37 062 51 126 47 650 15 143 18 000 38 584
Organisme international 0 0
Personnel de maison 684 7 272 13 325 10 217 10 830 20 066 8 676
Agriculture 578 5 958 9 964 11 890 15 568 22 178 10 921
Industrie 1 344 27 371 28 673 20 705 20 364 14 899 23 783
Service marchand 10 317 11 920 18 617 17 498 18 870 18 494 17 282
Service non marchand 0 21 752 34 870 20 502 36 580 26 760 30 607
Total 1 336 10 989 15 625 14 775 17 735 21 199 14 759
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Le statut de salarié le plus favorable à l'activité secondaire est d'être salarié public, cela permettant de gagner
2 fois plus (50 368 FCFA) qu'un salarié privé (26 113 FCFA), près de 3 fois plus qu'un indépendant non
agricole (20 867 FCFA) et 3 fois plus qu'un indépendant agricole (10 795 FCFA). Le même ordre de
grandeur est conservé dans les tranches d'âge 41-64 ans et 15-24 ans contrairement aux 25-35 ans où c'est
le salarié privé qui est le mieux payé (30 510 FCFA) devant l'indépendant non agricole (24 124 FCFA) et
le salarié public (21 000 FCFA).
 |
77 77 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
67
Les rémunérations d'activités secondaires des indépendants agricoles croissent de façon continue suivant
l'âge avec un revenu maximal de 22 178 FCFA à plus de 64 ans. Les revenus des indépendants agricoles
sont en général plus élevés mais plus fluctuants en alternant des hausses et des baisses le long des tranches
d'âge avec un niveau maximal de 24 124 FCFA à 25-35 ans. La même fluctuation de revenu d'activité
secondaire s'observe chez les salariés avec des maximums de 30 510 FCFA à 25-35 ans pour le privé et de
56 182 FCFA à 41-64 ans pour le public.
Dans l'analyse du revenu d'activité secondaire par type d'entreprise, on observe qu'il n'existe pas d'activité
secondaire dans les organismes internationaux. Par ailleurs, les plus de 64 ans n'exercent leur activité
secondaire que soit dans l'entreprise privée, soit dans l'entreprise associative/ONG ou alors à domicile. En
fin, l'entreprise publique n'emploie, en activité secondaire, que les 25-35 ans et les 41-64 ans. Dans
l'ensemble, l'entreprise associative/ONG paye le plus (38 584 FCFA) en activité secondaire, suivie de
l'entreprise publique (37 573 FCFA), de l'administration publique (34 089 FCFA) et l'entreprise privée. (15
153 FCFA). Le personnel de maison est le moins bien rémunéré comme actif secondaire (8 676 FCFA). Le
classement varie beaucoup d'une tranche d'âge à une autre. A 41-64 ans, l'administration publique et
l'entreprise publique offrent les premières et deuxième plus grande. L'entreprise privée a la particularité
d'utiliser tous les groupes d'âge et de leur offrir des rémunérations croissantes avec leur âge.
Par secteur d'activité, le service non marchand paie le plus (30 607 FCFA) en activité secondaire, suivi de
l'industrie (23 783 FCFA), du service marchand (17 282 FCFA), le secteur agricole étant le moins
rémunérateur (10 921 FCFA) en activité secondaire et en même temps le seul secteur payant moins que les
14 759 FCFA de moyenne nationale. Dans les tranches d'âge de pleine vie active (de 25 à 64 ans), le
classement est à peu près conforme au classement d'ensemble avec les 2 plus fortes rémunérations par le
service non marchand et l'industrie, devant le service marchand et l'agriculture. L'agriculture est le secteur
où le revenu d'activité secondaire augmente continuellement d'âge en âge pour un niveau maximal à plus
de 64 ans. Tous les autres secteurs montrent des hausses et des baisses de rémunération qui atteignent leur
maximum à 25-35 ans dans l'industrie et à 41-64 ans dans le service marchand et le service non marchand.
 |
78 78 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
68
8. Le sous-emploi
Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le sous-emploi existe « lorsque la durée ou la
productivité de l’emploi d’une personne sont inadéquates par rapport à un autre emploi possible que cette
personne est disposée à occuper et capable de faire. » Il est interprété notamment comme une défaillance
du marché du travail.
L'OIT distingue plusieurs formes de sous-emploi :
le sous-emploi visible, qui se caractérise par un nombre d’heures de travail insuffisant, reflétant une
durée du temps de travail inadéquate ;
les autres formes de sous-emploi (parfois qualifiées de sous-emploi invisible), qui se caractérisent
par un revenu horaire insuffisant, un mauvais emploi des compétences professionnelles, etc.,
reflétant une productivité du travail inadéquate résultant d’une mauvaise répartition des ressources
de main-d’œuvre ou d’un déséquilibre fondamental entre le travail et les autres facteurs de
production.
Le sous-emploi au sens du BIT comprend les personnes actives occupées (définition BIT) qui remplissent
l'une des conditions suivantes :
Elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage pendant la période de référence
utilisée pour définir l'emploi, et sont disponibles pour le faire, qu'elles recherchent activement un
emploi ou non ;
Elles travaillent à temps partiel (et sont dans une situation autre que celle décrite ci-dessus) ou à
temps complet, mais ont travaillé moins que d'habitude pendant une semaine de référence en raison
de chômage partiel, ralentissement des affaires, réduction saisonnière d'activité ou mauvais temps.
La part du sous-emploi est calculée en rapportant le sous-emploi à l’emploi total.
Une rupture a lieu en 2008 sur la mesure du sous-emploi dans l’emploi. A compter du premier trimestre
2008, la formulation de la question sur le souhait de travailler plus d’heures, utilisée pour le calcul du sous-
emploi, a été modifiée pour se rapprocher du concept BIT. D’une part, le souhait d’effectuer un plus grand
nombre d’heures est désormais exprimé, comme pour la mesure du chômage BIT, pour une semaine donnée
et non plus à un horizon indéterminé. Cette modification rend impossible les comparaisons avec les niveaux
précédents. D’autre part, les personnes à temps partiel souhaitant travailler plus d’heures, recherchant un
emploi mais n’étant pas disponibles, ne sont plus comptées dans le sous-emploi.
8.1. Structure de la durée hebdomadaire de travail
Il ressort des résultats de cette enquête que 27,4% des actifs occupés travaillent plus de 48 heures par
semaine. Ce phénomène est plus accentué en zones urbaines qu’en zones rurales. En effet, en zones
urbaines, 32,6% des occupés dépassent les 48 heures hebdomadaire (38,2% pour Bamako et 26,4% pour
les autres zones urbaines) contre 25,9% en zones rurales.
 |
79 79 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
69
Tableau 70 : Répartition des heures de travail selon les caractéristiques sociodémographiques
Heure de travail en classe
Moins de 35 heures 35 - 48 heures Plus de 48 heures Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Sexe
Homme 203340 6,9 1478226 50,0 1275929 43,1 2957495 100,0
Femme 751300 29,6 1555509 61,3 229971 9,1 2536780 100,0
Zone de résidence
Urbain 254086 20,5 583805 47,0 404398 32,6 1242289 100,0
Bamako 127664 19,7 272524 42,1 247648 38,2 647836 100,0
Autre urbain 126422 21,3 311281 52,4 156750 26,4 594453 100,0
Rural 700554 16,5 2449929 57,6 1101502 25,9 4251985 100,0
Classe d'âge de travail
15 - 24 ans 266528 17,8 830914 55,6 397261 26,6 1494703 100,0
25 - 35 ans 317409 18,7 944583 55,6 435854 25,7 1697847 100,0
36 - 40 ans 103939 15,9 369002 56,5 179886 27,6 652826 100,0
41 - 64 ans 266764 16,2 889236 53,9 492899 29,9 1648898 100,0
Total 954640 17,4 3033734 55,2 1505900 27,4 5494274 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Selon le sexe, 43,1% des hommes travaillent excessivement contre 9,1% chez les femmes occupées.
Du point de vu âge, le taux le plus élevé (29,9%) a été observé au niveau de la tranche d’âge 41-64 ans,
suivis des tranches d’âges 36-40ans et 15-24 ans avec respectivement 27,6% et 26,6%. La tranche d’âge
25-35 ans occupe le bas du tableau avec un taux de 25,7%.
En moyenne 17,4% des actifs occupés travaillent moins de 35 heures par semaine et plus de 55% exercent
les heures habituelles de travail (35 à 48 heures par semaine).
8.2. Profil du taux de sous-emploi
Globalement 10,2% des actifs occupés sont en situation de sous-emploi lié à la durée du travail dont 18,2%
pour les femmes et 3,4% seulement pour les hommes. Les actifs occupés de Bamako sont beaucoup sous
employés avec 16,2% comparativement à ceux des autres villes urbaines et des zones rurales avec
respectivement 12,5% et 9,0%.
Tableau 71 : Taux de sous-emploi selon le groupe d’âge par zone de résidence et par sexe
Classe d'âge
de travail
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
15 - 24 ans 8,1 28,3 19,8 9,4 22,8 15,9 3,0 14,4 8,1 3,9 16,7 9,9
25 - 35 ans 5,8 35,0 19,4 3,6 21,9 11,0 3,1 16,8 10,3 3,6 19,4 11,6
36 - 40 ans 1,9 37,0 12,5 6,2 27,2 13,7 2,7 13,7 8,3 3,0 17,0 9,5
41 - 64 ans 3,8 25,8 11,8 5,1 20,5 11,1 2,3 17,4 8,7 2,9 18,7 9,3
Total 4,8 30,9 16,2 5,6 22,3 12,5 2,8 15,9 9,0 3,4 18,2 10,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
80 80 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
70
Selon le sexe on constate que le sous-emploi touche beaucoup plus les femmes de Bamako (30,9%) que les
hommes (4,8%). Le même phénomène se constate au niveau des autres villes urbaines (22,3% contre 5,6%)
et en milieu rural (15,9% contre 2,8%).
On remarque qu’environ un actif occupé sur 10 est en situation de sous-emploi, quel que soit l’âge. Selon
les groupes d’âges, le taux le plus élevé a été observé au niveau de la tranche d’âge 25 – 35 ans avec 11,6%,
supérieur à la moyenne nationale.
Tableau 72 : Taux de sous-emploi selon la CSP, la zone de résidence et le sexe.
Catégorie
socioprofessionnelle
dans l'activité
principale
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Cadre supérieur 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 4,0 0,0 0 0,0 1,7 0,0 1,5
Cadre moyen 1,8 0,0 1,2 2,5 0,0 1,9 0,0 1,1 0,2 1,4 0,3 1,1
Employé / ouvrier 2,6 6,5 3,5 3,6 0,8 3,0 3,6 10,2 4,9 3,2 6,0 3,8
Manœuvre 1,5 4,7 2,8 13,0 28,2 14,6 10,1 31,1 13,2 6,2 9,0 7,0
Employeur 6,2 32,1 10,7 7,3 0,0 7,3 5,2 0 5,2 6,1 31,7 8,4
Indépendant 6,4 39,4 24,2 6,3 26,6 16,3 3,7 21,3 11,8 4,3 24,6 14,0
Apprenti 14,0 35,6 18,5 5,2 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 7,0 11,5 8,1
Aide familial 10,3 26,9 18,0 5,7 17,9 11,2 1,4 10,4 6,0 1,7 10,8 6,3
Total 4,8 30,9 16,2 5,6 22,3 12,5 2,8 15,9 9,0 3,4 18,2 10,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Ce tableau nous permet de faire une estimation du sous-emploi lié à la durée du travail. Ainsi, au Mali, près
d'un travailleur sur 10 sont sous employé. Parmi les femmes, le sous-emploi frappe beaucoup plus les
employeurs avec un taux de 31,7%, suivi des indépendants (24,6%).
Cependant, selon la CSP, la situation est beaucoup plus prononcée chez les indépendants (14,0%), les
employeurs (8,4%) et les apprentis (8,1%). Par contre, l’analyse fait ressortir que le sous-emploi affecte
moins les cadres moyens (1,1%) et les cadres supérieurs (1,5%).
Enfin, l’analyse révèle que les femmes indépendantes du district de Bamako sont les plus touchées par le
sous-emploi (39,4%). Par contre, on n’observe pas de cadre supérieur sous employé dans le district de
Bamako et en milieu rural.
 |
81 81 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
71
Tableau 73 : Taux de sous-emploi selon la situation dans la profession, le secteur d'activité et le secteur institutionnel par zone de résidence et
le sexe (en %).
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Situation dans la profession
Salarié 2,1 4,3 2,7 4,3 1,9 3,8 3,7 9,7 4,9 3,2 5,0 3,6
Patron, travailleurs
indépendants
6,3 39,7 25,1 6,5 26,4 16,6 3,8 21,6 12,3 4,4 25,0 14,6
Associés 6,8 12,2 7,4 4,5 30,4 9,9 3,6 12,5 5,5 4,2 14,3 6,2
Apprenti, aide familial 13,1 31,1 18,4 5,6 17,0 10,4 1,4 10,4 6,0 1,8 10,8 6,3
Secteur d'activité économique
Agriculture, élevage, forêt,
pêche
16,7 80,7 28,9 5,5 19,2 11,0 2,0 13,7 7,4 2,2 13,9 7,6
Industrie 5,4 47,2 12,7 5,7 29,1 10,6 6,9 30,3 19,3 6,1 32,0 15,9
Commerce 2,4 35,8 22,1 5,5 25,2 17,3 8,3 23,0 17,8 5,2 28,2 19,3
Services 6,0 16,4 9,7 5,8 15,4 8,6 5,6 23,2 10,7 5,8 18,2 9,8
Secteur institutionnel
Secteur public 0,0 1,5 0,4 2,4 0,0 1,9 0,0 7,7 1,8 0,9 3,0 1,4
Entreprise privée formelle 1,6 0,0 1,3 1,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0
Entreprise privée informelle 5,8 37,2 19,8 6,2 25,3 14,7 3,1 16,1 9,6 3,9 19,6 11,6
ONG, Organisations
internationales, association
0,0 0,0 0,0 1,3 3,4 2,1 1,0 5,0 1,7 1,0 4,5 1,7
Employés de maison 0,0 0,0 0,0 7,5 16,9 11,5 2,5 15,9 8,2 2,8 15,2 8,2
Total 4,8 30,9 16,2 5,6 22,3 12,5 2,8 15,9 9,0 3,4 18,2 10,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Les résultats de ce tableau nous révèlent le taux de sous-emploi avec certaines caractéristiques de l'emploi
telles que la situation dans la profession, le secteur d’activité économique et le secteur institutionnel. Ainsi,
au Mali, plus d'un travailleur sur 10 sont sous employés.
L'analyse par la situation dans la profession montre que les patrons, travailleurs indépendants sont les plus
touchés par le phénomène de sous-emploi comparativement aux autres modalités. En effet, le taux de sous-
emploi des patrons, travailleurs indépendants est de 14,6% dont 25,0% pour les femmes et 4,4% pour les
hommes. Pour cette même catégorie, l'on remarque que les salariés composés de cadres, d’employé,
d’ouvriers et de manœuvres sont les plus moins touchés par ce fléau (3,6%) et on l’observe au niveau des
associés et apprenti et aides familiaux avec respectivement 6,2% et 6,3%.
Au niveau du secteur d’activité économique, l'on constate une forte propension du commerce et de
l’industrie sous employés avec respectivement 19,3% et 15,9%. Ces deux catégories sont suivies par ordre
d'importance par les services et le secteur primaire (Agriculture, élevage, forêt, pêche), soit 9,8% pour les
premiers, et 7,6% pour le second. Aussi, les femmes du secteur industrie (Bamako, autre urbain et milieu
rural) connaissent des taux de sous-emploi respectifs de 47,2%, 29,1% et 30,3%. Du côté du secteur de
l’Agriculture, élevage, forêt, pêche, on observe que 80,7% des femmes de Bamako et seulement 2,0% des
hommes ruraux sont sous employés.
Par secteur institutionnel, les Entreprises privées informelles sont les plus affectées par le sous-emploi
(11,6%), surtout les femmes avec un taux de sous-emploi de 19,6% contre 3,9% pour les hommes. Cette
catégorie est suivie par les employés de maison avec un taux de sous-emploi 8,2%. On n’observe pas la
présence de femme sous-employée dans les entreprises privées formelles, par contre au niveau du secteur
public, 3% des femmes sont sous-employées.
 |
82 82 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
72
9. Le chômage
Le chômage est un phénomène très préoccupant dans tous les pays. Les causes du chômage sont multiples
et varie d’un pays à un autre. Dans la plus part des pays en développement, le chômage s’expliquerait par
la forte croissance démographique (3,5% en 2014 au Mali) et l’incapacité de l’économie à créer plus
d’emploi.
Ce chapitre, traite les caractéristiques du chômage, les stratégies de recherche et la prétention salariale des
demandeurs d’emploi.
9.1. Profil du taux de chômage
Il est important de revenir sur la définition du chômage au sens du BIT et du chômage au sens élargi, afin
de mieux comprendre ce phénomène.
Au sens du BIT, le chômage correspond à la situation des actifs qui n’ont pas travaillé au cours des 7 jours
précédant l’enquête, ne serait-ce qu’une heure, et qui recherchent un emploi et sont disponibles pour
travailler immédiatement.
Le chômage au sens élargi quant à lui regroupe les chômeurs au sens du BIT auxquels on ajoute ceux qui,
bien que n’ayant pas cherché d’emploi au cours de la période de référence, restent malgré tout disponibles
à travailler si on leur en proposait un. Au Mali c’est la définition élargie du chômage qui est retenue pour
déterminer le taux de chômage.
Sur le graphique 2, on constate un taux de chômage plus élevé chez les jeunes actifs de 15 à 29 ans que
chez les jeunes de la tranche d’âge 30-39 ans. Les jeunes sont plus exposés au chômage comparativement
aux adultes (les plus de 40 ans). Plus l’âge de l’individu avance, le risque d’être au chômage diminue. Le
taux de chômage élevé chez les jeunes serait dû à la croissance démographique que connait le pays. Le
poids des jeunes âgés de 15 à 39 ans dans la population totale est passé de 21% en 1998 à 35% en 20095.
Les femmes sont également plus vulnérables au chômage que les hommes. Ce taux de chômage élevé chez
les femmes trouve son explication dans le poids encore marqué des facteurs socioculturels. En effet, dans
la majeure partie du pays (notamment les zones rurales où vivent 71 % de la population), les tâches
domestiques restent dévolues à la femme tandis que l’homme se charge d’assurer les frais de
fonctionnement du foyer (Traoré. F, 2005).
5 Source : INSTAT / RGPH 1998 et 2009
 |
83 83 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
73
De façon générale, il ressort du tableau ci-dessous que les individus ayant le niveau d’instruction supérieur
sont 4 fois plus touchés par le chômage que ceux n’ayant aucun niveau d’instruction. Plus le niveau d’études
augmente, plus le risque d’être au chômage augmente. En général, les personnes les moins instruites
acceptent de faire des petits boulots contrairement à ceux qui ont un niveau d’instruction élevé.
Ceux-ci préfèrent exercer des métiers qui ont un lien avec leur domaine de formation. Les résultats d’autres
études réalisées dans certains pays de la sous-région ont abouti à la même conclusion. En Côte d’Ivoire en
2002, les titulaires du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), de la Licence et de la Maîtrise, toutes
spécialités confondues, ont respectivement des taux de chômage de 42,3%, 17,9%, et 25,2%6. En Tunisie
en 2012, les diplômés du supérieur et du secondaire ont respectivement connu des taux de chômage de
26,1% et 21% contre seulement 5,8% pour les analphabètes et 12,2% pour ceux qui ont le niveau primaire7.
Le rapport de l’OIT8 analysant les résultats d’enquêtes menées dans huit pays d’Afrique subsaharienne
montre que si les taux de chômage augmentent avec le niveau d’éducation, ce sont les jeunes gens les moins
instruits qui sont désavantagés en termes de salaire et d’accès à un emploi stable.
Les sans niveau d’instruction ont plus tendance à être des travailleurs indépendants ou à accepter des
salaires inférieurs. Selon ce rapport, dans tous les pays étudiés sauf un – le Malawi – plus le niveau
d’éducation d’un jeune est faible, moins ce jeune est susceptible d’être au chômage.
Les femmes sont les plus exposées au chômage quel que soit le niveau d’instruction. C’est surtout à Bamako
et autres zones urbaines que la différence entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes de
même niveau d’instruction est plus marquée, surtout à partir du secondaire. A Bamako, l’écart entre les
6 http://www.memoireonline.com/07/10/3750/m_Linsertion-professionnelle-des-diplmes-du-superieur--Abidjan3.html.
7 Source : ONEQ : « Rapport annuel sur le marché du travail en Tunisie, décembre 2013 ».
8 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_237571/lang--fr/index.htm
0
2
4
6
8
10
12
14
1
5
-
1
9
a
n
s
2
0
-
2
4
a
n
s
2
5
-
2
9
a
n
s
3
0
-
3
4
a
n
s
3
5
-
3
9
a
n
s
4
0
-
4
4
a
n
s
4
5
-
4
9
a
n
s
5
0
-
5
4
a
n
s
5
5
-
5
9
a
n
s
6
0
-
6
4
a
n
s
P
O
U
R
C
EN
TA
G
E
Graphique 2: taux de chômage élargi par groupe d'âge et par sexe
Homme Femme Ensemble
 |
84 84 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
74
deux sexes de niveau d’instruction supérieur est de 16 points de pourcentage contre 23 points de
pourcentage dans les autres zones urbaines.
Tableau 74 : Taux de chômage selon le niveau d'éducation, la zone de résidence et par sexe (en %)
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Niveau d'éducation
Aucun niveau 5,1 7,7 6,4 7,1 11,6 9,3 6,2 7,3 6,8 6,2 7,6 6,9
Maternelle 0 0 0 40,1 0 30,1 0 0 0 8,1 0 5,3
Fondamental 1 11,8 9,7 10,8 10 18,1 13,3 5,9 11,5 7,9 7,3 12,2 9,2
Fondamental 2 12,7 14,1 13,2 10,8 22 14,8 6,1 10,1 7,2 9 14,2 10,6
Secondaire 12,5 32,2 20,2 12,7 28,7 18,7 8,7 21,7 11,9 11,2 28,6 17,1
Supérieur 20,3 36,5 24,7 16 39,4 19,3 38,4 0 37,3 22,7 36,2 25,5
Total 10,5 12,8 11,5 9,5 15,9 12,2 6,4 7,8 7,1 7,3 9,3 8,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
La région la plus touchée par le chômage est celle de Gao (plus de 2 fois le taux de chômage global du
pays). Elle est suivie de la région de Sikasso et du district de Bamako, avec respectivement 11,6% et 11,5%.
Le taux de chômage à Gao est donc très élevé par rapport à la moyenne nationale, alors qu’il n’a que 2,4%
de la population active en 2014. L’effet de la crise a été donc plus marqué à Gao qu’à Tombouctou qui n’a
enregistré que 5,7% du taux de chômage en 2014.
La région de Mopti a connu le plus faible taux de chômage soit, 3,9%. La forte présente des bases militaires
dans cette région a certainement contribué à booster l’activité économique et réduire par conséquent le taux
de chômage. La région de Ségou a été également moins touchée par le chômage.
Tableau 75 : Taux de chômage selon la région et le sexe (en %)
Région Sexe
Homme Femme Total
Kayes 6,4 7,6 7,0
Koulikoro 11,2 7,4 9,6
Sikasso 8,2 14,6 11,6
Ségou 5,1 3,5 4,4
Mopti 4,5 3,2 3,9
Tombouctou 2,0 10,8 5,7
Gao 8,2 42,3 19,4
Bamako 10,5 12,8 11,5
Total 7,3 9,3 8,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
85 85 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
75
9.2. Caractéristiques des chômeurs
En 2014, le Mali comptait 492 310 chômeurs dont 52,6% de femmes contre 47,4% pour les hommes. Nous
examinons dans cette partie les différentes caractéristiques des chômeurs.
Près des 3/4 des chômeurs sont dans la tranche 15-35 ans au niveau des autres zones urbaines. A Bamako,
cette proportion atteint les 85%. Contrairement à Bamako, nous constatons que dans les autres zones
urbaines et rurales, la proportion de chômeurs de la tranche d’âge 41-64 est très élevée, atteignant jusqu’à
23% en milieu rural. Globalement plus de 70% des chômeurs sont des jeunes âgés de 15-35 ans.
Contrairement au taux de chômage, nous constatons que la proportion de chômeurs est plus élevée chez les
individus n’ayant aucun niveau comparativement à ceux qui ont le niveau d’études supérieur surtout dans
les zones urbaines (23,7% contre 18,3% à Bamako et 39,7% contre 5,7% dans autres zones urbaines).
L’écart entre les deux niveaux devient plus important en zone rurale 77% contre 1,9%.
De façon générale, la proportion de chômeurs est de 62% chez les individus n’ayant aucun niveau
d’instruction contre 5,4% chez ceux ayant le niveau d’études supérieur. Ceci n’est pas du tout surprenant
dans la mesure où les non scolarisés représentent 68% de la population en âge de travailler (15-64 ans)
contre 1,8% des diplômés du supérieur. Donc ce constat ne contredit pas ce qui a été évoqué plus haut,
c’est-à-dire que le chômage touche plus les diplômés que les non diplômés.
Tableau 76 : Proportion de chômeurs selon l’âge, le niveau d’instruction le milieu et le sexe
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Tranche d’âge
15 - 24 45,4 52,3 48,8 42,8 36,7 39,4 36,7 33,4 35,0 39,3 37,0 38,1
25 - 34 47,2 30,2 38,8 24,6 37,5 31,8 18,8 34,6 27,1 24,9 34,4 29,9
35 - 44 2,8 11,6 7,1 14,3 14,6 14,5 18,2 17,3 17,7 14,7 15,9 15,3
45 - 54 3,2 5,9 4,5 12,3 7,3 9,5 16,3 9,1 12,5 13,3 8,2 10,6
55 - 64 1,4 0,0 0,7 6,0 3,9 4,8 10,0 5,7 7,8 7,8 4,5 6,1
Niveau d’instruction
Aucun niveau 18,1 29,5 23,7 35,2 43,3 39,7 73,0 80,6 77,0 57,0 65,8 61,6
Fondamental 1 20,7 16,5 18,6 21,9 22,1 22,0 14,1 13,9 14,0 16,5 15,8 16,1
Fondamental 2 26,1 15,8 21,0 17,2 15,3 16,2 6,0 3,4 4,7 11,5 7,5 9,4
Secondaire 13,6 23,3 18,3 15,3 16,4 15,9 2,9 2,0 2,4 6,8 8,0 7,4
Supérieur 21,5 15,0 18,3 9,2 3,0 5,7 4,0 0,0 1,9 8,1 2,9 5,4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Il ressort dans le tableau ci-dessus que les proportions de chômeurs de courte ou longue durées sont presque
identiques chez les hommes et les femmes. L’écart entre les deux sexes n’est pas trop important (56,1%
des femmes sont touchées par le chômage de courte durée contre 43,9% des hommes). Quand il s’agit du
chômage de longue durée, l’écart entre les deux se rétréci de 5,4 points de pourcentage.
A Bamako, contrairement dans autres zones urbaines et rurales, les hommes et les femmes ont des
proportions égales de chômeurs (50,8% pour les hommes contre 49,2% pour les femmes).
 |
86 86 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
76
Tableau 77 : Type de chômage selon l'âge, le niveau d'éducation, le milieu de résidence et le sexe.
Milieu Sexe
Type de chômage
Chômage de courte durée Chômage de longue durée Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Bamako Homme 7207 48 35679 51,3 42885 50,8
Femme 7793 52 33811 48,7 41604 49,2
Total 15000 100 69489 100 84490 100
Autre urbain Homme 4042 44,1 32533 44,2 36575 44,2
Femme 5129 55,9 41019 55,8 46148 55,8
Total 9171 100 73551 100 82722 100
Rural Homme 4262 38,2 149780 47,7 154042 47,4
Femme 6892 61,8 164164 52,3 171056 52,6
Total 11154 100 313944 100 325098 100
Total Homme 15511 43,9 217991 47,7 233502 47,4
Femme 19814 56,1 238994 52,3 258808 52,6
Total 35325 100 456985 100 492310 100
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Sur le graphique 3, nous constatons que Sikasso est la seule région où la durée moyenne du chômage des
femmes est inférieure à celle des hommes (2 ans 8 mois chez les hommes contre 2 ans 7 mois pour les
femmes). En général, les femmes durent plus longtemps en chômage comparativement aux hommes. C’est
dans les régions de Kayes, Tombouctou, Gao que les écarts de durée moyenne entre les deux sexes est
importante. Gao et Tombouctou sont les deux régions où la durée moyenne du chômage est plus élevée
comparativement aux autres régions. Cela pourrait certainement être expliqué par la faiblesse de la
dynamique de l’activité économique.
2,82 2,78 2,75
2,54 2,65
3,73
3,15
2,63
4,17
2,94
2,69
2,88 2,85
3,93
4,26
3,36
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao Bamako
Graphique:Durée moyenne en année du temps de chômage par niveau d'instruction et par sexe
Homme Femme
 |
87 87 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
77
Les plus diplômés ont une durée moyenne relativement élevée (3 ans pour le supérieur et 3,5 ans pour le
secondaire) par rapport à ceux qui ont un niveau d’étude faible (2,9 pour aucun niveau et 2,8 pour le niveau
primaire). Au niveau secondaire, la durée moyenne du chômage des femmes depasse les quatre ans
(graphique 4). Ces constants confirment une fois de plus l’ampleur du chômage chez les diplômés.
9.3. Stratégie de recherche d'emploi et prétentions salariales des chômeurs :
Selon certaines théorie, la durée du chômage est fortement liée à la recherche d’emploi et aux prétentions
salariales du demandeur d’emploi.
Tableau 78 : Stratégie de recherche d'emploi par le chômeur (en %)
Moyen principal
de recherche
d'emploi
Bamako Autre urbain Rural Total
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Relations 63,3 36,7 50,2 82 75 78,1 97,2 90,7 93,8 88,6 79,2 83,7
Employeur 1,9 2,8 2,3 6,8 2,2 4,2 0,4 0,4 0,4 1,7 1,1 1,4
Annonces 16,5 11,3 13,9 0,6 5,4 3,3 0,3 0,2 0,3 3,3 2,9 3,1
ANPE 0,5 2 1,3 1 0,4 0,7 0,1 0 0,1 0,4 0,4 0,4
BPP 0,9 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1
Concours 9,9 10,8 10,3 7,5 5,9 6,6 0,8 0 0,4 3,5 2,8 3,1
Créer entreprise 6,1 34,5 20,1 1,7 6,4 4,3 0 7,3 3,8 1,4 11,5 6,7
Autre 1 1,9 1,4 0,4 4,6 2,7 1,1 1,4 1,2 1 2 1,5
Total effectif 42885 41604 84490 36575 46148 82722 154042 171056 325098 233502 258808 492310
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Les relations personnelles sont les moyens privilégiés par les chômeurs dans le cadre de leur recherche
d’emploi. Parmi l’ensemble des chômeurs, 84% utilisent ce canal. De plus en plus, les relations personnelles
ou réseaux de relations sont devenues le mode le plus courant de recherche d’emploi. Le phénomène est
moins rependu à Bamako (50%) contrairement en milieu rural (93,8%) et autre zone urbaine (78,1%).
2,61
2,75
3,03
3,273,19
2,96
4,37
2,99
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Aucun niveau Primaire Secondaire Supérieur
Graphique 4: Durée moyenne en année du temps de chômage par niveau d'instruction et par sexe
Masculin Féminin
 |
88 88 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
78
Seulement 6,7% des chômeurs souhaitent créer leur propre entreprise. C’est surtout à Bamako que cet
engouement est fort (20% des chômeurs) surtout chez les femmes (34,5%), comparativement aux autres
localités du pays.
La proportion de demandeurs d’emploi utilisant principalement le canal de l’ANPE et les Bureaux privés
de Placement (BPP) reste très insignifiante (0,4% pour l’ANPE et 0,1% pour les BPP). Cette proportion
reste très faible même à Bamako.
Tableau 79 : Salaire ou revenu minimum moyen accepté le chômeur
Sexe
Homme Femme Total
Région
Kayes 51517 45212 46417
Koulikoro 84487 44554 61614
Sikasso 89145 45050 66020
Ségou 55435 48908 52347
Mopti 30000 56201 54013
Tombouctou 62867 30063 36653
Gao 52252 34885 39797
Bamako 109342 72124 86552
Tranche d'âge
15 - 24 64600 50925 54878
25 - 34 102310 54147 75642
35 - 44 85479 42233 52749
45 - 54 73952 43803 53210
55 - 64 51739 20319 40744
Niveau d'étude
Aucun niveau 56528 34696 38927
Primaire 74301 47309 57801
Secondaire 90896 71228 79283
Supérieur 115388 133278 120487
Total 84460 50010 62323
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Le salaire minimum moyen accepté par les demandeurs d’emploi à Bamako est nettement supérieur à ceux
qui sont recherchés par les demandeurs d’emploi des autres régions du pays. Bamako est suivi par les
régions de Sikasso et Koulikoro. Le niveau de salaire accepté par les demandeurs d’emploi à Tombouctou
est le plus bas de toutes les régions.
A la lecture de ce tableau, il semblerait avoir une corrélation entre la prétention salariale des demandeurs
d’emploi et le taux de chômage. Excepté la région de Gao, les trois premières régions où le taux de chômage
est élevé sont celles qui viennent en tête en comparant également le montant du salaire minimum accepté
par les demandeurs d’emploi. L’analyse du niveau du salaire minimum accepté par tranche d’âge des
demandeurs d’emploi fait ressortir le même constat. Ce niveau est le plus élevé chez les tranches d’âge 15-
24 et 25-34 ans. Ce sont également les tranches d’âge qui ont enregistré les taux de chômage les plus élevés,
avec respectivement 11,1% et 9,1%.
La répartition du salaire minimum moyen accepté par les demandeurs en fonction du niveau d’étude fait
ressortir le même constat. Les diplômés du supérieur et ceux du secondaire ont des prétentions salariales
très élevées comparativement à ceux qui ont le niveau primaire ou aucun niveau d’étude. Ce sont ces
 |
89 89 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
79
derniers qui ont connu les plus faibles taux de chômage en 2014. La relation positive qui semble exister
entre le niveau du salaire recherché par les demandeurs d’emploi et le taux de chômage trouve son
explication dans la théorie de recherche d’emploi, développé par George Stigler. Selon cette théorie, les
chercheurs d’emploi font un arbitrage entre les offres d'emplois qui leur sont proposées et le fait de rester
au chômage. Ils ne se décident à occuper ces emplois que si le montant du salaire qui leur est proposé est
supérieur à l'espérance mathématique (c'est-à-dire la moyenne) du salaire que l'on pourra leur proposer plus
tard. Le niveau de salaire qui détermine s'il est plus avantageux pour le travailleur d'entrer sur le marché du
travail (sortir du chômage) est appelé "salaire de réservation". On peut ainsi parler d'un chômage volontaire.
En d'autres termes, le travailleur reste au chômage tant que le bénéfice marginal qu'il retire des offres
d'emploi qui lui sont proposées demeure inférieur au bénéfice marginal qu'il a à rester au chômage, dans
l'attente d'offres meilleures.
 |
90 90 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
80
Conclusion et recommandations
1. Conclusion
L’intégration de l’Enquête Permanente Auprès des Ménages en 2013 dans le dispositif mise en place par
l’Institut National de la Statistique à travers la coopération Suédoise pour le suivi et l’évaluation du Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté permet à notre de pays de réaliser chaque
année une enquête emploi. L’objectif principal de cette enquête est de produire des indicateurs pour évaluer
et suivre l’évolution de l’emploi au Mali. Après celle réalisée en 2013 suite à l’étroite collaboration entre
l’Agence Nationale Pour l’Emploi et l’INSTAT, l’édition de 2014 a été un succès grâce à la collaboration
entre l’INSTAT et le nouvel Observatoire National de l’Emploi et de la Formation.
Les données de cette enquête ont été collectées d’octobre à décembre 2014. L’analyse des principaux
résultats montre que le taux de chômage a légèrement augmenté, comparativement à 2013 malgré le retour
progressif de la paix. Les plus diplômés sont plus frappés par le chômage que les moins diplômés. Ce
phénomène reste essentiellement urbain. Plus de 90% des chômeurs mettent plus d’un an dans la recherche
d’un emploi généralement salarié. Le salaire minimum acceptable par les chômeurs pour occuper un emploi
est en moyenne de 62 323 FCFA par mois (soit 84 460 FCFA pour les hommes et 50 010 FCFA pour les
femmes).
Parallèlement au taux de chômage, le taux de sous-emploi permet de cerner certain dysfonctionnement du
marché du travail. En 2014, près de 11% des actifs occupés sont sous-employés. Ce taux est nettement en
recul par rapport à celui de 2013 et de 2010. Plus ce taux est élevé, plus cela traduit une situation
d’insatisfaction dans laquelle les personnes qui travaillent en dessous de 35 heures ne travaillent pas autant
qu’elles le voudraient pour atteindre un niveau de revenu adéquat. Cette réduction du taux de sous-emploi
traduit aussi, une baisse du taux de pluriactivité (une diminution de 21,6 point de pourcentage par rapport
à 2013) donc des opportunités d’emploi pour les chômeurs.
Tout comme en 2013, la structure des emplois selon le secteur institutionnel montre que la majorité des
actifs occupés exercent leur emploi dans le secteur informel. La part de l’emploi formel reste très faible
(3,5%). La structure de l’emploi par région fait ressortir un taux d’emploi faible à Gao, comparativement
aux autres régions.
Les migrants de retour au Mali viennent en grande majorité (67,5%) de la Côte d’Ivoire. Ceci s’explique
par le fait que ce pays est non seulement frontalier avec le Mali, mais aussi la première économie de l’espace
UEMOA. La contrainte familiale est la principale cause de retour de ces migrants au pays. Plus de 3/5 des
migrants trouvent que leur situation économique s’est améliorée durant leur séjour à l’extérieur.
Les chômeurs à la recherche d’emploi (83,7%) préfèrent utiliser le canal des relations personnelles pour
trouver un emploi. Ceci dénote soit une méconnaissance des missions des structures d’intermédiation, soit
un manque de confiance des chercheurs d’emploi à leur égard.
2. Recommandations :
 |
91 91 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
81
De ces différents résultats, il ressort les recommandations suivantes :
- élaborer des stratégies pour améliorer la qualité des programmes de formation des établissements
d’enseignement secondaire en général et ceux du supérieur en particulier en tenant compte des
réalités du marché du travail ;
- définir et introduire dans les cursus, des formations dédiées à l’entrepreneuriat dans toutes les
spécialités susceptibles d’encourager la créativité et de nouvelles façons de penser. La Direction
Nationale de l’Emploi en tant que structure chargée de la coordination et du suivi de la politique
nationale de l’emploi pourrait jouer un rôle important dans cette mise en œuvre ;
- mettre en place des actions afin d’appuyer, conseiller et encourager les acteurs du secteur informel
à s’orienter vers le secteur formel ;
- mettre en place des mesures d’accompagnement pour faciliter l’insertion socio-professionnelle des
migrants de retour au pays. Ceci les évitera de repartir à l’extérieur ;
- informer et sensibiliser les demandeurs d’emploi sur les missions, des structures (publiques et
privées) chargées de l’intermédiation sur le marché du travail. Ces actions pourraient orienter les
demandeurs d’emploi vers les canaux formels de recherche d’emploi et réduire par conséquent le
délai d’insertion des demandeurs d’emploi ;
- mettre en place un cadre de concertation entre les différentes structures (ANPE, FAFPA, APEJ,
ONEF, INIFORP, Projets, DNE, DNFP, etc.) chargées de la coordination et la mise en œuvre de la
politique nationale de l’emploi.
 |
92 92 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
82
Références bibliographiques
BOMISSO. I-G. Insertion professionnelle des diplômés du Supérieur à Abidjan. In : Memoire Online.
Economie et Finance. [en ligne]. Diponible sur :
http://www.memoireonline.com/07/10/3750/m_Linsertion-professionnelle-des-diplmes-du-superieur--
Abidjan3.html. (Page consultée le 19 septembre 2015).
Centre d’Observation de la Société. Mobilité Sociale : ascenseur ou ralenti. [en ligne]. Diponible sur :
http://www.observationsociete.fr/mobilit%C3%A9-sociale-lascenseur-au-ralenti. (Page consultée le 17
juin 2015).
Cyber Manuel de Sciences Economiques et Sociale. Mesurer la mobilité sociale. [en ligne]. Disponible sur :
http://libertariens.chez-alice.fr/mobimesa.htm. (Page consultée le 15 juin 2015)
Dominique Merllié (1999) : Les enquêtes de mobilité sociale, in Histoire et mesure, volume 14, n°1-2 Varia,
pp. 201-203
Dominique Merllié (2015) : Mobilité sociale, Encyclopædia Universalis. [en ligne]. Diponible sur :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/mobilite-sociale/. (Page consultée le 6 juillet 2015).
Institut National de la Statistique. Rapport du 3ème passage de l’EMOP 2014, février 2015.
Jean-Pierre Butault, Nathalie Delame, Stéphane Krebs, Philippe Lerouvillois (1999) : La pluriactivité – Un
correctif aux inégalités du revenu agricole, Economie et statistique n° 329-330, 1999-9/10.
KREBS. S (2005). Pluriactivité et mode de financement des exploitations agricoles, Economie rurale 289-
290, septembre-décembre.
MALRIEU. J-P. Mesure et évolution de la mobilité sociale. In : Partie 2. Inégalités, conflits et cohésion
sociale. Diponible sur le site. [en ligne]. Diponible sur :
http://jp.malrieu.free.fr/SES702/article.php3?id_article=37 . (Page consultée le 17 juin 2015)
O.N.E.Q. Rapport annuel sur le marché du travail en Tunisie, décembre 2013.
O.I.T (1998) : Mesure du revenu de l'emploi, Rapport II, 16ème Conférence internationale des statisticiens
du travail, Genève, 6-15 octobre.
O.I.T. Investir dans l’école sert-il aux jeunes d’Afrique ? In : O.I.T info. [en ligne]. Diponible sur :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_237571/lang--fr/index.htm. (Page
consultée le 24 septembre 2015).
Wikipedia. Mobilité sociale. [en ligne]. Disponible sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A9_sociale . (Page consultée le 12 juin 2015).
 |
93 93 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
83
Annexe : Quelques indicateurs du marché du travail
1. Population en âge de travailler
Définition : c’est la population en âge de travailler qui comprend donc toutes les personnes âgées de 15 à
64 ans en âge révolu.
Tableau A1 : Répartition de la population en âge de travailler selon le sexe
Situation dans l'activité Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Actif occupé 2 957 495 79,3 2 536 780 58,8 5 494 274 68,3
Chômeur 233 502 6,3 258 808 6,0 4 923 10 6,1
Inactif 538 657 14,4 1 517 857 35,2 2 056 514 25,6
Total 3 729 653 100,0 4 313 445 100,0 8 043 098 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
2. Population occupée ou emploi
Définition : Ensemble constitué des personnes ayant travaillé au moins une heure au cours de la semaine
précédant le passage de l’agent enquêteur ; et des personnes n’ayant pas travaillé mais qui ont normalement
un emploi et qui sont soit en vacances, soit malades, soit en grève, soit en situation d’arrêt provisoire de
travail ; ainsi que toutes les personnes qui doivent commencer à travailler au cours du mois suivant le
passage de l’agent enquêteur.
.
Tableau A2 : Répartition de la population occupée par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Milieu de résidence
Urbain 714 956 24,2 527333 20,8 1242289 22,6
Bamako 365 209 12,3 282627 11,1 647836 11,8
Autres villes 349 747 11,8 244706 9,6 594453 10,8
Rural 2 242 538 75,8 2009447 79,2 4251985 77,4
Groupe d'âge
15 - 24 ans 796 169 26,9 698534 27,5 1494703 27,2
25 - 34 ans 838 952 28,4 858895 33,9 1697847 30,9
35 - 54 ans 349 559 11,8 303267 12,0 652826 11,9
55 - 64 ans 972 815 32,9 676084 26,7 1648898 30,0
Niveau d'éducation
Aucun niveau 2 009 070 67,9 2 061 497 81,3 4 070 567 74,1
Primaire 759 194 25,7 410 167 16,2 1 169 360 21,3
Secondaire 125 266 4,2 51 711 2,0 176 977 3,2
Supérieur 63 965 2,2 13 405 ,5 77 370 1,4
Total 2 957 495 100,0 2 536 780 100,0 5 494 274 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
94 94 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
84
3. Population au chômage au sens du BIT
Définition : elle comprend toutes les personnes sans emploi, n’ayant pas travaillé ne serait-ce qu’une heure
lors de la semaine précédant le passage de l’agent enquêteur, ayant recherché un emploi au cours du mois
précédant le passage de l’agent enquêteur et se déclarant disponible pour prendre un emploi dans les quinze
jours.
Tableau A3 : Répartition de la population au chômage par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Milieu de résidence
Urbain 79 460 34,0 87 752 33,9 167 212 34,0
Bamako 42 885 18,4 41 604 16,1 84 490 17,2
Autres villes 36 575 15,7 46 148 17,8 82 722 16,8
Rural 154 042 66,0 171 056 66,1 325 098 66,0
Groupe d'âge
15 - 24 ans 91 657 39,3 95 803 37,0 187 460 38,1
25 - 34 ans 63 277 27,1 98 510 38,1 161 787 32,9
35 - 54 ans 19 678 8,4 25 166 9,7 44 844 9,1
55 - 64 ans 58 890 25,2 39 329 15,2 98 219 20,0
Niveau d'éducation
Aucun niveau 13 3433 57,1 170 187 65,8 303 620 61,7
Primaire 65 400 28,0 60 312 23,3 125 712 25,5
Secondaire 15 833 6,8 20 708 8,0 36 542 7,4
Supérieur 18 835 8,1 7 601 2,9 26 436 5,4
Total 233 502 100,0 258808 100,0 492 310 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
4. Population active
Définition : ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail,
qu'elles aient un emploi (population active occupée) ou qu'elles soient au chômage (population active
inoccupée).
Tableau A4 : Répartition de la population active par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Effectif % Effectif % Effectif %
Milieu de résidence
Urbain 794 416 24,9 61 5085 22,0 1 409 501 23,5
Bamako 408 095 12,8 324 231 11,6 732 326 12,2
Autres villes 386 322 12,1 290 854 10,4 677 175 11,3
Rural 2 396 580 75,1 2 180 503 78,0 4 577 083 76,5
Groupe d'âge
15 - 24 ans 887 826 27,8 794 337 28,4 1 682 163 28,1
25 - 34 ans 902 229 28,3 957 404 34,2 1 859 633 31,1
35 - 54 ans 369 237 11,6 328 433 11,7 697 670 11,7
55 - 64 ans 1 031 705 32,3 715 413 25,6 1 747 117 29,2
Niveau d'éducation
Aucun niveau 2 142 503 67,1 2 231 684 79,8 4374 187 73,1
Primaire 824 594 25,8 470 478 16,8 1 295 072 21,6
Secondaire 141 099 4,4 72 420 2,6 213 519 3,6
Supérieur 82 800 2,6 21 006 0,8 103 806 1,7
Total 3 190 996 100,0 2 795 588 100,0 5 986 584 100,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
95 95 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
85
5. Part des travailleurs pour leur propre compte et des travailleurs familiaux non rémunérés dans
le total des emplois (Taux d’emploi vulnérable) (Indicateur OMD)
Définition : le taux d’emploi vulnérable est égal à la part en pourcentage des travailleurs pour leur propre
compte et des travailleurs familiaux non rémunérés dans le total des emplois.
Tableau A5 : Taux d’emploi vulnérable par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 49,0 77,8 61,2
Bamako 40,9 72,7 54,8
Autres villes 57,6 83,7 68,3
Rural 83,2 91,3 87,0
Groupe d'âge
15 - 24 ans 75,8 84,5 79,8
25 - 34 ans 68,3 89,3 78,9
35 - 54 ans 72,3 91,2 81,1
55 - 64 ans 81,0 90,3 84,8
Niveau d'éducation
Aucun niveau 82,1 90,8 86,5
Primaire 70,3 87,3 76,2
Secondaire 20,6 22,9 21,3
Supérieur 13,6 20,9 14,8
Total 75,0 88,5 81,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
6. Taux de pluriactivité
Définition : rapport du nombre de personnes exerçant un ou plusieurs emplois secondaires à la population
active occupée.
Tableau A6 : Taux de pluriactivité par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 8,3 6,7 7,6
Bamako 2,3 1,7 2,0
Autres villes 14,5 12,6 13,7
Rural 27,7 33,4 30,4
Groupe d'âge
15 - 24 ans 13,7 22,4 17,8
25 - 34 ans 22,6 29,0 25,8
35 - 54 ans 26,4 34,1 30,0
55 - 64 ans 29,9 29,3 29,6
Niveau d'éducation
Aucun niveau 25,3 30,4 27,9
Primaire 20,7 19,1 20,1
Secondaire 8,9 4,0 7,5
Supérieur 6,5 3,3 5,9
Total 23,0 27,9 25,3
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
96 96 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
86
7. Ratio Emploi/ Population 15-64 ANS (Indicateur OMD)
Définition : rapport du nombre d’actifs occupés à l’effectif de la population en âge de travailler.
Tableau A7 : Ratio Emploi/ Population par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 66,7 45,3 55,5
Bamako 65,7 47,1 56,1
Autres villes 67,9 43,3 55,0
Rural 84,4 63,8 73,2
Groupe d'âge
15 - 24 ans 60,9 49,1 54,8
25 - 34 ans 88,7 63,2 73,7
35 - 54 ans 93,2 67,1 78,9
55 - 64 ans 88,4 62,5 75,6
Niveau d'éducation
Aucun niveau 89,2 63,4 73,9
Primaire 64,9 45,1 56,2
Secondaire 63,6 43,5 56,0
Supérieur 58,5 42,3 54,9
Total 79,3 58,8 68,3
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
8. Taux de croissance de l’emploi
Définition : le taux de croissance de l’emploi est la variation en pourcentage de l’effectif de la population
occupée d’une année à l’autre.
Tableau A8 : Taux de croissance de l’emploi par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain -1,9 -0,9 -1,5
Bamako -4,1 9,3 1,3
Autres villes 0,5 -10,5 -4,3
Rural 11,4 -1,0 5,2
Groupe d'âge
15 - 24 ans -3,7 -10,9 -7,2
25 - 34 ans 20,1 11,0 15,3
35 - 54 ans -63,6 -63,4 -63,5
55 - 64 ans 278,1 284,8 280,8
Niveau d'éducation
Aucun niveau 17,1 2,9 9,4
Primaire -3,2 -12,2 -6,6
Secondaire -18,9 -27,8 -21,7
Supérieur -26,4 -33,1 -27,6
Total 7,9 -1,0 3,6
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
97 97 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
87
9. Taux de chômage élargi
Définition : le taux de chômage élargi est la proportion en pourcentage de la population active qui est
disponible pour travailler, mais ne dispose pas d’un emploi.
Tableau A9 : Taux de chômage élargi par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 10,0 14,3 11,9
Bamako 10,5 12,8 11,5
Autres villes 9,5 15,9 12,2
Rural 6,4 7,8 7,1
Groupe d'âge
15 - 24 ans 10,3 12,1 11,1
25 - 34 ans 7,0 10,3 8,7
35 - 54 ans 5,3 7,7 6,4
55 - 64 ans 5,7 5,5 5,6
Niveau d'éducation
Aucun niveau 6,2 7,6 6,9
Primaire 7,9 12,8 9,7
Secondaire 11,2 28,6 17,1
Supérieur 22,7 36,2 25,5
Total 7,3 9,3 8,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
10. Taux de chômage BIT
Définition : c’est le pourcentage de la population active qui ne dispose pas d’emploi, qui est en recherche
active durant la période de référence donnée et qui est disponible.
Tableau A10 : Taux de chômage BIT par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 8,5 7,7 8,1
Bamako 9,0 6,7 8,0
Autres villes 8,0 8,7 8,3
Rural 5,9 5,9 5,9
Groupe d'âge
15 - 24 ans 8,9 7,2 8,1
25 - 34 ans 6,1 7,4 6,8
35 - 54 ans 5,3 6,3 5,8
55 - 64 ans 5,4 3,9 4,8
Niveau d'éducation
Aucun niveau 5,9 5,5 5,7
Primaire 6,9 7,3 7,0
Secondaire 9,2 18,6 12,2
Supérieur 17,0 30,4 19,7
Total 6,6 6,3 6,4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
98 98 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
88
11. Taux de chômage des jeunes 15-24 ans
Définition : c’est la proportion en pourcentage des chômeurs âgés de 15 à 24 ans révolu par rapport à la
population active de cette tranche d’âge.
Tableau A11 : Taux de chômage des jeunes 15-24 ans par milieu de résidence, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 21,9 21,2 21,5
Bamako 25,5 21,7 23,4
Autres villes 18,6 20,6 19,6
Rural 7,8 9,3 8,5
Niveau d'éducation
Aucun niveau 8,7 8,8 8,8
Primaire 10,9 16,5 13,0
Secondaire 23,5 55,7 37,6
Supérieur 63,6 69,2 65,4
Total 10,3 12,1 11,1
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
12. Taux de chômage des jeunes 15-35 ans
Définition : c’est la proportion en pourcentage des chômeurs âgés de 15 à 35 ans révolu par rapport à la
population active de cette tranche d’âge
Tableau A12 : Taux de chômage des jeunes 15-35 ans par milieu de résidence, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 15,5 17,9 16,7
Bamako 18,7 16,3 17,5
Autres villes 12,2 19,9 15,8
Rural 6,5 9,1 7,8
Niveau d'éducation
Aucun niveau 6,3 8,8 7,6
Primaire 9,6 14,4 11,5
Secondaire 17,6 38,3 25,6
Supérieur 39,9 40,2 40,0
Total 8,7 11,1 9,9
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
99 99 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
89
13. Proportion de chômeurs découragés
Définition : les travailleurs découragés sont des personnes qui désirent travailler mais qui ne sont pas dans
la population active et pensent, pour diverses raisons, qu'il n’y a pas d’emplois disponibles pour elles.
Tableau A13 : Proportion de chômeurs découragés par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 16,5 50,1 34,1
Bamako 15,8 51,0 33,1
Autres villes 17,3 49,3 35,2
Rural 8,1 26,1 17,6
Groupe d'âge
15 - 24 ans 14,7 43,2 29,3
25 - 34 ans 13,5 30,7 24,0
35 - 54 ans 0,7 19,1 11,1
55 - 64 ans 5,8 31,0 15,9
Niveau d'éducation
Aucun niveau 5,7 29,3 18,9
Primaire 14,0 46,6 29,6
Secondaire 19,7 42,8 32,8
Supérieur 30,6 22,9 28,4
Total 11,0 34,3 23,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
14. Proportion des Jeunes de (15-24 ans) « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation »
Définition : c’est le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans révolu qui ne sont ni en emploi, ni dans
aucun dispositif d’éducation ou de formation.
Tableau A14 : Proportion des Jeunes de (15-24 ans) « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation » par milieu
de résidence, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 10,5 30,7 21,5
Bamako 10,2 29,3 20,8
Autres villes 10,8 32,1 22,2
Rural 9,8 32,3 21,2
Niveau d'éducation
Aucun niveau 14,7 37,6 28,4
Primaire 6,3 23,6 14,0
Secondaire 5,6 25,7 14,0
Supérieur 17,9 18,7 18,1
Total 10,0 31,7 21,3
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
100 100 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
90
15. Proportion des Jeunes de (15-35 ans) « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation »
Définition : c’est le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 35 ans révolu qui ne sont ni en emploi, ni dans
aucun dispositif d’éducation ou de formation.
Tableau A15 : Proportion des Jeunes de (15-35 ans) « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation » par milieu de
résidence, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 11,0 37,1 25,3
Bamako 11,6 34,7 24,3
Autres villes 10,4 39,8 26,4
Rural 8,9 32,4 21,9
Niveau d'éducation
Aucun niveau 10,8 36,5 26,7
Primaire 6,9 27,4 16,4
Secondaire 8,8 30,8 17,9
Supérieur 23,7 27,1 24,7
Total 9,5 33,8 22,9
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
16. Taux d’emplois informel
Définition : Le taux d’emploi informel est défini comme le rapport du nombre d’actifs occupant un
emploi informel à l’effectif total des actifs occupés
Tableau A16 : Taux d’emplois informel par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 86,8 92,5 89,3
Bamako 86,9 93,0 89,5
Autres villes 86,7 92,1 88,9
Rural 98,2 99,1 98,6
Groupe d'âge
15 - 24 ans 99,5 98,8 99,1
25 - 34 ans 94,9 97,1 96,0
35 - 54 ans 93,4 98,1 95,6
55 - 64 ans 93,4 97,4 95,0
Niveau d'éducation
Aucun niveau 99,4 99,7 99,5
Primaire 96,4 96,9 96,5
Secondaire 53,7 41,9 50,2
Supérieur 41,7 43,9 42,1
Total 95,4 97,8 96,5
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
101 101 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
91
17. Proportion de l’emploi salarié
Définition : c’est le pourcentage des personnes occupées classées dans la catégorie des emplois salariés,
emplois pour lesquels les titulaires ont des contrats explicites ou implicites, écrits ou oraux, qui leur donnent
droit à une rémunération de base qui n’est pas directement dépendante du revenu de l’unité pour laquelle
ils travaillent.
Tableau A17 : Proportion de l’emploi salarié par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 32,6 15,3 25,2
Bamako 39,1 20,8 31,1
Autres villes 25,7 9,0 18,8
Rural 3,9 1,0 2,5
Groupe d'âge
15 - 24 ans 5,9 5,5 5,7
25 - 34 ans 13,6 4,1 8,8
35 - 54 ans 14,1 2,1 8,5
55 - 64 ans 11,3 3,2 8,0
Niveau d'éducation
Aucun niveau 3,8 1,3 2,5
Primaire 14,1 7,6 11,8
Secondaire 69,8 65,8 68,6
Supérieur 77,2 73,2 76,5
Total 10,8 4,0 7,7
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
18. Taux de salarisation
Définition : rapport du nombre de salariés à la population active occupée.
Tableau A18 : Taux de salarisation par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 36,7 17,4 28,5
Bamako 43,6 23,4 34,8
Autres villes 29,5 10,6 21,7
Rural 4,9 1,4 3,2
Groupe d'âge
15 - 24 ans 7,9 6,8 7,4
25 - 34 ans 15,5 4,5 9,9
35 - 54 ans 17,4 2,5 10,5
55 - 64 ans 12,2 3,8 8,8
Niveau d'éducation
Aucun niveau 4,8 1,9 3,3
Primaire 17,3 8,3 14,2
Secondaire 74,3 71,2 73,4
Supérieur 80,3 73,2 79,1
Total 12,6 4,7 9,0
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
102 102 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
92
19. Taux d’activité
Définition : rapport de la population active (population active occupée plus les chômeurs) à la population
en âge de travailler.
Tableau A19 : Taux d’activité par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 74,2 52,8 63,0
Bamako 73,4 54,1 63,4
Autres villes 75,0 51,4 62,6
Rural 90,2 69,3 78,8
Groupe d'âge
15 - 24 ans 67,9 55,9 61,6
25 - 34 ans 95,4 70,5 80,7
35 - 54 ans 98,5 72,6 84,4
55 - 64 ans 93,7 66,2 80,1
Niveau d'éducation
Aucun niveau 95,1 68,6 79,4
Primaire 70,4 51,7 62,3
Secondaire 71,7 60,9 67,6
Supérieur 75,7 66,4 73,6
Total 85,6 64,8 74,4
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
20. Taux de sous-emploi visible
Définition : Cet indicateur désigne le nombre de personnes pourvues d'un emploi dont les heures de travail
durant la période de référence sont insuffisantes par rapport à une autre situation d'emploi plus désirable
que ces personnes sont disposées à occuper et pour laquelle elles sont disponibles. Les directives actuelles
de l’OIT définissent le sous-emploi comme une situation d’emploi inadéquat en ce qui concerne la durée
et la productivité du travail.
Tableau A20 : Taux de sous-emploi par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le
sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 5,2 26,9 14,4
Bamako 4,8 30,9 16,2
Autres villes 5,6 22,3 12,5
Rural 2,8 15,9 9,0
Groupe d'âge
15 - 24 ans 3,9 16,7 9,9
25 - 34 ans 3,6 19,4 11,6
35 - 54 ans 3,0 17,0 9,5
55 - 64 ans 2,9 18,7 9,3
Niveau d'éducation
Aucun niveau 3,0 17,6 10,4
Primaire 4,4 22,8 10,8
Secondaire 2,8 7,5 4,2
Supérieur 3,9 5,1 4,2
Total 3,4 18,2 10,2
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
 |
103 103 |
▲back to top |
Enquête Nationale sur l’Emploi : rapport principal 2014
93
21. Taux de syndicalisation
Définition : C’est le rapport entre la population syndiqué et la population en emploi
Tableau A21 : Taux de syndicalisation par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 8,5 3,3 6,3
Bamako 3,7 1,4 2,7
Autres villes 13,5 5,3 10,1
Rural 3,8 1,6 2,7
Groupe d'âge
15 - 24 ans 2,2 1,6 1,9
25 - 34 ans 4,4 2,0 3,2
35 - 54 ans 7,3 1,8 4,7
55 - 64 ans 6,8 2,3 4,9
Niveau d'éducation
Aucun niveau 2,9 1,1 2,0
Primaire 5,2 2,2 4,1
Secondaire 25,8 30,9 27,3
Supérieur 24,7 13,8 22,8
Total 4,9 1,9 3,5
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
22. Durée moyenne du chômage
Définition : c’est le temps moyen (année) passé au chômage.
Tableau A22 : Durée moyenne du chômage par milieu de résidence, groupe d’âge, niveau d’éducation selon le sexe
Sexe
Masculin Féminin Total
Milieu de résidence
Urbain 2,84 3,33 3,10
Bamako 2,63 3,36 2,99
Autres villes 3,08 3,31 3,21
Rural 2,68 3,16 2,94
Groupe d'âge
15 - 24 ans 2,64 2,91 2,78
25 - 34 ans 2,82 3,49 3,23
35 - 54 ans 2,75 3,20 3,00
55 - 64 ans 2,77 3,34 3,00
Niveau d'éducation
Aucun niveau 2,61 3,19 2,93
Primaire 2,75 2,96 2,85
Secondaire 3,03 4,37 3,79
Supérieur 3,27 2,99 3,19
Total 2,73 3,22 2,99
Source : Calculs de l’ONEF à partir des données de l’EMOP (2014)
Copyright @ 2024 | ONEF .