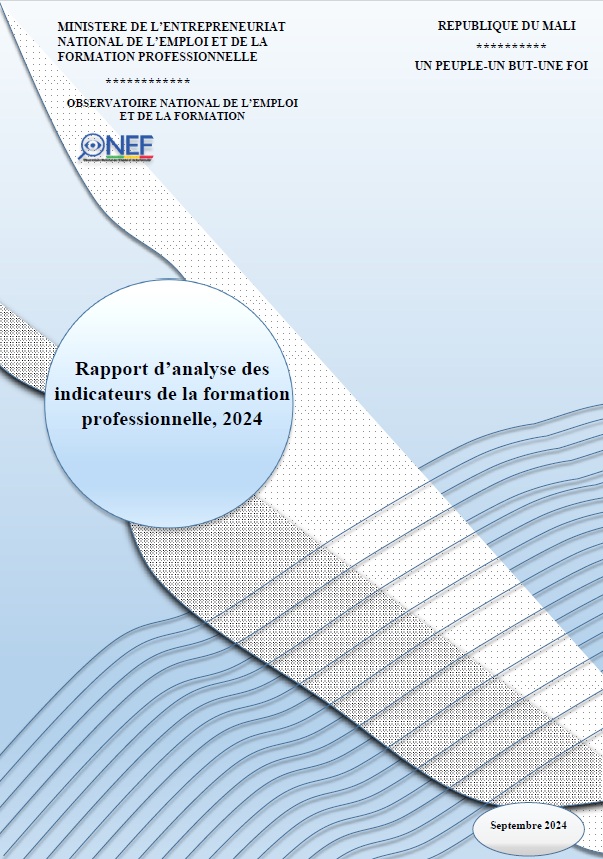MINISTER E DE L’ENTREPRENARIAT REPUBLIQUE DU MALI NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA Un...
 |
MINISTER E DE L’ENTREPRENARIAT REPUBLIQUE DU MALI NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA Un... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTER
E DE L’ENTREPRENARIAT REPUBLIQUE DU MALI
NATIONAL, DE L’EMPLOI ET DE LA Un Peuple – Un But – Une Foi
FORMATION PROFESSIONNELLE
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Rapport final
Rapport d’analyse des indicateurs de
la formation professionnelle 2023.
Septembre 2024
MINISTERE DE L’ENTREPRENEURIAT
NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
************
* OBS RVATOI NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Septembre 2024
Rapport d’analyse des
indicateurs de la formation
professionnelle, 2024
REPUBLIQUE DU MALI
**********
* UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
 |
2 2 |
▲back to top |
i
Table des matières
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................ ii
LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................................. ii
SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................................... iii
RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................ 4
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION ............................................................................................................... 5
2. METHODOLOGIE ........................................................................................................................................ 7
2.1. Collecte des données ........................................................................................................................... 7
2.2. Analyse des résultats ........................................................................................................................... 7
3. RESULTAT DE L’ETUDE ........................................................................................................................... 9
3.1. Analyse des indicateurs d’accès et de couverture de la formation professionnelle ...................... 9
3.2. Analyse des indicateurs d’efficacité interne du sous-secteur de la formation professionnelle .. 20
3.3. Analyse des indicateurs de ressources humaines et matérielles ................................................... 23
3.4. Analyse des indicateurs d’adéquation de la formation à l’emploi ............................................... 46
3.5. Analyse des indicateurs de financement ......................................................................................... 52
CONCLUSION ..................................................................................................................................................... 55
RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................................... 56
 |
3 3 |
▲back to top |
ii
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Proportion des apprenants inscrits dans les CFP privés par région et sexe (%) .................................. 10
Tableau 2: Proportion des apprenants inscrits dans les CFP privés par région et type de formation (%) ............. 11
Tableau 3: Répartition des apprenants selon les régions et le sexe ....................................................................... 14
Tableau 4: Nombre d’apprenants en formation professionnelle pour 100 000 habitants ...................................... 15
Tableau 5: Répartition des centres fonctionnels par région et type de formation enseigné (%)............................ 16
Tableau 6: Répartition des apprenants de la formation professionnelle selon le type de formation et sexe ......... 16
Tableau 7: Répartition des apprenants de la formation professionnelle selon la filière de formation ................... 18
Tableau 8: Répartition des apprenants selon la filière de formation et le type de formation ................................ 19
Tableau 9: Organismes fonctionnels de formation en 2023 .................................................................................. 21
Tableau 10: Proportion d’établissements privés engagés dans la formation professionnelle selon la région (%) 22
Tableau 11: caractéristiques de l’état des mobiliers collectifs .............................................................................. 24
Tableau 12: caractéristiques de l’état des mobiliers de bureau ............................................................................. 26
Tableau 13: Taux de satisfaction par rapport aux principaux équipements lourds par atelier............................... 27
Tableau 14: Taux de satisfaction par rapport aux principaux équipements légers par atelier ............................... 29
Tableau 15: Répartition des formateurs selon le diplôme et le sexe ..................................................................... 30
Tableau 16: répartition des formateurs selon le diplôme et le statut dans l’emploi .............................................. 31
Tableau 17: Taux de satisfaction par rapport aux salles de classes et autres locaux spécialisés (%) .................... 32
Tableau 18: Répartition des ateliers ...................................................................................................................... 33
Tableau 19: Répartition des postes de travail des ateliers ..................................................................................... 34
Tableau 20: caractéristiques des installations des ateliers (%) .............................................................................. 35
Tableau 21: Etat de l’éclairage, de l’aération et de la sécurité des ateliers (%) .................................................... 36
Tableau 22: caractéristiques des murs des ateliers (%) ......................................................................................... 37
Tableau 23: caractéristiques des sols des ateliers (%) ........................................................................................... 39
Tableau 24: Sources de financement des ateliers (%) ........................................................................................... 40
Tableau 25: Utilisation hebdomadaire de l'atelier par heure ................................................................................. 42
Tableau 26: Source de financement des centres de formation selon la région (%) ............................................... 53
Tableau 27: Répartition des apprenants de la formation professionnelle selon la source de financement ............ 54
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Proportion de filles/femmes inscrites dans la formation professionnelle (%) ........................................................... 12
Figure 2: Proportion de filles/femmes inscrites dans la formation professionnelle selon le type de formation (%) ................. 13
Figure 3: Proportion des établissements privés dans la formation professionnelle selon le type de formation (%).................. 23
Figure 4: Nombre moyen de partenaires par région pour un centre de formation professionnelle (CFP)................................. 43
Figure 5: Nombre moyen de partenaires par type de centre de formation professionnelle (CFP) ............................................ 44
Figure 6: Proportion de centre disposant de cellule d’insertion professionnelle selon le type de centre (%) ........................... 45
Figure 7: Proportion de centre disposant de cellule d’insertion professionnelle selon la région (%) ....................................... 46
Figure 8: Nombre d’apprenants en formation duale selon la région ......................................................................................... 47
Figure 9: Nombre d’apprenants en continue selon la région .................................................................................................... 48
Figure 10: Proportion de Centre de formation professionnelle effectuant au moins une visite d’entreprise ............................ 49
Figure 11: Proportion de Centre de formation professionnelle effectuant au moins une journée porte ouverte (%) ................ 50
Figure 12: Proportion de centre ayant un partenariat avec des entreprises intégrant les apprenants par région (%) ................ 51
 |
4 4 |
▲back to top |
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
ACEFOR Amélioration de la Compétitivité des Entreprises par la Formation Professionnelle
AFD Agence Française de Développement
ANPE Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
APEJ Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
CADD Cellule d’appui à la décentralisation déconcentration
CFA Communauté financière africaine,
CFP Centre de Formation Professionnelle
CIST Conférence Internationale des Statisticiens du Travail
CPS-
SICAEPIP
Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et
Promotion de l’Investissement Privé
DFM Direction des Finances et du Matériel
DNE Direction Nationale de l’Emploi
DNFP Direction Nationale de la Formation Professionnelle
DRH Direction des Ressources Humaines
EMOP Enquête Modulaire Permanente auprès des Ménages
EPST Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique
FAFPA Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage
FIER Formation professionnelle, Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux
FP Filière de formation
FPI Formation Professionnelle Initiale
HIMO Haute intensité de main-d'œuvre
INIFORP Institut national d’ingénierie de formation professionnelle
INSTAT Institut National des Statistique
MEFP Ministère d l’Emploi et de la Formation Professionnelle
OEF Observatoire de l’Emploi et la Formation
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
PAJE
NIETA
Projet d’appui aux jeunes entrepreneurs
PCFP Projet de Consolidation de la Formation Professionnelle
PDO Objectif de Développement du Projet
PEJ Programme Emploi Jeune
PNA/ERP Programme national d’action pour l’emploi en vue de la Réduction de la pauvreté
PNE Politique Nationale de l'Emploi
PRODEFPE Programme Décennal de Développement de la Formation Professionnelle pour l’Emploi
PTF Partenaire Technique Financier
SE Section d’énumération
SFP Stage de Formation Professionnelle
UP Unité Primaire
 |
5 5 |
▲back to top |
4
RESUME EXECUTIF
Le rapport d'analyse des indicateurs de la formation professionnelle 2024, produit par
l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) à partir des données de 2023,
présente une vue d’ensemble des dynamiques de la formation professionnelle au Mali. Basé sur
des données collectées auprès des centres de formation, il met en lumière les tendances, les
disparités régionales, les ressources humaines et matérielles, ainsi que les défis et progrès en
matière de formation professionnelle.
La formation professionnelle reste dominée par le secteur privé, représentant 93,3 % des centres
en 2023, une proportion stable par rapport à 2022. Cependant, certaines régions sont
exclusivement servies par des établissements privés, tandis que d'autres bénéficient de quelques
centres publics. Cette dépendance au secteur privé crée des disparités d'accès, en particulier
dans les zones rurales.
En 2023, la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle est
marquée, atteignant en moyenne 63,8 % des inscrits. La répartition entre les sexes varie
toutefois fortement selon les régions, certaines enregistrant des taux de participation féminine
supérieurs à 80 %, tandis que d’autres montrent une majorité masculine.
La filière "Coupe Couture Stylisme" reste prédominante, regroupant plus de la moitié des
apprenants en formation qualifiante, tandis que les formations techniques (construction
métallique, électricité bâtiment) sont sous-représentées, signalant un potentiel de diversification
des offres pour répondre aux besoins du marché.
Des disparités notables sont observées dans la qualité des infrastructures et équipements. Si
Bamako se distingue par un bon état général des salles de classe et équipements, plusieurs
régions souffrent d'un manque d’infrastructures en bon état, ce qui affecte la qualité de
l’apprentissage.
En moyenne, chaque centre collabore avec quatre partenaires professionnels, avec des centres
publics mieux pourvus en cellules d’insertion professionnelle (92,3 %) par rapport aux centres
privés (46,1 %). Cependant, des défis persistent dans l’accompagnement des jeunes, notamment
en matière de suivi et de coordination.
Le financement des centres repose principalement sur les frais d'inscription et les contributions
des partenaires techniques et financiers (PTF). En 2023, 64,6 % des apprenants financent eux-
mêmes leur formation, tandis que les PTF apportent un soutien en diminution, passant de 20,9
% en 2022 à 18,8 % en 2023.
En somme, ce rapport met en avant les avancées, les défis et les opportunités pour améliorer le
système de formation professionnelle au Mali, en soulignant la nécessité d'un engagement
renforcé de l’État et des partenaires pour soutenir une formation professionnelle plus équitable
et adaptée aux réalités économiques nationales.
 |
6 6 |
▲back to top |
5
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) dont l’une des missions est de
collecter, centraliser, traiter, analyser et diffuser des informations sur l’emploi et la formation
au Mali, produit à ce titre depuis sa création des indicateurs sur la formation professionnelle.
Depuis son opérationnalisation en 2015, il a bénéficié du financement et de l’appui technique
de plusieurs bailleurs de fonds, il s’agit notamment de la Banque mondiale, de l’Agence
française de développement, de l’Ambassade des Pays-Bas ainsi que de l’agence
luxembourgeoise pour la Coopération au développement (Lux-Development). L’expérience
acquise, les qualifications des agents de l’ONEF et le renforcement des capacités reçu lui
permettent de mener annuellement plusieurs études de qualité et de référence sur l’emploi et la
formation professionnelle.
Comparativement à la formation professionnelle diplômante, la formation professionnelle
qualifiante souffre de manque de données statistiques fiables et régulières, même si ces
dernières années la situation est en train de s’améliorer. En outre, la formation professionnelle
est réalisée et financée au Mali par plusieurs acteurs : l’État, les entreprises, les Organismes non
Gouvernementaux et les particuliers. Au niveau national, le financement de la formation
professionnelle est assuré par l’État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.
Compte tenu de la multiplicité des acteurs intervenants dans la formation professionnelle et
l’importance des financements orientés vers ce secteur, il est indispensable de disposer des
données statistiques régulières et fiables permettant d’évaluer les progrès réalisés dans le
domaine, d’informer sur les écarts constatés afin de faciliter la réflexion autour des mesures
d’amélioration à envisager. La maitrise des données permettra d’orienter les décideurs dans les
prises de décision relatives à la mise en œuvre des politiques et programmes touchant la
formation professionnelle. Néanmoins, la production d’un rapport d’analyse des indicateurs de
la formation professionnelle parait indispensable.
Par ailleurs, l’ONEF participe chaque année à la revue conjointe du secteur de l’éducation et de
la formation professionnelle. En effet, les départements chargés de l'éducation et de la formation
professionnelle organisent, en commun, un exercice annuel qui consiste à échanger et analyser
les enjeux, les défis, les progrès et les tendances du système éducatif et de la formation
professionnelle pour en tirer des leçons. Il s'agit d'une occasion de présenter les réalisations de
l'année écoulée et d'examiner les déterminants pertinents sans complaisance, proposer de
nouvelles mesures pour mettre en place les conditions d'un développement harmonieux de
l'éducation et de la formation professionnelle au Mali. La présentation des données statistiques
sur la formation professionnelle a mis en évidence des lacunes telles que le manque de données
actualisées sur les indicateurs de la formation professionnelle.
Ce rapport annuel offre ainsi des informations sur la dynamique de la formation professionnelle
pour l’année écoulée et, au besoin, fournira des indications sur les investissements à envisager
dans une perspective de développement de la formation professionnelle. Il constitue un outil
fondamental pour mieux visualiser plusieurs indicateurs de la liste minimale des indicateurs de
 |
7 7 |
▲back to top |
6
l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et identifier de nouveaux sujets
d’investigation.
L'objectif global de cette initiative étant de mettre à la disposition des utilisateurs des données
statistiques fiables et annuelles sur la formation professionnelle au Mali. Pour atteindre cet
objectif, cette production vise, de manière spécifique, à présenter les données collectées
concernant les centres de formation, le personnel administratif, les formateurs et les apprenants.
En outre, elle s'efforce d'analyser le niveau d'accès et la couverture de la formation
professionnelle, tout en estimant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires
au bon fonctionnement de ces centres.
De plus, ce rapport a pour but de renseigner sur des indicateurs relatifs à l'efficacité interne du
sous-secteur de la formation professionnelle. Il permettra également de calculer des indicateurs
concernant l'insertion professionnelle des sortants des centres de formation, tout en examinant
l'adéquation entre la formation proposée et les besoins du marché de l'emploi. Ainsi, ces
différentes analyses et informations s'entrelacent pour offrir une vision complète et précise de
la formation professionnelle au Mali, facilitant ainsi une meilleure compréhension et une prise
de décision éclairée.
 |
8 8 |
▲back to top |
7
2. METHODOLOGIE
Le rapport d'analyse des indicateurs de la formation professionnelle 2024 est élaboré à partir
des données collectées auprès des centres de formation professionnelle agréés par le Ministère
en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces données sont centralisées et
analysées afin de rédiger le rapport. Cette partie décrit la méthodologie utilisée pour la
réalisation de ce rapport relatif aux indicateurs de la formation professionnelle.
2.1. Collecte des données
Les données sont collectées par l’ONEF à travers un questionnaire élaboré sous l’application
KOBOCOLLECT. Le questionnaire a été adressé à tous les centres de formation
professionnelle agréés par le Ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle,
répertoriés sur le territoire national. En effet, ce questionnaire a permis de collecter les
informations relatives à l’identité des centres, l’état des équipements et du matériel, le personnel
administratif, les apprenants, les formateurs, les sources de financement etc…
2.1.1. Organisation de la collecte des données
Pour la collecte des données, le personnel de terrain était principalement constitué des points
focaux de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF), qui sont les agents
spécialisés des Directions Régionales de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DREFP).
Leur rôle a été déterminant pour garantir une couverture territoriale exhaustive, en particulier
dans les zones où se trouvent les centres de formation professionnelle (CFP) agréés par
Ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle.
La collecte a eu lieu dans toutes les localités du Mali où les CFP agréés sont présents, couvrant
ainsi un large éventail de contextes régionaux. Ce dispositif a permis de rassembler des
informations complètes et fiables sur le fonctionnement, les infrastructures, les ressources
humaines et matérielles, ainsi que les équipements des CFP pour l’année 2023. Cette approche
exhaustive visait à obtenir un état des lieux détaillé et à identifier les disparités régionales, dans
le but d'éclairer les décisions en matière de développement et de renforcement de la formation
professionnelle au Mali.
2.1.2. Processus de collecte des données
Le processus de collecte de données a été soutenu par l’utilisation de l’application
KOBOCOLLECT, une plateforme de collecte assistée par tablette, qui permet la saisie directe
et instantanée des informations sur le terrain. Cette méthode a optimisé l'efficacité et la
précision des données recueillies. En effet, chaque enquêteur, muni d’une tablette, a pu
directement enregistrer les réponses des centres, minimisant ainsi les erreurs de saisie et
accélérant le traitement des informations.
2.2. Analyse des résultats
À la suite de la centralisation des données collectées de différentes sources, une équipe a été
mise en place pour apurer, analyser et produire le rapport d’analyse provisoire. En premier lieu,
la tâche de cette équipe a consisté à apurer les données centralisées.
Après cette phase d’apurement, les données relatives aux indicateurs concernés ont été
calculées et interprétées selon le guide méthodologique des indicateurs clés de la formation
 |
9 9 |
▲back to top |
8
professionnelle au Mali, produit en avril 2020 par l’ONEF. Après cette phase, le rapport
provisoire, dans lequel les principaux indicateurs clés de la formation professionnelle ont été
présentés, a été produit.
Ce rapport a été soumis à l’appréciation des cadres responsables de la relecture et de la
correction des documents produits par l’ONEF. Cette étape avait pour objectif de réduire au
maximum les imperfections avant sa validation finale par le comité scientifique de l’ONEF. Le
rapport a été validé par le comité scientifique de l’ONEF le 09 janvier 2025.
 |
10 10 |
▲back to top |
9
3. RESULTAT DE L’ETUDE
Les résultats de cette enquête auprès des Centres de Formation Professionnelle (CFP)
fournissent des données statistiques sur les centres, les formateurs, le personnel administratif et
les apprenants, en se basant sur les données de 2023. Toutefois, l'application de la LOI N°2023-
007/DU 13 MARS 2023, portant création de nouvelles collectivités territoriales en République
du Mali, rendra difficile toute comparaison avec les données des années précédentes dans
l'ensemble des tableaux et graphiques.
3.1. Analyse des indicateurs d’accès et de couverture de la
formation professionnelle
Cette partie propose une analyse des indicateurs d’accès et de couverture de la formation
professionnelle, en s’appuyant sur la proportion des effectifs du privé par rapport à l’effectif
global inscrits dans la formation professionnelle, la proportion des filles/femmes inscrites dans
la formation professionnelle, le taux d’accroissement annuel des effectifs dans la formation
professionnelle, le nombre de centres de formation professionnelle fonctionnel, le nombre
d’apprenants en formation professionnelle pour 100 000 habitants et le nombre de jeunes
formés par type de formation.
3.1.1. Effectifs du privé dans l’effectif global des apprenants inscrits
dans la formation professionnelle
L’analyse des inscriptions dans les Centres de Formation Professionnelle (CFP) privés, à partir
des données recueillies auprès des CFP agréés, met en évidence des disparités notables entre
les régions et les sexes. En moyenne nationale, les femmes représentent 73,0 % des inscrits,
contre 27,0 % pour les hommes. Toutefois, ces proportions varient considérablement d'une
région à l'autre.
Dans certaines régions, la participation féminine est largement dominante. Par exemple, à
Kayes, 87,1 % des apprenants sont des femmes, tandis qu’à Koulikoro, elles représentent 90,0
% des inscrits. Des régions comme Sikasso et Koutiala confirment cette tendance avec
respectivement 73,3 % et 69,9 % d'apprenantes féminines.
En revanche, d'autres régions présentent une forte présence masculine dans les CFP privés. Gao,
par exemple, compte 64,8 % d'hommes parmi ses inscrits, tandis que dans des localités telles
que Nioro et Dioïla, les apprenants sont exclusivement masculins, avec des proportions
respectives de 100,0 % et 100,0 %. Par ailleurs, dans la région de Kita, la répartition entre les
sexes est presque équilibrée, avec 50,7 % d’hommes et 49,3 % de femmes.
Certaines régions, telles que Kidal, Taoudenni, Ménaka, Nara et Douentza, n'ont pas fourni de
données en raison de l'absence de collecte, causée par des contraintes logistiques. Des efforts
sont cependant prévus dans les années à venir pour mobiliser les ressources nécessaires afin
de couvrir l'ensemble du territoire national. Par conséquent, dans les tableaux et graphiques
de ce rapport, ces régions seront exclues pour alléger la présentation et en faciliter la lecture.
 |
11 11 |
▲back to top |
10
En somme, cette analyse souligne l’importance d’adapter les stratégies de formation
professionnelle en fonction des réalités locales, pour garantir un accès équitable à la formation
pour tous les jeunes, quel que soit leur sexe ou leur lieu de résidence.
Tableau 1: Proportion des apprenants inscrits dans les CFP privés par région et sexe (%)
Région Homme Femme Ensemble
Kayes 12,9 87,1 100,0
Koulikoro 10,0 90,0 90,3
Sikasso 26,7 73,3 86,9
Ségou 40,6 59,4 100,0
Mopti 37,7 62,3 100,0
Tombouctou 30,7 69,3 100,0
Gao 64,8 35,2 100,0
Kidal - - -
Taoudenni - - -
Ménaka - - -
Nioro 100,0 - 100,0
Kita 50,7 49,3 100,0
Dioïla 100,0 0,0 17,5
Nara - - -
Bougouni 8,8 91,2 57,1
Koutiala 30,1 69,9 97,3
San 45,8 54,2 95,0
Douentza - - -
Bandiagara 51,4 48,6 100,0
Bamako 24,7 75,3 57,0
Ensemble 27,0 73,0 77,8
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Les données présentées dans le tableau mettent en lumière la proportion des apprenants inscrits
dans les centres de formation professionnelle (CFP) privés, répartis par région et par type de
formation. Voici une analyse des résultats :
Dans certaines régions, comme Kayes et Nioro, l'ensemble des apprenants est exclusivement
inscrit en formation d'apprentissage, ce qui indique une forte orientation vers ce mode de
formation. Ces régions affichent ainsi un taux d'inscription de 100% en apprentissage, tandis
que d'autres types de formation sont absents. En revanche, des régions comme Koulikoro et
Sikasso montrent une diversité dans les types de formation, avec des proportions différentes
d'apprenants inscrits en formation continue et qualifiante. Par exemple, Koulikoro a un taux
d'inscription de 74,8% en formation continue, ce qui est relativement élevé, tandis que Sikasso
présente une forte proportion d'inscriptions à la formation continue (100%) et un taux
significatif en formation qualifiante (75,8%).
Il est également important de noter que certaines régions, telles que Mopti et Tombouctou,
affichent des taux d'inscription uniformes de 100% à toutes les catégories de formation, ce qui
révèle une économie de formation robuste et diversifiée. En revanche, d’autres régions la
proportion des inscrits est relativement faibles. Cela soulève des questions sur l'accessibilité et
l'intérêt pour les différentes formes de formation dans cette région.
Le district Bamako, la capitale, présente des résultats disparates, avec des inscriptions variées :
63,3% en apprentissage, une proportion respectable de 82,6% en formation continue, mais
 |
12 12 |
▲back to top |
11
seulement 29,4% en formation qualifiante. Cela pourrait indiquer un déséquilibre dans l'offre
de formation qui ne répond pas pleinement aux besoins des apprenants.
En somme, l'analyse des données révèle des disparités significatives dans l'inscription des
apprenants aux CFP privés selon les régions et les types de formation. Alors que certaines
régions se distinguent par une spécialisation dans l'apprentissage, d'autres connaissent une plus
grande diversité d'options de formation, soulignant ainsi l’importance d’une approche régionale
dans la planification des programmes de formation pour mieux répondre aux besoins locaux.
Tableau 2: Proportion des apprenants inscrits dans les CFP privés par région et type de formation (%)
Région Apprentissage Continue Qualifiante Ensemble
Kayes 100,0 - - 100,0
Koulikoro 100,0 74,8 100,0 90,3
Sikasso 100,0 100,0 75,8 86,9
Ségou - - 100,0 100,0
Mopti 100,0 100,0 100,0 100,0
Tombouctou 100,0 100,0 100,0 100,0
Gao - 100,0 - 100,0
Nioro 100,0 - - 100,0
Kita 100,0 - - 100,0
Dioïla 25,2 - 0,0 17,5
Bougouni 100,0 100,0 55,4 57,1
Koutiala 100,0 - 100,0 97,3
San - - 100,0 95,0
Bandiagara 100,0 - 100,0 100,0
Bamako 63,3 82,6 29,4 57,0
Ensemble 81,2 84,7 70,0 77,8
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.1.2. Filles/femmes inscrites dans la formation professionnelle
L'analyse des données concernant la proportion de filles et de femmes inscrites dans la
formation professionnelle révèle des disparités marquées entre les différentes régions. En effet,
la région de Nioro affiche un taux de 0 %, ce qui souligne un manque d'accès significatif à la
formation professionnelle pour les femmes dans cette zone. En revanche, certaines régions,
telles que Kayes (87,1 %) et Koulikoro (84,5 %), enregistrent des taux très élevés de
participation féminine, ce qui pourrait indiquer une meilleure sensibilisation aux opportunités
éducatives et un contexte socioculturel plus favorable à l'inclusion des femmes.
Entre ces extrêmes, on observe une tendance croissante dans les autres régions, avec des taux
variant de 35,2 % à 79,4 %. Par exemple, la région de Mopti, avec 62,3 %, et Ségou, à 63,8 %,
montrent une représentation féminine relativement forte, bien qu'encore en deçà de celle des
régions les plus avancées. Cela pourrait refléter des investissements locaux dans la formation
des filles et la formation professionnelle, ainsi que des politiques publiques visant à améliorer
l'égalité des sexes.
Il est intéressant de noter que l'ensemble des régions présente une moyenne de 63,8 %, ce qui
suggère que, malgré des disparités, il existe une tendance générale vers une plus grande
inclusion des femmes dans la formation professionnelle à l'échelle nationale. Cette dynamique
pourrait encourager d'autres régions, notamment celles avec des taux plus bas comme Gao (35,2
%) et Bandiagara (48,6 %), à adopter des initiatives similaires afin d'augmenter l'inscription des
 |
13 13 |
▲back to top |
12
filles. En somme, les données montrent non seulement les progrès réalisés, mais aussi
l'importance de poursuivre les efforts pour garantir à toutes les femmes un accès équitable à la
formation professionnelle.
Figure 1: Proportion de filles/femmes inscrites dans la formation professionnelle (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
La répartition des filles et des femmes inscrites dans la formation professionnelle selon le type
de formation. On observe que l'apprentissage est le domaine où la proportion de participantes
est la plus élevée, atteignant 68,5%. Cela pourrait indiquer une forte attractivité des métiers
manuels ou techniques pour les femmes. En revanche, les formations continues affichent une
participation de 55,9%, ce qui est nettement inférieur à celle des apprentissages. Cela suggère
que les femmes pourraient être moins enclines à s’engager dans des mises à jour de leurs
compétences dans ce cadre, éventuellement en raison de contraintes professionnelles ou
personnelles.
Pour les formations qualifiantes, la proportion s'élève à 58,1%, ce qui montre un intérêt
significatif, mais en deçà des taux d'apprentissage. Au total, en considérant l'ensemble des
formations, on atteint une proportion de 63,8%. Ce chiffre global témoigne d'une présence
importante des femmes dans la formation professionnelle, tout en mettant en lumière des
disparités selon les types de formation. Les variations observées entre les différentes catégories
soulignent des dynamiques spécifiques qui pourraient être explorées davantage pour mieux
comprendre les choix des femmes dans leur parcours de formation professionnelle.
0,0%
35,2%
48,6%
49,3%
50,5%
51,0%
62,3%
63,8%
69,3%
69,9%
71,6%
75,3%
79,4%
84,5%
87,1%
63,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Nioro
Gao
Bandiagara
Kita
San
Bamako
Mopti
Ségou
Tombouctou
Koutiala
Sikasso
Dioila
Bougouni
Koulikoro
Kayes
Ensemble
 |
14 14 |
▲back to top |
13
Figure 2: Proportion de filles/femmes inscrites dans la formation professionnelle selon le type de formation (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agrées, ONEF 2024
3.1.3. Effectifs des apprenants dans la formation Professionnelle
L'analyse de la répartition des apprenants selon les régions et le sexe révèle des tendances
intéressantes sur la diversité de la population étudiée et sur la répartition par genre. Dans
l'ensemble, on observe que la majorité des apprenants sont des femmes, représentant 63,8 % du
total, tandis que les hommes forment 36,2 % de la population.
Dans la région de Kayes, le nombre de femmes est significatif, avec un effectif de 465, soit 87,1
% des apprenants, tandis que les hommes ne représentent que 12,9 %. Une tendance similaire
se dégage dans la région de Koulikoro, où les femmes constituent 84,5 % des apprenants. En
revanche, à Gao, la tendance se renverse, 64,8 % des apprenants sont des hommes, et 35,2 %
de femmes. Cela crée un contraste marqué par rapport aux régions où les femmes sont
dominantes.
Sikasso et Mopti présentent également une répartition où les hommes obtiennent des
pourcentages plus élevés (28,4 % et 37,7 % respectivement), ce qui traduit une variation
régionale notable. Le cas particulier de Nioro est révélateur, avec un effectif de 16 hommes et
l'absence totale de femmes, mettant en exergue les disparités de genre au sein des régions.
À Bamako, la ville-capitale, la différence entre les sexes est beaucoup plus égalitaire, avec 51
% de femmes et 49 % d'hommes. Cela suggère une évolution vers une répartition plus équilibrée
dans les zones urbaines relativement versées dans la formation professionnelle.
En somme, cette enquête met en lumière des disparités intéressantes dans la répartition des
apprenants selon le sexe et la région, avec des zones marquées par une forte présence féminine
et d'autres où les hommes dominent largement. Ces données pourraient guider des politiques
visant à promouvoir l'égalité des sexes dans la formation professionnelle.
68,5%
55,9%
58,1%
63,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Apprentissage Continue Qualifiante Ensemble
 |
15 15 |
▲back to top |
14
Tableau 3: Répartition des apprenants selon les régions et le sexe
Région
Femme Homme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 465 87,1 69 12,9 534 100,0
Koulikoro 664 84,5 122 15,5 786 100,0
Sikasso 475 71,6 188 28,4 663 100,0
Ségou 111 63,8 63 36,2 174 100,0
Mopti 481 62,3 291 37,7 772 100,0
Tombouctou 223 69,3 99 30,7 322 100,0
Gao 45 35,2 83 64,8 128 100,0
Nioro 0 0,0 16 100,0 16 100,0
Kita 71 49,3 73 50,7 144 100,0
Dioïla 116 75,3 38 24,7 154 100,0
Bougouni 331 79,4 86 20,6 417 100,0
Koutiala 355 69,9 153 30,1 508 100,0
San 50 50,5 49 49,5 99 100,0
Bandiagara 34 48,6 36 51,4 70 100,0
Bamako 1460 51,0 1405 49,0 2865 100,0
Ensemble 4881 63,8 2771 36,2 7652 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.1.4. Apprenants en formation professionnelle pour 100 000
habitants
Cet indicateur mesure l’accès à la formation professionnelle de la population ainsi que le poids
des apprenants pour 100 000 habitants. En 2023, le taux moyen d'apprenants pour 100 000
habitants est de 34 pour l'ensemble des apprenants, avec 44 pour les femmes et 25 pour les
hommes. Cela indique une participation plus élevée des femmes à la formation professionnelle,
en moyenne, par rapport aux hommes.
La région de Mopti se classe première position en termes d'inscriptions à la formation
professionnelle pour chaque tranche de 100 000 habitants avec 90 apprenants pour chaque
tranche de 100 000 habitants. Plus spécifiquement, dans cette région, on compte 68 hommes et
106 femmes inscrits pour chaque tranche de 100 000 habitants.
Le district de Bamako se classe en deuxième position présentant un taux exceptionnellement
élevé de 68 apprenants pour 100 000 habitants (tant pour les femmes que pour les hommes, 68
pour les femmes et 67 pour les hommes). Ce cas reflète probablement la forte concentration de
centres de formation et d'opportunités professionnelles dans la capitale.
Les régions avec des taux extrêmement faibles, telles que Nioro (2), Bandiagara (8), et Gao
(18), indiquent probablement un manque d'infrastructure et d'opportunités d'apprentissage. Cela
nécessite des investissements ciblés pour améliorer l'accès à la formation professionnelle,
notamment en matière de centres de formation, de transport et d'accompagnement.
En général, les femmes semblent plus représentées dans plusieurs régions (notamment Mopti,
Sikasso, Kayes, et Koulikoro). Cela pourrait refléter des initiatives ciblées pour promouvoir la
participation féminine dans la formation professionnelle, ou des secteurs spécifiques d'emploi
accessibles aux femmes.
 |
16 16 |
▲back to top |
15
Tableau 4: Nombre d’apprenants en formation professionnelle pour 100 000 habitants
Région Femme Homme Ensemble
Kayes 51 7 29
Koulikoro 60 11 35
Sikasso 61 25 43
Ségou 9 5 7
Mopti 106 60 90
Tombouctou 48 20 33
Gao 13 22 18
Nioro 0 5 2
Kita 21 21 21
Dioïla 34 11 23
Bougouni 43 11 27
Koutiala 59 27 43
San 12 12 12
Bandiagara 8 8 8
Bamako 68 67 68
Ensemble 44 25 34
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.1.5. Types de formation
L'analyse de la répartition des centres de formation professionnelle (CFP) fonctionnels par
région et par type de formation (apprentissage, qualifiante, continue), à partir des données
collectées par l'ONEF en 2024, révèle une couverture globale élevée, mais avec des disparités
notables entre les régions et les types de formation.
À l'échelle nationale, 96,4 % des centres dispensent des formations en apprentissage, 95,9 %
des formations qualifiantes, et 89,1 % des formations continues. Cependant, cette distribution
varie d'une région à l'autre. Les régions de Kayes, Gao, Nioro, Kita, San et Bandiagara affichent
une couverture de 100 % pour les trois types de formation, démontrant une offre complète et
équilibrée.
D'autres régions, telles que Koulikoro, Sikasso et Mopti, présentent également une forte
disponibilité de l'apprentissage et des formations qualifiantes, avec des taux avoisinant ou
atteignant 100 %, mais des taux légèrement plus faibles pour la formation continue : Koulikoro
est à 84,2 % et Ségou à 81,8 %, ce qui indique un potentiel de renforcement dans ce domaine.
À Bamako, la couverture des centres fonctionnels reste élevée pour les trois types de formation
avec des taux de 97,3 % en apprentissage, 91,9 % en formation qualifiante, et 94,6 % en
formation continue, ce qui souligne une offre diversifiée dans la capitale.
En revanche, certaines localités comme Dioïla et Bougouni montrent des disparités marquées
entre les différents types de formation. À Dioïla, par exemple, 100 % des centres proposent des
formations en apprentissage, mais seulement 57,1 % offrent des formations qualifiantes et
continues. Bougouni présente des disparités encore plus importantes, avec 57,1 % pour
l'apprentissage, 85,7 % pour les formations qualifiantes, mais seulement 14,3 % pour la
formation continue, indiquant une couverture faible de ce type de formation dans la région.
Ces résultats montrent l’importance de renforcer l’accès aux formations continues dans
plusieurs régions et de mettre en place des solutions pour couvrir les zones non collectées, afin
d'assurer une distribution plus équitable de l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble
du territoire.
 |
17 17 |
▲back to top |
16
Tableau 5: Répartition des centres fonctionnels par région et type de formation enseigné (%)
Régions Apprentissage Qualifiante Continue
Kayes 100,0 100,0 100,0
Koulikoro 94,7 100,0 84,2
Sikasso 94,1 100,0 94,1
Ségou 100,0 100,0 81,8
Mopti 95,5 100,0 95,5
Tombouctou 100,0 92,3 100,0
Gao 100,0 100,0 100,0
Nioro 100,0 100,0 100,0
Kita 100,0 100,0 100,0
Dioïla 100,0 57,1 57,1
Bougouni 57,1 85,7 14,3
Koutiala 100,0 100,0 94,4
San 100,0 100,0 100,0
Bandiagara 100,0 100,0 100,0
Bamako 97,3 91,9 94,6
Ensemble 96,4 95,9 89,1
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
La répartition des apprenants de la formation professionnelle selon le type de formation et le
sexe met en lumière des différences significatives entre les femmes et les hommes. En
examinant les données, on constate que dans le cadre de l'apprentissage, les femmes
représentent une majorité significative avec 2970 apprenantes, soit 68,5 % des effectifs, tandis
que les hommes, avec 1366 participants, ne constituent que 31,5 %.
Pour la formation continue, la tendance se renverse légèrement, bien que les femmes demeurent
majoritaires avec 410 participantes (55,9 %) contre 323 hommes (44,1 %). Cela illustre un
intérêt encore important chez les femmes pour les opportunités de formation continue, bien
qu'elles soient moins représentées que dans l'apprentissage.
Concernant la formation qualifiante, les femmes totalisent 1501 effectifs, représentant 58,1 %
des apprenants, tandis que les hommes comptent 1082 apprenants, soit 41,9 %. Ce résultat
montre également une forte participation féminine, suggérant que les femmes sont préoccupées
par l'acquisition de qualifications professionnelles.
Dans l'ensemble, en combinant tous les types de formation, les femmes constituent 63,8 % des
apprenants, avec un effectif total de 4881, contre 36,2 % pour les hommes, qui totalisent 2771.
Ces chiffres soulignent une prévalence claire de la présence féminine dans la formation
professionnelle, ce qui pourrait refléter des tendances sociales et des efforts pour encourager
l'égalité des sexes dans le domaine de la formation.
Ainsi, l'analyse des données provient d'une enquête menée auprès des centres de formation
professionnelle agréés par l’ONEF en 2022, mettant en avant l'importance de poursuivre les
initiatives visant à équilibrer la représentation des sexes dans tous les types de formation
professionnelle.
Tableau 6: Répartition des apprenants de la formation professionnelle selon le type de formation et sexe
Type de formation
Femme Homme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Apprentissage 2970 68,5 1366 31,5 4336 100,0
Continue 410 55,9 323 44,1 733 100,0
Qualifiante 1501 58,1 1082 41,9 2583 100,0
Ensemble 4881 63,8 2771 36,2 7652 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agrées, ONEF 2024
 |
18 18 |
▲back to top |
17
3.1.6. Filière de formation
L'indicateur examiné ici se concentre sur le nombre de jeunes formés en formation
professionnelle, en analysant les données par filière. Cette étude permet d'évaluer les
potentialités en termes de main-d'œuvre.
La filière Coupe Couture Stylisme se distingue nettement avec 4015 apprenants, ce qui
représente 52,5 % de l'effectif total des formés. Ce chiffre pourrait indiquer une forte orientation
vers les métiers de l'industrie de la mode et du textile, voire une demande accrue pour des
formations dans ce secteur. Il est également possible que la concentration géographique des
centres de formation dans ce domaine y contribue.
Les filières techniques et industrielles, telles que la Construction métallique, l'Électricité
bâtiment, et la Mécanique auto, sont également présentes, mais à des niveaux nettement
inférieurs à ceux de la Couture. Malgré leur importance stratégique pour le développement
économique, ces domaines attirent moins de candidats, ce qui suggère un besoin d'intensifier la
promotion des métiers techniques et industriels afin de répondre à la demande croissante de
compétences dans des secteurs comme la construction et l'industrie.
En ce qui concerne les filières agricoles et agroalimentaires, des filières telles que la
Transformation agroalimentaire (8,5 %) et l'Embouche (2,3 %) montrent que l'agriculture et
l'alimentation, notamment l'agro-industrie, restent des domaines de formation importants.
Toutefois, ces filières pourraient bénéficier d'un développement accru pour améliorer la
compétitive des produits locaux.
Enfin, les filières de niche, telles que la Saponification, la Pisciculture, et le Tatouage, affichent
un intérêt limité, mais elles peuvent offrir des opportunités sur des marchés spécifiques,
notamment dans des secteurs liés à l'artisanat ou à des industries émergentes comme
l'aquaculture ou les produits cosmétiques artisanaux.
 |
19 19 |
▲back to top |
18
Tableau 7: Répartition des apprenants de la formation professionnelle selon la filière de formation
Filière de formation Nombre d'apprenants
Effectif %
Aviculture 105 1,4
Boulangerie Pâtisserie 27 0,4
Carrelage 46 0,6
Céréaliculture 5 0,1
Chaudronnerie 29 0,4
Coiffure esthétique 181 2,4
Conditionnement du sel 102 1,3
Conduite auto 10 0,1
Construction métallique 273 3,6
Coupe Couture Stylisme 4015 52,5
Electricité bâtiment 274 3,6
Electricité Photovoltaïque 28 0,4
Electronique 55 0,7
Embouche 179 2,3
Filature 41 0,5
Froid climatisation 177 2,3
Machinisme agricole 134 1,8
Maçonnerie 18 0,2
Maintenance des Equipements Agricoles 17 0,2
Maintenance Industriels 74 1,0
Maraîchage 124 1,6
Mécanique Auto 181 2,4
Mécanique Engins à 2 roues 201 2,6
Mécatronique 38 0,5
Menuiserie aluminium 42 0,5
Menuiserie bois 201 2,6
Peinture bâtiment 39 0,5
Pisciculture 12 0,2
Plomberie sanitaire 130 1,7
Production d'aliment bétail 39 0,5
Restauration 29 0,4
Saponification 7 0,1
Staff décoration 84 1,1
Tatouage 16 0,2
Teinture 37 0,5
Tissage 32 0,4
Transformation agroalimentaire 650 8,5
Ensemble 7652 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
La majorité des apprenants ont suivi des formations par apprentissage (4336 apprenants, soit
56,7 %), suivi par ceux en formation qualifiante (2583 apprenants, soit 34 %) et une plus petite
proportion en formation continue (733 apprenants, soit 9,6 %).
En apprentissage, la filière Coupe Couture Stylisme (52,5 % du total des apprenants) attire la
grande majorité des apprenants (2466 apprenants, soit 56,9 %). Cela montre l'importance de
cette filière en termes d'opportunités d'apprentissage sur le terrain. La filière Transformation
agroalimentaire (650 apprenants, 8,5 % du total) est également bien représentée, en particulier
dans l'apprentissage (275 apprenants, soit 6,3 %). Certaines filières spécialisées ont un nombre
très faible d'apprenants en apprentissage, comme la Boulangerie Pâtisserie (0 apprenant en
apprentissage), Céréaliculture (0 apprenant en apprentissage), ou encore Pisciculture (0
apprenant en apprentissage)
Dans la formation continue, certaines filières semblent avoir un nombre significatif
d'apprenants comme la Maintenance industrielle (44 apprenants, soit 6 %), et la Menuiserie
bois (17 apprenants, soit 2,3 %). Ces filières peuvent être perçues comme des formations
destinées aux adultes ou aux personnes en reconversion professionnelle. La Coiffure esthétique
et Mécanique auto attirent également un nombre relativement élevé d'apprenants en formation
 |
20 20 |
▲back to top |
19
continue, suggérant que ces secteurs sont populaires pour des formations flexibles ou de mise
à jour des compétences. Les filières très techniques comme Construction métallique et
Electricité bâtiment ont une proportion relativement faible d'apprenants en formation continue.
Dans la formation qualifiante, la filière de Coupe Couture Stylisme est encore très présente
(1122 apprenants, soit 43,4 % de son effectif total), ce qui montre qu'elle attire de nombreux
jeunes souhaitant obtenir une qualification formelle dans un secteur créatif et industriel. La
filière Transformation agroalimentaire montre également une proportion importante
d'apprenants en formation qualifiante (351 apprenants, soit 13,6 % de son effectif total).
D'autres filières comme Froid climatisation (52 apprenants, 2 %) et Mécanique Engins à 2 roues
(101 apprenants, 3,9 %) montrent également un nombre significatif d'apprenants en formation
qualifiante.
Tableau 8: Répartition des apprenants selon la filière de formation et le type de formation
Filière de formation
Apprentissage Continue Qualifiante Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Aviculture 45 1,0 15 2,0 45 1,7 105 1,4
Boulangerie Pâtisserie 0 0,0 0 0,0 27 1,0 27 0,4
Carrelage 29 0,7 0 0,0 17 0,7 46 0,6
Céréaliculture 0 0,0 0 0,0 5 0,2 5 0,1
Chaudronnerie 5 0,1 0 0,0 24 0,9 29 0,4
Coiffure esthétique 103 2,4 0 0,0 78 3,0 181 2,4
Conditionnement du sel 102 2,4 0 0,0 0 0,0 102 1,3
Conduite auto 10 0,2 0 0,0 0 0,0 10 0,1
Construction métallique 167 3,9 35 4,8 71 2,7 273 3,6
Coupe Couture Stylisme 2466 56,9 427 58,3 1122 43,4 4015 52,5
Electricité bâtiment 109 2,5 29 4,0 136 5,3 274 3,6
Electricité Photovoltaïque 10 0,2 0 0,0 18 0,7 28 0,4
Electronique 43 1,0 0 0,0 12 0,5 55 0,7
Embouche 113 2,6 6 0,8 60 2,3 179 2,3
Filature 0 0,0 0 0,0 41 1,6 41 0,5
Froid climatisation 115 2,7 10 1,4 52 2,0 177 2,3
Machinisme agricole 132 3,0 2 0,3 0 0,0 134 1,8
Maçonnerie 12 0,3 1 0,1 5 0,2 18 0,2
Maintenance des Equipements Agricoles 0 0,0 0 0,0 17 0,7 17 0,2
Maintenance industriel 9 0,2 44 6,0 21 0,8 74 1,0
Maraîchage 37 0,9 10 1,4 77 3,0 124 1,6
Mécanique Auto 100 2,3 31 4,2 50 1,9 181 2,4
Mécanique Engins à 2 roues 79 1,8 21 2,9 101 3,9 201 2,6
Mécatronique 16 0,4 0 0,0 22 0,9 38 0,5
Menuiserie aluminium 17 0,4 15 2,0 10 0,4 42 0,5
Menuiserie bois 171 3,9 17 2,3 13 0,5 201 2,6
Peinture bâtiment 25 0,6 0 0,0 14 0,5 39 0,5
Pisciculture 0 0,0 6 0,8 6 0,2 12 0,2
Plomberie sanitaire 63 1,5 11 1,5 56 2,2 130 1,7
Production d'aliment bétail 19 0,4 0 0,0 20 0,8 39 0,5
Restauration 4 0,1 10 1,4 15 0,6 29 0,4
Saponification 7 0,2 0 0,0 0 0,0 7 0,1
Staff décoration 43 1,0 19 2,6 22 0,9 84 1,1
Tatouage 0 0,0 0 0,0 16 0,6 16 0,2
Teinture 10 0,2 0 0,0 27 1,0 37 0,5
Tissage 0 0,0 0 0,0 32 1,2 32 0,4
Transformation agroalimentaire 275 6,3 24 3,3 351 13,6 650 8,5
Ensemble 4336 100,0 733 100,0 2583 100,0 7652 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
 |
21 21 |
▲back to top |
20
3.2. Analyse des indicateurs d’efficacité interne du sous-
secteur de la formation professionnelle
Des indicateurs comme le taux d’accroissement des Centres de formation professionnelle, la
part du privé dans les Centres de formation professionnelle, le pourcentage d’abandon dans le
sous-secteur de la Formation professionnelle, le taux de réussite à l’examen final de Certificat
de qualification professionnelle (CQP), le taux de scolarisation de la formation professionnelle
résidentielle et le taux de scolarisation de la formation professionnelle en apprentissage par
alternance devraient être calculés et interprétés. Cependant, par manque de données, les quatre
derniers indicateurs cités ci-dessus n’ont pas pu être analysés.
3.2.1. Situation des centres de formation professionnelle
L’analyse des organismes fonctionnels de formation par région en 2023, selon les données
collectées par l’ONEF en 2024, révèle une concentration inégale des centres à travers le pays.
Au total, 193 organismes de formation étaient opérationnels cette année-là, avec une répartition
significative entre les différentes régions.
La région de Bamako abrite la majorité des organismes de formation, avec 37 centres
fonctionnels, représentant 19,2 % de l’ensemble des structures, ce qui souligne le poids de la
capitale dans le secteur de la formation professionnelle. Les régions de Ségou et Mopti suivent
avec chacune 22 centres, représentant chacune 11,4 % des organismes de formation. Ces deux
régions, bien qu’étant en dehors de la capitale, jouent un rôle clé dans la couverture de l’offre
de formation.
Des régions comme Koulikoro (19 centres, soit 9,8 %) et Sikasso (17 centres, soit 8,8 %)
maintiennent également une présence significative, contribuant ainsi à diversifier l’accès aux
formations dans le sud du pays. Koutiala dispose également de 18 centres, représentant 9,3 %
de l’ensemble des centres.
À l’inverse, plusieurs régions affichent des taux relativement bas de centres de formation
fonctionnels. Par exemple, les régions de Kayes, Gao, et Kita ne comptent chacune que 6
centres, représentant 3,1 % des structures au niveau national. D’autres localités, comme Nioro
et Bandiagara, montrent des effectifs encore plus faibles avec respectivement 2 et 4 centres, soit
1,0 % et 2,1 % de l’ensemble des structures.
 |
22 22 |
▲back to top |
21
Tableau 9: Organismes fonctionnels de formation en 2023
Région Effectif %
Kayes 6 3,1
Koulikoro 19 9,8
Sikasso 17 8,8
Ségou 22 11,4
Mopti 22 11,4
Tombouctou 13 6,7
Gao 6 3,1
Nioro 2 1,0
Kita 6 3,1
Dioïla 7 3,6
Bougouni 7 3,6
Koutiala 18 9,3
San 7 3,6
Bandiagara 4 2,1
Bamako 37 19,2
Ensemble 193 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.2.2. Part du privé dans les centres de formation professionnelle
L'analyse de la proportion d'établissements privés engagés dans la formation professionnelle,
montre une prédominance marquée des centres privés dans presque toutes les régions. À
l’échelle nationale, 93,3 % des établissements de formation professionnelle sont privés, contre
seulement 6,7 % pour le secteur public, soulignant l'importance du secteur privé dans le
développement de ce sous-secteur.
Certaines régions, comme Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao, Nioro, et Kita, dépendent
exclusivement des établissements privés pour l’offre de formation professionnelle, avec des
proportions de 100 % de centres privés et aucune présence publique. Ces chiffres montrent que
le secteur privé est essentiel dans l'accès à la formation professionnelle dans ces zones.
D'autres régions, bien que présentant une légère présence du secteur public, sont également
dominées par le privé. Par exemple, Sikasso et Ségou ont respectivement 94,1 % et 95,5 % de
centres privés, tandis que Koulikoro affiche 89,5 % d’établissements privés. De même,
Bamako, malgré sa taille et son rôle central, compte 94,6 % d’établissements privés, ce qui
reflète une tendance forte vers une offre de formation principalement assurée par le secteur
privé dans la capitale.
Certaines exceptions notables apparaissent dans des régions comme Dioïla et Bougouni, où la
part du public est plus importante par rapport aux autres régions, avec respectivement 28,6 %
et 42,9 % de centres publics. Ces proportions, bien que minoritaires, montrent que dans ces
régions spécifiques, le secteur public a une présence significative dans la formation
professionnelle.
Globalement, ces données mettent en lumière la dépendance de la formation professionnelle au
secteur privé dans la majorité des régions, un facteur important à considérer pour les politiques
de développement et d’accessibilité de la formation professionnelle à travers le pays.
 |
23 23 |
▲back to top |
22
Tableau 10: Proportion d’établissements privés engagés dans la formation professionnelle selon la région (%)
Région Public Privé Ensemble
Kayes 0,0 100,0 100,0
Koulikoro 10,5 89,5 100,0
Sikasso 5,9 94,1 100,0
Ségou 4,5 95,5 100,0
Mopti 0,0 100,0 100,0
Tombouctou 0,0 100,0 100,0
Gao 0,0 100,0 100,0
Nioro 0,0 100,0 100,0
Kita 0,0 100,0 100,0
Dioïla 28,6 71,4 100,0
Bougouni 42,9 57,1 100,0
Koutiala 5,6 94,4 100,0
San 14,3 85,7 100,0
Bandiagara 0,0 100,0 100,0
Bamako 5,4 94,6 100,0
Ensemble 6,7 93,3 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
L'analyse de la proportion des établissements privés dans la formation professionnelle, selon le
type de formation, met en évidence une prédominance significative du secteur privé, comme
l'indiquent les données collectées par l'ONEF en 2024.
Pour les formations en apprentissage, 98,3 % des établissements sont privés, tandis que
seulement 69,2 % sont publics. Cela souligne que le secteur privé joue un rôle prédominant
dans la fourniture de cette forme de formation, ce qui est essentiel pour le développement des
compétences pratiques chez les apprenants.
Concernant les formations qualifiantes, la situation est similaire, avec 95,6 % des
établissements étant privés et 100 % de ceux qui sont publics. Cela indique que les formations
qualifiantes sont entièrement assurées par des établissements publics dans certains contextes,
tandis que le privé reste majoritaire dans l'ensemble des offres de formation.
Pour les formations continues, 91,1 % des centres sont privés, tandis que 61,5 % sont publics.
Ce ratio démontre que, même dans le cadre de la formation continue, le secteur privé
prédomine, bien que le secteur public reste également engagé dans la fourniture de ces
formations.
En résumé, les données révèlent une forte concentration d'établissements privés dans l'ensemble
des types de formation professionnelle, ce qui souligne l'importance croissante du secteur privé
dans la formation professionnelle au Mali. Cette dynamique peut avoir des implications
significatives pour l'accès à la formation, le développement des compétences et l'employabilité
des apprenants, rendant essentiel un équilibre entre les deux secteurs pour répondre aux besoins
variés du marché du travail.
 |
24 24 |
▲back to top |
23
Figure 3: Proportion des établissements privés dans la formation professionnelle selon le type de formation (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.3. Analyse des indicateurs de ressources humaines et
matérielles
Cette partie traite les informations relatives aux personnels administratifs, aux personnels
formateurs et aux apprenants ainsi qu’aux mobiliers et équipements des centres de formation
professionnelle.
3.3.1. Mobiliers et équipements
L’analyse des caractéristiques de l’état des mobiliers collectifs dans les établissements de
formation professionnelle, selon les données de l’ONEF pour 2024, met en évidence des
disparités notables entre les régions en termes de qualité des infrastructures et des équipements.
À l’échelle nationale, un total de 722 bureaux administratifs et 766 salles de cours sont jugés
en bon état, tandis que 23 bureaux et 14 salles présentent un état mauvais. Ces chiffres suggèrent
que la majorité des infrastructures administratives et pédagogiques sont en bon état, ce qui est
encourageant pour la qualité de l'enseignement.
Cependant, des variations régionales se dessinent. Par exemple, Bamako se distingue par un
nombre élevé de bureaux et de salles de cours en bon état, avec respectivement 374 et 191
unités, et seulement 7 et 3 en mauvais état. Cela souligne la prééminence de la capitale en
matière d'infrastructures, facilitant un meilleur environnement d'apprentissage.
En revanche, certaines régions comme Nioro et Bandiagara montrent des chiffres alarmants,
avec un faible nombre d’équipements en bon état. Nioro, par exemple, ne compte que 2 bureaux
en bon état, tandis que Bandiagara affiche 4 bureaux, tous considérés comme satisfaisants. Ces
statistiques mettent en évidence un besoin urgent d’amélioration dans ces régions pour garantir
un environnement de formation adéquat.
Concernant les mobiliers d’apprentissage, un total de 9682 tables-bancs sont en bon état, tandis
que 443 sont jugés mauvais. Cependant, des disparités se retrouvent également ici : des régions
69,2%
98,3% 96,4%100,0% 95,6% 95,9%
61,5%
91,1% 89,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Public Privé Total
Apprentissage Qualifiante Continue
 |
25 25 |
▲back to top |
24
comme Koulikoro et Koutiala affichent un nombre considérable de tables en bon état (1456 et
1803 respectivement), tandis que d'autres, comme Gao et Dioïla, montrent un état moins
favorable avec un plus grand nombre de meubles nécessitant une attention.
De plus, l’état des chaises et tables des apprenants est globalement préoccupant, avec 7002 en
bon état et 387 en mauvais état au niveau national. Cela est particulièrement problématique
dans des régions comme Bougouni, où des chiffres significatifs de mobiliers en mauvais état
ont été rapportés, entravant la qualité de l'apprentissage.
En somme, cette analyse souligne non seulement l’importance de l’état des mobiliers collectifs
pour le bon fonctionnement des centres de formation professionnelle, mais elle révèle
également des inégalités régionales qui nécessitent des interventions ciblées. L'amélioration des
infrastructures et des équipements dans les zones moins favorisées est cruciale pour garantir un
accès équitable à une formation de qualité à travers le pays.
Tableau 11: caractéristiques de l’état des mobiliers collectifs
Région
B
u
rea
u
x
a
d
m
in
istra
tifs
S
a
lles d
e co
u
rs
T
a
b
les-b
a
n
c
B
a
n
cs
a
p
p
ren
a
n
ts
C
h
a
ises
a
p
p
ren
a
n
ts
T
a
b
les
a
p
p
ren
a
n
ts
A
u
tres
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
Kayes 33 0 27 0 208 6 42 8 202 5 151 4 0 0
Koulikoro 58 3 94 0 1456 47 774 34 1014 75 836 86 0 0
Sikasso 34 0 57 0 490 5 162 11 502 0 133 0 230 0
Ségou 39 0 126 0 1100 35 559 48 556 49 535 47 0 0
Mopti 21 2 30 0 303 60 324 12 262 34 195 18 0 0
Tombouctou 18 0 24 0 265 20 162 10 290 5 87 5 0 0
Gao 12 0 44 0 910 82 160 20 245 0 90 4 5 2
Nioro 2 0 5 0 12 2 11 1 12 0 8 3 0 0
Kita 6 0 18 0 52 3 40 1 43 3 42 7 80 0
Dioïla 13 2 25 1 480 30 15 0 111 0 13 0 30 0
Bougouni 11 3 16 6 95 7 20 0 435 60 127 13 51 14
Koutiala 82 6 75 4 1803 65 671 42 313 53 246 33 33 2
San 15 0 30 0 545 11 236 11 312 16 306 16 0 0
Bandiagara 4 0 4 0 55 5 58 0 20 5 0 0 0 0
Bamako 374 7 191 3 1908 65 1240 39 2685 82 2010 58 194 10
Ensemble 722 23 766 14 9682 443 4474 237 7002 387 4779 294 623 28
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
L'analyse des caractéristiques de l’état des mobiliers de bureau dans les centres de formation
professionnelle, révèle des tendances variées et des défis significatifs au sein des différentes
régions.
Au niveau national, 550 ordinateurs sont en bon état, tandis que 76 sont jugés mauvais,
indiquant que la majorité des établissements disposent d'outils informatiques fonctionnels.
Cependant, certaines régions, comme Bandiagara, ne disposent d'aucun ordinateur en état de
marche, ce qui peut fortement limiter l'accès à l'informatique et à des ressources pédagogiques
modernes.
 |
26 26 |
▲back to top |
25
Koutiala se distingue par un nombre impressionnant d'ordinateurs en bon état (95), tandis que
Bamako en compte 217, démontrant la concentration des ressources technologiques dans les
zones urbaines. En revanche, des régions comme Gao et Nioro affichent des chiffres
préoccupants avec seulement 7 et 1 ordinateur respectivement, révélant une inégalité d'accès
aux équipements numériques.
En ce qui concerne les photocopieurs, 165 sont en bon état à l'échelle nationale, mais 33 sont
en mauvais état. Ségou, avec 28 photocopieurs en bon état, et Koulikoro, avec 22, montrent des
résultats satisfaisants, tandis que d'autres régions, comme Gao et Nioro, affichent des chiffres
alarmants, ce qui pourrait entraver la capacité des centres à fournir des documents et des
ressources pédagogiques.
L'état des scanners et des imprimantes révèle également des écarts. À l'échelle nationale, 120
scanners sont en bon état, et 31 sont mauvais, tandis que 185 imprimantes fonctionnent bien
contre 38 en mauvais état. Cela témoigne de la nécessité d'investir dans des équipements
d'impression, particulièrement dans les régions où ces outils sont souvent essentiels pour les
formations.
En matière de télécommunications, le nombre de postes téléphoniques en bon état (233)
surpasse ceux en mauvais état (43), ce qui suggère que les centres ont des moyens de
communication adéquats. Toutefois, des régions comme Bandiagara et Nioro montrent une
absence totale d’équipements, ce qui souligne un besoin urgent de développement des
infrastructures de communication.
Enfin, l’ensemble des données indique que, bien que certaines régions comme Bamako et
Koutiala bénéficient de bonnes infrastructures de bureau, d'autres régions présentent des
lacunes qui pourraient compromettre la qualité de la formation professionnelle. Ces disparités
soulignent l’importance d’une intervention ciblée pour améliorer l'état des mobiliers de bureau
dans les zones défavorisées, afin d’assurer un environnement de formation adéquat et
d’accroître l’efficacité des centres de formation professionnelle au Mali.
 |
27 27 |
▲back to top |
26
Tableau 12: caractéristiques de l’état des mobiliers de bureau
Région
O
rd
in
a
teu
rs
P
h
o
to
co
p
ieu
rs
S
ca
n
n
ers
Im
p
rim
a
n
tes
P
o
stes
télép
h
o
n
iq
u
es
A
u
tres
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
B
o
n
M
a
u
v
a
is
Kayes 9 0 4 0 2 0 4 8 9 2 0 0
Koulikoro 70 6 22 6 9 2 23 3 98 1 0 0
Sikasso 34 4 9 0 3 0 15 1 1 2 14 1
Ségou 36 5 28 1 27 0 28 0 56 21 0 0
Mopti 14 1 9 1 8 0 9 2 6 0 0 0
Tombouctou 20 0 12 1 12 0 15 1 15 1 0 0
Gao 7 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Nioro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kita 2 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 3
Dioïla 23 6 6 3 4 12 5 2 3 0 0 0
Bougouni 10 6 9 1 8 8 10 0 1 0 10 0
Koutiala 95 6 21 13 14 5 27 13 5 4 37 0
San 12 2 8 1 5 0 7 0 22 5 0 0
Bandiagara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bamako 217 37 32 6 28 3 34 7 16 7 9 4
Ensemble 550 76 165 33 120 31 185 38 233 43 70 8
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
L’analyse des taux de satisfaction par rapport aux principaux équipements lourds utilisés dans
les ateliers de formation professionnelle, d'après les données de l'ONEF pour 2024, met en
lumière des disparités significatives dans l'évaluation des ressources disponibles.
Au total, 6 730 équipements lourds sont recensés à travers les différents ateliers, avec un taux
de satisfaction général de 68,6 %. Ce chiffre suggère une satisfaction modérée vis-à-vis des
équipements, mais il masque des variations importantes d'un atelier à l'autre. Par exemple,
l'atelier d'Electricité photovoltaïque se distingue avec un taux de satisfaction élevé de 95,0 %,
indiquant que les apprenants apprécient fortement les ressources disponibles dans ce domaine.
De même, les ateliers de Carrelage, Filature, Froid et climatisation, et Maintenance des
équipements agricoles affichent des taux de satisfaction de 100 %, témoignant de la qualité et
de l'adéquation de l'équipement dans ces secteurs.
À l'opposé, certains ateliers comme la Cordonnerie, la Maroquinerie, et la Photographie
montrent un taux d’insatisfaction total (0,0 %), ce qui soulève des questions sur la disponibilité
et la qualité des équipements dans ces spécialités. Ces résultats suggèrent que les apprenants
dans ces ateliers pourraient rencontrer des difficultés majeures dans leur formation en raison de
l'insuffisance ou de la mauvaise condition des équipements.
Des ateliers comme Broderie (25,0 %) et Maquillage (40,0 %) montrent également des taux de
satisfaction faibles, soulignant la nécessité d'améliorer les ressources pour répondre aux attentes
des apprenants. En revanche, des secteurs tels que Mécanique auto (76,9 %) et Electricité (72,7
 |
28 28 |
▲back to top |
27
%) montrent une satisfaction relativement bonne, ce qui pourrait refléter des investissements
récents ou une adéquation des équipements avec les besoins de formation.
L'atelier de Construction métallique, avec un nombre élevé d'équipements (572) et un taux de
satisfaction de 68,8 %, indique qu'un effort supplémentaire pourrait être nécessaire pour
maximiser l'utilisation de ces ressources et améliorer l'expérience d'apprentissage.
Bien que certains ateliers affichent une satisfaction élevée, d'autres présentent des défis
importants liés à l'équipement. Il est crucial pour les responsables des centres de formation
professionnelle d'identifier les ateliers sous-performant et d'investir dans des améliorations pour
garantir que tous les apprenants disposent des ressources nécessaires à leur formation. Ces
actions pourraient contribuer à une meilleure satisfaction générale et à une amélioration des
résultats d'apprentissage dans les centres de formation professionnelle au Mali.
Tableau 13: Taux de satisfaction par rapport aux principaux équipements lourds par atelier
Nom de l’atelier Nombre d'équipements lourds Taux de satisfaction
Aviculture 253 77,8
Bogolan 58 20,0
Broderie 33 25,0
Carrelage 6 100,0
Coiffure esthétique 93 65,2
Construction métallique 572 68,8
Cordonnerie 9 0,0
Coupe-couture 2805 64,5
Electricité 147 72,7
Electricité bâtiment 168 76,5
Électricité photovoltaïque 302 95,0
Electronique 84 80,0
Embouche 130 71,4
Engins à deux roues 210 77,3
Filature 52 100,0
Forge 18 80,0
Froid et climatisation 82 100,0
Maçonnerie 54 90,0
Maintenance des équipements agricoles 8 100,0
Maquillage 27 40,0
Maraîchage 114 66,7
Maroquinerie 18 0,0
Mécanique auto 137 76,9
Mécatronique 4 100,0
Menuiserie aluminium 7 100,0
Menuiserie bois 85 73,3
Pâtisserie boulangerie 100 80,0
Photographie 5 0,0
Plomberie sanitaire 244 53,3
Restauration 16 71,4
Savonnerie 11 60,0
Staff-plâtrier 30 100,0
Teinture 204 66,7
Tissage 63 54,5
Tôlerie-peinture 55 100,0
Transformation agroalimentaire 526 65,8
Ensemble 6730 68,6
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
 |
29 29 |
▲back to top |
28
L'analyse des taux de satisfaction concernant les équipements légers utilisés dans les ateliers de
formation professionnelle, révèle des niveaux de satisfaction variés qui reflètent l'état et
l'adéquation des ressources disponibles.
Au total, 17 427 équipements légers ont été recensés à travers les différents ateliers, avec un
taux de satisfaction global de 68,5 %. Cela indique une satisfaction relativement modérée, mais
cache des disparités notables entre les différents secteurs. Par exemple, l'atelier d'Électricité
photovoltaïque affiche un taux de satisfaction optimal de 100 %, suggérant que les apprenants
sont pleinement satisfaits des équipements à leur disposition dans ce domaine. D'autres ateliers
comme Carrelage, Filature, Menuiserie aluminium, Staff-plâtrier, et Tôlerie-peinture également
bénéficient d'un taux de satisfaction de 100 %, témoignant d'une excellente adéquation entre
les ressources disponibles et les besoins de formation.
En revanche, des ateliers tels que la Cordonnerie, Maquillage, Maroquinerie, et Photographie
se distinguent par un taux d’insatisfaction total de 0,0 %, ce qui soulève des préoccupations sur
la disponibilité et la qualité des équipements nécessaires pour une formation efficace dans ces
spécialités. Ces chiffres suggèrent que les apprenants dans ces secteurs peuvent rencontrer des
obstacles significatifs dans leur apprentissage, ce qui pourrait impacter leurs compétences et
leur insertion professionnelle.
D'autres ateliers comme Broderie (28,6 %) et Forge (20,0 %) montrent des niveaux de
satisfaction relativement faibles, mettant en lumière un besoin urgent d'amélioration des
équipements afin d'accroître l'engagement et l'expérience d'apprentissage des apprenants. À
l'inverse, des secteurs tels que Mécanique auto (92,3 %) et Froid et climatisation (92,9 %)
bénéficient d'une satisfaction élevée, ce qui pourrait être attribué à des investissements récents
ou à des équipements bien adaptés aux formations dispensées.
En résumé, bien que certains ateliers présentent une satisfaction élevée grâce à des équipements
adéquats, d'autres font face à des défis importants qui nécessitent une attention particulière.
Pour améliorer l'expérience d'apprentissage et les résultats, il est essentiel que les responsables
des centres de formation professionnelle identifient les secteurs sous-performant et mettent en
œuvre des mesures correctives pour garantir que tous les apprenants disposent des ressources
nécessaires. Cela pourrait non seulement augmenter la satisfaction générale, mais également
contribuer à une meilleure qualité de la formation professionnelle au Mali.
 |
30 30 |
▲back to top |
29
Tableau 14: Taux de satisfaction par rapport aux principaux équipements légers par atelier
Nom de l’atelier Nombre d'équipements légers Taux de satisfaction
Aviculture 518 56,7
Bogolan 136 80,0
Broderie 46 28,6
Carrelage 18 100,0
Coiffure esthétique 197 63,0
Construction métallique 2021 64,0
Cordonnerie 33 0,0
Coupe-couture 6140 72,5
Electricité 371 60,5
Electricité bâtiment 309 72,2
Électricité photovoltaïque 1407 100,0
Electronique 123 58,3
Embouche 998 73,1
Engins à deux roues 433 69,6
Filature 63 100,0
Forge 22 20,0
Froid et climatisation 372 92,9
Maçonnerie 89 90,0
Maintenance des équipements agricoles 19 60,0
Maquillage 99 0,0
Maraîchage 785 55,6
Maroquinerie 14 0,0
Mécanique auto 399 92,3
Mécatronique 66 80,0
Menuiserie aluminium 61 100,0
Menuiserie bois 268 93,8
Pâtisserie boulangerie 117 60,0
Photographie 12 0,0
Plomberie sanitaire 652 56,3
Restauration 37 64,3
Savonnerie 27 60,0
Staff-plâtrier 6 100,0
Teinture 358 73,3
Tissage 513 54,5
Tôlerie-peinture 88 100,0
Transformation agroalimentaire 610 66,7
Ensemble 17427 68,5
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.3.2. Taux de qualification des formateurs
Il est proposé ici une analyse du niveau de qualification du personnel formateur en fonction du
sexe et du statut du formateur dans les centres de formation professionnelle (CFP) en 2023.
Pour rappel, le niveau minimum exigé pour former dans les CFP au Mali est le CAP. Au total,
le nombre de formateurs s’élève à 758 (566 hommes et 192 femmes) en 2023, contre 521 en
2022. Cette augmentation peut s'expliquer par l'ouverture de nouveaux centres de formation
professionnelle.
Les hommes dominent largement en termes de nombre de formateurs dans presque toutes les
catégories, tandis que la représentation féminine est plus marquée dans les diplômes de niveau
inférieur, comme le CAP, le BT, ainsi que d'autres diplômes. Les femmes représentent
seulement 25 % du total des formateurs, soulignant ainsi leur sous-représentation, notamment
dans les métiers de la formation technique, où les hommes sont plus nombreux.
 |
31 31 |
▲back to top |
30
Le Brevet Technique (BT) est de loin le diplôme le plus courant parmi les formateurs, tant pour
les femmes que pour les hommes, suivi par les diplômes de niveau Bac+2 (DUT/BTS) et les
diplômes de niveau Licence. Les diplômes plus élevés, comme la Maîtrise ou le Master, se
retrouvent en proportion marginale, ce qui pourrait indiquer une spécialisation orientée
davantage vers la formation pratique que vers la formation académique.
Concernant les diplômes de niveau inférieur (comme le CAP et le BT), on observe une
proportion plus élevée de femmes par rapport aux niveaux supérieurs. En revanche, dans les
catégories plus élevées (Licence, Bac+3 et au-delà), les hommes dominent davantage. Les
formateurs titulaires de diplômes supérieurs (Bac+3, Bac+4, Master) restent largement
masculins, malgré une présence féminine modeste.
Tableau 15: Répartition des formateurs selon le diplôme et le sexe
Diplôme
Femme Homme Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif %
Autres 52 27,1 109 19,3 161 21,2
BAC 11 5,7 12 2,1 23 3
BT 42 21,9 161 28,4 203 26,8
CAP 28 14,6 45 8,0 73 9,6
DUG/DUT/BTS/Bac+2 19 9,9 92 16,3 111 14,6
Licence/BAC+3 23 12 82 14,5 105 13,9
Maîtrise/Bac+4 9 4,7 33 5,8 42 5,5
Master/DEA/DESS 8 4,2 32 5,7 40 5,3
Ensemble 192 25 566 75 758 100
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Les données présentées dans le tableau ci-dessous montrent la répartition des formateurs en
fonction de leur diplôme et de leur statut dans l'emploi. Cette analyse révèle des tendances
significatives dans la composition des formateurs et leur diversité de statut.
Tout d'abord, il est notable que la majorité des formateurs sont contractuels, représentant 52,5
% de l'ensemble, suivis par les vacataires (32,3 %) et les fonctionnaires (15,2 %). Cela suggère
un recours important à des contractuels et des vacataires, ce qui pourrait indiquer des besoins
de flexibilité et d'adaptabilité dans la gestion des ressources humaines au sein des centres de
formation.
En examinant la répartition par niveau de diplôme, on constate que les formateurs titulaires d'un
BT (Brevet de Technicien) sont les plus nombreux, avec un total de 203 formateurs, dont 61,6
% ont un statut contractuel. À l'autre extrême, ceux ayant seulement un BAC sont moins
nombreux, mais il est intéressant de noter que la majorité de ces formateurs (56,5 %) viennent
du statut de vacataire. Cela pourrait refléter une tendance à engager des vacataires pour des
postes qui sont moins sécurisés, ou encore une flexibilité recherchée dans les formations de
niveau Bac.
Les diplômés de niveau supérieur (maîtrise, master) affichent une répartition plus équilibrée
entre les statuts, bien que la proportion de fonctionnaires soit relativement faible. Par exemple,
pour les titulaires d'une maîtrise, 33,3 % sont contractuels, mais une proportion significative
(26,2 %) est également fonctionnaire. Cela pourrait indiquer que les diplômes de niveau avancé
attirent davantage des professionnels qui recherchent la sécurité de l'emploi dans la fonction
publique.
 |
32 32 |
▲back to top |
31
En somme, l'analyse de ce tableau démontre une diversité de statuts parmi les formateurs,
influencée par leur niveau de diplôme. La prévalence des formateurs contractuels et vacataires,
associés à des qualifications variées, souligne la dynamique actuelle des ressources humaines
dans les centres de formation professionnelle, qui jonglent entre la performance pédagogique
et les besoins d'adaptation à un marché de l'emploi en constante évolution.
Tableau 16: répartition des formateurs selon le diplôme et le statut dans l’emploi
Diplôme Contractuel Fonctionnaire Vacataire Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Autres 85 21,4 9 7,8 67 27,3 161 21,2
BAC 10 2,5 0 0 13 5,3 23 3
BT 125 31,4 31 27 47 19,2 203 26,8
CAP 26 6,5 14 12,2 33 13,5 73 9,6
DUG/DUT/BTS/Bac+2 61 15,3 24 20,9 26 10,6 111 14,6
Licence/BAC+3 63 15,8 13 11,3 29 11,8 105 13,9
Maîtrise/Bac+4 14 3,5 11 9,6 17 6,9 42 5,5
Master/DEA/DESS 14 3,5 13 11,3 13 5,3 40 5,3
Ensemble 398 53 115 15 245 32 758 100
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.3.3. Satisfaction par rapport aux locaux
L'analyse des taux de satisfaction concernant les salles de classe et autres locaux spécialisés
dans les centres de formation professionnelle au Mali, montre des tendances contrastées et met
en lumière des domaines nécessitant des améliorations.
En 2023, le taux de satisfaction global concernant les salles de classe et autres locaux spécialisés
s'établit à 40,8 %, marquant une légère diminution par rapport à 42,9 % en 2022. Cette tendance
suggère une certaine constance dans l'évaluation des infrastructures, bien que des variations
significatives aient été observées dans plusieurs domaines spécifiques.
Pour les salles de classe, le taux de satisfaction est passé de 87,8 % en 2022 à 73,1 % en 2023,
marquant une baisse significative qui pourrait signaler une détérioration de la qualité des
espaces d'apprentissage ou une augmentation des attentes des apprenants. De même, les ateliers
affichent une baisse de satisfaction, passant de 81,4 % à 64,7 % dans la même période,
suggérant un besoin d'amélioration continue pour répondre aux exigences des formations
dispensées.
Les salles informatiques continuent de présenter un taux de satisfaction faible, avec 30,6 % en
2023, bien que cela représente une légère amélioration par rapport aux 24,5 % enregistrés en
2022. En revanche, les salles de formateur affichent une légère amélioration de 60,1 % à 59,0
%, indiquant que, bien qu'il y ait une perception positive, cette catégorie reste en-dessous des
attentes.
Les résultats concernant les laboratoires, les dortoirs, et les réfectoires révèlent une tendance
préoccupante, avec des taux de satisfaction très bas. En 2023, les laboratoires ont un taux de
satisfaction de 19,4 %, en augmentation par rapport à 11,7 % en 2022, mais toujours largement
insuffisant. Les dortoirs et réfectoires montrent également de faibles taux de satisfaction, avec
respectivement 14,1 % et 15,2 %, indiquant des conditions de vie et de repas qui ne répondent
pas aux besoins des apprenants.
 |
33 33 |
▲back to top |
32
Enfin, les bibliothèques et infirmeries continuent de montrer des niveaux de satisfaction
insatisfaisants, avec 19,7 % et 25,2 % respectivement en 2023, mais une légère amélioration
par rapport aux années précédentes. Cela suggère que, bien que des efforts puissent avoir été
faits pour améliorer ces espaces, ils nécessitent encore des investissements significatifs pour
atteindre des normes satisfaisantes.
Bien que certaines catégories, comme les salles de classe, aient connu une baisse de satisfaction,
d'autres, comme les laboratoires, ont montré des signes d'amélioration. Toutefois, les taux de
satisfaction globalement bas, notamment pour les dortoirs et les réfectoires, soulignent
l'importance d'initiatives ciblées pour améliorer les conditions d'apprentissage et de vie des
apprenants dans les centres de formation professionnelle.
Tableau 17: Taux de satisfaction par rapport aux salles de classes et autres locaux spécialisés (%)
Salle de classe et autres locaux spécialisés Nombre total
Taux de
satisfaction
Taux global de satisfaction
Salles de classes 759 73,1
40,8
Salles de formateur 160 59,0
Salles informatiques 48 30,6
Ateliers 378 64,7
Bureaux (local) 350 59,6
Laboratoire 24 19,4
Dortoir 33 14,1
Réfectoire 14 15,2
Bibliothèque 20 19,7
Infirmerie 71 25,2
Autres 45 68,2
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Le tableau ci-dessous présente la répartition des ateliers de formation professionnelle, où un
total de 200 ateliers est recensé. Parmi ceux-ci, le coupe-couture se distingue avec une part
significative de 33,0 %, indiquant son importance dans le paysage de la formation. Les ateliers
de construction métallique suivent, représentant 12,0 %, ce qui souligne également leur rôle
essentiel.
D'autres domaines comme l'aviculture et la coiffure esthétique comptent respectivement 3,5 %
et 3,0 % des ateliers, reflétant une diversité d'options de formation. Cependant, plusieurs
ateliers, tels que le bogolan, la cordonnerie, et le maquillage, n'ont qu'une seule installation,
montrant ainsi un intérêt plus limité pour ces spécialités.
En somme, la répartition des ateliers révèle une concentration significative autour de certains
domaines clés, tandis que d'autres sont moins représentés, ce qui peut indiquer des opportunités
à explorer pour élargir l'offre de formation professionnelle.
 |
34 34 |
▲back to top |
33
Tableau 18: Répartition des ateliers
Nom de l'atelier Nombre %
Aviculture 7 3,5
Bogolan 1 0,5
Broderie 2 1,0
Carrelage 1 0,5
Coiffure esthétique 6 3,0
Construction métallique 24 12,0
Cordonnerie 1 0,5
Coupe-couture 66 33,0
Electricité 8 4,0
Electricité bâtiment 4 2,0
Électricité photovoltaïque 4 2,0
Electronique 3 1,5
Embouche 6 3,0
Engins à deux roues 5 2,5
Filature 1 0,5
Forge 1 0,5
Froid et climatisation 3 1,5
Maçonnerie 2 1,0
Maintenance des équipements agricoles 1 0,5
Maquillage 1 0,5
Maraîchage 4 2,0
Maroquinerie 1 0,5
Mécanique auto 3 1,5
Mécatronique 1 0,5
Menuiserie aluminium 1 0,5
Menuiserie bois 4 2,0
Pâtisserie boulangerie 2 1,0
Photographie 1 0,5
Plomberie sanitaire 4 2,0
Restauration 3 1,5
Savonnerie 1 0,5
Staff-plâtrier 1 0,5
Teinture 6 3,0
Tissage 3 1,5
Tôlerie-peinture 1 0,5
Transformation agroalimentaire 17 8,5
Ensemble 200 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des postes de travail au sein des différents ateliers de
formation professionnelle, totalisant 2 926 postes, dont 2 695 sont fonctionnels, représentant une
utilisation efficace des ressources.
Les ateliers comme la coupe-couture se démarquent avec un nombre exceptionnel de 1 611 postes, bien
que 150 d'entre eux ne soient pas fonctionnels. Cela souligne une possible surcapacité ou des besoins en
maintenance. En revanche, des ateliers tels que le bogolan et la cordonnerie affichent une performance
optimale, avec 27 et 2 postes respectivement, tous opérationnels, ce qui reflète une efficacité totale.
D'autres ateliers, tels que la construction métallique, présentent également une proportion significative
de postes non fonctionnels (17 sur 208), ce qui pourrait nécessiter une attention particulière pour
améliorer l'utilisation des ressources.
La plomberie sanitaire et la teinture montrent des défis similaires avec des postes non fonctionnels
représentant 15,7 % et 23,3 % de leurs effectifs respectifs. Cette analyse met en lumière l'importance
d'évaluer et d'améliorer la fonctionnalité des postes de travail dans certains ateliers afin de maximiser
l'efficacité et d'assurer une meilleure préparation des apprenants aux exigences du marché.
 |
35 35 |
▲back to top |
34
Tableau 19: Répartition des postes de travail des ateliers
Nom de l'atelier Nombre de
poste de travail
Nombre de poste de
travail fonctionnel
Nombre de poste de
travail non fonctionnel
Aviculture 76 73 3
Bogolan 27 27 0
Broderie 9 8 1
Carrelage 16 16 0
Coiffure esthétique 80 74 6
Construction métallique 208 191 17
Cordonnerie 2 2 0
Coupe-couture 1611 1461 150
Electricité 99 99 0
Electricité bâtiment 60 57 3
Électricité photovoltaïque 38 33 5
Electronique 31 27 4
Embouche 36 34 2
Engins à deux roues 42 38 4
Filature 10 10 0
Forge 1 1 0
Froid et climatisation 31 31 0
Maçonnerie 23 23 0
Maintenance des équipements agricoles 6 6 0
Maquillage 10 10 0
Maraîchage 54 54 0
Maroquinerie 2 2 0
Mécanique auto 30 30 0
Mécatronique 4 4 0
Menuiserie aluminium 5 5 0
Menuiserie bois 18 14 4
Pâtisserie boulangerie 8 8 0
Photographie 4 4 0
Plomberie sanitaire 51 43 8
Restauration 10 10 0
Savonnerie 20 18 2
Staff-plâtrier 5 5 0
Teinture 60 46 14
Tissage 13 13 0
Tôlerie-peinture 2 2 0
Transformation agroalimentaire 230 210 20
Ensemble 2926 2695 231
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des installations des ateliers de formation
professionnelle, mettant en lumière la disponibilité d'eau, d'électricité, de circuits de gaz, d'air
comprimé, ainsi que les mesures de sécurité incendie. En général, 90,5 % des ateliers disposent
d'une connexion à l'eau, tandis que 94 % sont alimentés en électricité, ce qui témoigne d'un bon
niveau d'équipement pour les activités de formation.
Cependant, des disparités notables existent selon les ateliers. Par exemple, l'atelier de
maçonnerie affiche un faible taux d'alimentation en électricité (50 %), tandis que l'atelier de
mécanique auto présente une couverture totale pour l'eau et l'électricité, mais montre une
nécessité d'amélioration pour les circuits de gaz (66,7 %).
L'atelier de menuiserie aluminium est exemplaire avec 100 % d'installations fonctionnelles dans
toutes les catégories, illustrant un standard élevé. En revanche, certains ateliers comme la
maintenance des équipements agricoles ne disposent pas d'eau, ce qui pourrait entraver la
qualité de la formation et la sécurité des apprenants.
Les installations de sécurité incendie varient également, avec 58 % des ateliers ayant des
mesures en place. Les ateliers de carrelage, menuiserie et forge présentent des installations de
 |
36 36 |
▲back to top |
35
sécurité incendie efficaces, tandis que d'autres, comme l'atelier de maraîchage, montrent des
lacunes significatives.
Bien que la majorité des ateliers soient bien équipés, l'analyse révèle des disparités qui
pourraient affecter la qualité de l'enseignement et la sécurité, nécessitant des efforts ciblés pour
améliorer les installations des ateliers moins bien dotés.
Tableau 20: caractéristiques des installations des ateliers (%)
Nom de l'atelier Eau Electricité
Circuit
de gaz
Air
comprimé
Arrêt
d'urgence
Sécurité
incendie
Aviculture 100,0 71,4 14,3 0,0 14,3 42,9
Bogolan 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Broderie 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0
Carrelage 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Coiffure esthétique 83,3 100,0 16,7 50,0 33,3 50,0
Construction métallique 95,8 100,0 37,5 25,0 41,7 87,5
Cordonnerie 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coupe-couture 84,8 97,0 10,6 31,8 18,2 45,5
Electricité 87,5 100,0 0,0 12,5 25,0 50,0
Electricité bâtiment 50,0 100,0 0,0 0,0 25,0 100,0
Électricité photovoltaïque 75,0 100,0 50,0 25,0 75,0 100,0
Electronique 100,0 100,0 0,0 33,3 33,3 100,0
Embouche 100,0 66,7 0,0 0,0 16,7 50,0
Engins à deux roues 100,0 80,0 60,0 40,0 40,0 80,0
Filature 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forge 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Froid et climatisation 66,7 100,0 33,3 66,7 66,7 100,0
Maçonnerie 100,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Maintenance des équipements
agricoles
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maquillage 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maraîchage 100,0 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0
Maroquinerie 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mécanique auto 100,0 100,0 66,7 33,3 66,7 66,7
Mécatronique 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Menuiserie aluminium 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Menuiserie bois 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 75,0
Pâtisserie boulangerie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Photographie 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Plomberie sanitaire 100,0 100,0 25,0 0,0 25,0 75,0
Restauration 100,0 66,7 100,0 33,3 33,3 33,3
Savonnerie 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Staff-plâtrier 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Teinture 100,0 83,3 0,0 0,0 0,0 16,7
Tissage 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 33,3
Tôlerie-peinture 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Transformation agroalimentaire 100,0 100,0 41,2 23,5 23,5 64,7
Ensemble 90,5 94,0 22,0 26,5 28,5 58,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Le tableau ci-dessous présente l'état de l'éclairage, de l'aération et de la sécurité des différents
ateliers de formation, fournissant un aperçu des conditions d'apprentissage. En général, 100 %
des ateliers bénéficient d'un bon éclairage, ce qui est essentiel pour garantir un environnement
de travail efficace et sécuritaire.
 |
37 37 |
▲back to top |
36
Cependant, la situation de l'aération varie considérablement : la majorité des ateliers, tels que
l'aviculture, la coiffure esthétique et le maraîchage, affichent un bon éclairage mais ne disposent
pas d'aération naturelle, ce qui pourrait nuire à la qualité de l'air et à la santé des apprenants. En
revanche, l'atelier de mécanique auto est un cas particulier, affichant un éclairage complètement
insuffisant (0 %) mais une bonne aération, ce qui montre qu'il est essentiel d'améliorer
l'éclairage pour une meilleure sécurité.
La sécurité des ateliers est généralement bien notée, avec 100 % de satisfaction pour des ateliers
comme la broderie, l'embouche et la mécanique auto. Cependant, l'atelier de savonnerie révèle
des lacunes avec un bon éclairage mais une sécurité compromise, indiquant qu'une attention
particulière doit être accordée aux mesures de sécurité incendie dans certains cas.
En résumé, bien que les ateliers bénéficient majoritairement d'un bon éclairage et de conditions
de sécurité satisfaisantes, des efforts sont nécessaires pour améliorer l'aération dans plusieurs
ateliers, ainsi que pour traiter les problèmes spécifiques de sécurité afin de garantir un
environnement d'apprentissage optimal pour tous les apprenants.
Tableau 21: Etat de l’éclairage, de l’aération et de la sécurité des ateliers (%)
Nom de l'atelier Éclairage Aération Sécurité
Aviculture Bon Mauvais Naturelle Conditionnée Bon Mauvais
Bogolan 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Broderie 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Carrelage 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Coiffure esthétique 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Construction métallique 100,0 0,0 83,3 16,7 83,3 16,7
Cordonnerie 95,8 4,2 66,7 33,3 95,8 4,2
Coupe-couture 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Electricité 98,5 1,5 72,7 27,3 95,5 4,5
Electricité bâtiment 100,0 0,0 100,0 0,0 87,5 12,5
Électricité photovoltaïque 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Electronique 100,0 0,0 75,0 25,0 75,0 25,0
Embouche 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Engins à deux roues 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Filature 100,0 0,0 80,0 20,0 80,0 20,0
Forge 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Froid et climatisation 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Maçonnerie 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Maintenance des équipements agricoles 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Maquillage 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Maraîchage 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Maroquinerie 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Mécanique auto 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Mécatronique 100,0 0,0 66,7 33,3 100,0 0,0
Menuiserie aluminium 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Menuiserie bois 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Pâtisserie boulangerie 100,0 0,0 50,0 50,0 100,0 0,0
Photographie 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Plomberie sanitaire 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Restauration 100,0 0,0 75,0 25,0 100,0 0,0
Savonnerie 66,7 33,3 100,0 0,0 66,7 33,3
Staff-plâtrier 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Teinture 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Tissage 100,0 0,0 100,0 0,0 66,7 33,3
Tôlerie-peinture 66,7 33,3 100,0 0,0 100,0 0,0
Transformation agroalimentaire 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Ensemble 100,0 0,0 76,5 23,5 100,0 0,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
 |
38 38 |
▲back to top |
37
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des murs des différents ateliers, en mettant
l'accent sur la nature et l'état de ces murs. En général, la majorité des ateliers, comme ceux de
broderie, carrelage, et maçonnerie, affichent des murs en dur et dans un état satisfaisant, ce qui
contribue à la sécurité et au confort des apprenants. En effet, 100 % des ateliers notés montrent
des murs en bon état, garantissant ainsi des conditions de travail optimales.
Cependant, certaines exceptions se démarquent. Par exemple, l'atelier de maraîchage et de
maroquinerie présentent des murs partiellement en banco (25 % pour la maroquinerie), mais ils
sont tous en bon état, indiquant une bonne gestion des infrastructures. À l'inverse, l'atelier de
savonnerie présente un état des murs plus préoccupant, avec 33,3 % de ses murs en mauvais
état, ce qui pourrait affecter la sécurité et le confort des utilisateurs.
Dans l'ensemble, il est encourageant de noter que la plupart des ateliers sont bien construits et
maintenus. Cependant, les différences dans l'état des murs, surtout dans certains ateliers comme
la savonnerie, soulignent la nécessité de surveiller et d'améliorer régulièrement les
infrastructures pour maintenir un environnement d'apprentissage sûr et efficace. Cela pourrait
également contribuer à renforcer la réputation des centres de formation et à attirer davantage
d'apprenants en offrant des installations de qualité.
Tableau 22: caractéristiques des murs des ateliers (%)
Nom de l'atelier Nature des murs État des murs
Aviculture En dur Semi-dur Banco Tôle Bon Mauvais
Bogolan 85,7 0,0 14,3 0,0 100,0 0,0
Broderie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Carrelage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Coiffure esthétique 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Construction métallique 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Cordonnerie 95,8 0,0 0,0 4,2 100,0 0,0
Coupe-couture 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Electricité 95,5 3,0 1,5 0,0 100,0 0,0
Electricité bâtiment 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Électricité photovoltaïque 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Electronique 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Embouche 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Engins à deux roues 66,7 0,0 0,0 33,3 100,0 0,0
Filature 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Forge 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Froid et climatisation 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maçonnerie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maintenance des équipements agricoles 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maquillage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maraîchage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maroquinerie 75,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0
Mécanique auto 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Mécatronique 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Menuiserie aluminium 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Menuiserie bois 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Pâtisserie boulangerie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Photographie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Plomberie sanitaire 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Restauration 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Savonnerie 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3
Staff-plâtrier 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Teinture 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Tissage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Tôlerie-peinture 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Transformation agroalimentaire 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Ensemble 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
 |
39 39 |
▲back to top |
38
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des sols des ateliers, en mettant en lumière
les types de revêtements et leur état. De manière générale, la majorité des ateliers montrent un
engagement fort envers des sols en bon état, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité et
l'efficacité des apprenants.
La plupart des ateliers, comme la broderie, la coiffure esthétique, et la maçonnerie, affichent
100 % de leurs sols en bon état, ce qui reflète une infrastructure bien entretenue. Cela favorise
un environnement de travail propre et sécuritaire, essentiel pour les activités pratiques menées
dans ces domaines.
Cependant, certains ateliers présentent des variabilités intéressantes. Par exemple, l'atelier de
cordonnerie affiche un revêtement varié avec 75 % en béton et 16,7 % en terre battue, mais se
maintient avec un bon état à 91,7 %. En revanche, l'atelier de savonnerie montre un état
préoccupant, avec 33,3 % de ses sols en mauvais état, soulignant un besoin d'amélioration pour
garantir un espace de travail adéquat.
Les ateliers de menuiserie aluminium et de staff-plâtrier se distinguent par des revêtements de
sol non conventionnels, respectivement 100 % en carrelage et 100 % en terre battue, tout en
maintenant un état satisfaisant de 100 % pour le carrelage. Cela démontre la diversité des
pratiques de construction et d'entretien parmi les ateliers.
Bien que la plupart des ateliers présentent des sols en bon état, les variations observées,
notamment dans les ateliers de cordonnerie et de savonnerie, soulignent l'importance d'un suivi
régulier et de rénovations ciblées pour maintenir un environnement de formation efficace et
sécurisé. L'analyse des revêtements de sol et de leur état peut ainsi offrir des pistes pour
l'amélioration continue des infrastructures de formation.
 |
40 40 |
▲back to top |
39
Tableau 23: caractéristiques des sols des ateliers (%)
Nom de l'atelier Revêtement du sol État du sol
Aviculture Béton Terre battue Carrelage Autre Bon Mauvais
Bogolan 85,7 0,0 0,0 14,3 100,0 0,0
Broderie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Carrelage 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
Coiffure esthétique 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Construction métallique 33,3 0,0 66,7 0,0 100,0 0,0
Cordonnerie 75,0 16,7 8,3 0,0 91,7 8,3
Coupe-couture 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Electricité 74,2 6,1 18,2 1,5 100,0 0,0
Electricité bâtiment 100,0 0,0 0,0 0,0 87,5 12,5
Électricité photovoltaïque 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Electronique 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Embouche 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Engins à deux roues 50,0 16,7 0,0 33,3 100,0 0,0
Filature 60,0 40,0 0,0 0,0 80,0 20,0
Forge 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Froid et climatisation 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maçonnerie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maintenance des équipements agricoles 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maquillage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maraîchage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maroquinerie 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Mécanique auto 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Mécatronique 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0
Menuiserie aluminium 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Menuiserie bois 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Pâtisserie boulangerie 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Photographie 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Plomberie sanitaire 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Restauration 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Savonnerie 66,7 0,0 33,3 0,0 66,7 33,3
Staff-plâtrier 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Teinture 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Tissage 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Tôlerie-peinture 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Transformation agroalimentaire 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Ensemble 82,4 5,9 11,8 0,0 100,0 0,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Le tableau ci-dessous illustre les sources de financement des ateliers, mettant en lumière les
diverses contributions financières qui soutiennent leur fonctionnement. L'analyse de ces
données révèle des tendances intéressantes quant à la dépendance financière des ateliers et la
diversité des sources de financement.
La plupart des ateliers, comme ceux de bogolan, carrelage, cordonnerie, et savonnerie,
dépendent principalement du financement privé, avec des proportions atteignant 100 %. Cela
indique une tendance vers l'autonomisation financière de ces ateliers, soulignant l'importance
d'une gestion efficace des ressources pour leur pérennité.
D'autres ateliers, comme ceux de maçonnerie et de teinture, présentent des sources de
financement variées. Par exemple, la maçonnerie dépend à 50 % de l'aide extérieure et à 50 %
du financement privé, tandis que la teinture bénéficie de 16,7 % de financement communautaire
et de 83,3 % provenant du secteur privé. Cela suggère que ces ateliers adoptent une approche
plus intégrée en cherchant à diversifier leurs sources de financement.
 |
41 41 |
▲back to top |
40
En revanche, des ateliers comme électricité bâtiment et mécatronique montrent une dépendance
plus marquée à l'égard des financements privés, avec 75 % pour chacun d'eux. Cette dépendance
pourrait poser des défis si le soutien privé venait à diminuer.
Un point notable est que certains ateliers, comme ceux de photographie et de menuiserie
aluminium, montrent une approche multi-facette en combinant des financements provenant de
la communauté et du privé, illustrant la collaboration entre différents acteurs pour garantir un
soutien financier durable.
Bien que la majorité des ateliers s'appuient principalement sur des financements privés,
l'analyse des diverses sources de financement révèle une opportunité pour les ateliers de
diversifier leurs soutiens financiers afin d'assurer une plus grande résilience économique. Il
serait judicieux de renforcer les collaborations avec les communautés et de rechercher des aides
extérieures pour réduire la dépendance vis-à-vis du secteur privé et garantir un soutien financier
plus équilibré et durable.
Tableau 24: Sources de financement des ateliers (%)
Nom de l'atelier État Communauté Aide extérieure Privé Autres
Aviculture 14,3 0,0 0,0 85,7 0,0
Bogolan 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Broderie 50,0 0,0 50,0 100,0 0,0
Carrelage 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Coiffure esthétique 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7
Construction métallique 20,8 29,2 16,7 58,3 12,5
Cordonnerie 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Coupe-couture 13,6 21,2 4,5 75,8 12,1
Electricité 12,5 0,0 0,0 75,0 12,5
Electricité bâtiment 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0
Électricité photovoltaïque 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0
Electronique 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0
Embouche 16,7 0,0 0,0 100,0 0,0
Engins à deux roues 20,0 40,0 0,0 80,0 0,0
Filature 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Forge 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Froid et climatisation 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0
Maçonnerie 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Maintenance des équipements
agricoles
0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maquillage 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Maraîchage 25,0 50,0 0,0 75,0 0,0
Maroquinerie 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Mécanique auto 33,3 33,3 0,0 66,7 0,0
Mécatronique 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Menuiserie aluminium 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Menuiserie bois 0,0 50,0 25,0 75,0 0,0
Pâtisserie boulangerie 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Photographie 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Plomberie sanitaire 25,0 0,0 25,0 75,0 25,0
Restauration 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0
Savonnerie 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Staff-plâtrier 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Teinture 16,7 16,7 0,0 83,3 0,0
Tissage 33,3 0,0 33,3 100,0 33,3
Tôlerie-peinture 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Transformation agroalimentaire 23,5 23,5 11,8 76,5 11,8
Ensemble 16,0 18,5 8,5 76,5 9,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
 |
42 42 |
▲back to top |
41
L'analyse de l'utilisation hebdomadaire de l'atelier montre une variation significative entre les
différentes disciplines. Par exemple, des secteurs comme la filature et la forge affichent une
utilisation de 30 heures, indiquant une forte demande et vitalité dans ces domaines. En
revanche, des activités comme la cordonnerie et la tôlerie-peinture ne sont utilisées que pour 4
et 3 heures respectivement, ce qui pourrait révéler un manque d'intérêt ou de ressources dans
ces spécialités.
De plus, des domaines tels que l'électricité bâtiment (25 heures) et la pâtisserie boulangerie (22
heures) montrent une utilisation soutenue, reflétant probablement un intérêt croissant pour des
compétences pratiques dans le secteur de la construction et de l'alimentation. Notons également
que certaines activités, telles que la maçonnerie (5 heures) et la mécatronique (5 heures), sont
moins sollicitées, ce qui pourrait inciter à reconsidérer la promotion de ces compétences au sein
des formations proposées.
Par ailleurs, un chiffre révélateur des heures hebdomadaires est la moyenne de 18 heures, qui
sert de référence pour comprendre l'engagement dans chacune des disciplines. Les activités qui
se rapprochent de cette moyenne, comme la broderie (6 heures) ou la teinture (13 heures),
pourraient bénéficier d'une évaluation des motifs qui poussent à cette utilisation modeste, afin
de concevoir des stratégies pour stimuler l'intérêt et l'engagement des participants.
Enfin, il est également intéressant de noter que, malgré certaines activités à faible utilisation,
d'autres, comme la coiffure esthétique (16 heures) et la mécanique auto (14 heures), montrent
une utilisation modérée, soulignant un potentiel d'amélioration à explorer par des initiatives de
formation adaptées qui répondent aux besoins et intérêts des apprentis. En somme, cette analyse
suggère non seulement les domaines d'excellence, mais aussi les secteurs nécessitant une
attention particulière pour maximiser l'utilisation et la valeur de l’atelier.
 |
43 43 |
▲back to top |
42
Tableau 25: Utilisation hebdomadaire de l'atelier par heure
Nom de l’atelier
Utilisation hebdomadaire
de l'atelier (heures)
Aviculture 20
Bogolan 18
Broderie 6
Carrelage et maçonnerie 5
Coiffure esthétique 16
Construction métallique 21
Cordonnerie 4
Coupe-couture 18
Electricité 21
Electricité bâtiment 25
Électricité photovoltaïque 16
Electronique 16
Embouche 21
Engins à deux roues 18
Filature 30
Forge 30
Froid et climatisation 7
Maçonnerie 5
Maintenance des équipements agricoles 15
Maquillage 30
Maraîchage 20
Maroquinerie 4
Mécanique auto 14
Mécatronique 5
Menuiserie aluminium 6
Menuiserie bois 10
Pâtisserie boulangerie 22
Photographie 20
Plomberie sanitaire 20
Restauration 12
Savonnerie 20
Staff-plâtrier 5
Teinture 13
Tissage 23
Tôlerie-peinture 3
Transformation agroalimentaire 19
Moyenne 18
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.3.4. Partenaires des centres de formation professionnelle
La moyenne globale du nombre de partenaires professionnels dans toutes les régions est de 4.
Certaines régions affichent un nombre moyen de partenaires supérieur à cette moyenne
nationale, notamment Sikasso (6 partenaires), Mopti et Bandiagara (5 partenaires) ainsi que
Bamako (5 partenaires). Ces régions pourraient bénéficier d'un réseau professionnel plus dense,
favorisant les opportunités de collaboration et le développement dans le secteur professionnel.
En revanche, des régions comme Kita (1 partenaire), ainsi que Kayes, Koulikoro, Ségou et San
(2 partenaires en moyenne), ont un réseau de partenaires plus restreint. Cela pourrait révéler un
besoin de renforcer les liens professionnels dans ces zones afin d’améliorer les perspectives
d'insertion et de développement professionnel.
Ces données mettent en évidence une disparité régionale dans le nombre de partenaires
professionnels. Des initiatives de mise en réseau et d’échange pourraient être envisagées pour
les régions ayant un nombre de partenaires inférieur à la moyenne. Par ailleurs, les régions au
 |
44 44 |
▲back to top |
43
réseau plus développé, comme Bamako et Sikasso, pourraient servir de modèles ou de points
de départ pour des actions de renforcement des réseaux dans les autres régions.
Figure 4: Nombre moyen de partenaires par région pour un centre de formation professionnelle (CFP)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Les données montrent que le nombre moyen de partenaires professionnels est identique pour
les organismes de formation publics et privés, avec une moyenne de 4 partenaires dans les deux
cas.
Cette égalité entre les établissements publics et privés suggère qu’il n’y a pas de différence
significative dans l’accès aux partenariats professionnels selon le statut de l'organisme de
formation. Ainsi, la capacité à établir des liens avec des partenaires dans le milieu professionnel
ne semble pas être influencée par le caractère public ou privé de l'institution.
Cependant, bien que la moyenne soit similaire, il pourrait être pertinent d'examiner plus en
détail la nature de ces partenariats. Par exemple, les organismes publics et privés pourraient
avoir des types de partenariats différents (secteurs d'activité, entreprises locales ou
internationales, etc.), ce qui pourrait influencer les opportunités d'insertion professionnelle pour
les apprenants.
2
2
6
2
5
3
3
3
1
4
2
4
2
5
5
4
0 1 2 3 4 5 6 7
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Nioro
Kita
Dioïla
Bougouni
Koutiala
San
Bandiagara
Bamako
Ensemble
 |
45 45 |
▲back to top |
44
Bien que le statut de l'organisme n'affecte pas le nombre moyen de partenaires, une analyse plus
qualitative des partenariats pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur la valeur ajoutée
de ces réseaux dans le milieu professionnel.
Figure 5: Nombre moyen de partenaires par type de centre de formation professionnelle (CFP)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.3.5. Cellule d'insertion professionnelle
Au niveau national, la proportion de centres disposant d'une cellule d'insertion professionnelle est de
49,2%. Ce chiffre global indique qu'environ la moitié des centres, tous types confondus, sont
dotés d’une cellule d’insertion, laissant ainsi une marge importante pour l'amélioration de
l’accompagnement à l’insertion professionnelle dans les centres qui en sont dépourvus.
Les centres publics sont largement équipés en cellules d’insertion, avec une proportion de
92,3%. Cela indique que presque tous les centres publics ont mis en place une structure dédiée
à l’accompagnement des apprenants dans leur insertion professionnelle. Cette forte présence de
cellules d'insertion dans les centres publics peut être le reflet d’une politique visant à renforcer
le soutien aux jeunes en fin de formation et à faciliter leur transition vers le marché du travail.
À l'inverse, les centres privés présentent un taux bien inférieur, avec seulement 46,1% d'entre
eux dotés d'une cellule d’insertion professionnelle. Cette disparité peut suggérer que les centres
privés sont moins souvent équipés de dispositifs d'accompagnement pour l’insertion
professionnelle, possiblement en raison de priorités différentes ou de ressources limitées. Cette
situation pourrait désavantager les apprenants des centres privés, qui pourraient bénéficier d'un
soutien moins structuré pour leur insertion professionnelle.
En fin, cette analyse souligne un besoin de renforcer la présence de cellules d’insertion
professionnelle dans les centres privés afin de réduire les inégalités d’accès au soutien à
l'insertion et d'offrir aux apprenants des deux types de centres des chances équitables de
transition vers l’emploi.
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Public Privé Ensemble
 |
46 46 |
▲back to top |
45
Figure 6: Proportion de centre disposant de cellule d’insertion professionnelle selon le type de centre (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
Les données de la Figure ci-dessous montrent des disparités significatives entre les régions
quant à la proportion de centres disposant d'une cellule d'insertion professionnelle.
Certaines régions se distinguent par un taux élevé de centres avec une cellule d'insertion,
notamment Koutiala et Bandiagara, où tous les centres (100%) sont équipés de cette cellule.
D'autres régions affichent également un taux relativement élevé, comme Dioïla (85,7%), Mopti
(63,6%), Bamako (62,2%) et Bougouni ainsi que San (57,1% chacun). Cette présence renforcée
de cellules d’insertion dans ces localités pourrait offrir aux apprenants un accompagnement
plus structuré et une meilleure transition vers le marché du travail.
À l'opposé, certaines régions sont dépourvues de cellules d'insertion dans leurs centres, comme
Kayes, Nioro, et Kita (0,0%). L'absence de cellules d'insertion dans ces régions pourrait limiter
les perspectives d'insertion professionnelle pour les jeunes et les priver d’un appui essentiel
dans leur intégration au milieu professionnel.
Des régions telles que Sikasso (47,1%), Ségou (27,3%), Koulikoro (26,3%), Gao (16,7%) et
Tombouctou (15,4%) présentent un taux modéré de centres disposant de cellules d'insertion, ce
qui laisse place à des améliorations. L’implantation de cellules d’insertion dans ces régions
pourrait renforcer le soutien offert aux apprenants et répondre aux besoins d’accompagnement
en matière d’insertion professionnelle.
Globalement, la proportion moyenne de centres dotés de cellules d'insertion professionnelle est
de 49,2% au niveau national. Cela indique qu'environ la moitié des centres, tous statuts
confondus, ne disposent pas de dispositifs d’accompagnement pour l’insertion des jeunes. Des
efforts pourraient être entrepris pour uniformiser la disponibilité de ces cellules d'insertion, en
priorisant les régions qui en sont dépourvues afin de réduire les inégalités d’accès à un soutien
à l’insertion professionnelle.
92,3%
46,1%
49,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Public Privé Ensemble
 |
47 47 |
▲back to top |
46
Figure 7: Proportion de centre disposant de cellule d’insertion professionnelle selon la région (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.4. Analyse des indicateurs d’adéquation de la formation à
l’emploi
3.4.1. Apprenants en formation duale
L’analyse de la répartition des apprenants en formation duale selon les régions met en évidence
de fortes disparités dans le nombre d'inscrits. La région de Bamako, avec 2658 apprenants,
représente le pôle de formation le plus important, ce qui pourrait être dû à sa densité de
population et à sa concentration de centres de formation et d’opportunités économiques.
À l'inverse, des régions comme Gao (0 apprenant), Nioro (16 apprenants) et San (24 apprenants)
montrent une faible participation au programme, ce qui peut suggérer des défis d'accès aux
infrastructures de formation, un manque d'options pour l’apprentissage dual, ou des différences
dans les besoins de main-d'œuvre qualifiée.
Dans les régions intermédiaires, Mopti (702 apprenants), Sikasso (652 apprenants) et Kayes
(534 apprenants) témoignent d’une participation notable, probablement en raison d’initiatives
locales ou de politiques d'incitation en faveur de la formation duale.
Enfin, la somme totale de 6919 apprenants montre un potentiel significatif du programme à
l'échelle nationale, mais avec une concentration évidente dans certaines régions, d'où l'intérêt
de renforcer l'accessibilité de la formation dans les zones sous-représentées. Ces observations
pourraient amener à des recommandations pour améliorer l’équité d’accès aux programmes de
formation dans l’ensemble du pays.
0,0%
26,3%
47,1%
27,3%
63,6%
15,4%
16,7%
0,0%
0,0%
85,7%
57,1%
100,0%
57,1%
100,0%
62,2%
49,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Nioro
Kita
Dioïla
Bougouni
Koutiala
San
Bandiagara
Bamako
Ensemble
 |
48 48 |
▲back to top |
47
Figure 8: Nombre d’apprenants en formation duale selon la région
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.4.2. Apprenant en formation continue
L’analyse des apprenants en formation continue par région révèle des disparités frappantes dans
la distribution régionale, certaines zones n'ayant pratiquement aucun apprenant. Des régions
telles que Kayes, Ségou, Nioro, Kita, Dioïla, Koutiala, San, et Bandiagara présentent 0
apprenant, ce qui pourrait indiquer des défis importants d'accès, de sensibilisation, ou de besoin
de renforcement de l'offre de formation continue dans ces zones.
Koulikoro et Bamako sont les principales régions participantes avec respectivement 301 et 207
apprenants, ce qui pourrait s'expliquer par la proximité de ces zones avec des centres urbains
offrant de meilleures infrastructures et une plus forte demande de formation continue.
D'autres régions comme Gao (128 apprenants) et Mopti (70 apprenants) montrent également
une participation notable, suggérant peut-être un intérêt croissant pour la formation continue,
malgré des ressources limitées dans certaines zones.
En résumé, le nombre total de 733 apprenants au niveau national est relativement faible, avec
une concentration notable dans des régions spécifiques. Cette distribution inégale met en
lumière la nécessité de renforcer les efforts pour promouvoir et déployer la formation continue
de manière plus équilibrée dans tout le pays, afin d’assurer une couverture plus équitable et de
répondre aux besoins de compétences dans les régions sous-desservies.
0
16
24
70
144
154
249
307
416
485
508
534
652
702
2658
6919
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Gao
Nioro
San
Bandiagara
Kita
Dioïla
Ségou
Tombouctou
Bougouni
Koulikoro
Koutiala
Kayes
Sikasso
Mopti
Bamako
Ensemble
 |
49 49 |
▲back to top |
48
Figure 9: Nombre d’apprenants en continue selon la région
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.4.3. Visite d’entreprise par les apprenants des centres de formation
professionnelle
Les données de la Figure 5 montrent la proportion de centres de formation professionnelle
effectuant au moins une visite d’entreprise selon les régions, révélant des variations notables
entre elles. Au niveau national, 57,0% des centres ne réalisent aucune visite d’entreprise, contre
43,0% qui en effectuent au moins une. Cette moyenne générale révèle que la majorité des
centres n'ont pas encore intégré les visites d’entreprises comme pratique courante, malgré les
bénéfices qu’elles apportent en matière de préparation à l’emploi.
Certaines régions se distinguent par un faible taux de visites d’entreprises, avec une majorité
de centres n’effectuant aucune visite. Par exemple, Kayes, Nioro, Kita, et Bandiagara sont des
régions où 100% des centres ne réalisent aucune visite d’entreprise. De même, Mopti (90,9%)
et Gao (66,7%) présentent également un pourcentage élevé de centres sans aucune visite
d'entreprise. Cette absence de visites peut limiter l'exposition des apprenants au milieu
professionnel et réduire leurs opportunités d'interagir avec des entreprises pour mieux
comprendre les attentes du marché du travail.
En revanche, certaines régions montrent un engagement plus fort en matière de visites
d’entreprises. Bamako enregistre le pourcentage le plus élevé de centres effectuant au moins
une visite d’entreprise, avec 75,7% de ses centres engagés dans cette pratique. San et
Tombouctou suivent de près, avec respectivement 71,4% et 69,2% de centres réalisant des
visites d’entreprise. Ces visites permettent aux apprenants de renforcer leurs compétences
pratiques et d'acquérir une meilleure compréhension des réalités du monde professionnel.
Dans d’autres régions, la proportion de centres effectuant des visites est plus équilibrée, comme
à Sikasso (41,2%), Ségou (40,9%), et Koutiala (38,9%). Ces centres, bien que n’ayant pas un
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
15
70
128
207
301
733
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Kayes
Ségou
Nioro
Kita
Dioïla
Koutiala
San
Bandiagara
Bougouni
Sikasso
Tombouctou
Mopti
Gao
Bamako
Koulikoro
Ensemble
 |
50 50 |
▲back to top |
49
taux de visite aussi élevé que Bamako, montrent une certaine ouverture vers l’insertion des
apprenants dans le milieu professionnel à travers des visites d'entreprises.
En renforçant cette pratique, les centres de formation pourraient améliorer la préparation des
apprenants au monde du travail et leur offrir des perspectives plus concrètes sur leurs futurs
environnements professionnels.
Figure 10: Proportion de Centre de formation professionnelle effectuant au moins une visite d’entreprise
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.4.4. Organisation des journées portes ouvertes par les CFP
La moyenne nationale indique que 71,5% des centres ne réalisent aucune journée portes
ouvertes, contre seulement 28,5% qui en organisent au moins une. Ce chiffre souligne que la
grande majorité des centres n’ont pas encore intégré cette activité dans leur programme, malgré
ses avantages potentiels en matière de visibilité et d'insertion professionnelle.
Certaines régions se distinguent par une absence totale d'organisation de journées portes
ouvertes. Par exemple, Kayes, Sikasso, Nioro, Kita, Bougouni, et Bandiagara montrent une
proportion de 100% de centres n’ayant jamais organisé de journée portes ouvertes. Cette
absence d'événements d'ouverture peut limiter l'engagement avec la communauté, l'opportunité
pour les apprenants de présenter leurs compétences, et la visibilité des CFP dans leur région
respective.
D’autres régions présentent une participation modérée aux journées portes ouvertes. Par
exemple, Koulikoro (36,8%), Tombouctou (38,5%) et Gao (33,3%) comptent une proportion
de centres organisant ces événements, bien que ce soit encore en deçà de la majorité. Dioïla et
Koutiala affichent des taux similaires, avec respectivement 28,6% et 22,2% de centres
impliqués dans l’organisation de journées portes ouvertes. Ces chiffres montrent une certaine
100,0%
63,2%
58,8%
59,1%
90,9%
30,8%
66,7%
100,0%
100,0%
42,9%
57,1%
61,1%
28,6%
100,0%
24,3%
57,0%
36,8%
41,2%
40,9%
9,1%
69,2%
33,3%
57,1%
42,9%
38,9%
71,4%
75,7%
43,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Nioro
Kita
Dioïla
Bougouni
Koutiala
San
Bandiagara
Bamako
Ensemble
Aucune Au moins une visite d’entreprise
 |
51 51 |
▲back to top |
50
volonté de promouvoir l'engagement communautaire, mais il reste encore un potentiel
d'amélioration.
Certaines régions montrent cependant un taux relativement élevé de centres organisant au moins
une journée portes ouvertes, ce qui indique une dynamique plus active. Bamako, avec 67,6%
de ses centres effectuant des journées portes ouvertes, et San avec 71,4%, sont en tête en matière
de promotion de leurs activités auprès du public. Ces événements peuvent jouer un rôle clé pour
rapprocher les centres de formation de leurs communautés, pour sensibiliser les entreprises
locales aux compétences des apprenants, et pour favoriser les opportunités d’insertion
professionnelle.
Cette analyse met en lumière l’importance de promouvoir les journées portes ouvertes dans les
CFP, notamment dans les régions où elles sont encore peu fréquentes voire inexistantes. En
multipliant ces initiatives, les centres pourraient non seulement améliorer leur visibilité et attirer
davantage d'apprenants, mais également faciliter les liens entre les apprenants et le monde du
travail, en ouvrant leurs portes aux entreprises et aux acteurs locaux.
Figure 11: Proportion de Centre de formation professionnelle effectuant au moins une journée porte ouverte (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
3.4.5. Partenariat centres et entreprises intégrant les apprenants
Au niveau national, la proportion moyenne de centres disposant de partenariats avec des
entreprises est de 52,6%, ce qui signifie qu’un peu plus de la moitié des centres offrent cette
possibilité d’intégration en entreprise aux apprenants. Bien que cette moyenne soit
encourageante, elle souligne également qu'une part importante des centres reste sans
partenariat, notamment dans certaines régions.
Certaines régions se démarquent par un fort taux de partenariats avec des entreprises. Nioro
affiche un taux de 100%, indiquant que tous les centres de cette région ont des partenariats
permettant l’intégration des apprenants dans des entreprises. Ce modèle de collaboration
pourrait être très bénéfique pour les apprenants, qui ont ainsi de meilleures opportunités
d'expérience pratique et d'insertion sur le marché du travail. Sikasso (85,7%) et Tombouctou
(76,9%) suivent de près, démontrant également un haut niveau de partenariats, ce qui reflète un
100,0%
63,2%
100,0%
86,4%
90,9%
61,5%
66,7%
100,0%
100,0%
71,4%
100,0%
77,8%
28,6%
100,0%
32,4%
71,5%
36,8%
13,6%
9,1%
38,5%
33,3%
28,6%
22,2%
71,4%
67,6%
28,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Nioro
Kita
Dioïla
Bougouni
Koutiala
San
Bandiagara
Bamako
Ensemble
Aucune Au moins une journée porte ouverte
 |
52 52 |
▲back to top |
51
engagement marqué dans ces régions pour rapprocher les centres de formation du secteur
professionnel.
Plusieurs autres régions montrent un niveau de partenariats significatif, bien que légèrement
inférieur. Bougouni (71,4%), San, Gao, et Kita (66,7% chacun), ainsi que Koulikoro (61,1%)
et Bamako (59,4%) présentent des taux modérés de centres ayant des partenariats avec des
entreprises. Ces collaborations, bien que non universelles, indiquent que plus de la moitié des
centres de ces régions offrent à leurs apprenants des possibilités d’intégration en entreprise, ce
qui peut constituer un atout pour leur insertion professionnelle.
À l'inverse, certaines régions affichent des taux plus faibles, ce qui pourrait limiter les
opportunités d'intégration en entreprise pour les apprenants. Ségou et Mopti comptent
respectivement 22,2% et 31,8% de centres ayant des partenariats, ce qui est bien en dessous de
la moyenne nationale. Kayes se distingue par un taux de 0%, indiquant qu'aucun centre de cette
région ne dispose de partenariat avec des entreprises pour intégrer les apprenants. L'absence de
partenariats dans ces régions pourrait poser des difficultés pour l'insertion professionnelle des
jeunes et limiter leur expérience pratique.
Ces données suggèrent un besoin de promouvoir les partenariats entre les centres de formation
et les entreprises, en particulier dans les régions où de tels partenariats sont rares voire
inexistants, comme à Kayes. Le renforcement de ces collaborations pourrait améliorer
l’insertion des apprenants dans le milieu professionnel et favoriser leur transition vers l'emploi
en leur offrant des expériences concrètes en entreprise.
Figure 12: Proportion de centre ayant un partenariat avec des entreprises intégrant les apprenants par région (%)
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
0,0%
22,2%
31,8%
33,3%
40,0%
50,0%
59,4%
61,1%
66,7%
66,7%
66,7%
71,4%
76,9%
85,7%
100,0%
52,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Kayes
Ségou
Mopti
Koutiala
Dioïla
Bandiagara
Bamako
Koulikoro
Gao
Kita
San
Bougouni
Tombouctou
Sikasso
Nioro
Ensemble
 |
53 53 |
▲back to top |
52
3.5. Analyse des indicateurs de financement
La moyenne nationale montre que les centres de formation professionnelle s'appuient
majoritairement sur les prestations de service (65,8%) et les frais d'inscription (60,1%). Bien
que les financements de l’État ne représentent que 11,4% en moyenne, certaines régions,
comme Bougouni (71,4%) et Kita (33,3%), bénéficient davantage de l’appui public. Cela
suggère une disparité dans la répartition du financement public entre les régions, avec certaines
régions recevant plus de soutien que d’autres.
Certaines régions dépendent principalement des frais d'inscription et des prestations de service
comme principales sources de financement. Par exemple, Koulikoro tire 78,9% de son
financement des frais d'inscription, et 90,9% de celui de Ségou provient des prestations de
service. Ces données indiquent une forte contribution des apprenants et de la clientèle locale
dans le financement des activités de ces centres, ce qui pourrait suggérer un modèle de
financement tourné vers l'autonomie financière par le biais de services payants et des frais
d'inscription.
D'autres régions se distinguent par une forte dépendance aux partenaires techniques et
financiers (PTF) et aux partenaires financiers locaux. Par exemple, Bandiagara finance ses
centres exclusivement grâce aux PTF (100%) et aux legs (100%), soulignant ainsi une forte
dépendance aux financements extérieurs et aux dons. Tombouctou obtient également 46,2% de
ses financements de PTF, ce qui montre l'importance des contributions internationales ou
nationales dans certaines régions pour soutenir la formation professionnelle.
Certaines régions, telles que Kayes, Gao, et Kita, montrent une utilisation très marquée de
certaines sources spécifiques. Gao tire 100% de son financement des prestations de service et
66,7% de celui de Kayes provient également de cette source, alors que Kita et Nioro s'appuient
sur les frais d'inscription et les prestations de service pour leur financement (100% chacun).
Ces données suggèrent que ces centres reposent fortement sur les recettes générées en interne
pour financer leurs activités, ce qui peut refléter des pratiques de gestion plus axées sur
l’autosuffisance.
Mopti se distingue par un financement diversifié, avec des contributions provenant de plusieurs
sources : 68,2% de ses fonds viennent des legs, 81,8% des prestations de service et 72,7% des
frais d'inscription. Cette diversification permettrait une plus grande stabilité financière et une
meilleure résilience aux fluctuations des sources de financement.
En fin, l'analyse de ces données révèle que les centres de formation professionnelle au Mali
adoptent des modèles de financement variés, en fonction des ressources locales disponibles et
de leur accès aux financements externes. Si certaines régions comme Ségou et Koulikoro
favorisent les recettes générées en interne, d'autres, telles que Bandiagara et Tombouctou,
dépendent davantage de financements extérieurs. Un renforcement des capacités de
financement autonome, ainsi qu'une meilleure distribution des subventions publiques,
pourraient contribuer à équilibrer les ressources financières entre les différentes régions et à
assurer une meilleure pérennité des centres de formation.
 |
54 54 |
▲back to top |
53
Tableau 26: Source de financement des centres de formation selon la région (%)
Région
B
u
d
g
et d
e
l’
E
ta
t
C
o
llectiv
ités
lo
ca
les
P
a
rten
a
ires
fin
a
n
ciers
lo
ca
u
x
P
T
F
L
eg
s
P
resta
tio
n
s d
e
serv
ice
F
ra
is
d
’
in
scrip
tio
n
F
ra
is d
e
sco
la
rité
A
u
tres
resso
u
rces
Kayes 0,0 16,7 16,7 16,7 0,0 66,7 50,0 0,0 0,0
Koulikoro 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 78,9 0,0 10,5
Sikasso 0,0 0,0 11,8 0,0 5,9 70,6 47,1 0,0 0,0
Ségou 4,5 0,0 18,2 59,1 0,0 90,9 40,9 4,5 4,5
Mopti 4,5 4,5 9,1 31,8 68,2 81,8 72,7 9,1 4,5
Tombouctou 0,0 0,0 0,0 46,2 7,7 69,2 15,4 0,0 0,0
Gao 0,0 0,0 33,3 33,3 0,0 100,0 33,3 0,0 0,0
Nioro 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Kita 33,3 0,0 66,7 50,0 0,0 100,0 100,0 0,0 33,3
Dioïla 28,6 14,3 0,0 14,3 0,0 71,4 71,4 28,6 28,6
Bougouni 71,4 0,0 14,3 57,1 0,0 42,9 71,4 14,3 71,4
Koutiala 22,2 22,2 22,2 11,1 0,0 83,3 61,1 11,1 22,2
San 14,3 28,6 28,6 42,9 14,3 85,7 71,4 28,6 14,3
Bandiagara 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Bamako 10,8 8,1 13,5 8,1 2,7 40,5 73,0 5,4 10,8
Ensemble 11,4 6,2 14,5 25,4 11,9 65,8 60,1 6,2 11,4
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agréés, ONEF 2024
La répartition des apprenants de la formation professionnelle selon la source de financement,
telle que présentée dans le tableau, met en évidence des disparités significatives entre les
différentes régions. Par exemple, Kayes affiche une diversité de financements, avec 29,2 %
d’apprenants soutenus par l'État ou des collectivités, tandis que 51,3 % proviennent de
financements en propre, et 19,5 % des partenaires techniques et financiers (PTF). À l'opposé,
la région de Koulikoro se distingue par une dépendance marquée aux financements des PTF,
qui représentent 91,5 % des apprenants, avec seulement 2,7 % soutenus par l'État.
D'une manière générale, on constate que certaines régions, comme Sikasso, montrent une
proportion équilibrée entre les différents types de financement, avec 39,1 % issus de l'État et
60,9 % de financements privés, tandis que d'autres, telles que Ségou et Gao, dépendent
exclusivement des financements propres des apprenants. En effet, cette absence de financement
externe pour ces régions pourrait poser des questions sur l'accessibilité et l’équité de la
formation professionnelle.
À Bamako, bien que le pourcentage d'apprenants financés par le PTF soit relativement élevé
(72,8 %), une proportion notable bénéficie également des financements propres (20,5 %), ce
qui pourrait refléter un système plus diversifié et potentiellement plus durable. L’ensemble du
pays présente également une tendance claire, avec 73,3 % des apprenants financés par des
sources privées, illustrant un modèle de formation professionnelle qui repose largement sur
l'initiative individuelle et les moyens propres.
Ce panorama met en évidence des disparités régionales dans l'accès aux financements pour la
formation professionnelle. Par exemple, des régions telles que Bougouni et Koutiala s'appuient
presque exclusivement sur leurs propres ressources, tandis que d'autres, comme Koulikoro,
dépendent largement des partenaires techniques et financiers (PTF). Ces différences peuvent
influencer tant la qualité que l'attractivité des formations disponibles dans chaque région, ainsi
que le développement des compétences de la main-d'œuvre locale.
 |
55 55 |
▲back to top |
54
Tableau 27: Répartition des apprenants de la formation professionnelle selon la source de financement
Région Etat/ Collectivité PTF Propre compte Ensemble
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Kayes 156 29,2 274 51,3 104 19,5 534 100,0
Koulikoro 21 2,7 719 91,5 46 5,9 786 100,0
Sikasso 259 39,1 404 60,9 0 0,0 663 100,0
Ségou 0 0,0 249 100,0 0 0,0 249 100,0
Mopti 61 7,9 354 45,9 357 46,2 772 100,0
Tombouctou 25 7,8 287 89,1 10 3,1 322 100,0
Gao 0 0,0 0 0,0 128 100,0 128 100,0
Nioro 1 6,3 15 93,8 0 0,0 16 100,0
Kita 0 0,0 108 75,0 36 25,0 144 100,0
Dioïla 0 0,0 154 100,0 0 0,0 154 100,0
Bougouni 0 0,0 416 99,8 1 0,2 417 100,0
Koutiala 0 0,0 508 100,0 0 0,0 508 100,0
San 0 0,0 24 100,0 0 0,0 24 100,0
Bandiagara 0 0,0 11 15,7 59 84,3 70 100,0
Bamako 191 6,7 2086 72,8 588 20,5 2865 100,0
Ensemble 714 9,3 5609 73,3 1329 17,4 7652 100,0
Source : Enquête auprès des centres de formation professionnelle agrées, ONEF 2024
 |
56 56 |
▲back to top |
55
CONCLUSION
Le présent rapport d’analyse des indicateurs de la formation professionnelle a été élaboré sur la
base des données collectées auprès des centres de formation professionnelle agrées par le
Ministère en charge de l’Entreprenariat, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le
rapport met en évidence des progrès notables, mais aussi des disparités persistantes dans le
sous-secteur de la formation professionnelle. L’analyse révèle un besoin pressant de diversifier
et de renforcer les financements, particulièrement dans les régions qui dépendent exclusivement
de partenaires extérieurs, ce qui pourrait menacer la pérennité des centres de formation en cas
de diminution de ces sources.
Malgré une nette prédominance du secteur privé dans la formation professionnelle, il est apparu
qu’un plus grand nombre de centres publics ont établi des cellules d’insertion professionnelle
et des partenariats avec des entreprises, ce qui facilite l’insertion des jeunes formés. Le
développement de ces dispositifs dans les centres privés reste une priorité pour garantir une
insertion équitable et soutenue.
L'analyse a également révélé que les infrastructures sont globalement en bon état, bien que
certaines régions aient besoin davantage de soutien pour atteindre les standards nationaux. De
plus, des efforts accrus pour promouvoir les visites d’entreprises et les journées portes ouvertes
pourraient renforcer les liens entre les centres de formation et le monde du travail, favorisant
ainsi l’adéquation des formations avec les besoins du marché.
Enfin, l’importance de l’inclusion des femmes dans les formations professionnelles est
manifeste, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour équilibrer la représentation
dans les filières techniques, qui restent sous-investies. En s’appuyant sur ces constats, il est
crucial de renforcer l’autonomie financière des centres et de poursuivre les initiatives visant à
élargir l’accès aux dispositifs d’insertion professionnelle dans toutes les régions, afin de rendre
la formation professionnelle plus accessible, durable et inclusive.
 |
57 57 |
▲back to top |
56
RECOMMANDATIONS
Les recommandations qui découlent de ce rapport mettent en exergue des points forts à
conforter, des lacunes à combler ou des orientations nouvelles à suivre. Ces recommandations
doivent permettre d’améliorer les actions à entreprendre dans le futur et de les réorienter si
nécessaire. Elles sont entre autres :
1. Direction nationale de la formation professionnelle
• Suivi des centres de formation professionnelle : Effectuer des inspections
régulières des centres de formation pour évaluer la conformité aux normes
établies. Cela devrait couvrir les infrastructures, les équipements, la qualité de
la formation, la qualification des formateurs, etc.
• Mise en place d’un répertoire de la main d’œuvre : Mettre en place un
répertoire de la main d’œuvre issus de la formation professionnelle.
• Renforcement des cellules d'insertion : Élaborer des outils et des supports pour
assister les centres de formation professionnelle dans l'efficacité de leurs cellules
d'insertion professionnelle.
• Mise en place d’une base de données : Mettre en place une base de données
fiable des centres ou ateliers de formation professionnelle en tenant compte de
tous les centres de formation professionnelle du Mali.
2. Centres de formation professionnelle
• Investissement dans les infrastructures : Rénover les infrastructures et les
équipements des centres de formation pour garantir des environnements
d'apprentissage de haute qualité.
• Formation du personnel formateur : Augmenter le nombre de formateurs
qualifiés pour garantir une meilleure qualité de la formation et répondre aux
besoins du marché du travail.
3. Entreprises
• Accueil des apprenants : Favoriser l'accueil des apprenants en stage ou en
apprentissage pour offrir des opportunités de formation pratique sur le terrain.
• Reconnaissance des compétences : Reconnaître les compétences acquises par
les apprenants au sein des centres de formation professionnelle pour faciliter leur
insertion professionnelle.
4. Partenaire Financier et Technique (PTF)
• Soutien financier : Continuer à soutenir financièrement la formation
professionnelle au Mali, en mettant l'accent sur les besoins en infrastructure, en
équipement et en développement des compétences.
• Collaboration avec les structures en charges de l'emploi : Renforcer la
collaboration avec les structures en charges de l’emploi pour améliorer les
 |
58 58 |
▲back to top |
57
dispositifs de suivi de l'insertion professionnelle des apprenants, en particulier
dans les régions où ils sont moins répandus.
• Encouragement du partage des bonnes pratiques : Encourager le partage de
bonnes pratiques et la diffusion de l'expertise en formation professionnelle pour
renforcer le secteur.
En mettant en œuvre ces recommandations, les acteurs impliqués dans la formation
professionnelle au Mali peuvent contribuer à améliorer l'efficacité et la pertinence du dispositif
de formation professionnelle, tout en renforçant l'employabilité des apprenants et en stimulant
le développement économique du pays.
Copyright @ 2024 | ONEF .