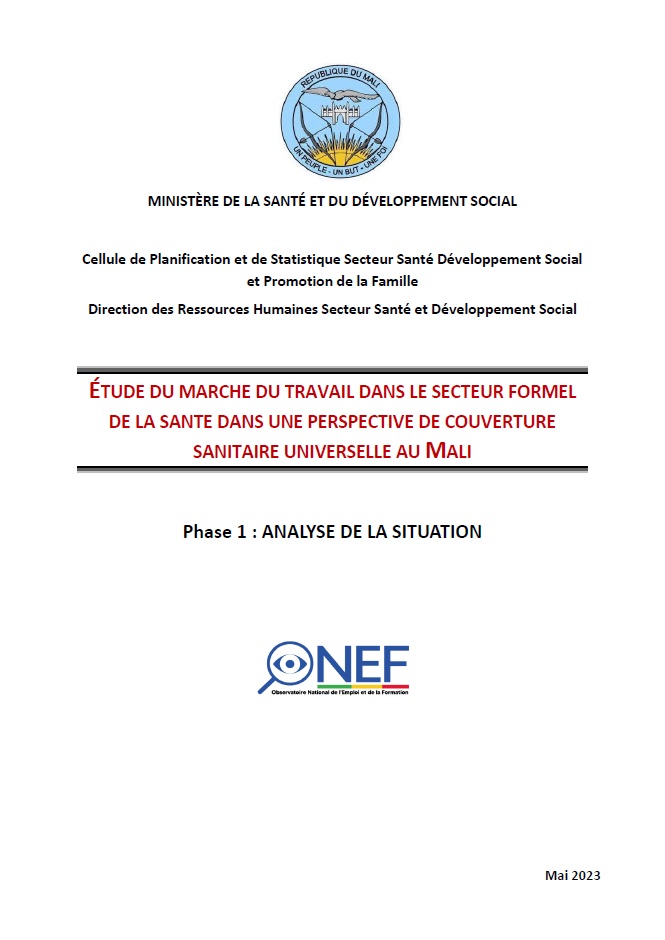MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL Cellule de Planification et de...
 |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL Cellule de Planification et de... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé Développement Social
et Promotion de la Famille
Direction des Ressources Humaines Secteur Santé et Développement Social
ÉTUDE DU MARCHE DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR FORMEL
DE LA SANTE DANS UNE PERSPECTIVE DE COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE AU MALI
Phase 1 : ANALYSE DE LA SITUATION
Mai 2023
 |
2 2 |
▲back to top |
2
Remerciements
La mission de consultation remercie son Excellence Madame la Ministre de la Santé et du
Développement social et son Cabinet, le Représentant résidant de l’OMS au Mali et toute son
équipe, le Bureau Régional de l’OMS en Afrique et le Département des personnels de santé
de l’OMS à Genève, pour l’intérêt accordé à cette étude du marché du travail dans le secteur
formel de la santé dans une perspective de couverture sanitaire universelle au Mali. Elle
remercie également par la présente, la Direction des Ressources Humaines (DRH), la Cellule
de Planification et de Statistique (CPS) et les autres Directions Techniques du Ministère de la
Santé et du Développement Social qui n’ont ménagé aucun effort pour accueillir et orienter
cette mission en vue de lui assurer une pleine réussite . Nous remercions également
l’ensemble des parties prenantes ayant facilité la conduite de cette étude et surtout la collecte
des données.
 |
3 3 |
▲back to top |
3
Résumé
Contexte et justification
Au Mali, le Gouvernement s’est engagé à fournir des personnels de santé disponibles et de
qualité, équitablement répartis à l’échelle géographique et satisfaits de leurs conditions de vie
et de travail. Cet engagement marque la volonté des plus hautes autorités du pays à améliorer
la santé des populations à travers la fourniture de services et soins de santé financièrement
et géographiquement accessibles. Cette ambition a été formalisée et opérationnalisée à
travers la Politique de Développement des Ressources Humaines du secteur de la santé, du
développement social et de la promotion de la famille, assortie de son plan d’action
stratégique intégré, tous élaboré depuis 2019 et dont l’échéance sera à son terme en 2023.
En préparation de la prochaine politique, le Ministère de la Santé et du Développement Social
à travers sa Direction des Ressources Humaines (bénéficiaire de l’étude) et sa Cellule de
Planification et de Statistique, a pris l’initiative de conduire une étude en vue d’avoir un aperçu
holistique de la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé.
Pour une première étape, il a été convenu de répertorier les principaux goulots
d’étranglement auxquels sont confrontées les Ressources Humaines de la Santé. Une seconde
phase à venir devrait documenter leurs causes pour identifier et définir des orientations
stratégiques pour le développement des Ressources Humaines de la Santé au Mali.
Cadrage de l’étude
Cette première phase de l’étude a pour objectif d’analyser la situation du marché du travail
dans le secteur de la santé, en se focalisant sur ses différents piliers : i) l’offre incluant la
production, l’attrition, la disponibilité assortie de la distribution des personnels de santé et, ii)
la demande à travers les recrutements des personnels de santé. En sus de ces piliers, l’étude
réalise des analyses de projection, notamment de l’offre et de la demande économique des
personnels de santé, et aborde également la dynamique évolutive et les déterminants clés du
financement public destiné aux personnels de santé. Cette étude s’est intéressée aux
questions clés suivantes :
Question stratégique : quels sont les principaux leviers stratégiques à actionner dans le but
de permettre au Mali de fournir des personnels de santé en quantité et en qualité suffisantes,
répartis harmonieusement et conformément aux besoins prioritaires du système de santé et
satisfaits de leurs conditions de vie et de travail ?
Questions de recherche d’ordre descriptif
- La production des personnels de santé s’est-elle accrue au cours de ces dernières
années ?
 |
4 4 |
▲back to top |
4
- Quelles sont les destinations les plus prisées et les principales sources de financement
de la formation en santé à l’étranger dans le secteur de la santé ?
- Les performances académiques des étudiants et élèves issus des formations en santé
ont-elles connu une amélioration au cours de ces dernières années ?
- Quelle est la composition des personnels de santé ?
- L’attrition des personnels de santé est-elle accrue ? Quels sont les principaux motifs à
l’origine de cette attrition ?Les recrutements ont-ils augmenté au cours de ces
dernières années ?
- Les recrutements ont-ils augmenté au cours de ces dernières années ?
- Les emplois crées ont-ils augmenté au cours de ces dernières années ?
Questions de recherche d’ordre analytique
- Les personnels de santé sont-ils et seront-ils suffisamment disponibles pour couvrir les
besoins requis pour l’atteinte des objectifs de développement sanitaire ?
- Les personnels de santé sont-ils égalitairement et équitablement répartis ?
- La demande réagit-elle favorablement à l’offre entrante de personnels de santé sur le
marché du travail ?
- Le financement public des personnels de santé s’est-il accru au cours de ces dernières
années ? Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la dynamique d’évolution de ce
financement ?
- Le gouvernement disposera-t-il d’une capacité budgétaire suffisante pour financer les
coûts de l’offre attendue en matière de personnels de santé ?
Principales étapes
Cette étude a débuté à travers un atelier de sensibilisation des parties prenantes ayant permis
à l’équipe technique de présenter l’analyse du marché du travail, ses bénéfices et des
différentes étapes. Cet atelier a aussi été l’occasion non seulement de recueillir auprès des
parties prenantes, les défis et les besoins du pays en matière de développement sanitaire et
des Ressources Humaines de la Santé mais aussi de définir les questions de recherche
auxquelles l’étude s’attèlera à répondre. Suite à cette phase, un protocole a été élaboré afin
de documenter la méthodologie à suivre pour la conduite de cette première étape et définir
les besoins de données, assortis de leurs sources potentielles. Il s’en est suivi l’élaboration des
outils de collecte et la collecte de données, après avoir recruté un cabinet d’étude. Au cours
du processus, un atelier de suivi a été organisé afin de présenter les données préliminaires
ayant été collectées en vue d’obtenir les avis des parties prenantes quant aux alternatives à
adopter afin de combler le gap de données n’ayant pas pu être collectées en ce moment. A la
 |
5 5 |
▲back to top |
5
suite de cet atelier, la collecte de données a été complétée ; ce qui a permis d’analyser les
données pour rédiger le présent rapport.
Collecte des données
Deux catégories de données ont été collectées. La première se réfère aux données
secondaires collectées à travers une exploitation : i) de bases de données nationales ayant été
transmises par les autorités administratives des ministères en charge de la fonction publique,
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ii) de
bases de données internationales obtenues à travers une recherche sur internet, incluant celle
de l’OMS (Global Health Expenditure), de la Banque Mondiale (World Development Indicator),
du FMI (World Economic Outlook) et de l’IHME (Global Burden of Disease). La collecte de
données secondaires a été complétée par une revue documentaire essentiellement basée sur
le financement des personnels de santé (rapports sur la situation de l’exécution du budget,
documents de programmation budgétaire et économique pluriannuel, collectés sur le site du
Ministère de l’Économie et des Finances). La seconde catégorie de données se réfère aux
données primaires ayant été collectées auprès des structures de santé et établissements de
formation, provenant surtout du secteur privé. Cette collecte supplémentaire avait pour
objectif de compléter les données secondaires.
Les données collectées ont essentiellement porté sur les thématiques suivantes : la
disponibilité du personnel de santé, la production et le recrutement du personnel de santé,
l’attrition et le financement des professionnels de santé. Les taux de complétude des données
allaient de 85,9% à 100% et de 85,7% à 96,9% en ce qui concerne respectivement les données
primaires et secondaires.
Contraintes et limites
Certaines données n’ont pas été collectées du fait qu’elles n’ont pas été disponibles. . Il s’agit
des données sur la situation des personnels de santé de l’Armée, les migrations des agents de
santé, certaines données relatives à la demande (nombre de postes établis, financés et
vacants), à la rémunération (salaires et primes) et à la production (nombre d’étudiants et
élèves annuellement dans un cursus de formation en santé). En outre, il était convenu
d’estimer et d’analyser les besoins en personnels de santé. Cependant, les données collectées
à ce stade ne permettent pas de réaliser cet exercice à bon escient.
Résultats
Offre de personnels de santé : production et performance académique des diplômés issus
des formations en santé
Au cours de ces dernières années (2017-2021), la production totale des diplômés s’est accrue
de 14,3% annuellement et de 4,7% en moyenne. La production domestique des diplômés issus
des établissements privés et publics a respectivement augmenté de 13,8% et 21,1% par an.
 |
6 6 |
▲back to top |
6
En outre, il ressort que le secteur privé reste le principal offreur de diplômés sur le marché
avec une fourniture de 80,8% de la main d’œuvre entrante sur ce marché.
Le nombre de diplômés formés à l’étranger a connu une décroissance annuelle de 15,8% au
cours de la même période. Les destinations les plus prisées pour la formation à l’étranger sont
le Sénégal, la France et le Maroc avec respectivement 13,8%, 11,5% et, avec 11,2% de ces
diplômés formés. La formation à l’étranger a été majoritairement financée sur fonds propres
(par les diplômés eux-mêmes), représentant 50,5% des cas.
Les performances académiques, analysées à travers les taux de réussite aux examens de fin
d’année, ont connu une baisse pour bon nombre d’établissements de formation en santé.
Entre 2017 et 2021, les taux de réussite enregistrés par les établissements publics et privés de
formation ont respectivement varié de 98,2% à 16,6% et de 78,8% à 77,6%, attestant que les
étudiants du privé produisent des performances relativement plus faibles que ceux du public.
Ils ont baissé de 99% à 50% à l’école de médecine et de 98% à 13% à l’Institut National de
Formation en Sciences de Santé.
Offre de personnels de santé : disponibilité et distribution
Au cours de ces dernières années, la disponibilité des personnels de santé s’est accrue. Entre
2016 et 2022, la densité totale du personnel de santé est passée de 9,6 à 11,3 agents de santé
pour 10 000 habitants, ce qui parait encore faible. En 2022, elle variait de 5,9 (Sikasso) et 29,6
(Bamako). La densité relative au cumul des médecins, infirmiers et sages-femmes a varié de
5,1 à 5,9 agents de santé pour 10 000 habitants au cours de la même période. En 2022, cette
densité oscillait entre 2,6 à Ségou et 15,3 à Bamako tandis que celle des sages-femmes variait
entre 1,9 à Mopti et 6,3 à Bamako. Ces résultats devraient être relativisés et approfondis par
une estimation et une analyse des besoins en matière de personnels de santé, repartis par
catégorie professionnelle.
Les personnels de santé sont majoritairement composés d’infirmiers, de techniciens de santé
et de sages-femmes étant respectivement représentés en 2022 à 19,6%, 17,3% et 14,9%. Ils
regroupent essentiellement des hommes (représentés à 54,6%), des jeunes (représentés
respectivement à 48,1% et 32,1% chez les personnels du secteur privé et public) et de
contractuels (représentés à 52,6%). Ils sont principalement employés par le secteur public
(représenté à 77,8%) et régis majoritairement par le code de la fonction publique de l’État
(représenté à 25,1%).
Du point de vue régional, les personnels de santé sont inéquitablement et inégalement
répartis. La majorité des régions reçoivent moins de personnels de santé qu’il en faut pour
prendre en charge la population qu’elles abritent, à l’exception de Gao et de Kidal (zone
d’insécurité avec des abandons de postes observés) et Bamako qui enregistre un stock bien
au-dessus de la normale c’est-à-dire du personnel qu’il lui faut . Parmi les catégories
 |
7 7 |
▲back to top |
7
professionnelles analysées, seules les sages-femmes, dans toutes les régions, enregistrent une
taille supérieure à la norme nécessaire à la prise en charge des femmes en âge de procréation.
Du point de vue des piliers de la pyramide sanitaire, il ressort que les personnels de santé sont
fortement concentrés au niveau tertiaire comptant 325 personnels par établissements de
santé à savoir, les hôpitaux de troisième référence, contre 57 et 10 personnels de santé
assignés respectivement aux niveaux secondaire (avec les hôpitaux de deuxième référence)
et primaire (avec les centres de santé communautaires et les centres de santé de référence).
Ceci atteste une allocation inéquitable et inégalitaire compte tenu que l’ensemble des besoins
les plus essentiels se localise généralement au niveau du premier échelon de la pyramide
sanitaire.
Offre de personnels de santé : attrition
L’attrition a baissé tout en restant faible au cours de ces dernières années. Entre 2016 et 2021,
le taux d’attrition a baissé de 1,2% à 0,4%. En 2016, il a été de 1,4% et 0,3% respectivement
chez les personnels des secteurs public et privé contre des proportions respectives de 0,5% et
0,2% estimées en 2021. En outre, les principaux motifs de l’attrition sont les départs et les
décès représentent respectivement 81,1% et 13,1% des personnels de santé sujets à la
l’attrition.
Offre de personnels de santé : projection de l’offre en matière de personnels de santé
Au cours des prochaines années, l’offre de personnels de santé augmentera annuellement de
7,2%. Il augmentera de 2,6% chez les médecins, de 5,6% chez les infirmiers, de 6,8% chez les
sages-femmes, de 21,2% chez les techniciens de santé et plus globalement de 16,7% chez les
personnels de santé émanant du secteur privé. Toutefois, l’offre connaitre une tendance
baissière de 2,7% chez les pharmaciens, de 9,1% chez les personnels d’appui, de 19,3% chez
les personnels administratifs, de 54,7% chez les agents d’entretien, de sécurité et de
déplacement, et plus généralement de 0,3% chez les personnels de santé du secteur public.
Demande de personnels de santé : recrutements
Entre 2016 et 2022, les recrutements ont baissé annuellement de 6,5% du fait de la
décroissance de ceux réalisés par le secteur public, ayant varié de 1 385 à 701. Le secteur privé
emploie moins mais a entrepris des efforts en vue d’augmenter son niveau de recrutement.
Ceci s’est traduit par une variation de 246 à 79 entre 2016 et 2018, puis une montée en flèche
à 315 en 2022.
Création d’emplois
Entre 2016 et 2022, Le nombre net d’emplois crées a baissé : i) de 1 352 pour l’ensemble des
personnels de santé, ii) de 1 024 chez les sages-femmes, iii) de 454 chez les médecins, iv) de
331 chez les techniciens de santé, v) de 22 chez les agents d’entretien, de sécurité et de
 |
8 8 |
▲back to top |
8
déplacement et, vi) de 17 chez les pharmaciens. Il a augmenté : i) de 423 chez les personnels
d’appui, ii) de 55 chez les infirmiers et, iii) de 17 chez les personnels administratifs.
En outre, le nombre net d’emplois crées, a augmenté de 233 à 338 chez les personnels du
secteur privé et baissé de 1 185 à -196 chez ceux du secteur public. Ainsi, les évidences
indiquent que les personnels de santé du secteur public ont fait l’objet d’une destruction nette
d’emplois au cours de l’année 2022, ceci étant aussi le cas des médecins, des sages-femmes,
des pharmaciens, des techniciens de santé et des agents d’entretien, de sécurité et de
déplacement.
Équilibre entre l’offre et la demande en matière de personnels de santé
La demande en matière de personnels de santé réagit insuffisamment à l’offre entrante sur le
marché du travail de la santé. En effet, entre 2016 et 2021, le taux d’absorption des diplômés
issus des formations en santé a baissé de 43,8% (dont 37,2% et 6,6% provenaient
respectivement des secteurs public et privé) à 11,7% (dont 7,2% et 4,5% provenaient
respectivement des secteurs public et privé) entre 2016 et 2021. La baisse du taux
d’absorption provient essentiellement d’une surproduction des diplômés, provenant
essentiellement des établissements privés de formation, associés à une baisse du niveau de
recrutement. De toute évidence, les Etablissements privés de formation produisent un
nombre considérable de diplômés que le secteur privé n’est pas en mesure d’absorber. Par
ailleurs, le secteur public du fait des contraintes budgétaires n’arrive pas à épuiser le stock de
diplômés formés dans les établissements privés, ce qui fait que beaucoup sont au chômage.
Comparativement aux hommes, les femmes rencontrent plus de difficultés ou sont moins
incitées à intégrer le marché du travail dans le secteur de la santé. Les femmes sont en effet
plus représentées dans la distribution des diplômés (70% à 68,2% entre 2016 et 2021) alors
qu’elles le sont moins dans celle des personnels (40,8% à 45,1%).
Financement public des personnels de santé
Les dépenses publiques liquidées en faveur des personnels de santé ont baissé annuellement
de 27,9% au cours de la période 2019-2021, résultant : i) du niveau faible et en baisse de
priorisation de la santé dans les allocations du budget total, ayant varié de 3,7% à 1,1% , ii) de
la décroissance du niveau de priorisation des personnels de santé dans les allocations du
budget dédié à la santé, ayant varié de 44,2% à 42,8% et, iii) de la baisse considérable du taux
d’exécution réel du budget ventilé en faveur des personnels de santé, ayant varié de 99,9% à
64,8% en 2019 et 21,9% en 2021.
En outre, les évidences sont telles que les personnels de santé sont faiblement représentés
dans la distribution du budget destiné aux agents de la fonction publique. Ils ne percevaient
qu’entre 2,7% en 2016 et 4,4% en 2021 des dépenses liquidées en faveur des agents de la
fonction publique.
 |
9 9 |
▲back to top |
9
De plus, le Gouvernement, compte tenu de sa capacité budgétaire limitée, ne sera pas mesure
de couvrir les coûts attendus de l’offre en matière de personnels de santé. Entre 2023 et 2028,
la demande économique variera de 15,3 à 23,9 milliards de Fcfa tandis que le coût lié à l’offre
passera de 19,7 à 32 milliards de Fcfa.
Les évidences produites ont suscité des questions qui devraient être élucidés à travers des
pistes d’analyse suggérées pour la seconde phase de l’étude. Ces questions et pistes
d’analyse sont reportées ci-dessous.
Questions en suspens
- Quel est le supplément de personnels de santé à recruter pour combler les besoins du
système de santé ?
- Quelles sont les difficultés rencontrées dans le processus d’affectation des personnels
de santé en milieux reculés, voire mal desservis ?
- Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour inciter les personnels de santé à
exercer dans les zones lointaines et mal desservies ?
- Quels sont les facteurs à l’origine de la surproduction des diplômés formés par les
établissements privés de formation ?
- Quels sont les facteurs expliquant la difficulté pour les femmes ou leur faible incitation
à intégrer le marché du travail de la santé à la sortie de leur formation ?
- Quels sont les goulots d’étranglement inhibant les performances académiques des
étudiants et élèves issus des formations en santé ?
- Quels sont les facteurs à l’origine du niveau faible et en baisse du niveau de priorisation
de la santé dans les allocations budgétaires de l’État et du taux d’exécution réel du
budget liquidé en faveur des personnels de santé ?
- Les taux de vacance de postes et le ratio de disponibilité des personnels de santé ont-
ils augmenté au cours de ces dernières années ?
Pistes d’analyse
- Conduire une évaluation des besoins en Ressources Humaines de la Santé, basés sur
le profil épidémiologique et la charge de travail des personnels de santé.
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative afin d’inventorier les principaux goulots
d’étranglement inhibant l’affectation des personnels de santé en milieux reculés, voire
mal desservis.
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative des préférences des personnels de
santé, surtout du genre féminin.
 |
10 10 |
▲back to top |
10
- Inventorier les personnels de santé sujets aux abandons de poste dans les régions
d’insécurité à savoir Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou, Taoudéni etc.
- Réaliser une analyse qualitative des facteurs expliquant la surproduction des diplômés
formés par les établissements privés de formation.
- Réaliser une cartographie des établissements privés de formation à caractère formel
et informel.
- Réaliser des analyses qualitatives et quantitative des facteurs expliquant : i) la difficulté
des femmes ou leur faible incitation éventuelle à intégrer le marché du travail de la
santé et ii) la baisse de la performance académique des étudiants et élèves issus des
formations en santé.
- Réaliser une analyse qualitative afin de comprendre les raisons suscitant le niveau
faible et en baisse tant de la priorisation budgétaire en faveur de la santé que du taux
réel d’exécution du budget dédié aux personnels de santé.
- Calculer et analyser le taux de vacance de postes et le ratio de disponibilité des
personnels de santé.
Prochaines étapes
- Tenir un atelier de restitution des résultats de la première phase de l’étude ;
- Conduire la seconde phase de l’étude ;
- Tenir un atelier de validation des résultats de la seconde phase de l’étude ;
- Finaliser et restituer le rapport de l’analyse du marché du travail incluant les résultats
des deux phases principales du processus.
 |
11 11 |
▲back to top |
11
TABLE DES MATIERES
Remerciements .......................................................................................................................... 2
Résumé ....................................................................................................................................... 3
Sigles et abréviations ................................................................................................................ 17
1. Profil sanitaire et épidémiologique .................................................................................. 18
1.1. Organisation du système de santé ............................................................................ 18
1.2. Performance du secteur de la santé.......................................................................... 20
1.2.1. Charge de morbidité et de mortalité ................................................................. 20
1.2.2. Évolution des indicateurs clés de résultats de santé ......................................... 21
1.2.3. Situation du financement de la santé ................................................................ 23
2. Cadrage de l’étude ............................................................................................................ 24
2.1. Contexte de l’étude ................................................................................................... 24
2.2. Justification de l’étude .............................................................................................. 25
2.3. Cadre conceptuel de l’analyse du marché du travail de la santé .............................. 26
2.4. Questions de recherche ............................................................................................. 27
2.5. Objectifs de l’étude ................................................................................................... 27
2.6. Approches méthodologiques .................................................................................... 28
2.6.1. Principales étapes de l’étude ............................................................................. 28
2.6.2. Collecte, compilation et analyse des données ................................................... 28
3. Situation du marché du travail ......................................................................................... 31
3.1. Offre des Ressources Humaines de la Santé ............................................................. 31
3.1.1. Le secteur de l’éducation des agents de santé : analyse de la formation ......... 31
3.1.2. Disponibilité et distribution des personnels de santé ....................................... 36
3.1.3. Attrition des personnels de santé ...................................................................... 47
3.1.4. Projections de l’offre en personnels de santé ................................................... 50
3.2. Demande des Ressources Humaines de la Santé ...................................................... 51
3.3. Équilibre entre l’offre et la demande des Ressources Humaines de la Santé .......... 55
3.4. Financement des Ressources Humaines de la Santé ................................................ 58
 |
12 12 |
▲back to top |
12
3.4.1. Analyse de la dynamique du financement public des personnels de santé et de
ses principaux déterminants ............................................................................................. 58
3.4.2. Analyse comparative de la demande économique et du coût de l’offre en
matière de personnels de santé ....................................................................................... 63
4. Discussions ........................................................................................................................ 65
5. Principaux goulots d’étranglement, questions en suspens et pistes d’analyse ............... 68
6. Prochaines étapes ............................................................................................................. 74
Références ................................................................................................................................ 75
Documents consultés ........................................................................................................... 75
Bases de données exploitées et Sites internet consultés .................................................... 77
Annexes .................................................................................................................................... 78
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. Liste des questions clés de l’étude ......................................................................... 27
Tableau 2. Taux de complétude des données collectées ........................................................ 30
Tableau 3. Densités régionales des personnels de santé par catégorie professionnelle, 2022
.................................................................................................................................................. 38
Tableau 4. Nombre de personnels de santé par établissement de santé et par catégorie
professionnelle, selon les piliers de la pyramide sanitaire, 2022 ............................................ 47
Tableau 5. Taux d’attrition des personnels de santé selon la catégorie professionnelle, 2016-
2021 .......................................................................................................................................... 48
Tableau 6. Projections de l’offre en personnels de santé selon la catégorie professionnelle et
le secteur d’exercice, 2023-2030 ............................................................................................. 51
Tableau 7. Nombre d’emplois crées nets, répartis par catégorie professionnelle, 2016-201 55
Tableau 8. Taux d’absorption des diplômés issus des formations en santé, selon la catégorie
professionnelle, 2016-2021 ...................................................................................................... 57
Tableau 9. Matrice des défis, des questions en suspenses et des pistes d’analyse ................ 72
Tableau 10. Détails d’estimation des projections de l’offre en matière de personnels de santé,
2023-2030 ................................................................................................................................ 85
 |
13 13 |
▲back to top |
13
LISTE DES FIGURES
Figure 1. Pyramide sanitaire au Mali ........................................................................................ 19
Figure 2. Répartition des décès par catégorie de maladies, 2015-2019 .................................. 20
Figure 3. Principaux motifs de mortalité, 2009-2019 .............................................................. 20
Figure 4. Principaux motifs d’invalidité, 2009-2019 ................................................................ 21
Figure 5. Mortalité maternelle et infanto-juvénile, 2010-2020 ............................................... 22
Figure 6. Espérance de vie à la naissance, 2010-2020 ............................................................. 22
Figure 7. Indice de la CSU, 2010-2019 ...................................................................................... 22
Figure 8. Indicateurs épidémiologiques clés du VIH/sida et du paludisme, 2010-2021 .......... 22
Figure 9. Indicateurs épidémiologiques clés de la tuberculose et de la malnutrition, 2010-2021
.................................................................................................................................................. 22
Figure 10. Taux d’accouchements assistés et taux de prévalence de la contraception moderne,
2010-2018 ................................................................................................................................ 22
Figure 11. Dépenses totales et publiques de santé, 2013-2020 .............................................. 23
Figure 12. Paiements directs en pourcentage des dépenses totales de santé, 2013-2020 .... 23
Figure 13. Dépenses totales et publiques allouées au renforcement des soins de santé
primaires, 2016-2019 ............................................................................................................... 24
Figure 14. Cadre d’analyse du marché du travail de la santé et des leviers politiques pour
l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle ..................................................................... 26
Figure 15. Nombre total de diplômés, 2017-2021 ................................................................... 32
Figure 16. Distribution des diplômés selon le lieu et le type d’établissement de formation,
2017-2021 ................................................................................................................................ 32
Figure 17. Nombre de diplômés issus des formations en médecine et en infirmerie, 2017-2021
.................................................................................................................................................. 33
Figure 18. Nombre de diplômés issus des formations de sages-femmes et pharmaciens, 2017-
2021 .......................................................................................................................................... 33
Figure 19. Nombre de diplômés issus des formations de techniciens de santé, 2017-2021 .. 33
Figure 20. Distribution des diplômés en santé de Nationalité Malienne formés à l'étranger
selon la région de formation .................................................................................................... 34
Figure 21. Distribution des diplômés en santé de Nationalité Malienne formés à l'étranger
selon le pays de formation ....................................................................................................... 34
 |
14 14 |
▲back to top |
14
Figure 22. Distribution des diplômés en santé de Nationalité Malienne formés à l'étranger
selon la source de financement ............................................................................................... 34
Figure 23. Taux moyen de réussite des étudiants et élèves issus des établissements de
formation en santé ................................................................................................................... 35
Figure 24. Taux moyen de réussite par filière et catégorie d’établissements de formation ... 35
Figure 25. Taux de réussite aux examens de fin d’année par cycle de formation, 2019-2021 36
Figure 26. Taux de réussite aux examens de fin d’année établissement de formation, 2017-
2021 .......................................................................................................................................... 36
Figure 27. Disponibilité des personnels de santé, 2016-2022 ................................................. 37
Figure 28. Disponibilité des médecins, infirmiers et sages-femmes, 2016-2022 .................... 37
Figure 29. Densité des personnels de santé selon la catégorie professionnelle, 2016-2022 .. 37
Figure 30. Densités régionales des agents de santé communautaires .................................... 39
Figure 31. Distribution des personnels de santé selon la catégorie professionnelle, 2022 .... 40
Figure 32. Distribution des personnels de santé selon le secteur et le régime d'exercice, 2022
.................................................................................................................................................. 40
Figure 33. Distribution des personnels de santé selon le genre, 2022 .................................... 40
Figure 34. Pyramide des âges des personnels de santé du secteur privé, 2022 ..................... 41
Figure 35. Pyramide des âges des personnels de santé du secteur public, 2022 .................... 41
Figure 36. Indice d’Équité Géographique des personnels de santé, 2022 .............................. 43
Figure 37. Indice d’équité géographique médian par catégorie professionnelle, 2022 .......... 45
Figure 38. Distribution régionale des établissements privés de formation, 2022 ................... 46
Figure 39. Nombre de personnels de santé par établissement de santé, selon les piliers de la
pyramide sanitaire, 2022 ......................................................................................................... 47
Figure 40. Taux d’attrition des personnels de santé selon le secteur d’exercice, 2016-2021 . 48
Figure 41. Distribution du nombre de personnels de santé sujets à l’attrition par motif, 2016-
2021 .......................................................................................................................................... 49
Figure 42. Projections de l’offre en personnels de santé, 2023-2030 ..................................... 50
Figure 43. Nombre total de recrutements, 2016-2022 ............................................................ 52
Figure 44. Nombre de recrutements réalisés par les secteurs public et privé, 2016-2022 ..... 52
Figure 45. Distribution des recrutements selon le secteur d'exercice .................................... 53
Figure 46. Distribution des recrutements selon le régime d'emploi, 2016-2022 .................... 53
 |
15 15 |
▲back to top |
15
Figure 47. Distribution des recrutements selon la catégorie professionnelle ......................... 53
Figure 48. Nombre total d’emplois nets crées au profit de l’ensemble des personnels de santé,
2016-2022 ................................................................................................................................ 54
Figure 49. Nombre d’emplois nets crées, répartis selon le secteur d’exercice, 2016-2022 .... 54
Figure 50. Taux d’absorption des diplômés issus des formations en santé ............................ 56
Figure 51. Répartition des diplômés absorbés par secteur d’exercice, 2016-2021................. 56
Figure 52. Représentation des femmes dans la distribution des diplômés et des personnels de
santé ......................................................................................................................................... 57
Figure 53. Dépenses publiques courantes totales en milliards de Fcfa, 2016-2021 ............... 58
Figure 54. Financement public domestique dédié aux agents de la fonction publique et aux
personnels de santé, 2016-2021 .............................................................................................. 58
Figure 55. Enveloppes des dépenses publiques courantes ventilées en faveur de la santé et
des personnels de santé, 2016-2021 ....................................................................................... 60
Figure 56. Priorisation budgétaire en faveur de la santé et des personnels de santé, 2016-2021
.................................................................................................................................................. 60
Figure 57. Décomposition simple et évolutive des dépenses publiques courantes liquidées en
faveur des personnels de santé, 2016-2021 ............................................................................ 62
Figure 58. Dépenses publiques liquidées en faveur de la santé et des personnels de santé,
2016-2021 ................................................................................................................................ 62
Figure 59. Taux réel d’exécution des dépenses dédiées aux personnels de santé, 2016-2021
.................................................................................................................................................. 63
Figure 60. Demande économique et le coût financier de l’offre en matière de personnels de
santé, 2023-2027 ...................................................................................................................... 64
LISTES DES ANNEXES
Annexe 1. Liste des données secondaires collectées............................................................... 78
Annexe 2. Liste des données primaires collectées .................................................................. 80
Annexe 3. Liste des données non collectées ............................................................................ 82
Annexe 4. Note méthodologique d’estimation des projections de l’offre des personnels de
santé ......................................................................................................................................... 84
Annexe 5. Note méthodologique relative à l’analyse de décomposition du financement public
des personnels de santé ........................................................................................................... 87
 |
16 16 |
▲back to top |
16
Annexe 6. Détails sur les projections de la demande économique et le coût financier de l’offre
en matière de personnels de santé .......................................................................................... 90
 |
17 17 |
▲back to top |
17
Sigles et abréviations
AESD Agents d’Entretien, de Sécurité et de Déplacement
AVC Accident Vasculaire Cérébral
ASC Agents de Santé Communautaire
CEDEAO Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest
CNCFP Centre National des Concours de la Fonction Publique
CNECE Centre National des Examens et Concours de l’Éducation
CNOS Centre National d’Odonto Stomatologie
CPS Cellule de Planification et Statistique
CSCOM Centre de Santé Communautaire
CSRéf Centre de Santé de Référence
CSU Couverture Sanitaire Universelle
CREDD Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable
DGESRS Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
DNFCT Direction Nationale de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales
DNFPP Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel
DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement
DPBEP Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel
DRH Direction des Ressources Humaines
FMI Fonds Monétaire International
HTA Hypertension Artérielle
IEG Indice d’Équité Géographique
IHME Institute for Health Metrics and Evaluation
INFSS Institut National de Formation en Sciences de la Santé
IOTA Institut National d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique
IRA Infections Respiratoires Aigues
OOAS Organisation Ouest Africaine de la Santé
ODD Objectifs de Développement Durable
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
OMS Organisation Mondiale de la Santé
PA Personnels d’Appui
PDDSS Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social
Pers.Adm Personnels administratif
PIB Produit Intérieur Brut
PRODESS Programme de Développement Socio-Sanitaire
PTF Partenaires Techniques et Financiers
QR Question de Recherche
RHS Ressources Humaines de la Santé
SIDA Syndrome de l’Immunodéficience Humaine
TS Techniciens de Santé
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
 |
18 18 |
▲back to top |
18
1. Profil sanitaire et épidémiologique
1.1. Organisation du système de santé
Le système de santé Malien est organisé sous une forme pyramidale à trois niveaux (Figure 1)
- Au niveau administratif : (i) Le niveau central définit les orientations stratégiques et
détermine les investissements et le fonctionnement du système. En outre, il définit les
critères d’efficience, d’équité et de viabilité. Il veille à l’application des normes et
standards. Il s’efforce de mobiliser les ressources auprès de l’État, des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) et du Secteur privé pour le financement des soins de
qualité accessibles à tous ; (ii) Le niveau régional /intermédiaire assure l’appui
technique au niveau opérationnel ; (iii) le niveau District ou niveau opérationnel où
l’Équipe Cadre de District assure l’appui technique aux CSCOM.
Sur le plan technique : (i) Le premier niveau de contact est représenté par les
CSCOM. Certains villages dans les aires de santé disposent de maternités rurales
tenues par des matrones ; (ii) le premier niveau de référence est constitué des Centres
de Santé de Référence (CSRéf) ou Hôpitaux de District. Ils disposent d’un plateau
technique permettant d’assurer la prise en charge des soins chirurgicaux et gynéco-
obstétricaux d’urgence tels que les césariennes ; (iii) le second niveau de référence est
constitué des Établissements Publics Hospitaliers régionaux, au nombre de sept
(Kayes, Kati, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou) et l’Hôpital Mère-Enfant
implanté dans le District de Bamako, (iv) le troisième niveau de référence comprend
les Établissements Publics Hospitaliers Universitaires et Spécialisés avec un plateau
technique à vocation générale (Hôpital du Point G, Hôpital Gabriel Touré, Hôpital du
Mali, Hôpital de Kati Centre d’Excellence de traumatologie orthopédique, Institut
d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique-IOTA, Centre d’Odonto- Stomatologie-CNOS,
Hôpital de Dermatologie de Bamako, et de la Clinique Périnatale Mohamed VI de
Sébénikoro).
A côté du système public s’implantent : (i) un secteur sanitaire privé à but lucratif et non
lucratif, autorisé depuis 1985, dans les domaines notamment médical, paramédical,
pharmaceutique et traditionnel ; (ii) des services de santé de l’Armée composés de postes
médicaux, d’infirmeries, de maternités de garnison et d’infirmeries-hôpitaux ; (iii) des services
confessionnels de santé des organisations religieuses qui complètent partout l’offre de
services de soins de santé sur l’ensemble du territoire national ; (iv) une médecine
traditionnelle riche et variée, qui est présente dans les quartiers des villes et dans tous les
villages. Elle constitue le premier recours aux soins pour la majorité de la population. En 2011
on dénombrait 20 structures. On constate que dans 31% des cas, les malades sont allés cueillir
des plantes pour se soigner.
 |
19 19 |
▲back to top |
19
Figure 1. Pyramide sanitaire au Mali
Source : Représentation schématique des informations exploitées dans le PRODESS IV.
S’agissant des personnels de santé, ils sont regroupés en deux secteurs à savoir le secteur
privé et le secteur public regroupant les personnels : i) de la fonction publique de l’État, et, ii)
de la fonction publique des Collectivités Territoriales et de l’Armée. Le secteur privé regroupe,
dans la majorité, des contractuels tandis que le secteur public est composé de fonctionnaires
et de contractuels. En sus de ces secteurs, existent les ONG qui recrutent bien souvent des
personnels de santé dans l’optique de fournir des services de santé, de planification, voire
administratifs. Ces catégories de personnels peuvent être inclues parmi ceux du secteur privé.
 |
20 20 |
▲back to top |
20
1.2. Performance du secteur de la santé
1.2.1. Charge de morbidité et de mortalité
Le Mali fait face à une transition épidémiologique incomplète, caractérisée par une double
charge de mortalité, incluant notamment l’émergence progressive des maladies non
transmissibles et la persistance des maladies transmissibles.
En 2019, 60,3% des décès provenaient des maladies transmissibles ainsi que les conditions
maternelles, prénatales et nutritionnelles, contre une proportion estimée à 63,3% en 2015.
Les principales maladies concernées sont les troubles néonataux, le paludisme, les diarrhées,
les infections respiratoires aigües (IRA) et la malnutrition. Le pourcentage de décès causés par
les maladies non transmissibles a augmenté de 28,2% à 30,3% entre 2015-2019. Parmi ces
maladies non transmissibles figurent les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les
cardiopathies ischémiques et les défauts congénitaux, pour lesquels la charge de mortalité a
connu une hausse estimée respectivement à 27,2%, 32,6% et 29,2% entre 2009 et 2019
(Figures 2 et 3).
Figure 2. Répartition des décès par catégorie de
maladies, 2015-2019
Figure 3. Principaux motifs de mortalité, 2009-2019
Source: World Development Indicators, Banque Mondiale. Source : IHME (30 Décembre 2012) (version originale en anglais) disponible au
lien suivant https://www.healthdata.org/mali
L’invalidité au Mali provient principalement des risques environnementaux et
comportementaux : Au cours de la période 2009-2019, les principaux facteurs d’invalidité au
63,3% 60,3%
28,2% 30,3%
8,5% 9,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2019
Autres causes
Maladies non transmissibles
Maladies transmissibles et les conditions maternelles,
prénatales et nutritionnelles
 |
21 21 |
▲back to top |
21
Mali ont été : la malnutrition, la pollution de l’air, la qualité de l’assainissement, les rapports
sexuels à risques et l’hypertension artérielle (HTA) (Figure 4).
Figure 4. Principaux motifs d’invalidité, 2009-2019
Source : IHME (30 Décembre 2012) (version originale en anglais) disponible au lien suivant
https://www.healthdata.org/mali
1.2.2. Évolution des indicateurs clés de résultats de santé
Les indicateurs de santé se sont améliorés au cours de ces dernières années au Mali, à
l’exception de la prévalence de la sous-nutrition.
Le ratio de mortalité maternelle est passé de 660 à 562 décès pour 100 000 naissances
vivantes entre 2010 et 2017 tandis que le taux de mortalité infanto-juvénile a varié de 130,3
à 91 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 2010 et 2020 (Figure 5). Au cours de la
période 2010-2020, l’espérance de vie a augmenté légèrement de 56,4 à 58,6 ans, soit un
écart estimé à environ deux années (Figure 6). L’indice de Couverture Sanitaire Universelle
(CSU) a connu un accroissement, passant de 36 en 2010 à 42 en 2019 (Figure 7). La prévalence
du VIH/sida reste faible et s’est progressivement réduite au fil des années. En effet, entre 2010
et 2021, elle est passée de 1,2 à 0,8 personnes infectées pour 100 habitants âgés de 15 à 49
ans. Au cours de la période 2010-2020, l’incidence du paludisme a baissé de 383,6 à 357,5
nouveaux cas pour 100 000 personnes à risque tandis que celle associée à la tuberculose a
varié de 63 à 50 nouveaux cas pour 100 000 personnes. Le taux de prévalence de la sous-
nutrition a augmenté de 5,8% à 9,8% entre 2010 et 2020 (Figures 8 et 9). Le taux
 |
22 22 |
▲back to top |
22
d’accouchements assistés était de 67,3% en 2018 contre une proportion de 28,1% estimée en
2010. Le taux de prévalence de la contraception moderne est passé de 9% à 16,4% au cours
de la période 2010-2018 (Figure 10).
Figure 5. Mortalité maternelle et
infanto-juvénile, 2010-2020
Figure 6. Espérance de vie à la
naissance, 2010-2020
Figure 7. Indice de la CSU, 2010-
2019
Figure 8. Indicateurs
épidémiologiques clés du VIH/sida et
du paludisme, 2010-2021
Figure 9. Indicateurs
épidémiologiques clés de la
tuberculose et de la malnutrition,
2010-2021
Figure 10. Taux d’accouchements
assistés et taux de prévalence de la
contraception moderne, 2010-2018
Source: World Development Indicators, Banque Mondiale.
0
20
40
60
80
100
120
140
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ratio de mortalité maternelle pour
100,000 naissances vivantes (axe
gauche)
Taux de mortalité infanto-juvénile
pour 1 000 naissances vivantes (axe
droit)
56
57
57
58
58
59
59
60
60
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2010 2015 2017 2019
200
250
300
350
400
450
500
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
Taux de prévalence du VIH/sida
pour 100 personnes âgées de 15 à
49 ans (axe gauche)
Taux d'incidence de paludisme pour
100 000 personnes à risque (axe
droit)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
10
20
30
40
50
60
70
2
0
1
0
2
0
1
2
2
0
1
4
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
2
0
Taux d'incidence de la tuberculose
pour 100 000 personnes (axe
gauche)
Prévalence de la sous-nutrition
(axe droit)
5
7
9
11
13
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2010 2013 2015 2018
Taux d'accouchements assistés
(axe gauche)
Taux de prévalence de la
contraception moderne (axe
droit)
 |
23 23 |
▲back to top |
23
1.2.3. Situation du financement de la santé
Le financement de la santé s’est accru mais reste cependant insuffisant pour atteindre les
objectifs de développement sanitaire au Mali. Les dépenses totales de santé ont été estimées
à 35,5 dollars par habitant en 2020 contre 32,8 en 2013. En dépit de l’augmentation de ces
dépenses, elles restent tout de même faibles au regard du seuil minimal de 112 dollars requis
pour les pays à revenu faible pour atteindre la Couverture Sanitaire Universelle à l’horizon
2030 (Stenberg et al., 2017). Quant aux dépenses publiques de santé, elles ont augmenté de
0,8% à 1,15% du PIB entre 2013 et 2020 ; la proportion toujours faible par rapport à celle
estimée à 5% et suggérée au pays en développement pour fournir un paquet essentiel de
services de santé (McIntyre et al., 2017) (Figure 11).
La contribution des ménages au financement de la santé, à travers les paiements, a connu
une tendance à la baisse mais reste toujours conséquente. Il existe ainsi des risques
potentiels de catastrophes financières et de pauvreté chez les ménages. Au cours de la
période 2013-2020, les paiements directs ont baissé de 32,8% à 28,7% des dépenses totales
de santé, proportion restant au-dessus du seuil de 20% au-delà duquel, les ménages risquent
d’encourir des catastrophes financières et de pauvreté (Chatham House, 2004) (Figure 12).
Figure 11. Dépenses totales et publiques de santé,
2013-2020
Figure 12. Paiements directs en pourcentage des
dépenses totales de santé, 2013-2020
Source: Global Health Expenditure Database, OMS.
Les soins de santé primaires sont considérés comme une des priorités majeures de santé
publique au Mali. En 2020, 76,2% des dépenses courantes de santé et 74,4% des dépenses
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
25
27
29
31
33
35
37
39
41
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses totales de santé par habitant dollars (axe
gauche)
Dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB
(axe droit) 27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 |
24 24 |
▲back to top |
24
publiques de santé ont été alloués au renforcement des soins de santé primaires, contre des
proportions respectivement estimées à 82,5% et 69,8% en 2016 (Figure 13).
Figure 13. Dépenses totales et publiques allouées au
renforcement des soins de santé primaires, 2016-2019
Source: Global Health Expenditure Database, OMS.
2. Cadrage de l’étude
2.1. Contexte de l’étude
La problématique internationale des personnels de la Santé
Les Ressources Humaines de la Santé constituent la pierre angulaire de tout système de santé.
La satisfaction de la demande mondiale et des besoins croissants en personnels de santé au
cours des quinze prochaines années ainsi que l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle
(CSU) et plus généralement des Objectifs de Développement Durables de la Santé (ODD 31), à
l’horizon 2030 nécessite des actions ambitieuses et urgentes dans le secteur de la santé.
Dans cette optique, la Commission de Haut niveau sur l’Emploi en Santé et la Croissance
Économique, a été créée en 2016en vue de réfléchir et de formuler des propositions d’actions
à l’égard des pays, visant à soutenir la création d’emplois dans les secteurs sociaux,
notamment de la santé, cette création d’emploi étant considérée comme un levier important
d’intervention en faveur de la croissance économique et inclusive. Les recommandations ont
essentiellement été articulées autour des priorités suivantes : i) stimuler les investissements
dans la création d’emplois décents et motivants dans le secteur de la santé, surtout au profit
des femmes et des jeunes, à travers une mobilisation accrue des ressources et un
renforcement de la collaboration multisectorielle et de la coopération internationale, ii)
développer la formation initiale et continue de qualité pour un changement de
comportements et de pratiques, iii) réformer les modèles de services axés sur la prévention
et le renforcement des soins de santé primaires, iv) garantir la protection et la sécurité de tous
1 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
8
2
,5
%
6
9
,8
%
7
6
,3
%
7
4
,4
%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
Dépenses totales allouées aux SSP
en pourcentage des dépenses
courantes de santé
Dépenses publiques allouées aux
SSP en pourcentage des dépenses
publiques de santé
2016 2019
 |
25 25 |
▲back to top |
25
les agents et des établissements de santé dans tous les contextes et, v) entreprendre des
recherches et analyses approfondies sur le marché de l’emploi dans le secteur de la santé.
En outre, la stratégie 2030 des Ressources Humaines de la Santé formulée par l’OMS a mis en
évidence l’intérêt de renforcer la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité, la couverture et
la qualité des personnels de santé à travers un accroissement des investissements propres ;
l’objectif étant de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des politiques nationales
de renforcement des systèmes de santé et de progresser plus rapidement vers la Couverture
Sanitaire Universelle.
Les Ressources Humaines au cœur du programme de développement socio-sanitaire au Mali
Dans une perspective de continuité de la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement
Sanitaire et Social (PDDSS, 2014-2023), défini dans le Cadre Stratégique pour la Relance
Économique et le Développement Durable (CREDD), et dans l’optique de prendre en compte
les résultats de l’évaluation à mi-parcours du Programme de Développement Socio-Sanitaire
(PRODESS III, 2014-2018), la République du Mali s’est engagée à travers le PRODESS IV à
améliorer l’état de santé de la population en mettant l’accent sur l’accès universel aux soins
de santé de qualité, géographiquement et financièrement accessibles. Parmi les axes
d’interventions prioritaires de sa composante « santé » figure le développement des
Ressources Humaines de la Santé et d’autres champs d’actions impliquant le rôle des
personnels de santé. Ce sont : i) le renforcement des soins de santé primaires et de la lutte
contre les maladies, ii) le renforcement des soins hospitaliers et de recherche, iii)
l’amélioration de la disponibilité et de l’accès aux médicaments, vaccins, consommables
médicaux et produits de santé, iv) l’amélioration de la gouvernance à travers une meilleure
administration du secteur , une coordination renforcée entre les acteurs et une
décentralisation de la gestion du système de santé, v) le renforcement du financement de la
santé, y compris l’accroissement des ressources et des allocations alignées aux défis
prioritaires du système de santé et, vi) le renforcement du système d’information sanitaire.
2.2. Justification de l’étude
Au Mali, les principaux défis à relever pour le développement des Ressources Humaines de la
Santé sont les suivants :
Renforcer la disponibilité et la répartition géographique des personnels de santé ;
Optimiser les Ressources Humaines de la Santé pour une meilleure absorption et une
réduction du chômage à travers des stratégies de rationalisation de la formation
initiale et de régulation des recrutements ;
Renforcer l’efficacité et la qualité de la formation continue ;
Renforcer les mécanismes de motivation et de fidélisation des personnels de santé.
 |
26 26 |
▲back to top |
26
Au regard de ces défis et compte tenu de l’arrivée à échéance de la Politique de
Développement des Ressources Humaines du secteur de la santé, du développement social et
de la promotion de la famille, assortie de son plan d’action stratégique intégré (2019-2023),
le Ministère de la Santé et du Développement Social, à travers sa Direction des Ressources
Humaines (DRH) et sa Cellule de Planification et Statistique (CPS), a pris l’initiative de conduire
cette étude, afin de mieux comprendre la dynamique du marché du travail dans le secteur de
la santé. Il a été convenu de conduire cette étude en deux phases. La première phase faisant
l’objet de ce rapport a pour objet de répertorier l’ensemble des goulots d’étranglement
inhibant le fonctionnement harmonieux du marché du travail. A l’issue de cette étape, il est
prévu de poursuivre les investigations au cours d’une seconde phase afin d’identifier les
principales causes des goulots d’étranglement recensés et de définir des actions et
orientations stratégiques sur lesquelles portera le prochain plan de développement des
Ressources Humaines de la Santé.
2.3. Cadre conceptuel de l’analyse du marché du travail de la santé
L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé est un processus itératif qui s’appuie
généralement du cadre conceptuel de Sousa et al., (2013) (Figure 14).
Figure 14. Cadre d’analyse du marché du travail de la santé et des leviers politiques pour
l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle
Source: Adapté de Sousa et al., (2013).
Il s’agit d’une représentation schématique des interactions entre un secteur éducatif censé
produire des ressources humaines et un système de santé disposé à utiliser les compétences
qui en sont produites. En d’autres termes, le cadre conceptuel met en évidence le processus
à travers lequel les ressources humaines e la santé sont produites ainsi que la dynamique à
travers laquelle elles arrivent à intégrer le marché du travail, doté des aptitudes suivantes. Les
personnels de santé doivent être dotés des aptitudes suivantes : la disponibilité, l’accessibilité,
 |
27 27 |
▲back to top |
27
l’acceptabilité et la qualité des soins produites. Ces différentes aptitudes requises pour les
ressources humaines en santé, dépendent des politiques de formation, des politiques
migratoires dans le pays, des stratégies d’insertion professionnelle, ainsi que de la motivation,
de la répartition et de la gestion des carrières des professionnels de santé.
2.4. Questions de recherche
Les questions clés auxquelles l’étude du marché du travail dans le secteur de la santé visent à
répondre ont été définies en cohérence avec les défis des personnels de santé. Elles
regroupent une question stratégique à partir de laquelle ont été définies des questions de
recherche d’ordre descriptif et analytique (Tableau 1)
Tableau 1. Liste des questions clés de l’étude
Question stratégique : quels sont les principaux leviers stratégiques à actionner dans le but de permettre au Mali de fournir
des personnels de santé en quantité et en qualité suffisante, répartis harmonieusement et en fonction des besoins prioritaires
du système de santé, et satisfaits de leurs conditions de vie et de travail ?
Questions de recherche d’ordre descriptif Questions de recherche d’ordre analytique
- La production des personnels de santé s’est-elle accrue au
cours de ces dernières années ?
- Quelles sont les destinations les plus prisées et les
principales sources de financement de la formation en
santé à l’étranger dans le secteur de la santé ?
- Les performances académiques des étudiants et élèves
issus des formations en santé ont-elles connu une
amélioration au cours de ces dernières années ?
- Quelle est la composition des personnels de santé ?
- L’attrition des personnels de santé est-elle accrue ? Quels
sont les principaux motifs à l’origine de cette attrition ?
- Les recrutements ont-ils augmenté au cours de ces
dernières années ?
- Les emplois crées ont-ils augmenté au cours de ces
dernières années ?
- Les personnels de santé sont-ils et seront-ils
suffisamment disponibles pour couvrir les besoins requis
à l’atteinte des objectifs de développement sanitaire ?
- Les personnels de santé sont-ils égalitairement et
équitablement répartis ?
- La demande réagit-elle favorablement à l’offre entrante
de personnels de santé sur le marché du travail de la santé
?
- Le financement public des personnels de santé s’est-il
accru au cours de ces dernières années ? Quels sont les
principaux facteurs à l’origine de la dynamique
d’évolution de ce financement ?
- Le gouvernement disposera-t-il d’une capacité budgétaire
suffisante pour financer les coûts de l’offre attendue en
matière de personnels de santé ?
2.5. Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette première phase de l’étude est d’analyser la situation du marché
du travail dans le secteur de la santé au Mali. Les objectifs spécifiques sous-adjacents sont les
suivants :
- Analyser l’offre sur le marché du travail de la santé à travers la production, la
disponibilité, la distribution ainsi que l’attrition des personnels de santé ;
- Estimer et apprécier les projections de l’offre en matière de personnels de santé ;
 |
28 28 |
▲back to top |
28
- Analyser la demande à travers les recrutements ;
- Analyser le niveau de désalignement entre l’offre et la demande en matière de
personnels de santé ;
- Analyser la dynamique d’évolution des financements publics destinés aux personnels
de santé ainsi que leurs principaux déterminants ;
- Analyser la capacité budgétaire du Gouvernement à financer les coûts inhérents à
l’offre attendue des personnels de santé.
2.6. Approches méthodologiques
2.6.1. Principales étapes de l’étude
Cette étude a débuté par un atelier organisé le 16 Mars 2022 à Bamako. Cet atelier avait pour
objet de sensibiliser les parties prenantes sur l’intérêt, les objectifs et les principales étapes
d’une étude du marché du travail dans le secteur de la santé. Il a aussi permis d’identifier les
besoins et défis du pays en matière de développement sanitaire et des Ressources Humaines
de la Santé, à partir desquels ont été définies les principales questions clés auxquelles devrait
répondre cette étude. Il s’en est suivie la phase d’élaboration du protocole de l’étude ayant
principalement permis d’identifier les données à collecter, assorties de leurs sources. A l’issue
de cette phase, l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) a été retenu
afin d’élaborer les différents outils de collecte de données et de conduire tant la collecte que
l’analyse des données. Après recrutement de l’ONEF, une collecte préliminaire des données a
été entamée à l’issue de laquelle a été tenu un second atelier de suivi à mi-parcours, organisé
le 05 Août 2022 à Bamako. Cet atelier a permis non seulement de présenter les premières
données collectées mais aussi de définir avec la collaboration des parties prenantes des
actions visant à pallier les différentes contraintes rencontrées au cours de la première étape
de collecte des données. Ensuite, la collecte des données a été poursuivie, à l’issue de laquelle
les données ont été analysées en vue de la rédaction du rapport de l’étude.
2.6.2. Collecte, compilation et analyse des données
2.6.2.1. Méthodes de collecte des données
Deux principales approches ont été utilisées dans le cadre de la collecte des données sur les
personnels de santé. Il s’agit en premier lieu d’une exploitation de bases nationales de
données secondaires sur les personnels de santé, orientées vers les professionnels de santé
du secteur public et collectées auprès de la Direction Nationale de la Fonction Publique des
Collectivités Territoriales (DNFCT), de la Direction Nationale de la Fonction Publique et du
Personnel (DNFPP), du Centre National des Concours de la Fonction Publique (CNCFP), du
Centre National des Examens et Concours de l'Education (CNECE), de la Direction Générale
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DGESRS) et de la Direction
Nationale de la Planification du Développement (DNPD). La collecte des données secondaires
 |
29 29 |
▲back to top |
29
a été assortie d’une exploitation de bases de données internationales (World Economic
Outlook, FMI, World Development Indicator, Banque Mondiale, Global Health Expenditure
Database, OMS, Global Burden of Disease, IHME) et d’une revue documentaire
essentiellement basée sur la question du financement des personnels de santé (rapports sur
la situation de l’exécution du budget, documents de programmation budgétaire et
économique pluriannuel).
La seconde approche a porté sur une collecte de données primaires relatives aux personnels
de santé du secteur privé, y compris principalement des contractuels. Cette seconde collecte
a aussi été l’occasion de compléter les données secondaires existantes au niveau du secteur
public. Ces données ont été collectées auprès des structures de santé et des établissements
de formation.
Les données collectées ont essentiellement porté sur les thématiques suivantes : i) la
disponibilité du personnel de santé, ii) la production et les recrutements du personnel de
santé, l’attrition et le financement des professionnels de santé.
2.6.2.2. Principales étapes de la collecte des données
La collecte des données a été facilitée à travers l’implication de la Cellule de Planification et
de Statistique du secteur de la santé, de la Direction des Ressources Humaines de la Santé,
des ordres professionnels, notamment : l’Ordre des pharmaciens, l’Ordre des médecins,
l’Ordre des infirmières et infirmiers, l’Ordre des chirurgiens-dentistes, l’Ordre des sages-
femmes. Particulièrement dans le cadre de la collecte des données primaires, chacun de ces
ordres a mis à la disposition de l’ONEF une lettre d’instruction des agents enquêteurs afin de
faciliter leur prise de contact avec les structures de santé à enquêter.
- Données secondaires : comme indiqué ci-dessus, un protocole de l’étude a été élaboré
et a permis de lister les variables à collecter, assorties de leurs sources ainsi que les
indicateurs à construire. Par la suite, des correspondances ont été adressées aux
principales structures publiques, les sollicitant de mettre à la disposition de l’ONEF, le
répertoire du personnel de santé émargeant sur le budget de l’État et des Collectivités
Territoriales. Cette phase a pris plus de temps compte tenu des lourdeurs
administratives. Après une série de relances à titre de suivi, les bases données ont été
transmises sous un format Excel, dont la liste est reportée au sein de la section
« Référence ».
- Données primaires : à partir de la liste des données à collecter mentionnées dans le
protocole de l’étude, des fiches de collecte ont été élaborées et adressées aux
structures privées de santé et des établissements de formation en santé. La collecte a
couvert les districts sanitaires des dix régions du Mali en sus de celui de Bamako. Les
enquêteurs ont été par la suite formés (renforcement de capacités) au remplissage de
ces fiches sur l’outil « KoBoCollect ». Il s’en est suivi un pré-test (du 27 au 29 juillet
 |
30 30 |
▲back to top |
30
2022) ayant permis d’ajuster les questions qui s’y trouvent. Suite à ce pré-test, les
enquêteurs ont été déployés sur le terrain afin de collecter les données.
2.6.2.3. Qualité et compilation des données
Les bases de données étaient de tailles d’échantillon différentes avec des taux moyens et
médians de complétude allant respectivement de 85,9% à 100% et de 99,9% à 100% en ce qui
concerne les données secondaires et de 85,7% à 96,9% et de 100% s’agissant des données
primaires (Tableau 2). Une description plus détaillée des données collectées est reportée en
Annexes 1 et 2.
Les données collectées ont été compilées et analysées à partir de trois outils à savoir : Excel,
STATA et SPSS.
Tableau 2. Taux de complétude des données collectées
Type de
données
Base de données
Nombre
de
variables
Taille des
échantillons
Source
Statistiques clés des taux de complétude
Moyenne
Écart
type
Médiane Min Max
Données
secondaires
Situation des personnels de
santé des Collectivités
Territoriales
18 3 614 DNFCT 94,6% 0,123 100% 59% 100%
Situation des personnels de
santé en activité de la
fonction publique de l’État
19 6 173 DNFPP 85,9% 0,270 99,9% 17,9% 100%
Situation des étudiants
formés à l’extérieur
12 654 DNPD 93,8% 0,160 100% 46,9% 100%
Situation des recrutements
des personnels de santé de
la fonction publique de
l’État
11 947 CNCFP 100% 0 100% 100% 100%
Situation des finalistes de
l’examen de fin de cycle des
écoles de formation en
santé
14 29 949 CNECE 97,6% 0,088 100% 66,9% 100%
Données
primaires
Situation des personnels de
santé répertoriés par les
structures de santé
29 7 621
Structures
privées et
publiques de
santé
85,7% 0,298 100% 5% 100%
Situation des étudiants et
élèves formés
25 1302
Établissements
privés et publics
de formation
96,9% 0,075 100% 72,4% 100%
Situation des étudiants et
élèves en cours de
formation
25 2903
Établissements
privés et publics
de formation
83,9% 0,314 100% 3,5% 100%
2 Cet échantillon porte sur le nombre d’établissements de formation enquêtés.
3 Cet échantillon porte sur le nombre d’établissements de formation enquêtés
 |
31 31 |
▲back to top |
31
2.6.2.4. Contraintes rencontrées et limites de l’étude
En dépit de l’implication de l’ensemble des parties prenantes et notamment des ordres des
professionnels de santé dans le processus de collecte des données, quelques cas de refus ont
été notifiés de la part de certaines officines, des pharmacies, cabinet et cliniques privées. De
plus la collecte de données sur le terrain coïncidait avec la période de vacances au cours de
laquelle les établissements de formation en santé étaient fermés. Ainsi, les informations
collectées sur la production des personnels ne sont pas totalement exhaustives.
Par ailleurs, certaines données n’ont pas pu être renseignées. Elles portent notamment sur :
i) la situation des personnels de santé de l’Armée, ii) la migration des personnels de santé et,
iii) certaines données relatives à la demande (nombre de postes établis, financés et vacants),
à la rémunération (salaires et primes) et à la production (nombre d’étudiants et élèves entrant
chaque année dans le cursus de formation en santé) des personnels de santé.
En outre, il était prévu au départ de cette étude d’estimer les besoins en personnels de santé
en prenant en compte le contexte épidémiologique du pays et la charge de travail incombant
aux personnels de santé. Toutefois, à ce stade, les données disponibles n’ont pas permis de
réaliser cet exercice à bon escient.
La liste des données manquantes et non collectées est reportée en Annexe 3.
3. Situation du marché du travail
3.1. Offre des Ressources Humaines de la Santé
3.1.1. Le secteur de l’éducation des agents de santé : analyse de la formation
3.1.1.1. Production des diplômés issus des formations en santé
La production des diplômés issus des formations en santé s’est accrue au cours de ces
dernières années. Ils ont été en majorité formés au Mali et plus précisément par les
établissements privés de santé.
Entre 2017 et 2021, le nombre total de diplômés est passé de 4 268 à 8 338, soit une hausse
annuelle de 14,3%. Le nombre de diplômés formés au Mali a varié de 4 124 à 8 277, soit une
augmentation de 15%, et représentant respectivement 96,6 % et 99,3% du total des
personnels de santé produits et disponibles sur le marché du travail de la santé.
En 2017, la production domestique (au Mali) des personnels de santé comptait 3 531 et 593
diplômés respectivement formés par les établissements privés et publics de formation,
représentant respectivement 82,7% et 13,9% du total des personnels de santé produits et
disponibles sur le marché du travail de la santé. En 2021, ces proportions ont été
respectivement estimées à 80,8% et 18,5%, représentant respectivement 6 733 et 1 544
diplômés formés par les établissements privés et publics de formation. Ainsi, le nombre de
diplômés issus des établissements privés et publics de formation ont respectivement
 |
32 32 |
▲back to top |
32
augmenté de 13,8% et 21,1% par an. Ces tendances haussières attestent que même si le
secteur privé reste le principal offreur de diplômés sur le marché du travail de la santé, l’État
entreprend des efforts en vue d’accroitre progressivement sa contribution à la production des
personnels de santé. Le nombre de diplômés formés à l’extérieur a connu une décroissance
depuis ces dernières années, variant de 144 à 61 étudiants/élèves entre 2017 et 2021, soit
une baisse de 15,8% par an, et représentant respectivement 3,4% et 2% du total des diplômés
produits et disponibles sur le marché du travail de la santé (Figures 15 et 16).
Figure 15. Nombre total de diplômés, 2017-2021 Figure 16. Distribution des diplômés selon le lieu et le
type d’établissement de formation, 2017-2021
Source : Données collectées auprès de la DNPD et des établissements de formation.
La production des diplômés a augmenté pour toutes les filières de formation, avec une
tendance plus prononcée chez les étudiants issus des formations en médecine et en
pharmacie. Depuis ces dernières années le Mali a produit plus de techniciens de santé
comparativement aux catégories professionnelles.
Entre 2017 et 2021, le Mali a produit entre 197 et 708 médecins, soit une hausse de 29,2% par
an, et représentant respectivement entre 4,6% et 8,5% du total des diplômés offerts sur le
marché du travail dans le secteur de la santé. Au cours de la même période, le nombre
d’infirmiers et de sage femmes produit s’est accrue de 19% par an, variant respectivement de
474 à 1 129 et de 536 à 1 327. En 2017, ces diplômés issus des formations d’infirmerie et de
sages-femmes représentaient respectivement 11,1% et 12,6% du total de personnels de santé
produits, contre respectivement 13,5% et 15,9% en 2021. En 2017, le nombre de techniciens
de santé produits représentait 70,5% du total des diplômés offerts sur le marché du travail de
la santé, contre une proportion estimée à 58,7% en 2021. Ces proportions équivalaient
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2017 2018 2019 2020 2021
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021 Total
Mali (secteur privé) Mali (secteur public) A l'étranger
 |
33 33 |
▲back to top |
33
respectivement à 3 011 et 4 891 techniciens de santé mis à disposition sur le marché du travail
de la santé. Les pharmaciens formés étaient au nombre de 27 en 2017 et de 147 en 2021,
représentant respectivement 0,6% et 1,8% du total des diplômés formés (Figures 17, 18 et
19).
Figure 17. Nombre de diplômés issus
des formations en médecine et en
infirmerie, 2017-2021
Figure 18. Nombre de diplômés issus
des formations de sages-femmes et
pharmaciens, 2017-2021
Figure 19. Nombre de diplômés issus
des formations de techniciens de
santé, 2017-2021
Source : Données collectées auprès de la DNPD et des établissements de formation.
Les diplômés Maliens ayant bénéficié d’une formation initiale à l’étranger et dans le secteur
de la santé, ont été essentiellement formés dans les pays de la CEDEAO, d’Afrique du Nord
et du Moyen Orient. Ces formations ont été principalement financées sur fonds propres (par
les diplômés eux-mêmes).
Entre 2016 et 2021, 609 Maliens au total ont bénéficié d’une formation initiale en santé à
l’étranger dont 42,8% formés dans les pays de la zone CEDEAO, 25,3% formés dans les pays
de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient et 17,6% formés dans les pays d’Europe (Figure 20).
Le top 3 des pays recevant le plus d’étudiants/élèves en formation initiale sont : le Sénégal
avec 91 étudiants/élèves (soit 13,8% du total), la France avec 76 étudiants/élèves (soit 11,5%
du total) et le Maroc avec 74 étudiants/élèves (soit 11,2% du total) (Figure 21). Parmi les 609
formations dispensées à l’étranger : 333 ont été financées sur fonds propres (par les diplômés
eux-mêmes), représentant un peu plus de 50% du total tandis que 183, soit plus de 25% du
total ont été financées par l’État Malien ; le reste étant financé à plus de 20% à travers la
coopération internationale, bilatérale et multilatérale (Figure 22).
0
200
400
600
800
1 000
1 200
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021
Médecins (axe gauche)
Infirmiers (axe droit)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2017 2018 2019 2020 2021
Sage-femmes (axe gauche)
Pharmaciens (axe droit)
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2017 2018 2019 2020 2021
 |
34 34 |
▲back to top |
34
Figure 20. Distribution des diplômés
en santé de Nationalité Malienne
formés à l'étranger selon la région de
formation
Figure 21. Distribution des diplômés en
santé de Nationalité Malienne formés à
l'étranger selon le pays de formation
Figure 22. Distribution des diplômés
en santé de Nationalité Malienne
formés à l'étranger selon la source
de financement
Source : Données collectées auprès de la DNPD.
3.1.1.2. Performances académiques des étudiants et élèves issus des
formations en santé
Les performances académiques des diplômés au moment de la formation et issus des
institutions de formation en santé ont évolué différemment selon le cycle, l’établissement
et la filière de formation. Ces performances pourraient toutefois être améliorées.
Estimés en moyenne par catégorie d’établissements de formation au cours de la période 2017-
2021, il ressort que les taux de réussite des étudiants et élèves aux examens de fin d’année,
ont baissé de 98,2% à 16,6% dans les établissements publics de formation et de 78,8% à 77,6%
dans les établissements privés de formation (Figure 23). Ceci atteste que les diplômés des
établissements publics de formation sont relativement plus performants que ceux issus des
établissements privés de formation, d’autant plus qu’ils sont soumis généralement aux
mêmes examens et concours nationaux de fin de cycle. Ce constat est aussi observé pour
l’ensemble des filières de formation analysées selon la disponibilité des données (Figure 24).
Les résultats obtenus de cette analyse suscitent des questionnements relatifs aux motifs ayant
conduit à une forte production des diplômés par les établissements privés de formation. En
8,5%
25,3%
2,1%
2,7%
0,2%0,2
%
42,8%
0,8%
17,6%
Amérique Latine
et Carraibes
Afrique du Nord
et Moyen Orient
Amérique du
Nord
Asie
Afrique du Sud
CEDEAO
CEMAC
Europe
0 20 40 60 80 100
Afrique du Sud
Congo
Espagne
Italie
Serbie
Gabon
Libye
Roumanie
Tunisie
Mauritanie
Angleterre
Ukraine
États-Unis
Belgique
Bénin
Niger
Cuba
Guinée Conakry
Maroc
Sénégal
0,2%
27,8%
21,5%
50,5%
Autres sources
Budget de l'État
Coopération internationale
Fonds Propres
 |
35 35 |
▲back to top |
35
effet, cette production considérable pourrait provenir de deux facteurs : i) des performances
académiques considérables et représentées par des taux de réussite élevés enregistrés au sein
de ces établissements de formation et/ou ii) un nombre significatif d’étudiants et/ou élèves
reçus en formation. Compte tenu du niveau faible des taux de réussite enregistrés par les
établissements privés de formation, comparativement à ceux du public, il ressort que la cause
la plus probable à l’origine de la forte production des diplômés issus des établissements privés
de formation, toutes choses étant égales par ailleurs, serait le nombre significatif
d’étudiants/élèves inscrits et bénéficiant d’une formation par cette catégorie
d’établissements de formation.
Figure 23. Taux moyen de réussite des étudiants et
élèves issus des établissements de formation en
santé
Figure 24. Taux moyen de réussite par filière et catégorie
d’établissements de formation
Source : Données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé et des établissements de formation.
Une analyse plus spécifique par type d’établissements et par cycle de formation indique qu’au
sein des établissements d’enseignement secondaire et supérieur en santé, les taux de réussite
aux examens de fin d’année ont augmenté d’au moins 4 points de pourcentage entre 2019 et
2021 (Figure 25) tandis qu’ils ont baissé d’au moins 50 points de pourcentage à l’école de
médecine et à l’Institut National de Formation en Sciences de Santé (INFSS) entre 2017 et
2021. Toutefois, dans les universités privées, ces taux ont augmenté de 22 points de
pourcentage mais restent tout de même faibles (Figure 26).
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
2017 2018 2019 2020 2021
Établissements publics (axe gauche)
Établissements privés (axe droit)
79%
99% 100% 99% 99%
15%
81%
67%
62%
90%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
Établissements publics Établissements privés
 |
36 36 |
▲back to top |
36
Figure 25. Taux de réussite aux examens de
fin d’année par cycle de formation, 2019-
2021
Figure 26. Taux de réussite aux examens de
fin d’année établissement de formation,
2017-2021
Source : Données collectées auprès du CNCFP, du CNECE et de la DGESRS et des établissements de formation.
3.1.2. Disponibilité et distribution des personnels de santé
3.1.2.1. Disponibilité des personnels de santé
Au cours de ces dernières années, la disponibilité des personnels de santé s’est accrue au
cours de ces dernières années et est jugée insuffisante. La hausse concerne l’ensemble des
catégories professionnelles, surtout les sages-femmes, exception faite des infirmiers.
Entre 2016 et 2022, le nombre total de personnels de santé a varié de 17 578 à 24 553, soit
une augmentation de 4,9% par an, et représentant respectivement 9,6 et 11,3 agents de santé
pour 10 000 habitants. Le cumul des médecins, infirmiers et sages-femmes est passé de 9 311
à 12 893, soit une augmentation annuelle de 4,8%, représentant respectivement 5,1 et 5,9
agents de santé pour 10 000 habitants (Figures 27 et 28).
66,2% 66%
70,3%
73%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
Cycle secondaire Cycle supérieur
2019 2021
99% 98%
10%
50%
13%
32%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
École de
médecine (axe
gauche)
Institut
National de
Formation en
Sciences de la
Santé (axe
gauche)
Universités
privées (axe
droit)
2017 2021
 |
37 37 |
▲back to top |
37
Figure 27. Disponibilité des personnels de santé, 2016-
2022
Figure 28. Disponibilité des médecins, infirmiers et
sages-femmes, 2016-2022
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès collectées auprès de la
DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé.
Au cours de la même période, la densité des médecins est passée de 1,5 à 1,8 agents de santé
pour 10 000 habitants (Figure 29.A) tandis que celle des sages-femmes a varié de 3,2 à 4,3
agents de santé pour 5 000 femmes en âge de procréer (Figure 29.B). Les densités des
pharmaciens et techniciens de santé ont augmenté respectivement de 5,8 à 7,5 et de 16,9 à
17,8 agents de santé pour 100 000 habitants (Figure 29.C). La densité associée aux infirmiers
est restée stagnante et a été estimée à 1.1 agents de santé pour 5,000 habitants (Figure 29.D).
Figure 29. Densité des personnels de santé selon la catégorie professionnelle, 2016-2022
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès collectées auprès de la
DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé.
9
,6
1
0
,8
1
0
,9
1
0
,8
1
1
,1
1
1
,2
1
1
,3
3
4
,9
3
3
,7
3
3
,6
3
3
,7
3
3
,4
3
3
,3
3
3
,2
0
10
20
30
40
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gaps de densité par rapport à l'étalon (pour 10
000 habitants)
Densité des personels de santé (pour 10 000
habitants)
5
,1 6
,1 6
,2
6
,2
6
,2 6 5
,9
1
7
,9
1
6
,9
1
6
,8
1
6
,8
1
6
,8
1
7
1
7
,1
0
5
10
15
20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gaps de densité par rapport à l'étalon (pour 10
000 habitants)
Densité des médecins, infirmiers et sages-
femmmes (pour 10,000 habitants
0,0
1,0
2,0
2016 2022
A. Nombre de médecins pour 10 000
habitants
0
5
2016 2022
B. Nombre de sage-femmes pour 5 000
femmes en âge de procréer
0
20
Pharmaciens Techniciens de santé
C. Nombre de pharmaciens et de
techniciens de santé pour 100 000
habitants
2016 2022
0,0
0,5
1,0
1,5
2016 2022
D. Nombre d'infirmiers pour 5 000 habitants
 |
38 38 |
▲back to top |
38
L’analyse des densités régionales des personnels de santé par catégorie professionnelle
indique que la disponibilité des personnels de santé est plus accrue dans les régions de
Bamako et de Kidal
En 2022, les régions de Bamako et de Kidal comptaient respectivement 29,6 et 23,1 personnels
de santé pour 10 000 habitants tandis que la région de Sikasso enregistrait 5,9 personnels de
santé pour 10 000 habitants. De plus, Bamako et Kidal comptaient respectivement 15,3 et 12,1
médecins, infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. Cette densité a été la plus faible
à Ségou et était estimé à 2,6 pour 10 000 habitants. En outre, il ressort que les densités de
médecins, d’infirmiers et de sages-femmes étaient aussi les plus élevées à Bamako et Kidal.
Ces régions enregistraient respectivement : i) 7,1 et 2,7 médecins pour 10 000 habitants, ii)
2,6 et 3,7 infirmiers pour 5 000 habitants et, iii) 6,3 et 4,9 sages-femmes pour 5 000 femmes
en âge de procréer. Les densités de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes ont été les plus
faibles à Ségou avec respectivement 0,6 médecins pour 10 000 habitants, 0,5 infirmiers pour
5 000 habitants et 2,4 sages-femmes pour 5 000 femmes en âge de procréer (Tableau 3).
Tableau 3. Densités régionales des personnels de santé par catégorie professionnelle, 2022
Régions
Densité des
personnels de santé
pour 10 000 habitants
Densité des
médecins,
infirmiers et sages-
femmes pour 10
000 habitants
Densité des
médecins pour
10 000
habitants
Densité des
infirmiers pour
5 000
habitants
Densité des sages-
femmes pour 5
000 femmes en
âge de procréer
Bamako 29,6 15,3 7,1 2,6 6,3
Gao 11,8 5,7 1,3 1,5 3,3
Kayes 10,6 4,4 0,8 0,8 4,3
Kidal 23,1 12,1 2,7 3,7 4,9
Koulikoro 9,7 5,4 1,2 1,1 4,6
Mopti 6,1 2,9 0,8 0,6 1,9
Ségou 6,9 2,6 0,6 0,5 2,4
Sikasso 5,9 3,2 0,7 0,6 2,7
Tombouctou 6,4 2,9 0,6 0,6 2,2
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès de
la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé
En 2022, le Mali comptait au total 5,3 agents de santé communautaire pour 10 000
habitants. Cette densité était particulièrement plus élevée à Kidal comparativement aux
autres régions. Cette densité indique que les agents de santé communautaire sont plus
disponibles dans la région de Kidal (Figure 30).
A ce stade les résultats relatifs à Kidal et Gao devraient être considérés avec précaution. En effet,
compte tenu de la situation d’insécurité constatée dans ces régions, il est observé que certains
professionnels abandonnent leur poste pour rejoindre le capital, ce qui n’est pas comptabilisé dans le
répertoire des personnels de santé.
 |
39 39 |
▲back to top |
39
Figure 30. Densités régionales des agents de santé
communautaires
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des
personnels de santé et collectées auprès collectées auprès de la DNFPP, de la
DNFPCT, des structures de santé. Note : AESD : Agents d’entretien, de sécurité
et de Déplacement.
3.1.2.2. Distribution des personnels de santé
Distribution selon la catégorie professionnelle, le régime et le secteur d’exercice
Les Ressources Humaines de la Santé regroupent majoritairement des personnels
paramédicaux incluant les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens de santé. En 2022,
le Mali comptait 12 728 professionnels paramédicaux, représentant 51,8% des personnels de
santé, incluant : i) 4 809 infirmiers, soit 19,6% du total, ii) 4 254 techniciens de santé, soit
17,3% du total et iii) 3 665 sages-femmes, soit 14,9% du total. Les catégories professionnelles
les moins représentées étaient, entre autres, les pharmaciens, les personnels en charge de
l’administration et les agents d’entretien, de sécurité et de déplacement (AESD) (Figure 31)
Les personnels de santé sont essentiellement employés par le secteur public, dépendant
principalement de la fonction publique de l’État. Ils sont en majorité composés de
contractuels. En 2022, 77,8% soit 19 091 agents de santé, exerçaient dans le secteur public
regroupant : i) 6 173 personnels dépendant de la fonction publique de l’État, soit 25,1% du
total des professionnels de santé, ii) 3 614 agents dépendant de la fonction publique des
Collectivités Territoriales, soit 14,7% du total des professionnels de santé et, iii) 9 304
contractuels représentant 37,9% du total des professionnels de santé. Le secteur privé,
composé uniquement de contractuels était représenté à 22,2%, incluant notamment 5 462
agents (Figure 32).
3,1
3,7
4
4,4
4,5
5,3
5,7
5,9
8,6
12,4
0 2 4 6 8 10 12 14
Sikasso
Mopti
Ségou
Tombouctou
Bamako
Mali
Koulikoro
Kayes
Gao
Kidal
Densité des agents de santé communautaires pour 10 000
habitants
 |
40 40 |
▲back to top |
40
Figure 31. Distribution des personnels de santé selon la
catégorie professionnelle, 2022
Figure 32. Distribution des personnels de santé selon le
secteur et le régime d'exercice, 2022
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès collectées auprès de la DNFPP,
de la DNFPCT, des structures de santé. Note : AESD : Agents d’entretien, de sécurité et de Déplacement.
Distribution selon le genre et l’âge
Les personnels de santé sont en majorité composés d’hommes, à l’exception des sages-
femmes qui ne comptent que des femmes. En 2022, plus de 50% des personnels de santé
étaient du genre masculin. Exception faite des sages-femmes, les agents de santé du genre
féminin étaient les plus représentés chez les infirmiers et les techniciens de santé, avec des
proportions estimées à plus de 40% (Figure 33).
Figure 33. Distribution des personnels de santé selon le genre, 2022
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès de la DNFPP,
de la DNFPCT, des structures de santé. Note : AESD : Agents d’entretien, de sécurité et de Déplacement. TA : Techniciens
de santé. PA : personnels d’appui, Pers. Adm : personnels administratifs.
15,4%
19,6%
14,9%
6,6%
17,3%
10,6%
1% 8,1%
6,5%
Médecins (généralistes et
spécialistes)
Infirmiers
Sage-femmes
Pharmaciens
Techniciens de santé
Personnels d’appui
Autres personnels de santé
AESD
Personnels administratifs
25,1%
14,7%
37,9%
22,2%
Fonctionnaires de l'État
Fonctionnaires des
Collectivités Territoriales
Contractuels du secteur
public
Contractuels du secteur privé
17,7%
5
0
,1
%
1
0
0
%
3
1
,2
%
4
5
,6
%
3
0
,3
%
3
3
,9
%
2
9
,8
%
3
1
,4
%
4
5
,4
%
8
2
,3
% 4
9
,9
%
6
8
,8
%
5
4
,4
%
6
9
,7
%
6
6
,1
%
7
0
,2
%
6
8
,6
%
5
4
,6
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Femmes Hommes
 |
41 41 |
▲back to top |
41
Les jeunes âgés de 15 à 35 ans sont les plus représentés dans la distribution des personnels
de santé du secteur privé et sont considérablement représentés dans celles des
professionnels du secteur public. En 2022, 48,1% des personnels de santé du secteur privé
étaient composés de jeunes âgés de 15 à 35 ans, avec une proportion estimée à 45,2% chez
les hommes et 51,4% chez les femmes (Figure 34). Au sein de la distribution des personnels
de santé du secteur public, ils étaient représentés à 32,7% du point de vue de leur ensemble
et à 29,6% et 35,8% respectivement chez les hommes et les femmes. S’agissant toujours du
secteur public, la tranche d’âge la plus représentée était celle de 36 à 45 ans, avec 43,8% de
l’ensemble, 45,5% des hommes et 42% des femmes (Figure 35).
Figure 34. Pyramide des âges des personnels de santé
du secteur privé, 2022
Figure 35. Pyramide des âges des personnels de santé
du secteur public, 2022
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès collectées auprès de la
DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé.
Distribution selon la région
La distribution régionale des personnels de santé a été appréciée à travers l’indice d’équité
géographiques (IEG) estimée pour chaque région et chaque catégorie professionnelle. Pour chacune
des régions et catégorie professionnelle, l’IEG représente le rapport entre : A) la proportion des agents
de santé de la catégorie professionnelle « i » exerçant dans la région « j » dans le total des personnels
de santé de la même catégorie professionnelle, exerçant à l’échelle nationale (toute catégorie
professionnelle confondue) et, B) la proportion des agents de la population résidant dans la région
« j » dans l’ensemble de la population estimée à l’échelle nationale (toute région confondue).
Formule de calcul :
????????,?? =
?????? ∑ ??????,??
??,??
??,??⁄
???????? ∑ ????????
??
??⁄
Avec :
????????,?? : représentant l’Indice d’Équité Géographique calculé en considérant la catégorie professionnelle
« i » des personnels de santé exerçant dans la région « j », avec « n » et « m », représentant
respectivement le nombre total de personnels de santé et de régions.
4500 2500 500 1500 3500
15-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56 ans et plus
Hommes
Femmes
5000 0 5000
15-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56 ans et plus
Hommes
Femmes
 |
42 42 |
▲back to top |
42
????????,??: représentant le nombre de personnels de santé de la catégorie professionnelle « i », exerçant
dans la région « j ».
????????: représentant la taille de la population résidant dans la région « j ».
Interprétation :
Un IEG inférieur ou supérieur à 1 indique une distribution asymétrique des personnels de santé
attestant respectivement d’une iniquité négative et positive. Un IEG supérieur à 1 signifie qu’au sein
de la région, la part des personnels de santé de la catégorie professionnelle donnée, exerçant dans
cette région, reste supérieure à celle de la population qu’elle reçoit. En d’autres termes, la région reçoit
plus de personnels de santé de la catégorie professionnelle donnée, qu’elle n’en devrait pour prendre
en charge la population qu’elle abrite.
Un IEG inférieur à 1 signifie qu’au sein de la région, la part des personnels de santé de la catégorie
professionnelle données, exerçant dans cette région, reste inférieure à celle de la population qu’elle
reçoit. Autrement dit, la région reçoit moins de personnels de santé de la catégorie professionnelle
données, qu’ elle devrait recevoir pour prendre en charge la population qu’elle abrite.
Un IEG égal à l’unité traduit une distribution égalitaire, c’est-à-dire une distribution symétrique des
personnels de santé de la catégorie professionnelle donnée. Cette égalité à l’unité signifie que les
personnels de santé sont équitablement distribués en fonction du nombre d’habitants qu’elle abrite.
Plus l’IEG se rapproche de 1, plus la distribution régionale des personnels de santé est équitable.
Les indices d’équité géographique (IEG) indiquent que les personnels de santé sont
inéquitablement et inégalement distribués entre les régions. La majeure partie des régions
reçoivent moins de personnels de santé qu’elles ne devraient recevoir pour prendre en
charge la population qu’elles abritent, à l’exception de Gao, Kidal and Bamako qui dans la
plupart des cas concentrent le plus de personnels de santé. L’interprétation des IEG est
succinctement documentée ci-dessous par catégorie professionnelle :
- L’ensemble des personnels de santé excluant les agents de santé communautaires :
Les régions de Gao, de Kidal et de Bamako recevaient plus de personnels de santé
qu’elles ne devraient pour couvrir les populations qu’elles abritaient tandis que les
autres régions en recevaient moins (Figure 36.A).
- Les médecins : les régions de Kidal et de Bamako recevaient plus de médecins qu’elles
n’en devraient pour couvrir les populations qu’elles abritaient tandis que les autres
régions en recevaient moins (Figure 36.B).
- Les infirmiers : Les régions de Gao, Bamako et Kidal recevaient plus d’infirmiers
qu’elles n’en devraient pour couvrir les populations qu’elles abritaient tandis que les
autres régions en recevaient moins (Figure 36.C).
- Les sages-femmes : toutes les régions recevaient plus de sages-femmes qu’elles n’en
devraient pour couvrir les femmes en âge de procréer qu’elles abritaient. Ce
supplément est plus élevé à Koulikoro, Kidal et Bamako (Figure 36.D).
 |
43 43 |
▲back to top |
43
- Les techniciens de santé : Les régions de Gao, de Kidal et de Bamako recevaient plus
de techniciens de santé qu’elles n’en devraient pour couvrir les populations qu’elles
abritaient tandis que les autres régions en recevaient moins (Figure 36.E).
- Les personnels d’appui : les régions de Kayes, de Kidal et de Bamako recevaient plus
de personnels d’appui qu’elles n’en devraient pour couvrir les populations qu’elles
abritaient tandis que les autres régions en recevaient moins (Figure 36.F).
- Les personnels administratifs : les régions de Gao, Bamako et Kidal recevaient plus de
personnels administratifs qu’elles n’en devraient pour couvrir les populations qu’elles
abritaient tandis que les autres régions en recevaient moins (Figure 36.G).
- Les agents de santé communautaires (ASC) : les régions de Koulikoro, de Kayes, de Gao
et Kidal recevaient plus d’ASC qu’elles n’en devraient pour couvrir les populations
qu’elles abritaient tandis que les autres régions en recevaient moins (Figure 36.H).
Figure 36. Indice d’Équité Géographique des personnels de santé, 2022
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
A. Personnels de santé excluant les
agents de santé communautaires
IEG, 2022 Seuil d'équité
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
B. Médecins
IEG, 2022 Seuil d'équité
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
C. Infirmiers
IEG, 2022 Seuil d'équité
0
2
4
6
8
D. Sage-femmes
IEG, 2022 Seuil d'équité
 |
44 44 |
▲back to top |
44
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès de la DNFPP, de la
DNFPCT, des structures de santé. Note : les barres en rouge représentent les régions recevant plus de personnels qu’elles en
devraient pour couvrir les populations qu’elles abritent tandis que les barres en vert portent sur les régions recevant moins de
personnels de santé qu’elles en devraient pour couvrir les populations qu’elles abritent.
La distribution inégalitaire et inéquitable des personnels de santé concerne l’ensemble des
catégorie professionnelles, exception faite des sages-femmes. Les indices d’équité
géographique (IEG) calculés en valeur médiane par catégorie professionnelle indiquent que
l’ensemble des régions reçoivent plus de sages-femmes qu’elles n’en devraient pour prendre
en charge les femmes en âge de procréer qu’elles abritent, ce qui n’est pas le cas des autres
catégories professionnelles en particulier les pharmaciens (Figure 37).
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
E. Techniciens de santé
IEG, 2022 Seuil d'équité
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
F. Personnels d'appui
IEG, 2022 Seuil d'équité
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
G. Personnels administratifs
IEG, 2022 Seuil d'équité
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
H. Agents de santé communautaire
IEG, 2022 Seuil d'équité
 |
45 45 |
▲back to top |
45
Figure 37. Indice d’équité géographique médian par catégorie professionnelle, 2022
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès
de la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé. Note : les barres en rouge représentent les catégories
professionnelles pour lesquelles le nombre de personnels de santé reste plus faible pour prendre en charge
la population ayant besoin de services de santé tandis que les barres en vert portent sur les catégories
professionnelles pour lesquelles le nombre de personnels de santé reste plus élevé qu’il n’en fallait pour
prendre en charge la population ayant besoin de services de santé.
A ce stade les résultats relatifs à Kidal et Gao devraient être considérés avec précaution. En effet,
compte tenu de la situation d’insécurité constatée dans ces régions, il est observé que certains
professionnels abandonnent leur poste pour rejoindre la capitale, ce qui n’est pas comptabilisé dans
le répertoire des personnels de santé.
Les inégalités observées dans la distribution régionale des personnels de santé pourraient
provenir de deux facteurs essentiels, le premier étant la forte concentration des
établissements de formation dans les villes au détriment des zones les plus reculées et mal
desservies, incitant les étudiants et élèves à aller se former dans les métropoles et à y rester.
En effet, au Mali, l’ensemble des établissements publics et universitaires de formation est
localisé à Bamako, de même que les institutions privées de formation en majorité , soit près
de la moitié (Figure 38). La seconde cause potentielle à vérifier serait la difficulté de déployer
les personnels de santé dans les zones reculées compte tenu de l’insuffisance probable des
mécanismes d’incitations.
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Pharmaciens
Médecins
Techniciens de santé
Infirmiers
Personnels d’appui
Personnels de l'administration
ASC
Sage-femmes
 |
46 46 |
▲back to top |
46
Figure 38. Distribution régionale des établissements privés de formation,
2022
Source : Données collectées auprès de la DNFCT, de la DNFPP et des structures de santé
Les résultats obtenus de l’analyse de la distribution régionale des personnels de santé à travers les
indices d’équité géographie ne peuvent permettre d’attester de l’existence d’un surplus ou d’un
excédent. Ils permettent uniquement d’apprécier dans quelle mesure les personnels de santé sont
distribué égalitairement et équitablement sur le territoire national. Une estimation et une analyse des
besoins comparativement à la situation des personnels de santé permettrait d’avoir une idée sur les
catégories professionnelles en déficit et en surplus.
Distribution selon les piliers de la pyramide sanitaire
Les personnels de santé sont répartis inégalement et inéquitablement entre les niveaux de
la pyramide sanitaire. Le même constat est observé pour toutes les catégories
professionnelles.
L’analyse de la répartition des personnels de santé selon les piliers de la pyramide sanitaire vu
du point de vue de son organisation technique, indiquent que le nombre de personnels de
santé par établissement de santé reste plus élevé au niveau tertiaire (hôpitaux de troisième
référence) suivi, du niveau secondaire (hôpitaux de deuxième référence), du niveau primaire
(centres de santé communautaire, centres de santé de référence et hôpitaux de district) et du
secteur privé4. Ainsi le secteur primaire bénéficie le moins de personnels de santé alors qu’il
4 Les données relatives à la taille du personnel de santé et au nombre d’établissements de santé du secteur privé,
n’ont pas été désagrégée selon les piliers de la pyramide sanitaire. Il était donc impossible de les ventiler selon
ces piliers.
10,2%
11%
11,4%
7,1%
2,4%
3,9%
54,1%
Kayes
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Bamako
 |
47 47 |
▲back to top |
47
regorge des besoins les plus essentiels et des pathologies les plus faciles à prendre en charge
(Figure 39 et Tableau 4).
Figure 39. Nombre de personnels de santé par
établissement de santé, selon les piliers de la
pyramide sanitaire, 2022
Tableau 4. Nombre de personnels de santé par établissement
de santé et par catégorie professionnelle, selon les piliers de
la pyramide sanitaire, 2022
Catégories
professionnelles
Primaire Secondaire Tertiaire
Structures
privées
AESD 1 3,8 30,7 0,4
Infirmiers 2 10,3 51,7 0,4
Médecins 1,1 14,8 82 0,1
Personnels
administratif
0,8 3,8 14 0,4
Personnels
d’appui
1,1 11,3 71,7 0,2
Sages-femmes 2 3 17,3 0,03
Techniciens de
santé
2 6,8 46 0,4
Pharmaciens 0,1 3,2 11,3 3
Source : Données collectées auprès de la DNFCT, de la DNFPP et des structures de santé
3.1.3. Attrition des personnels de santé
Au cours de ces dernières années, l’attrition des personnels de santé est restée faible et a
connu une tendance légère à la baisse.
Entre 2016 et 2021, le taux d’attrition des personnels de santé est passé de 1,2% à 0,4%, soit
une baisse de 0,8 points de pourcentage. Il a varié de 1,4% à 0,5% chez les personnels du
secteur public et de 0,3% à 0,2% chez ceux du secteur privé (Figure 40).
10
57
325
6
0 100 200 300 400
Primaire
Secondaire
Tertiaire
Structures privées
 |
48 48 |
▲back to top |
48
Figure 40. Taux d’attrition des personnels de santé selon le secteur d’exercice, 2016-2021
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès
de la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé. Note : l’attrition des personnels du secteur public inclut
les décès, les congés de formation, les prises de disponibilités, les mises à disposition et le départ à la retraite.
L’attrition des personnels du secteur privé ne concerne que les décès et les départs à la retraite (compte tenu
du fait de certaines données non disponibles).
Au cours de la même période, l’attrition a légèrement baissé chez la majorité des catégories
professionnelles, exception faite des infirmiers, des sages-femmes et des agents d’entretien,
de sécurité et de déplacement (AESD). En effet, il a légèrement augmenté chez les infirmiers
et les sages-femmes alors qu’il n’a pas varié chez les AESD. Les tendances baissières les plus
prononcées ont été observées chez les techniciens de santé, les médecins tandis que les taux
d’attrition les plus élevées ont été enregistrés en moyenne chez les personnels d’appui et les
techniciens (Tableau 5).
Tableau 5. Taux d’attrition des personnels de santé selon la catégorie professionnelle, 2016-
2021
Types d'emploi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne Variation
Médecins (généralistes et
spécialistes)
1,5% 1,1% 1,1% 0,6% 0,3% 0,1% 0,8% -1,4%
Infirmiers 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,8% 0,3% 0,4%
Sages-femmes 0,2% 0,6% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2%
Pharmaciens 0,5% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% -0,2%
Techniciens de santé 3,0% 1,8% 2,0% 1,3% 0,1% 0,1% 1,4% -2,9%
Personnels d’appui 2,2% 3,2% 3,2% 2,5% 0,7% 1,0% 2,1% -1,1%
Autres personnels de santé 0,4% 0,0% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% -0,4%
Agents d’entretien, de gardiennage
et de conduite
0,4% 0,4% 0,2% 0,7% 0,1% 0,4% 0,4% 0,0%
Personnels d’administration et de
gestion
0,5% 0,2% 0,4% 0,7% 0,3% 0,2% 0,4% -0,3%
Baisse du taux d’attrition entre 2016 et 2021
Augmentation du taux d’attrition entre 2016 et 2021
Variation nulle du taux d’attrition entre 2016 et 2021
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès de
la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé.
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total (axe gauche) Secteur public (axe gauche)
Secteur privé (axe droit)
 |
49 49 |
▲back to top |
49
Les principaux motifs de l’attrition des personnels de santé sont les départs à la retraite et
les décès.
Ente 2016 et 2021, 81,1% des personnels de santé sujets à l’attrition étaient constitués de
départs à la retraite. Cette proportion était de : i) 81,7% chez les personnels du secteur public,
ii) 69,8% chez les personnels du secteur privé, iii) 80,7% chez les médecins (généralistes et
spécialistes), iv) 96,6% chez les sages-femmes, v) 91,5% chez les techniciens de santé, vi)
89,2% chez les personnels d’appui, vii) 84,6% chez les personnels administratifs, viii) 32,6%
chez les infirmiers, ix) 48,1% chez les pharmaciens et, x) 42,1% chez les AESD.
Parmi les personnels soumis à l’attrition, 13,1% concernaient des décès, avec une proportion
de 30,2% et 12% respectivement estimée chez les personnels des secteur privé et public. Cette
proportion a été la plus élevée chez les AESD, les infirmiers et les pharmaciens et estimée
respectivement à 57,9%, 51,2% et 37% (Figure 41). Cette évidence pourrait susciter des
questionnements sur l’existence éventuelle d’une surmortalité au sein des personnels de
santé. En comparant le taux de mortalité chez les personnels de santé (estimé à 96,7 décès
pour 100 000 habitants et variant de 60 à 106,3 décès pour 100 000 habitants chez ceux des
secteurs privé et public entre 2016 et 2021) au taux brut de mortalité de la population (estimé
au cours de la même année à 781,9 décès pour 100 000 habitants)5, il apparait que les
Ressources Humaines de la Santé ne sont pas en situation de surmortalité, même si les taux
de mortalité ne sont pas négligeables.
Figure 41. Distribution du nombre de personnels de santé sujets à l’attrition par motif,
2016-2021
Source : Estimations à partir des données relatives à la situation des personnels de santé et collectées auprès
de la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé.
5 Le taux de mortalité des personnels de santé a été calculé en rapportant le nombre total de décès enregistrés
entre 2016 et 2021 à la taille totale des ressources humaines de la santé. La même approche a été utilisée pour
estimer le taux de mortalité de la population (source : World Development Indicator, Banque Mondiale)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Médecins (généralistes et spécialistes)
Infirmiers
Sages-femmes
Pharmaciens
Techniciens de santé
Personnels d’appui
AESD
Personnels administratifs
Personnels de santé
Secteur public
Secteur privé
Décès Congés de formation Prises de disponibilité Mises à disposition Départs à la retraite
 |
50 50 |
▲back to top |
50
3.1.4. Projections de l’offre en personnels de santé
L’offre en personnels de santé baissera au cours des prochaines années tant du point de vue
de leur ensemble que par catégorie professionnelle. La baisse sera occasionnée
principalement par la décroissance du nombre de diplômés attendu mais aussi de
l’augmentation, même faible de l’attrition.
Les projections de l’offre en personnels de santé ont été estimées à partir de la formule
suivante :
???????????? = ????????????−1 + ??????????????é ???? ?????????????????????? − ????????????????????−1
Source : Analyses du Marché du Travail dans le secteur de la santé en Sierra Leone (2019) et au Lesotho
(2021).
Les résultats indiquent que l’offre des personnels de santé passera de 38 246 à 66 755 agents
entre 2023 et 2030, soit une hausse estimée en moyenne à 7,2% par an, avec un stock initial
de 24 553 agents estimé en 2022 (Figure 42).
Figure 42. Projections de l’offre en personnels de santé, 2023-2030
Source : Estimations à partir des données collectées auprès de la DNFPP, de la
DNFPCT, des structures de santé et des établissements de formation.
En focalisant les analyses par catégorie professionnelle et par secteur d’exercice, il ressort que
l’offre augmentera chez les médecins, les infirmiers et surtout chez les techniciens de santé
tandis qu’elle baissera chez le reste des catégories professionnelles, surtout les des agents
d’entretien, de sécurité et de déplacement. S’agissant du secteur d’exercice, les résultats
indiquent que l’offre émanant du secteur privé augmentera chaque année de 16,7% en
moyenne alors que celle du secteur public baissera de 0,3% en moyenne et par an (Tableau 6).
Une note méthodologique, assortie de données de projection plus détaillées est reportée en
Annexe 4.
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
 |
51 51 |
▲back to top |
51
Tableau 6. Projections de l’offre en personnels de santé selon la catégorie professionnelle et
le secteur d’exercice, 2023-2030
Catégorie professionnelle 2023 2030
Variation
annuelle
moyenne
Médecins (généralistes et spécialistes) 8 372 10 282 2,6%
Infirmiers 8 581 13 291 5,6%
Sages-femmes 4 654 7 874 6,8%
Pharmaciens 3 618 2 905 -2,7%
Techniciens de santé 6 583 30 567 21,2%
Personnels d’appui 2 873 1 338 -9,1%
Autres personnels de santé 236 226 -0,5%
AESD 1 827 3 -54,7%
Personnels administratifs 1 501 270 -19,3%
Secteur public 26 295 25 664 -0,3%
Secteur privé 11 950 41 092 16,7%
Source : Estimations à partir des données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé
et des établissements de formation.
3.2. Demande des Ressources Humaines de la Santé
Les recrutements ont baissé au cours de ces dernières années. Entre 2016 et 2022, le nombre
de recrutements est passé de 1 631 à 1 016, soit une baisse de 6,5% par an (Figure 43). Au
cours de la même période, le nombre de recrutements réalisés par le secteur public est passé
de 1 385 à 701, soit une baisse annuelle de 9,2%. Le nombre de recrutements réalisés par le
secteur privé a varié de 246 en 2016 à 79 en 2018, année à l’issue de laquelle ce nombre a
progressivement augmenté, passant à 315 en 2022 (Figure 44). Ceci atteste les efforts
entrepris par le secteur privé pour absorber le stock de diplômés sortis de formation.
 |
52 52 |
▲back to top |
52
Figure 43. Nombre total de recrutements, 2016-
2022
Figure 44. Nombre de recrutements réalisés par
les secteurs public et privé, 2016-2022
Source : Données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT et des structures de santé.
Les personnels de santé ont été principalement recrutés par le secteur public et étaient
majoritairement composés de contractuels, de sages-femmes et de médecins.
En 2016, 84,9% et 15,1% des personnels de santé étaient respectivement recrutés par les
secteurs public et privé contre des proportions respectives de 69% et 31% estimées en 2022
(Figure 45). En 2022, les personnels de santé recrutés étaient représentés à 82,7% de
contractuels contre une proportion de 81,7% estimée en 2016 (Figure 46).
De plus, sur 8 782 recrutements réalisés au total entre 2016 et 2022 : i) 29,4% étaient des
sages-femmes, ii) 18,4% étaient des médecins (généralistes et spécialistes), iii) 12,2% étaient
des personnels d’appui, iv) 11,5% étaient des infirmiers, v) 10,4% étaient des techniciens de
santé, vi) 7,3% étaient des personnels administratifs, vii) 6,5% étaient des pharmaciens et viii)
4,2% étaient des agents d’entretien, de sécurité et de déplacement (AESD) (Figure 47).
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secteur public (axe gauche)
Secteur privé (axe droit)
 |
53 53 |
▲back to top |
53
Figure 45. Distribution des
recrutements selon le secteur
d'exercice
Figure 46. Distribution des
recrutements selon le régime
d'emploi, 2016-2022
Figure 47. Distribution des
recrutements selon la catégorie
professionnelle
Source : Données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT et des structures de santé. Note : AESD : des agents d’entretien, de sécurité et
de déplacement.
Le nombre d’emplois nets crées a baissé au cours de ces dernières années, à l’occurrence
pour la majorité des catégories professionnelles, à l’exception des infirmiers, des personnels
d’appui et administratifs aussi bien que des personnels du secteur privé. Certaines
catégories professionnelles, et plus généralement les personnels du secteur public ont été
confrontés à des destructions nettes d’emploi au cours de ces certaines années.
Le nombre d’emplois nets crées mesure dans quelle mesure l’interaction entre les recrutements et
l’attrition s’est escompté d’un surplus ou d’un déficit de personnels de santé exerçant sur le marché du
travail dans le secteur de la santé. Il est calculé à travers le nombre de recrutements soustraits de
l’attrition.
Un nombre d’emplois nets positif indique que le nombre de personnels de santé entrant sur le marché
du travail reste supérieur à celui des agents de santé sortis de ce marché du fait de l’attrition. Ceci
atteste d’une création nette d’emplois.
Un nombre d’emplois nets négatif indique que le nombre de personnels de santé entrant sur le marché
du travail reste inférieur à celui des agents de santé sortis de ce marché du fait de l’attrition. Ceci atteste
d’une destruction nette d’emploi.
Une baisse du nombre net et crée d’emplois , estimé en valeur positive traduit une baisse du flux entrant
de personnels de santé sur le marché du travail. Toutefois une baisse du nombre net et crée d’emplois,
escomptée d’une valeur négative à l’année finale indique que la baisse des emplois crées s’est traduite
par une destruction d’emplois.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
To
ta
l
Secteur privé (contractuels)
Secteur public
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
To
ta
l
Fonctionnaires Contractuels
Médecins
Infirmiers
Sage-femmes
Pharmaciens
Techniciens de santé
Personnels d’appui
Autres personnels de santé
AESD
Personnels administratifs
 |
54 54 |
▲back to top |
54
Entre 2016 et 2022, le nombre d’emplois nets crées est passé de 1 418 à 66, soit une baisse
absolue de 1 352 emplois (Figure 48).
Au cours de la même période, le nombre d’emplois nets crées par l’État (secteur public) a
baissé de 1 185 à -196. Le nombre d’emplois nets crées et négatif, observé en 2022 pour le
secteur public atteste qu’au cours de cette année, le nombre de personnels sortant du marché
du travail du fait de l’attrition était supérieur à celui des personnels recrutés, ce qui traduit
une destruction nette d’emplois estimés à 196. S’agissant du secteur privé, le nombre
d’emplois nets crées a connu une évolution en dents-de-scie. Il a augmenté de 233 à 338 entre
2016 et 2017, baissant en suite en 2019 à 54 avant d’augmenter à 403 en 2020 et baissé une
nouvelle fois en 2022 à 262. Toutefois, en considérant uniquement les années 2016 et 2022,
il ressort que ce nombre a augmenté en valeur absolue, soit de 29 emplois nets crées
(Figure 49).
Figure 48. Nombre total d’emplois nets crées au
profit de l’ensemble des personnels de santé, 2016-
2022
Figure 49. Nombre d’emplois nets crées, répartis
selon le secteur d’exercice, 2016-2022
Source : Estimations à partir des données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT et des structures de santé.
L’analyse par catégorie professionnelle indique que le nombre d’emplois nets crées a baissé
pour la majorité des catégories professionnelles, surtout chez les sages-femmes. Les seules
catégories professionnelles ayant fait l’objet d’une augmentation de ce nombre net d’emplois
crées sont constituées des infirmiers ainsi que des personnels d’appui et administratifs. Les
personnels d’appui et administratifs ont été soumis à des destructions d’emplois de 2016
jusqu’à respectivement 2020 et 2019.En 2022, plusieurs catégories professionnelles ont été
confrontées à des destructions nettes d’emplois. Il s’agit notamment des médecins, des sages-
femmes, des pharmaciens, des techniciens de santé et des agents d’entretien, de sécurité et
de déplacement (Tableau 7).
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secteur public (axe gauche)
Secteur privé (axe droit)
 |
55 55 |
▲back to top |
55
Tableau 7. Nombre d’emplois crées nets, répartis par catégorie professionnelle, 2016-201
Catégories
professionnelles
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Variation
absolue
Médecins 381 410 291 215 70 24 -73 -454
Infirmiers 23 661 79 15 24 -38 78 55
Sage-femmes 1 022 1 014 159 95 75 42 -2 -1 024
Pharmaciens 9 3 17 44 268 181 -8 -17
Techniciens de santé 24 484 62 -12 13 10 -307 -331
Personnels d’appui -29 -39 -32 -30 -6 392 394 423
Autres personnels de
santé -1 0 -4 -1 0 4 0 1
AESD -6 -6 -4 -12 216 136 -28 -22
Personnels
administratifs -5 0 5 -7 457 123 12 17
Source : Estimations à partir des données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT et des structures de santé.
3.3. Équilibre entre l’offre et la demande des Ressources Humaines de la
Santé
L’offre et la demande en personnels de santé à l’entrée du marché du travail reste
désalignées.
Les diplômés issus des formations en santé ont été insuffisamment absorbés tandis que la
capacité d’absorption de ces derniers par le marché du travail de la santé a progressivement
baissé au cours de ces dernières années. Entre 2016 et 2021, le taux d’absorption des
diplômés a baissé de 43,8% à 11,7%6 (Figure 50).
De plus, la majorité des diplômés issus des formations en santé a été absorbée par le secteur
public. En 2016, 37,2% des diplômés étaient absorbés pour le compte du secteur public alors
que le secteur privé n’absorbait que 6,6% des diplômés. En 2021, ces proportions sont
respectivement passées à 7,2% et 4,5%. Ainsi, au cours de la période 2016-2021, 16,8% et
6 Le taux d’absorption se réfère au nombre de recrutements en pourcentage de celui des diplômés produits. Il aurait été utile
d’estimer le taux d’absorption spécifique aux secteurs public et privé. Seulement, les données disponibles ne permettaient
pas de réaliser cet exercice. Par exemple, aucune informe ne puisse confirmer que la totalité des diplômés issus des
établissements privés de formation a été recrutée en totalité par les établissements privés de santé. De plus, aucune
information ne puisse attester que l’ensemble des personnels de santé recrutés par les structures privées de santé provienne
des établissements publics de santé. Il aurait donc été biaisé de rapporter le nombre de recrutements réalisées par le secteur
privé par le nombre de diplômés issus des établissements privés de santé.
 |
56 56 |
▲back to top |
56
4,6% des diplômés issus des formations en santé ont été en moyenne et respectivement
absorbés par les secteurs public et privé (Figure 51).
Figure 50. Taux d’absorption des diplômés issus des
formations en santé
Figure 51. Répartition des diplômés absorbés par
secteur d’exercice, 2016-2021
Source : Données collectées auprès de la DNFCT et de la DNFPP, des structures de santé et des établissements de formation.
Conformément aux tendances observées sur la production et les recrutements et vu les
évidences de cette section, il apparait que la baisse des taux d’absorption provient d’une
induction considérable de la production, si grande qu’elle n’arrive pas à être absorbée. Cette
induction provient notamment du secteur privé ayant produit plus de diplômés qu’il ne
pouvait absorber, espérant ainsi que les besoins du secteur public l’amèneraient à absorber
ce stock de diplômés. Toutefois du fait de certaines contraintes à élucider par la suite, l’État
n’a pas été en mesure de combler cette attente .
En outre, il est observé que la baisse des taux d’absorption reste généralisée à l’ensemble des
catégories professionnelles, à l’exception des diplômés issus des formations en pharmacie et
formations auxiliaires, pour lesquels le taux d’absorption a augmenté au fil des années
(Tableau 8).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Secteur public Secteur privé
 |
57 57 |
▲back to top |
57
Tableau 8. Taux d’absorption des diplômés issus des formations en santé, selon la catégorie
professionnelle, 2016-2021
Catégories professionnelles 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variation
Médecins 45,9% 20,1% 5,5% -40,4%
Infirmiers 11% 13,8% 3% 2,8% 0,1% -10,9%
Sages-femmes 23,6% 16,3% 10,9% 4,5% -19,1%
Pharmaciens 10,4% 3,5% 14,9% 24,4% 71,5% 37,4% 27%
Techniciens de santé 4,8% 19,6% 5,5% 1,5% 0,4% 0,3% -4,5%
Personnels d’appui 7,2% 9% 10,9% 5,3% 1,6% 56,3% 49%
Légendes
Catégories professionnelles associées à un taux d'absorption décroissant
Catégories professionnelles associées à un taux d'absorption croissant
Source : Données collectées auprès de la DNFCT et de la DNFPP, des structures de santé et des établissements
de formation.
Comparativement aux hommes, les femmes rencontrent plus de difficultés ou sont moins
incitées à intégrer le marché du travail de la santé. En effet les femmes, comparativement
aux hommes sont plus représentées dans la distribution des diplômés alors qu’elles le sont
moins dans celles personnels de santé. Entre 2016 et 2021, les diplômés issus des formations
en santé comptaient respectivement 70% et 68,2% de femmes tandis que les personnels de
santé comptaient 40,8% et 45,1% de femmes (Figure 52).
Figure 52. Représentation des femmes dans la distribution des diplômés
et des personnels de santé
Source : Données collectées auprès de la DNFCT et de la DNFPP, des structures de santé
et des établissements de formation.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Personnels Diplômés
 |
58 58 |
▲back to top |
58
3.4. Financement des Ressources Humaines de la Santé
3.4.1. Analyse de la dynamique du financement public des personnels de santé et
de ses principaux déterminants
Au cours de ces dernières années, le Mali a connu un accroissement de ses dépenses
publiques. En 2016, une proportion considérable de ces dépenses a été dédiée aux agents
de la fonction publique. Elle a toutefois baissé depuis lors.
Entre 2016 et 2021, les dépenses budgétaires du Gouvernement Malien se sont accrues,
passant de 1 753 à 2 312 milliards de Fcfa. Les dépenses publiques courantes totales,
composante des dépenses budgétaires à partir de laquelle sont allouées les ressources
dédiées aux personnels de la fonction publique, ont varié de 1 013 à 1 141 milliards de Fcfa
entre 2016 et 2018, représentant une augmentation annuelle de 4% (Source : Document de
Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle, DPBE, 2019-2021, 2022-2024 et
2023-2025). Entre 2019 et 2021, des dépenses sont passées de 1 281 à 1 682 milliards de Fcfa,
soit une augmentation de 9,5% par an (Figure 53).
En 2021, 10,7% des dépenses publiques courantes totales ont été liquidées en faveur des
agents de la fonction publique, contre une proportion de 38,9% estimée en 2016.
Les personnels de santé ont été faiblement représentés dans la distribution des ressources
publiques dédiées au financement des personnels de la fonction publique. Entre 2016 et
2021, les personnels de santé bénéficiaient de 2,7% et 4,4% de ces dépenses liquidées au
profit des agents de la fonction publique (Figure 54).
Figure 53. Dépenses publiques courantes totales
en milliards de Fcfa, 2016-2021
Figure 54. Financement public domestique dédié aux
agents de la fonction publique et aux personnels de
santé, 2016-2021
Source : DPBEP,2018-2020, 2019-2021 et 2022-2024 et Rapports sur la situation d’exécution budgétaire provisoire du budget
(2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Part des dépenses publiques courantes totales liquidées aux
agents de la fonction publique (axe gauche)
Part des dépenses publiques des agents de la fonction
publique dédiée aux personnels de santé (axe droit)
 |
59 59 |
▲back to top |
59
Les financements publics de la santé et des personnels de santé sont étroitement liés.
L’augmentation et la baisse du volume des ressources liquidées en faveur du secteur de la
santé, telle observées respectivement au cours des périodes 2016-2018 et 2019-2021, s’est
traduite par une hausse et une baisse respective de celles liquidées en faveur des personnels
de santé. En outre, les personnels de santé ont tendance à être de plus en plus priorisés dans
les arbitrages budgétaires des ressources publiques dédiées à la santé lorsque la part des
ressources publiques totales du Gouvernement, ventilée en faveur de la santé, augmente, et
vice-versa. Enfin, en termes de financement réel, la santé occupe une proportion faible dans
le budget de l’État tandis que les personnels de santé sont considérablement représentés dans
le budget dédié au secteur de la santé. Les statistiques résumées à travers les Figures 55 et 56
indiquent les tendances suivantes :
- Entre 2016 et 2018 : les dépenses publiques courantes liquidées au profit des
personnels de santé ont varié de 10,8 à 30,8 milliards de Fcfa, représentant un
accroissement annuel de 41,8%. Les dépenses publiques courantes liquidées en faveur
du secteur de la santé7 sont passées de 27,8 à 69,2 milliards de Fcfa, soit une
augmentation de 35,5% par an. En 2016, 2,7% des dépenses publiques courantes
totales étaient liquidées en faveur de la santé contre une proportion de 6,1% estimée
en 2018 ; ceci étant loin d’atteindre la cible d’Abuja de 15%. Les personnels de santé
percevaient 38,9% en 2016 et 44,5% en 2018 de ces dépenses publiques courantes
liquidées en faveur du financement de la santé8. Ainsi, au cours de la période 2016-
2018, le financement public liquidé en faveur des personnels de santé s’est accru. Cet
accroissement provient essentiellement de deux facteurs. Le premier se réfère à
l’augmentation de l’enveloppe allouée au secteur de la santé provenant non
seulement d’une re-priorisation du secteur dans les arbitrages budgétaires de l’État
mais aussi de l’augmentation constatée de l’enveloppe des dépenses publiques
courantes totales. Le second se réfère à la re-priorisation des personnels de santé dans
le budget dédié au secteur de la santé.
- Entre 2019 et 2021, les dépenses publiques courantes liquidées au profit des
personnels de santé ont varié de 21,1 à 7,9 milliards de Fcfa, représentant une baisse
annuelle de 27,9%. Au cours de la même période, les dépenses publiques courantes
liquidées ventilées au profit du secteur de la santé sous forme de liquidations, ont varié
de 47,8 à 18,5 milliards de Fcfa, soit une baisse annuelle de 27,1%. La proportion des
7 Il s’agit des dépenses allouées uniquement au Ministère de la Santé. Celles allouées à travers le canal des autres
Ministères et Institutions Publiques n’ont pas été prises en compte car non renseignées au sein des rapports
d’exécution budgétaires exploités.
8 Les dépenses liquidées en faveur des personnels de santé ont été rapportées aux dépenses publiques courantes
liquidées au profit de la santé, lesquelles ont été rapportées aux dépenses publiques courantes totales. En effet,
les lignes budgétaires relatives aux personnels de santé et documentées au sein des rapports d’exécution
budgétaire ne sont que des dépenses récurrentes. Les dépenses relatives aux investissements réalisées en faveur
des personnels de santé ne sont pas disponibles.
 |
60 60 |
▲back to top |
60
dépenses publiques courantes totales liquidées en faveur du secteur de la santé est
passée de 3,7% à 1,1%, toujours en dessous de la cible d’Abuja. Celle dédiée au secteur
de la santé et liquidées en faveur des personnels de santé a baissé de 44,2% à 42,8%.
Par conséquent, au cours de la période 2019-2021, le financement public des
personnels de santé s’est rétréci compte tenu de deux facteurs : i) la baisse de
l’enveloppe dédiée au secteur de la santé occasionnée par une dépriorisation du
secteur dans les arbitrages budgétaires de l’État et, ii) la dépriorisation des personnels
de santé dans les arbitrages du budget dédié au secteur de la santé. La hausse
observée de l’enveloppe totale des dépenses publiques n’a pas été suffisante pour
contrer les effets de la dépriorisation des personnels de santé dans les arbitrages du
budget ventilé en faveur de la santé et du secteur de la santé en lui-même dans les
arbitrages du budget total.
Figure 55. Enveloppes des dépenses publiques
courantes ventilées en faveur de la santé et des
personnels de santé, 2016-2021
Figure 56. Priorisation budgétaire en faveur de la
santé et des personnels de santé, 2016-2021
Source : DPBEP,2018-2020, 2019-2021 et 2022-2024 et Rapports sur la situation d’exécution budgétaire provisoire du
budget (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Afin de conforter les évidences produites, une analyse de décomposition9 a été réalisée et
indique que l’évolution observées des financements publics dédiés aux personnels de santé
tient principalement de la propension du Gouvernement à reprioriser ou déprioriser le
secteur de la santé dans les arbitrages de son budget (Figures 57 et 58).
9 Une note analytique du financement public des personnels de santé est reportée en Annexe 5.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2016 2018 2019 2021
Santé Personnels de santé
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2016 2018 2019 2021
Part des dépenses publiques courantes totales
liquidées à la santé (axe gauche)
Part des dépenses publiques courantes de
santé liquidées aux personnels de santé (axe
droit)
 |
61 61 |
▲back to top |
61
- Entre 2016 et 2018 : l’augmentation constatée des dépenses publiques liquidées en
faveur des personnels de santé s’explique à 76% par la re-priorisation de la santé dans
les arbitrages budgétaires de l’État tandis que 13% de cette hausse provenait de la re-
priorisation des personnels de santé dans les arbitrages du budget dédié à la santé. Le
reste à savoir 11% provenaient de la hausse des dépenses publiques courantes totales
dont : i) 7% provenaient de la hausse des financements domestiques, tels que ceux
apportées par les institutions financières (banques et autres institutions financières),
ayant varié de 220 à 358 milliards de Fcfa, représentant une hausse annuelle de 17,6%
et, ii) 2% provenant de la baisse du besoin de financement public, étant passé de 737
à 701 milliards de Fcfa, soit une baisse annuelle de 1,7%.Ainsi, la hausse des dépenses
publiques courantes totales provient de celle des financements domestiques nets et
de la baisse des besoins de financement public. Toutefois, au cours de la même
période, les recettes publiques propres de l’État, les dons, les emprunts nets extérieurs
ont varié respectivement de 1 390 à 1 359 milliards de Fcfa, de 132 à 117 milliards de
Fcfa, de 7,9 à 6,9 milliards de Fcfa (Source : Document de Programmation Budgétaire
et Économique Pluriannuelle, DPBE, 2019-2021, 2022-2024 et 2023-2025). A l’absence
de la baisse constatée des recettes publiques propres, des dons et des emprunts nets
extérieurs, les dépenses publiques courantes liquidées en faveur des personnels de
santé auraient augmenté de 3,05%.
- Entre 2019 et 2021 : la baisse constatée des dépenses publiques liquidées en faveur
des personnels de santé s’explique à 80% par la dépriorisation de la santé dans les
arbitrages budgétaires de l’État tandis que 2% de cette baisse provenait de la
dépriorisation des personnels de santé dans les arbitrages du budget dédié à la santé.
Comme indiqué ci-dessous, les dépenses publiques courantes ont augmenté de 9,5%
par an ; une baisse ayant été insuffisante pour contrer les effets de la dépriorisation
de la santé dans le budget total de l’état et des personnels de santé dans le budget
dédié au secteur de la santé mais ayant tout de même atténué la baisse des dépenses
publiques liquidées au profit des personnels de santé. A l’absence de cette baisse, les
dépenses publiques dédiées aux personnels de santé auraient augmenté de 18% dont :
i) 13% provenant de la hausse des recettes publiques propres de l’État ayant varié de
1652 à 1819 milliards de Fcfa et, ii) 4% provenant de la hausse des financements
domestiques nets ayant varié de -43,1 (traduisant un emprunt net intérieur) à 490
milliards de Fcfa. Toutefois, il faudrait noter que les dons, les emprunts nets extérieurs
ont respectivement baissé de 191 à 67 et de 5,8 à 5,1 milliards de Fcfa alors que le
besoin de financement a augmenté de 526 à 700 milliards de Fcfa (Source : Document
de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle, DPBE, 2019-2021, 2022-
2024 et 2023-2025). La baisse des dons et des emprunts nets extérieurs ainsi que la
hausse du besoin de financement, ont concouru à baisser les dépenses publiques
liquidées en faveur des personnels de santé de 1,08%.
 |
62 62 |
▲back to top |
62
Une note méthodologique reportée en Annexe 5 documente l’approche utilisée dans le
cadre des analyses pour produire ces évidences déclinées ci-dessous.
Figure 57. Décomposition simple et évolutive des
dépenses publiques courantes liquidées en faveur
des personnels de santé, 2016-2021
Figure 58. Dépenses publiques liquidées en faveur
de la santé et des personnels de santé, 2016-2021
Source : DPBEP,2018-2020, 2019-2021 et 2022-2024 et Rapports sur la situation d’exécution budgétaire provisoire du budget
(2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Note : RHS : Ressources Humaines de la Santé.
Le niveau d’exécution budgétaire en faveur des personnels de santé a énormément baissé
au cours de ces dernières années. Les dotations budgétaires initiales planifiées pour le
financement public des personnels de santé ont été de moins en moins consommées. Le
taux réel d’exécution budgétaire10 en faveur des personnels de santé est passé de 99,2% à
21,9% entre 2016 et 2021. En 2021, près de 78,1% des dotations initiales à allouer aux
personnels de santé n’ont pas été liquidées (Figure 59).
10 Le taux réel d’exécution budgétaire représente les montants du budget liquidité en faveur des personnels de
santé en pourcentage des dotations initiales planifié en leur faveur.
13%
2%
76%
80%
11%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016-2018 2019-2021
Dépenses publiques totales
Priorisation de la santé dans le budget total
Priorisation des RHS dans budget-santé
13%
2
%
76%
80%
2%
1
3
%
1
%
1
%
7
%
4
%
0,05%
0,05%
2
%
0
,0
3
%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2016-2018
2019-2021
Priorisation des RHS dans budget-santé
Priorisation de la santé dans le budget total
Recettes publiques, excluant les dons
Dons
Financements domestiques
Emprunts nets extérieurs
Besoin de financement public
 |
63 63 |
▲back to top |
63
Figure 59. Taux réel d’exécution des dépenses dédiées aux
personnels de santé, 2016-2021
Source : DPBEP,2018-2020, 2019-2021 et 2022-2024 et Rapports sur la
situation d’exécution budgétaire provisoire du budget (2016, 2017, 2018,
2019, 2020)
3.4.2. Analyse comparative de la demande économique et du coût de l’offre en
matière de personnels de santé
Cette analyse consiste à estimer et à analyser conjointement la demande économique et le coût de
l’offre en matière de personnels de santé.
La demande économique se réfère à la capacité attendue du gouvernement à financer les dépenses
liées aux personnels de santé. De ce fait elle a été estimée à partir des projections des dépenses
publiques totales établies par le FMI en considérant inchangé le niveau de priorisation des personnels
de santé dans le budget total mais aussi celui des personnels de santé dans le budget dédié au secteur
de la santé. Après avoir estimé ces projections et dans l’optique de prendre en compte le secteur privé,
compte tenu des données indisponibles relatives au financement privé des personnels de santé, il a
été supposé qu’une proportion des dépenses publiques allouées aux personnels de santé seront
dédiée au secteur privé. Il s’agit de la part du secteur privé (dernière données renseignées) dans la
distribution des personnels de santé. Ainsi l’estimation de la demande économique a été réalisée à
partir de l’équation suivante :
??????????+1 = [
??????
??????
∗
??????
??????
∗ ????????+1] + [1 +
??????????????é??
??????????????????
]
Tels que :
??????????+1 : représente la dépense publique projetée en faveur des personnels de santé à l’année
« t+1 » ;
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
 |
64 64 |
▲back to top |
64
??????
??????
: représente la part des dépenses publiques de santé allouée aux personnels de santé. La dernière
valeur renseignée en 2021 a été considérée ;
??????
??????
: représente la part des dépenses publiques totales allouées au secteur de la santé. La dernière
valeur renseignée en 2021 a été considérée ;
??????????????é??
??????????????????
: représente la part des agents de santé du secteur privé dans le total des personnels de santé.
La dernière valeur renseignée en 2022 a été considérée.
S’agissant du coût attendu de l’offre en matière de personnels de santé, il a été calculé en pondérant
les projections de l’offre par les dépenses annuelles moyennes financées par l’État au profit des
personnels de santé. La dernière valeur renseignée de 2021 a été considérée.
Source : Analyses du Marché du Travail dans le secteur de la santé en Sierra Leone (2019) et au Lesotho
(2021).
En dépit de la baisse attendue de l’offre en matière de personnels de santé, le
Gouvernement sera doté d’une capacité insuffisante au financement du coût de ladite offre.
En effet, au cours de la période 2023-2028, la demande économique variera de 15,3 à 23,9
milliards de Fcfa (soit de 24 à 38,7 millions de dollars US) tandis que le coût lié à l’offre
attendue en matière de personnels de santé évoluera de 19,7 à 32 milliards de Fcfa (soit de
31,9 à 52 millions de dollars US11) (Figure 60). Les données chiffrées sur la demande
économique et le coût financier de l’offre en matière de personnels de santé, sont reportés
en Annexe 6.
Figure 60. Demande économique et le coût financier de
l’offre en matière de personnels de santé, 2023-2027
11 https://www.capital.fr/devises/cours/USD/XOF. Parité : 1 USD = 616,4141 Fcfa (dernière mise à jour le
04/03/2023 à 00h23).
10
15
20
25
30
35
2023 2024 2025 2026 2027 2028
En
m
ill
ia
rd
s
d
e
Fc
fa
Demande économique Coûts financiers de l'offre
 |
65 65 |
▲back to top |
65
Source : Données collectées auprès de la DNFCT et de la DNFPP, des
structures de santé et des établissements de formation et de la base de
données du FMI, (World Development Outlook, Octobre 2022). Note :
les données après 2027 ne sont pas renseignées.
4. Discussions
Cette section a vocation à documenter les messages clés de cette première phase de l’étude
tout en apportant des réponses explicites aux différentes questions de recherche. Elle apporte
explicitement des réponses aux différentes questions de recherche (QR).
Questions de recherche d’ordre descriptif
QR1. La production des personnels de santé s’est-elle accrue au cours de ces dernières
années ?
La production des diplômés sortis des formations initiales en santé a augmenté au cours de
ces dernières années, soit de 14,3% par an. Elle a aussi augmenté pour toutes les filières de
formations, surtout chez les étudiants issus des formations en médecine et pharmacie. Les
étudiants et élèves ont été majoritairement formés au Mali et surtout par les établissements
privés de formation.
QR2. Quelles sont les destinations les plus prises et les principales sources de financement
de la formation à l’étranger dans le secteur de la santé ?
Les destinations les plus prises de la formation à l’étranger dans le secteur de la santé sont le
Sénégal, la France et le Maroc. Ces formations ont été pour la plupart des cas financées sur
fonds propres.
QR3 : Les performances académiques des étudiants et élèves issus des formations en santé
ont-elles connu une amélioration au cours de ces dernières années ?
Dans bon nombre d’établissements de formation, les taux de réussite aux examens de fin
d’années ont baissé mais restent plus élevés dans les établissements publics comparativement
à ceux du secteur privé. C’est notamment le cas de l’Institut National de Formation en Sciences
de Santé et l’école de médecine. Toutefois, les établissements d’enseignement secondaire et
supérieur ainsi que les universités privées ont vu leur taux de réussite augmenter, même si
ces performances peuvent être davantage améliorées surtout dans les universités privées.
QR4 : Quelle est la composition des personnels de santé ?
Les Ressources Humaines de la Santé regroupent majoritairement des personnels
paramédicaux composés d’infirmiers, de sages-femmes et de techniciens de santé. Les
personnels de santé sont essentiellement composés d’hommes, de jeunes, de contractuels et
sont principalement employés par le secteur public, dépendant principalement de la fonction
publique de l’État.
 |
66 66 |
▲back to top |
66
QR5 : L’attrition des personnels de santé est-elle accrue ? Quels sont les principaux motifs à
l’origine de cette attrition ?
L’attrition des personnels de santé est restée faible et a légèrement baissé tant du côté de
l’ensemble des personnels de santé que de celui des catégories professionnelles, à l’exception
d’une part, des infirmiers et sages-femmes pour lesquels elle a légèrement augmenté et
d’autre part, des agents d’entretien, de sécurité et de déplacement, pour lesquels elle n’a
connu une aucune variation. De plus, il ressort que deux principaux motifs sont à l’origine de
l’attrition. Il s’agit des départs à la retraite suivie des décès.
QR6 : Les recrutements ont-ils augmenté au cours de ces dernières années ?
Les recrutements ont baissé de 6,5% par an au cours de ces dernières années. Cette baisse
résulte de la décroissance observée du nombre de recrutements réalisés par le secteur public.
Le secteur privé emploie moins de personnels de santé mais a entrepris des efforts afin
d’augmenter son niveau de recrutement.
QR7 : Les emplois crées ont-ils augmenté au cours de ces dernières années ?
Le nombre d’emplois nets crées a baissé du point de vue de l’ensemble des personnels de
santé, et à l’occurrence pour la majorité des catégories professionnelles, exception faite des
infirmiers et des personnels d’appui et administratifs. Il a baissé pour les personnels du secteur
public et augmenté en ce qui concerne ceux du secteur privé.
En outre, certaines catégories de personnels ont été confronté à des destructions d’emploi en
2022. C’est le cas des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens, des techniciens de
santé, des agents d’entretien, de sécurité et de déplacement ainsi des personnels du secteur
public.
Questions de recherche d’ordre analytique
QR8 : La disponibilité des personnels de santé s’est améliorée au cours des dernières années
mais peut-être davantage renforcée. Elle pourrait en effet s’améliorer davantage si la
hausse attendue de l’offre des personnels de santé est mise à profit à travers une meilleure
absorption sur le marché du travail.
La disponibilité des personnels de santé s’est accrue au fil des années compte tenu de
l’augmentation des densités clés de personnels de santé et de médecins, infirmiers et sages-
femmes, toutes évaluées pour 10 000 habitants. Prises individuellement, les densités des
personnels de santé par catégorie ont toutes augmenté à l’exception des infirmiers pour
lesquels la densité a stagné au fil du temps.
En outre, il ressort que la disponibilité des personnels de santé vus dans leur ensemble tout
comme par catégorie professionnelle, reste plus élevée dans les régions de Bamako et de Kidal
et plus faible à Ségou.
 |
67 67 |
▲back to top |
67
A noter que les résultats relatifs à la région de Kidal et même à celle de Gao devraient être
pris avec précaution car bon nombre de personnels de santé ont fait l’objet d’abandons de
poste au regard de la situation sécuritaire mais sont toujours considérés comme étant en
fonction dans lesdites régions.
L’offre de personnels de santé augmentera au cours des prochaines années. A ce propos, il
aurait été pertinent de confronter l’évolution prospective de l’offre en matière de personnels
de santé à celle des besoins. Malheureusement la disponibilité actuelle des données n’a pas
permis de réaliser une estimation des besoins attendus en personnels de santé.
QR9 : Les personnels de santé sont-ils égalitairement et inéquitablement répartis ?
La distribution régionale des personnels de santé reste inéquitable et inégalitaire. En effet, la
majorité des régions reçoit moins de personnels de santé qu’il aurait fallu pour prendre en
charge la population qu’elles abritent. Les régions de Gao, de Kidal et certainement de Bamako
font l’exception et regorgent d’un stock de personnels de santé supérieur à celui qu’elles
devraient avoir pour prendre en charge les populations qu’elles reçoivent. Parmi les
catégories professionnelles, il ressort que les sages-femmes sont les seules à être fortement
représentées qu’il n’aurait fallu pour prendre en charge les femmes en âge de procréer reçues
dans toutes les régions.
En outre, les personnels de santé restent concentrés aux niveaux supérieurs de la pyramide
sanitaire. Le premier échelon reçoit moins de personnels de santé alors qu’elle enregistre les
besoins de santé les plus essentiels et les pathologies les plus faciles à prendre en charge.
QR10 : La demande réagit-elle favorablement à l’offre entrante de personnels de santé sur
le marché du travail de la santé?
La demande en matière de personnels de santé réagit insuffisamment à l’offre entrante sur le
marché du travail de la santé. En effet, les diplômés sortis des formations en santé sont
insuffisamment absorbés, conduisant bon nombre au chômage. En 2021, seulement 11,7%
des diplômés étaient absorbés avec une proportion estimée à 43,8% en 2016. Cette
absorption insuffisante s’explique par la surproduction des diplômés provenant
essentiellement des établissements privés de formation, associée à la baisse observée des
recrutements provenant surtout du secteur public. En d’autres termes, il ressort que le secteur
privé, principal producteur de la main d’œuvre dans le secteur de santé, n’arrive pas à
absorber ce qu’il produit, comptant ainsi sur le secteur public, principal utilisateur de cette
main d’œuvre, pour absorber ce stock de diplômés. Toutefois, compte tenu de certaines
contraintes budgétaires (Cf. les QR relatifs au financement), l’État n’est pas en mesure
d’absorber à souhait dans la Fonction Publique, le stock produit et non employé par le secteur
privé. Ce faisant, beaucoup sont utilisés comme , contractuels plutôt que fonctionnaires.
Comparativement aux hommes, les femmes rencontrent plus de difficultés ou sont plutôt
moins incitées à intégrer le marché du travail dans le secteur de la santé. En effet
 |
68 68 |
▲back to top |
68
comparativement aux hommes, les femmes restent plus représentées dans la distribution des
diplômés tandis qu’elles le sont moins dans celle des personnels.
QR11 : Le financement public des personnels de santé s’est-il accru au cours de ces dernières
années ?
Le financement public des personnels de santé a baissé depuis 2019 ; cela à cause non
seulement de la baisse et du niveau faible de la priorisation du secteur de la santé dans les
allocations du budget total de l’État (de 3,7% à 1,1%) mais aussi des personnels de santé dans
le budget dédié au secteur de la santé (de 44,2% à 42,8%), L’enveloppe budgétaire totale s’est
élargie de 9,7% mais n’a pas suffi à contrer les effets associés à la baisse de la part du budget
total liquidée en faveur de la santé et celle du budget-santé dédié aux personnels de santé.
En outre, la baisse des flux réels de financement public ventilés en faveur des personnels de
santé provient de l’exécution très faible et en baisse du budget qui leurs est alloué. Le taux
réel d’exécution du budget dédié aux personnels de santé a baissé de 99,9% à 64,8% en 2019
et 21,9% en 2021
En outre, il ressort que les personnels de santé sont faiblement représentés dans la
distribution du budget dédié aux agents de la fonction publique. Les personnels de santé
employés par l’État ne recevaient qu’entre 2,7% en 2016 et 4,4% en 2021 du budget ventilé
en faveur des agents de la fonction publique.
QR12 : Le gouvernement disposera-t-il d’une capacité budgétaire suffisante pour financer
les coûts de l’offre attendue en matière de personnels de santé ?
Au cours des prochaines années, le Gouvernement, compte tenu de sa capacité budgétaire
limitée, ne sera pas en mesure de couvrir les coûts attendus de cette offre.
5. Principaux goulots d’étranglement, questions en suspens
et pistes d’analyse
Cette première phase de l’étude met en lumière un certain nombre de défis auxquels sont
confrontées les Ressources Humaines de la Santé au Mali. Toutefois, des questions restent en
suspens et mériteraient d’être élucidées au cours d’une seconde phase afin de mieux
comprendre les causes de ces défis pour définir des actions stratégiques visant à les contrer.
Ces goulots d’étranglement, assortis des questions en suspens, sont reportés ci-dessous :
- La disponibilité insuffisante des personnels de santé : quel est le supplément de
personnels de santé à recruter pour combler les besoins du système de santé ?
- Les disparités géographiques des personnels de santé : quelles sont les difficultés
rencontrées dans le processus d’affectation des personnels de santé en milieux
reculés, voire mal desservis ? Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour
inciter et retenir les personnels de santé à exercer dans les zones lointaines et mal
desservies ?
 |
69 69 |
▲back to top |
69
- L’absorption faible et en baisse des diplômés issus des formations en santé : quels sont
les facteurs à l’origine de la surproduction des diplômés formés par les établissements
privés de formation ? Quels sont les facteurs expliquant la difficulté pour les femmes
ou leur faible incitation éventuelle à intégrer le marché du travail de la santé à la sortie
de leur formation ?
- La détérioration des performances académiques des étudiants et élèves issus des
formations en santé : quels sont les goulots d’étranglement inhibant les performances
académiques des étudiants et élèves issus des formations en santé ?
- La baisse des financements publics destinés aux personnels de santé : quels sont les
facteurs à l’origine du niveau faible et en baisse du niveau de priorisation de la santé
dans les allocations budgétaires de l’État et du taux d’exécution réel du budget liquidé
en faveur des personnels de santé ?
- Combler les gaps analytiques de l’étude : Les taux de vacance de postes et le ratio de
disponibilité des personnels de santé ont-ils augmenté au cours de ces dernières
années ?
Afin de trouver des réponses à ces questions, il serait important d’investiguer davantage à
travers des analyses supplémentaires, surtout d’ordre qualitatif. Les pistes d’analyse sont
reportées ci-dessous :
- Conduire une évaluation des besoins en Ressources Humaines de la Santé, basés sur
le profil épidémiologique et la charge de travail des personnels de santé. Cette
évaluation quantitative permettra d’estimer les gaps de personnels de santé à recruter
au niveau national. De plus, elle servira à définir des normes en personnels de santé,
par type de structure de santé et par région, ce qui permettra d’identifier les
différentes régions et les centres de santé en déficit et en surplus de personnels de
santé. Cette évaluation nécessitera une revue documentaire et une exploitation de
bases de données secondaires tant nationales qu’internationales. Les documents clés
ainsi que les bases de données à exploiter seront identifiés par la suite. Il sera aussi
utile dans cette lancée de prévoir un entretien groupé auprès des personnels de santé
représentés par les différents ordres des personnels de santé, les sociétés savantes
(associations des professionnels de santé), l’alliance du secteur privé pour la
promotion de la santé et la fédération nationale des associations de santé
communautaire. Cet entretien devrait permettre de collecter des données et
informations nécessaires à l’estimation des besoins en matière de personnels de santé
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative afin d’inventorier les principaux goulots
d’étranglement inhibant l’affectation des personnels de santé en milieux reculés, voire
mal desservis. Un entretien groupé auprès du personnel de la DRH permettra dans un
premier temps d’identifier ces goulots d’étranglement. En second lieu, un
questionnaire adressé aux personnels de santé, permettra non seulement d’apprécier
leur avis quant aux goulots d’étranglement identifiés mais aussi et surtout de les
hiérarchiser afin d’en identifier ceux les plus prioritaires à adresser selon les personnels
 |
70 70 |
▲back to top |
70
de santé. L’accès aux personnels de santé pourrait s’établir à travers les différents
ordres des personnels de santé ainsi que les sociétés savantes telles que les
associations des professionnels de santé.
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative des préférences des personnels de
santé, surtout du genre féminin, en vue d’identifier les mécanismes les plus pertinents
à mettre en œuvre pour renforcer l’incitation de ces derniers à exercer dans les zones
reculées, voire mal desservies. Pour ce faire, il est suggéré dans un premier temps de
conduire une revue documentaire afin d’inventorier l’ensemble des mécanismes
d’incitation susceptibles d’être mis en œuvre au Mali. Ensuite, un entretien groupé
conduit auprès du personnel de la DRH permettra de recenser les mécanismes
existants de motivation et de fidélisation des personnels de santé. Dès lors,
l’investigation permettra de recenser les mécanismes existants et ceux susceptibles
d’être adoptés au Mali. A la suite de la revue documentaire et de cet entretien groupé,
il est recommandé de conduire une enquête auprès des personnels de santé à travers
les ordres et les associations de professionnels de santé. Cette enquête à conduire à
travers l’administration de questionnaires, permettra d’avoir l’avis des personnels de
santé sur : i) les mécanismes existants à abolir du fait de leur inefficacité, ii) les
mécanismes existants à maintenir du fait de leur efficacité et, iii) les mécanismes non
existants à adopter du fait de l’intérêt qui leurs est accordé par les agents de santé.
- Inventorier les personnels de santé sujets aux abandons de poste dans les régions
d’insécurité à savoir Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou, Taoudéni etc. Cet exercice
quantitatif permettra d’avoir une vue plus claire sur le nombre de personnels à
redéployer dans d’autres régions où le besoin est criard ou d’identifier à travers les
résultats de l’analyse des préférences, les alternatives d’incitation qui permettront à
ces derniers de rejoindre leur poste en dépit de l’insécurité. Pour ce faire, il sera requis
de procéder à travers une exploitation de la base de données de la DRH compilée
certainement à partir des informations transmises par l’ensemble des formations
sanitaires et structures hospitalières.
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative des facteurs expliquant la
surproduction des diplômés formés par les établissements privés de formation : à ce
propos, il est suggéré de conduire un entretien groupé auprès des établissements
privés de formation (universités privées, écoles de santé, etc.), du Centre National des
Concours de la Fonction Publique (CNCFP) et du Centre National des Examens et
Concours de l’Éducation (CNECE). Cet entretien permettra de déceler les facteurs à
l’origine de la surproduction des diplômés formés par les établissements privés de
formation. Par la suite, une cartographie des établissements privés de formation à
caractère formel et informel permettra de confirmer l’effectivité des goulots
d’étranglement constatés.
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative des facteurs expliquant la difficulté des
femmes ou leur faible incitation éventuelle à intégrer le marché du travail dans le
 |
71 71 |
▲back to top |
71
secteur de la santé. Pour ce faire, l’idéal serait de conduire un entretien groupé auprès
des diplômées du genre féminin, sorties de formation et à la recherche d’emploi. La
mise en liaison pourrait être établis à travers le canal des établissements de formation
et à l’occurrence des associations des anciens étudiants/élèves issus des
établissements de formation. Cet entretien devrait permettre d’inventorier les
différents facteurs recherchés. Ensuite, cet entretien serait l’occasion d’administrer un
questionnaire afin d’amener les personnels ciblés à prioriser les facteurs les plus
handicapant et suscitant le plus de difficultés pour les femmes à intégrer le marché du
travail. Le cas échéant, l’enquête sur les préférences des personnels de santé
permettrait de déceler : i) si les personnels de santé du genre féminin, ont été
confrontés à des difficultés pour intégrer le marché du travail à la sortie de leur
formation et, ii) dans quelle mesure ces difficultés ont été plus moins handicapantes ?
- Réaliser une analyse qualitative et quantitative des facteurs expliquant la baisse de la
performance académique des étudiants et élèves issus des formations en santé : dans
l’optique de conduire cette analyse à bon escient, il devrait être envisagé de conduire
des entretiens groupés auprès des établissements de formations. Compte tenu du
nombre conséquent d’établissements de santé, il est suggéré de se focaliser sur
l’Institut National de Formation en Sciences de Santé (INFSS), l’école de médecine et
une université privée à identifier. Ces entretiens devraient être conduits auprès des
étudiants et élèves, des enseignants et même des personnels administratifs. Ces
entretiens devraient être l’occasion d’administrer des questionnaires afin d’estimer et
de hiérarchiser les goulots d’étranglement recensés par ordre d’importance établie
selon l’avis des enquêtés.
- Réaliser une analyse qualitative des facteurs expliquant le niveau faible et en baisse
tant de la priorisation budgétaire en faveur de la santé et que du taux réel d’exécution
du budget dédié aux personnels de santé : des entretiens groupés conduits
séparément auprès des personnels de la CPS et du Ministère de l’Économie et des
Finances sont fortement recommandés.
- Calculer et analyser le taux de vacance de postes et le ratio de disponibilité des
personnels de santé : cet exercice permettra d’apprécier au mieux la réactivité de
l’offre entrante de personnels de santé à la demande. Cet exercice nécessitera de
collecter les données soit à travers une revue documentaire ou à partir d’une
exploitation des bases de données secondaires nationales de la Direction Nationale de
la Fonction Publique des Collectivités Territoriales, la Direction Nationale de la
Fonction Publique et du Personnel ou de la Direction Nationale de la Planification du
Développement.
La synthèse des goulots d’étranglement, des questions en suspens et des pistes d’analyse est
reportée dans le tableau ci-dessous.
 |
72 72 |
▲back to top |
Tableau 9. Matrice des défis, des questions en suspenses et des pistes d’analyse
Défis Questions en suspens Pistes d’analyse Approches de collecte de
données
Sources d’information
La disponibilité insuffisante
des personnels de santé
- Quel est le supplément de
personnels de santé à recruter pour
combler les besoins du système de santé ?
- Conduire une évaluation
quantitative des besoins en Ressources
Humaines de la Santé.
- Revue documentaire.
- Exploitation de bases
de données secondaires
nationales et internationales.
- A identifier
- Entretien groupé
- Ordres et associations des
professionnels de santé, Alliance du
secteur privé pour la promotion de la
santé Fédération nationale des
associations de santé communautaire.
Les disparités géographiques
des personnels de santé
- Quelles sont les difficultés
rencontrées dans le processus
d’affectation des personnels de santé en
milieux reculés, voire mal desservis ?
- Réaliser une analyse qualitative et
quantitative afin d’inventorier les principaux
goulots d’étranglement inhibant
l’affectation des personnels de santé en
milieux reculés, voire mal desservis.
- Entretien groupé - Direction des Ressources
Humaines du Ministère de la Santé et de
Développement Social.
- Quels sont les mécanismes à
mettre en œuvre pour inciter les
personnels de santé à exercer dans les
zones lointaines et mal desservie ?
- Inventorier les mécanismes
existants d’incitation des personnels de
santé.
- Revue documentaire - Internet
- Réaliser une analyse quantitative
des préférences des personnels de santé,
surtout du genre féminin.
- Entretien groupé - Ordres et associations des
professionnels de santé, Alliance du
secteur privé pour la promotion de la
santé Fédération nationale des
associations de santé communautaire.
- Inventorier les personnels de santé
sujets aux abandons de poste dans les
régions d’insécurité (Kidal, Gao, Ménaka,
Tombouctou, Taoudéni etc.).
- Exploitation de bases
de données nationales
- Direction des Ressources
Humaines du Ministère de la Santé et de
Développement Social.
- Quels sont les facteurs à l’origine
de la surproduction des diplômés formés
par les établissements privés de
formation ?
- Réaliser une analyse qualitative des
facteurs expliquant la surproduction des
diplômés formés par les établissements
privés de formation.
- Entretien groupé - Établissements privés de
formation.
- Centre National des Concours
de la Fonction Publique.
- Centre National des Examens et
Concours de l’Éducation.
 |
73 73 |
▲back to top |
73
L’absorption faible et en
baisse des diplômés issus des
formations en santé
- Réaliser une cartographie des
établissements privés de formation à
caractère formel et informel.
- Administration d’un
questionnaire
- Établissements privés de
formation.
- Centre National des Concours
de la Fonction Publique.
- Centre National des Examens et
Concours de l’Éducation.
- Quels sont les facteurs expliquant
la difficulté pour les femmes ou leur faible
incitation éventuelle à intégrer le marché
du travail de la santé à la sortie de leur
formation ?
- Réaliser une analyse qualitative et
quantitative des facteurs expliquant la
difficulté des femmes ou leur faible
incitation éventuelle à intégrer le marché du
travail dans le secteur de la santé.
- Entretien groupé - Diplômés du genre féminin,
sortis de formation et à la recherche
d’emploi (associations des anciens
étudiants/élèves issus des
établissements de formation)
- Administration d’un
questionnaire
La détérioration des
performances académiques
des étudiants et élèves issus
des formations en santé
- Quels sont les goulots
d’étranglement inhibant les performances
académiques des étudiants et élèves issus
des formations en santé ?
- Réaliser une analyse qualitative et
quantitative des facteurs expliquant la
baisse de la performance académique des
étudiants et élèves issus des formations en
santé.
- Entretiens groupés
- Administration d’un
questionnaire
- Institut National de Formation
en Sciences de Santé, école de médecine
et une université privée (élèves et
étudiants, enseignants et personnels
administratifs).
La baisse des financements
publics destinés aux
personnels de santé
- Quels sont les facteurs à l’origine
du niveau faible et en baisse du niveau de
priorisation de la santé dans les allocations
budgétaires de l’État et du taux
d’exécution réel du budget liquidés en
faveur des personnels de santé ?
- Réaliser une analyse qualitative des
facteurs expliquant le niveau faible et en
baisse tant de la priorisation budgétaire en
faveur de la santé et que du taux réel
d’exécution du budget dédié aux personnels
de santé.
- Entretiens groupés - Cellule de Planification et
Statistique du Ministère de la Santé et
du Développement Social
- Ministère de l’Économie et des
Finances.
Combler les gaps analytiques
de l’étude
- Les taux de vacance de postes et
le ratio de disponibilité des personnels de
santé ont-ils augmenté au cours de ces
dernières années ?
- Estimer et analyser le taux de
vacances de postes et le ratio de
disponibilité des personnels de santé
- Revue documentaire.
- Exploitation de bases
de données secondaires
nationales.
- Direction Nationale de la
Fonction Publique et du Personnel ;
- Direction Nationale de la
Fonction Publique des Collectivités
Territoriales ;
- Direction Nationale de la
Planification du Développement.
 |
74 74 |
▲back to top |
6. Prochaines étapes
Dans l’optique de poursuivre les investigations, il est envisagé :
- De tenir un atelier de restitution des résultats de la première phase de l’étude : cet
atelier sera l’occasion d’avoir une compréhension partagée des résultats obtenus,
d’identifier les points de réflexion à creuser davantage et de développer une feuille de
route pour la conduite de la seconde phase de l’étude.
- De conduire la seconde phase de l’étude : il est attendu : i) d’élaborer une note
méthodologique à partir des points de réflexions retenus lors de l’atelier de restitution,
ii) d’élaborer les outils de collecte (guides d’entretien, questionnaires), iii) d’organiser
et de conduire la collecte des données et, iv) d’élaborer le rapport de la seconde phase
de l’étude devant intégrer les principales causes des défis recensés au cours de la
première, assortis de recommandations stratégiques visant à les adresser.
- De tenir un atelier de validation des résultats de la seconde phase de l’étude.
- Finaliser et restituer le rapport de l’analyse du marché du travail incluant les résultats
des deux phases principales du processus.
 |
75 75 |
▲back to top |
75
Références
Documents consultés
- Chatham House Report (2014). Shared Responsibilities for Health: A Coherent Global
Framework for Health Financing.
- McIntyre D, Meheus F, Røttingen JA (2017). What level of domestic government health
expenditure should we aspire to for universal health coverage? Health Economics,
Policy, and Law, 12(2), 125-137.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2017). Rapport
provisoire sur la situation d’exécution du budget de l’État au 31 Décembre 2016.
Secrétariat Général.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2018). Rapport
provisoire sur la situation d’exécution du budget de l’État au 31 Décembre 2017.
Secrétariat Général.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2018). Document
de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel-DPBEP 2019-2021.
Direction Générale du Budget.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2019). Rapport
provisoire sur la situation d’exécution du budget de l’État au 31 Décembre 2018.
Secrétariat Général.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2019). Rapport
provisoire sur la situation d’exécution du budget de l’État au 30 Septembre 2019.
Secrétariat Général.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2021). Rapport
provisoire sur la situation d’exécution du budget de l’État au 31 Décembre 2020.
Secrétariat Général.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2021). Rapport
provisoire sur la situation d’exécution du budget de l’État au 31 Mars 2021. Secrétariat
Général.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2021). Document
de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel-DPBEP 2022-2024.
Direction Générale du Budget.
- Ministère de l’Économie et des Finances de la République du Mali (2022). Document
de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel-DPBEP 2023-2025.
Direction Générale du Budget.
- Ministère de la Santé et du Développement Social de la République du Mali (2021).
Programme de Développement Socio-Sanitaire 2020-2023-PRODESS IV. Cellule de
 |
76 76 |
▲back to top |
76
Planification et de Statistique Secteur Développement Social et Promotion de la
Famille.
- Ministère de la Santé et de l’Assainissement de la République de Sierra Leone (2019).
Analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Avec l’appui de l’OMS.
- Ministère de la Santé en République de Lesotho (2021). Analyse du marché du travail
dans le secteur de la santé : vers des investissements durables et fondés sur des
données probantes pour le personnel de santé. Avec l’appui de l’OMS.
- Stenberg K, Hanssen O, Edejer TTT, Bertram M, Brindley C, Meshreky A, Soucat A
(2017). Financing transformative health systems towards the achievement of the
health Sustainable Development Goals: a model for projected resource needs in 67
low-income and middle-income countries. The Lancet Global Health, 5(9), e875-e887.
 |
77 77 |
▲back to top |
77
Bases de données exploitées et Sites internet consultés
Bases de données primaires Bases de données secondaires
Internationales Nationales
- Base de données sur la situation
des personnels de santé des structures
de santé.
- Base de données sur la situation
des étudiants formés entre 2016 et
2021.
- Base de données sur la situation
des étudiants en cours de formation en
2022.
- Global Health Data (IHME).
- Global Health Expenditure
Database, OMS (2021).
- World Development
Indicators, Banque Mondiale.
- World Economic Outlook,
FMI (October 2022).
- Base de données sur la situation des
personnels de santé des Collectivités Territoriales
(DNFCT).
- Base de données sur la situation des
personnels de santé en activité de la fonction
publique de l’État (DNFPP).
- Base de données sur la situation des
recrutements des personnels de santé de la
fonction publique de l’État (CNCFP).
- Base de données sur la situation des
nouveaux diplômés du secondaire des écoles de
formations paramédicales (DGESRS).
- Base de données sur la situation des
étudiants formés à l’extérieur (DNPD).
- Base de données sur la situation des
recrutements des personnels de santé de la
fonction publique des Collectivités Territoriales
(CNCFP).
- Base de données sur les résultats des
concours de la fonction publique (CNCFP).
- Base de données sur les résultats des
concours de l’éducation (CNECE).
Sites internet consultés
- https://www.healthdata.org/mali
- https://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en
- https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#
- https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October
- https://budget.gouv.ml/?q=Bibliotheque
 |
78 78 |
▲back to top |
78
Annexes
Annexe 1. Liste des données secondaires collectées
Bases de
données
Taille de
l’échantillon
Thématique
Source de
données
Variable collectée
Taux de
complétude
Situation des
personnels de santé
des Collectivités
Territoriales
3 614
Disponibilité des
personnels de santé
DNFCT
Matricule 100%
Prénoms 100%
Nom 100%
Date de naissance 100%
Années de naissance 100%
Lieu de naissance 100%
Sexe 100%
Statut matrimonial 100%
Position statutaire (retraités, en
activité, décès, détachements,
prises de disponibilité, mises à
disposition)
100%
Année d’effet d’intégration 100%
Catégorie professionnelle 100%
Spécialité 99,6%
Grade (catégorie) 100%
Grade (classe) 75,1%
Grade (échelon) 75,1%
Valeur indiciaire (pour le calcul
du salaire brut)
99,4%
Région d’affectation 59,0%
Situation des
personnels de santé
en activité de la
fonction publique
de l’État
6 173
Disponibilité des
personnels de santé
DNFPP
Année de naissance 99,9%
Lieu de naissance 93,9%
Age 99,9%
Sexe 100%
Date de recrutement 100%
Ancienneté 100%
Date de prise de service 35,3%
Code Régime (stagiaire vs
titulaire)
100%
Catégorie professionnelle 100%
Spécialités 91,5%
Grade (catégorie) 92,8%
Grade (classe) 97,1%
Grade (échelon) 100%
Valeur indiciaire (pour le calcul
du salaire brute)
97,2%
Position statutaire (en activité,
détachements, en congés de
formation, en congés spéciaux,
suspensions administratives)
100%
Date d’affectation 80,9%
Région d’affectation 100%
Cercle d’affectation 26,1%
Commune d’affectation 17,9%
654 Production/ DNPD
Identifiant 100%
Age 79%
 |
79 79 |
▲back to top |
79
Bases de
données
Taille de
l’échantillon
Thématique
Source de
données
Variable collectée
Taux de
complétude
Situation des
étudiants formés à
l’extérieur
Formation des
personnels de santé
Sexe 100%
Nationalité 100%
Cycle de formation 100%
Pays de formation 100%
Nom et Prénoms 100%
Filière de formation 100%
Statut professionnelle (élèves,
étudiants, retraités, stagiaires)
100%
Structure utilisatrice du
personnel
46,9%
Source de financement de la
formation
100%
Année de retour au pays 100%
Situation des
recrutements des
personnels de santé
de la fonction
publique de l’État
947
Recrutement des
personnels de santé
CNCFP
Année 100%
Mention obtenue au concours
d’entrée à la fonction publique
100%
Catégorie professionnelle 100%
Spécialité 100%
Rang obtenu au concours
d’entrée à la fonction publique
100%
Prénoms 100%
Nom 100%
Sexe 100%
Date de naissance 100%
Lieu de naissance 100%
Région d’affectation 100%
Situation des
finalistes de
l’examen de fin de
cycle des écoles de
formation en santé
29 949
Formation des
ressources humaines en
santé
CNECE
Numéro de place 99.8%
Prénom et Nom 100%
Sexe 100%
Date de naissance 100%
Lieu de naissance 99,9%
Etablissement 99,9%
Centre d’examen 100%
Filière 100%
Total écrit et TP 100%
Moyenne d’admission 100%
Résultat 100%
Mention 66,9%
Présence 100%
Année (2016 à 2021) 100%
 |
80 80 |
▲back to top |
80
Annexe 2. Liste des données primaires collectées
Base de données Thématique Section Variable collectée Taux de
complétude
Collecte relative aux
personnels de santé des
structures de santé de
2016 à 2022
Disponibilité des
personnels de santé
Identification de la
structure de santé
Nom de la structure 80,0%
Sigle ou enseigne 72,4%
Nom du Responsable de la structure de santé 100%
Statut de la structure de santé 100%
Région 100%
Commune 100%
Cercle 100%
Quartier/localité 100%
Milieu de résidence 100%
Boite Postale 100%
Téléphone 100%
Fax 100%
Site Web 100%
E-Mail 100%
Date de création 100%
Date de démarrage 100%
Domaine d’intervention de la structure 82,2%
Situation des
personnels de
santé en activité
Catégorie professionnelle 100%
Spécialité 100%
Statut professionnelle (fonctionnaire vs
contractuel)
100%
Sexe 100%
Age 100%
Année 100%
Évolution du
nombre de
personnels de
santé, contractuel
de la structure
Catégorie professionnelle 15,6%
Spécialité 100%
Année 4,5%
Recrutements 6,7%
Départs à la retraite 35,6%
Décès 88,9%
Collecte relative aux
élèves/étudiants formés
au sein des
établissements de
formation de 2016 à 2021
Production/
Formation des personnels
de santé
Identification de
l’établissement de
formation
Nom de l’établissement 86,7%
Sigle ou enseigne 84,4%
Responsable de l’établissement de formation 100%
Statut de l’établissement de formation 100%
Région 80,0%
Commune 72,4%
Cercle 100%
Quartier/localité 100%
Milieu de résidence 100%
Boite Postale 100%
Téléphone 100%
Fax 100%
Site Web 100%
E-Mail 100%
Date de création 100%
Date de démarrage 100%
Nombre de filières de formation 100%
 |
81 81 |
▲back to top |
81
Base de données Thématique Section Variable collectée Taux de
complétude
Identification de
l’établissement de
formation
Nombre de diplômes ou attestation délivrés par
établissement de la santé
100%
Informations sur le
nombre
d’élèves/étudiants
formés
Filière de formation 100%
Corps 100%
Catégorie professionnelle 100%
Taux de réussite 100%
Sexe 100%
Nationalité 100%
Année 100%
Collecte relative aux
élèves/étudiants en cours
de formation à l’année
universitaire 2021-2022
Production/
Formation des personnels
de santé
Identification de
l’établissement de
formation
Nom de l’établissement 100%
Sigle ou enseigne 77,2%
Responsable de l’établissement de formation 100%
Statut de l’établissement de formation 100%
Région 100%
Commune 100%
Cercle 100%
Quartier/localité 8,8%
Milieu de résidence 100%
Boite Postale 3,5%
Téléphone 12,3%
Fax 40,3%
Site Web 91,2%
E-Mail 87,7%
Date de création 100%
Date de démarrage 100%
Nombre de filières de formation 100%
Nombre de diplômes ou attestation délivrés par
établissement de la santé
100%
Informations sur le
nombre
d’élèves/étudiants
en cours de
formation
Filière de formation 100%
Année d’étude (classe) 100%
Catégorie professionnelle 100%
Spécialité 100%
Niveau d’étude (premier cycle, licence, master,
doctorat, DES, Autres)
100%
Sexe 100%
Nationalité 77,2%
 |
82 82 |
▲back to top |
82
Annexe 3. Liste des données non collectées
Variables Thématiques
Salaires nets, y compris les indemnités des personnels de
santé des secteurs privé et public.
Rémunération des personnels de santé
Nombre de personnels de santé en exercice, réparti par
catégorie professionnelle, ayant émigré à l’étranger.
Migration internationale des personnels de santé
Nombre de personnels de santé au chômage, réparti par
catégorie professionnelle, ayant émigré à l’étranger.
Nombre de personnels de santé en exercice de la diaspora
ayant immigré au Mali
Nombre de personnels de santé étrangers ayant immigré
au Mali
Nombre de postes ouverts/établis par catégorie
professionnelle, par groupe de genre, par milieu de
résidence (urbain vs rural) et secteur d’exercice (public vs
privé)
Demande en personnels de santé
Nombre de postes ouverts/établis et financés par
catégorie professionnelle, par groupe de genre, par milieu
de résidence (urbain vs rural) et secteur d’exercice (public
vs privé)
Nombre de postes établis/ouverts et non financés par
catégorie professionnelle, par groupe de genre, par milieu
de résidence (urbain vs rural) et secteur d’exercice (public
vs privé)
Nombre de postes établis/ouverts, financés et vacants par
catégorie professionnelle, par groupe de genre, par milieu
de résidence (urbain vs rural) et secteur d’exercice (public
vs privé)
Nombre des personnels de santé de l’armée répartis par :
i) catégorie professionnelle, ii) par spécialité, iii) par groupe
de genre (femmes vs hommes), iv) milieu de résidence
(urbain vs rural), v) par région, vi) par position statutaire
(fonctionnaires vs contractuels) et, vii) catégorie
d’établissements de santé.
Situation des personnels de santé de l’Armée
Nombre recrutements des personnels de santé de
l’armée répartis par : i) catégorie professionnelle, ii) par
spécialité, iii) par groupe de genre (femmes vs hommes),
iv) milieu de résidence (urbain vs rural), v) par région, vi)
par position statutaire (fonctionnaires vs contractuels) et,
vii) catégorie d’établissements de santé.
Nombre de personnels de santé de l’Armée sujets à
l’attrition (départs à la retraites, détachement, départs
pour formation, mises à disposition, prises de disponibilité,
etc.)
Lieu et Age de naissance des personnels de santé de
l’Armée
Date de prise de service des personnels de santé de
l’Armée.
 |
83 83 |
▲back to top |
83
Variables Thématiques
Date de la dernière affectation chez les personnels de
santé de l’Armée.
Date du dernier avancement chez les personnels de santé
de l’Armée.
Grade des personnels de santé (catégorie, classe, échelon)
Valeur indiciaire des personnels de santé de l’Armée
Nombre des enseignants chercheurs répartis par : i)
catégorie professionnelle, ii) par spécialité, iii) par groupe
de genre (femmes vs hommes), iv) milieu de résidence
(urbain vs rural), v) par région, vi) par position statutaire
(fonctionnaires vs contractuels) et, vii) catégorie
d’établissements de santé.
Situation des enseignants chercheurs
Nombre recrutements des enseignants
chercheurs répartis par : i) catégorie professionnelle, ii)
par spécialité, iii) par groupe de genre (femmes vs
hommes), iv) milieu de résidence (urbain vs rural), v) par
région, vi) par position statutaire (fonctionnaires vs
contractuels) et, vii) catégorie d’établissements de santé.
Nombre de enseignants chercheurs sujets à l’attrition
(départs à la retraites, détachement, départs pour
formation, mises à disposition, prises de disponibilité, etc.)
Lieu et Age de naissance des enseignants chercheurs.
Date de prise de service des enseignants chercheurs.
Date de la dernière affectation chez les enseignants
chercheurs.
Date du dernier avancement chez les enseignants
chercheurs.
Grade des personnels de santé (catégorie, classe, échelon)
Valeur indiciaire des enseignants chercheurs.
 |
84 84 |
▲back to top |
84
Annexe 4. Note méthodologique d’estimation des projections de l’offre des personnels de
santé
Les projections de l’offre des personnels de santé ont été estimées à partir des formules
suivantes :
Offre (RHS)t,n = Qn + Ft,n − Yt,n
Tel que :
????,?? = ∑ ????−1,??,?? ∗ ????,??
??
??=1
????,?? = ????,?? + ????,??
Avec t, n, et ?? représentant respectivement les indices assignés à l’année, à la catégorie
professionnelle et à l’établissement de formation.
- ???? : représentant le nombre de personnels en exercice sur le marché du travail de la
santé, de la catégorie professionnelle « n » ;
- ????,?? : représentant le nombre des futurs diplômés à l’année « t » de la filière de
formation conduisant à exercer dans la catégorie professionnelle « n » ;
- ????−1,??,??: représentant le nombre d’étudiants/élèves en cours de formation, à l’année
« t-1 », de la filière de formation conduisant à exercer dans la catégorie professionnelle
« n » proposée par l’établissement de formation « ?? », ?? étant le nombre total
d’établissements de formation.
- ????,??: le taux de réussite aux examens de la filière de formation conduisant à exercer
dans la catégorie professionnelle « n », proposée par l’établissement de formation
« ?? », ?? étant le nombre total d’établissements de formation.
- ????,?? : représentant le niveau net d’attrition à l’année « t » des personnels de santé de
la catégorie professionnelle « n ».
- ????,?? : représentant les départs à la retraite à l’année « t » des personnels de santé de
la catégorie professionnelle « n ».
- ????,?? : représentant les autres motifs d’attrition. Pour le secteur public, il s’agit des
décès, des départs pour congés de formation et congés spéciaux, les mises à
disposition, les détachements, les prises de disponibilités et les suspensions
administratives. S’agissant du secteur privé, le seul motif d’attrition retenu en sus des
départs à la retraite (compte tenu de la disponibilité des données) se réfère aux décès.
Les projections des autres motifs d’attrition ont été estimées en pondérant le nombre
de personnels de santé en perspectives déflaquées des départs à la retraite par le taux
moyen d'.
 |
85 85 |
▲back to top |
85
Quelques détails d’estimations sont reportés ci-dessous.
Tableau 10. Détails d’estimation des projections de l’offre en matière de personnels de santé, 2023-
2030
Années
2023 2024
Offre Production Attrition Offre Production Attrition
Médecins (généralistes et spécialistes) 8 372 4 711 117 9 491 1 232 113
Infirmiers 8 581 3 867 95 9 807 1 325 99
Sages-femmes 4 654 1 167 178 5 272 793 176
Pharmaciens 3 618 2 117 120 3 598 93 114
Techniciens de santé 6 583 2 387 58 9 719 3 194 58
Personnels d’appui 2 873 432 158 2 758 42 156
Autres personnels de santé 236 0 0 236 0 0
AESD 1 827 0 162 1 666 0 161
Personnels administratifs 1 501 0 102 1 399 0 102
Secteur public 26 295 7 984 780 27 493 1 966 768
Secteur privé 11 950 6 697 209 16 453 4 715 212
Personnels de santé 38 246 14 682 989 43 946 6 680 980
Années
2025 2026
Offre Production Attrition Offre Production Attrition
Médecins (généralistes et spécialistes) 9 888 509 112 10 136 360 112
Infirmiers 10 550 834 92 11 206 739 83
Sages-femmes 5 879 783 176 6 478 780 181
Pharmaciens 3 541 59 115 3 479 51 113
Techniciens de santé 13 140 3 488 67 16 664 3 595 71
Personnels d’appui 2 615 4 147 2 462 0 154
Autres personnels de santé 236 0 0 236 0 0
AESD 1 505 0 161 1 344 0 161
Personnels administratifs 1 297 0 102 1 195 0 102
Secteur public 27 930 1 194 756 28 211 1 038 757
Secteur privé 20 721 4 484 216 24 989 4 487 219
Personnels de santé 48 652 5 678 972 53 200 5 525 977
Années
2027 2028
Offre Production Attrition Offre Production Attrition
Médecins (généralistes et spécialistes) 10 341 329 124 10 546 324 119
Infirmiers 11 833 720 94 12 459 717 90
Sages-femmes 7 074 779 183 7 669 778 183
Pharmaciens 3 414 48 114 3 346 47 115
Techniciens de santé 20 208 3 634 90 23 767 3 648 90
Personnels d’appui 2 313 0 148 2 162 0 151
Autres personnels de santé 236 0 0 236 0 0
AESD 1 184 0 160 1 024 0 160
Personnels administratifs 1 092 0 103 990 0 102
Secteur public 28 424 1 006 793 28 640 999 783
Secteur privé 29 271 4 505 223 33 559 4 515 227
Personnels de santé 57 695 5 511 1 016 62 199 5 514 1 010
Années
2029 2030
Offre Production Attrition Offre Production Attrition
 |
86 86 |
▲back to top |
86
Médecins (généralistes et spécialistes) 10 423 323 446 10 282 323 464
Infirmiers 12 878 716 297 13 291 716 303
Sages-femmes 7 772 778 676 7 874 778 676
Pharmaciens 3 127 47 266 2 905 47 268
Techniciens de santé 27 171 3 654 250 30 567 3 655 260
Personnels d’appui 1 754 0 408 1 338 0 416
Autres personnels de santé 231 0 5 226 0 5
AESD 513 0 511 3 0 510
Personnels administratifs 628 0 362 270 0 358
Secteur public 27 170 998 2 468 25 664 998 2 504
Secteur privé 37 326 4 520 753 41 092 4 522 756
Personnels de santé 64 496 5 518 3 221 66 755 5 519 3 260
Source : Estimations à partir des données collectées auprès de la DNFPP, de la DNFPCT, des structures de santé
et des établissements de formation.
 |
87 87 |
▲back to top |
87
Annexe 5. Note méthodologique relative à l’analyse de décomposition du financement public
des personnels de santé
Analyse de l’évolution passée du financement public des personnels de santé et de ses
déterminants :
Trois équations de décomposition ont été spécifiées :
Modèle simple: ???? = ????. ????. ???? (1)
Modèle intermédiaire: ???? = ???? + ???? + ???? + ???? + ???? (2)
Modèle augmenté: ???? = ???? ∗ ???? ∗ [???? + ???? + ???? + ???? + ????] (3)
Où :
- ???? : Dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des personnels de santé à
l’année « t » exprimé en Fcfa.
- ???? : Dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des personnels de santé en
pourcentage des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur du secteur de
la santé (notamment allouées à travers le Ministère de la Santé et du Développement
Social), à l’année « t ». Elles approximent la priorisation du budget-santé en faveur des
personnels de santé.
- ???? : Dépenses publiques domestiques liquidées en faveur du secteur de la santé en
pourcentage des dépenses publiques totales liquidés et propres de l’État. Elles
approximent la priorisation du budget total de l’État au profit du secteur de la santé.
- ???? : Dépenses publiques totales liquidées et propres de l’État, à l’année “t” et
exprimées en Fcfa.
- ???? : Recettes publiques excluant les dons à l’année “t”, exprimées en Fcfa.
- ???? : Financements domestiques incluant les financements des banques et des autres
institutions financières non bancaires, à l’année “t”, exprimés en Fcfa.
- ???? : Emprunts nets extérieurs à l’année “t”, exprimés en Fcfa.
- ???? : Dons à l’année “t”, exprimés en Fcfa.
- ???? : Autres sources de financement public (financements extérieurs, investissements
domestiques et extérieurs, dépenses sur fonds spéciaux et budgets annexes et besoin
de financement), à l’année « t », exprimées en Fcfa.
Pour (1) :
????(????) = ????(????) + ????(????) + ????(????)
????(????−1) = ????(????−1) + ????(????−1) + ????(????−1)
Les taux de croissance des variables sont approximés à partir de la différence entre leur
logarithmes népériens (ln) à l’année « t » et « t-1 ».
 |
88 88 |
▲back to top |
88
????(????) − ????(????−1)
= [????(????) − ????(????−1)] + [????(????) − ????(????−1)] + [????(????) − ????(????−1)]
Ainsi :
?̂??? = ?̂??? + ?̂??? + ?̂???
Où ?̂??? représente les taux de croissance :
?̂??? = ????(????) − ????(????−1)
?̂??? = ????(????) − ????(????−1)
?̂??? = ????(????) − ????(????−1)
?̂??? = ????(????) − ????(????−1)
Pour (2) :
?̂??? = ?̂???. (?̌??? + ?̌??? + ?̌??? + ?̌??? + ?̌???)
Où ?̌??? représentent les contributions des déterminants à la variation des dépenses publiques
totales. Ces variables portent notamment sur la variation entre deux années des déterminants
en pourcentage de la variation des dépenses publiques totales liquidées et propres de l’État.
?̌??? =
∆????
∆????
=
???? − ????−1
???? − ????−1
?̌??? =
∆????
∆????
=
???? − ????−1
???? − ????−1
?̌??? =
∆????
∆????
=
???? − ????−1
???? − ????−1
?̌??? =
∆????
∆????
=
???? − ????−1
???? − ????−1
?̌??? =
∆????
∆????
=
???? − ????−1
???? − ????−1
En conclusion :
?̂??? = ?̂??? + ?̂??? + ?̂???
Avec
?̂??? = ?̂???. (?̌??? + ?̌??? + ?̌???)
Ainsi
?̂??? = ?̂??? + ?̂???. (?̌??? +?̌??? + ?̌??? + ?̌??? + ?̌???)
Où:
?̂??? : Taux de croissance des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des
personnels de santé, étant fonction de :
 |
89 89 |
▲back to top |
89
- ?̂??? : Taux de croissance des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des
personnels de santé en pourcentage des dépenses publiques domestiques liquidées
en faveur de la santé ;
- ?̂??? : Taux de croissance des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur du
secteur de la santé en pourcentage des dépenses publiques totales liquidées et
propres de l’État ;
- ?̂??? : Taux de croissance des dépenses publiques totales liquidées et propres de l’État ;
- ?̌??? : Variation annuelle des recettes publiques, excluant les dons ;
- ?̌??? : Variation annuelle des financements domestiques ;
- ?̌??? : Variation annuelle des emprunts nets extérieurs ;
- ?̌??? : Variation annuelle des dons ;
- ?̌??? : Variation annuelle des autres sources de financement public ;
- ?̂???/?̂??? : Contribution de la priorisation du budget santé en faveur des personnels de
santé à la variation passée du volume des dépenses publiques domestiques liquidées
en faveur des personnels de santé ;
- ?̂???/?̂??? : Contribution de la priorisation du budget total en faveur du secteur de la santé
à la variation passée du volume des dépenses publiques domestiques liquidées en
faveur des personnels de santé ;
- ?̂???/?̂??? : Contribution du volume des dépenses publiques totales liquidées et propres
de l’État à la variation passée du volume des dépenses publiques domestiques
liquidées en faveur des personnels de santé ;
- (?̂??? ?̂???⁄ ). ?̌??? : Contribution des recettes publiques (excluant les dons), à la variation
passée du volume des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des
personnels de santé ;
- (?̂??? ?̂???⁄ ). ?̌??? : Contribution des financements domestiques à la variation passée du
volume des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des personnels de
santé ;
- (?̂??? ?̂???⁄ ). ?̌??? : Contribution des emprunts nets extérieurs à la variation passée du
volume des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des personnels de
santé ;
- (?̂??? ?̂???⁄ ). ?̌??? : Contribution des dons à la variation passée du volume des dépenses
publiques domestiques liquidées en faveur des personnels de santé.
- (?̂??? ?̂???⁄ ). ?̌??? : Contribution des autres sources de financement public à la variation
passée du volume des dépenses publiques domestiques liquidées en faveur des
personnels de santé.
 |
90 90 |
▲back to top |
90
Les équations ont été estimées et testées sur la période 2016-2021 selon la disponibilité des
données.
Annexe 6. Détails sur les projections de la demande économique et le coût financier de l’offre
en matière de personnels de santé
En Fcfa 2023 2024 2025
Demande économique des personnels de santé 15 269 056 514 16 792 851 873 18 773 763 352
Coûts de l'offre des personnels de santé 19 691 059 935 22 625 839 055 25 048 530 078
En Fcfa 2026 2027 2028
Demande économique des personnels de santé 20 379 386 965 22 054 568 342 23 863 969 737
Coûts de l'offre des personnels de santé 27 390 405 830 29 704 543 476 32 023 708 737
En dollars US 2023 2024 2025
Demande économique des personnels de santé 24 770 777 27 242 809 30 456 415
Coûts de l'offre des personnels de santé 31 944 532 36 705 583 40 635 881
En dollars US 2026 2027 Total
Demande économique des personnels de santé 33 061 195 35 778 819 38 714 185
Coûts de l'offre des personnels de santé 44 435 073 48 189 267 51 951 616
Source : Données collectées auprès de la DNFCT et de la DNFPP, des structures de santé et des établissements
de formation et de la base de données du FMI, (World Development Outlook, Octobre 2022). Note : les données
après 2027 ne sont pas renseignées. Note : Parité : 1 USD = 616.4141 Fcfa (dernière mise à jour le 04/03/2023 à
00h23). https://www.capital.fr/devises/cours/USD/XOF.
Copyright @ 2024 | ONEF .