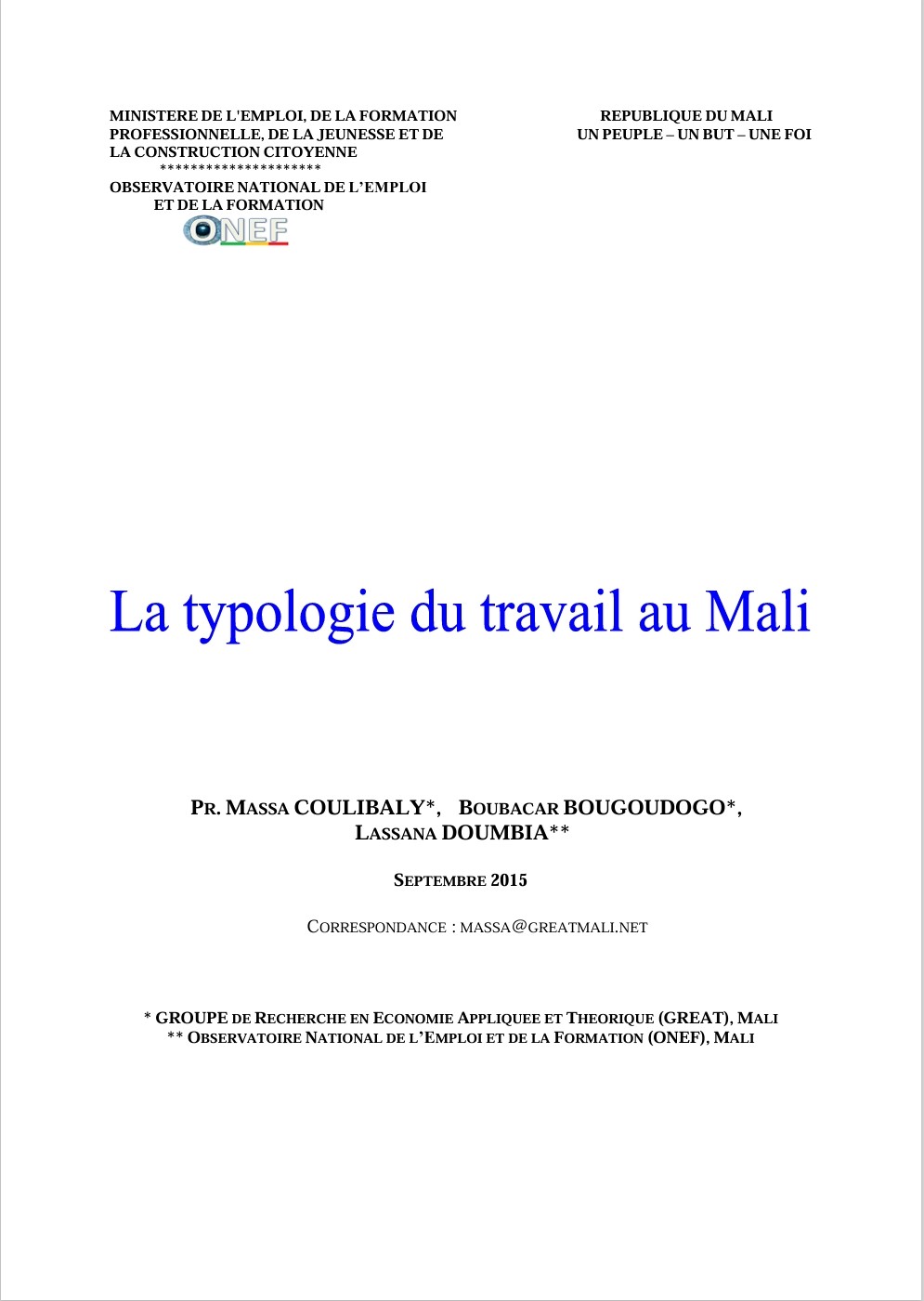MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN...
 |
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN... |
 |
1 1 |
▲back to top |
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI
PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
LA CONSTRUCTION CITOYENNE
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
PR. MASSA COULIBALY*, BOUBACAR BOUGOUDOGO*,
LASSANA DOUMBIA**
SEPTEMBRE 2015
CORRESPONDANCE : MASSA@GREATMALI.NET
* GROUPE DE RECHERCHE EN ECONOMIE APPLIQUEE ET THEORIQUE (GREAT), MALI
** OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF), MALI
 |
2 2 |
▲back to top |
Table des matières
Résumé .................................................................................................................................................................... 1
Introduction ............................................................................................................................................................. 1
1. Classification du travail ............................................................................................................................... 1
1.1. Travail domestique ................................................................................................................................. 4
1.1.1. Travail domestique non rémunéré ............................................................................................... 5
1.1.2. Travail domestique rémunéré ...................................................................................................... 6
1.2. Travail indépendant ................................................................................................................................ 7
1.2.1. Travail indépendant agricole ....................................................................................................... 9
1.2.2. Travail indépendant non agricole .............................................................................................. 10
1.3. Travail salarié ....................................................................................................................................... 12
1.3.1. Travail salarié formel ................................................................................................................ 14
1.3.2. Travail salarié informel ............................................................................................................. 16
1.4. Travail des enfants ................................................................................................................................ 17
2. Caractéristiques du travail .......................................................................................................................... 19
2.1. Conditions de travail ............................................................................................................................ 19
2.1.1. Forme de rémunération ............................................................................................................. 19
2.1.2. Contrat de travail ....................................................................................................................... 21
2.1.3. Durée de travail ......................................................................................................................... 23
2.1.4. Précarité de l'emploi .................................................................................................................. 25
2.1.5. Catégories socioprofessionnelles............................................................................................... 27
2.2. Emploi secondaire et emploi informel .................................................................................................. 28
2.2.1. Pluriactivité ............................................................................................................................... 28
2.2.2. De l'emploi informel .................................................................................................................. 29
2.3. Relations de travail ............................................................................................................................... 30
2.3.1. Couverture sociale ..................................................................................................................... 31
2.3.2. Dialogue social .......................................................................................................................... 31
2.3.3. Promotion du capital humain .................................................................................................... 33
2.4. Risques professionnels ......................................................................................................................... 34
2.4.1. Pénibilité de l'emploi ................................................................................................................. 35
2.4.2. Dangerosité de l'emploi ............................................................................................................. 35
2.4.3. Harcèlement sexuel sur le lieu de travail ................................................................................... 37
2.4.4. Discrimination ........................................................................................................................... 37
3. Déterminants du type de travail ................................................................................................................. 38
3.1. Déterminants de l'emploi ...................................................................................................................... 38
3.2. Modélisation économétrique de la probabilité d'exercer un type de travail ......................................... 39
Conclusions ........................................................................................................................................................... 41
Références bibliographiques ................................................................................................................................. 42
 |
3 3 |
▲back to top |
1
Onef
Résumé
Les données de l'EMOP 2014 permettent d'estimer à environ 5.5 millions d'individus, le
nombre d'actifs occupés, soit un taux d'emploi de 68% des maliens âgés de 15-64 ans. Le taux
de salariat n'est que de 4% des 6 ans et plus, soit 6% pour les actifs de 15 ans et plus ainsi que
pour les 15-64 ans, c'est dire combien le salariat est encore faible au Mali, c'est dire aussi
combien prédomine encore le statut de travailleur indépendant, surtout agricole.
Le peu d'emploi salarié est en outre à dominance informelle. Aussi n'y a-t-il au Mali que 182
mille salariés formels sur les 518 mille salariés, salariat formel dominé par les plus de 35 ans,
ce qui en exclut une bonne partie de la jeunesse parce que son rythme de progression est
nettement en deçà du taux d'arrivée de ces jeunes, y compris les plus diplômés, sur le marché
du travail.
Les caractéristiques particulières du marché malien du travail comprennent, entre autres, la
prédominance de la rémunération du travail au bénéfice ou à la vente, l'absence de contrat
sinon un contrat verbal, la précarité de l'emploi en terme d'emploi majoritairement irrégulier,
la pluriactivité des actifs, l'informalité grandissante, l'absence de couverture sociale des
travailleurs et la faiblesse des organes de dialogue social sur le lieu de travail, le peu
d'opportunité de promotion du capital humain et l'existence d'un certain de nombre
professionnels auxquels font face les travailleurs.
L'analyse multivariée de l'occupation d'un emploi a permis de régresser le statut de travail
(indépendant, agricole ou non agricole, salarié informel, salarié privé formel et salarié public
formel) sur un ensemble de facteurs dont les plus déterminants auront été le milieu de
résidence, l'âge et le sexe de l'individu et quelque le décile de revenu du ménage. Le modèle
élaboré à cet effet prédit plus correctement l'occupation d'en emploi salarié informel que le
classement erroné de non salariés informels dans ce statut de salariés informels.
Introduction
Le présent rapport se propose d'établir la typologie du travail sur la base des données de
l'enquête nationale EMOP 2014. Cette typologie se décline en classification du travail, allant
du travail domestique (rémunéré ou non) au travail salarié en passant par le travail
indépendant (agricole et non agricole) ainsi que le travail des enfants. A cette classification est
associée la caractérisation du travail en termes de conditions de travail, de l'emploi secondaire
et de l'emploi informel, de relations industrielles ou de travail et de risques professionnels tels
qu'ils se dégagent des données d'enquête. A la suite de ces deux sections, on procède à la
construction d'un modèle logistique multinomial de la probabilité d'occuper tel ou tel emploi
non sans présenter au préalable les principaux déterminants d'une telle probabilité.
1. Classification du travail
Les caractéristiques du travail, que les travailleurs soient du secteur marchand ou de la
fonction publique, doivent être définies avec précaution et sous certaines conditions. Ainsi,
l'INSEE (2014) procède à une classification entre "inactif" et "actif occupé" ainsi que
 |
4 4 |
▲back to top |
2
Onef
"chômeur". Une personne "inactive" est définie comme une personne qui n’est ni actif occupé
ni chômeur (jeunes scolaires, étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en
incapacité de travailler). A l'inverse, un actif occupé désigne une personne âgée de 15 ans ou
plus ayant travaillé (même une heure) au cours d’une semaine de référence, ou pourvue d’un
emploi mais qui en est temporairement absente. C'est ainsi que les apprentis et les stagiaires
rémunérés effectuant un travail sont des actifs occupés. Enfin, le chômeur indique une
personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions, à
savoir:
être sans emploi (i.e. ne pas avoir travaillé, même une heure) durant une semaine de
référence
être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours et
chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 3
mois.
Pour évaluer le marché du travail, on utilise le concept de taux d'emploi qui "n'est pas une
mesure évidente, spontanée, de la situation du marché du travail" (Raveaud, 2006).
Néanmoins, ce concept a aussi bien l'avantage de compléter le taux de chômage que de
justifier par la pérennité des systèmes de protection sociale et l'équilibre des comptes publics.
Ainsi, l'Union européenne fixe comme objectif en la matière un taux d'emploi de 70%, taux
que seulement 4 pays atteignent (dont le Danemark, 76% et l'Angleterre, 72%) et 15
nettement en deçà de cette barre (e.g. France, 62% et Italie, 58%).
De façon générale, la typologie du travail peut être décrite selon les modes de mise au travail
(travail libre, salarié ou forcé) et le type d'activité (marchand ou non marchand). On
distinguera ainsi le travail indépendant du travail salarié, les deux constituant le travail
rémunéré i.e. l'emploi. Ce dernier exclurait le travail domestique non rémunéré et le travail
forcé sous forme de corvées voire d'esclavage.
Tableau 1. Typologie du travail
Mode de mise au travail
Travail libre Travail salarié Travail forcé
Type
d'activités
Activités non marchandes Travail domestique Salariés des administrations/ménages Esclavage,
corvées Activités marchandes Travail indépendant Salariés des entreprises
Travail rémunéré = emploi
Source: Economie du Travail, 2012
A son tour, l'emploi peut être sérié en emploi formel et informel, chacune de ces formes
pouvant être répartie entre catégories socioprofessionnelles et secteur d'activité, lequel secteur
peut être à son tour formel ou informel. Les données de l'EMOP 2014 permettent d'estimer à
environ 5.5 millions le nombre d'actifs occupés, avec une prédominance rurale (77% de cet
effectif), Bamako et le reste du milieu urbain se partageant presque égalitairement le quart de
la population active occupée, soit un taux d'emploi de 68% des maliens âgés de 15-64 ans,
sous-emploi compris. Trois classes d'âge se partagent tout aussi presque égalitairement les 9
dixièmes de l'emploi total, les 15-24 ans (pour 27%), les 25-35 ans (pour 31%) et les 41-64
ans (pour 30%). C'est dire que les 36-40 ans et les plus de 64 ans représentent à peine 10% du
marché total. Les femmes sont légèrement sous représentées comparativement aux hommes,
46% de l'emploi contre 56%. Il n'y a presque pas d'inégalité par décile de revenu des
ménages. Il y a par contre une nette dominance des analphabètes, liée à leur poids important
dans la population active et dans la population du Mali plus généralement.
 |
5 5 |
▲back to top |
3
Onef
Tableau 2. La situation des actifs occupés
Total
Strate
Bamako 647 836
Autre urbain 594 453
Rural 4 251 985
Décile de revenu
D1 434 792
D2 531 670
D3 518 538
D4 560 789
D5 567 192
D6 558 506
D7 566 605
D8 571 928
D9 569 752
D10 614 502
Sexe
Homme 2 957 495
Femme 2 536 780
Age
15 - 24 ans 1 494 703
25 - 35 ans 1 697 847
36 - 40 ans 652 826
41 - 64 ans 1 648 898
Fréquentation scolaire
N'a jamais fréquenté l'école 4 059 359
Ne fréquente plus l'école 1 267 096
Fréquente toujours l'école 167 819
Education
Aucun niveau 4 063 510
Maternel 7 057
Fondamental 1 780 341
Fondamental 2 389 019
Secondaire 176 977
Supérieur 77 370
Diplôme
N'a pas été à l'école 4 059 359
Aucun diplôme 1 077 853
DEF 101 578
CAP 65 594
BT 92 432
BAC 20 811
BTS/DEUG 19 721
Licence 46 639
Master 4 345
Doctorat 5 942
Total 5 494 274
Source: EMOPP 2014
Les mêmes données EMOP (2014) permettent d'estimer à plus de 400 mille le nombre de
seniors (les plus de 64 ans), soit 70% de cette sous-population. Les seniors occupés le sont
plus en milieu rural, dans les activités domestiques (9 emplois sur 20) et agricoles (plus de la
moitié). Le travail des seniors est caractérisé par la ruralité, l'analphabétisme, l'informalité et
la masculinité de l'emploi (à l'exception du travail domestique). Leur salariat se recrute plus
dans les ménages de déciles supérieurs de revenu, soit la couche supérieure de la classe
moyenne, déciles 8 et 9 et la classe riche, décile 10.
 |
6 6 |
▲back to top |
4
Onef
Tableau 3. Travail des plus de 64 ans (en % et effectif total)
Domestique Indépendant agricole Salarié
Strate
Bamako 7 8 24
Autre urbain 11 8 10
Rural 82 84 66
Décile de revenu
D1 6 7
D2 8 10
D3 10 8 2
D4 15 10
D5 10 11 1
D6 12 13
D7 9 12 33
D8 11 11 25
D9 10 10 15
D10 9 11 23
Sexe
Homme 36 70 100
Femme 64 30
Fréquentation scolaire
N'a jamais fréquenté l'école 96 94 72
Ne fréquente plus l'école 4 6 28
Fréquente toujours l'école 0 0
Education
Aucun niveau 96 94 72
Fondamental 1 3 5 10
Fondamental 2 0 0
Secondaire 1 1 11
Supérieur 0 7
Informalité
Secteur informel 100 100 73
Secteur formel 0 0 27
Total 203 018 227 463 7 770
Source: EMOPP 2014
1.1. Travail domestique
Au total, le travail domestique concerne 55% de l'ensemble des 6 ans et plus au Mali. C'est un
effectif de 7 millions d'individus sur les près de 13 millions d'individus âgés de 6 ans et plus.
Il est essentiellement pratiqué par les femmes qui ont un taux de 79% des femmes âgées de 6
ans et plus contre seulement 30% des hommes de la même tranche d'âge. Il est en outre
légèrement plus rural qu'urbain avec plus de 10 points de pourcentage d'écart entre le milieu
rural et le district de Bamako.
Tableau 4. Situation du travail domestique (en % et milliers)
Travail domestique
Total des 6 ans et plus
Effectif % Taux
Strate
Bamako 781 11 46% 1 710
Autre urbain 898 13 54% 1 666
Rural 5 493 77 57% 9 594
Sexe
Homme 1 913 27 30% 6 324
Femme 5 260 73 79% 6 646
Age
6 - 14 ans 1 813 25 42% 4 305
15 - 24 ans 1 730 24 63% 2 729
25 - 35 ans 1 608 22 70% 2 305
36 - 40 ans 564 8 68% 827
41 - 64 ans 1 255 17 58% 2 182
plus de 64 ans 203 3 33% 623
Education
Aucun niveau 4 873 68 59% 8 205
Fondamental 1 1 553 22 48% 3 216
Fondamental 2 557 8 52% 1 074
Secondaire 144 2 44% 328
Supérieur 47 1 32% 148
Total 7 174 100 55% 12 971
Source: EMOPP 2014
 |
7 7 |
▲back to top |
5
Onef
Au total, le taux de travail domestique augmente avec l'âge jusqu'à 35 ans puis décroît. Ainsi,
il passe de 42% pour les 6-14 ans à 70% pour les 25-35 ans en passant par 63% pour les 15-24
ans. En valeur absolue, la classe d'âge des 6-14 ans (1.8 millions de travailleurs domestiques)
est suivie respectivement par la classe des 15-24 ans (1.7) et la classe des 25-35 ans (1.6).
Ainsi, en termes d'effectifs absolus, les plus jeunes fournissent les plus gros contingents de
travailleurs domestiques, 72% ont 35 ans et moins. Par niveau d'éducation, le taux de travail
domestique diminue en passant d'aucun niveau au fondamental 1 puis augmente au
fondamental 2 pour ensuite diminuer continuellement au secondaire puis au supérieur. En
termes absolus, les analphabètes représentent les deux tiers des travailleurs domestiques (4.87
millions)
La situation est légèrement différente au regard de l'activité principale du travailleur
domestique (ainsi que du secteur dans lequel est classée cette activité principale) et au regard
aussi de la taille de l'entreprise où cette activité principale est exercée. D'abord sur les 7
millions de travailleurs domestiques, 4 millions exercent une autre activité principale, les 3
autres millions ayant le travail domestique comme activité principale voire exclusive, que ce
travail soit rémunéré ou non. Comme il fallait s'y attendre, le personnel de maison exerce
principalement du travail domestique, 63% de taux d'exercice, mais curieusement, le taux est
quasiment le même pour les travailleurs exerçant dans les entreprises privées, 62% d'entre eux
sont concernés par les activités domestiques. Les moins impliqués par contre sont les
travailleurs de l'administration publique, des entreprises publiques et ceux exerçant dans les
organisations de la société civile (entre 38 et 43% contre une moyenne nationale de 62%). Les
services non marchands et l'industrie sont les deux secteurs d'activités qui détachent quelque
peu des corvées domestiques tout comme les entreprises de plus de 50 employés.
Tableau 5. Situation du travail domestique par activité (en % et milliers)
Travail domestique
Effectif total
Effectif % Taux
Activité principale
Administration publique 45 1 38% 117
Entreprise publique 15 0 43% 36
Entreprise privée 2 901 70 62% 4 665
Entreprise associative/ONG 37 1 42% 87
Organisme international 1 0 53% 1
Personnel de maison 1 141 28 63% 1 823
Secteur d'activité
Agriculture 2 980 72 63% 4 693
Industrie 258 6 53% 490
Service marchand 663 16 60% 1 102
Service non marchand 237 6 54% 443
Taille de l'entreprise
1 personne (auto-emploi) 1 235 30 74% 1 657
2-5 personnes 1 789 43 57% 3 119
6-10 personnes 739 18 58% 1 278
11-50 personnes 304 7 61% 495
plus de 50 personnes 11 0 44% 25
Total 4 139 100 62% 6 729
Source: EMOPP 2014
1.1.1. Travail domestique non rémunéré
La quasi-totalité du travail domestique est sans rémunération (99.7%). Il est de 100% pour
tous les actifs qui ont une autre activité principale, chez les élèves ainsi que chez tous ceux
qui ont le niveau secondaire d'éducation au moins. Il en est de même pour les ménages des
premier et quatrième déciles de revenus, soit tous des ménages pauvres. Les taux de travail
 |
8 8 |
▲back to top |
6
Onef
domestique gratuit sont différenciés selon la strate, le sexe, les classes d'âge et le niveau
d'éducation. Ainsi, les taux les plus élevés s'observent en milieu rural, chez les femmes, les
15-40 ans (la population jeune au sens du Mali) ainsi que chez les analphabètes. Le taux total
est le même que celui du travail domestique tout court, qu'il soit ou non rémunéré compte
tenu justement du poids écrasant de la gratuité dans l'activité domestique (études, entretien de
maison, cuisine, recherche de bois, corvée d'eau, garde des enfants et personnes malades,
réparations diverses, etc.).
Tableau 6. Situation du travail domestique non rémunéré (en % et milliers)
Travail domestique non rémunéré
Total des 6 ans et plus
Effectif % Taux
Strate
Bamako 773 11 45% 1 711
Autre urbain 897 13 54% 1 666
Rural 5 486 77 57% 9 594
Sexe
Homme 1 903 27 30% 6 325
Femme 5 253 73 79% 6 646
Age
6 - 14 ans 1 812 25 42% 4 305
15 - 24 ans 1 720 24 63% 2 729
25 - 35 ans 1 604 22 70% 2 305
36 - 40 ans 563 8 68% 827
41 - 64 ans 1 254 18 58% 2 182
plus de 64 ans 203 3 33% 623
Education
Aucun niveau 4 860 68 59% 8 205
Fondamental 1 1 550 22 48% 3 216
Fondamental 2 555 8 52% 1 074
Secondaire 144 2 44% 328
Supérieur 47 1 32% 148
Total 7 156 100 55% 12 791
Source: EMOPP 2014
La situation est la même quand on observe les travailleurs domestiques au regard de leurs
activités principales différentes de ce qui se fait à domicile.
Tableau 7. Situation du travail domestique non rémunéré par activité (en % et milliers)
Travail domestique non rémunéré
Effectif total
Effectif % Taux
Activité principale
Administration publique 45 1 38% 117
Entreprise publique 15 0 43% 36
Entreprise privée 2 901 70 62% 4 665
Entreprise associative/ONG 37 1 42% 87
Organisme international 1 0 53% 1
Personnel de maison 1122 27 62% 1 823
Secteur d'activité
Agriculture 2 974 72 63% 4 693
Industrie 258 6 53% 490
Service marchand 661 16 60% 1 102
Service non marchand 228 6 51% 443
Total 4 121 100 61% 6 729
Source: EMOPP 2014
1.1.2. Travail domestique rémunéré
A l'opposé du travail domestique gratuit, le travail domestique rémunéré concerne une part
négligeable de la population, 18'137 individus au total. Ceux-ci sont majoritairement jeunes,
non scolarisés ou déscolarisés. Le taux moyen n'est que de 0.3%, avec près de deux fois plus à
Bamako et chez les 15-24 ans. Naturellement, tous les domestiques avec rémunération sont
des employés de maison.
 |
9 9 |
▲back to top |
7
Onef
Tableau 8. Situation du travail domestique rémunéré (en % et milliers)
Travail domestique rémunéré
Effectif total
Effectif % Taux
Strate
Bamako 9 50 0.5% 1 711
Autre urbain 2 11 0.1% 1 666
Rural 7 39 0.1% 9 594
Sexe
Homme 10 56 0.2% 6 325
Femme 8 44 0.1% 6 646
Age
6 - 14 ans 2 11 0.0% 4 305
15 - 24 ans 10 56 0.4% 2 729
25 - 35 ans 4 22 0.2% 2 305
36 - 40 ans 1 6 0.1% 827
41 - 64 ans 1 6 0.0% 2 182
plus de 64 ans 0 0 0.0% 623
Fréquentation
scolaire
Jamais fréquenté 13 72 0.2% 7 859
Ne fréquente plus 5 28 0.2% 1 875
Fréquente toujours 0 0 0.0% 3 237
Education
Aucun niveau 13 72 0.2% 337
Fondamental 1 3 17 0.1% 3 216
Fondamental 2 2 11 0.2% 1 074
Secondaire 0 0 0.0% 328
Supérieur 0 0 0.0% 148
Type d'entreprise
Administration publique 0 0 0.0% 117
Entreprise publique 0 0 0.0% 36
Entreprise privée 0 0 0.0% 4 665
Entreprise associative/ONG 0 0 0.0% 87
Organisme international 0 0 0.0% 1
Personnel de maison 18 100 1.0% 1 823
Taille de l'entreprise
1 personne (auto-emploi) 5 28 0.3% 1 657
2-5 personnes 5 28 0.2% 3 119
6-10 personnes 4 22 0.3% 1 278
11-50 personnes 4 22 0.8% 495
plus de 50 personnes 0 0 0.0% 25
Secteur d'activité
Agriculture 5 28 0.1% 4 693
Industrie 1 6 0.1% 490
Service marchand 3 17 0.2% 1 102
Service non marchand 9 50 2.1% 443
Total 18 100 0.3% 6 729
Source: EMOPP 2014
1.2. Travail indépendant
Les résultats de l'enquête permettent d'isoler le travail indépendant. En effet, les travailleurs
indépendants sont estimés à 6.2 millions, soit 48% de l'effectif total des 6 ans et plus. La
plupart des travailleurs indépendants se retrouvent en milieu rural avec une part du total de
84% contre 9% en autre urbain et 7% à Bamako. On observe très peu de variations en
analysant cette population par décile de revenu. Enfin, l'on remarque une dominance
masculine sur ce segment de marché du travail avec un taux de 54% contre 46% pour les
femmes.
Tableau 9. Situation du travail indépendant par strate, décile et sexe (en % et milliers)
Travailleur indépendant
Effectif total
Effectif % Taux
Strate
Bamako 448 7 26% 1 711
Autre urbain 526 8 32% 1 666
Rural 5 238 84 55% 9 594
Décile de revenu D1 545 9 43% 1 258
 |
10 10 |
▲back to top |
8
Onef
D2 663 11 54% 1 237
D3 672 11 57% 1 184
D4 708 11 55% 1 297
D5 694 11 54% 1 279
D6 666 11 52% 1 283
D7 652 10 50% 1 314
D8 610 10 46% 1 333
D9 539 9 40% 1 337
D10 462 7 32% 1 449
Sexe
Homme 3 358 54 53% 6 325
Femme 2 854 46 43% 6 646
Total 6 212 100 48% 12 971
Source: EMOPP 2014
Répartis par classe d'âge, l'on remarque une plus grande dominance des "adultes" avec un
effectif de plus de 3 millions sur les 6.2 millions de travailleurs indépendants, soit 49%, avec
respectivement 25% et 24% pour les classes d'âge 25-35 ans et 41-64 ans. L'on observe
également que les plus forts taux de travailleurs indépendants sont de la tranche d'âge 25-64
ans (avec successivement 71% pour la classe 36-40; 69% pour celle des 41-64 ans et enfin
66% pour celle des 25-35 ans). Enfin, le travail indépendant est marqué par l'analphabétisme,
le faible niveau scolaire, la forte présence de l'agriculture et du secteur informel. Ainsi, seuls
10 milliers de titulaires de licence comme diplôme sont recrutés dans ce milieu sur un total de
plus de 6 millions d'individus.
Tableau 10. Situation du travail indépendant par classe d'âge et par niveau d'éducation (en % et milliers)
Travailleur indépendant
Effectif total
Effectif % Taux
Age
6 - 14 ans 982 16 23% 4 305
15 - 24 ans 1 384 22 51% 2 729
25 - 35 ans 1 529 25 66% 2 305
36 - 40 ans 584 9 71% 827
41 - 64 ans 1 504 24 69% 2 182
Plus de 64 ans 227 4 37% 623
Fréquentation scolaire
Jamais fréquenté 4 800 77 61% 7 859
Ne fréquente plus 1 037 17 55% 1 875
Fréquente toujours 375 6 12% 3 237
Education
Aucun niveau 4 806 77 61% 7 868
Maternel 21 0 6% 337
Fondamental 1 1 009 16 31% 3 216
Fondamental 2 310 5 29% 1 074
Secondaire 49 1 15% 328
Supérieur 17 0 11% 148
Diplôme
N'a pas été à l'école 4 800 77 61% 7 859
Aucun diplôme 1 282 21 30% 4 310
DEF 64 1 20% 323
CAP 22 0 17% 132
BT 19 0 13% 139
BAC 10 0 16% 61
BTS/DEUG 5 0 10% 53
Licence 10 0 12% 81
Master 0 0 1% 7
Doctorat 1 0 9% 7
Total 6 212 100 48% 12 971
Source: EMOPP 2014
 |
11 11 |
▲back to top |
9
Onef
1.2.1. Travail indépendant agricole
Au total, près de trois quarts des travailleurs indépendants sont des indépendants agricoles
avec des taux d'agricoles parmi les indépendants de 85% en milieu rural et 33% dans les
communes urbaines autres que celles de Bamako. Seulement, 2% des travailleurs
indépendants sont agricoles dans la capitale. L'on observe très peu de variation des taux
d'indépendants agricoles dans le total des indépendants par décile de revenu sauf pour le
décile 10 où seulement 28% des indépendants sont des indépendants agricoles.
Tableau 11. Situation du travail indépendant agricole par strate, sexe et décile (en % et milliers)
Indépendants agricoles
Total indépendants
Effectif % Taux
Strate
Bamako 7 0 2% 448
Autre urbain 175 4 33% 526
Rural 4 477 96 85% 5 238
Sexe
Homme 2 624 56 78% 3 358
Femme 2 035 44 71% 2 854
Décile
D1 503 11 92% 545
D2 603 13 91% 663
D3 579 12 86% 672
D4 623 13 88% 708
D5 575 12 83% 694
D6 514 11 77% 666
D7 475 10 73% 652
D8 385 8 63% 610
D9 273 6 51% 539
D10 130 3 28% 462
Total 4 660 100 75% 6 212
Source: EMOPP 2014
Par classe d'âge, l'on remarque une plus grande dominance des jeunes de 35 ans au plus avec
un effectif de plus de 3.06 sur les 4.66 millions d'indépendants agricoles, soit 65% de l'effectif
total des indépendants agricoles. L'on observe également que les plus fortes proportions
d'indépendants agricoles dans la population des indépendants sont parmi les moins de 15 ans
(avec toutefois un très faible effectif absolu, moins d'un million d'enfants) suivis des 15-24
ans puis des 25-35 ans. Enfin, les plus grands effectifs d'indépendants agricoles sont aussi
sans niveau d'enseignement ou n'ayant jamais fréquenté l'école.
 |
12 12 |
▲back to top |
10
Onef
Tableau 12. Situation du travail indépendant agricole par âge et éducation (en % et milliers)
Indépendant agricole
Total indépendants
Effectif % Taux
Age
6 - 14 ans 869 19 88% 982
15 - 24 ans 1 100 24 79% 1 384
25 - 35 ans 1 087 23 71% 1 529
36 - 40 ans 399 9 68% 584
41 - 64 ans 1 051 23 70% 1 504
Plus de 64 ans 154 3 68% 227
Fréquentation scolaire
N'a jamais fréquenté l'école 3 757 81 78% 4 800
Ne fréquente plus l'école 593 13 57% 1 037
Fréquente toujours l'école 309 7 82% 375
Niveau d'éducation
Aucun niveau 3 760 81 78% 4 806
Maternelle 17 0 80% 21
Fondamental 1 706 15 70% 1 009
Fondamental 2 160 3 52% 310
Secondaire 13 0 27% 49
Supérieur 4 0 21% 17
Diplôme obtenu
N'a pas été à l'école 3 757 81 78% 4 800
Aucun diplôme 859 18 67% 1 282
DEF 26 1 41% 64
CAP 6 0 29% 22
BT 4 0 23% 19
BAC 4 0 38% 10
BTS/DEUG 0 0 7% 5
Licence 2 0 22% 10
Master 0 0 0% 0
Doctorat 0 0 41% 1
Total 4 660 100 75% 6 212
Source: EMOPP 2014
1.2.2. Travail indépendant non agricole
L'effectif des travailleurs indépendants non agricoles est estimé à 1.55 millions d'individus au
total, soit 25% des 6.2 millions de travailleurs indépendants. Sur cet effectif, 49% sont du
milieu rural, 28% de Bamako et 23% pour le reste du milieu urbain. Le plus fortes proportions
d'indépendants non agricoles dans la population des indépendants sont observées à Bamako
puis dans les autres communes urbaines, ce qui fait de ce type de travail un travail
proportionnellement plus urbain que rural. Il y a légèrement plus de femmes que d'hommes et
le travail indépendant féminin est relativement plus non agricole que celui masculin (29% de
taux contre 22%). Il faut enfin noter que les travailleurs indépendants non agricoles sont
proportionnellement plus dans les déciles supérieurs qu'inférieurs avec aussi des taux de non
agricoles parmi les indépendants tout autant plus importants le long de l'échelle des déciles.
Le travail indépendant non agricole serait un moyen de lutte contre la pauvreté.
 |
13 13 |
▲back to top |
11
Onef
Tableau 13. Situation du travail indépendant non agricole par strate et sexe (en % et milliers)
Indépendant non agricole
Total indépendants
Effectif % Taux
Strate
Bamako 441 28 98% 448
Autre urbain 350 23 67% 526
Rural 761 49 15% 5 238
Décile de
revenu
D1 42 3 8% 545
D2 60 4 9% 663
D3 93 6 14% 672
D4 85 5 12% 708
D5 119 8 17% 694
D6 152 10 23% 666
D7 176 11 27% 652
D8 225 14 37% 610
D9 266 17 49% 539
D10 333 21 72% 462
Genre
Homme 734 47 22% 3 358
Femme 818 53 29% 2 854
Total 1 552 100 25% 6 212
Source: EMOPP 2014
Sur l'ensemble des travailleurs non agricoles, près de six personnes sur dix sont dans les
tranches d'âge 25-35 ans et 41-64 ans (presque à égalité de 3 personnes sur dix pour chaque
classe d'âge prise séparément). Au regard du pourcentage de non agricoles parmi les
indépendants, la classe d'âge 36-40 ans se distingue des autres, à égalité avec les plus de 64
ans. De même, l'écrasante majorité des indépendants non agricoles sont analphabètes
quoiqu'ils représentent une faible proportion des indépendants sans instruction (à cause
justement du poids des indépendants agricoles dans cette sous-population). Les plus
importants secteurs d'activité des indépendants non agricoles demeurent les services
marchands, plus de trois indépendants non agricoles sur cinq, suivis de l'industrie (moderne
comme artisanale) pour un quart des indépendants non agricoles et enfin les services non
marchands, pour le dixième restant.
Tableau 14. Situation du travail indépendant non agricole par classe d'âge et éducation (en % et milliers)
Indépendant non agricole
Total indépendants
Effectif % Taux
Age
6 - 14 ans 114 7 12% 982
15 - 24 ans 284 18 21% 1 384
25 - 35 ans 442 28 29% 1 529
36 - 40 ans 186 12 32% 584
41 - 64 ans 453 29 30% 1 504
plus de 64 ans 73 5 32% 227
Diplôme
N'a pas été à l'école 1 043 67 22% 4 800
Aucun diplôme 423 27 33% 1 282
DEF 38 2 59% 64
CAP 16 1 71% 22
BT 14 1 77% 19
BAC 6 0 62% 10
BTS/DEUG 5 0 93% 5
Licence 8 1 78% 10
Master 0 0 100% 0
Doctorat 0 0 59% 1
Secteur d'activité
Agriculture 0 0 0% 4 660
Industrie 403 26 100% 403
Service marchand 944 61 100% 944
Service non marchand 205 13 100% 205
Total 1 552 100 25% 6 212
Source: EMOPP 2014
 |
14 14 |
▲back to top |
12
Onef
1.3. Travail salarié
En 2014, le Mali affiche un taux d'emploi salarié, formel ou non, de 4% des 6 ans et plus, soit
6% pour les actifs de 15 ans et plus ainsi que pour les 15-64 ans, c'est dire combien le salariat
est encore faible au Mali en termes de proportion de la population active. Le taux national, va
de 2% en milieu rural à 14% à Bamako en passant par 8% dans les autres communes urbaines,
de 2% pour les femmes à 6% pour les hommes. La faiblesse du taux est dommageable au
niveau de vie des ménages quand on voit que le salariat augmente le long des déciles, de 1%
pour les quatre premiers déciles à 15% pour le dernier décile, celui des riches. Aussi la classe
des riches renferme-t-elle plus de deux salariés sur cinq contre un sur trois pour la clase
moyenne supérieure, soit au total, trois quarts des salariés du pays. On observe aussi qu'il y a
trois fois plus d'hommes salariés que de femmes ce qui laisse sous-entendre que les femmes
pourraient se retrouver proportionnellement plus dans les déciles inférieurs comparativement
aux hommes. De la même manière, le taux de salariat augmente du milieu rural au milieu
urbain et le long des déciles, de presque zéro pour le décile 1 à 15% pour le décile 10.
Tableau 15. Situation du travail salarié par strate, décile et sexe (en % et en milliers)
Salarié total
Effectif total
Effectif % Taux
Strate
Bamako 236 46 14% 1 711
Autre urbain 133 26 8% 1 666
Rural 149 29 2% 9 594
Décile de
revenu
D1 5 1 0% 1 258
D2 10 2 1% 1 237
D3 12 2 1% 1 184
D4 10 2 1% 1 297
D5 19 4 2% 1 279
D6 29 6 2% 1 283
D7 44 8 3% 1 314
D8 74 14 6% 1 333
D9 103 20 8% 1 337
D10 213 41 15% 1 449
Sexe
Homme 384 74 6% 6 325
Femme 133 26 2% 6 646
Total 518 100 4% 12 971
Source: EMOPP 2014
Un tiers des travailleurs salariés se retrouvent dans la classe d'âge des 25-35 ans avec aussi un
fort taux de salariat de 7%, mais inférieur aux 8% des 36-40 ans laquelle tranche d'âge ne
renferme pourtant qu'un peu plus d'un dixième des salariés. Les jeunes de 15-24 ans
représentent près de deux salariés sur dix pour un taux de salariat de 4%, loin derrière les 41-
64 ans à tout point de vue.
Il faut noter une présence massive des non éduqués avec près de 55% des salariés (pas été à
l'école et aucun diplôme) pour une proportion cumulée de 5% de leur catégorie. Enfin, le
travail salarié est dominé par le secteur des services (marchand et non marchand) avec un taux
de 77% pour une proportion cumulée de 68% de leur catégorie. Par niveau d'éducation, les
non diplômés (y compris ceux qui n'ont pas été à l'école) constituent 55% des salariés pour un
taux de salariat d'à peine 3%. A partir de la licence, le taux de salariat est très élevé, de 46% à
81% mais pour des effectifs absolus très faibles. Le salariat reste encore prédominant dans les
services non marchands (46% des salariés du pays pour un taux de salariat de 54%) suivi des
 |
15 15 |
▲back to top |
13
Onef
services marchands pour 31% des salariés, l'industrie absorbant à peine 17% des salariés de
seulement dix points de pourcentage d'écart sur l'agriculture.
Tableau 16. Situation du travail salarié par classe d'âge, éducation et secteur d'activité (en % et milliers)
Salarié total
Effectif total
Effectif % Taux
Age
6 - 14 ans 17 3 0% 4 305
15 - 24 ans 110 21 4% 2 729
25 - 35 ans 169 33 7% 2 305
36 - 40 ans 68 13 8% 827
41 - 64 ans 145 28 7% 2 182
Plus de 64 ans 8 2 1% 623
Diplôme
N'a pas été à l'école 154 30 2% 7 859
Aucun diplôme 132 25 3% 4 310
DEF 38 7 12% 323
CAP 44 8 33% 132
BT 76 15 55% 139
BAC 11 2 18% 61
BTS/DEUG 15 3 28% 53
Licence 37 7 46% 81
Master 4 1 66% 7
Doctorat 5 1 81% 7
Secteur
d'activité
Agriculture 34 7 1% 4 693
Industrie 88 17 18% 490
Service marchand 158 31 14% 1 102
Service non marchand 238 46 54% 443
Total 518 100 4% 6 729
Source: EMOPP 2014
Les données de l'EMOP permettent de scinder le travail salarié en salariés du secteur public et
ceux du secteur privé. En le faisant, l'on observe que 71% des 518 mille salariés exercent dans
le secteur privé contre 21% dans le secteur public. Cette dominance du secteur privé est
identifiable aussi bien par strate, par sexe, par décile de revenu que par secteur d'activité
principale. Cependant, par diplôme, cela n'est vérifié que pour le niveau DEF de diplôme et
moins, au-delà, le secteur public embauche relativement plus que le secteur privé, soit un
salariat privé de faible niveau de diplôme. Plus de 60% des diplômes du CAP et plus sont
recrutés dans le secteur public tandis que plus de 70% des DEF et moins le sont dans le
secteur privé.
 |
16 16 |
▲back to top |
14
Onef
Tableau 17. Répartition du travail salarié en public et privé (en % et milliers)
Public Privé
Effectif total
Effectif % Effectif %
Strate
Bamako 46 19% 191 81% 236
Autre urbain 56 42% 77 58% 133
Rural 47 32% 101 68% 149
Décile de revenu
D1 1 12% 4 88% 5
D2 0 1% 10 99% 10
D3 1 5% 11 95% 12
D4 1 10% 9 90% 10
D5 0 2% 19 98% 19
D6 7 23% 22 77% 29
D7 8 18% 36 82% 44
D8 17 23% 57 77% 74
D9 32 32% 70 68% 103
D10 82 38% 131 62% 213
Sexe
Homme 116 30% 269 70% 384
Femme 33 25% 100 75% 133
Age
6 - 14 ans 0 0% 17 100% 17
15 - 24 ans 7 6% 103 94% 110
25 - 35 ans 53 31% 116 69% 169
36 - 40 ans 25 36% 44 64% 68
41 - 64 ans 63 44% 81 56% 145
plus de 64 ans 1 9% 7 91% 8
Diplôme
N'a pas été à l'école 7 5% 147 95% 154
Aucun diplôme 16 12% 116 88% 132
DEF 10 27% 28 73% 38
CAP 26 59% 18 41% 44
BT 47 62% 29 38% 76
BAC 6 49% 6 51% 11
BTS/DEUG 9 59% 6 41% 15
Licence 21 56% 16 44% 37
Master 3 81% 1 19% 4
Doctorat 3 63% 2 37% 5
Secteur d'activité
Agriculture 3 8% 31 92% 34
Industrie 7 8% 81 92% 88
Service marchand 28 18% 130 82% 158
Service non marchand 111 46% 127 54% 238
Total 149 29% 369 71% 518
Source: EMOPP 2014
1.3.1. Travail salarié formel
Au Mali, l'emploi salarié formel est relativement faible comparé à l'ensemble des salariés, soit
182 mille individus sur les 518 mille salariés, ce qui fait un taux de formalité de 35% c'est
dire qu'un peu plus seulement du tiers des salariés du pays ont un emploi formel satisfaisant
aux conditions d'enregistrement, de contrat de travail et de rémunération salariale fixe. Plus de
deux tiers de ces salariés formels exercent en milieu urbain et légèrement plus à Bamako
malgré son plus faible taux de formalité des salariés comparativement au reste urbain et même
au milieu rural. Pour voir combien le salariat formel est porteur de progrès il suffit d'observer
que près de 6 salariés formels sur 10 sont dans le décile 10 de bien-être, celui des riches et 3
autres sur 10 dans les déciles 8 et 9, soit ceux de la classe moyenne supérieure. A peine 1%
des salariés formels sont dans la classe des pauvres. A égalité de taux de salariat formel, les
femmes représentent pourtant moins que les hommes dans l'effectif des salariés formels, une
femme pour deux hommes en moyenne.
 |
17 17 |
▲back to top |
15
Onef
Tableau 18. Situation du travail salarié formel par strate, décile et sexe (en % et milliers)
Salarié formel
Effectif total
Effectif % Taux
Strate Bamako 68 37 29% 236
Autre urbain 58 32 44% 133
Rural 56 31 38% 149
Décile de
revenu
D1 0 0 5% 5
D2 0 0 2% 10
D3 0 0 0% 12
D4 2 1 22% 10
D5 0 0 2% 19
D6 7 4 25% 29
D7 10 5 23% 44
D8 16 9 22% 74
D9 39 21 38% 103
D10 107 59 50% 213
Sexe Homme 134 74 35% 384
Femme 48 26 36% 133
Total 182 100 35% 518
Source: EMOPP 2014
Une autre particularité du salariat formel au Mali est qu'il est dominé par les plus de 35 ans
(60% du total), c'est dire qu'il exclut une bonne partie de la jeunesse parce que son rythme de
progression est nettement en deçà du taux d'arrivée de ces jeunes, y compris les plus
diplômés, sur le marché du travail. Malgré qu'il soit donc à forte intensité de diplôme, il
discrimine les jeunes même lorsqu'ils sont diplômés, ce qui marque une sorte de stagnation de
ce type moderne de salariat. C'est la conséquence du désengagement de l'Etat, principal
employeur jusqu'ici des salariés formels, le secteur privé marchand n'étant pas encore à
mesure de combler le vide encore moins faire face à l'élargissement de la base d'employables,
dont de plus en plus de jeunes diplômés. L'administration publique reste encore un des
principaux pourvoyeurs d'emploi salarié formel.
 |
18 18 |
▲back to top |
16
Onef
Tableau 19. Situation du travail formel par âge, éducation et secteur d'activité (en % et en milliers)
Salarié formel
Effectif total
Effectif % Taux
Age
6 - 14 ans 0 0 1% 17
15 - 24 ans 9 5 8% 110
25 - 35 ans 64 35 38% 169
36 - 40 ans 27 15 39% 68
41 - 64 ans 78 43 54% 145
plus de 64 ans 4 2 52% 8
Education
Aucun niveau 13 7 9% 154
Maternel 0 0 0% 0
Fondamental 1 12 7 15% 76
Fondamental 2 25 14 27% 94
Secondaire 87 48 67% 131
Supérieur 45 25 73% 62
Diplôme
N'a pas été à l'école 13 7 9% 154
Aucun diplôme 27 15 21% 132
DEF 9 5 24% 38
CAP 28 15 64% 44
BT 53 29 70% 76
BAC 6 3 57% 11
BTS/DEUG 12 7 80% 15
Licence 26 14 69% 37
Master 3 2 72% 4
Doctorat 4 2 81% 5
Type d'entreprise
Administration publique 101 55 88% 115
Entreprise publique 20 11 59% 34
Entreprise privée 54 30 18% 296
Entreprise associative/ONG 7 4 49% 13
Organisme international 1 1 88% 1
Personnel de maison 1 1 1% 59
Secteur d'activité
Agriculture 3 2 9% 34
Industrie 18 10 21% 88
Service marchand 46 25 29% 158
Service non marchand 115 63 48% 238
Total 182 100 35% 518
Source: EMOPP 2014
1.3.2. Travail salarié informel
L'emploi salarié informel, sans couverture sociale donc essentiellement1, représente 65% du
salariat total au Mali. Il est non seulement urbain mais aussi rural. Lorsqu'ils sont salariés, les
pauvres sont largement informels avec des taux d'informalité allant de 78% à 100% selon les
déciles de la classe des pauvres (contre 50% dans la classe des riches), c'est dire que le salariat
informel tire beaucoup moins que le formel le salarié de la pauvreté. Ainsi, 60% des salariés
formels sont dans le dernier décile de bien-être contre la moitié pour les salariés informels. La
discrimination des femmes est ici aussi remarquable que pour le salariat formel.
1 L'emploi informel a été défini comme étant cet emploi qui ne procure ni INPS ni congés payés ou congés
maladie ou congés maternité, ni allocations familiales
 |
19 19 |
▲back to top |
17
Onef
Tableau 20. Situation du travail salarié informel par strate, décile et sexe (en % et milliers)
Salarié informel
Effectif total
Effectif % Taux
Strate
Bamako 168 50 71% 236
Autre urbain 75 22 56% 133
Rural 93 28 62% 149
Décile de revenu
D1 5 1 95% 5
D2 10 3 98% 10
D3 12 4 100% 12
D4 8 2 78% 10
D5 19 6 98% 19
D6 22 7 75% 29
D7 34 10 77% 44
D8 58 17 78% 74
D9 64 19 62% 103
D10 106 32 50% 213
Sexe
Homme 250 75 65% 384
Femme 85 25 64% 133
Total 335 100 65% 518
Source: EMOPP 2014
Contrairement à l'emploi salarié formel, le salariat informel a un visage beaucoup plus jeune,
les deux tiers ayant au plus 35 ans d'âge ave un taux d'informalité de 76%, sans diplôme (73%
des salariés informels ou n'ont pas de diplôme ou n'ont simplement pas été à l'école), au-delà
de la licence, il n'y a presque plus salariés informels diplômés. Il s'exerce proportionnellement
plus en dehors des services non marchands, pour 63% à raison de 33% dans les activités
marchandes proprement dites comme le commerce et de 21% dans l'industrie et l'artisanat de
production.
Tableau 21. Situation du travail salarié informel par âge, éducation et secteur d'activité (en % et milliers)
Salarié informel
Effectif total
Effectif % Taux
Age
6 - 14 ans 17 5 99% 17
15 - 24 ans 102 30 92% 110
25 - 35 ans 105 31 62% 169
36 - 40 ans 42 13 61% 68
41 - 64 ans 66 20 46% 145
plus de 64 ans 4 1 48% 8
Diplôme
N'a pas été à l'école 141 42 91% 154
Aucun diplôme 105 31 79% 132
DEF 29 9 76% 38
CAP 16 5 36% 44
BT 23 7 30% 76
BAC 5 1 43% 11
BTS/DEUG 3 1 20% 15
Licence 12 4 31% 37
Master 1 0 28% 4
Doctorat 1 0 19% 5
Secteur d'activité
Agriculture 31 9 91% 34
Industrie 70 21 79% 88
Service marchand 112 33 71% 158
Service non marchand 123 37 52% 238
Total 335 100 65% 518
Source: EMOPP 2014
1.4. Travail des enfants
Le travail des enfants est analysé sous ses formes de travail domestique, rémunéré et non
rémunéré, de travail indépendant, agricole et non agricole et de travail salarié, exclusivement
 |
20 20 |
▲back to top |
18
Onef
informel. Sur les 4.3 millions d'enfants de 6-14 ans, 1.6 millions travaillent, soit un taux de
travail de 37%. Les enfants travailleurs sont majoritairement des travailleurs indépendants
(64%) puis domestiques (38%) et finalement 1% d'enfants salariés, tous employés informels.
Les 37% de taux national de travail des enfants se décomposent en un taux de travail
domestique de 14%, 22% de travail indépendant et près de 1% de travail salarié.
Au total donc, le Mali compte 982 mille enfants travailleurs indépendants, 604 mille
domestiques et 17 mille salariés. Les taux de travail des enfants sont particulièrement plus
élevés chez les filles (59% contre 26%) pour ce qui est du travail domestique et plus chez les
garçons pour les travail indépendant (27% contre 18%). La travail salarié informel est
concentré à Bamako avec un taux de travail salarié des enfants de 2% contre 1% dans le reste
du milieu urbain et près de 0% en milieu rural (pour néanmoins près de 6 mille enfants en
valeur absolue).
Tableau 22. Situation du travail des enfants (en % et milliers)
Domestique Indépendant Salarié
Effectif enfants
Effectif Taux Effectif Taux Effectif Taux
Strate
Bamako 143 29% 6 1% 9 2% 495
Autre urbain 212 41% 43 8% 3 1% 519
Rural 1 459 44% 933 28% 6 0% 3 291
Sexe
Homme 588 26% 615 27% 4 0% 2 239
Femme 1 226 59% 367 18% 14 1% 2 066
Education
Aucun niveau 824 46% 663 37% 14 1% 1 794
Maternel 75 23% 14 4% 0 0% 327
Fondamental 1 856 41% 291 14% 3 0% 2 072
Fondamental 2 58 52% 13 12% 0 0% 111
Secondaire 1 100% 0 0% 0 0% 1
Total 1 814 42% 981 23% 17 0% 4 305
Secteur
d'activité
Agriculture 513 59% 869 100% 3 0% 872
Industrie 24 73% 32 100% 0 0% 32
Service marchand 43 87% 49 98% 1 2% 50
Service non marchand 24 53% 33 71% 13 29% 46
Total 604 14% 982 23% 17 0% 4 305
Source: EMOPP 2014
Par niveau d'éducation, le taux de travail des enfants est plus élevé pour les non scolarisés que
chez les scolarisés ou les élèves. A partir du fondamental, le travail des enfants est à
dominance domestique avec de faibles taux de travail indépendant aux deux niveaux
fondamental 1 et 2. Le travail domestique ou familial s'opère principalement dans le secteur
agricole, soit l'enfant est aide familial soit il est actif agricole à part entière.
Le travail domestique rémunéré concerne 13 mille enfants sur les 604 mille domestiques, soit
2% de cet effectif. Il représente les trois quarts du salariat des enfants. Les salariés
domestiques sont très majoritairement féminins, plus de 9 sur 10 alors que les filles
représentent 8 dixièmes du salariat infantile total. Tout le salariat ici est informel,
prédominant en milieu urbain, 77% des domestiques salariés dont 62% à Bamako, 71% de
l'ensemble des salariés dont 53% à Bamako.
 |
21 21 |
▲back to top |
19
Onef
Tableau 23. Situation du travail rémunéré des enfants (en % et milliers)
Domestique rémunéré Salarié informel
Total enfants 6-14 ans
Effectif % Taux Effectif % Taux
Strate
Bamako 8 62 2% 9 53 2% 495
Autre urbain 2 15 0% 3 18 1% 519
Rural 3 23 0% 6 35 0% 3 291
Sexe
Homme 1 8 0% 4 24 0% 2 239
Femme 12 92 1% 14 82 1% 2 066
Total 13 100 17 100 4 305
Source: EMOPP 2014
2. Caractéristiques du travail
Le taux de chômage constitue certes un indicateur pertinent de l'état de santé du marché du
travail, mais il doit être complété de la qualité des emplois, leur stabilité ou la couverture
sociale qu'ils offrent aux travailleurs, toute chose permettant d'anticiper la pris en compte de
leurs aspirations professionnelles (Bensidoun, 2015). Aussi, cette section va-t-elle traiter des
conditions de travail, de la pluriactivité et de l'informalité, des relations de travail et des
risques professionnels. Il s'agit de la population active occupée, celle des 15-64 ans pourvus
d'en emploi, 5.5 millions d'individus dont 46% de femmes.
2.1. Conditions de travail
Les conditions de travail sont successivement décrites à l'aide des formes de rémunération du
travail, du contrat de travail, de la durée du travail, de la précarité de l'emploi et des catégories
socioprofessionnelles.
2.1.1. Forme de rémunération
Au Mali, les formes de rémunération varient selon le secteur d'activité, le type d'entreprise
ainsi que sa taille. Il ressort des données de l'enquête EMOP 2014, 5 principales formes de
rémunération du travail dont au bénéfice ou à la vente (37%), à la tâche (9%), ou la journée
ou à l'heure (3%), etc. La rémunération sous forme de salaire fixe ne représente que 8% de la
rémunération au Mali. Les autres formes de rémunération comprennent les commissions, les
paiements en nature, sous forme d'aide sociale. Ces autres formes de rémunération sont
dominantes en milieu rural ainsi que chez les hommes. C'est le cas aussi pour les 6 premiers
déciles de revenu. Partout ailleurs prédomine la rémunération à la vente ou au bénéfice. Le
salaire fixe est la deuxième plus importante forme de rémunération à Bamako et pour les
travailleurs appartenant au décile 10 de revenu, soit la classe des riches. Elle est la troisième
forme de rémunération dans les communes urbaines autres que celles de Bamako,
contrairement à partout ailleurs où occupe cette troisième place comme au plan national le
paiement à la tâche.
 |
22 22 |
▲back to top |
20
Onef
Tableau 24. Formes de rémunération du travail salarié (en % et milliers)
Bénéfice/vente Tâche Salaire fixe Jour/heure Autres Total
Strate
Bamako 38% 17% 29% 12% 3% 648
Autre urbain 40% 17% 19% 5% 20% 594
Rural 36% 6% 3% 1% 54% 4 252
Décile de
revenu
D1 29% 2% 1% 0% 68% 435
D2 31% 3% 1% 1% 64% 532
D3 32% 3% 2% 1% 61% 519
D4 34% 5% 2% 2% 58% 561
D5 38% 7% 2% 2% 50% 567
D6 36% 8% 4% 3% 49% 559
D7 43% 10% 6% 3% 38% 567
D8 41% 14% 11% 4% 31% 572
D9 42% 15% 14% 4% 24% 570
D10 37% 17% 30% 4% 12% 615
Sexe
Homme 30% 11% 10% 3% 45% 2 957
Femme 44% 6% 5% 2% 44% 2 537
Total 2 006 486 420 140 2 443 5 494
% total 37 9 8 3 44 100
Source: EMOPP 2014
Il est aussi possible de sérier les formes de rémunérations selon la classe d'âge, le diplôme, le
type d'entreprise, la taille de l'entreprise et les secteurs d'activités. Abstraction faite des
multiples autres formes dont il a déjà été question, la forme dominante qui reste est le
paiement au bénéfice ou à la vente, quelle que soit la tranche d'âge avec une proportion
d'autant plus élevée qu'on avance dans l'âge. Cette forme domine également pour les ayant au
plus le DEF comme diplôme ou n'en ayant pas du tout. Par type d'entreprise, c'est également
l'apanage des sociétés privées et associatives, celles employant au plus 5 personnes, surtout si
elles sont informelles. C'est encore le mode dominant dans les secteurs agricoles et services
marchands. Du coup, le salaire fixe est quelque peu l'exception, au profit des travailleurs
diplômés (CAP au moins), le secteur public (administration et entreprises publiques), les
organismes internationaux et enfin les entreprises de plus de 10 agents. Ce mode de
rémunération est le trait dominant du système formel d'activité et donc sa raréfaction est un
signe d'informalisation croissante de l'économie.
 |
23 23 |
▲back to top |
21
Onef
Tableau 25. Formes de rémunération du travail salarié et informalité (en % et milliers)
Bénéfice/vente Tâche Salaire fixe Jour/heure Autres Total
Age
15 - 24 ans 19% 6% 6% 2% 67% 1 495
25 - 35 ans 36% 9% 9% 3% 44% 1 698
36 - 40 ans 42% 11% 8% 4% 34% 653
41 - 64 ans 51% 10% 8% 2% 28% 1 649
Diplôme
Pas été à l'école 39% 7% 3% 2% 49% 4 059
Aucun diplôme 32% 15% 9% 4% 39% 1 078
DEF 27% 12% 27% 8% 26% 102
CAP 10% 5% 66% 10% 9% 66
BT 9% 3% 82% 0% 5% 92
BAC 21% 8% 49% 1% 21% 21
BTS/DEUG 16% 4% 77% 0% 3% 20
Licence 9% 6% 77% 2% 6% 47
Master 0% 0% 95% 0% 5% 4
Doctorat 4% 6% 90% 0% 0% 6
Type
d'entreprise
Administration publique 0% 0% 100% 0% 0% 116
Entreprise publique 0% 0% 100% 0% 0% 36
Entreprise privée 48% 12% 5% 3% 32% 3 959
Entreprise associative/ONG 39% 8% 21% 0% 31% 70
Organisme international 0% 0% 100% 0% 0% 1
Personnel de maison 6% 2% 3% 0% 88% 1 313
Taille de
l'entreprise
1 personne (auto-emploi) 69% 13% 4% 4% 10% 1 508
2-5 personnes 33% 10% 3% 3% 52% 2 438
6-10 personnes 14% 4% 5% 1% 76% 984
11-50 personnes 7% 2% 20% 0% 71% 389
Plus de 50 personnes 4% 4% 66% 1% 25% 22
Informalité
Secteur informel 38% 9% 4% 3% 46% 5 262
Secteur formel 6% 1% 91% 1% 1% 232
Secteur
d'activité
Agriculture 32% 4% 1% 0% 64% 3 667
Industrie 33% 41% 11% 8% 8% 437
Service marchand 64% 10% 13% 8% 5% 1 008
Service non marchand 15% 18% 58% 5% 5% 382
Total 2 006 486 420 140 2 443 5 494
% total 37 9 8 3 44 100
Source: EMOPP 2014
2.1.2. Contrat de travail
Au Mali, le travail peut être contractualisé sous plusieurs formes. L'enquête EMOP 2014
dénombre principalement 4 types qui sont le contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à
durée déterminée (CDD), le contrat verbal et l'absence de contrat (pour plus de 9 travailleurs
sur 10). Lorsqu'il y a contrat, il est d'abord verbal puis à durée indéterminée et enfin à durée
déterminée pour le reste.
L'absence de contrat ne souffre au Mali d'aucun effet de milieu de résidence ni même de
niveau de vie du travailleur. Elle est toutefois plus dominante en milieu rural qu'en milieu
urbain pour ne concerner à Bamako que deux travailleurs sur trois contre les 9 sur 10 au plan
national et les 4 sur 5 dans le reste du milieu urbain. Elle diminue également le long des
déciles de revenu, de 100% pour le premier décile à 70% pour le dernier en passant par les
84% pour l'avant dernier décile. Elle frappe légèrement plus les femmes que les hommes avec
un écart de 7 points de pourcentage en défaveur des femmes. Les autres formes de contrat
sont légèrement en faveur des hommes comparativement aux femmes.
Partout où prédomine l'absence de contrat, les autres formes de contrat de travail n'ont plus de
raison d'être, comme dans le cas des déciles de la classe des pauvres et pratiquement tout le
milieu rural où l'on ne dénombre que 2 à 3% de contrat réel, verbal ou écrit. Aussi, le CDI est-
 |
24 24 |
▲back to top |
22
Onef
il quasiment l'apanage du milieu urbain et des déciles de 6 à 10, tous justement de la classe
moyenne et des riches. La situation est la même pour le CDD. Le fait que le contrat verbal
monte à l'échelle des déciles est la conséquence de l'absence de contrat tout simplement dans
la première moitié inférieure de ces déciles de revenu.
Tableau 26. Types de contrats de travail par strate, décile et sexe (en % et en milliers)
CDI CDD Contrat verbal Pas de contrat Total
Strate
Bamako 10% 4% 17% 69% 648
Autre urbain 9% 4% 6% 81% 594
Rural 1% 1% 1% 98% 4 252
Décile de revenu
D1 0% 0% 0% 100% 435
D2 0% 0% 1% 99% 532
D3 0% 0% 1% 99% 519
D4 1% 0% 1% 98% 561
D5 0% 1% 1% 98% 567
D6 1% 1% 2% 96% 559
D7 1% 1% 4% 94% 567
D8 3% 2% 6% 90% 572
D9 6% 2% 8% 84% 570
D10 16% 5% 10% 70% 615
Sexe
Homme 5% 2% 5% 89% 2 957
Femme 1% 1% 2% 96% 2 537
Total 168 66 187 5 073 5 494
% total 3% 1% 3% 92% 100%
Source: EMOPP 2014
Par groupe d'âge, l'absence de contrat frappe encore plus les jeunes de moins de 25 ans. Et
lorsqu'ils décrochent un contrat, dans la majorité des cas, celui-ci est verbal et rarement CDD
ou encore plus rarement CDI. Pour prétendre au CDI, il faut être au moins de niveau
fondamental d'éducation, avoir été scolarisé y compris fréquenter toujours l'école. Il est
pourtant le mode dominant dans l'administration publique, pour plus de 4 travailleurs sur 5
(84%), encore l'exception dans le secteur privé, l'apanage des entreprises de plus de 5 actifs.
Les organismes internationaux privilégient le CDD au CDI, à raison de 6 contre 3.
 |
25 25 |
▲back to top |
23
Onef
Tableau 27. Types de contrats de travail par secteur (en % et en milliers)
CDI CDD Contrat verbal Pas de contrat Total
Age
15 - 24 ans 0% 1% 5% 94% 1 495
25 - 35 ans 4% 2% 4% 91% 1 698
36 - 40 ans 4% 1% 4% 92% 653
41 - 64 ans 4% 2% 2% 92% 1 649
Fréquentation
scolaire
N'a jamais fréquenté 0% 0% 2% 98% 4 059
Ne fréquente plus 12% 4% 8% 76% 1 267
Fréquente toujours 4% 2% 6% 88% 168
Education
Aucun niveau 0% 0% 2% 98% 4 064
Maternelle 0% 6% 0% 94% 7
Fondamental 1 1% 1% 6% 93% 780
Fondamental 2 7% 3% 11% 80% 389
Secondaire 46% 14% 9% 31% 177
Supérieur 57% 14% 6% 24% 77
Diplôme
N'a pas été à l'école 0% 0% 2% 98% 4 059
Aucun diplôme 2% 1% 6% 90% 1 078
DEF 11% 4% 18% 68% 102
CAP 37% 16% 9% 39% 66
BT 55% 15% 7% 23% 92
BAC 31% 6% 17% 46% 21
BTS/DEUG 58% 9% 3% 30% 20
Licence 55% 17% 5% 23% 47
Master 65% 26% 4% 5% 4
Doctorat 67% 2% 21% 10% 6
Type d'entreprise
Administration publique 84% 13% 1% 2% 116
Entreprise publique 57% 21% 14% 9% 36
Entreprise privée 1% 1% 4% 94% 3 959
Entreprise associative/ONG 6% 6% 6% 83% 70
Organisme international 28% 57% 0% 15% 1
Personnel de maison 0% 0% 2% 98% 1 313
Taille de l'entreprise
1 personne (auto-emploi) 0% 0% 3% 97% 1 508
2-5 personnes 0% 0% 3% 97% 2 438
6-10 personnes 1% 1% 4% 94% 984
11-50 personnes 7% 4% 9% 80% 389
plus de 50 personnes 33% 28% 4% 35% 22
Secteur d'activité
Agriculture 0% 0% 0% 100% 3 667
Industrie 3% 3% 9% 86% 437
Service marchand 4% 2% 8% 86% 1 008
Service non marchand 29% 8% 17% 47% 382
Total 168 66 187 5 073 5 494
% total 3% 1% 3% 92% 100%
Source: EMOPP 2014
2.1.3. Durée de travail
Dans le traitement des données, la durée de travail a été sériée en trois intervalles de temps,
moins de 35 heures hebdomadaires, 35-48 heures et plus de 48 heures, cela pour apprécier
successivement le sous-emploi et la durée excessive de travail dans les deux extrêmes
intervalles. La majorité des travailleurs sont dans l'intervalle du milieu, celui du temps dit
normal de travail. C'est le cas pour 55% des travailleurs en moyenne avec des écarts plus ou
moins importants selon la strate, le décile de revenu, l'âge, le sexe, l'éducation, le secteur
d'activités et le type d'entreprise ou lieu de travail. Ainsi, les femmes sont davantage dans la
norme que les hommes (61% contre 50%), le milieu rural plus que le milieu urbain (à 16
points de pourcentage d'écart sur Bamako et 6 sur le reste du milieu urbain), le décile 10 y est
moins astreint que les autres bien qu'il ait le plus fort taux de durée excédant les 48 heures
hebdomadaires. Si travailler moins de 35 heures hebdomadaires peut être assimilé à du sous-
emploi, alors les femmes le sont plus que les hommes, les travailleurs ruraux plus que leurs
 |
26 26 |
▲back to top |
24
Onef
camarades urbains. A contrario, si travailler plus de 48 heures hebdomadaires relève de la
durée excessive de travail, alors Bamako s'y astreint plus que toute autre strate, les hommes
plus que les femmes et le travail est d'autant plus excessif que le niveau de vie du travailleur
s'élève comme pour dire "travailler plus pour vivre mieux" si ce n'est "vivre mieux pour
travailler plus". Evidemment, il faut ajouter cependant que les écarts entre déciles ne sont pas
statistiquement significatifs en la matière
Tableau 28. Typologie du temps de travail par strate, décile et sexe (en % et milliers)
Moins de 35 heures 35 - 48 heures Plus de 48 heures Total
Strate
Bamako 20% 42% 38% 648
Autre urbain 21% 52% 26% 594
Rural 17% 58% 26% 4 252
Décile de revenu
D1 17% 54% 29% 4 348
D2 16% 61% 23% 5 317
D3 16% 59% 25% 519
D4 16% 61% 23% 561
D5 18% 58% 24% 567
D6 16% 59% 26% 559
D7 21% 51% 29% 567
D8 18% 51% 31% 572
D9 18% 50% 32% 570
D10 18% 49% 33% 615
Sexe
Homme 7% 50% 43% 2 957
Femme 30% 61% 9% 2 537
Total 955 3 034 1 506 5 494
% total 17% 55% 27% 100%
Source: EMOPP 2014
A l'exception du niveau BAC de diplôme qui en soi ne donne que marginalement accès au
marché du travail plus que ouvrant plutôt la voie à des études universitaires, et du niveau
DEF pour les mêmes raisons ou presque, à l'exception donc de ces diplômes, la durée normale
de travail est d'autant plus la règle que l'on a de diplôme. Il n'y a pourtant pas d'effet âge ni
même d'effet fréquentation scolaire si ce n'est que les élèves et étudiants travailleurs ont le
plus grand taux de sous-emploi. Le secteur public a la double particularité du plus fort taux de
durée normale de travail mais aussi de sous-emploi, avec en contrepartie un taux de durée
excessive de travail des plus faibles.
Il est curieux que l'auto-emploi soit davantage en deçà de la durée normale de travail qu'au-
delà. Sans doute s'agit-il du travail agricole dont on sait qu'il est particulièrement saisonnier.
Mais cela ne se vérifie pas quand on regarde le taux de sous-emploi du secteur d'activités
agricoles (14% contre 23% dans l'industrie ou les services marchands sauf que ceux-ci ont un
taux d'emploi excessif plus élevé de 10 points de pourcentage d'écart en moyenne).
 |
27 27 |
▲back to top |
25
Onef
Tableau 29. Typologie du temps de travail par secteur (% et milliers)
Moins de 35 heures 35 - 48 heures Plus de 48 heures Total
Age
15 - 24 ans 18% 56% 27% 1 495
25 - 35 ans 19% 56% 26% 1 698
36 - 40 ans 16% 57% 28% 653
41 - 64 ans 16% 54% 30% 1 649
Fréquentation
scolaire
N'a jamais fréquenté 17% 56% 28% 4 059
Ne fréquente plus 18% 55% 28% 1 267
Fréquente toujours 32% 45% 23% 168
Diplôme
N'a pas été 17% 56% 28% 4 059
Aucun diplôme 18% 53% 29% 1 078
DEF 23% 47% 30% 102
CAP 26% 57% 17% 66
BT 27% 61% 12% 92
BAC 27% 31% 42% 21
BTS/DEUG 21% 61% 18% 20
Licence 17% 65% 18% 47
Master 12% 75% 13% 4
Doctorat 0% 78% 22% 6
Type
d'entreprise
Administration publique 31% 62% 7% 116
Entreprise publique 20% 71% 9% 36
Entreprise privée 18% 54% 28% 3 959
Entreprise associative/ONG 13% 51% 37% 70
Organisme international 15% 38% 47% 1
Personnel de maison 14% 59% 28% 1 313
Taille de
l'entreprise
1 personne (auto-emploi) 30% 49% 22% 1 508
2-5 personnes 13% 55% 32% 2 438
6-10 personnes 11% 61% 29% 984
11-50 personnes 12% 64% 24% 389
plus de 50 personnes 6% 62% 32% 22
Secteur
d'activité
Agriculture 14% 60% 26% 3 667
Industrie 23% 48% 29% 437
Service marchand 23% 45% 32% 1 008
Service non marchand 27% 40% 33% 382
Total 955 3 034 1 506 5 494
% total 17% 55% 27% 100%
Source: EMOPP 2014
2.1.4. Précarité de l'emploi
Le marché du travail au Mali est marqué par sa précarité, mesurée par le caractère non
régulier du travail. En effet, le taux de travail régulier n'est que de 43%, soit 57% de taux de
travail irrégulier dont 48% pour le travail saisonnier et 5% pour le travail à la tâche et 4% de
travail à la journée. La forme saisonnière du travail irrégulier est dominante en milieu rural
parce que caractérisé par des activités agricoles pratiquées pendant les 4 mois de l'hivernage,
elle est majoritaire également pour les travailleurs des 6 premiers déciles de revenu. Il faut
remarquer que le travail régulier ne s'observe véritablement que dans le milieu urbain et
surtout pour les trois derniers déciles de revenu que sont ceux de la classe moyenne supérieure
et de la classe des riches. Le travail saisonnier des femmes est légèrement supérieur à celui
des hommes. La précarité du travail à Bamako prend les formes de travail à la tâche et de
travail à la journée dont on sait être le mode de recrutement des manœuvres dans cette ville
tant pour des activités agricoles que pour des tâches de nettoyage et autres tâches du travail
temporaire urbain, partout ailleurs la précarité est de nature saisonnière.
 |
28 28 |
▲back to top |
26
Onef
Tableau 30. Nature du travail par strate, décile et sexe (en % et milliers)
Travail régulier Travail à la journée Travail à la tâche Travail saisonnier Total
Strate
Bamako 69% 13% 13% 5% 648
Autre urbain 66% 6% 8% 20% 594
Rural 36% 2% 4% 59% 4 252
Décile de
revenu
D1 22% 1% 1% 76% 435
D2 26% 2% 2% 70% 532
D3 36% 3% 1% 61% 519
D4 36% 2% 4% 59% 561
D5 38% 3% 5% 54% 567
D6 39% 4% 5% 51% 559
D7 44% 6% 5% 46% 567
D8 55% 5% 9% 32% 572
D9 60% 5% 9% 26% 570
D10 67% 6% 10% 17% 615
Sexe
Homme 47% 3% 6% 44% 2 957
Femme 38% 4% 4% 53% 2 537
Total 2 363 207 286 2 639 5 494
% total 43% 4% 5% 48% 100%
Source: EMOPP 2014
Il est notoire que le travail saisonnier soit la nature particulière majoritaire des seuls jeunes de
moins de 25 ans (53% d'entre eux contre 46% pour les autres tranches d'âge). Les jeunes sont
rejoints dans cette situation défavorable par les travailleurs (peu importe leurs âges) sans
niveau d'éducation (54%) et surtout par les actifs opérant dans le secteur agricole (69%). Au
total, la précarité est jeune et rurale. Elle est presque inexistante pour les travailleurs de niveau
d'éducation secondaire et plus. Dans le secteur industriel, elle prend une forme relativement
importante de travail à la tâche comme dans l'artisanat. Enfin, il faut remarquer que le travail
saisonnier est relativement plus courant dans le secteur des services non marchands par
rapport aux services marchands. Cela est probablement induit par l'école mais il ne faut pas
oublier que les services marchands concentrent près de trois plus de travailleurs que les non
marchands.
Tableau 31. Nature du travail par âge, niveau d'éducation et secteur (en % et en milliers)
Travail
régulier
Travail à la
journée
Travail à
la tâche
Travail
saisonnier
Total
Age
15 - 24 ans 39% 4% 5% 53% 1 495
25 - 35 ans 43% 4% 5% 47% 1 698
36 - 40 ans 45% 4% 6% 46% 653
41 - 64 ans 46% 3% 5% 46% 1 649
Education
Aucun niveau 38% 3% 5% 54% 4 064
Maternelle 36% 0% 10% 54% 7
Fondamental 1 47% 4% 6% 43% 780
Fondamental 2 58% 7% 9% 26% 389
Secondaire 84% 4% 4% 9% 177
Supérieur 88% 2% 4% 7% 77
Secteur d'activité
Agriculture 29% 0% 2% 69% 3 667
Industrie 62% 12% 21% 5% 437
Service marchand 76% 12% 8% 4% 1 008
Service non marchand 70% 7% 7% 17% 382
Total 2 363 207 286 2 639 5 494
% total 43% 4% 5% 48% 100%
Source: EMOPP 2014
 |
29 29 |
▲back to top |
27
Onef
2.1.5. Catégories socioprofessionnelles
Lorsqu'on raisonne non pas par statut de travail, pour distinguer les indépendants des salariés
ainsi que des domestiques, mais par catégories socioprofessionnelles, on distingue une plus
grande variété de situations plus ou moins homogènes vis-à-vis du travail. Cela fait éclater
aussi bien le rang des indépendants mais surtout celui des salariés. Il reste un groupe compact
d'indépendants qui n'ont pu être classés avec précision parce que par exemple n'étant ni
employeurs ni autres. Ce groupe restant, compte tenu justement de la prédominance du travail
indépendant, agricole et non agricole, au Mali, reste néanmoins majoritaire sur le marché du
travail, 54% de l'effectif total des actifs occupés. Ce caractère majoritaire est valable quelle
que soit la strate et ne souffre d'aucun effet genre, le taux reste toutefois quelque peu plus
élevé en milieu urbain que rural (60% contre 52%). Curieusement il n'est pas majoritaire dans
les trois derniers déciles des pauvres (déciles 2 à 4) alors qu'il l'est dans le premier. Dans ces
trois déciles de pauvres, la catégorie socioprofessionnelle dominante est celle des aides
familiaux, catégorie dont l'importance diminue ensuite le long des déciles restants, plus forte
dans la classe moyenne inférieure que dans celle supérieure et très faible dans la classe des
riches (7%). Cette catégorie d'aide familial domine ensuite dans le milieu rural et chez les
femmes.
Les employés et ouvriers sont des catégories très urbaines et appartiennent dans une large
mesure à la classe moyenne et à celle des riches. Elle a un visage plus masculin que féminin.
Il faut remarquer que les manœuvres et apprentis sont dans cette même situation de grimper
dans l'échelle des déciles de bien-être à la différence notoire donc des aides familiaux. Il n'est
pas étonnant que les employeurs soient du seul milieu urbain et des seuls 4 derniers déciles de
revenu. C'est un peu le cas aussi des cadres moyens et même des cadres supérieurs qui eux ne
sont que dans les deux derniers déciles de bien-être, à dominance masculine.
Tableau 32. Catégories socioprofessionnelles par âge, décile et sexe (en % et milliers)
Cadre
supérieur
Cadre
moyen
Employé
/ ouvrier
Manœuvre Employeur Indépendant Apprenti Aide
familial
Total
Strate
Bamako 2% 6% 18% 9% 3% 60% 2% 1% 648
Autre urbain 1% 7% 11% 2% 1% 60% 2% 15% 594
Rural 0% 1% 2% 1% 0% 52% 0% 44% 4 252
Décile
de
revenu
D1 0% 0% 1% 0% 0% 53% 0% 46% 435
D2 0% 0% 1% 0% 0% 48% 0% 50% 532
D3 0% 0% 1% 1% 0% 48% 0% 50% 519
D4 0% 1% 1% 0% 0% 49% 0% 49% 561
D5 0% 0% 2% 1% 0% 51% 0% 45% 567
D6 0% 1% 3% 1% 0% 52% 0% 43% 559
D7 0% 1% 4% 2% 1% 58% 2% 33% 567
D8 0% 2% 6% 4% 1% 59% 1% 27% 572
D9 1% 4% 9% 3% 1% 62% 2% 18% 570
D10 3% 12% 15% 4% 2% 56% 1% 7% 615
Sexe
Homme 1% 3% 7% 2% 1% 53% 1% 33% 2 957
Femme 0% 1% 2% 1% 0% 55% 0% 40% 2 537
Total 22 125 254 92 32 2 954 39 1 977 5 494
% total 0% 2% 5% 2% 1% 54% 1% 36% 100%
Source: EMOPP 2014
 |
30 30 |
▲back to top |
28
Onef
2.2. Emploi secondaire et emploi informel
On l'a plusieurs fois souligné déjà et beaucoup d'autres études le confortent, le marché du
travail est doublement caractérisé par la pratique courante de la pluriactivité et le caractère
majoritairement informel de l'emploi et du secteur d'activités.
2.2.1. Pluriactivité
Exercer une ou plusieurs activités secondaires en plus de son activité principale est une
pratique donc courante sur le marché malien du travail. On l'observe, selon les données de
l'enquête emploi chez 25% des actifs occupés avec des taux encore plus élevés en milieu rural
(30%) et dans les déciles 3 à 7 (30 à 32%). Dans ce dernier cas, la pluriactivité doit être pour
beaucoup dans l'accès des travailleurs à la classe moyenne, même inférieure. Lorsqu'ils
pratiquent la pluriactivité, les travailleurs s'adonnent plus généralement à une seule activité
secondaire, 24% sur les 25% dénombrés, légèrement plus les femmes que les hommes et
toujours plus dans la classe moyenne que chez les riches. Deux activités secondaires sont
privilégiés par les ruraux et une, les communes urbaines autres que celles de Bamako et
encore par la classe moyenne ainsi que la moitié des pauvres. Au total, la pluriactivité est
révélatrice du niveau insuffisant de la rémunération de l'activité principale couplée dans bien
du sous-emploi. Il faut aussi ajouter qu'il ne se dégage aucun effet âge, éducation ou secteur
d'activité en la matière.
Tableau 33. Répartition de la pluriactivité par strate, décile et éducation (en % et milliers)
Aucune activité
secondaire
Une activité
secondaire
Deux activités
secondaires
Trois activités
secondaires
Total
Strate
Bamako 98% 2% 0% 0% 648
Autre urbain 86% 13% 1% 0% 594
Rural 70% 29% 2% 0% 4 252
Décile de
revenu
D1 84% 15% 1% 0% 435
D2 73% 26% 1% 0% 532
D3 70% 29% 2% 0% 519
D4 69% 29% 2% 0% 561
D5 69% 29% 2% 0% 567
D6 68% 31% 1% 0% 559
D7 69% 29% 2% 0% 567
D8 75% 24% 2% 0% 572
D9 83% 17% 0% 0% 570
D10 89% 11% 0% 0% 615
Sexe
Homme 77% 22% 1% 0% 2 957
Femme 72% 26% 2% 0% 2 537
Total 4 106 1 311 75 2 5 494
% total 75% 24% 1% 0% 100%
Source: EMOPP 2014
Bien que marginal, l'exercice de trois activités secondaires a quand même été recensé pour
près de 2 mille actifs occupés (exactement 1789 travailleurs concernés). Cette sous-population
est exclusivement rurale, d'activité agricole uniquement et relève tout aussi exclusivement de
l'emploi informel non salarié. Tous ces travailleurs exercent dans des entreprises privées ou
exploitations familiales privées, n'ont jamais été à l'école ou ne fréquentent plus l'école, ils ont
entre 25 et 64 ans. Aussi, on y recense quatre fois plus d'hommes que de femmes. Enfin ils
sont répartis entre trois déciles, le décile 2 de la classe des pauvres et les déciles 5 et 6 de la
classe moyenne inférieure.
 |
31 31 |
▲back to top |
29
Onef
Graphique 1. Répartition des travailleurs à 3 activités secondaires (effectif)
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
Rural
D2
D5
D6
Homme
Femme
25 - 35 ans
41 - 64 ans
N'a jamais fréquenté l'école
Ne fréquente plus l'école
Non salarié
Entreprise privée
Personnel de maison
Secteur informel
Agriculture
Total
1 789
807
626
356
1 433
356
356
1 433
807
982
1 789
1 433
356
1 789
1 789
1 789
Source: EMOPP 2014
2.2.2. De l'emploi informel
Sur l'ensemble des actifs occupés au Mali, plus de neuf personnes sur dix exercent un emploi
informel (97%) contre 3% d'emploi formel. Aussi bien par milieu de résidence que par décile
ou par sexe, plus de huit personnes sur dix occupent un emploi informel. Le taux varie, selon
les trois caractéristiques tantôt mentionnées de 82% à 100%. L'emploi exclusivement informel
est le quotidien des 5 premiers déciles de revenu, les 4 premiers constituant la classe des
pauvres et le cinquième le premier pallier de la classe moyenne inférieure, sur les trois déciles
qui décrivent cette classe. C'est ainsi que chercher à passer de l'emploi informel à l'emploi
formel n'est pas simplement une question de conformer les employeurs à la légalité mais aussi
et surtout un moyen de lutte contre la pauvreté et un moyen de promotion de la femme étant
donné que le taux d'informalité des femmes est supérieur à celui des hommes.
Tableau 34. Informalité de l'emploi par strate, décile et sexe (en % et milliers)
Emploi informel Emploi formel Total
Strate
Bamako 90% 11% 648
Autre urbain 89% 11% 594
Rural 99% 1% 4 252
Décile de revenu
D1 100% 0% 435
D2 100% 0% 532
D3 100% 0% 519
D4 100% 1% 561
D5 100% 0% 567
D6 99% 2% 559
D7 99% 1% 567
D8 97% 3% 572
D9 93% 7% 570
D10 82% 18% 615
Sexe
Homme 95% 5% 2 957
Femme 98% 2% 2 537
Total 5 302 192 5 494
% total 97% 3% 100%
Source: EMOPP 2014
 |
32 32 |
▲back to top |
30
Onef
Rien ne change pratiquement dans l'informalité de l'emploi au regard des groupes d'âge, sauf
que le taux diminue de 3 à 4 points de pourcentage en quittant les moins de 25 ans aux 25-40
ans puis aux 41-64 ans. Les variations les plus notables sont observées selon le diplôme
obtenu avec une relation nettement et significativement négative entre le niveau de diplôme et
l'informalité de l'emploi, plus le travailleur est diplômé moins son emploi est informel et
inversement. Corrélativement à ce résultat est le fait que l'emploi formel est une question de
diplôme d'où l'implication appréciable de l'école sur le marché du travail, de 1-3% de taux
d'emploi formel lorsque l'on n'a pas de diplôme à 45% dès le CAP, 55-59% au BTS ou à la
licence ainsi de suite.
Par secteur d'activité, l'emploi formel est plus courant dans les services non marchands que
dans les autres secteurs (31% contre 5% pour les services marchands, 4% pour l'industrie et
presque zéro pour l'agriculture). Il en résulte que l'emploi formel soit le monopole du secteur
public et des organismes internationaux (qui curieusement enregistrent 10% de taux d'emploi
informel). Le désengagement de l'Etat va donc de paire avec l'extension de l'emploi informel
au Mali et donc l'échec du secteur privé (2% de taux d'emploi formel) à faire mieux que l'Etat,
en tout cas sur le marché du travail.
Tableau 35. Informalité de l'emploi et secteurs d'activité (en % et milliers)
Emploi informel Emploi formel Total
Age
15 - 24 ans 99% 1% 1 495
25 - 35 ans 96% 4% 1 698
36 - 40 ans 96% 4% 653
41 - 64 ans 95% 5% 1 649
Diplôme
N'a pas été à l'école 99% 1% 4 059
Aucun diplôme 97% 3% 1 078
DEF 90% 10% 102
CAP 55% 45% 66
BT 43% 57% 92
BAC 69% 31% 21
BTS/DEUG 41% 59% 20
Licence 45% 55% 47
Master 29% 71% 4
Doctorat 28% 72% 6
Type d'entreprise
Administration publique 13% 87% 116
Entreprise publique 45% 55% 36
Entreprise privée 98% 2% 3 959
Entreprise associative/ONG 91% 9% 70
Organisme international 10% 90% 1
Personnel de maison 99% 1% 1 313
Secteur d'activité
Agriculture 100% 0% 3 667
Industrie 96% 4% 437
Service marchand 95% 5% 1 008
Service non marchand 69% 31% 382
Total 5 302 192 5 494
% total 97% 3% 100%
Source: EMOPP 2014
2.3. Relations de travail
Les relations de travail sont ici décrites à travers l'analyse de l'état des couvertures sociales du
travailleur, l'existence et le fonctionnement du dialogue social sur le lieu de travail et les
opportunités de promotion du capital humain sous formes de promotion et de formation
offertes aux agents.
 |
33 33 |
▲back to top |
31
Onef
2.3.1. Couverture sociale
Au Mali, seulement 3% des travailleurs sont couverts en matière de protection et d'assistance
sociale, soit le taux de l'emploi formel. La couverture comprend les allocations familiales, les
avantages en espèces et en nature non inclus dans le salaire, les régimes de prévoyance
sociale, la participation au bénéfice, l'assistance médicale en cas de maladie, etc. Le taux reste
faible quelle que soit la strate, indépendamment du décile de revenu. On observe de légers
décalages entre hommes et femmes en défaveur des femmes, entre milieu en défaveur de
Bamako et entre déciles en faveur des seuls deux derniers déciles (4-6% contre 2-3% pour
tous les autres déciles, à l'exception du premier décile qui est à 0%). Il ne souffre d'aucun effet
âge, éducationnel ou de toute autre caractéristique liée à l'activité économique.
Graphique 2. Existence de couverture sociale par strate, décile et sexe (en %)
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
1%
5%
3%
0%
2%
3%
3%
2%
3%
2%
3%
4%
6%
4%
2%
3%
Source: EMOPP 2014
2.3.2. Dialogue social
Le dialogue social est apprécié à travers l'existence sur le lieu de travail d'organisations
syndicales ou de tout autre groupement de travailleurs en tenant lieu comme par exemple les
comités d'entreprises. De ce point de vue, seulement 5% des travailleurs déclarent l'existence
de tels organismes de représentativité des actifs occupés sur leurs lieux de travail. Le taux est
plus élevé en milieu urbain surtout dans les communes urbaines autres que celles de Bamako.
Les hommes travaillent dans des structures plus dotées de tels organes de dialogue Etat –
patronat – employés que les femmes. Le taux pour les travailleurs de décile 10 de niveau de
vie de leurs ménages est trois fois plus important que la moyenne nationale (14%). Dans tous
les cas, le taux augmente le long des déciles indiquant une contribution positive du dialogue
social à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
 |
34 34 |
▲back to top |
32
Onef
Graphique 3. Existence d'organisme de dialogue par strate, décile et sexe (en %)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
6%
13%
3%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
6%
5%
7%
14%
7%
2%
5%
Source: EMOPP 2014
Un autre effet important de promotion du dialogue social est le niveau d'éducation des
travailleurs, plus celui-ci est important plus sont présents sur le lieu de travail les organes de
représentation des employés face aux employeurs, à leurs groupements et à l'Etat.
Evidemment, un tel effet positif semble s'arrêter au niveau du secondaire puisque le taux
baisse au niveau de la licence pour remonter ensuite un degré plus haut ensuite chuter
drastiquement au degré supérieur. Plus significatif est le lien étroit entre dialogue social et
type d'entreprise voire secteur d'activités. L'administration publique est le principal lieu de
dialogue social, suivi des entreprises publiques dont on sait qu'il n'en reste plus grand monde
depuis les programmes d'ajustement structurel des années 1980 et qui se sont poursuivis
inlassablement jusqu'à nos jours sous diverses formes. Il faut noter l'inexistence totale de
structure de dialogue social dans les organismes internationaux employeurs de travailleurs
maliens.
Tableau 36. Existence d'organisme de dialogue et secteur (en % et milliers)
Pas d'organe de
dialogue
Existence d'organe
de dialogue
Total
Diplôme
N'a pas été à l'école 98% 3% 4 059
Aucun diplôme 95% 5% 1 078
DEF 91% 9% 102
CAP 66% 35% 66
BT 62% 38% 92
BAC 76% 24% 21
BTS/DEUG 57% 43% 20
Licence 69% 31% 47
Master 30% 70% 4
Doctorat 54% 46% 6
Type d'entreprise
Administration publique 32% 68% 116
Entreprise publique 61% 39% 36
Entreprise privée 97% 3% 3 959
Entreprise associative/ONG 90% 10% 70
Organisme international 100% 0% 1
Personnel de maison 97% 3% 1 313
Secteur d'activité
Agriculture 98% 2% 3 667
Industrie 94% 6% 437
Service marchand 94% 6% 1 008
Service non marchand 78% 22% 382
Total 5 236 259 5 494
% total 95% 5% 100%
Source: EMOPP 2014
 |
35 35 |
▲back to top |
33
Onef
2.3.3. Promotion du capital humain
Ce que l'on appelle promotion du capital humain porte en réalité sur les opportunités de
promotion du personnel et de formation continue, opportunités dont déclarent les répondants à
l'enquête EMOP 2014 avoir bénéficié sur leur lieu de travail. Ce sont ainsi 9% des travailleurs
qui auraient bénéficié de telles opportunités (500 mille au total sur les 5.5 millions d'actifs
occupés), beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes, un peu plus dans le milieu
urbain hors de Bamako, un peu plus aussi dans la deuxième moitié supérieure des déciles à
l'exception notoire du décile 5, soit donc un peu plus au-dessus de la médiane qu'en dessous.
Graphique 4. Existence de promotion par strate, décile et sexe (en %)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
8%
12%
9%
5%
6%
9%
8%
11%
9%
9%
10%
10%
13%
11%
7%
9%
Source: EMOPP 2014
Davantage de promotion du capital, surtout de formation continue, est offerte aux agents des
services non marchands comparativement aux autres, 17% de taux contre 9% dans l'industrie
qui devrait tout autant en avoir besoin si le progrès technique pénétrait vraiment nos
entreprises ce qui ne semble pas être le cas manifestement. L'existence d'opportunités de
promotion du personnel croît avec le niveau de diplôme de l'agent, de 8-11% pour les non
diplômés à 26% pour le BT, puis 31% pour le BTS jusqu'à 65% pour le master (l'équivalent
de la maîtrise et un peu plus avant l'adoption définitive du système universitaire dit LMD –
Licence, master, doctorat) ou 76% pou la licence.
 |
36 36 |
▲back to top |
34
Onef
Tableau 37. Opportunité de promotion sur le lieu de travail (en % et milliers)
Non Oui Total
Diplôme
N'a pas été à l'école 92% 8% 4 059
Aucun diplôme 89% 11% 1 078
DEF 91% 9% 102
CAP 78% 22% 66
BT 74% 26% 92
BAC 89% 11% 21
BTS/DEUG 69% 31% 20
Licence 76% 24% 47
Master 35% 65% 4
Doctorat 73% 27% 6
Secteur d'activité
Agriculture 91% 9% 3 667
Industrie 91% 9% 437
Service marchand 92% 8% 1 008
Service non marchand 83% 17% 382
Total 4 993 501 5 494
% total 91% 9% 100%
Source: EMOPP 2014
Sous sa forme d'opportunités de formation, la promotion du capital humain est encore plus
marginale que la promotion du personnel, 2% de taux moyen, variant entre 1% pour les
femmes à 3% pour les hommes. A l'exception du seul décile 4, les pauvres (déciles 1à 4) ne
bénéficient pas de formation continue sur le lieu de travail. Cela va de 1-2% pour la classe
moyenne inférieure à 3-5% pour la classe moyenne supérieure puis 9% pour les riches.
Curieusement, il y a plus de formation dans le reste du milieu urbain qu'à Bamako et bien sûr
plus à Bamako qu'en milieu rural.
Graphique 5. Existence de formation par strate, décile et sexe (en %)
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
3%
9%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
2%
3%
5%
9%
3%
1%
2%
Source: EMOPP 2014
2.4. Risques professionnels
Autres éléments importants d'appréciation des caractéristiques du travail au Mali, ce sont les
risques professionnels. Dans l'enquête emploi, ceux-ci ont été approchés par la pénibilité de
l'emploi, sa dangerosité, les plaintes possibles liées au harcèlement sexuel sur le lieu de travail
ou à des actes de discrimination.
 |
37 37 |
▲back to top |
35
Onef
2.4.1. Pénibilité de l'emploi
Plus de huit travailleurs, âgés de 15-64 ans faut-il le rappeler, sur dix estiment que leur travail
est pénible, soit 4.5 millions d'agents sur les 5.5 millions, ce qui est énorme, dans le relatif
comme dans l'absolu. Il faut préciser que la pénibilité a été suggérée dans le questionnaire de
l'enquête à travers des situations de travail telles que rester longtemps débout, rester dans des
postures pénibles, porter ou déplacer des charges lourdes, subir des secousses et vibrations,
etc. Le taux est invariant par sexe (82%). Il est légèrement plus élevé en milieu rural qu'urbain
donc les activités agricoles seraient davantage pénibles (subjectivement tout au moins) que
toute autre activité économique, physique comme intellectuelle. On ne décèle pas vraiment de
variation significative du taux de pénibilité le long des déciles de revenu, avec peut être un
léger mieux pour les 3 derniers déciles mais de niveau inférieur à celui du premier décile, à
moins de prétendre que les plus pauvres n'ont plus conscience de la pénibilité de leur emploi,
heureux qu'ils seraient d'en avoir eu.
Graphique 6. Pénibilité par strate, décile et sexe (en %)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
65%
79%
85%
64%
84%
87%
89%
85%
88%
87%
79%
80%
75%
82%
82%
82%
Source: EMOPP 2014
2.4.2. Dangerosité de l'emploi
La dangerosité de l'emploi est dans l'enquête, mesurée par des situations diverses décrites
dans le questionnaire comme les risques infectieux, les risques de blessure ou d'accident, la
respiration de fumées et autres risques possibles. Pour les deux tiers des travailleurs, ces
risques seraient réels, ce qui est énorme, hommes et femmes indiquant surtout le même taux
de dangerosité ce qui le rendrait encore plus crédible. Il est bien sûr plus élevé en milieu rural
(71%) qu'en milieu urbain et moins élevé à Bamako (42%) que le reste urbain (63%). Il est
beaucoup plus élevé dans les déciles de 2 à 6, soit les deux premiers déciles de la classe
moyenne inférieure (déciles 5 et 6) et les trois derniers déciles de la classe des pauvres
(déciles 2 à 4). La dangerosité est moins perçue dans les deux déciles extrêmes (56% chez les
10% les plus pauvres et 53% les 10% les plus riches), le premier pour insouciance des risques
encourus sur le lieu de travail et le second pour s'en être prémunis en connaissance de cause.
 |
38 38 |
▲back to top |
36
Onef
Graphique 7. Dangerosité par strate, décile et sexe (en %)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
42%
63%
71%
56%
70%
78%
75%
72%
72%
69%
64%
59%
53%
67%
67%
67%
Source: EMOPP 2014
Les risques les plus élevés sont observés dans l'industrie puis dans l'agriculture. Les risques
seraient moindres dans les services, marchands (49%) comme non marchands (41%). Par type
d'entreprise, le secteur privé serait plus à risque que le secteur associatif ou encore plus que le
secteur public (administration comme entreprises publiques). Par contre, il ne l'est pas plus
que pour le personnel de maison, poste finalement le plus dangereux de tout. Il serait
beaucoup moins dangereux de travailler dans un organisme international, vu que celui-ci est
essentiellement dans les services, humanitaires pour la plupart et donc non marchands. Par
niveau de diplôme, il faut faire abstraction des master et doctorat et s'apercevoir que la
dangerosité décroît le long des grades de diplôme, 70% pour aucun diplôme à seulement 25%
pour la licence, au-delà duquel diplôme le risque augmente sans que l'on n'imagine
véritablement pourquoi.
Tableau 38. Dangerosité du travail et secteur d'activité (en % et milliers)
Non Oui Total
Diplôme
N'a pas été à l'école 32% 68% 4 059
Aucun diplôme 30% 70% 1 078
DEF 43% 57% 102
CAP 44% 56% 66
BT 58% 42% 92
BAC 55% 45% 21
BTS/DEUG 71% 29% 20
Licence 75% 25% 47
Master 50% 50% 4
Doctorat 32% 69% 6
Type d'entreprise
Administration publique 46% 54% 116
Entreprise publique 56% 44% 36
Entreprise privée 33% 67% 3 959
Entreprise associative/ONG 35% 65% 70
Organisme international 79% 21% 1
Personnel de maison 31% 69% 1 313
Secteur d'activité
Agriculture 27% 73% 3 667
Industrie 23% 77% 437
Service marchand 51% 49% 1 008
Service non marchand 59% 41% 382
Total 1 826 3 669 5 494
% total 33% 67% 100%
Source: EMOPP 2014
 |
39 39 |
▲back to top |
37
Onef
2.4.3. Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Selon les codifications de l'enquête, le harcèlement sexuel pourrait être de la part de collègues
de travail ou de la part de clients. Dans l'un ou l'autre cas et encore plus dans les deux à la fois
on parle de harcèlement sexuel. Les résultats estiment son ampleur à 2% de l'ensemble des
actifs occupés, soit environ 96 mille individus, des deux sexes d'ailleurs à parfaite égalité de
taux, ce qui fait en valeur absolue davantage d'hommes que de femmes étant donné qu'il y a
plus d'actifs occupés masculins que féminins, de 420 mille âmes d'écart. Le taux est
également invariant par strate, ce qui donne plus de ruraux effectivement que d'urbains pour
les mêmes raisons que pour le sexe. Par décile de revenu, on n'observe pas non plus de
différence significative, le taux oscillant simplement entre 0 et 3% sans la moindre linéarité,
ni dans un sens ni dans l'autre.
Graphique 8. Existence du harcèlement sexuel (en %)
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
2%
2%
2%
0%
1%
3%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
2%
2%
2%
Source: EMOPP 2014
2.4.4. Discrimination
Les formes de discrimination retenues dans l'enquête EMOP 2014 sont celles relatives au
sexe, à la religion, au handicap, au groupe ethnique d'appartenance, à l'appartenance politique,
au milieu de provenance (urbain versus rural ou villageois versus citadin pour faire
stigmatisation) voire à la localité de résidence ou encore au pays d'origine si né et/ou grandi
ailleurs qu'au Mali, etc. Il est heureux que sur toutes ces formes, la discrimination reste
marginale sur le lieu de travail. Elle toucherait 1% des actifs occupés, soit 66 mille âmes. Le
phénomène serait quasiment inconnu à Bamako tandis qu'il est de 1% dans le milieu rural
mais 2% dans le reste urbain. Le taux national s'observe le long de presque tous les déciles, à
l'exception des déciles 2 et 3 puis du décile 10, deux déciles de pauvres et le seul décile des
riches, tous à 2% de taux de discrimination.
 |
40 40 |
▲back to top |
38
Onef
Graphique 9. Existence de discrimination par strate, décile et sexe (en %)
0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%
Bamako
Autre urbain
Rural
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Homme
Femme
Total
0%
2%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
Source: EMOPP 2014
3. Déterminants du type de travail
Les différents types de travail dont on cherche à identifier les déterminants sont le statut
d'indépendant agricole, celui d'indépendant non agricole, de salarié informel, de salarié privé
formel et de salarié public formel. Le dernier type est pris pour référence dans la modélisation
logistique multinomiale sur les déterminants identifiés.
3.1. Déterminants de l'emploi
A l'instar de l'analyse économétrique des déterminants du niveau de vie des ménages par des
modèles logistiques de type multinomial (BIT, 2005) on peut, s'agissant du type particulier de
travail que peut exercer un actif, y recourir également. Dans ce cas, on mesurera la probabilité
d'occurrence de chaque type de travail (en référence à un type choisi e.g. l'emploi salarié
formel public dont il est question aujourd'hui de trouver des substituts dans le secteur privé,
déclaré moteur de la croissance et du développement et qui doit en outre faire reculer le
travail indépendant non salarié) par le logarithme d'exercer un des types de travail tantôt
rappelés.
On distinguera quatre groupes de variables susceptibles d'expliquer le type de travail
qu'exerce un actif occupé. Ce sont les variables relatives au milieu de résidence de l'individu,
les variables caractérisant le ménage, celles liées à l'expérience professionnelle et les
caractéristiques démographiques individuelles des travailleurs. Le milieu de résidence est
scindé en milieu rural, Bamako et autre milieu urbain. Les deux variables liées au ménage
sont la taille de celui-ci (en termes de nombre de membres du ménage) et de décile de revenu
auquel appartient le ménage et donc le travailleur qui s'y trouve étant donné que tous les
membres d'un même ménage sont supposés appartenir au même niveau de bien-être.
L'expérience professionnelle de l'individu est mesurée par l'ancienneté dans l'emploi, peu
importe les entreprises dans lesquelles cette expérience a été obtenue, soit sur le lieu courant
 |
41 41 |
▲back to top |
39
Onef
de travail, soit antérieurement dans une ou plusieurs autres entreprises, soit encore sur
différents postes de travail dans la même entreprise ou chaîne d'entreprises. Quant aux
caractéristiques démographiques individuelles des travailleurs, l'on a retenu le sexe, l'âge, le
niveau d'éducation achevé et le diplôme obtenu.
Chacune des variables retenues peut influer positivement ou négativement, directement ou par
divers truchements, le statut de travail de l'actif occupé. L'analyse des résultats du modèle
édifie à cet effet et permet d'en tirer les conséquences pour la promotion de l'emploi salarié
formel au Mali.
3.2. Modélisation économétrique de la probabilité d'exercer un type de travail
La probabilité d'exercer tel type d'emploi plutôt que tel autre est estimée, sur le logiciel SPSS,
à l'aide d'un modèle logistique ordonné avec comme variables explicatives (quantitatives et
qualitatives réunions) les déterminants indiqués plus haut. Le modèle précise si ces
déterminants permettent de prédire la variable d'intérêt (à savoir le type d'emploi) à des
niveaux supérieurs au hasard (Tenenhaus, 2007). Les résultats aident également à trouver un
bon compromis entre forte sensibilité et forte spécificité, la sensibilité étant la capacité à
prédire un évènement (e.g. l'exercice d'un travail salarié formel) tandis que la spécificité est la
capacité à prédire un non-évènement (prédire de l'emploi informel dans un monde
d'informalité).
le principe de la méthode est de calculer les coefficients de régression de façon itérative i.e. à
partir de certaines valeurs de départ, vérifier si les coefficients estimés sont bien ajustés aux
données, corriger les coefficients, réexaminer le bon ajustement des valeurs estimées, etc.
jusqu'à ce qu'aucune correction ne puisse atteindre un meilleur résultat (Desjardins, 2005). La
méthode a l'avantage de ne pas exiger une distribution normale des prédicteurs ni
l'homogénéité des variances cependant elle nécessite d'examiner les corrélations entre les
prédicteurs avant de procéder à l'élaboration du modèle car elle est très sensible à la
multicolinéarité entre prédicteurs. Lorsque certains prédicteurs sont fortement corrélés, il est
préférable d'en éliminer puisqu'il s'agit probablement de variables redondantes.
Les valeurs des pseudo R2, Cox and Snell de 0.257, Nagelkerke de 0.300 et dans une moindre
mesure MCFadden de 0.153, tous 3 fournis dans l'output du logiciel, montrent une certaine
association entre les déterminants ci-dessus rappelés et la variable dépendante. Ces valeurs
représentent des estimations de la variance expliquée par le modèle. Plus elles sont élevées,
plus la probabilité prédite par le modèle s’approche de la valeur observée.
Le test de ratio de vraisemblance montre que l'introduction de chacune des variables
explicatives retenues, quelles qu'elles soient, apporte significativement à l'explication de la
variance de la variable dépendante.
 |
42 42 |
▲back to top |
40
Onef
Tableau 39. Tests de ratio de vraisemblance
Effets des facteurs Likelihood Ratio Tests
Chi-Square df Sig.
Constante 0.000 0
Age 952.485 4 .000
Taille du ménage 122.329 4 .000
Ancienneté emploi 1322.568 4 .000
Strate 2317.490 8 .000
Sexe 296.164 4 .000
Education 2528115.479 16 .000
Diplôme 2533894.045 16 .000
Décile de revenu 599.653 36 .000
La lecture des résultats de la régression nécessite de définir, au préalable la notion de Odds-
ratio, coefficients B dans le tableau de résultats. Egalement appelé rapport des chances,
rapport des cotes ou risque relatif rapproché, c'est une mesure statistique exprimant le degré
de dépendance entre des variables aléatoires qualitatives. Les valeurs des odds-ratios
représentent le nombre de fois d'appartenance à un groupe lorsque la valeur du prédicteur
augmente d'une unité.
A titre d'illustration, la probabilité pour un individu d'être salarié privé informel est
significativement impactée par l'âge, l'ancienneté dans l'emploi, la strate, le sexe et le décile
de revenu du ménage. Par contre, la taille du ménage n'agit pas significativement sur la
probabilité qu'un individu soit salarié privé informel.
Tableau 40. Régression logistique (Coefficients de régression de la probabilité de salarié privé informel)
B=log(Odd-ratio) Std. Error Wald df Sig. Exp(B)
Constante -13.121 14.679 .799 1 .371
Age -.024 .008 8.425 1 .004 .976
Taille -.010 .010 .957 1 .328 .990
Ancienneté emploi -.029 .009 9.303 1 .002 .972
Bamako 3.752 .424 78.238 1 .000 42.590
Autre urbain .538 .181 8.857 1 .003 1.712
Milieu rural (Référence) 0 0
Femme -.780 .163 22.970 1 .000 .459
Homme (Référence) 0 0
D1 .722 .391 3.417 1 .065 2.058
D2 .866 .372 5.410 1 .020 2.376
D3 1.009 .366 7.577 1 .006 2.742
D4 .889 .345 6.657 1 .010 2.433
D5 1.101 .338 10.592 1 .001 3.008
D6 .899 .317 8.030 1 .005 2.458
D7 .920 .305 9.080 1 .003 2.509
D8 1.142 .286 15.965 1 .000 3.132
D9 .568 .257 4.882 1 .027 1.766
D10 (Référence) 0 0
Dans la lecture du tableau, on notera par exemple que le fait d'être femme diminue la
probabilité d'occuper un emploi salarié privé informel de 54% (0.459-1) comparativement au
fait d'être homme. La taille du ménage agit négativement aussi mais son coefficient n'est pas
significativement non nul, à la différence de l'ancienneté qui agit significativement et
négativement avec une diminution de la probabilité de 3% lorsque l'ancienneté augmente
d'une année. A contrario, le fait de résider en autre milieu urbain accroît cette probabilité de
71% comparativement au milieu rural. Les déciles de revenu participent de la même hausse,
bien sûr à des seuils différents, 7% d'erreur pour le décile 1, 3% pour le décile 9, 2% pour le
décile 2 et beaucoup moins d'erreur pour les autres déciles (à peine 1%).
 |
43 43 |
▲back to top |
41
Onef
Dans l'ensemble, le modèle prédit correctement plus de trois quarts (78%) de la classification
observée des individus. Autrement dit, les individus pour lesquels la prédiction de statut de
travail est identique à l'observation constituent 78% de l'ensemble. Le plus fort taux de
prédiction correcte est pour les indépendants agricoles (93%) suivis des indépendants non
agricoles (60%). A l'inverse, les plus faibles taux s'observent pour les salariés informels
(17%) et les salariés privés formels (1%). Ces chiffres correspondent à des erreurs de
prédiction de 7% sur les indépendants agricoles, 40% sur les indépendants non agricoles, 83%
sur les salariés informels et 99% sur les salariés privés formels.
Tableau 41. Classification
Prédit
In
d
ép
en
d
an
t
ag
ri
co
le
In
d
ép
en
d
an
t
n
o
n
a
g
ri
co
le
S
al
ar
ié
in
fo
rm
el
S
al
ar
ié
p
ri
v
é
fo
rm
el
S
al
ar
ié
p
u
b
li
c
fo
rm
el
T
o
ta
l
T
o
ta
l
%
P
o
u
rc
en
ta
g
e
co
rr
ec
t
O
b
se
rv
é
indépendant agricole 9 592 600 23 2 48 10 265 62.3% 93.4%
indépendant non agricole 1 310 2 711 308 0 175 4 504 27.3% 60.2%
Salarié informel 146 541 186 1 199 1 073 6.5% 17.3%
Salarié privé formel 14 46 13 1 97 171 1.0% 0.6%
Salarié public formel 16 50 19 1 373 459 2.8% 81.3%
Total 11 078 3 948 549 5 892 16 472 78.1%
Total % 67.3% 24.0% 3.3% 0.0% 5.4%
Sensitivité 86.6% 68.7% 33.9% 20.0% 41.8%
Spécificité 12.5% 77.2% 64.3% 62.3% 65.6%
Erreur 6.6% 39.8% 82.7% 99.4% 18.7%
Il y a 67% d'indépendants agricoles prédits contre 93% d'observés, 24% d'indépendants non
agricoles prédits contre 60% d'observés, 3% de salariés informels prédits contre 17%
d'observés, aucun salarié privé formel contre moins de 1% d'observé. Ces prédictions sont
particulièrement bonnes pour les indépendants agricoles où le sensitivité est supérieure à la
spécificité. Les résultats indiquent également que pour les autres types de travail, les
prédictions des non salariés privés informels parmi ces autres types sont plus fortes, la
spécificité étant supérieure à la sensitivité.
Conclusions
La faiblesse du salariat est dommageable au niveau de vie des ménages quand on voit que le
salariat augmente le long des déciles de bien-être. Aussi, près de 6 salariés formels sur 10 sont
dans le décile 10 de bien-être, celui des riches et 3 autres sur 10 dans les déciles 8 et 9, soit
ceux de la classe moyenne supérieure. A peine 1% des salariés formels sont dans la classe des
pauvres.
Malgré que le travail salarié formel soit à forte intensité de diplôme, il discrimine les jeunes
même lorsqu'ils sont diplômés, ce qui marque une sorte de stagnation de ce type moderne de
salariat. C'est la conséquence du désengagement de l'Etat, principal employeur jusqu'ici des
salariés formels, le secteur privé marchand n'étant pas encore à mesure de combler le vide
encore moins faire face à l'élargissement de la base d'employables, dont de plus en plus de
jeunes diplômés. L'administration publique reste encore un des principaux pourvoyeurs
d'emploi salarié formel.
 |
44 44 |
▲back to top |
42
Onef
La rémunération du travail sous forme de salaire fixe est le trait dominant du système formel
d'activité et donc sa raréfaction est un signe d'informalisation croissante de l'économie.
Puisque, et plus généralement, l'emploi exclusivement informel est le quotidien des 5
premiers déciles de revenu, chercher à passer de l'emploi informel à l'emploi formel n'est pas
simplement une question de conformer les employeurs à la légalité mais aussi et surtout un
moyen de lutte contre la pauvreté et un moyen de promotion de la femme étant donné que le
taux d'informalité des femmes est supérieur à celui des hommes.
Il faut dire qu'au Mali, le désengagement de l'Etat est allé de paire avec l'extension de l'emploi
informel et donc l'échec du secteur privé (2% de taux d'emploi formel) à faire mieux que
l'Etat, en tout cas sur le marché du travail. C'est dire la difficulté de faire rentrer le marché
malien du travail, sur lequel prédomine le type informel comme cela a été indiqué avec un
salariat encore très marginal, dans les paradigmes d'une économie moderne de marché, sinon
un vrai défi à relever.
Références bibliographiques
Séverin Aimé Blanchar Ouadika (2009): Pauvreté et marché du travail en milieu urbain,
Enquête congolaise auprès des ménages pour l'évaluation de la pauvreté (ECOM 2005),
janvier
Gilles Raveaud (2006): La stratégie européenne pour l'emploi – Une politique d'offre de
travail, juillet-septembre Travail et emploi n° 107
Julie Desjardins (2005): L'analyse de régression logistique, Tutorat in Quantitative methods
for psychology, vol. 1(1), p. 35-41
Michel Tenenhaus (2007): La régression logistique, HEC
Economie du travail 1_Forté_UdS_Janvier 2012: Plan indicatif
Isabelle Bensidoun, Aude Sztulman (2015): Egypte 1998-2012 – De l'emploi public protégé
à l'emploi informel précaire, un marché du travail en déshérence, CEE, Document de travail,
n° 182, avril
INSEE (2014): Les revenus et le patrimoine des ménages, Edition 2014, juin
Copyright @ 2024 | ONEF .