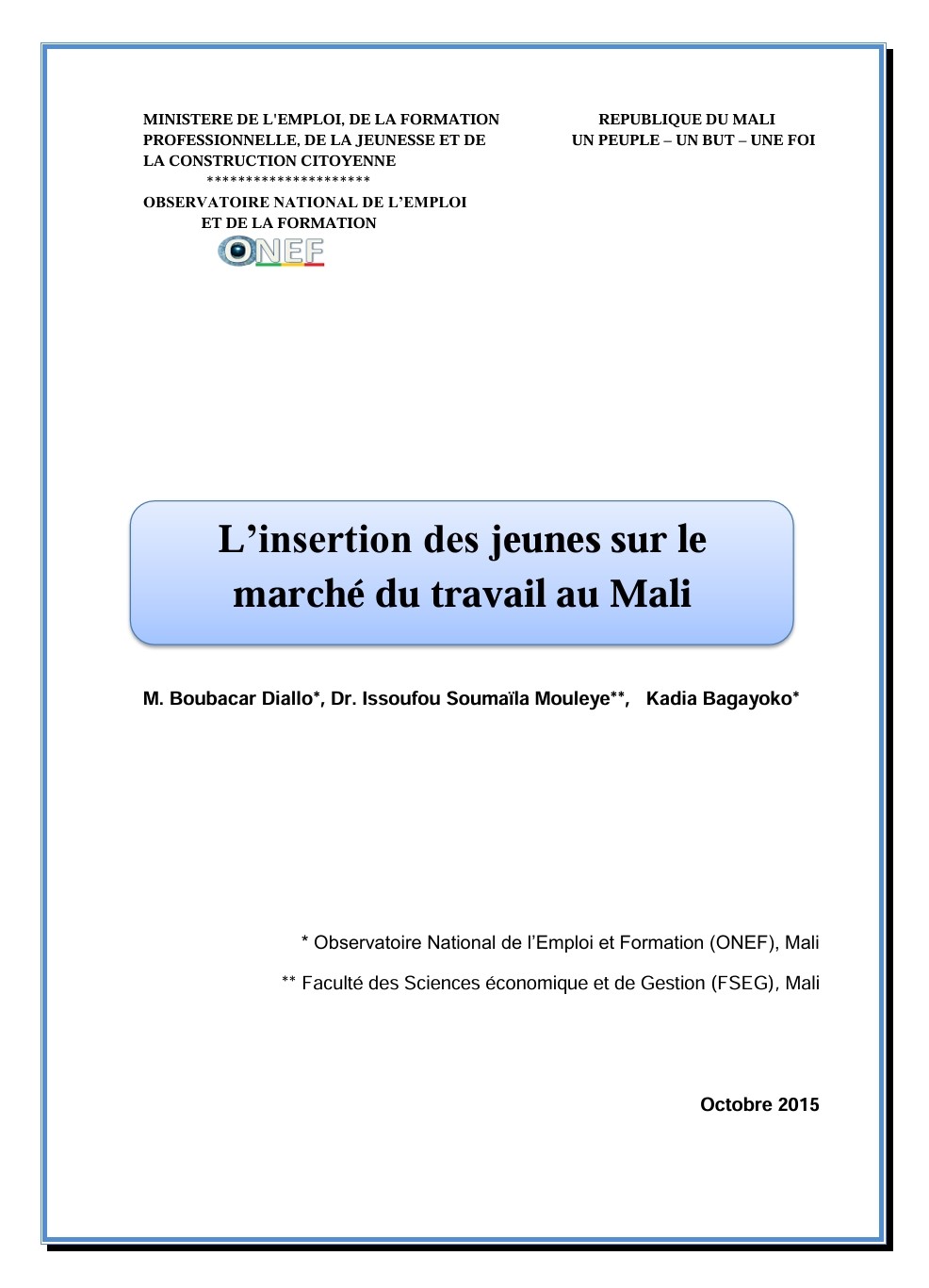L’insertion des jeunes sur le marché du travail au Mali MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA...
 |
L’insertion des jeunes sur le marché du travail au Mali MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA... |
 |
1 1 |
▲back to top |
L’insertion des jeunes sur le
marché du travail au Mali
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION REPUBLIQUE DU MALI
PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
LA CONSTRUCTION CITOYENNE
*********************
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
M. Boubacar Diallo*, Dr. Issoufou Soumaïla Mouleye**, Kadia Bagayoko*
* Observatoire National de l’Emploi et Formation (ONEF), Mali
** Faculté des Sciences économique et de Gestion (FSEG), Mali
Octobre 2015
 |
2 2 |
▲back to top |
1
Table des matières
Sigles et abréviations ..................................................................................................................... 3
Liste des tableaux ........................................................................................................................... 4
Liste des graphiques ....................................................................................................................... 5
Résumé ........................................................................................................................................... 6
Introduction : .................................................................................................................................. 8
1. Les fondements théoriques et empiriques de l’insertion professionnelle des
jeunes sur le marché du travail ............................................................................................ 11
1.1. Les fondements théoriques de l’insertion professionnelle .......................... 11
1.1.1. La théorie du capital humain : ...................................................................... 11
1.1.2. La théorie du filtre : ......................................................................................... 12
1.1.3. La théorie de recherche d’emploi : .............................................................. 12
1.2. Quelques travaux réalisés sur l’insertion professionnelle : ......................... 13
2. Situation des jeunes sur le marché travail en 2014. ........................................................... 15
2.1. Les jeunes face à la recherche d’emploi : ......................................................... 16
2.1.1. Caractéristiques des jeunes en activité : ................................................... 17
2.1.2. Caractéristiques des jeunes ni en emploi ni en éducation ni en
formation ............................................................................................................................ 18
2.1.3. Attitude des jeunes ni en emploi, ni en éducation et ni en formation
face à la recherche d’emploi ......................................................................................... 20
2.2. Les emplois occupés par les jeunes : ................................................................ 22
2.2.1. Le taux d’emploi des jeunes.......................................................................... 22
2.2.2. Nature des emplois occupés par les jeunes ............................................. 23
2.3. Le chômage des jeunes : ....................................................................................... 25
2.3.1. Caractéristiques du chômage des jeunes : ............................................... 25
2.3.2. Les stratégies de recherche d’emploi des chômeurs ............................ 27
3. Les déterminants de l’insertion professionnelle des jeunes .............................................. 30
3.1. Les données .............................................................................................................. 30
3.2. Le choix de variables : ............................................................................................ 31
3.2.1. La variable dépendante : ................................................................................ 31
3.2.2. Les variables explicatives : ........................................................................... 31
3.3. La spécification du modèle.................................................................................... 33
3.3.1. L’estimation des paramètres et interprétation des résultats du
modèle 34
 |
3 3 |
▲back to top |
2
3.3.3. Evaluation individuelle des coefficients .................................................... 34
3.3.4. Interprétation des résultats ........................................................................... 34
Conclusion ..................................................................................................................................... 37
Recommandation ......................................................................................................................... 38
Biographiques ............................................................................................................................... 40
Annexe : ........................................................................................................................................ 42
 |
4 4 |
▲back to top |
3
Sigles et abréviations
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
APEJ Agence Pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
BPP Bureau Privé de Placement
BIT Bureau International du Travail
CREE-Germe Créez votre Entreprise - Gérez Mieux votre Entreprise
EPAM Enquête Permanente Auprès des Ménages
EMOP Enquête Modulaire Permanente
FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
INIFORP Institut National d’Ingénierie de la Formation Professionnelle
INSTAT Institut National de la Statistique
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
OIT Organisation International du Travail
PEJ Programme Emploi Jeune
P-CTSP Projet - Comité de Transition pour le Salut du Peuple
 |
5 5 |
▲back to top |
4
Liste des tableaux
Tableau 1 : Répartition des jeunes (15-40 ans) selon la situation dans l’activité……………. 13
Tableau 2 : Répartition des jeunes (15-40 ans) ni en emploi, ni en éducation et ni en
formation selon la recherche d’emploi………………………………………………
17
Tableau 3 : Taux d’emploi des jeunes de 15 à 40 ans…………………………………………. 18
Tableau 4 : Taux de chômage des jeunes de 15 à 40 ans en 2014…………………….......... 22
Tableau 5 : Taux d’inscription des jeunes chômeurs à l’ANPE………………………………... 24
Tableau 6 : Taux d’inscription des jeunes chômeurs auprès des bureaux privés de
placement ……………………………………………………………………………..
24
Tableau 7 : Répartition des chômeurs selon la durée au chômage…………………………... 26
 |
6 6 |
▲back to top |
5
Liste des graphiques
Graphique 1 : Répartition en pourcentage des jeunes ni en emploi, ni éducation, ni en
formation en 2014 selon le niveau d'instruction et le genre…………………..
15
Graphique 2 : Répartition en pourcentage des jeunes ni en emploi, ni en éducation et ni
en formation selon la tranche d'âge et le genre en 2014……………………..
16
Graphique 3 : Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) selon la nature de
l'emploi et le niveau d'instruction au Mali en 2014……………………………
20
Graphique 4 : Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) selon la nature de
l'emploi et le genre au Mali en 2014…………………………………………..
21
Graphique 5 : Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) selon la nature de
l'emploi et la tranche d'âge au Mali en 2014…………………………………...
22
Graphique 6 : Répartition des jeunes chômeurs selon les moyens utilisés pour la
recherche d’emploi………………………………………………………………..
24
Graphique 7 : Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) chômeurs selon le type
d’emploi recherché et le genre………………………………………………….
26
 |
7 7 |
▲back to top |
6
Résumé
Les données de l’Enquête Modulaire Permanente 2014 ont servie à la réalisation
de cette thématique. L’analyse descriptive a été complétée par une analyse
économétrique.
Les jeunes âgés de 15-40 ans représentent 38,7% de l’ensemble de la population.
Parmi ces jeunes, 70,9% vivent en milieu rural contre seulement 29,1% en milieu
urbain.
En 2014 au Mali, 65% des jeunes âgés de 15 à 40 étaient des actifs occupés
contre 6,7% de chômeurs. Parmi les jeunes en situation activités, 72% sont sans
aucun niveau d’instruction contre seulement 1% des jeunes ayant le niveau
d’études supérieur.
Parmi les jeunes en situation d’inactivité, 65% sont dans la tranche d’âge 15-24
ans. En général au Mali, beaucoup de jeunes poursuivent leur formation jusqu’à
l’âge de 24 ans et souvent même au-delà.
Parmi les 22,6% de jeunes âgés de 15 à 40 ans qui ne sont ni en emploi ni en
formation, les femmes représentent 81,9%. Parmi ces jeunes, 78% ne sont pas à
la recherche d’emploi dont 91% de femmes.
Le taux d’emploi global des jeunes de 15 à 40 ans est de 66% en 2014. Les non
scolarisés occupent 74 % des emplois. Parmi ceux-ci plus 90 sont hommes. Le
taux d’emploi des diplômés du supérieur (hommes et femmes) demeure faible
comparativement à celui des jeunes ayant un niveau d’études inférieur.
Les jeunes non scolarisés occupent tous (100%) des emplois informels. Les
jeunes ayant le niveau d’études primaire occupent à 97% des emplois informels
contre seulement 3% d’emploi formel. Pour les diplômés du secondaire, 56%
parmi eux occupent des emplois informels, contre 57% des diplômés du supérieur.
Les chômeurs de longue durée (plus d’un an) représentent 92% de l’ensemble
des jeunes chômeurs en 2014.
 |
8 8 |
▲back to top |
7
Après l’estimation du modèle de régression logistique, les variables qui ont été
déterminantes dans l’insertion des jeunes sur le marché du travail sont : l’âge, le
sexe, le milieu de résidence, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, le revenu
moyen du ménage.
 |
9 9 |
▲back to top |
8
Introduction :
La promotion de l’emploi en général et celle des jeunes en particulier constitue un
défi majeur pour les pouvoirs publics en Afrique et particulièrement au Mali.
Conscient du danger que représentent le sous-emploi et le chômage des jeunes,
les autorités maliennes ont élaboré et mis en œuvre un certain nombre de
programmes afin de promouvoir la création d’emploi pour les jeunes qui
constituent l’une des couches les plus touchées par le chômage.
Ainsi pour faciliter l’accès de ces jeunes à l’emploi, les différents régimes depuis
l’indépendance du pays ont mis en place une panoplie de dispositifs. Parmi ceux-
ci, il faut citer : le contrat de qualification professionnelle, institué par l'Ordonnance
92-022 /P-CTSP du 13 avril 1992. Il avait pour objectif de combler le manque
d'expérience des jeunes diplômés en vue de les rendre plus compétitifs sur le
marché de l'emploi. Ce dispositif à montrer ses limites dix ans après sa mise en
œuvre à cause du manque d’engouement des employeurs.
Toujours pour lutter contre le chômage des jeunes, le Ministère du Développement
Social, de la Solidarité et des Personnes Agées a également initié un contrat de
qualification dénommée « Solidarité-Emploi-Jeune ». Ce contrat consiste à faciliter
le placement des jeunes dans les entreprises afin qu’ils effectuent un stage de 6
mois non renouvelable pour bénéficier d’un versement d’allocations. Ainsi de
février à juin de l’année 2002, environ 600 jeunes diplômés ont été reçus par les
entreprises et collectivités territoriales. Tout comme le dispositif précédent, cette
mesure a également fait ses limites. L’Etat était le seul a supporté le coût du stage.
Par manque de suivi, certains stagiaires ne suivaient pas effectivement les stages
et recevaient des allocations.
Pour corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre de ces deux
dispositifs, le Programme Emploi Jeune (PEJ) a été initié en 2003. La composante
1 de ce projet est basée sur le partenariat et le partage des coûts du programme
entre les acteurs publics, privés et bénéficiaires ; le suivi et l’évaluation des jeunes
stagiaires pour faciliter leur embauche à la fin d’un stage de qualification de six
mois renouvelable une fois. La mise en œuvre de ce programme de 2003 à 2008
a permis de placer en stage de qualification 6592 jeunes et 4000 jeunes
 |
10 10 |
▲back to top |
9
volontaires dans les différents département ministériels et les collectivités
territoriales [TOURE. A, 2009]. Toujours selon le même auteur, 5625 jeunes ont
été formés à l’utilisation d’outils comme CREE-Germe et plus de 3556 plans
d’affaires ont été élaborés. Le devenir des bénéficiaires des différents
programmes reste inconnu.
A l’issue de cette première phase du Programme Emploi Jeune, une deuxième
phase a été lancée pour la période 2011-2016.
Malgré la mise en œuvre de ces différents programmes et politiques, les jeunes
ont du mal à s’insérer sur le marché du travail. En 2014, la proportion de jeunes
âgés de 15 à 24 ans représentait 34,04%1 de la population total au chômage.
Toujours selon la même source, 11,1 % de la population active au chômage sont
dans la même tranche d’âge contre 8,2% de taux de chômage global.
Le constat qui se dégage est qu’au Mali, les jeunes diplômés ont des difficultés
pour trouver un emploi. Le taux d’insertion global des diplômés sortis des grandes
écoles en 1995 était de 59,8%2. Contrairement aux pays européens, en Afrique et
particulièrement au Mali, l’économie ne repose pas sur les entreprises bien
structurées capables d’absorber le flux des sortants du système éducatif qui sont
formés pour travailler surtout dans les entreprises formelles. Les différentes
études sur l’insertion des diplômés du système éducatif ont montré que les
diplômés rencontrent d’énormes difficultés d’insertion. Ainsi en 1995, 18 mois
après leur sortie, seulement 22% des diplômés de l’enseignement technique et
professionnel avaient obtenu un emploi [O. François et al, 1995]. Selon les
différentes enquêtes emplois réalisées au Mali, il semblerait avoir une corrélation
positive entre le taux de chômage et le niveau de diplôme. Le taux de chômage
est plus élevé chez les titulaires de diplôme supérieur que ceux n’ayant aucun
niveau d’étude (25,5% contre 6,9% en 2014)3.
1 Source : ENE – 2014 collectées à partir de l’EMOP-2014 de l’INSTAT
2 Etudes de suivi des diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur au Mali, Décembre 1996
3 Source : ENE – 2014 collectées à partir de l’EMOP-2014 de l’INSTAT
 |
11 11 |
▲back to top |
10
Ainsi face à ces constats, la question qui se pose est de savoir pourquoi les jeunes
sont-ils confrontés aux difficultés d’insertion sur le marché du travail ? Pour trouver
des éléments de réponses à cette question, nous tentons de répondre aux
questions suivantes :
- Quelles sont les caractéristiques des emplois occupés par les jeunes ?
- Quelles attitudes les jeunes adoptent-ils pour chercher un emploi ?
- Quelles sont les caractéristiques des jeunes chômeurs ?
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les facteurs déterminants de
l’insertion des jeunes sur le marché du travail.
De façons spécifique, il s’agit de :
1. décrire les caractéristiques des emplois occupés par les jeunes sur le
marché du travail ;
2. identifier les canaux utilisés par les jeunes dans le cadre des recherches
d’emploi ;
3. décrire les caractéristiques des jeunes chômeurs.
Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre fait ressortir les
concepts théoriques et empiriques sur la recherche d’emploi et l’insertion des
jeunes sur le marché du travail. Au niveau du chapitre 2, nous examinons la
situation des jeunes sur le marché du travail en 2014. Le chapitre 3 identifie les
facteurs déterminants de l’insertion des jeunes sur le marché du travail.
 |
12 12 |
▲back to top |
11
1. Les fondements théoriques et empiriques de
l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché
du travail
Les travaux réalisés dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes se
sont beaucoup inspirés des théories néoclassiques. Parmi ces théories, on peut
citer la théorie du capital humain (Becker, 1964), la théorie filtre (Arrows et
Spence, 1973, 1974), la théorie de la recherche d’emploi (George Stigler, 1960),
la théorie du salaire de réserve. L’ensemble des travaux relatifs à l’insertion
s’inscrit dans l’une ou l’autre de ces théories. Pour mieux comprendre le
comportement des jeunes sur le marché du travail, nous développons dans ce qui
suit ces fondements théoriques concernant le marché du travail des jeunes et
l’insertion dans la vie active. Nous évoquerons également quelques résultats de
recherches effectués sur la question.
1.1. Les fondements théoriques de l’insertion professionnelle
1.1.1. La théorie du capital humain :
Ce concept a été développé pour la première fois en 1961 par l’économiste
américain Theodore Schultz. À partir de 1965, le concept fut approfondi et
vulgarisé par Gary Becker. Il obtient en 1992 le prix Nobel d’économie pour son
développement de la théorie du capital humain. Il définit le capital humain comme :
« l’ensemble des capacités productives qu’un individu acquiert par accumulation
des connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc.»4. Pour Becker,
chaque travailleur a un capital propre, qui lui vient de ses dons personnels, innés,
et de sa formation. Son stock de capital immatériel peut s'accumuler ou s'user. Il
augmente quand il investit, ce qui détermine les différences de productivité, et, par
hypothèse, de revenu.
4 http://ses.ens-lyon.fr/a-les-fondements-de-la-theorie-du-capital-humain-68305.kjsp#note8
 |
13 13 |
▲back to top |
12
1.1.2. La théorie du filtre :
Cette théorie est considérée comme étant un prolongement de la théorie du capital
humain. Michael Spence qui est présenté comme l’un des principaux promoteurs,
fait l'hypothèse que les études ne sont pas un investissement pour augmenter le
capital humain mais un simple moyen de sélection. L'éducation n'aurait pas pour
effet d'augmenter la productivité de l'agent mais de sélectionner les agents qui
sont déjà et seront les plus productifs. Ce qui remet en cause la rentabilité sociale
d'une éducation qui comporte des coûts importants sans pour autant améliorer la
productivité des travailleurs. Le diplôme obtenu est donc simplement un signal
pour l'employeur, c'est une preuve que l'agent est meilleur que les autres et qu'il
a été sélectionné.
1.1.3. La théorie de recherche d’emploi :
Cette théorie aide à mieux comprendre l’attitude des demandeurs d’emploi sur le
marché du travail. Elle a été développée par George Stigler5 dans les années
1960, parfois appelée : « théorie du Job search ». Elle permet d'expliquer la
coexistence entre un chômage volontaire et un chômage involontaire.
Dans un premier temps, les chercheurs d’emploi font un arbitrage entre les offres
d'emplois qui leur sont proposées et le fait de rester au chômage. Ils ne se
décident à occuper ces emplois que si le montant du salaire qui leur est proposé
est supérieur à l'espérance mathématique (c'est-à-dire la moyenne) du salaire que
l'on pourra leur proposer plus tard. Le niveau de salaire qui détermine s'il est plus
avantageux pour le travailleur d'entrer sur le marché du travail (sortir du chômage)
est appelé "salaire de réservation". On peut ainsi parler d'un chômage volontaire.
En d'autres termes, le travailleur reste au chômage tant que le bénéfice marginal
qu'il retire des offres d'emploi qui lui sont proposées demeure inférieur au bénéfice
marginal qu'il a à rester au chômage, dans l'attente d'offres meilleures. La
rémunération au-dessous de laquelle le travailleur va décider d'entrer dans
5 George Joseph Stigler, né le 17 janvier 1911 à Seattle (État de Washington, États-Unis) et mort le 1er
janvier 1991 à Chicago, est un économiste américain. Il a reçu le « prix Nobel » d'économie en 1982.
 |
14 14 |
▲back to top |
13
l'inactivité (de passer du statut de chômeur au statut d'inactif) est appelé "salaire
de réserve".
Dans un second temps, le chômage involontaire succède au chômage volontaire,
les chômeurs recherchant à tout prix un emploi.
Pour certains, le taux élevé du chômage chez les femmes s’expliquerait en partie
par cette théorie. Le coût du chômage (absence de salaire) étant moins lourd pour
les femmes dont le mari travaille et pour les jeunes entretenus par leur famille,
ceux-ci seraient moins pressés d’obtenir un emploi.
1.2. Quelques travaux réalisés sur l’insertion professionnelle :
L'insertion des jeunes dans la vie active constitue depuis un certain nombre
d'années un problème de société récurrent, souvent vécu difficilement par les
jeunes et leurs familles. Malgré la mise en œuvre des politiques et programmes
visant à promouvoir l’emploi des jeunes dans bon nombre de pays, la proportion
de jeunes au chômage demeure importante et inquiétante. Les difficultés liées à
l’insertion des jeunes sur le marché du travail ont siccité à la réalisation
d’importants travaux de recherche de par le monde. La plus part de ces
recherches tente d’expliquer les causes de ce phénomène. En général, ces
raisons varient d’un pays à un autre.
La forte employabilité des jeunes à faible niveau d’instruction par rapport à ceux
ayant un niveau d’instruction élevé serait due au fait que les jeunes qui ont un
niveau d’instruction élevé ne sont pas disposés à exercer des petits métiers.
Même s’ils exercent ce type de métiers, la plupart d’entre eux ne le déclarent pas
lors des enquêtes et se considèrent comme chômeurs (Camara, 2011).
Le même constat se dégage au Mali. Les chiffres de l’EPAM 2004, indiquent une
différence significative entre les taux de chômage selon le niveau d’instruction. En
effet, de façon générale – et paradoxale – le chômage touche plus les diplômés
du secondaire technique et professionnel et ceux du supérieur (17,8% contre
19,4%). Cette situation est d'autant plus problématique que les formations
techniques et professionnelles ont été conçues pour mieux répondre aux besoins
 |
15 15 |
▲back to top |
14
de l'économie et favoriser l'insertion des diplômés. En outre, le taux de chômage
élevé des diplômés constitue un signal très négatif pour les personnes encore
scolarisées dans la mesure où il réduit le rendement de l’éducation en
n’augmentant pas la probabilité de trouver un emploi (Traoré, 2005).
Selon une étude réalisée en Guinée sur l’insertion socio-professionnelle des
diplômés de l’enseignement supérieur, les facteurs qui influencent
significativement l’accès à un emploi sont le statut des établissements de
formation, la maîtrise d’une langue internationale autre que le français, le stage,
la formation en technique de recherche d’emploi, la spécialité, le groupe d’âge et
la position sociale des parents (Doumbouya et al, 2011).
Avec la dégradation de la conjoncture économique en Europe et particulièrement
en France, les jeunes sortis de l’enseignement supérieur en 2010, interrogés dans
le cadre des enquêtes Génération, n’ont pas été à l’abri du chômage
contrairement à leurs prédécesseurs sortis en 2004. Contrairement à la plus part
des pays africains, les non-diplômés restent les plus exposés au chômage dans
les pays développés.
Les chances de trouver plus facilement un emploi sont souvent liées aux filières
de formation. Les jeunes bacheliers en sciences techniques et en sciences
mathématiques au Maroc ont des itinéraires universitaires plus prometteurs, du
fait de leur large éventail de choix et de leur avantage comparatif pour accéder
aux formations sélectives. Ces diplômés trouvent, une fois effectuées des études
supérieures, plus de facilités à l’insertion (Mourji et Gourch, 2007).
Les difficultés d’insertion professionnelle en France sont plus importantes pour les
jeunes dont le père est ouvrier que pour les enfants de cadres ou de professions
intermédiaires (Lopes et G. Thomas, 2006).
 |
16 16 |
▲back to top |
15
2. Situation des jeunes sur le marché travail en 2014.
Avant d’analyser cette situation, il est important de définir un certain nombre de
concepts qui sont utilisés tout au long de cette analyse. Qu’est-ce que nous
attendons par jeune, taux de chômage, population en âge de travailler, inactifs,
population active ?
Jeune : est considéré comme jeune tout individu âgé de 15 à 25 ans selon
le BIT. Par contre au Mali, les jeunes sont des individus âgés de 15 à 40
ans.
Population occupé ou en emploi : C’est la somme des personnes âgées de
15-64 ans qui, pendant la période de référence sont au travail ou pourvues
d’un emploi, mais ne l’ont pas exercé.
Taux de chômage BIT : c’est le pourcentage de la population active qui ne
dispose pas d’emploi, qui est en recherche active durant la période de
référence donnée et qui est disponible.
Taux de chômage élargi : c’est la proportion en pourcentage de la
population active qui est sans emploi et disponible pour travailler. C’est ce
taux qui est officiellement utilisé au Mali.
Population en âge de travailler : c’est la population en âge de travailler qui
comprend donc toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans en âge révolue.
On définit conventionnellement les inactifs comme les personnes qui ne
sont ni en emploi ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants,
retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de
travailler, etc.
Population active : Elle représente l’ensemble des personnes âgées de 15
à 64 ans révolu, qui sont occupées et celles qui sont au chômage.
 |
17 17 |
▲back to top |
16
Taux de sous-emploi : le nombre d’actifs occupés travaillant
involontairement moins de 35 heures par semaine rapporté à la population
active occupée
Proportion de jeune ni en emploi, ni en formation : c’est le pourcentage de
jeunes âgés de 15 à 40 ans révolu qui ne sont ni en emploi, ni dans aucun
dispositif d’éducation ou de formation.
2.1. Les jeunes face à la recherche d’emploi :
Le comportement des jeunes par rapport à la recherche d’emploi peut nous aider
à mieux comprendre non seulement l’accès des jeunes à l’emploi, mais également
à mieux cerner l’intérêt que les jeunes portent aux programmes d’insertion et aux
activités des structures chargées de l’intermédiation.
En 2014 au Mali, 65% des jeunes âgés de 15 à 40 étaient des actifs occupés
contre 6,7% de chômeurs. Parmi les jeunes en situation activités, 72% sont sans
aucun niveau d’instruction contre seulement 1% des jeunes ayant le niveau
d’études supérieur. Les jeunes femmes sont les plus nombreuses parmi les
inactifs (71%). Cette inactivité touche en particulier les jeunes de la tranche d’âge
15-24 ans (65%).
Comparativement aux autres régions, les régions de Sikasso et Ségou ont plus
d’actifs occupés (respectivement 20% et 17%). Par contre, Sikasso et Bamako ont
des proportions importantes de jeunes chômeurs (23% et 20%). Les jeunes dans
l’inactivité sont plus nombreux à Bamako qu’ailleurs (23%).
 |
18 18 |
▲back to top |
17
2.1.1. Caractéristiques des jeunes en activité :
Dans cette partie nous avons reparti les jeunes âgés de 15 à 40 suivant la situation
dans l’activité en trois catégories à savoir les actifs occupés, chômeurs, inactifs
qui se présente comme suite.
Tableau 1-Répartition des jeunes (15-40 ans) selon la situation dans l’activité
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Situation dans l’activité
Actifs occupés Chômeurs Inactifs Ensemble
Ensemble (en millier) 3 845 394 1 622 5 861
Distribution (en%)
Niveau d’éducation
Aucun niveau 72 57 46 64
Primaire 23 28 46 30
Secondaire 3 9 6 4
Supérieur 1 7 2 2
Sexe
Hommes 52 44 29 45
Femmes 48 56 71 55
Age (an)
15 - 24 39 48 65 47
25 - 35 44 41 27 39
36 - 40 17 11 8 14
Région
Kayes 15 14 10 13
Koulikoro 15 15 22 17
Sikasso 20 26 11 18
Ségou 17 9 13 15
Mopti 15 7 10 13
Tombouctou 4 3 6 5
Gao 2 5 7 4
Bamako 12 20 23 15
Ensemble 100 100 100 100
 |
19 19 |
▲back to top |
18
2.1.2. Caractéristiques des jeunes ni en emploi ni en éducation ni en
formation
L’un des constats qui se dégagent au tableau n°1, est qu’une part importante
(65%) de jeunes en situation d’inactivité se trouve dans la tranche d’âge 15-24
ans. En général au Mali, beaucoup de jeunes poursuivent leur formation jusqu’à
l’âge de 24 ans et souvent même au-delà. Dans le graphique ci-dessous, les
jeunes qui constituent leur formation ont été exclu de la population des inactifs
pour mieux cerner cette question.
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Parmi les 22,6% de jeunes âgés de 15 à 40 ans qui ne sont ni en emploi ni en
formation, les femmes représentent 81,9%. La proportion des jeunes femmes est
plus importante que celle des hommes à tous les niveaux de l’enseignement à
l’exception du niveau supérieur. En passant du niveau aucun au niveau
secondaire l’écart entre les deux se rétréci (de 70 points à 36 points de
pourcentage).
15%
27% 28%
68%
85%
77%
72%
32%
Aucun niveau Primaire Secondaire Supérieur
P
o
u
ce
n
ta
ge
Niveau d'instruction
Graphique 1: Répartition en pourcentage des jeunes ni en emploi, ni éducation, ni en formation
en 2014 selon le niveau d'instrcution et le genre
Hommes Femmes
 |
20 20 |
▲back to top |
19
Ces chiffres démontrent une fois de plus l’importance de l’inactivité des jeunes
femmes.
Tout comme le graphique 1, le graphique 2 faire ressortir le même constat quant
à la proportion plus élevée des femmes ni en emploi, ni en éducation et ni en
formation par rapport à celle des hommes au niveau de toutes les tranches d’âge.
Cet écart devient plus importance en passant de la tranche d’âge 15-24 ans à la
celle des 36-40 ans (56 points contre 72 points de pourcentage).
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
A partir de 20 ans, la probabilité pour qu’une femme soit mariée devient plus
élevée et cela jusqu’à 25 ou 30 ans. L’inactivité des femmes serait donc liée leurs
statut matrimonial. Le poids de la tradition fait que les femmes mariées sont
nombreuses à ne pas exercer une activité économique. Certaines ne sont même
autorisées par leur mari à faire le petit commerce auquel bon nombre de femmes
s’adonnent.
22%
15% 14%
78%
85% 86%
15 - 24 25 - 35 36 - 40
P
o
u
rc
en
ta
ge
Tranche d'âge
Graphique 2: Répartition en pourcentage des jeunes ni en emploi, ni en éducation et ni en
formation selon la tranche d'âge et le genre en 2014
Hommes Femmes
 |
21 21 |
▲back to top |
20
2.1.3. Attitude des jeunes ni en emploi, ni en éducation et ni en
formation face à la recherche d’emploi
Dans le tableau 2, nous analysons le comportement de ces jeunes par rapport à
la recherche d’emploi.
Le principal constat qui se dégage dans ce tableau est que parmi les jeunes ni en
emploi, ni en éducation et ni en formation, plus 78% ne sont pas à la recherche
d’emploi. Parmi ceux-ci, plus 91 % sont des femmes. Plus de 90% des jeunes ni
en emploi, ni en éducation et ni en formation qui ne sont pas à la recherche
d’emploi sont mariés. Les jeunes femmes mariées constituent une part importante
des inactifs sur le marché du travail.
 |
22 22 |
▲back to top |
21
Tableau 2-Répartition des jeunes (15-40 ans) ni en emploi, ni en éducation et ni en formation selon la
recherche d’emploi
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Du fait que ces jeunes ne sont pas à la recherche d’emploi, ils ne sont pas donc
considérés comme chômeurs au selon la définition du Bureau International du
Travail (BIT). C’est donc plus d’un million de jeunes qui ne sont pas comptabilisés
parmi les chômeurs.
Recherche d’emploi
Non Oui Ensemble
Ensemble (en milliers) 1 047 279 1 326
Distribution (en%)
Niveau d’éducation
Aucun niveau 76 63 73
Primaire 21 25 22
Secondaire 2 7 3
Supérieur 1 6 2
Ensemble 100 100 100
Sexe
Hommes 9 51 18
Femmes 91 50 82
Ensemble 100 100 100
Age (an)
15 - 24 44 43 44
25 - 35 43 43 43
36 - 40 13 14 13
Ensemble 100 100 100
Statut matrimonial
Marié monogame 56 43 55
Marié polygame 36 51 38
Union libre 1 0 1
Célibataire 1 1 0
Divorcé/Séparé 1 1 1
Veuf 5 4 5
Ensemble 100 100 100
 |
23 23 |
▲back to top |
22
2.2. Les emplois occupés par les jeunes :
Dans cette section, nous analysons le taux d’emploi des jeunes et la nature des
emplois qu’ils occupent.
2.2.1. Le taux d’emploi des jeunes
Tableau 3-Taux d’emploi des jeunes de 15 à 40 ans
Source : Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Sexe
Hommes Femmes Ensemble
Population jeune
(en milliers)
2 629 3232 5 861
Distribution (en%)
Niveau d’éducation
Aucun niveau 90 64 74
Primaire 59 42 51
Secondaire 58 38 50
Supérieur 44 37 42
Age (an)
15 - 24 61 49 55
25 - 35 89 63 74
36 - 40 93 67 79
Région
Kayes 76 70 73
Koulikoro 72 47 58
Sikasso 78 69 73
Ségou 84 63 73
Mopti 88 67 76
Tombouctou 79 47 61
Gao 69 13 36
Bamako 57 44 50
Ensemble 76 58 66
 |
24 24 |
▲back to top |
23
Le taux d’emploi global des jeunes de 15 à 40 ans est de 66% en 2014. Les non
scolarisés occupent 74 % des emplois. Parmi ceux-ci plus 90 sont hommes. Le
taux d’emploi des diplômés du supérieur (hommes et femmes) demeure faible
comparativement à celui des jeunes ayant un niveau d’études inférieur. Mais de
façon générale, le taux d’emploi des hommes est plus élevé que celui des femmes
à tous les niveaux. C’est surtout dans les régions de Koulikoro, Tombouctou et
Gao que l’écart entre les deux sexes est considérable.
2.2.2. Nature des emplois occupés par les jeunes
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Le graphique 3 nous renseigne que les jeunes non scolarisés occupent tous
(100%) des emplois informels. Les jeunes ayant le niveau d’études primaire
occupent à 97% des emplois informels contre seulement 3% d’emploi formel. Pour
les diplômés du secondaire, 56% parmi eux occupent des emplois informels,
contre 57% des diplômés du supérieur.
100%
97%
56% 57%
0%
3%
44% 43%
Aucun niveau Primaire Secondaire Supérieur
P
o
u
rc
en
ta
ge
Niveau d'instruction
Graphique 3: Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) selon la nature de
l'emploi et le niveau d'instruction au Mali en 2014
Informel formel
 |
25 25 |
▲back to top |
24
Les diplômés de l’enseignement technique et professionnel et ceux du supérieur
sont formés en principe pour exercer dans le secteur formel ou pour occuper des
emplois formels. Le secteur formel n’offre pas beaucoup d’opportunité à ces
diplômés, de ce fait, certains sont obligés d’accepter des emplois informels.
Nous constatons sur le graphique 4 que plus de 95% des hommes et des femmes
occupent des emplois informels. La proportion des femmes (98%) est légèrement
supérieure à celle des hommes (96%). De façon globale, 97% les jeunes
occupent des emplois informels contre 98% des actifs occupés dans le pays.
96%
4%
98%
2%
Informel formel
P
o
u
rc
e
n
ta
ge
N
at
u
re
d
e
l'
e
m
p
lo
i
Sexe
G R A P H I Q U E 4 : R É P A P A R T I T I O N E N P O U R C E N T A G E D E S J E U N E S ( 1 5 - 4 0 A N S ) S E L O N
L A N A T U R E D E L ' E M P L O I E T L E G E N R E A U M A L I E N 2 0 1 4
Hommes Femmes
 |
26 26 |
▲back to top |
25
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Sur ce graphique, 99% des jeunes âgés de 15 à 24 ans occupent des emplois
informels contre 96% des jeunes âgés de 25-35 ans et de 36-40 ans.
2.3. Le chômage des jeunes :
Dans cette section, nous analysons les caractéristiques du chômage des jeunes
et le comportement de ceux-ci par rapport à la recherche d’emploi.
2.3.1. Caractéristiques du chômage des jeunes :
Le taux de chômage des jeunes femmes à tous les niveaux est plus élevé que
celui des jeunes hommes (tableau 4). Le chômage touche beaucoup plus les
femmes que les hommes presque dans toutes régions à l’exception de la région
de Ségou et Mopti. Globalement, 11% des chômeurs sont des femmes contre 8%
des chômeurs hommes.
Le rapport de l’OIT6 analysant les résultats d’enquêtes menées dans huit pays
d’Afrique subsaharienne montre que si les taux de chômage augmentent avec le
niveau d’éducation, ce sont les jeunes gens les moins instruits qui sont
6 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_237571/lang--fr/index.htm
15 - 24 25 - 35 36 - 40
99% 96% 96%
1% 4% 4%
P
o
u
rc
en
ta
ge
Tranche d'âge
Graphique 5: Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) selon la nature de l'emploi et
la tranche d'âge au Mali en 2014
Informel formel
 |
27 27 |
▲back to top |
26
désavantagés en termes de salaire et d’accès à un emploi stable.
Tableau 4-Taux de chômage des jeunes de 15 à 40 ans en 2014
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Les moins éduqués ont plus tendance à être des travailleurs indépendants ou à
accepter des salaires inférieurs. Selon ce rapport, dans tous les pays étudiés sauf
un – le Malawi – plus le niveau d’éducation d’un jeune est faible, moins ce jeune
est susceptible d’être au chômage.
Sexe
Hommes Femmes Ensemble
Population active
Jeune (en milliers)
2 159 2 081 4 240
Distribution (en%)
Niveau d’éducation
Aucun niveau 6 8 7
Primaire 9 14 11
Secondaire 14 35 22
Supérieur 35 43 37
Age (an)
15 - 24 10 12 11
25 - 35 7 10 9
36 - 40 5 8 6
Région
Kayes 9 9 9
Koulikoro 9 9 9
Sikasso 7 16 12
Ségou 6 4 5
Mopti 6 3 5
Tombouctou 3 13 8
Gao 9 49 22
Bamako 15 15 15
Milieu
Rural 17 13 15
Urbain 9 7 8
Ensemble 8 11 9
 |
28 28 |
▲back to top |
27
2.3.2. Les stratégies de recherche d’emploi des chômeurs
Nous constatons sur ce graphique 6 que 86% des hommes chômeurs et 79%
des femmes à la recherche d’emploi passent par les relations personnelles pour
chercher un emploi.
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Les structures qui ont été créées pour faciliter le contact entre les demandeurs et
les offreurs d’emploi sont rarement fréquentées par les jeunes à la recherche
d’emploi. Des actions de sensibilisation doivent être faites par ces structures
auprès des futurs demandeurs d’emploi.
Contrairement aux hommes, 11% des femmes à la recherche d’emploi désir créer
leur propre entreprise.
86%
2% 4% 0% 0% 5% 2% 1%
79%
1%
3%
0% 0% 3%
11%
2%
Relations
personnelles
(parents ou
amis)
Directement
auprès de
l’employeur
Petites
annonces,
médias
ANPE Bureau de
placement
privé (BPP)
Concours Cherche à
créer une
entreprise
Autre moyen
P
o
u
rc
e
n
ta
ge
Sources de recherche d'emploi
Graphique 6-Répartition des jeunes chômeurs selon les moyens utilisés pour
la recherche d’emploi
Homme Femme
 |
29 29 |
▲back to top |
28
Tableau 5-Taux d’inscription des jeunes chômeurs à l’ANPE
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Seulement 4% des jeunes chômeurs à la recherche d’emploi affirment être
s’inscrits à l’ANPE. Le taux d’inscription des hommes est légèrement supérieur à
celui des femmes (5% contre 4%). Ce tableau dénote une fois de plus la
méconnaissance des missions de l’ANPE par les demandeurs d’emploi. Ce faible
taux d’inscription auprès de l’ANPE sous-estime considérablement les statistiques
sur les demandes et les offres d’emplois publiées par la structure.
Tableau 6 : Taux d’inscription des jeunes chômeurs auprès des bureaux privés de placement
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Le même constat se dégage à la lecture de ce tableau. Le taux d’inscription des
jeunes chômeurs à la recherche d’emploi est très faible au niveau des Bureaux
Privés de Placement (BPP). Ces mêmes constats se dégagent dans les résultats
d’autres études réalisées sur la question dans d’autres pays comme la Côte
d’Ivoire (A. Gratier, 2007), le Cameroun (J. TEDOU et al, 2010).
Sexe
Hommes Femmes Ensemble
Population de jeunes
chômeurs (en milliers)
175 219 394
Distribution (en%)
Inscription à l’ANPE
Oui 5 3 4
Non 95 97 96
Ensemble 100 100 100
Sexe
Hommes Femmes Ensemble
Population de jeunes
chômeurs (en milliers)
175 219 394
Distribution (en%)
Inscription auprès des BPP
Oui 1 0 1
Non 99 100 99
Ensemble 100 100 100
 |
30 30 |
▲back to top |
29
Un effort de sensibilisation doit être fait auprès des demandeurs d’emploi sur les
missions de l’ANPE et les structures privées chargées de l’intermédiation.
Source : ONEF Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Ce graphique fait clairement apparaître la préférence des femmes pour l’emploi
indépendant (75%) contrairement aux hommes (25%). Les hommes préfèrent
surtout en majorité (51%) des emplois salariés. Au mali les femmes sont plus
disposées à prendre le risque que les hommes. Les hommes et les femmes jouent
des rôles différents dans la société. En général la prise en charge des dépenses
familiales est assurée par les hommes, ce pourrait expliquer leur préférence pour
les emplois salariés.
Les chômeurs de longue durée représentent 92% de l’ensemble des jeunes
chômeurs en 2014. Cette proportion est très élevée pour qui connait ses
conséquences sur le plan individuel (Tableau 7).
51%
25%
27%
49%
75%
73%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Salarié
Indépendant
indifférent
Graphique 7: Répartition en pourcentage des jeunes (15-40 ans) chômeurs selon le type
d’emploi recherché et le genre
Hommes Femmes
 |
31 31 |
▲back to top |
30
Tableau 7-Répartition des chômeurs selon la durée au chômage
Source : Etabli à partir des données de l’EMOP 2014
Il peut engendre le risque de déqualification, de repli sur soi, de pauvreté. Sur le
plan social, il nuit à la cohésion sociale en excluant une partie de la population de
l’un des plus puissants vecteurs d’intégration : le travail.
3. Les déterminants de l’insertion professionnelle des
jeunes
3.1. Les données
Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de l’enquête
modulaire permanente auprès des ménages, réalisée en 2014 par l’Institut
National de la statistique (INSTAT). Elles ont été collectées lors du troisième
passage de ladite enquête (octobre - décembre). C’est donc des données
transversales qui fournissent des informations sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité de la population sur la période de l’enquête.
Au-delà de l’analyse descriptive effectuée ci-dessus, ce chapitre tente
d’expliquer l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail par
des variables liées aux caractéristiques individuelles, à l’environnement
socioculturel et à l’environnement économiques des parents. Pour ce faire, un
modèle logistique multinomial est utilisé.
Sexe
Hommes
Femmes
Ensemble
Population de jeunes
chômeurs (en milliers)
175 219 394
Distribution (en%)
Type de chômage
Chômage de courte durée (moins d’un an) 7 9 8
Chômage de longue durée (plus d’un an) 93 91 92
Ensemble 100 100 100
 |
32 32 |
▲back to top |
31
3.2. Le choix de variables :
La revue de la littérature et les analyses bi-variées réalisées ont permis
d’identifier et d’utiliser certaines variables dans le cadre de la modélisation des
déterminants de l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.
3.2.1. La variable dépendante :
La variable dépendante du modèle est la situation dans l’activité. Elle a trois
modalités : actifs occupés, chômeurs, inactifs. Le choix du modèle est justifié
par la présence de ces trois modalités au niveau de la variable dépendante.
3.2.2. Les variables explicatives :
Ces variables peuvent être classées en trois catégories
3.2.2.1. Caractéristiques individuelles
Age
L’âge et l'âge au carré sont des variables généralement utilisées pour
appréhender le potentiel lié à l'expérience de l'individu. Dans le cadre de cette
étude, nous avons retenu les tranches d’âge 15-24 ans, 25-35 ans et 36-40 ans.
Sexe
Le genre peut être un élément discriminant dans l'insertion des jeunes, compte
tenu des réalités socioculturelles du pays.
Niveau d’instruction
Le niveau d’instruction influe sur les capacités productrices de l’individu par
l’accumulation des connaissances générales ou spécifiques. Cette variable
comporte les modalités suivantes : aucun niveau, primaire, secondaire et
supérieur.
Le statut matrimonial
Le statut matrimonial défini la situation de l’individu par rapport au mariage.
L’individu est considéré comme marié si le mariage est célébré de façon
 |
33 33 |
▲back to top |
32
traditionnelle, civile ou religieuse. Les modalités de cette variable sont au nombre
de trois : marié(e), célibataire, divorcé(e), veuf (ve)/séparé(e)
3.2.2.2. Caractéristiques liées à l’environnement socioculturel et familial
Milieu de résidence
Les opportunités d’emploi varient d’une localité à une autre. Le milieu urbain est
une forte zone de concentration démographique comparativement au milieu rural.
Cette variable présente deux modalités : urbain et rural.
Existence d'enfants de moins de 14 ans
L’âge légal pour travailler commence à partir de 15 ans. Avant cet âge, les enfants
sont en général à la charge des plus âgés. La variable a deux modalités : oui et
non.
Nombre d'actifs occupés dans le ménage
Les actifs occupés sont des individus qui ont déclaré exercé une activité au
moment de l’enquête. Pour faciliter l’interprétation de cette variable, les individus
sont classés dans les catégories suivantes.
3.2.2.3. Caractéristiques liées à l’environnement économique du chef de
ménage
Secteur d'activité du chef de ménage
Cette variable permet de classer le chef de ménage exerçant une activité suivant
les secteurs d’activités : secteur primaire, industrie et BTP, commerce, service.
Le Niveau d’instruction du chef de ménage
Tout comme le niveau d’instruction de l’individu, celui du chef de ménage
comporte également quatre modalités : aucun niveau, primaire, secondaire et
supérieur.
 |
34 34 |
▲back to top |
33
Le revenu moyen du ménage
Il s’agit de l’ensemble des revenus du ménage rapporté au nombre de personne
vivant dans le ménage.
3.3. La spécification du modèle
Le choix du modèle logistique multinomial est justifié par le nombre de modalités
(plus de 2) et du caractère qualitatif de la variable à expliquer. Parmi les trois
types du modèle multinomial, c’est le modèle logistique multinomial nominal ou
non ordonné qui est retenu dans le cadre cette étude. Les modalités de la variable
dépendante ne respectent pas un ordre préétabli.
L’objectif de cette régression logistique est d’analyser une relation causale entre
une variable dépendante situation dans l’activité (SITUAT) et les dix (10) variables
indépendantes retenues dans l’étude. En d’autres termes, la régression permet
de déterminer la probabilité d’appartenance du jeune à une des catégories (actif
occupé, chômeur, inactif) de la variable dépendante (SITUAT) expliquée par les
variables explicatives retenues dans le cadre de cette étude. Cette analyse permet
de mieux comprendre et d’expliquer l’insertion professionnelle des jeunes sur le
marché du travail, voire même de la prédire, si le modèle est suffisamment solide.
L’équation du modèle se présente comme suit :
??(?? = ??/??1, … , ????) =
1
1+??????−(??+∑ ????????)
??
??=1
ou
?????????? ?? = ?? + ∑ ????
??
??=1
????
Y est la variable dépendante avec k modalités
???? Représente les variables indépendantes avec i=1, n.
 |
35 35 |
▲back to top |
34
3.3.1. L’estimation des paramètres et interprétation des résultats du
modèle
Nous avons estimé le modèle7 avec dix (10) explicatives, parmi lesquelles, six (06)
ont été significatives. La variable à expliquer est la situation dans l’activité qui
comporte trois (03) modalités : actif occupé, chômeur, et inactif. La modalité de
référence est actif occupé.
3.3.2. Evaluation de la qualité de l’ajustement du modèle
Vu le résultat du test significatif du ratio de vraisemblance, nous pouvons donc
affirmer que les variables explicatives retenues dans cette étude apportent une
quantité importante d’informations pour expliquer la variabilité de la situation dans
l’activité.
3.3.3. Evaluation individuelle des coefficients
Les variables explicatives retenues dans le cadre cette étude sont toutes
significatives au seuil 1%. Les coefficients sont tous significativement différent de
zéro, de ce fait, les variables du modèle contribuent tous à mieux prédire la
situation d’activité des jeunes.
3.3.4. Interprétation des résultats
Les jeunes de 15-24 ans et 25-35 ans sont plus exposés au chômage que
ceux de 36-40 ans.
Un jeune dans les tranches d’âge 15-24 ou 25-35 ans a respectivement 1,8 et 1,3
fois plus de risque qu’un jeune de la tranche d’âge 36-40 ans d’être chômeur plus
tôt qu’être actif occupé. Par contre s’il est la tranche d’âge 15-24 ans, le jeune a
2,9 fois plus de risque d’être inactif plus tôt qu’être actif occupé. Ceci s’explique
par le fait que les jeunes de cette tranche d’âge pour la plus part sont en formation,
7 Les résultats détaillés du modèle logistique multinomial se trouvent à l’annexe.
 |
36 36 |
▲back to top |
35
et rare sont parmi eux, ceux qui exercent une activité professionnelle ou cherchent
à travailler.
Les jeunes hommes ont un risque plus élevé de chômer que les jeunes
femmes
Une jeune femme a respectivement 43% et 74% de risque de moins qu’un jeune
homme d’être au chômage et inactif plutôt qu’être actif occupé, toute chose égales
par ailleurs (c’est-à-dire à même tranche d’âge, niveau d’instruction, milieu de
résidence, etc.).
Les jeunes vivants en milieu rural sont plus exposés au chômage que ceux
habitants dans la zone urbaine.
Un jeune vivant en milieu rural à respectivement 1,2 et 2,3 fois plus de risque
qu’un jeune vivant en milieu urbain d’être au chômage et inactif plutôt qu’être actif
occupé. Ce résultat contredit, les résultats d’autres études selon lesquelles, La
proportion de chômeurs est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Les
données de l’EMOP ont été collectées d’octobre en décembre 2014. Cette période
coïncide avec la fin des travaux champêtres dans les zones rurales et pourrait
faire baisser le taux d’emploi de la population active.
Le niveau d’instruction des jeunes ne les met pas à l’abri du chômage.
Un jeune avec aucun niveau d’instruction, niveau primaire, niveau secondaire a
respectivement 81%, 75% et 52,3% moins de risque qu’un jeune ayant le niveau
d’études supérieur d’être au chômage plutôt qu’être actif occupé. Plus le niveau
d’études augmente, plus le risque d’être au chômage devient élevé.
Le statut matrimonial
Les jeunes mariés et célibataires ont respectivement 58% et 52% moins de risque
qu’un jeune veuf d’être au chômage plutôt qu’être actif occupé. Par contre, les
jeunes divorcés, séparés ont 2,5 fois plus de risque d’être au chômage plutôt
qu’être actif occupé.
 |
37 37 |
▲back to top |
36
Le risque de chômer augmente avec le niveau du revenu moyen du ménage
Un jeune issue de ménage dont le revenu est au plus égal à 25 000 FCFA, ou se
situe entre 25 000 et 50 000 a respectivement 3% et 23% moins de risque qu’un
jeune issu d’un ménage dont le revenu est supérieur ou également à 100 000
FCFA d’être au chômage plutôt qu’être actif occupé. Par contre, les jeunes dont
le ménage dispose de moins de 25 000 FCFA de revenu ont 2,4 fois plus de risque
d’être inactif qu’un jeune dont le revenu par tête est supérieur à 100 000 FCFA.
 |
38 38 |
▲back to top |
37
Conclusion
Cette étude avait pour objectif principal à identifier déterminants de l’insertion des
jeunes sur le marché du travail au mali.
Pour atteindre cet objectif, nous avons fait dans un premier temps une analyse
descriptive des caractéristiques des jeunes sur le marché du travail. Nous avons
également analysé les moyens utilisés par les jeunes dans le cadre de la
recherche d’emploi. Le constant qui découle de cette analyse est que les jeunes
sont en situation de précarité sur le marché du travail. Plus de 95 % d’entre eux
occupent des emplois informels et ont pour la plus part aucun niveau d’instruction.
Les diplômés du supérieur et ceux du secondaire, bien qu’étant sous représentés
dans l’échantillon ont un taux d’emploi très faible comparativement à ceux qui
n’ont aucun niveau ou ceux ayant seulement le niveau d’études primaire.
Le taux de chômage par contre est très élevé pour les plus diplômés, ce qui
confirme une fois de plus la difficulté d’insertion de ces jeunes sur le marché du
travail. Les chômeurs qui sont à la recherchent d’emploi passent par des relations
personnelles pour la plus part (86%) et très peu d’entre eux passent par le canal
de l’Agence Nationale pour l’Emploi ou par les Bureaux privés de placement.
Les jeunes femmes représentent plus 90% des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni
en éducation, ni en formation et qui n’ont entreprit aucune démarche pour
chercher un emploi durant la semaine de référence de l’enquête. Ces femmes
viennent donc grossir le lot des inactifs. Celles qui sont à la recherche d’emploi
désir plutôt créé leur propre entreprise contrairement aux hommes qui préfèrent
plus tôt obtenir un emploi salarié.
La régression logistique multinomiale réalisée dans un second temps, nous a
permis d’identifier un certain nombre de facteurs déterminants dans l’insertion des
jeunes sur le marché du travail. Ces facteurs sont entre autre : le niveau d’études,
le genre, le milieu de résidence, le niveau d’études du chef de ménage, le revenu
du ménage, le statut matrimonial du jeune.
 |
39 39 |
▲back to top |
38
Contrairement aux pays développés, le niveau du diplôme ne met pas les jeunes
à l’abri du chômage en Afrique et particulièrement au Mali. Les jeunes hommes
sont plus exposés au chômage par rapport aux jeunes femmes.
Les jeunes vivants en milieu urbain sont moins exposés au chômage que ceux
vivant en milieu rural.
Cette étude nous permis de mettre en exergue l’importance des facteurs
individuels, familiaux et environnementaux dans l’insertion des jeunes sur le
marché. Les facteurs macro-économiques qui n’ont pas été abordés dans cette
étude jouent également un rôle important dans la création d’entreprises et par
conséquent dans la création d’emploi.
Recommandation
Les constats faits suite à cette étude, nous amènent à faire des recommandations
à l’endroit aux :
1. Structures chargées de l’exécution des politiques et programmes
d’emploi :
o de sensibiliser davantage les jeunes demandeurs d’emploi sur les
missions des structures ;
o de mettre en place des produits nouveaux à l’endroit des
demandeurs d’emploi afin de les orienter dans leur démarche ;
o de financer les projets des jeunes sur une base très sélective en
donnant la priorité aux projets bien structurés et présentés par les
jeunes femmes ;
o de mettre en place un cadre de concertation entre les structures
comme l’ANPE, l’APEJ, le FAFPA, l’ONEF et l’INIFORP, pour une
meilleure coordination de la mise en œuvre des activités.
2. Autorités de :
o veiller à la bonne mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi
et du programme national emploi jeune en particulier ;
 |
40 40 |
▲back to top |
39
o mettre en place un dispositif de suivi-évaluation coordonné par
l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) des
politiques et programmes visant à promouvoir la création d’emploi.
 |
41 41 |
▲back to top |
40
Biographiques
Cahuc, P., et Zybberberg, A. (2005) Le chômage fatalité ou nécessité ?, édition
Flammarion, Paris.
Camara, I et Zanou, B. Capital humain et insertion des jeunes sur le marché du
travail : cas de la Commune d’Aboisso :(Côte d’Ivoire). Communication ENSEA,
2011.
Doumbya, M., Bah, A.O et Diallo, R.F. Déterminants de l’insertion
socioprofessionnelle des diplômés des Institutions d’enseignement supérieur
guinéenne. Programme des subventions ROCARE pour la recherche en
éducation 2011.
Ehrenberg, R., et Smith, R. (2000) Modern Labor Economics: theory and public
policy Addison Wesley Longman, Inc.
Fouzi Mourji. Modélisation de l’insertion professionnelle des diplômés de
l’enseignement superieur au Maroc. Crise économique n°22 * Printemps d’été
2008.
Orivel, F., Doumbia, S., Eury, Xavier. Etude de suivi des diplômés des
enseignements secondaire et supérieur au Mali. Observatoire de l’Emploi et de
la Formation (OEF), décembre 1995.
Institut international de planification de l’éducation : l’insertion professionnelle
des jeunes-un défi permanent, lette d’information, Vol. xxiii, n°2, avril-juin 2005,
Paris, France.
Lopez, A et Thomas, G. Insertion des jeunes sur le marché du travail : poids des
origines socio-culturelles. Données sociales- la société française, édition 2006.
Maillefert, M. l’Economie du travail : concepts, débats et analyses, 2ème édition,
Studyrama, France, 3ème trimestre, 2004
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle-Rapport d’évaluation
finale du Programme Emploi-Jeune (PEJ), rapport définitif, juillet 2009.
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle-Programme Emploi-
Jeune (PEJ II), Document cadre, version finale, 2011.
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle-Politique Nationale de
l’Emploi, mai 2014.
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle-Programme National de
Formation Professionnelle, Juillet 2009.
 |
42 42 |
▲back to top |
41
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle-Programme Décennal
de Développement de la Formation Professionnelle pour l’Emploi (PRODEFPE),
1ère phase : Programme triennal 2015-2017, Janvier 2015.
Site des sciences économiques et sociales : les fondements de la théorie du
Capital humain. [en ligne]. Disponible sur : http://ses.ens-lyon.fr/a-les-
fondements-de-la-theorie-du-capital-humain-68305.kjsp#note8. (Page consultée
le 17 décembre 2015).
O.I.T. Actualité : Investir dans l’éducation sert –il aux jeunes d’Afrique ? [en
ligne]. Disponible sur : http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_237571/lang--fr/index.htm. (Page consultée de 23
décembre 2015).
Weyer, F (2011). Education et insertion professionnelle au Mali : jeu des
trajectoires, enjeu familial et inégalités, Karthala, Paris.
 |
43 43 |
▲back to top |
42
Annexe :
Résultats de régression logistique multinomiale (la modalité de référence est actif occupé)
Constante ,275 ,000 ,105 ,000
Tranche d’âge
15 - 24 ans ,574 0,000 1,776 1,086 0,000 2,963
25 - 35 ans ,248 0,000 1,281 ,150 0,000 1,162
36 - 40 ans Réf Réf
Genre
Femme -,558 0,000 ,572 -1,359 0,000 ,257
Homme Réf Réf
Milieu de résidence
Rural ,148 ,000 1,159 ,832 0,000 2,297
Urbain Réf Réf
Statut matrimonial
Marié -,534 0,000 ,587 -,311 0,000 ,733
Célibataire -,658 0,000 ,518 -,386 0,000 ,680
Divorcé(e)/Séparé(e) ,899 0,000 2,458 ,098 ,000 1,103
Veuf Réf Réf
Niveau d’instruction
Aucun -1,641 0,000 ,194 -1,070 0,000 ,343
Primaire -1,396 0,000 ,247 -,127 ,000 ,881
Secondaire -,740 0,000 ,477 -,240 ,000 ,786
Supérieur Réf Réf
Niveau d’instruction du chef de ménage
Aucun -,377 0,000 ,686 -,493 0,000 ,611
Primaire -,587 0,000 ,556 -,477 0,000 ,620
Secondaire -,347 ,000 ,707 -,076 ,000 ,927
Supérieur Réf Réf
Tranche de revenu du ménage
0 - 25 000 FCFA -3,441 0,000 ,032 ,877 0,000 2,403
25 000 - 50 000 FCFA -1,430 0,000 ,239 ,539 0,000 1,715
50 000 - 75 000 FCFA -1,471 0,000 ,230 ,190 0,000 1,209
75 000 - 100 000 FCFA -,513 0,000 ,599 ,034 ,000 1,035
Plus de 100 000 FCFA Réf Réf
Nombre d'observation
Log-vraisemblance
R2 de McFaden
InactifVariables
5 860 771
6236546,745
0,31
β βSignif. Exp(β) Signif. Exp(β)
Chômeur
Copyright @ 2024 | ONEF .